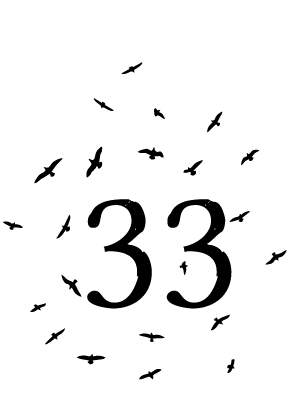
8 juin 1951, sur la route menant à la fondation, 20 h
— Louise ! s’écria Isabeau, au volant de l’Aston. Louise Duval ?
— Je réfléchis si nous en connaissons une autre, taquina Évariste.
— Louise l’alcoolique ?
— Savez-vous pourquoi cette femme a la manie de se parfumer si fort alors qu’elle n’est par ailleurs pas coquette, et pourquoi elle se badigeonne les mains de crème hydratante au moins de s’irriter ?
— Eh bien je… Peut-être qu’elle aime ça ?
— Le parfum capiteux qu’elle porte, c’est la première chose qu’on remarque chez elle. Les effluves saturés de patchouli accaparent l’odorat, et, de fait, le détournent d’une chose qu’elle ne peut feindre.
— Laquelle ?
— Elle ne sent pas l’alcool. Avez-vous déjà rencontré un alcoolique notoire ne sentant pas l’alcool ? Eux pensent qu’il suffit de manger telle ou telle substance pour que cela passe inaperçu, mais en réalité l’haleine et les pores ne mentent jamais. Quand une personne est alcoolique au point que nous a fait croire Louise, tout sur sa personne sent ce qu’elle boit. Mais en réalité, Louise n’est pas alcoolique et ne l’a jamais été. Pour que son entourage ne finisse pas par remarquer cette contradiction, elle a pris l’habitude de se parfumer à outrance, de sorte qu’on pense que toute autre odeur ne pourrait perdurer. J’ai d’abord mis ça sur le compte d’un problème de confiance en soi. Louise est une femme qui vieillit, elle a perdu son éclat et sa beauté et elle n’exerce plus les fonctions techniques et médicales qui avaient jadis fait sa fierté. Elle aurait pu feindre une pathologie addictive pour susciter la pitié de son entourage, une façon d’être vue et plainte.
— Qui aime faire pitié ?
— Quelqu’un qui pense ne pas pouvoir susciter d’autres sentiments. Pour certains, la pitié reste plus tolérable que l’indifférence.
— Quand bien même elle aurait simulé son alcoolisme, cela ne fait pas d’elle un monstre sanguinaire.
— Non, en effet. Par contre, le fait qu’elle ait participé à des expériences médicales à Struthof en ne cachant pas son admiration pour le champ d’étude des médecins de mort a tendance à la rendre un tantinet suspecte.
— C’est là que j’ai du mal. J’ai lu ce journal, pas aussi précisément que vous, mais je n’arrive pas à comprendre ce qui vous fait dire que le narrateur est une femme, et qu’il s’agit de Louise.
— Pourtant vous auriez dû remarquer deux détails importants. Le premier est qu’aucune lettre ne fait mention du genre de celui qui raconte. Quand il s’agit d’un journal dans lequel on confie ses pensées, particulièrement dans un contexte aussi dur et traumatisant que celui-là, il faut de la discipline pour éviter tous les accords de genre. C’est un véritable exercice de style imposé, car un témoignage met en avant une émotion, grâce à l’emploi du« je » souvent au centre de la narration. Dans notre cas, à aucun moment le narrateur ne dévoile son genre, il évite soigneusement d’employer la première personne et de décrire ses émotions. Pourquoi ? Pourquoi s’imposer une technique stylistique contraignante quand le but affiché de la rédaction est de témoigner pour ne pas perdre la raison ?
» Et puis il y a cet autre détail que je n’ai vu qu’aujourd’hui. Au milieu de toutes les tortures, des conditions de vie horribles, de la famine, des deuils, l’auteur n’insiste vraiment que sur une seule conséquence de ses mauvais traitements : ses mains. Le narrateur fait une fixation sur les crevasses et les gerçures qui maculent ses doigts. Il aurait pu parler de toutes les autres marques de son incarcération, ce n’était pas ce qui manquait, mais ses mains sont essentielles pour lui. Cette obsession de l’hydratation des mains ne vous rappelle-t-elle rien ? L’attitude compulsive de Louise avec sa crème hydratante, que nous avons prise pour la manifestation d’une extrême nervosité.
» Et alors les paroles d’Armand – celles qui m’obsèdent depuis qu’il les a dites – me sont revenues en mémoire : tout est à l’envers, ce qui est droit est tordu, ce qui est blanc est noir, et le Bien fait le Mal. Depuis le début, il nous donne la solution. Rien de ce que nous voyons ne doit être compris dans le bon sens, et tout doit s’inverser. Parce qu’il s’agit d’un camp de mort et que l’auteur décrit la vie de prisonnier, le cerveau, par facilité de raisonnement, en conclut que le narrateur l’est aussi. Mais en réalité, il s’agit d’une femme. Et cela corrobore son positionnement. Celui qui écrit n’est jamais avec les autres prisonniers. Il observe de loin, il n’a aucune interaction avec eux pour la simple raison qu’elle ne vivait pas avec eux dans le baraquement 9, elle se contentait de les observer à l’occasion des expériences médicales auxquelles elle a collaboré. Pour elle, ces hommes étaient comme des souris de laboratoire qu’elle étudiait dans leur habitat. Ce journal n’est pas un témoignage, mais plus le compte-rendu d’un scientifique qui analyse le comportement d’une espèce dans son microcosme.
— Je n’en reviens pas, souffla Isabeau, Louise… Elle est très très forte.
— Et dangereuse, aussi. Il va falloir nous montrer prudents, mon ami. Le véritable visage du Mal n’est pas celui de Jacques Charlier, mais bien celui de Louise.
— Et cette lettre ? Pourquoi l’a-t-elle envoyée ? Vous ne l’avez pas ouverte, mais peut-être qu’elle contenait des informations dont on aurait pu se servir pour la débusquer.
— Louise est une mystificatrice. En réalité, et quoi qu’elle en pense, sa raison de vivre tient plus en sa capacité à abuser des gens qu’en celle de mener des expériences scientifiques. Tout ça n’est qu’un prétexte pour montrer au monde qu’elle peut jouer avec lui sans qu’il ne se rende compte. Car le but ultime de Louise est de jouer à être Dieu. Tendre la main, construire des vies, les détruire, les reconstruire et les redétruire. Mais que serait la beauté de son œuvre, si elle ne peut la partager avec personne ? C’est pourquoi elle se sert de moi parce qu’elle s’imagine que je suis assez digne de son intelligence pour saisir la complexité de son plan. Sa dernière lettre n’est sans nul doute qu’un ramassis de« regardez comme je suis brillante ! Regardez comme je me suis jouée de vous ! J’ai gagné, je suis la plus forte ».
Isabeau tordit sa bouche en une moue dubitative.
— Faut dire que jusque-là, elle n’a pas complètement tort.
— Dans quel camp êtes-vous, mon ami ? Allons, nous avons encore de quoi déjouer ses plans.
— Quels plans ?
— On sait que Charlier et elle se sont servis d’enfants pour les transformer en bombes à retardement. Ils ont commencé sur des adolescents comme Armand, et ils ont fait des tests en conditions réelles sur des adultes comme votre suicidé.
— Ce n’est pas mon suicidé.
— Un peu, si, et je ne me souviens pas de son nom. Peu importe. Ce qu’Armand a essayé de nous dire avec ses mots, c’est que leur but est de pervertir ce qu’il y a de plus innocent – les enfants – et de les retourner pour en faire des créatures maléfiques. Vous voyez où je veux en venir ? Quelle serait la pire chose que ces jolies têtes blondes pourraient faire et qui resterait dans l’histoire de toute une région, voire d’un pays ?
Les mains d’Isabeau se crispèrent sur le volant.
— La plupart des patients ne restent pas à la fondation…, marmonna-t-il.
— Oui, et donc ?
— Donc, à un moment, ils rentrent chez eux…
— J’aime tellement vous tirer les vers du nez, mon ami.
— Ils vont les faire s’en prendre à leurs familles ? lâcha Isabeau, horrifié. Non !
— Si j’étais un monstre qui veut prouver que rien n’échappe à ma volonté de contrôle, c’est ce que je ferais. Je montrerais au monde qu’il n’est à l’abri nulle part et que je peux l’atteindre à tout moment, au moyen d’individus auxquels personne ne penserait.
Isabeau appuya brusquement sur la pédale d’accélérateur.
— Quand je parlais des risques du métier, je ne pensais pas aux accidents de la route, observa Évariste en se retenant à la poignée de la portière.
— Je gère, répliqua Isabeau, les mâchoires serrées. Il faut se procurer la liste des cobayes et prévenir les familles. Nous sommes vendredi soir, ils ont dû repartir chez eux pour le week-end !
— Quelle excellente suggestion, mon ami, je n’y avais pas pensée avant.
L’Aston Martin dut faire appel à toutes ses ressources de grande sportive pour encaisser la vitesse avec laquelle Isabeau prit le virage qui menait à la fondation Sorel. Pilant sur le parking, il sortit du véhicule nimbé d’un nuage de poussière et de gravillons projetés par les roues du véhicule. Quand Évariste descendit à son tour, son visage avait perdu toutes ses couleurs, et il prit une seconde pour apprécier la position debout ainsi que le fait d’être toujours en vie.
— Dépêchez-vous ! s’écria Isabeau tandis qu’il s’élançait à grandes enjambées en direction de l’entrée.
— J’ai créé un monstre.
Il n’y avait plus personne dans le hall d’entrée de la fondation. À la fin de la semaine, même les travailleurs acharnés jetaient l’éponge et préféraient la décadence banale d’une vie de famille à la foi en la sainte économique. Mais à l’étage des bureaux et de la direction, les couloirs étaient encore allumés. Isabeau sortit un couteau de sa poche et fendit la bâche qui avait été apposée sur la vitre qu’il avait brisée quelques jours auparavant. Ils gravirent les marches du grand escalier et filèrent droit au QG de la direction. Des bruits de voix leur confirmèrent que les lieux étaient encore occupés en ce début de soirée. Évariste ouvrit la porte de l’antichambre du grand bureau de Sorel. Les deux secrétaires, immuablement vissées à leur chaise, leurs doigts frappant les machines à écrire avec la mécanique d’un automate, avaient déserté le décor, tout comme Charlier qui – et Isabeau n’en comprenait la raison que maintenant – passait tout son temps dans cette place forte.
Derrière le mur, deux voix se mélangeaient de façon étouffée. Évariste ne prit pas la peine de frapper et entra. Les visages de René Barbier et Marcel Sorel affichèrent un mélange détonant et grimaçant qui mêlait surprise, consternation et colère. Le colosse Barbier bondit hors de son siège en vociférant :
— Vous ! Comment osez-vous débarquer ici ?
Se précipitant sur Évariste, les bras menaçants et tendus en direction du cou de l’enquêteur, Barbier fut stoppé dans son élan par Isabeau. Le jeune homme se saisit du poignet de René et le tordit en une clef efficace pour lui retourner le bras dans le dos et obliger son corps à se plier en deux et à rester dans cette position un petit moment.
— C’est nouveau, ça ? observa Évariste avec une pointe d’admiration.
— Je n’avais pas encore eu l’occasion de mettre en pratique mes dernières leçons.
— Ce maître d’armes est un grand pédagogue.
— Ce serait quand même plus facile s’il parlait français.
— Je peux savoir ce que vous fabriquez ici ? coupa Sorel, dont les veines apparentes du front menaçaient de se rompre.
— Nous vous sauvons probablement la vie, pour peu que votre entêtement ne fasse pas tout rater, répliqua l’enquêteur d’une voix sèche et autoritaire.
— Pardon ?
— Où gardez-vous les dossiers des enfants que vous traitez ici ? Je parle de ceux sur lesquels vous fondez toutes vos ambitions en testant des techniques de manipulation mentale. Ceux du fameux sous-sol.
— Non mais de quoi parlez-vous ? grogna René, le nez planté sur le plateau du grand bureau.
— Écoutez, nous n’avons pas le temps d’échanger des politesses. Nous savons ce que vous faites au sous-sol, d’ailleurs sans doute bien plus précisément que vous. Les chaises, les drogues, les seringues. Donnez-nous la liste des cobayes qui sont parqués dans cette salle de torture.
— Alors c’était bien vous le cambriolage ! tonna René.
— Attendez, messieurs, vous en parlez comme si nous étions des monstres, ce n’est pas ce que vous croyez, se défendit Sorel. Il ne s’agit pas de science de manipulation mentale, comme vous dites. Nous avons certes repris quelques travaux de médecins nazis, mais jamais nous n’aurions utilisé les mêmes méthodes. Nous travaillons sur l’épigénétique, un champ d’étude tout nouveau destiné à influer sur l’évolution de la génétique sur plusieurs générations. Nous pensons que nous pouvons altérer les mécanismes de modification de l’expression des gènes en induisant des réactions biologiques sur des patients.
— Je sais ce qu’est l’épigénétique, j’ai suivi les travaux de Waddington en la matière, répliqua Évariste avec froideur.
Ah bah pas moi, pensa Isabeau avec une certaine frustration.
— Vous jouez aux apprentis sorciers en espérant que des traits induits peuvent être acquis et transmis d’une génération sur l’autre. La quête du contrôle de l’adaptation de l’espèce à son environnement par l’étude de la biologie du développement n’est pas nouvelle. Et pour vos expériences, il vous faut des cobayes de plus en plus jeunes. Ce que j’aimerais comprendre, c’est le but de tout ça. Qu’espérez-vous améliorer dans le fonctionnement et l’activité des gènes de vos congénères, pour prendre autant de risques ?
Sorel soupira avec douleur.
— C’est pour les rendre plus forts psychologiquement, confia-t-il d’une voix plus ténue. Pour que plus jamais ils ne se laissent abuser par des tyrans tels qu’Hitler, pour que leur libre arbitre soit plus affûté et plus performant. Nous œuvrons pour le futur, afin de rendre les générations à venir plus intelligentes et plus réactives. Nous avons déjà vécu deux guerres mondiales qui ont failli emporter notre civilisation, il est temps que l’Homme mette sa survie au centre de ses préoccupations, vous ne pensez pas ?
— Vous êtes d’une stupidité sans bornes. L’épigénétique ne parle pas de morale, d’éthique ou du sens du Bien et du Mal. La psychologie émotionnelle d’un individu n’est pas uniquement inscrite dans ses gènes. Elle est le produit de l’environnement dans lequel il évolue et des expériences qu’il accumule tout au long de sa vie. Le sens du devoir, l’ambition, la bienveillance ne sont pas qu’une donnée strictement biologique qu’on peut remonter comme le mécanisme d’une montre.
— Eh bien, moi, je crois que vous avez tort ! L’être humain peut se résumer à un génotype, et on peut l’influencer pour commander une réaction précise à un stimulus.
— Laissez-moi deviner, vous avez convaincu l’Église de mettre de l’argent dans le projet en lui faisant croire qu’on pourrait rendre les générations futures plus perméables à la spiritualité ? C’est ce fameux sujet qui divise depuis le début les laïcs et les religieux, n’est-ce pas ?
— Si nos espoirs poursuivent des buts différents, cela n’empêche pas de collaborer, justifia Sorel sans grande conviction.
— Mais expliquez-moi, vos futures machines génétiques bien programmées auront-elles le choix de leur Dieu, ou leur aurez-vous implanté l’image d’une chrétienté toute-puissante ? Comment pouvez-vous avoir la prétention de savoir ce qui serait susceptible de rendre meilleur un être humain ? Qui vous donne le droit de définir l’avenir de l’humanité ?
— La douleur de la perte d’un enfant pour une guerre stupide et stérile, répliqua Sorel sans desserrer les dents.
— Votre autocentrisme a ouvert la porte à des monstres encore plus dangereux que vous, et pendant que vous jouez à créer un genre humain conforme à votre morale et à votre vision du futur, deux Bêtes ont torturé des enfants pour les transformer en bombes qu’ils actionnent selon leur bon vouloir.
— De quoi parlez-vous ? demanda René, soudain vidé de toute agressivité, ce qui mit fin à son immobilisation.
— Jacques Charlier et Louise Duval se sont servis de vos infrastructures et de certains de vos médecins pour détourner vos recherches et étudier les expériences de manipulations psychologiques. Et croyez-moi, le lavage de cerveau et la reprogrammation neurologique sont bien plus rapides et efficaces que l’épigénétique.
— Charlier l’handicapé, et Duval l’alcoolique ? se moqua Barbier sans cacher son mépris. Allons, et pourquoi pas le père Noël tant que vous y êtes.
— Je pense que vous trouverez intéressant de savoir que la femme qui s’est présentée à vous comme une amie de votre fils, celle qui vous a sans doute parlé la première des expériences liées aux théories de l’évolution biologique, celle qui vous a probablement donné le nom de quelques investisseurs tels qu’Henri Stein, est en réalité en partie responsable de la mort d’Albert.
Il y eut un blanc. Le sang de Sorel quitta brusquement sa tête pour s’effondrer dans ses membres inférieurs.
— Qu… Quoi ? bafouilla-t-il, la voix brisée.
— Elle faisait partie des prisonniers du camp de Struthof, mais, comme parfois certains membres du personnel médical, elle a négocié ses compétences auprès des nazis. C’est là qu’elle a découvert les expériences médicales menées dans ce camp et qui sont responsables de la mort de votre fils. Une vraie révélation pour cette grande comédienne sans doute frustrée de ne pas avoir pu exploiter ses connaissances scientifiques au cours d’une carrière limitée par son sexe.
Sorel se plongea dans ses souvenirs. Il se remémorait les premières discussions avec cette femme fragile dont le parcours ressemblait à celui de son fils, une femme brillante qui était sortie triomphante des camps et en avait fait une force. Une femme pleine d’idées novatrices pour sauver les générations futures de ce genre de drame historique. Le regard du directeur vibrant d’incompréhension déroulait dans le vide chaque moment depuis qu’il l’avait rencontrée. L’énergie de Louise, sa foi, et puis sa fragilité, la progression de son alcoolisme. Combien de fois avait-il plaidé sa cause auprès de ses collaborateurs qui se plaignaient de son attitude ? Après tout, elle avait en partie été à l’origine de la création de la fondation, il se sentait un devoir de la soutenir quoi qu’il arrive. Si son fils avait été dans la même situation, il ne l’aurait pas abandonné.
Et tout ça n’était qu’un voile de fumée qu’elle lui avait soufflé dans la figure pour l’empêcher de voir son vrai visage.
— Je… Ce n’est pas possible, je ne peux pas le croire, balbutia Marcel en fixant Barbier et Fauconnier d’un air incrédule.
— Il va falloir me croire sur parole, parce que d’ici très peu de temps cette femme sera à l’origine d’un drame sans précédent.
— De quoi parlez-vous ? demanda René. Quel drame ?
— Le but de Louise est de frapper les esprits pour montrer au monde la puissance de son intelligence. Votre sous-sol est plein d’enfants que vous destiniez à vos études sur l’évolution de l’information biologique et qu’elle a transformés en bombes. Si nous n’intervenons pas rapidement, ces cobayes programmés pour détruire ce qu’ils ont de plus cher vont attaquer leurs familles. Donnez-nous la liste de ces enfants, maintenant !
Un blanc attesta du choc de la révélation.
— Mais bon Dieu, vous allez vous remuer ! s’écria Isabeau. Au point où vous en êtes, que risquez-vous, si ce n’est qu’une fausse alerte ? Donnez-nous cette satanée liste, que nous prévenions les autorités afin qu’elles se rendent au domicile des familles, ou je vous jure que je vous balance par la fenêtre de votre bureau !
Évariste jeta à Isabeau un œil brillant de malice et d’une pointe de fierté.
— D’accord, d’accord, céda Sorel.
— Marcel ! tenta de le retenir Barbier.
— Ça suffit ! Imagine une seule seconde que ce qu’ils disent soit vrai ? Nous serions complices de torture sur enfants. J’ai toujours couvert les méthodes brutales du père Martin parce que je pensais qu’elles étaient efficaces, mais jamais je n’aurais accepté qu’on détruise l’esprit d’un enfant pour en faire une machine de mort. Suivez-moi, les dossiers du projet Conséquences sont chez mademoiselle Lavoisier.
Les quatre hommes sortirent et filèrent droit dans le bureau de l’ancienne responsable administrative. Une fois dans la pièce où s’entassaient des cartons qui attestaient un changement de propriétaire, Sorel ouvrit un grand placard fonctionnel et commença à fouiller dans des dossiers suspendus. Évariste contourna le bureau aux trois quarts vide et ouvrit plusieurs tiroirs où restaient quelques souvenirs de l’ancienne occupante.
— Sauf cas très particulier ou demande de la famille, nous ne gardons aucun enfant le week-end à la fondation, déclara Sorel en sortant une quinzaine de pochettes cartonnées. Voilà, tous les enfants sélectionnés pour le programme sont là.
Alors qu’il était focalisé sur le contenu d’un des tiroirs du bureau, les traits du visage d’Évariste se crispèrent. Il passa ses doigts sur un beau stylo laqué, une médaille de naissance, ainsi qu’une vieille photo floue et jaunie.
— Voilà le lien… le lien… comment… comment…, marmonna-t-il comme si plus rien autour n’existait.
— Évariste ? interpella Isabeau, habitué à ramener l’attention de son mentor dans l’instant présent.
— C’est tout, vous êtes sûr ? demanda l’enquêteur en reprenant pied dans la réalité et en glissant la photo dans sa poche.
— Oui, c’est certain.
— Isabeau, c’est le moment de vous rappeler au bon souvenir du chef de la police de Neuchâtel.
Le jeune homme composa le numéro que lui avait donné l’un des policiers l’ayant auditionné et qui l’avait invité à l’appeler à toute heure du jour ou de la nuit. Quand Isabeau obtint le bon interlocuteur, il donna le nom et l’adresse de chacun des quinze enfants figurant sur les dossiers de la fondation. S’étant montré très convaincant dans la journée – ou du moins ayant efficacement soutenu l’exposé de Joras –, Isabeau n’eut pas besoin de justifier ses informations pour que la personne à l’autre bout du téléphone lui confirme envoyer des agents dans chacune des résidences des familles des patients ainsi listés. Quand le jeune homme raccrocha, le bureau fut frappé d’un silence solennel et culpabilisant digne d’un prétoire.
— L’un de vous deux a-t-il une arme ? demanda Évariste sur un ton d’une banalité assez peu adaptée à la question.
— Pardon ? s’étonna Sorel.
— Oui, répondit Barbier.
— Bien, allons la chercher. Je pense que Louise est dans les locaux et qu’elle prépare sa grande sortie de scène. Il faut la trouver.
— Allons dans mon bureau, indiqua Barbier en sortant dans le couloir.
Une détonation retentit. La tête de René fut projetée en arrière en expulsant un jet de sang puissant comme la queue d’une comète. Son corps brutalement privé de la tonicité de la vie s’effondra au sol, tandis que son crâne en partie pulvérisé laissait échapper son contenu sur la moquette molletonnée.
— Oh mon Dieu ! s’épouvanta Marcel. René !
Isabeau dégaina son pistolet, et, avec la plus grande prudence, jeta un coup d’œil dans le couloir. Il fit signe que la voie était dégagée.
— C’est elle, annonça Évariste d’une voix grave. Elle met un point final à son plan. Il faut sortir d’ici.
Les trois hommes enjambèrent la dépouille de René et se dirigèrent prudemment vers l’escalier. Une très forte odeur de fumée frappa leurs narines. Ils n’eurent pas besoin de parler, leurs regards leur suffirent pour se mettre d’accord sur un fait précis : le feu venait de s’inviter à la soirée.
— Elle… Elle aurait décidé de brûler la fondation ? hallucina Sorel, dont l’expression se transforma en un masque de profond désarroi.
— Pourquoi la garder quand elle n’en a plus besoin, répondit Évariste. Essayons de voir si nous pouvons sortir par le hall.
Quand ils atteignirent le haut des escaliers, la vision que leur offrit le rez-de-chaussée leur évoqua ces peintures mettant en scène l’un des cercles de l’enfer, celui qui ne lésinait pas sur les effets pyrotechniques. Les immenses tapis protégeant le marbre et le parquet du sol gavaient les flammes d’une nourriture facile et riche, tout comme les tentures, les coussins, les nappes, comme si l’architecte avait signé un pacte avec le diable afin de lui faciliter la récolte. Le feu se répandait à une vitesse fulgurante, car rien ne lui barrait la route.
Sous l’assaut des volutes empoisonnées exhalées par le brasier, les trois hommes commencèrent à tousser.
— Comment va-t-on sortir de là ? s’inquiéta Sorel avec une profonde angoisse.
— Le fait que ce soit vous qui posiez la question n’augure rien de bon, nota Évariste en sortant un mouchoir de sa poche pour le nouer devant son visage tout en indiquant aux autres de faire pareil. Y a-t-il un escalier de service ?
— Oui, là-bas !
Évariste, Isabeau et Marcel s’élancèrent du côté opposé au hall. Ils ouvrirent une petite porte débouchant sur un escalier étroit au sol et aux murs simplement bétonnés. Dévalant les marches quatre à quatre, le groupe se retrouva au niveau du rez-de-chaussée en un temps record.
— Y a-t-il une sortie à l’arrière du bâtiment ?
— Oui, mais je ne suis pas certain qu’elle soit ouverte, et je n’ai pas les clefs. Ce sont les gardiens qui les ont.
— Et ils brillent par leur absence, commenta Évariste.
— On les a licenciés en raison de leur incompétence, nous devions recevoir les nouveaux candidats lundi.
— Excellente idée, mon cher. Il n’y aura plus rien à garder d’ici là, mais ils étaient effectivement incompétents.
— Je propose qu’une fois devant la sortie, on la défonce, trancha Isabeau en ouvrant la voie.
Lorsqu’ils furent face à la porte de sortie de secours barrée d’une tige de fer servant de poignée et qu’Isabeau put l’ouvrir d’un coup d’épaule, le soulagement et l’espoir gonflèrent leurs poitrines. Mais à peine le jeune homme eut-il mis un pied à l’extérieur que des coups de feu retentirent, l’obligeant à une stratégie de repli.
— Elle commence à bien me courir, la fausse alcoolique ! ragea-t-il.
— Elle a réfléchi à ce plan depuis des années, rien ne lui échappe dans cette fondation. Nous sommes sur son territoire, mon ami.
Isabeau grogna de colère, et son regard jeta des éclairs. Il n’était pas du genre à craindre le danger ni à renoncer en cas de difficultés. L’inaction le rendait fou. S’armant de son pistolet, il entrouvrit la porte et tenta de déceler du mouvement dans le jardin à peine éclairé à l’arrière du bâtiment. Quelques secondes plus tard, alors que son champ de vision ne lui donnait aucune information exploitable, Isabeau entendit une nouvelle détonation, et un éclat de bois frôla sa joue quand la balle se ficha dans la porte, non loin de son visage. Il riposta immédiatement, mais tirer sans avoir de cible avait statistiquement peu de chances de produire un résultat exploitable.
— Nom de Dieu, je n’arrive pas à la voir ! vociféra le jeune homme alors qu’une nouvelle balle sifflait dans les airs pour finir sa course dans l’un des gonds, qu’elle pulvérisa à l’impact.
— À l’abri, mon ami ! ordonna Évariste sans cacher son inquiétude à voir ainsi son assistant exposer sa tête aux tirs ennemis. Un héros mort ne sert à rien. Tâchons de trouver une autre sortie qu’elle n’aura pas le temps d’atteindre avant nous.
Isabeau et lui interrogèrent Sorel du regard ; le directeur de la fondation commençait à ressembler à une écrevisse cuite.
— Je… Je ne vois pas…, bafouilla-t-il entre deux toux douloureuses.
— Merci, vous nous aidez beaucoup. Isabeau, concentrez-vous, vous avez aussi vu les plans du bâtiment, et je suis sûr que vous les avez retenus comme personne. Réfléchissez, il doit bien y avoir une autre sortie qu’on peut rapidement atteindre avant que tout commence à s’écrouler ici.
Isabeau focalisa son attention sur le souvenir des images des plans du bâtiment. Entre la fumée suffocante, le manque d’options, et les toux réunies des trois hommes qui entraient en résonance, il éprouvait beaucoup de difficultés à réfléchir.
— Tout va bien, mon ami, rassura Évariste de sa voix hypnotique, vous allez y arriver.
Une lumière de bon augure finit par illuminer les traits du jeune homme :
— Sur la gauche, là-bas, le réfectoire a une ouverture sur une minuscule terrasse. De mémoire, elle est composée d’une baie vitrée.
— Vous n’allez jamais au réfectoire ? tacla Évariste.
— Heu… bah non, bafouilla Marcel, l’air aussi penaud que dégoulinant de sueur.
— Allons-y !
Les trois hommes revinrent sur leurs pas, frôlant dangereusement le hall dévoré par les flammes qui, à présent, remontaient le long des poutres pour se déployer dans les étages supérieurs comme les immenses branches d’un arbre. Une double porte rouge foncé sur laquelle était inscrit le mot« réfectoire » redonna de l’espoir aux prisonniers. Mais la susceptibilité de l’espoir avait fait sa réputation et n’avait pas arrangé ses rapports avec le genre humain.
Un craquement lugubre et assourdissant saisit d’effroi Isabeau, Évariste et Marcel Sorel. Regardant tout autour d’eux, aucun ne pouvait déterminer la raison d’un tel son, mais tous étaient convaincus qu’ils n’avaient pas rêvé. Soudain, une grande quantité de matériaux, bois, plâtre, tapisserie et morceaux de moellons, dégringola du plafond et s’écrasa au sol avec tant de puissance que l’impact projeta les trois hommes en arrière. Ajoutées à la fumée des flammes, les particules de poussière épaisses rendaient l’air à peine respirable. Toute la partie du couloir débouchant sur le réfectoire croulait à présent sous une tonne de gravats.
— On ne… va… jamais… s’en sortir, se lamenta Sorel en crachant ses poumons.
— Avons-nous déjà été dans une situation pire que celle-ci ? demanda Évariste à Isabeau.
— Pas que je sache. Voilà donc qui est fait.
Fauconnier observa le jeune homme, tout en le gratifiant d’un sourire tendre.
— Je suis navré, mon ami.
— Ne le soyez pas. D’abord, ça me fait un peu peur, ensuite, je n’aurais pas voulu être ailleurs.
— Je… Je suis tellement désolé, intervint Sorel, ce qui ne manqua pas d’interpeller ses deux interlocuteurs, qui visiblement l’avaient un peu oublié.
La fumée noire et funeste avait envahi tout l’espace en étendant son voile opaque dans les couloirs. Les flammes rampantes et grouillantes diffusaient une lumière à la fois vive et lugubre. Leur crépitement à chacune de leurs morsures rappelait à qui les entendait que la gueule de l’enfer s’ouvrait sous leurs pieds.
Sorel fut le premier à s’écrouler au sol et à perdre connaissance. Évariste tenta de le ranimer, mais sans grand succès. Le nez collé au plus près du plancher pour minimiser la quantité de fumée qu’ils inhalaient, le couple d’enquêteurs se trouvait à court d’idées.
Les rideaux de feu qui les encerclaient tel le décor d’un horrible théâtre se déformèrent brusquement en ondulant comme la surface d’une eau troublée par le jet d’une pierre. Un bruit de moteur et de verre qui éclate retentit au milieu de l’apocalypse. Une ombre noire tacha la robe dorée et orangée de l’incendie et sembla en arracher des pans entiers. Il fallut plusieurs secondes à Isabeau et Évariste pour comprendre qu’une voiture venait de défoncer l’entrée de la fondation en traversant les flammes. Isabeau se mit à agiter les bras avec toute l’énergie qu’il lui restait et poussa un cri de rage et d’espoir. La voiture tourna dans leur direction en défonçant tout ce qui se trouvait sur son passage en partie rongé par le feu. Quand le véhicule parvint à la hauteur des trois hommes, le conducteur ouvrit la portière et en sortit aussi vite que possible.
— Georges ! s’écria Évariste en traînant Sorel pour le jeter sur la banquette arrière.
— Je craignais que vous soyez en retard pour votre thé de 21 heures, monsieur.
Quand ils furent tous dans la voiture, Georges opéra un demi-tour digne d’un pilote de Formule 1 et sortit en trombe du bâtiment dans un crissement de pneus, en partie fondus par la chaleur. Le majordome ne stoppa la voiture qu’à la sortie de la forêt.
— Est-ce que tout le monde va bien ? s’enquit-il.
— Je crois que nous allons nous en remettre, mais il faudrait s’en assurer auprès d’un professionnel, répondit Évariste en retirant son chapeau et en passant la main dans ses cheveux.
— Merci mon Dieu, ce n’était pas l’Aston Martin, souffla Isabeau en basculant la tête en arrière pour reprendre de l’air.