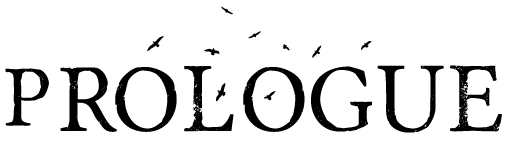
23 avril 1951, 14 rue La-Fontaine, Paris 16e
Quand Ambroise Perrin passa le porche menant à l’entrée du Castel Béranger, rue La Fontaine dans le seizième arrondissement de Paris, il fut convaincu de deux choses : il haïssait le thé, et il allait mettre fin à ses jours.
Non pas que les deux affirmations fussent liées – encore qu’en poussant un peu – mais, dès lors qu’il avait aperçu les façades du célèbre immeuble, elles lui étaient venues simultanément à l’esprit. Comme une évidence.
Si vous pouvez baptiser un bâtiment, c’est que son prix d’achat est indécent. Ambroise était un chanceux, il avait saisi toutes les opportunités placées sur son chemin, gravi chaque étape de la réussite, et la guerre ne l’avait ni tué ni ruiné. Un vrai chanceux. Sa famille pouvait donc se permettre d’occuper le dernier étage de l’hôtel particulier depuis presque deux décennies.
À peine s’était-il approché du fameux vestibule qui avait en partie permis à l’immeuble de remporter le prix de la plus belle façade en 1898 qu’un haut-le-cœur frappa Ambroise. Une fois les six étages gravis, voici ce qui l’attendait : beaucoup de thé, beaucoup de vieilles femmes bavardes, beaucoup de chapeaux ridicules, et beaucoup de parfum. De quoi rendre insupportable l’atmosphère de n’importe quel salon de n’importe quelle habitation. Il n’était pas quelqu’un de très mondain, c’était le domaine de son épouse. Cela avait d’ailleurs été l’une des raisons qui l’avaient décidé à l’épouser. Elle faisait ce qu’il détestait : parler avec les gens, enrichir leur réseau, s’assurer d’appuis et se créer sans cesse de nouveaux amis pour renouveler les anciens. Les amitiés ne devaient jamais durer trop longtemps, parce que, comme les denrées alimentaires, elles avaient une date de péremption. Et son choix s’était révélé fort judicieux, car son épouse se montrait d’une redoutable efficacité dans l’exécution de sa mission.
Et parmi les événements que préférait son épouse, les levées de fonds trônaient en bonne place. Le vocable était pompeux. En réalité, pour Ambroise, il s’agissait de réunions d’épouses riches qui souhaitaient donner un peu de sens à une vie caricaturée par l’étiquette sociale. Colette, sa tendre moitié, lui avait pourtant assuré qu’il n’y avait rien de plus efficace que ces réunions pour délier les langues et les commérages. Et dans chaque commérage se trouvait un embryon de révélation qui pouvait toujours servir.
Ambroise referma la porte en verre cerclé de fer forgé du vestibule et jugea que cette levée de fonds-ci était de trop. Flottait dans l’air un mélange bizarre de fleurs séchées et de l’encens que la voisine du premier faisait brûler tous les jours. Il haïssait cette odeur, tout comme il haïssait la musique que le résident du troisième écoutait en continu et qu’on entendait du rez-de-chaussée. Son épouse lui disait qu’il devait être la seule personne au monde à ne pas aimer la musique. D’après elle, tout le monde aimait la musique. Et le thé. Colette disait aussi beaucoup d’âneries.
Dès le palier du premier étage atteint, il apparut à Ambroise que cette existence lui était intolérable. Il prit le temps de réfléchir à sa vie et réalisa qu’il n’avait jamais pu choisir sa propre destinée. Son père avait déterminé sa carrière en lui léguant son entreprise, sa mère l’avait harcelé pour qu’il se marie au plus vite, l’État l’avait envoyé à la guerre, et sa femme lui avait imposé deux enfants. Même l’idée de cet appartement hors de prix lui avait été inspirée par sa famille, comme preuve ostentatoire de leur réussite sociale. Mais lui, qu’avait-il voulu de tout ça ?
Plus il gravissait les marches, plus ses membres lui paraissaient de plomb. Respirait-il plus difficilement ? Il en avait l’impression. Dans cinq ans, il aurait soixante ans, l’âge auquel on peut profiter des fruits de son labeur grâce à quelques rentes lucratives. De ce côté-là, Ambroise n’avait pas chômé. En tant qu’aîné d’une fratrie de huit enfants, on ne lui avait pas laissé le choix de l’oisiveté et de la distraction. Par voie de conséquence, Ambroise ne renvoyait pas l’image de quelqu’un de drôle. Parfois, il s’ennuyait lui-même.
Au troisième étage, il songea que, bien que les détails pratiques lui échappent encore, il n’allait pas laisser de mot d’adieu ou d’excuses. Après tout, le suicide était quelque chose de très personnel. Livrer ses motivations enlevait un peu de solennité et de mystère à l’acte.
Au quatrième, Ambroise se demanda quel moyen conviendrait le mieux pour mettre son projet à exécution. Pourquoi n’y avait-il jamais pensé avant ? D’ordinaire, il prenait garde à être préparé et prévoyant. Peut-être n’avait-il jamais réfléchi au sens de sa vie avec autant de concentration ? Mais aujourd’hui, l’évidence le frappait avec violence et déchirait le voile épais qu’il avait toujours eu devant les yeux. La Vérité ne pouvait être ignorée.
Au cinquième, il décida qu’il se trancherait les veines. Un peu banal, certes, mais avec les classiques, au moins, aucune déception possible. Il ne sentait presque plus l’encens, mais entendait toujours la musique. Tant d’années de vie écoulées, de personnes rencontrées, de morts et de douleurs supportées, et, au bout du compte, une réelle impatience d’en finir.
Planté devant son appartement, au sixième étage, Ambroise changea d’avis. Il avait toujours eu peur des couteaux et autres objets tranchants. Son geste n’aurait donc aucune logique. Quand il entra, une vague de piaillements le rendit presque sourd.
— Bonsoir, mon aimé, lança Colette en apercevant son époux. Nous vous attendions. Désirez-vous une tasse de thé ?
Ambroise posa sa mallette au sol et son pardessus sur la chaise. Il prit une immense inspiration avant de parler de façon plus intelligible qu’il ne l’avait jamais fait.
— Colette, je dois me montrer parfaitement honnête avec vous : j’ai toujours détesté le thé.
Après s’être libéré de ce grand poids, Ambroise traversa le salon, ouvrit la fenêtre et sauta.