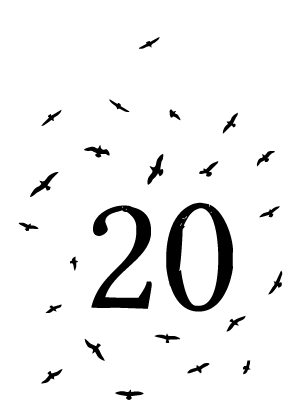
3 juin 1951, Neuchâtel, fondation Sorel, 20 h 30
À travers la longue fenêtre, le vent fort remuait les branches des arbres en créant des ondulations pareilles au roulis des vagues. Le soleil chutait vers l’horizon et la nature avertissait que, dès la nuit tombée, les bourrasques laisseraient place à la pluie.
Lové au cœur des bois, le bâtiment de la fondation Sorel subissait plus qu’aucune autre structure les humeurs changeantes du temps. Quand l’orage grondait, il résonnait entre les troncs, prenait appui sur les feuilles des cimes, et venait claquer contre les murs du bâtiment.
L’équipe de nuit, plus réduite que celle de jour, venait de prendre son service. Seuls quelques administratifs zélés traînaient encore à leur bureau, alors que les heures de visite étaient terminées depuis longtemps. Louise faisait partie de ces retardataires. Assise à son bureau couvert de tout un tas d’objets tels que des dossiers, des livres, un chapelet, pas moins de trois encriers et quatre petits pots en terre contenant de drôles de cactus poussant en dépit du bon sens, elle collait des étiquettes, l’air absent. Le reste de la pièce n’était guère plus ordonné. Ajoutant un titre à l’encre sur une large pochette en cuir, elle s’apprêtait à mettre un point final à sa longue journée de travail, quand on frappa à sa porte. Elle tressaillit, éclaircit sa voix, et, d’un ton hésitant, indiqua au visiteur d’entrer. Et malgré ses efforts, elle ne put dissimuler la vague d’angoisse qui la submergea quand elle vit Thérèse entrer dans son bureau.
— J’espère ne pas vous déranger, entama la responsable administrative.
— Non, répondit Louise, sur la défensive. Que puis-je faire pour vous ?
Thérèse retira une pile de feuilles d’une chaise afin de pouvoir s’y asseoir.
— En réalité, rien. (Hésitante, elle marqua une pause, avant de reprendre.) Depuis notre dernière réunion, un peu avant la fête à Venise, nous n’avons pas trop eu le temps de parler…
— Oui, répondit Louise, non sans grimacer au souvenir de ce douloureux épisode.
— J’ai réalisé que nous n’avions pas eu l’occasion de parler de cet horrible….
Elle soupira.
— … C’est faux, en fait, je suis venue parce que c’est moi qui ai besoin de vous parler… en toute franchise.
Le sourcil droit de Louise s’arqua, mais elle préféra ne pas commenter, à ce stade.
— Ce n’est pas une démarche facile, confia la femme en gris, mais je me suis rendu compte que mon comportement envers vous était un peu… déplacé.
Cette fois, Louise ne put cacher sa profonde surprise.
— Je ne suis pas en train de dire que je vous apprécie, mais je suis sans doute un peu dure avec vous. Plus qu’avec les autres.
Thérèse marqua une pause et tourna son regard vers toutes les choses entassées un peu partout sur les meubles.
— La rumeur dit que vous avez vécu des événements difficiles durant la guerre et que cela expliquerait votre manque de contrôle. Ce conflit a produit tant de drames. Moi, j’ai toujours vu les épreuves de la vie comme des occasions de devenir plus forte et plus dure. Je ne me suis jamais défilée devant les problèmes et je n’ai jamais fui en…
Elle n’eut pas besoin d’achever sa phrase. N’importe qui aurait compris qu’elle faisait référence à la boisson. Sans aller jusqu’à acquiescer, Louise ne protesta pas non plus.
— Je réalise que tout le monde n’a pas la même force ni la même volonté. Tout ça pour dire que vous vous faites assez de mal toute seule, je n’ai pas besoin d’en rajouter. Je sais que vous désiriez mon poste et que nous étions en compétition.
Louise se raidit sur son siège.
— Je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie, se défendit Thérèse avant même que son interlocutrice n’ouvre la bouche. Je dis ça dans le sens où c’est facile pour moi de vous regarder de haut. Je me trouve à la bonne place.
— En cela, je suis d’accord avec vous.
— Je… J’ai bien conscience de ne pas être une personne très accessible ni même très sympathique. Je ne suis pas sourde, j’entends les messes basses quand je passe dans les couloirs. Mais je ne suis pas mauvaise, c’est juste… c’est juste que je ne sais pas faire. Je ne sais pas être douce, avenante et gentille.
— Eh bien… j’apprécie votre démarche, reconnut Louise sans trop savoir quoi dire d’autre.
— Merci. J’aimerais que nous puissions parvenir à des relations cordiales et de confiance. Je crois que vous et moi, nous nous ressemblons un peu.
— Ah oui ?
— Oui, toutes les deux, nous vivons pour notre travail et n’avons guère d’autres intérêts en dehors. La vie n’a été douce ni pour vous, ni pour moi. Si nous comparions nos vies sociales, je suis persuadée que nous trouverions quelques points communs.
— Sans doute.
Thérèse se détendit autant que sa nature rectiligne pouvait le lui permettre. Elle croisa les jambes et cala son dos contre le dossier de la chaise. Dans cette posture, elle avait presque l’air à l’aise.
— Nous sommes soumises à tant de pression, ils ne se rendent pas compte, là-haut, poursuivit-elle, les yeux perdus en direction de la fenêtre. Ils ordonnent, ils exigent sans savoir si c’est possible et les efforts que cela nous demande. Alors nous nous efforçons de les satisfaire, nous suons sang et eau, et pour quelle reconnaissance ? Une petite tape dans le dos, comme on fait avec un bon chien. N’est-ce pas injuste, Louise, que ce soit toujours des hommes qui se trouvent au sommet des pyramides et le corps des femmes qui serve de fondations ?
— Si, je suppose.
— Eh bien, je vais vous confier mon sentiment, parce que je sais que vous, vous ne me jugerez pas. Je suis convaincue que c’est notre faute, à nous les femmes. Nous mettons au monde les hommes, nous les nourrissons avec notre propre lait, nous nettoyons leurs excréments, nous les éduquons, pansons leurs blessures et séchons leurs larmes. C’est nous qui faisons d’eux des petits garçons capricieux habitués à exiger et à obtenir. Et après, ils ne font que grandir, mais leur cœur reste le même : froid, autocentré, et sec.
— Il faudrait donc rééduquer les femmes ?
— Absolument. Mais qui décide de leur éducation ? Les hommes. Le serpent qui se mord la queue depuis qu’Adam et Ève se sont fait chasser du paradis. Ne nous pardonneront-ils jamais ce péché originel ? Devons-nous toutes payer pour l’erreur d’une seule femme avec sa satanée pomme de malheur ?
— Je ne suis pas certaine qu’Ève ait commis une erreur. Je crois qu’elle a simplement voulu comprendre le sens de son existence en l’absence d’explication. La soif de connaissance n’est jamais un péché en soi.
— Eh bien, elle a au moins commis l’erreur de se faire prendre, conclut Thérèse, avant de marquer une brève pause et de reprendre sur un autre sujet : Vous savez, c’est étrange, mais ça me fait du bien de vous parler. Je crois que je ne me suis jamais autant confiée à personne. Vous savez écouter, Louise.
— Merci.
— Et je vais vous dire, nous allons fêter cette conversation surréaliste qui a peu de chances de se reproduire.
Elle quitta son siège pour aller s’assurer que la porte du bureau était bien fermée. Elle jeta un regard complice à Louise, laquelle affichait une expression d’incompréhension totale, puis se mit à regarder dans tous les coins du bureau, derrière les meubles et sous les dossiers.
— Mais… que cherchez-vous ?
— Je suis sûre qu’au fond de vous, vous le savez.
S’accroupissant, Thérèse regarda derrière un large meuble dont la forme rappelait celle d’un gros buffet.
— La voilà ! jubila-t-elle en extirpant une bouteille de rhum presque pleine, coincée entre un pied et le mur.
Louise changea de figure.
— Je vous en prie, la rassura Thérèse, je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour lâcher prise. Moi aussi, je veux le faire. Un peu. Vous m’accompagnez, bien sûr.
— Heu… non… non merci. Sans façon.
— Allons, je suis aussi coupable que vous, je ne risque pas de vous dénoncer. Vous n’allez pas me laisser faire n’importe quoi toute seule, n’est-ce pas ? Juste un verre.
La mine de Louise ressembla à celle d’une petite fille docile quand elle ouvrit un des tiroirs de son bureau pour en sortir deux verres. L’action enchanta Thérèse, du moins autant qu’elle pouvait éprouver une forme d’enchantement. L’intendante les servit avec beaucoup de générosité, avant d’avaler d’une traite les trois quarts du liquide. Elle grimaça et ne put réprimer la toux qui suivit.
— Oh, je… Ce que c’est fort, c’est toujours comme ça ?
— Non, on finit par s’habituer. Après, c’est comme de l’eau, répondit Louise d’une voix blanche tout en portant le verre à ses lèvres tremblotantes.
— Eh bien, ça réchauffe. Je vais peut-être en prendre un deuxième… pour voir.
— Vous verrez.
Mais Thérèse et Louise ne s’arrêtèrent pas à deux verres. Ne sachant plus guère de quoi parler, les deux femmes décidèrent d’un commun accord tacite de vider la bouteille. Ce soir-là, l’alcool scella leur premier point commun. Elles ne buvaient pas tout à fait ensemble, mais plutôt l’une à côté de l’autre. Au fur et à mesure, la bouteille de moins en moins pleine créa une complicité artificielle. Louise buvait bien plus vite que Thérèse, mais comme cette dernière était une novice, elles furent rapidement dans le même état d’ivresse et de désinhibition sociale.
— Quand même, Louise, où as-tu déniché cet homme ? attaqua Thérèse sur un ton de familiarité qui sortait de nulle part.
— Q… Hein ? Vous… Tu… Vous parlez d’Évariste Fauconnier ?
— Parce que tu as encore… d’autres hommes dans ta vie ?
— Non, avoua Louise, avant de laisser filer un rire aigu. Et si je peux me payer ses services, c’est parce qu’un ancien ami règle la facture. Et elle est salée.
— Comment tu fais ?
— Quoi ?
— Comment tu fais pour que les hommes veuillent toujours te protéger et t’aider ? Pour qu’ils aient pitié de toi ? Tu n’es plus toute jeune, et tu n’es pas très belle. Enfin, pas comme les actrices qui font rêver les hommes. Alors, c’est quoi ton secret ?
— Je ne sais pas. Peut-être que j’appuie sur une corde en eux qui les rend sensibles. Peut-être que je sais ce qu’ils veulent.
— Tu couches ?
— Thérèse ! s’offusqua Louise, avant d’éclater de rire.
— Pardon, s’excusa l’administratrice, l’air un peu mauvais. Je… Il est fort, cet alcool, je ne sais plus ce que je raconte. Moi, j’aimerais avoir ce pouvoir. La vie doit être un peu plus facile.
— Hmm… parfois, seulement.
— Tu sais ce qui est arrivé à nos collègues qui sont morts à Venise ? questionna Thérèse, changeant brusquement de sujet.
— Non, je ne comprends pas pourquoi on m’a épargnée. Tous les soirs, quand je me couche, je me dis que la Mort va réaliser qu’elle en a oublié un. Alors elle viendra et me prendra en plein milieu de mon sommeil, comme elle l’a fait avec eux. Sans que je m’en aperçoive. Je m’allongerai, je fermerai les yeux, et j’arrêterai juste de respirer, en plein milieu d’un rêve.
Le regard brumeux d’ivresse de Thérèse se posa sur Louise avec un peu moins de réprobation.
— Crois-tu que cela aurait été plus facile si nous étions nées hommes ? Le monde nous déteste quand même un peu plus qu’eux.
Louise haussa les épaules. Une heure plus tard, la bouteille était vide et elles avaient fini le reste d’une autre que Louise avait sorti de sous un autre meuble. Le silence s’était déployé dans l’atmosphère de la pièce ainsi qu’au-dehors. Le vent n’était plus, la pluie pas encore. Le moment devenait immobile. Thérèse fixait le corps de Louise avachi sur son bureau, la tête dans les dossiers. Elle ne bougeait plus depuis un moment et, bientôt, elle se mit à ronfler. Un éclair mauvais traversa la pupille de Thérèse, qui se leva de son siège. Elle avait beaucoup de mal à tenir debout, et ses réflexes se trouvaient ralentis par son ébriété. Titubant entre les objets, elle heurta une chaise. Le bruit sourd la tétanisa. Elle retint sa respiration jusqu’à être sûre que Louise ne se réveille pas. Mais celle-ci ne broncha pas d’un poil et ronronna de plus belle. Thérèse prit une nouvelle inspiration, avant de se diriger vers la sortie.
Le couloir était vide et plongé dans le noir. Heureusement, elle connaissait chaque recoin de la fondation par cœur. Cela lui fut bien utile, car elle contrôlait de moins en moins bien la coordination de ses membres.
— Petite gourde, marmonna-t-elle, tu aurais dû t’arrêter plus tôt… Pardon.
S’excusant auprès de ce qu’elle identifia comme une grosse plante qu’elle venait de heurter, Thérèse parvint laborieusement jusqu’à son propre bureau. Elle referma derrière elle, alluma une petite lampe, puis balaya la pièce du regard. Elle respirait fort et paraissait hésiter sur ce qu’elle devait faire ensuite. Elle ferma les yeux, puis se jeta sur les tiroirs d’une armoire, et les tira jusqu’à les faire sortir de leurs rails pour renverser le contenu au sol. Elle fit de même avec tous les autres meubles qui contenaient des dossiers. Se ruant sur son bureau, elle s’employa à renverser avec frénésie tout ce qui se trouvait dessus. Son chignon si impeccable venait de céder sous la pression de son hystérie en libérant une belle chevelure de jais. Rien ne semblait pouvoir arrêter son entreprise de destruction. Son corps, comme possédé par tout l’enfer, gesticulait dans tous les sens. Elle frappait dans les meubles, donnait des coups de pied dans les chaises, et arracha même l’un des rideaux de la fenêtre. Au bout d’une dizaine de minutes, la dévastation de la pièce était totale.
Thérèse avait du mal à reprendre sa respiration. Des perles de sueur agrémentaient ses tempes, son front et son cou. Elle tenait à peine debout. Enjambant les multiples objets qui jonchaient le sol, elle saisit un coupe-papier, la seule chose qu’elle n’avait pas envoyée valdinguer. Ses mains se mirent à trembler. Puis, d’un geste fou, elle planta la pointe du coupe-papier dans son épaule. Malgré son effort à le contenir, elle ne put empêcher un cri de s’échapper hors de sa gorge. Le sang forma une petite cascade rouge sur le chemisier blanc qu’elle portait sous sa veste de tailleur gris. Se débarrassant de celle-ci, elle taillada avec maladresse le reste de la soie claire. Grimaçant de douleur à chaque geste, elle fit un effort considérable pour sortir de son bureau. Prenant toujours garde à ce qu’il n’y ait personne, bien que sa vision se trouvât fortement réduite, elle entreprit de faire le chemin en sens inverse. Les bras serrés contre la poitrine pour éviter de répandre du sang sur le sol, elle rejoignit Louise.
Celle-ci dormait toujours dans la même position.
— Tu ne nous causeras plus jamais de tort, murmura Thérèse avant de glisser le coupe-papier dans la main de Louise.
Puis elle frotta ses doigts contre sa blessure, ce qui lui occasionna une plus grande souffrance, et les essuya sur la main de Louise et son avant-bras. Une fois la mise en scène achevée, Thérèse recula pour admirer son tableau. Alors son visage perdit toute émotion, son souffle se calma, ses membres s’immobilisèrent.
Et dans la seconde suivante, elle poussa le hurlement le plus puissant qu’elle ait jamais poussé.