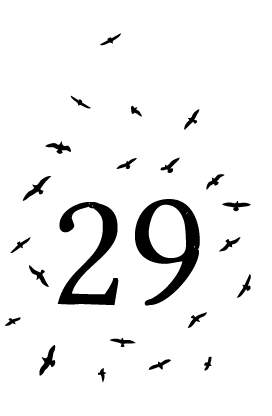
8 juin 1951, Neuchâtel, rue des Poudrières, 9 h
Après avoir garé l’Aston Martin rue des Poudrières, tout près du poste de police, Évariste et Isabeau patientèrent jusqu’à ce que Louise sorte du bâtiment. Ce matin encore, elle devait s’acquitter de nombreuses formalités administratives, avant de pouvoir mettre ces accusations derrière elle. Quand il était devenu certain que la police en avait fini avec elle, Louise avait à nouveau appelé son enquêteur afin de lui fixer un rendez-vous, lors duquel il entendait bien obtenir le fin mot de l’histoire.
Isabeau observait Évariste du coin de l’œil. Depuis quelques heures, l’enquêteur s’était muni d’un petit carnet sur lequel il griffonnait, rayait et réécrivait quelques phrases. Évariste n’écrivait jamais. Il se servait des notes d’Isabeau qu’il lisait et relisait, parfois il les répétait à voix haute avec une ponctuation différente, comme si la musicalité changeante des intonations pouvait en faire varier le sens. Mais jamais il n’écrivait. Excepté quand il tenait une piste et que celle-ci s’annonçait impossible. La curiosité d’Isabeau l’avait poussé à regarder les mots qu’Évariste couchait dans ces moments-là, cependant, la plupart du temps, il n’y avait rien de compréhensible. Juste une suite de mots, de flèches, et de points d’interrogation.
— Tiens, ne serait-ce pas mademoiselle Lavoisier ? demanda Isabeau en désignant la silhouette rectiligne et grise d’une femme qui sortait du commissariat.
— J’aurais aimé assister à la confrontation entre ces deux créatures.
— Sa jalousie va lui coûter sa carrière, et peut-être même sa liberté.
— Oh, je pense qu’elle pourra plaider les circonstances atténuantes dues à la consommation d’alcool. Les prisons sont assez pleines de criminels sans y ajouter une femme rongée par la rancune et profondément malheureuse. Regardez ses yeux, mon ami, ils sont éteints. Croyez-moi, cette femme vient de comprendre qu’une mort civile peut être bien pire qu’une mort physique.
Comme si elle avait eu l’intuition qu’on parlait d’elle, Thérèse jeta un regard en direction de la voiture et des deux hommes. Son visage un peu plus creusé que d’ordinaire trahissait le souvenir de nuits compliquées et l’anticipation de jours guère plus simples. Elle disparut au coin de la rue dont elle partageait la couleur des murs, comme si elle n’en avait été qu’une extension.
Vingt minutes plus tard, Louise sortit à son tour du poste de police. Elle avait tiré ses cheveux en arrière et portait une robe noire plutôt bien coupée. Si son visage manquait toujours de couleur et de fraîcheur, l’ancienne infirmière avait meilleure allure. Isabeau et Évariste allèrent à sa rencontre puis l’emmenèrent dans un petit café situé au bout de la rue.
Une fois tous bien installés, l’enquêteur entra dans le vif du sujet sans les politesses d’usage.
— Alors, si vous nous disiez qui est responsable de ce revirement de situation et ce qu’il s’est passé ?
— Jacques, répondit Louise, les yeux un peu hallucinés par sa propre révélation.
— Comment a-t-il confondu les mensonges de Thérèse ?
— Il ne l’a pas fait. Ce soir-là, il travaillait tard. Comme tous les soirs, en fait. Apparemment, il a croisé Thérèse, mais elle était tellement saoule que non seulement elle ne l’a pas vu, mais en plus, quand elle l’a bousculé, elle n’a pas réalisé que c’était une personne. Elle a repris sa route, et comme son état l’a choqué, Jacques a décidé de la suivre. Je crois que la voir à peine tenir sur ses jambes et parler dans le vide a dû l’amuser. Bien sûr, tout a changé quand elle a mis son propre bureau à sac.
— Pourquoi ne l’a-t-il pas arrêté ?
— Elle brandissait un coupe-papier qu’elle s’est planté dans l’épaule, il a paniqué. J’aurais paniqué, aussi. Comment… Comment on peut détester quelqu’un à ce point ? Au point de se mutiler.
— Vous seriez surprise de savoir ce que l’être humain est capable de faire par haine ou par amour.
— Je savais qu’elle ne me portait pas dans son cœur, mais elle a obtenu tout ce qu’elle pouvait espérer à la fondation. Je n’étais plus une menace ni une concurrente depuis longtemps. Mais on ne connaît jamais les gens.
— Vous étiez une menace pour la réputation de la fondation. Je pense que cette femme n’a qu’une seule passion dans la vie, c’est son travail. Je suppose qu’elle s’est dit que si nous ne vous disculpions pas des soupçons assez vite, il fallait qu’elle vous retire du paysage.
— Elle a toujours eu un discours extrémiste concernant la loyauté professionnelle, mais de là à monter toute cette histoire…
— Heureusement que votre ami Jacques n’a aucune vie sociale et se trouvait encore à la fondation ce soir-là.
— Ce matin à la première heure, j’ai reçu un appel de Marcel Sorel qui m’a assuré, je cite,« de tout son soutien ». Il a condamné avec force les agissements de Thérèse. Cependant… Enfin, je me demande dans quelle mesure il n’était pas au courant de ses projets. Je vois mal Thérèse faire une telle chose sans lui en parler. S’il avait eu un motif pour me licencier sans passer pour un horrible patron qui se débarrasse d’un employé à la première rumeur, cela l’aurait arrangé, après tout. Enfin, je suppose que nous ne le saurons jamais.
— Quand tout sera fini, Louise, comptez-vous rester ici ? demanda Évariste en plissant ses yeux de reptile au-dessus des volutes parfumées de son thé noir.
— Quand ? répéta Louise avec un sourire amer. La question n’est-elle pas plutôt si ?
— Tout sera bientôt fini, ma chère, je vous l’assure.
Louise se redressa, le regard soudain vif de curiosité.
— Avez-vous une piste ?
— Disons que je commence à voir se dessiner le grand schéma, répondit Évariste sur un ton énigmatique.
Isabeau sourit.
— Mais vous allez le garder pour vous, commenta Louise en soupirant. Cela fait partie de votre charme.
— La résolution d’un crime se rapproche beaucoup de la pâtisserie. Si vous ouvrez le four en plein milieu de la cuisson, le gâteau sera gâché.
Pâtisserie et crime, il a osé la faire, pensa Isabeau en roulant des yeux au ciel.
— Alors que me conseillez-vous de faire, maintenant ? demanda Louise.
— Eh bien, considérant votre nature, je vous dirais bien de rester chez vous et de ne plus en sortir, afin de ne pas aggraver à nouveau votre situation.
Louise ne releva pas la pique et dévisagea l’enquêteur en attendant qu’il reformule.
— Vous est-il néanmoins possible de rester un temps chez vous ?
— Heu… oui, je suppose qu’à la fondation je ne leur manque pas. Combien de temps ?
— Ce ne sera plus très long. Je vous appellerai quand tout sera fini.
L’incrédulité de Louise se lisait sur chacun de ses traits, mais elle choisit de sourire poliment. Elle ne s’éternisa pas auprès des deux hommes et finit par prendre congé d’eux au bout d’un quart d’heure.
Isabeau et Évariste commandèrent une deuxième tournée de café et de thé. L’air s’emplissait de douceur, tandis que le soleil chauffait déjà les rues et éblouissait la salle en frappant les vitres de l’établissement. Les deux hommes n’échangèrent plus un mot jusqu’à ce qu’Évariste décide de leur départ.
— Qu’avez-vous en tête ? demanda Isabeau une fois dans la rue.
— Passons au bureau de poste, je vais envoyer un télégramme à Joras. Il faut absolument que nous lui mettions la main dessus. Ensuite, je serai…
Il s’interrompit. Tel un limier qui tient sa proie dans son champ de vision, plus aucun muscle ne remua, tandis que ses yeux visaient l’Aston Martin.
— Cette journée promet d’être très intéressante, finit-il par marmonner en s’approchant du pare-brise sur lequel reposait une épaisse enveloppe marron.
Après s’en être emparé, il décacheta la pochette, alors qu’Isabeau regardait tout autour d’eux en dévisageant chaque passant comme s’il allait pouvoir lire en eux.
— La personne qui nous a déposé ceci est déjà loin, mon ami, affirma Évariste avant d’ouvrir la portière passager et de prendre place à l’intérieur du véhicule.
Isabeau l’imita.
— Vous savez qui nous a donné ça ? demanda-t-il une fois derrière le volant.
— Peut-être bien, répondit l’enquêteur, l’air pensif alors qu’il sortait de l’enveloppe une liasse de vieilles feuilles sales et jaunies.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Je ne sais pas encore. Vos questions m’empêchent de lire.
Isabeau poussa l’un des plus énormes soupirs qu’il possédait dans son registre et patienta en tapotant le volant du bout des doigts. Évariste parcourut ce qui ressemblait de loin à des lettres écrites avec une encre de mauvaise qualité sur un papier ancien et couvert de taches. Isabeau remarqua que les lèvres de son mentor formèrent un sourire satisfait qui chez lui devenait aussi toujours un peu effrayant.
— Alors ?
— C’est une sorte de journal intime écrit par un prisonnier du camp de Struthof en 1943.
— Super. Quel rapport avec notre affaire ?
— Je ne sais pas encore, mais il y en a forcément un. Rentrons, je dois étudier au plus vite ce journal, et avec le plus grand soin. On nous les a confiées parce que la dernière clef de l’énigme se trouve entre ces lignes. C’est une certitude.
— Cela aurait été plus simple que la personne qui nous a remis ce document nous donne directement le nom du coupable.
— Et tellement moins amusant. Peut-être que cet ange gardien ne sait pas le déchiffrer et compte sur nous pour le faire.
— Et nous allons le faire…
— Oui. Enfin surtout moi, vous, vous allez conduire jusqu’à l’hôtel et vous plaindre.
Isabeau démarra la voiture, et lui fit faire un rapide demi-tour en serrant les dents.

Isabeau gara la voiture non loin de l’hôtel. Évariste n’avait à nouveau plus prononcé un seul mot et s’était plongé dans l’observation des documents confiés par un inconnu de façon providentielle. L’œil clair de l’enquêteur brillait de malice, comme celui d’un enfant à qui on vient de donner le jouet dont il rêvait depuis longtemps et qu’il n’espérait plus.
À peine eurent-ils passé la porte de l’hôtel qu’Odette surgit devant eux en leur barrant la route.
— Vous voilà enfin ! s’écria-t-elle en faisant tinter ses énormes boucles d’oreilles.
— Nous avions rendez-vous ? demanda Évariste sans cacher l’ironie du ton dans la question.
— Non ! Mais quelqu’un vous attend depuis un moment dans le salon. Je ne savais plus quoi lui dire.
— D’attendre, par exemple ? Je vous remercie de l’avoir installé. De qui s’agit-il ?
— D’un certain docteur Latreille.
Évariste et Isabeau affichèrent une profonde surprise.
— Joras ?
— Je ne me suis pas permis de lui demander son prénom, déclara Odette, avant d’hésiter : C’est son prénom ? Vous le connaissez ?
Sans lui apporter de réponse qui aurait satisfait sa curiosité maladive, les deux hommes prirent congé d’elle de façon un peu cavalière – au point de la laisser sans voix, ce qui n’était pas une mince affaire la concernant – pour rejoindre le salon vert. À cette heure, il était désert. Presque désert. À une table positionnée près de la fenêtre donnant sur la rue, un homme presque aussi vieux que Georges, mais sans sa classe aristocratique désuète, patientait avec un immobilisme inhumain.
— Joras ! s’exclama Évariste en lui tendant la main pour le saluer. Mais que faites-vous là, mon ami ?
— Vous ne répondez pas au téléphone, répondit le médecin sur un ton dénué de toute émotion. Le gardien de votre immeuble m’a donné votre nouvelle adresse.
— C’est plutôt vous qui ne répondez pas, Georges n’a pas arrêté d’essayer de vous joindre. Où étiez-vous passé ?
— À Venise.
Le visage de l’enquêteur s’éclaira d’une lumière intense.
— Parfait, commenta-t-il avant de tirer une des autres chaises entourant la table. Je ne crois pas que vous ayez déjà rencontré mon assistant, Isabeau le Du ?
— Enchanté de vous rencontrer enfin, répondit le jeune homme avec un grand sourire.
— Vous n’êtes pas une fille, observa Joras.
— C’est une erreur dont il se repend tous les jours, confia Évariste en faisant signe au jeune homme de prendre place à côté d’eux. Alors, racontez-moi tout, mon ami ; que pensez-vous de ces assassinats au Danieli ? J’imagine que si vous avez accepté de quitter votre laboratoire parisien bien-aimé, c’est que vous avez flairé quelque chose de très intéressant.
— Non, répliqua Joras, le regard aussi mort que celui d’une gamba cuite au four.
Isabeau eut du mal à dissimuler une envie de rire. Il avait déjà eu l’occasion d’entendre une conversation téléphonique entre Évariste et Joras, et il s’était rendu compte que l’éminent légiste de la capitale éprouvait une sorte d’incapacité chronique à user des codes sociaux élémentaires. Il ressemblait à une sorte de grande calculatrice qui aurait été dotée de la parole. Par erreur. Tant qu’il pouvait répondre par une donnée chiffrée ou un fait objectif, tout se passait bien, mais dès qu’il s’agissait d’apprécier les subtilités de l’humour, du second degré, du sarcasme ou de l’ironie, dont Évariste était si amateur, alors la machine s’enrayait et se bloquait. L’enquêteur s’en amusait d’ailleurs beaucoup. Isabeau avait fini par le soupçonner de ne s’entourer que d’esprits au fonctionnement bien singulier, que la société avait du mal à comprendre et à intégrer. Comme s’il était sans cesse à la recherche de l’exception pour défier la règle qui l’ennuyait profondément.
— Je pensais qu’il s’agissait d’un empoisonnement classique, reprit Joras, et comme souvent dans les cas d’empoisonnement, il est très difficile de retrouver la substance à l’autopsie. Je ne me serais donc pas déplacé pour un empoisonnement, même très bien administré, ce qui est le cas dans notre affaire. Par acquit de conscience, j’ai néanmoins envoyé des extraits du rapport du légiste de Venise à quelques confrères qui voyagent beaucoup plus que moi, dans l’espoir que certains auraient déjà rencontré ces symptômes et reconnaîtraient le poison utilisé.
— Et quelqu’un vous a répondu, anticipa Évariste, au comble de l’excitation.
— Qui vous en a parlé ?
— Personne, mon ami, je fais une simple supposition.
Le visage de Joras exprima pour la première fois un embryon d’expression, qui pouvait faire penser à du mépris pour le terme injurieux de« supposition ».
— L’un de mes confrères, le docteur Kovalev, spécialisé en neurochirurgie, m’a rappelé assez vite et m’a indiqué que les circonstances de la mort de ces sept victimes lui rappelaient une affaire similaire survenue l’année dernière à New Haven, une petite ville située non loin de New York. Cinq adolescents en week-end dans une colonie de vacances ont été retrouvés morts au petit matin dans leur dortoir, au milieu des autres. Pas de traces de violence, pas d’antécédents de maladies, pas de cause apparente du décès, si ce n’est un arrêt complet des fonctions vitales survenu au même moment dans la nuit. Comme le docteur Kovalev mène des recherches très poussées sur l’activité cérébrale en sommeil paradoxal, les autorités américaines ont fait appel à lui pour avoir son expertise. À part quelques hypothèses sur l’utilisation de certaines substances, il n’a jamais trouvé la formule exacte qui avait pu provoquer le décès de ces jeunes gens.
Joras marqua une pause. Isabeau et Évariste échangèrent un regard aussi intrigué que dubitatif. Si le médecin s’arrêtait là, la déception serait insurmontable.
— Et ? tenta l’enquêteur.
— Et quoi ?
— C’est tout ?
— Non.
— Oh.
— Préférez-vous que je garde la suite pour plus tard ?
— J’hésite, s’amusa Évariste, ce qui échappa à son interlocuteur. Isabeau ?
— Je vote pour qu’on continue, répondit le jeune homme, mais je dois dire que j’ai hésité.
— Va pour continuer, alors, trancha l’enquêteur.
— Tandis que le docteur Kovalev résidait à l’hôtel et se préparait à rentrer en France, reprit Joras comme s’il ne s’était jamais interrompu, des hommes sont venus dans sa chambre lui faire une proposition. Ils se sont présentés comme des agents de la CIA. L’agence se trouvait sur le point d’ouvrir un laboratoire d’études psychologiques, et elle recrutait les plus grands spécialistes dans les domaines des neurosciences, de la biologie, de la génétique et de la pharmaceutique. En d’autres circonstances, cela n’aurait pas interpellé mon collègue – il a l’habitude de ce genre de démarches compte tenu de son intelligence supérieure dans son domaine –, mais quand les hommes lui ont décrit les raisons de leur démarche, il a eu quelques soupçons. Soupçons qui ont été confirmés par les morts à Venise dont je l’ai averti.
— Qu’avait la CIA dans la tête exactement ?
— Le projet pour lequel elle voulait recruter le docteur Kovalev s’appelait Blue Bird. Il visait à explorer les techniques de contrôle mental d’un individu. Le but poursuivi était de savoir s’il était possible de développer des protocoles qui permettraient de contrôler une personne au point où celle-ci ferait ce qu’on lui demande même contre sa propre volonté, y compris contre les lois fondamentales de la nature, comme celle de l’autopréservation.
— La mort, résuma Évariste, pensif.
— Les deux grandes guerres mondiales ont montré les limites d’un conflit classique. Même les vainqueurs sont ruinés par les infrastructures et les moyens déployés dans les combats. La victoire se réduit à un budget et à un nombre de soldats. Les conflits futurs se feront sur un terrain plus invisible. Imaginez pouvoir infiltrer l’esprit des rangs ennemis et changer leur personnalité. Il serait alors possible de les faire se retourner contre leur hiérarchie, d’obliger un dirigeant à signer des accords de paix ou un contrat commercial, de piloter à distance le suicide d’un haut dignitaire parce qu’il s’oppose à tel ou tel projet.
— Mais… enfin, hésita Isabeau, c’est vrai ? Je veux dire, c’est vraiment possible de faire ça ? De manipuler des personnes au point qu’elles arrêtent de vivre sur commande ? Comment ?
— La base du contrôle mental est la destruction de la conscience native. Une fois cela fait, le cerveau serait comme une page blanche sur laquelle, en théorie, il serait possible d’inscrire de nouvelles impulsions neuronales. Autrement dit, une nouvelle conscience. Pour pouvoir transformer un individu en marionnette, il faut supprimer en lui toute capacité de raisonnement, afin que le fonctionnement de son cerveau en soit réduit à de simples fonctions vitales et de mimétisme. Il faut donc briser l’individualité pour qu’il ne reste rien de ce qui fait la personnalité et la capacité à prendre une décision. L’une des pistes développées par certains scientifiques est le recours aux drogues dissociatives couplées à des drogues hallucinatoires. Vous administrez ainsi des substances chimiques qui provoquent un éclatement de la personnalité. La perception de la réalité est alors compromise, et plus l’administration des drogues est longue, moins le cobaye pourra récupérer l’usage normal de son cerveau originel. Une fois qu’il ne reste rien qu’une coquille vide, vous enclenchez la seconde phase du traitement : l’implantation de la nouvelle idée. À supposer que cela fonctionne, vous obtenez un robot qui obéit à l’ordre implanté, et ce quel que soit l’ordre.
— Y compris par exemple pousser un homme sain d’esprit à rentrer un soir chez lui et se jeter par la fenêtre ? demanda Isabeau.
— Si le processus est mené à son terme, en théorie, votre cobaye fait ce que vous voulez : se jeter contre un mur, tuer quelqu’un, réciter une poésie, jouer de n’importe quel instrument ou se précipiter par la fenêtre.
— Suivez-moi, mon ami, j’ai quelque chose à vous montrer, indiqua Évariste en se levant de son siège.
Le conduisant dans la suite à l’étage, l’enquêteur tendit au légiste les dossiers volés à la fondation.
— Certaines des substances mentionnées dans ce rapport pourraient-elles être de ces drogues dissociatives dont vous parlez ?
Joras s’assit sur l’un des deux fauteuils présents dans le salon situé entre les chambres des résidents et garda le silence pendant de longues minutes.
— C’est difficile à dire, finit par déclarer le légiste, ce n’est pas mon domaine de compétence. J’ai entendu parler de certaines expériences à base d’ergot de seigle associé à de la kétamine ou de la phencyclidine. C’est un cocktail qui permet à la fois la dissociation, la distorsion sensorielle et les hallucinations. Mais cela ne serait pas suffisant sans le recours à une programmation neuronale ou neurolinguistique. Et pour cela, il vous faut avoir recours à des techniques d’électrochocs et d’hypnose. Bien entendu, tout ceci n’est qu’expérimental et n’a fait l’objet d’aucune validation scientifique, pour des raisons évidentes d’éthique. Il faudrait que j’appelle le docteur Kovalev et que je lui donne la liste des substances que je lis ici, mais je peux d’ores et déjà vous dire que ces lignes-là (Joras tourna le document dans la direction d’Évariste en soulignant d’un doigt plusieurs suites de chiffres), c’est un paramétrage d’électrochoc.
— La plupart sont des enfants, intervint Isabeau, la mine sombre.
— Ce sont les meilleurs cobayes. Les mécanismes de leurs cerveaux et leurs filtres sociaux sont instables et en pleine évolution. De plus, les pics d’hormones dus à leur croissance peuvent constituer de formidables leviers. Plus le sujet est jeune, plus la dissociation et la suggestion fonctionnent, et moins la résistance psychologique est grande.
Joras se leva pour feuilleter le reste des documents volés et étalés sur la table basse. Évariste s’assit sur le second fauteuil et ressortit son petit calepin. Isabeau aurait aimé quitter la pièce, rouler jusqu’à la fondation, et y mettre le feu après avoir sorti tous les patients. Mais comme il lui manquait un bon combustible, il se contenta de fixer le lac à travers la fenêtre et de prendre de longues inspirations pour calmer sa colère.
— Évariste, finit par reprendre Joras, j’ignore sur quelle affaire vous travaillez, mais il faut vous hâter. Ce que je lis dans ces documents prouve qu’ils mènent leurs expériences depuis longtemps, et les sept morts à Venise ressemblent fort à un test en conditions réelles sur le terrain. Quel que soit leur but, ils ont eu la confirmation que leurs expériences fonctionnaient. Plus rien ne les retient.
— Surtout si on considère que la mort antérieure d’Ambroise Perrin était déjà un premier test et qu’ils ont voulu vérifier que cela fonctionnait sur un groupe, ajouta Isabeau.
— Le but de la manipulation mentale est de transformer des individus en choses dont on se sert pour un but précis, et ce sont rarement des objectifs louables.
— Oh, mon ami, je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, jubila l’enquêteur.
— Non, je n’essaie pas. Je vous le dis. Ces documents disent qu’ils sont en train de créer une armée. Et même si je ne suis pas convaincu que la manipulation mentale induite par psychotropes soit fiable et efficace, personne ne peut sortir intact de telles expériences. Au pire, ils ont créé des bombes à retardement.
— C’est bien le problème, mon ami, nous ignorons quel but ils poursuivent. La CIA travaille pour le secret, le contre-espionnage et le sabotage. Elle travaille pour la protection et la puissance d’un État en perpétuelle concurrence avec d’autres, mais un institut privé en partie géré par l’Église, quel est son but ? En quoi posséder une armée de zombies obéissant au doigt et à l’œil pourrait lui être utile ?
— Je ne suis pas enquêteur, je suis médecin, répondit Joras le plus sérieusement du monde.
— Trois petites réponses, murmura Évariste en fixant son carnet. Juste trois petites réponses et le schéma se révélera. Il faut que je me replonge dans ce journal.
Isabeau tiqua. S’éloignant de la fenêtre, il vint jeter un coup d’œil par-dessus l’épaule de son mentor. Ce dernier lui tendit le calepin avec une expression de défi. Le jeune homme s’en empara et s’assit sur le bord de la table basse. Il lut à voix haute les inscriptions figurant sur la feuille.
— Un : pourquoi sept morts ? Deux : pourquoi les victimes de Venise n’avaient-elles pas de carton d’invitation ? Trois : qu’est-ce que a131617 ?
Il marqua une pause, tout en dévisageant son voisin.
— Vous êtes sérieux ?
— Toujours, répondit Évariste en sortant quelques pages volantes écrites par le prisonnier de Struthof. Peut-être avez-vous les réponses, mon ami ?
— Heu… Alors, sept morts parce que ces sept personnes participaient aux expériences dans le sous-sol et ont été éliminées soit parce qu’elles devenaient gênantes, soit pour être arrêtées dans leur funeste besogne.
— Hmmm, répliqua l’enquêteur sur un ton faussement distrait, mais pourquoi pas six ou huit ? Il y a d’autres noms de médecins figurant sur ces quelques dossiers et qui, j’en suis certain, se trouvaient eux aussi à Venise, comme la quasi-totalité du personnel de la fondation. Pourquoi ces sept-là parmi tous les autres ?
Isabeau prit le temps de la réflexion, avant d’enchaîner sur la deuxième question :
— Ils ont peut-être jeté leurs cartons d’invitation.
— Dans ce cas, on les aurait retrouvés dans la poubelle, mon ami. Or l’inventaire de ce qui a été relevé dans leur chambre d’hôtel ne fait aucunement mention de ces cartons. Alors que les autres invités les avaient encore en leur possession lorsqu’ils ont été interrogés par la police..
— En quoi est-ce si important ?
— Parce que les personnes qui n’ont pas de carton d’invitation sont toutes mortes.
— Deux points communs, intervint Joras, qui ne perdait pas une miette de l’échange. Donc deux paramètres à prendre en considération afin de les relier.
— Et si ça n’est pas lié au meurtre ?
— Et si ça l’est ? se délecta Évariste.
Isabeau fronça le nez.
— Et pour la suite de chiffres, hésita-t-il en gribouillant sur le calepin, c’est forcément un code. Peut-être une date, ou des coordonnées ?
— Mais qu’est-ce que vous êtes en train de faire ? pesta l’enquêteur en se levant et en récupérant son carnet. Est-ce que j’écris sur vos notes ?
— Tout le temps ! s’exclama Isabeau.
Évariste constata que le jeune homme avait ajouté une ponctuation à la suite de chiffres, et transformé la minuscule du a en majuscule.
— A13 deux-points 16 tiret 17, lut-il à voix haute. Pourquoi avez-vous inscrit ça ?
— Je… Je ne sais pas. Enfin, si, c’est comme ça que je l’ai vu écrit sur le fameux mur dont je vous ai parlé.
— Mon ami, mon ami, soupira l’enquêteur, l’air navré, combien de fois vous ai-je parlé de l’importance des détails ?
— Ce n’est que de la ponctuation, ça ne change pas les chiffres.
— Les plus grands secrets de l’univers se cachent dans les virgules ! Je croyais que vous le saviez.
— Je suis désolé, je n’ai pas réalisé que c’était si important. Et donc, quel est le grand secret que ces fichus deux-points et ce tiret nous révèlent ?
— A13 : 16-17 ressemble fort à la présentation classique des chapitres et des versets de l’Apocalypse de Jean, répondit Joras sur un ton de premier de la classe qui agaça Isabeau.
— Il aura une bien meilleure note que vous, mon cher. Deuxième partie du Livre de la Révélation, chapitre treize, versets seize et dix-sept.« Et elle – la Bête – fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front ».« Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la Bête, ou le nombre de son nom. » Ce que les jume…
Frappé de sidération, Évariste se raidit instantanément. Les secondes s’écoulèrent, tandis que Joras et Isabeau demeuraient suspendus à son immobilisme tendu. Le jeune homme avait déjà vu ce phénomène se produire avant. Le cerveau de l’enquêteur se mettait à surchauffer, et la mécanique du reste du corps, accablée d’un afflux d’informations trop important, s’enrayait. Au bout d’un moment, un malaise envahit la chambre.
— Tout va bien ? s’inquiéta Isabeau, qui craignait toujours que son mentor ne finisse par rester coincé dans les limbes de son esprit.
— Je sais qui est la Bête ! s’écria soudain Évariste, en s’emparant de son chapeau et de son manteau. Georges ! J’ai besoin d’une adresse, il faut appeler la fondation !
— Hein ? Quoi ? Attendez, qui est la Bête ?
— Les couverts à poisson, mon ami ! Comment n’ai-je pas fait le lien avant ? Les couverts à poisson, c’était pourtant évident !