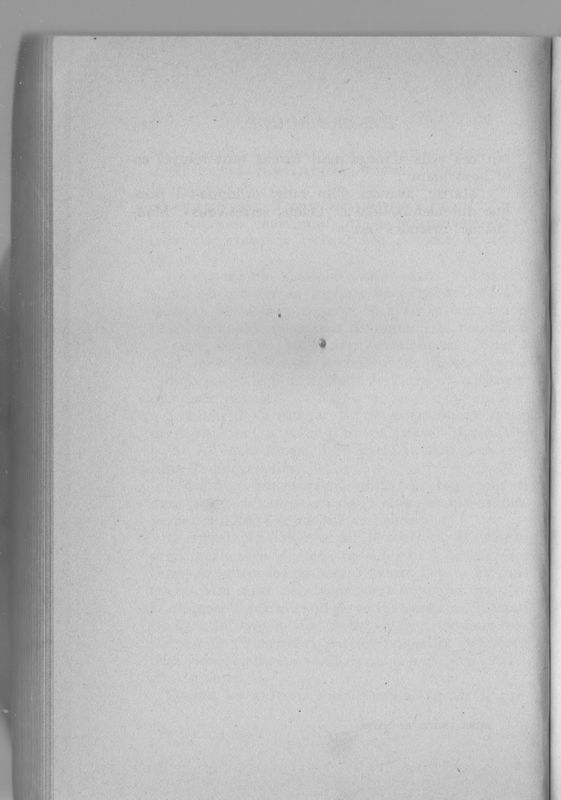 I
I
FABRICE FOUDROYÉ
ROLAND GUÉRIN sonna plusieurs fois, timidement puis impatiemment, avant de s’aviser que, dans ce moulin, on entrait sans s’annoncer.
« LE VOLTAIRE – Rédaction. » Il s’assit dans l’antichambre et, de tous ceux qui s’y croisaient, personne né prit garde à lui. Les portes battaient, des téléphones sonnaient lointains ou stridents ; de nouveaux visages apparaissaient sans cesse, tous très jeunes ; ils se faisaient des signes d’intelligence et jetaient un regard morne au visiteur comme à quelque paquet oublié. Immobile, tirant sur les pans de son cache-col gris, Roland assistait au spectacle avec l’émerveillement inquiet d’un enfant devant un port de mer.
Lorsqu’elle eut achevé de raconter à tout l’étage son dernier samedi soir et ses graves soucis de coiffure, l’hôtesse s’occupa de lui.
« J’ai reçu une lettre de Simone Ardant (c’était la rédactrice en chef du Voltaire) me priant de passer la voir… »
La fille lui tendit une fiche : NOM DU VISITEUR, il l’écrivit ; MOTIF DE LA VISITE : « C’est justement ce que je viens apprendre. »
Depuis la rencontre avec le lieutenant Mansart, il était devenu assez susceptible ; ou plutôt il ménageait le reste de sa fierté et ressemblait à un homme qui accumule de la petite monnaie pour venir à bout d’une dette énorme.
La fille prit le feuillet entre deux doigts que leurs ongles allongeaient démesurément et s’éloigna d’une démarche qu’elle souhaitait à la fois souveraine et provocante. Il y avait un miroir dans l’antichambre et, chaque fois qu’elle passait devant lui, la fille s’y mirait avec complaisance.
En se rasseyant, Roland éprouva cette sorte d’angoisse, ventre creux et cœur battant, inséparable de l’attente chez le médecin, des trains de l’aube et des veilles d’examen. Et il comprit soudain, non sans humiliation, que c’était en partie pour fuir cette angoisse enfantine qu’il avait choisi un métier qui en fût l’antidote. Mais aujourd’hui, il était de nouveau le petit garçon sur sa chaise… Quelle stupide tentation l’avait donc induit à envoyer six pages de maximes au Voltaire avec ces mots faussement désinvoltes : « Qu’est-ce que vous en pensez ? »
En tempête, une porte s’ouvrit à deux battants et Simone Ardant – comment ne pas la reconnaître ? – s’écria impatiemment, comme si c’était elle qui attendait depuis si longtemps : « Professeur Guérin ? »
Elle cherchait d’un regard blasé ; Roland se leva.
« Quoi ! C’est vous ? » Et, pour excuser le sourire qu’elle n’avait pu réprimer : « Que vous êtes jeune… Venez ! »
Il pénétra dans le bureau à sa suite ; il y vit un buste de Jaurès, un cheval chinois, une reproduction de van Gogh, une carte du monde. C’était la première fois que Roland approchait une personnalité vraiment connue : de celles, dont on voit, dans la presse, des caricatures ou des photos indiscrètes et sur qui les chansonniers font des plaisanteries, toujours les mêmes. Il ne pouvait s’empêcher d’en être flatté, mais furieux de l’être. Simone Ardant passa une main nue (jamais une bague, jamais un bijou) dans cette chevelure d’une teinte célèbre qui la faisait surnommer « le flambeau du nouveau socialisme ». Roland s’aperçut qu’il se tenait assis sur l’extrême bord de son siège.
Ainsi, il était seul avec Simone Ardant ; elle dépensait son temps pour lui seul, et il en ressentait autant de gêne que de fierté. Les gens importants, il les avait toujours considérés comme d’une autre race ; et devant les lieux où ils résidaient et régentaient, Roland pressait le pas comme un pauvre devant la salle d’attente de 1re classe. Ses collègues étaient pareillement partagés entre leur supériorité au regard des élèves et l’infériorité qu’ils ressentaient d’instinct face aux gens d’argent ou à ceux « dont on parle ».
Toutes ces pensées lui vinrent en un éclair tandis que la journaliste parlait ; elles le rendirent assez digne, un peu insolent, tout à fait inconscient de son charme, donc charmant. Il remarqua pourtant qu’elle n’y était pas insensible et cela le troubla.
Roland vivait dans une chasteté presque continue à laquelle il attribuait des motifs nobles afin de ne pas trop souffrir du mariage assez trouble de respect et de timidité qui en était la véritable cause. Avec une modestie charmante quoique lâche, il ne pensait presque jamais qu’il pût séduire. Il s’aperçut pourtant de l’impression qu’il produisait en ce moment sur cette femme. Peut-être ne s’en avisait-il que parce qu’elle était célèbre ; ou plutôt parce que, depuis l’injure du lieutenant Mansart, il lui fallait reconquérir sa propre estime par n’importe quel moyen.
Tout cela occupait davantage son esprit que le monologue de Simone Ardant qui discourait du Voltaire, du socialisme, de la jeunesse, de la guerre d’Indochine.
« Vous avez bien compris ce que nous cherchons : démystifier l’opinion. Mais certains mythes ont la vie dure ; et d’autres naissent impunément sous nos yeux : celui du para, notamment.
– Bah ! Tous les enfants le connaissent, dit Roland : c’est Superman…
– Oui, mais Superman ne se fabrique pas en série, comme on a fait les S. S., les marines, les kamikaze ! De la guerre mondiale n° 1 est sortie l’armée nationale ; et de la suivante, à nouveau l’armée de métier – quelle dérision !
– C’est surtout un retour aux demi-dieux : champions et vedettes. Et le para est à la fois l’un et l’autre… »
« Mais pourquoi m’en parle-t-elle ? » se demandait Roland. Il connaissait bien les motifs de sa propre hargne, et ils étaient bas ; mais pour quelles raisons, guère plus avouables peut-être, d’autres partageaient-ils son humeur ?
Il écoutait Simone Ardant avec une admiration méfiante : il éprouvait brusquement la certitude que ses opinions, si célèbres, n’étaient que des humeurs pétrifiées, et qu’en elle le parti pris s’alimentait à toutes les ressources de l’esprit. Avec de grands gestes de ses mains impérieuses, elle construisait pour ce seul auditeur un monde peut-être meilleur, sûrement plus logique, mais auquel il accordait de moins en moins d’attention. Il regardait seulement – si fixement qu’elle finit par s’en apercevoir – un filet de rides ténues à la commissure de ses lèvres… Des dents de fauve, des lèvres orgueilleuses, mais le pouce du Temps avait imprimé là, et là seulement, son empreinte. « Elle a déjà passé de l’autre côté, se dit-il. Le sait-elle seulement ? (C’était une pensée naïve.) Le jour où elle s’en avisera sans recours, ses partis pris deviendront féroces… »
Cependant, elle continuait de lui confier les soucis et les espoirs du Voltaire, du Parti. Et Roland s’en trouvait flatté, presque ému, ignorant que c’est l’une des faiblesses des Importants que de s’abandonner ainsi devant le premier venu, quitte à ne pas le reconnaître, le lendemain.
Elle le trouvait charmant, ce Roland Guérin qui ne prenait même pas la peine de se déguiser en professeur ! Avec ce mélange de jeunesse et de maturité, de respect et d’insolence… Il avait enroulé une jambe autour de l’autre comme le font les écoliers, et il écoutait, la tête penchée, avec un sourire ironique et triste.
À quoi se prit-elle à songer ? Ses lèvres seules parlaient encore du socialisme et de la guerre ; mais son cœur avait dû rejoindre cette retraite fragile, ressentir cette blessure inavouable que cachent tous ceux qui montrent un peu trop leur force. Roland vit son visage s’assombrir, s’adoucir, devenir soudain accessible. « J’aimerais l’aimer », songea-t-il. C’était « être aimé d’elle » qu’il voulait dire. Cette femme plus âgée que lui, plus forte surtout, lui apportait à la fois la protection d’une mère et la tendresse inquiète d’un dernier amour ; tandis que, pareil aux enfants, il n’aurait à donner en retour que ce qui ne lui coûtait rien : la grâce de son âge.
Leurs regards se rencontrèrent par hasard, un instant ; et chacun dut lire en l’autre sa propre rêverie, car ils tressaillirent ensemble, comme lorsqu’on passe devant un miroir inattendu. Ce fut elle qui rompit :
« Je vous fais perdre votre temps, dit-elle avec un sourire mondain qui lui retirait dix ans d’âge mais bien du charme. L’essentiel tient en peu de mots – comme toujours, hélas ! Votre envoi nous a enchantés. Je vais le publier, et je vous demande une collaboration régulière…
– En toute liberté ?
– C’est la devise du journal.
– Bien sûr, dit Roland qui avait retrouvé ses esprits ; mais « Liberté-Égalité-Fraternité » est bien celle de la république !
– Il est parfait ! s’écria Simone Ardant juste un peu trop fort. Je vais vous confier au secrétariat de la rédaction. »
Elle passa, de nouveau, ses longs doigts dans ses cheveux. C’était un geste de M. Lecœur ; mais l’un faisait mousser une écume de neige, l’autre attisait une flamme. Ce geste si familier troubla de nouveau Roland ; il résistait avec peine à l’envie de passer, une seule fois, ses doigts à lui dans cette chevelure…
« Sandrine, appela-t-elle sans le quitter des yeux, voici M. le professeur Guérin ! »
Cette Sandrine apparaissant montra le même sursaut lorsqu’elle aperçut un aussi jeune homme. Cette fois, Simone Ardant éclata de rire, mais d’un rire un peu forcé qui mit les autres mal à l’aise.
« J’en étais sûre ! Moi aussi, Sandrine, moi aussi… Allons, reprit-elle avec une ombre de regret, je te le laisse. »
De trois doigts elle dessina vers Roland un signe d’adieu assez enfantin et sortit.
Lorsque le garçon détourna sur Sandrine ses yeux un peu désenchantés, il ne remarqua d’abord que les lunettes, d’un ovale étiré vers les tempes : mi-biche, mi-chat, ou serpent peut-être. Des verres si épais qu’ils agrandissaient l’œil et lui conféraient la fixité naïve et dure qu’ont les regards sur les frises égyptiennes. Mais lorsqu’elle commença de parler, Roland oublia les maxillaires trop larges et je ne sais quoi de masculin dans la démarche, le geste et, sinon le regard, du moins cette façon de le planter hardiment dans le vôtre. Il oublia les imperfections de cette inconnue parce qu’il venait de pénétrer dans le domaine de sa voix. À peine enrouée, voilée plutôt, comme celle des étrangères et des chanteuses réalistes, cette voix conférait à son parler un ton si singulier, si poétique qu’elle donnait l’impression de ne pas user de notre langage mais d’en traduire sur l’instant chaque parole. Aucune affectation dans sa façon de dire ; et cependant, en passant par cette voix un peu brisée, à la fois ardente et lasse, chaque mot semblait neuf.
« Cette fille n’est pas belle, pensa Roland, mais elle me fascine. N’en ayons surtout pas l’air ! » Il croyait que c’était l’effet de cette seule voix ; mais, comme cette Sandrine se taisait depuis un long moment, attentive à rechercher son manuscrit dans des dossiers, Roland s’avisa que, taciturne, sa séduction demeurait aussi puissante qu’involontaire, inexplicable – probablement insoupçonnée.
Elle ne le regardait plus ; il se permit de l’observer sans ménagement et ne baissa les yeux que lorsqu’elle se leva et marcha vers un classeur, car il lui eut paru déloyal de l’épier ainsi, de dos, sans défense. Mais il avait eu le temps d’être ébloui par cette évidence : « Elle n’est ni aussi belle ni aussi bien faite que Simone Ardant, par exemple ; mais elle est jeune. Non pas à la manière des jeunes filles qui le sont comme malgré elles, et se considèrent parfois avec un émerveillement irritant… Mais consciente et maîtresse de sa jeunesse. Et moi aussi ! »
Un éblouissement de joie… Pour la première fois depuis la déplorable rencontre du lieutenant Mansart, il retrouvait son équilibre, c’est-à-dire assez d’estime de soi pour vivre en paix. La pensée toute simple qu’il était jeune, jeune comme cette Sandrine, le lui rendait entièrement – pour un instant. Où prenait-elle donc cette force tranquille, cette assurance merveilleusement contagieuse ? L’impression de tenir la mort en respect, de respirer aux côtés de cette Sandrine un air qui ne contenait aucun germe de décrépitude – voilà qui paraissait soudain à Roland beaucoup plus précieux que la protection passionnée d’une femme comme celle qu’il entendait, dans le bureau voisin, parler d’une voix tout ordinaire, et que la mort avait déjà marquée du doigt.
Sandrine se retourna. Il ne put s’empêcher d’observer le coin de ses lèvres… – Intact ! Plein et duveté comme un fruit incorruptible !
La voix reprit, et l’écart même entre son charme et la banalité des paroles dites rendait Roland plus vigilant.
« J’ai beaucoup, beaucoup aimé votre texte, disait Sandrine. Nous allons le publier en gros corps dans un encadré. À la dernière page, peut-être, qu’en pensez-vous ?
– Rien. Ce n’est pas mon domaine.
– Tant mieux ! Vous n’êtes pas journaliste ; ne le devenez jamais !
– Qu’est-ce que cela veut dire ? » Demanda-t-il en souriant.
Elle sourit aussi, mais se reprit presque aussitôt : l’échange de ces deux sourires si ouverts, si proches, ressemblait à un baiser.
« Cela veut dire… cela veut dire qu’il reste un cœur interposé entre les événements et votre papier. Vous êtes encore capable d’écrire un texte, et non pas, suivant notre langage, de la copie…
– De la « copie » ? Comme un écolier ?
– Au fait, vous êtes professeur de quoi ?
– D’enfants, comme tous les professeurs.
– Bien qu’enfant vous-même !
– Est-ce que chacun de nous…
– Je veux dire : sachant encore qu’il en est un », précisa-t-elle avec une sorte de gravité attendrissante.
Ils se turent un moment ; mais, parce qu’il ne voulait pas de nouveau lâcher les rênes à sa rêverie, il reprit doucement :
« Donc… en dernière page, peut-être ? »
Elle dut rompre elle-même – cela se vit – avec des pensées complaisantes et répondit un peu trop vite (pour rattraper quel temps perdu ?)
« Oui, mais mon but serait que vous finissiez par occuper cette dernière page.
– Tout entière ? Chaque semaine ?
– Tout entière, chaque semaine. Une sorte de bloc-notes : tout ce qui vous passera par l’esprit.
– Et par le cœur ?
– C’est un mot qui n’a guère sa place au Voltaire !
– Alors, je crains de…
– Rasseyez-vous !… C’est justement pour cette raison que vous y avez la vôtre. Voilà mon avis à moi.
– Depuis que vous m’avez lu ?
– Non, vu.
– Mais…
– Ah ! Ne le prenez pas mal ! Ne faites pas l’homme », ajouta-t-elle avec un sourire singulier.
Une page entière dans le journal qu’esprits forts et mauvais esprits -– mais ce sont les mêmes – avaient adopté et que le lieutenant Mansart devait détester si fort, quelle revanche ! Comme tous les bonheurs inespérés, celui-ci lui advenait presque par hasard, d’une manière merveilleusement injuste.
« Je ne sais pas si j’y parviendrai, dit Roland avec sincérité.
– Cela ne durera que si, précisément, vous n’êtes pas toujours sûr d’y parvenir… C’est la différence entre les véritables écrivains et les autres.
– Peut-être pourrez-vous m’aider, hasarda-t-il.
– C’est donc que vous acceptez ?
– Et vous ? »
Elle retira ses lunettes ; il vit des yeux désarmés, égarés dans ce visage si sûr de lui. « Ils sont sa vérité, pensa Roland ; tout le reste est conquête et maîtrise de soi » – et il en était rassuré et déçu.
« Ne jouons pas, comme les enfants, à qui ne s’engagera pas le premier !
– Alors, engageons-nous ensemble », proposa Roland en lui tendant la main.
Ce contact si simple, il en ressentait une envie physique ; et lorsqu’elle plaça sa main dans la sienne, son trouble dut le dénoncer car elle la retira trop vivement.
« Vous aider, mais comment ?
– En comptant sur moi », répondit-il d’une voix altérée ; et, comme cette parole le découvrait, il ajouta n’importe quoi :
« Et aussi en m’empêchant d’être trop naïf…
– Ne faites pas l’homme ! » Répéta-t-elle tout bas.
Elle remit ses lunettes ; mais il savait à présent qu’il existait une seconde Sandrine, et il désirait retrouver celle-là.
« J’aimerais… (Il dut affermir sa voix.) J’aimerais dîner avec vous un soir… Ce soir, par exemple ? »
Il s’était jeté à l’eau ; maintenant il réapparaissait à la surface, rouge, maladroit. Que la réponse était longue à venir !
« Oui, dit-elle enfin avec une gravité d’épousée.
– Il faut sans doute que vous préveniez chez-vous.
– Chez moi il n’y a que moi.
– Par contre, je dois téléphoner, reprit-il avec embarras. Oui, ma mère habite avec moi.
– Elle habite avec vous, ou bien vous habitez avec elle ?
– C’est la même chose », répondit-il mais il pensait : « Bien sûr que non ! » et se sentait stupide ; elle eut la charité de parler d’autre chose, très vite.
((Votre papier, on le signe Roland Guérin ? – Certainement pas ! Mes collègues… mes élèves… »
Il était devenu écarlate. « Deux initiales alors ? » « Même pas ! » songea-t-il ; et il proposa : « Un pseudonyme. C’est plus amusant, non ? » Ils cherchèrent, passèrent en revue les héros de Voltaire, de Musset, de Marivaux. Soudain elle s’immobilisa, un doigt levé, telle une sibylle ; puis le pointant lentement vers lui :
« Fabrice, décida-t-elle, Le Journal de Fabrice. » Il prit ce doigt, cette main, la porta à ses lèvres : « Merci, Clélia… »
Roland s’éveille, l’esprit débordant de rêves interrompus, le corps dispos. Il ressent cet « où suis-je ? » qui, le temps d’un éclair, remet en cause notre destinée entière et l’on pourrait aussi bien être hindou, mendiant ou vieillard. « Qui suis-je ? Où suis-je ? Et quelle heure est-il ? »
Il reprend pied en respirant cette odeur chaude et fraîche qui emplit la chambre et le trouble avant même qu’il en ait retrouvé la source. Sandrine…
Agrandissant des yeux que le sommeil scelle encore, il scrute les ténèbres voisines. Ce corps allongé près du sien, il en reconnaît déjà les formes. Il se penche sur Sandrine ; respire son air, sent monter en lui une sorte de gratitude, de chaleur, de certitude surtout. « Sandrine… »
Ce nom tout neuf, il le murmure. Invoquée du fond de sa nuit, la dormeuse change un peu d’attitude : à une cariatide en succède une autre, presque jumelle. Elle geint, à peine ; mais, dans cette plainte confuse, Roland retrouve l’écho de la voix qui l’envoûte.
« Sandrine… »
C’est elle seule qu’il aime en ce moment, leur fulgurante rencontre, leur entente absolue. Mais déjà il vient de penser : Le Voltaire… Le Journal de Fabrice… – et la satisfaction vient polluer sa joie ; son présent se ternit d’avenir.
Le visage blanc luit dans l’ombre, telle une veilleuse très basse. Mais Roland aperçoit aussi le cadran lumineux d’une pendule de chevet qui marque deux heures… « Quoi deux heures, et maman qui m’attend ! » Cette pensée submerge toute autre et le visage résigné de Mme Guérin oblitère aussitôt celui de Sandrine et la, dernière page du Voltaire.
« Sandrine, ma chérie, souffle-t-il. Sandrine, il faut que je te quitte… Je dois rentrer… »
Encore embrumée de sommeil ou déjà de volupté, la voix répond très bas :
« Tu vois bien que c’est toi qui habites chez ta mère… »
Presque aussi pâles qu’eux, deux bras nus émergent des draps flétris ; deux mains impatientes battent les ténèbres à la recherche de Roland, le trouvent, l’attirent irrésistiblement.