I
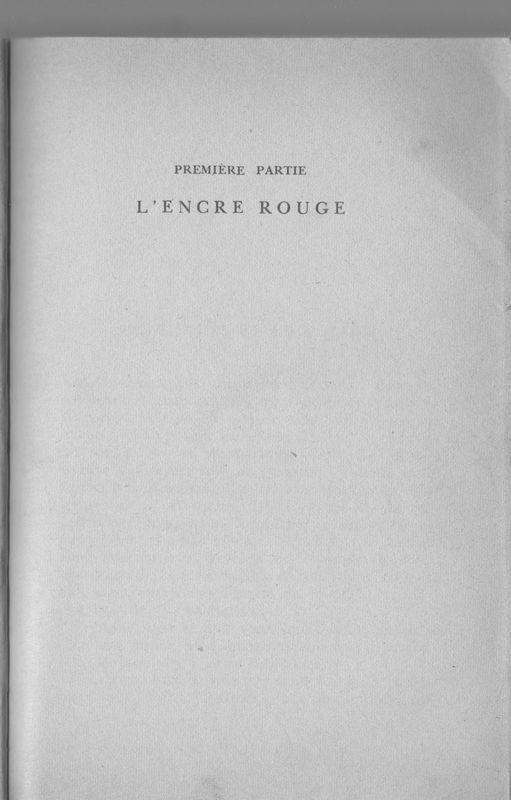 LES VAGUES ET LE
ROCHER
LES VAGUES ET LE
ROCHER
ROLAND aspira une ultime bouffée d’air frais avant de pénétrer dans ce café qu’il détestait d’avance. L’amère odeur de bière et de tabac froid l’investit aussitôt ; il s’y mêlait un relent d’urine – toilettes au sous-sol – et de parfum criard. Le garçon chauve s’empressa vers un guéridon douteux qu’il torcha puis désigna à Roland avec un sourire d’intelligence. « Pourquoi fait-il semblant de me connaître ? Jamais vu ! Et même, je refuse de regarder son visage… » Mais le patron qui bedonnait, gilet ouvert, derrière son comptoir lui souriait aussi de loin. Impossible d’éluder cette complicité avec toute la médiocrité du monde.
« Du thé », commanda-t-il.
Il savait que ce breuvage serait infect et servi dans une tasse épaisse, mais tant mieux : il ne voulait rien attendre d’autre de ce lieu.
Le patron souleva une trappe et descendit pesamment aux enfers. Roland sentit le remugle qui montait des dessous ténébreux et, dans un geste de défense enfantin, il enroula autour de son cou ce foulard de laine grise, beaucoup trop long que, tous les deux hivers, sa mère lui tricotait depuis l’enfance. Il aperçut, dans les glaces indiscrètes, son mince visage aux îlots d’ombre, ses yeux de velours noir sur lesquels une mèche retombait comme un rideau, le cache-col, les épaules un peu veules. Il n’aimait pas surprendre cette face étrangère, si différente de celle qu’il s’imaginait, et sur laquelle, pensait-il, se lisaient ses défauts. Il détourna donc son regard et vit une petite femme assise sur la banquette et qui le guettait timidement. « Si j’évite ses yeux, je paraîtrai la mépriser ; et, si je la regarde… »
Devant tous les êtres, Roland cherchait laborieusement l’attitude la moins humiliante pour eux, sans comprendre qu’un surcroît de précautions aussi visible les blesse bien plus sûrement. Mais il avait dix-huit ans, et la simplicité lui aurait paru la pire des disgrâces.
Non loin de l’apprentie prostituée qui ne demandait rien d’autre qu’un café au lait et un sourire, un besogneux écrivait. Ses papiers étalés sur le faux cuir de la banquette, le faux bois des chaises, le faux marbre de la table, l’homme avait si bien oublié les lieux qu’il se grattait la tête, se curait le nez et poussait de brèves exclamations tel un chien qui rêve. Son visage désert s’éclairait d’un sourire complaisant lorsque, la plume haute, il parcourait ces lettres quadrillées. « … Et que personne ne lira jusqu’au bout ! pensa Roland. Mais de quoi vivent-ils tous ? – Et de quoi vivrai-je ? » Le monde lui apparut soudain comme une ville fermée. Par quel hasard offrirait-il précisément un gagne-pain à chacun ? Parfois, en pleine rue, un vertige le saisissait : où se rendaient tous ces gens ? Que contenait leur serviette ? Et leur cerveau ?
Quelques tables plus loin, deux maigres et deux gros jouaient aux cartes, se taisant puis parlant tous ensemble. Roland fixa l’une des nuques épaisses, irriguées de vin rouge. « Lui ne se pose aucune question ! » Un moment, il rêva d’un monde purgé de tous ses Gros… « Il faut bien que tout le monde vive, Excellence ! – Je n’en vois pas la nécessité. » Cette réplique célèbre l’enchantait, le vengeait impunément des bistrots, des brutes, de tous ceux qui étaient plus forts que lui. Tous ces hommes de main… Il regarda les siennes, blanches, minces, devenues à ce point les jumelles de celles de sa mère qu’elle s’amusait parfois à les joindre deux à deux, indiscernables.
Une clameur ébranla les glaces, les tables et fit sursauter la petite prostituée.
« Les voilà qui reviennent, dit le patron. (Son ventre remuait lorsqu’il parlait.) Si ça continue, faudra fermer, Ernest.
–… que c’est ? demanda une nuque rouge sans se retourner.
– Les étudiants qui manifestent.
–… petits cons, décréta la nuque. Carreau ! J’annonce le roi.
– C’est un bel homme », fit l’un des joueurs avec une gravité de diacre.
Roland se sentit rougir : « Ce sont eux, les… les imbéciles ! Sortons manifester contre eux, contre tous les Gros ! » – Mais il ne bougea pas.
La vague était passée ; un troupeau d’agents la suivit d’une course pesante. Roland imagina le patron et les joueurs en pèlerine et képi bleus ; cela leur allait bien. La pendule sonna avec une indifférence hautaine. Un jeune homme attablé devant un verre intact tressaillit, consulta sa montre, la remit à l’heure, soupira, aperçut dans les glaces Roland qui l’observait.
« Elle ne viendra pas, mon pauvre vieux… Tu m’as vu t’observer et tu prends l’air indifférent. La vie est un jeu de miroirs. Trop compliqué pour moi… » Pourtant, sans cette complication, quel prix aurait-il attaché à la vie ?
Dans le silence retombé, Roland entendit renifler doucement. Il chercha de nouveau à travers le labyrinthe des miroirs. Dans le coin le plus retiré, un couple achevait de se désunir. La femme pleurait comme saigne un blessé abandonné ; elle avait épuisé toutes ses défenses. L’homme paraissait dur, fermé : un rocher indifférent à cette petite source – et Roland le détesta. De tout son cœur il donnait raison à celle qui pleurait, raison d’avance aux faibles, aux offensés. Le monde, à ses yeux, se divisait en deux : les bourreaux, les victimes, et dès longtemps il avait choisi ses alliés. « Mais Georges, se demanda-t-il – c’était son ami d’enfance qu’il attendait dans ce café du Quartier latin – dans quel camp est passé Georges ? À moins qu’il ne soit devenu un Gros ! »
La jeune femme tenta un dernier argument, quelque humble concession qui l’humiliait elle-même ; elle tournait vers l’homme un visage qui devenait laid à mesure qu’il était moins aimé. Dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, elle-même ne s’aimerait plus ; elle serait perdue. Le rocher n’abaissa pas les yeux sur elle ; il comptait impatiemment le temps qu’il lui fallait perdre, et sans doute se trouvait-il très charitable de n’être pas encore parti ; mais déjà ils ne respiraient plus le même air.
« Quelle sale gueule de vainqueur », murmura Roland.
Il éprouvait un désir assez trouble de consoler la fille. Elle devait sentir les larmes… Il songea à cette odeur triste, à ces lèvres gonflées, et se jugea ignoble. Casser la figure du type, ça oui ! Et puis, une fois en train, tout briser dans la baraque, viser les bouteilles une par une… Mais il n’aperçut dans la glace, devant lui, qu’un jeune homme maigre, affublé d’un cache-col gris et dont le regard paraissait l’implorer.
Les trompes discordantes des voitures de police se firent entendre ; elles devinrent soudain si assourdissantes que les joueurs de cartes eux-mêmes tournèrent la tête : quelqu’un venait d’ouvrir la porte.
« Georges !
– Roland ! »
Un instant, ils demeurèrent face à face en silence, puis ensemble ils éclatèrent de rire. C’était trop drôle, ces petits garçons déguisés en hommes ! Tant d’événements, une guerre mondiale, et se retrouver si semblables… « C’est trop drôle, pensait Roland, ses moustaches presque rousses ; et cette brosse de cheveux qui avance en pointe sur le front : on dirait l’as de cœur ! Et sa dent de devant, cassée en biais comme un couperet de guillotine… » L’œil aigu de Georges (le gauche) discerna que le regard noir s’attardait sur cette dent :
« Oui, mon vieux, cassée l’année dernière.
– Dans une bagarre.
– Comment le sais-tu ?
– Un ensemble ! » Répondit Roland avec un geste enveloppant de ses deux mains blanches.
L’autre regarda ces mains et remarqua :
« Tu n’as pas engraissé. »
« Mais toi, pensa Roland, tu as épaissi. Est-ce que je deviendrai jamais un homme ? » Si c’était cela : cette sorte d’assurance, cette cuirasse invisible qui durcissait jusqu’au visage de son ami, ce sang à fleur de peau, il s’en sentait tout à fait éloigné.
« Qu’est-ce que tu bois ? – Comment va ta mère ? – Où allez-vous habiter ? – Quelles études ?… » Les questions fusèrent en gerbe et les garçons durent mettre de l’ordre dans leur curiosité comme on reprend son souffle.
« L’agrég si je peux, répondit Roland ; sinon, la licence.
– Tu veux être prof ? Au fond, ça ne me surprend pas.
– Et pourquoi ? » Demanda l’autre un peu trop vivement.
Les mains aux doigts carrés imitèrent pesamment le geste de tout à l’heure : « Un ensemble »… Tiens, je parie que tu étais pour Pétain.
– Ma mère, oui.
– Mais, toi ?
– Oh ! Moi… Écoute, reprit-il en souriant, il n’y a pas cinq minutes que nous nous sommes retrouvés après cinq ans, et nous parlons déjà de Pétain et de l’autre. La barbe ! Ne soyons pas aussi bêtes que les grands ! »
Georges posa sa main sur son bras :
« Mais nous sommes « les grands ».
– Pas moi ! » Cria Roland.
Georges choisit d’en rire mais son regard devint celui d’un étranger.
« Georges, reprit le jeune homme d’une voix altérée, est-ce que tu penses quelquefois à la mort ?
– Jamais. »
Question et réplique avaient été pareillement spontanées, absurdes, essentielles. Ils se regardèrent, en silence.
« Je ne sais pas pourquoi je t’ai demandé cela… »
La réponse de Georges l’avait tout ensemble déçu et rassuré ; il ressentait un besoin absolu de s’annexer son amitié, de faire alliance avec cet étranger que la faiblesse, la mort semblaient ne jamais devoir atteindre. « Mais qu’il n’en sache rien ! »
Le tumulte les sauva de leur embarras : de nouveau les manifestants déferlèrent dans la rue en scandant des injures.
« Allons, bon ! fit le patron d’un air écœuré. Ils remettent ça…
– Qu’est-ce qui se passe ? » Demanda Georges.
Roland lui expliqua qu’on venait d’attribuer une chaire en Sorbonne à un maître dont les opinions politiques déplaisaient à certains…
« Allons-y !
– Mais tu ne sais même pas quelles opinions…
– Je suis donc forcément pour ou contre. Viens !
– Non, dit Roland, j’ai horreur des bagarres idiotes. »
Georges enfila ses gants de cuir et se leva.
« À moins que tu n’aies horreur des bagarres tout court ?
– C’est qu’elles sont toujours idiotes, fit Roland d’une voix tremblante. Mais puisque tu ne peux pas t’en passer, allons-y ! »
Il laissa trop d’argent sur la table, heureux d’accabler le garçon de sa générosité comme Georges l’accablait lui-même de sa force ; mais Ernest-le-chauve l’en méprisa seulement.
« Savent pas quoi faire de leur temps et de leurs sous, ces deux-là, dit-il amèrement au patron.
– Oui, fit l’autre qui avait trouvé le moyen d’engraisser sous l’Occupation, cinq ans de bagarres, ça ne leur suffit pas ! »
Georges et Roland sortirent sur le seuil et la jeune foule, tel un fleuve en crue, les arracha brutalement à leur rive. Ils furent emportés, roulés un long moment avant de reprendre pied.
Mouton que le troupeau piétine, Roland se défendait mal ; Georges moulina des poings avec bonne humeur jusqu’à se frayer un passage.
« Ah ! On respire mieux ! Mais… où est-il passé ?… Roland ! Ho ! Roland, viens par ici ! »
L’autre, dont les tempes battaient, n’entendait rien à travers le chahut. Il vit seulement la main de cuir lui faire signe impérieusement ; il rejoignit et, lorsqu’ils furent côte à côte. :
« Ne me lâche plus, commanda Georges. Je ne comprends rien à ce qu’ils crient, ceux-là ! (Roland le lui expliqua.) Ah ! Bon. »
Et il se mit à brailler un nom qu’il ignorait un instant plus tôt mais d’un tel coffre que ses voisins le dévisagèrent, bouche bée. Lui-même tourna vers Roland une face radieuse :
« C’est marrant, non ? »
« Non ! pensa Roland, c’est seulement dégradant – et il gardait les lèvres serrées. Il n’y a aucune raison que cela se termine ! Quelle heure est-il ? » Il eût souhaité que le soir tombât vite ; mais c’était l’arrière-saison : l’été tiède et tenace refusait de mourir.
L’un des manifestants, une sorte de géant à la tête creuse, fit provision de souffle et lança un nouveau slogan plus injurieux encore que le précédent. Les autres bafouillèrent, hésitèrent un moment comme un convoi sur un aiguillage, puis entonnèrent.
« Pourvu que la police… » Roland n’eut pas le temps d’achever cette pensée.
« Chouette, les flics ! murmura Georges. Serre les dents ! »
Les cars bleus venaient de s’arrêter et, telles des bennes, déversaient aveuglément sur le boulevard Saint-Michel du casque sombre et de la pèlerine roulée. Couleurs de pompes funèbres, quelques officiers noirs galonnés d’argent donnaient à grands gestes des ordres évidents.
Les slogans des manifestants se fondirent en une clameur faite à la fois de crainte et d’excitation. Les premiers rangs s’arrêtèrent, voulurent refluer ; les suivants butèrent contre eux, puis le fleuve incertain se divisa. Déjà, pareils à des joueurs de rugby, les agents de tête « marquaient » chacun leur adversaire.
« Groupez-vous à gauche ! hurla Georges, la rue est libre… À gauche, tous ! » Répéta-t-il avec un geste de tragédien – mais comment orienter une mêlée aussi confuse ?
Un œil sur leurs troupes, l’autre sur les agents, les chefs se démenaient :
« Regroupement devant la gare du Luxembourg. Faites passer ! »
Roland, paralysé par la panique, s’aperçut qu’il dérivait sans résistance vers la police.
« Qu’est-ce que tu fous ? »
Il sentit une maîtresse poigne l’agripper en vain par la manche, par son col qui se déchira, enfin par les pans du foulard gris.
« Tu m’étr…
– Amène-toi, crétin ! »
Il s’abandonna à cette machine de guerre qui lui ouvrait, à coups de pied, à coups de poing, une sortie parmi les fuyards. La stratégie de Georges était la bonne : ceux qui l’avaient suivi se retrouvèrent à l’abri dans la rue de la Sorbonne, trop étroite pour que s’y risquent les agents. Comme ils observaient les combattants :
« Ce que je ne peux pas encaisser, dit Georges en serrant les poings, c’est le trois contre un. Regarde les flics !
– Et les nôtres ! Ils en font autant dès qu’ils le peuvent. C’est la règle de toute guerre : on ne la déclare, si possible, qu’à trois contre un, et ce sont toujours les trois qui finissent par la gagner. Sans intérêt ! conclut Roland d’une voix que l’essoufflement rendait véhémente.
– Tu es trop intelligent pour moi, gronda Georges. Si toutes les guerres…
– Sylvie ! »
C’était presque un cri de douleur. Georges vit son compagnon se jeter en avant, puis s’immobiliser, hésiter, repartir. Il le rattrapa encore une fois par son cache-col gris qui volait.
« Où vas-tu ? Tu es fou !
– Sylvie, une amie… La fille en vert, là-bas, coincée par les types…
– Reste ici ! J’y vais.
– Non, moi ! » Réclama faiblement Roland.
Mais l’autre fonçait déjà, tel un bélier, la tête en avant. On le vit fendre le reflux, sauter sur le dos d’un agent avec une précision de félin, le faire virevolter, profiter de son désarroi pour empoigner Sylvie, l’entraîner et se fondre dans un groupe afin d’éviter les représailles qui couraient vers lui sur de grosses chaussures.
Roland se glissa jusqu’à eux. Quand il bousculait les gars, il ne pouvait s’empêcher de murmurer « Pardon ! »
« Sylvie (il se sentait assez honteux), je te présente Georges. C’est mon ami. »
Aucun des deux autres n’eut le temps de faire une phrase. Une vague de fond balaya la place de la Sorbonne ; les agents s’étaient subitement regroupés et chargeaient en masse. Comme une seule fleur rouge au milieu d’un bouquet, on perçut distinctement, parmi la clameur, le cri de douleur d’un étudiant piétiné. Sylvie tourna vers les garçons ses yeux de chat que la crainte arrondissait encore.
« Venez tous les deux », commanda Georges.
Il contourna le buste d’Auguste Comte étoilé d’encre rouge, voulut descendre la petite rue – mais non ! Les casques noirs se profilaient en bas…
« Quel jeu d’idiots ! Tous des gosses, tous ! » Dit Roland rageusement. Il ne pensait alors qu’à Sylvie, pas encore à lui dont les jambes tremblaient.
Les trois remontèrent en courant le long de la Sorbonne. « Pourvu que nous puissions atteindre la rue Cujas avant que les flics… Ouf ! » Ils tournèrent le coin ; Sylvie perdait un de ses souliers ; il fallut plonger à sa recherche, vite, vite !… Toujours courant, ils longèrent une porte verte, tatouée d’inscriptions et qui paraissait condamnée. Georges se jeta sur elle de tout son poids ; une serrure dut céder car le lourd vantail s’entrouvrit.
« Filez par là, vous deux ! Commanda-t-il en frottant son épaule meurtrie.
– Et toi ?
– Ça va chauffer, ça m’amuse. Je reste.
– Alors, moi aussi, dit Roland sans entrain.
– Fous-moi la paix ! »
Georges le jeta presque dans l’entrebâillement où Sylvie avait déjà disparu puis il détala.
D’instinct, Roland repoussa le battant : en interdisant ce refuge aux autres fuyards, il lui semblait redoubler sa propre sécurité. C’était un geste ignoble, il le sentit trop tard.
Les cris, les sifflets, les sirènes, tout parut soudain très lointain, irréel. L’on n’entendait plus, dans ces demi-ténèbres, que le souffle haletant de Sylvie et le sien ; on n’y respirait plus que l’odeur, hors du temps, des lieux abandonnés.
« Où sommes-nous ? » demanda la jeune fille.
Ses jambes lui manquaient ; elle aurait voulu s’asseoir, mais sur quoi ? Des tas de copies, d’archives, de dossiers où la crasse émergeait ; des bustes d’inconnus que la poussière avait maquillés ; des vestiges d’appareils de physique qui devaient autrefois servir à démontrer des évidences. Ce désordre, cette terrifiante immobilité des musées de cire – on eût dit que la guerre était passée par là, ou quelque grand désastre qui fige à jamais les décors et les gens dans une éternité triviale ; mais c’était seulement la dévastation impassible du Temps.
« Ils appellent cela une « réserve », dit Roland, et moi un cimetière. Si c’est tout ce qui reste des choses de l’esprit, qu’est-ce qui vaut la peine de vivre ?
– Peut-être le bonheur », hasarda Sylvie.
Il lui jeta un regard singulier ; elle vit, dans la pénombre, étinceler ce diamant noir. Puis, après un silence qui ne pesait à aucun d’eux, Roland rejeta brusquement sa mèche comme s’il voulait, du même geste, chasser ses pensées.
« Ne restons pas ici ! »
Il l’entraîna par la main doucement. La porte grinça quand il l’entrouvrit sur un couloir toujours aussi triste. L’odeur de poussière s’éloignait ; un jour avare parvenait jusqu’à eux. Roland s’arrêta, plissa son front, décida de prendre à gauche : une porte vitrée, un escalier…
« Où m’emmènes-tu ?
– Ne t’inquiète pas, à la Sorbonne je suis chez moi ! »
« Chez moi »… L’immense ruche d’ombre et de silence le revanchait des bagarreurs, des braillards et des uniformes.
« C’est plutôt désert « chez toi », observa Sylvie en riant.
– Tant mieux ! »
Il s’amusa à l’égarer un peu dans ce vieux bâtiment qu’il aimait, dont il aimait jusqu’à la vétusté, l’air confiné, la poussière vénérable. Tant d’esprits s’étaient ouverts ici pour donner ou recevoir… Tant de têtes chenues avaient confié à de plus jeunes le trésor de leurs veilles, à la condition qu’à leur tour ils en instruisissent d’autres…
Ils étaient parvenus à un petit amphithéâtre, calme comme une église, désert et habité comme elle. Malgré soi, on y marchait sur la pointe des pieds. Roland poursuivit tout haut sa pensée :
« Transmettre à d’autres ce qu’on a reçu, faire aimer ce qu’on a aimé, Sylvie, c’est la seule façon d’arrêter le Temps.
– Tu disais le contraire, tout à l’heure, dans la « réserve ».
– Je me trompais. Ce ne sont pas les papiers ni les livres qui comptent : seuls les esprits, les esprits vivants », répéta-t-il avec respect.
Sous le regard des vitres mornes, il monta cérémonieusement s’asseoir dans cette chaire modeste, presque délabrée, mais à laquelle aucun trône ne pouvait être comparé ; car aucune puissance, à ses yeux, n’égalait celle d’enseigner des esprits qui en enseigneraient de nouveaux jusqu’à la fin des temps. Assis à la place du maître, il osa tourner vers Sylvie un regard dénué pourtant de tout orgueil. Elle n’y lut qu’une sorte de joie, de plénitude presque physique. Y a-t-il de l’orgueil à nager ? Et parce qu’elle ne souriait pas de lui, il acheva :
« Sylvie, c’est le plus noble des métiers.
– Quel métier prépare ton ami Georges ? »
Il se leva brusquement.
« Je ne sais pas.
– Officier ? »
À son tour, elle avait prononcé ce mot avec une sorte de considération ; et, de nouveau, il la regarda bizarrement. Se faire officier au lendemain d’une guerre définitive, cela lui paraissait absurde, déplacé.
« Pourquoi pas ? répondit-il avec une feinte légèreté, il en faut aussi ! Mais… (Il se rassit.) Tu comprends bien ce que je disais tout à l’heure, Sylvie ? Et tu le ressens aussi, n’est-ce pas ? »
Il mendiait. Si fragile dans son désert vermoulu, il avait l’air d’un pauvre. Ils s’en rendirent compte ensemble ; Roland se redressa, et Sylvie courut gracieusement s’asseoir sur l’un des bancs de l’amphithéâtre :
« Moi, tu sais, je suis encore du mauvais côté -de la chaire : celui des élèves ! »
Ils sourirent, mais seuls leurs regards disaient la vérité. Et Roland lut une telle tendresse dans celui de la jeune fille qu’il se leva, s’approcha d’elle très lentement sans la quitter des yeux, fit de ses deux mains un écrin blanc, juste à la forme des joues rondes. Il sentit battre les tempes tièdes sous l’extrémité de ses doigts ; et il allait parler, mais elle donna à ses lèvres une moue en forme de « chut », en forme de baiser aussi. Alors il se pencha sur elle et l’embrassa puis, très vite, posa sa joue contre cette autre si douce afin d’échapper à son regard.
« Sylvie, murmura-t-il, j’ai besoin de partager. – Même tous tes goûts ? Même le métier ? » Elle avait mis une pointe d’anxiété dans sa voix, Roland ne la perçut pas et prit cette question pour un acquiescement.
« Bien sûr, c’est-cela le bonheur dont tu parlais. »
« Non, pensa-t-elle, c’est seulement commode ! Maintenant, je le sais : il aimera toujours la Sorbonne et l’Enseignement plus que moi… » Elle souffrit ; tandis que Roland, qui n’observait pas son visage, vivait peut-être l’instant le plus heureux qu’il eût connu.
En portant à ses lèvres cette main tout abandonnée, Roland remarqua pour la première fois sa robustesse et la carrure des doigts – le contraire même des mains de sa mère. Il en éprouva une gêne confuse : trahir, il lui semblait trahir. Mais elle murmura « Roland », et il pensa avec angoisse et ravissement qu’il ne pourrait jamais se passer du son de cette voix.
Ils firent silence à l’unisson de la vieille maison assoupie sur son savoir et sa patience : l’un contre l’autre, un couple d’oiseaux nichés au creux d’un arbre déserté. Le temps s’était arrêté ; un silence insolite… Parfois, à l’autre extrémité du grand corps immobile, un craquement, un tassement que personne n’entendrait ; comme si des fantômes respectueux traversaient les amphithéâtres au bois dormant, les bibliothèques hantées.
Et tout d’un coup, une clameur aiguë fit trembler les vitres. Les deux jeunes gens se précipitèrent à la croisée et virent de haut : les grilles puis les portes de la Sorbonne venaient de céder sous la poussée des manifestants et ceux-ci remplissaient la cour intérieure, indécis, cherchant une issue, pareils à des chevaux sauvages qu’on vient de pousser dans l’enclos. Certains avaient trouvé refuge derrière les statues de Pasteur et de Victor Hugo comme les enfants croient se cacher derrière des arbres. Aussi incertains qu’eux, les policiers s’étaient arrêtés sur ce seuil violé et attendaient des ordres. Imperceptible instant où les chiens, cernant le cerf immobile, ne l’attaquent pas encore…
« Descendons ! » dit Sylvie.
Il lui semblait que leur place était là-bas, dans ce rempart naïf entre les hommes d’armes et leur école, parmi ces braillards, leurs camarades, qui venaient comme d’habitude de se taire en pénétrant entre ces murs si respectables.
« Descendons avec eux ! »
Elle releva la tête vers Roland et le vit si pâle qu’elle prit peur. Il torturait les pans de son cache-col ; les coins de sa bouche tremblaient un peu.
« Non… Non, reprit-il en raclant sa gorge pour affermir sa voix, au contraire ! »
Il la saisit par le poignet (que sa main était froide !) et l’entraîna, mi-marchant mi-courant, dans le dédale familier des corridors et des escaliers. Un moment, des cris violents trouvèrent leur chemin jusqu’aux fuyards ; mais Roland se mit seulement à courir plus vite en murmurant : « Les brutes ! » Ils parvinrent enfin devant une porte basse que le garçon ouvrit sans peine et se retrouvèrent rue Saint-Jacques où des promeneurs allaient, de leur pas d’automne, sans paraître se douter qu’à cent mètres de là…