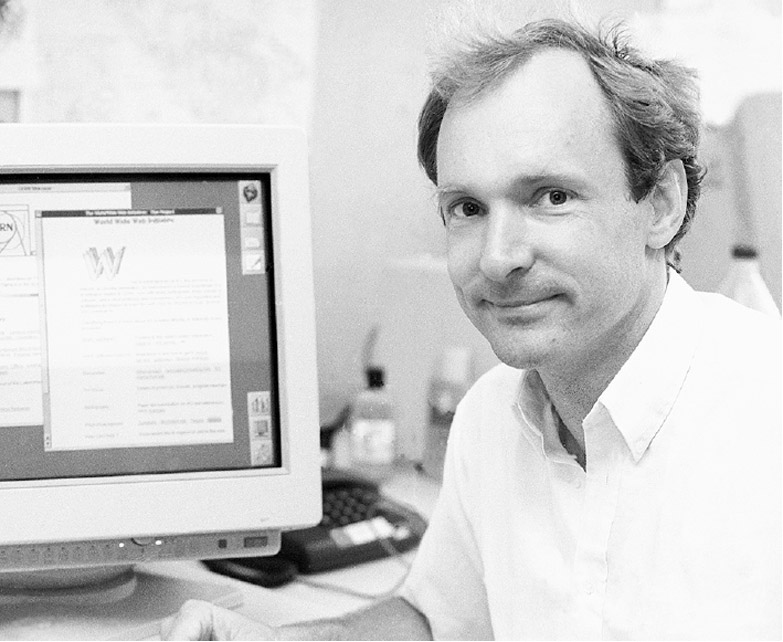En ligne
Internet et l’ordinateur individuel naquirent tous les deux dans les années 1970, mais se séparèrent en grandissant. Évolution insolite, d’autant plus qu’ils continuèrent de se développer séparément pendant plus d’une décennie. C’était d’abord à cause d’une différence d’état d’esprit entre les gens qui embrassaient les joies du réseautage et ceux qui avaient le vertige à la pensée de pouvoir disposer de leur propre ordinateur. Contrairement aux utopistes du projet Community Memory qui adoraient fonder des communautés virtuelles, beaucoup des premiers fans de l’ordinateur individuel étaient des geeks qui voulaient faire cavalier seul sur leur propre machine, du moins au début.
Il y avait aussi une raison plus concrète à cette évolution séparée de l’informatique individuelle et des réseaux. L’ARPANET des années 1970 n’était pas ouvert aux citoyens ordinaires. En 1981, Lawrence Landweber, de l’université du Wisconsin, réunit un consortium d’universités non connectées à ARPANET pour créer un autre réseau fondé sur les protocoles TCP/IP, qui fut appelé CSNET. « Le réseautage n’était disponible que pour une petite fraction de la communauté des chercheurs en informatique à l’époque », confirmerait Landweber en 20141. CSNET devint le précurseur d’un réseau financé par la National Science Foundation, NSFNET. Mais même après qu’ils furent tous intégrés à la trame d’Internet au début des années 1980, il était difficile pour un simple particulier disposant d’un ordinateur individuel d’accéder au réseau. Il fallait en général être affilié à une université ou à un établissement de recherche pour pouvoir se connecter.
Si bien que pendant presque quinze ans, à partir du début des années 1970, la croissance d’Internet et le boom de l’informatique individuelle progressèrent en parallèle. Ils ne s’imbriquèrent pas avant la fin des années 1980, quand des particuliers, chez eux ou au bureau, purent enfin composer un code et se retrouver en ligne. Ce qui déclencherait une nouvelle phase dans la révolution numérique et concrétiserait la vision de Bush, Licklider et Engelbart, pour qui les ordinateurs augmenteraient l’intelligence humaine en devenant des outils favorisant à la fois la créativité et la collaboration.
Le courrier électronique et la télématique
« La rue trouve toujours le moyen de se servir du progrès à ses propres fins », écrivait William Gibson dans « Gravé sur chrome », sa nouvelle cyberpunk de 1982. De même, les chercheurs qui avaient accès à ARPANET surent s’en servir à leur manière. Ce réseau était censé permettre l’accès à des ressources informatiques en temps partagé. Ce en quoi il fut un modeste échec. En revanche, à l’instar de nombreuses technologies, il se propulsa vers le succès en devenant le véhicule des communications et du réseautage social. L’une des vérités de l’ère numérique est que le désir de communiquer, de se connecter, de collaborer et de former des communautés tend à créer des applications phares. La première qui apparut sur ARPANET fut le courrier électronique (e-mail), en 1972.
Le courrier électronique était déjà utilisé par des chercheurs connectés en temps partagé au même ordinateur. Un programme appelé SNDSMG permettait à l’utilisateur d’un gros ordinateur central d’envoyer un message à destination du dossier personnel d’un autre utilisateur du même ordinateur. Fin 1971, Ray Tomlinson, un ingénieur du MIT qui travaillait chez BBN, décida de concocter un programme sympa qui permettrait d’envoyer de tels messages à des dossiers résidant sur d’autres ordinateurs centraux. Il y parvint en combinant SNDSMG avec un programme expérimental de transfert de fichiers appelé CPYNET, qui pouvait échanger des fichiers entre ordinateurs éloignés sur ARPANET. C’est alors qu’il trouva quelque chose d’encore plus ingénieux : afin d’ordonner à un message d’aller dans le dossier d’un utilisateur basé dans un site différent, il utilisa le signe @ de son clavier pour créer la syntaxe d’adressage dont nous nous servons tous désormais : nom d’utilisateur@nom de domaine. Ainsi Tomlinson créa-t-il non seulement le courrier électronique, mais aussi le symbole iconique du monde connecté2.
ARPANET permettait à des chercheurs d’un centre donné de puiser dans les ressources informatiques d’un autre centre, mais cela se produisait rarement. Au lieu de quoi le courrier électronique s’imposa comme la principale méthode de collaboration. Le directeur de l’ARPA, Stephen Lukasik, devint l’un des premiers fanatiques du courriel, forçant ainsi tous les chercheurs qui avaient besoin de traiter avec lui à l’imiter. L’étude qu’il commanda en 1973 montra que, moins de deux ans après son invention, le courrier électronique représentait soixante-quinze pour cent du trafic sur ARPANET. « La plus grande surprise du programme ARPANET a été l’incroyable popularité et le succès non moins incroyable du courrier réseauté », concluait un rapport de BBN quelques années plus tard. Ce n’aurait pas dû être une surprise. Non seulement le désir de réseautage social impulse les innovations, mais il les coopte aussi.
Le courrier électronique fit plus que faciliter les échanges de messages entre deux utilisateurs d’ordinateurs. Il conduisit à la création de communautés virtuelles, celles qui, ainsi que l’avaient prédit Licklider et Taylor en 1968, étaient « choisies plus sur la base d’une communauté d’intérêts et d’objectifs que par une proximité physique accidentelle. »
Les toutes premières communautés virtuelles démarrèrent avec les chaînes de courriels distribués à de vastes groupes d’abonnés autosélectionnés, qu’on appela ensuite listes de diffusion. La première liste importante fut SF-Lovers, créée en 1975 pour les amateurs de science-fiction. Au début, les responsables de l’ARPA voulaient la supprimer de peur qu’un sénateur quelconque puisse ne pas apprécier que l’argent de l’armée soit utilisé pour soutenir un repaire virtuel de fans de SF, mais les administrateurs du groupe réussirent à faire valoir que c’était un exercice valable pour qui voulait s’entraîner à jongler avec de vastes échanges d’informations.
D’autres méthodes de formation de communautés en ligne apparurent. Certaines utilisaient Internet comme réseau de base ; d’autres étaient plus orientées. En février 1978, deux membres du groupe d’informaticiens amateurs Chicago Area Computer Hobbyists’ Exchange, Ward Christensen et Randy Suess, se trouvèrent bloqués par une tempête de neige exceptionnelle. Ils profitèrent de ce repos forcé pour développer le premier serveur télématique (BBS pour Bulletin Board System), qui permettait aux hackers, aux informaticiens amateurs et à des « sysops » (system operators) autoproclamés de monter leurs propres forums en ligne et de proposer des fichiers, des logiciels piratés, des informations et l’affichage de messages. Quiconque disposait d’un moyen de se connecter en ligne pouvait participer. L’année suivante, des étudiants de l’université Duke et de l’université de Caroline du Nord, qui n’étaient pas encore connectées à Internet, développèrent un autre système, hébergé sur des ordinateurs individuels, qui proposait des forums de discussion avec des fils conducteurs pour les questions et réponses. On l’appela Usenet, et les catégories des messages affichés devinrent des groupes ou forums de discussion (newsgroups) spécialisés. En 1984, il y avait déjà près d’un millier de terminaux Usenet dans des universités et d’autres établissements d’un bout à l’autre des États-Unis.
Même avec l’apparition de ces serveurs télématiques et des forums Usenet, la plupart des simples particuliers possesseurs d’ordinateurs individuels avaient bien du mal à rejoindre des communautés virtuelles. Il leur fallait un moyen de se connecter, ce qui n’était pas facile à partir de leur domicile ou même de la plupart des bureaux. C’est alors qu’au début des années 1980 apparut une innovation, mi-technologique mi-juridique, qui semblait mineure au départ, mais qui eut un énorme impact.
Les modems
Le petit appareil qui réalisa enfin la liaison entre l’ordinateur de salon et les réseaux mondiaux s’appelait un modem. Il pouvait moduler et démoduler (d’où son nom) un signal analogue tel que celui acheminé par un circuit téléphonique afin d’émettre et de recevoir des informations sous forme numérique. Il permettait ainsi aux particuliers de connecter leurs ordinateurs à d’autres par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique. La révolution en ligne pouvait alors commencer*1.
Elle mit longtemps à venir, car AT&T avait un quasi-monopole sur le système téléphonique américain et contrôlait même le matériel que vous utilisiez chez vous. Vous ne pouviez pas connecter quoi que ce soit à votre ligne téléphonique, ni même à votre téléphone, à moins que « Maman Bell » vous l’ait loué ou approuvé. Bien qu’AT&T ait proposé des modems dans les années 1950, ils étaient lents et hors de prix, principalement conçus pour un usage militaire ou industriel, et pas vraiment pour inciter des électroniciens amateurs à créer des communautés virtuelles.
C’est alors qu’il y eut l’affaire du Hush-A-Phone. Il s’agissait d’un simple dispositif en plastique dont on coiffait la partie microphone du combiné pour amplifier la voix : en parlant moins fort, on réduisait le risque d’être écouté par l’entourage. Il existait depuis vingt ans sans faire de mal à personne lorsqu’un juriste de chez AT&T en aperçut un dans une vitrine. La société décida d’attaquer le fabricant en justice, alléguant que tout dispositif externe non agréé par elle, y compris un petit cône en plastique, était susceptible de porter atteinte à son réseau. Ce qui montre jusqu’où AT&T était capable d’aller pour protéger son monopole.
Par bonheur, ses efforts se retournèrent contre elle. Elle fut déboutée par une cour d’appel fédérale, et les barrières interdisant de se brancher sur son réseau commencèrent à s’effondrer. Il était toujours illégal de brancher un modem électroniquement sur le réseau téléphonique, mais on pouvait y parvenir d’une manière mécanique, par exemple en prenant le combiné et en le posant dans les oreillettes à ventouse d’un coupleur acoustique. Au début des années 1970, il existait quelques modems de ce type, dont le Pennywhistle, conçu par Lee Felsenstein pour une clientèle d’amateurs, qui pouvait émettre et recevoir des signaux numériques à la cadence de trois cents bits par seconde*2.
La deuxième étape fut réalisée lorsqu’un cow-boy texan obstiné gagna, après une bataille juridique de douze ans qu’il finança en vendant son bétail, le droit pour ses clients de communiquer avec lui au moyen d’un combiné téléphonique de son invention adapté à la radio. Il fallut quelques années pour élaborer toute la réglementation, mais dès 1975 la Commission fédérale des communications (FCC) ouvrit la voie aux consommateurs désirant raccorder des dispositifs électroniques au réseau.
Les règles étaient draconiennes, vu le lobbying intensif d’AT&T, si bien qu’à l’origine les modems électroniques étaient relativement onéreux. Mais en 1981, Hayes commercialisa son Smartmodem. On pouvait le brancher directement sur une ligne téléphonique et le connecter à un ordinateur, sans avoir besoin d’un poussif et encombrant coupleur acoustique. Bricoleurs, cyberpunks et autres pionniers, mais aussi l’utilisateur moyen d’un ordinateur de salon pouvaient saisir le numéro d’un fournisseur d’accès, retenir leur souffle en attendant le grincement parasité qui annonçait l’établissement de la connexion, puis se brancher sur les communautés virtuelles qui se formaient autour des services télématiques, des forums Usenet, des listes de diffusion et autres bonnes adresses en ligne.
The WELL
Presque à chaque décennie de la révolution numérique, l’amuseur amusé Stewart Brand trouvait le moyen d’être là où se chevauchaient la technologie, la communauté et la contre-culture. Il avait produit le spectacle techno-psychédélique pour le Trips Festival de Ken Kesey, réalisé un reportage sur Spacewar et le Xerox PARC pour Rolling Stone, co-organisé la Mère de toutes les démos de Douglas Engelbart et fondé le Whole Earth Catalog. Il n’était donc pas surprenant que, en automne 1984, juste au moment où les modems devenaient disponibles et les ordinateurs individuels conviviaux, Brand contribue à imaginer l’idée d’un prototype de communauté en ligne, The WELL.
Tout commença lorsque Brand reçut la visite d’un autre de ces créateurs ludiquement sérieux de la contre-culture technologique, Larry Brilliant. Médecin et épidémiologiste, Brilliant avait le désir irrésistible de changer le monde tout en s’amusant. Il avait été le médecin de service lors de l’occupation d’Alcatraz par les Indiens, cherché la spiritualité dans un ashram himalayen avec le célèbre gourou Neem Karoli Baba (c’est là que son chemin croisa pour la première fois celui de Steve Jobs), s’était engagé dans la campagne de l’Organisation mondiale de la santé pour éradiquer la variole et, avec le soutien de Jobs et de sommités de la contre-culture comme Baba Ram Dass et Wavy Gravy (Richard Alpert et Hugh Romney), avait créé la fondation Seva, axée sur la lutte contre la cécité dans les communautés défavorisées du monde entier.
Lorsqu’un des hélicoptères utilisés par la fondation Seva au Népal eut des problèmes mécaniques, Brilliant recourut à un système de consultation à distance avec un Apple II donné par Jobs pour organiser une mission de réparation. Il fut impressionné par le pouvoir potentiel des groupes de discussion en ligne. Quand il alla enseigner à l’université du Michigan, il contribua à édifier une entreprise autour d’un système de forums qu’il avait créé sur le réseau de l’université. Connu sous le nom de PicoSpan, il permettait à ses usagers d’afficher des commentaires sur divers sujets et les organisait en fils de discussion pour permettre à tous les participants de les lire. L’idéalisme de Brilliant, son techno-utopisme et son esprit d’entreprise se complétaient harmonieusement. Il se servit du système de consultation à distance pour apporter de l’aide médicale à des hameaux asiatiques et organiser des missions de dépannage.
Lorsque Brilliant se rendit à un colloque à San Diego, il appela son vieil ami Stewart Brand pour l’inviter à dîner. Ils se retrouvèrent dans un restaurant en bord de mer près du site où Brand s’était programmé une journée de plongée naturiste. Brilliant avait deux objectifs liés : populariser le logiciel PicoSpan et créer une communauté intellectuelle en ligne. Il vanta à Brand les mérites d’un partenariat dans lequel lui, Brilliant, apporterait deux cent mille dollars de capital, achèterait l’ordinateur et fournirait le logiciel. « Stewart gérerait ensuite le système et l’étendrait au travers de son réseau de gens intelligents et intéressants, explique Brilliant3. Mon idée était d’utiliser cette technologie nouvelle comme un moyen de discuter de tout ce qu’on trouvait dans le Whole Earth Catalog. Il peut y avoir un réseau social autour des couteaux suisses, des cuisinières solaires ou de n’importe quoi4. »
Brand transforma l’idée en un concept plus grandiose : créer la communauté en ligne la plus stimulante du monde où les gens puissent discuter de tout ce qu’ils voudraient. « Il n’y a qu’à démarrer une conversation et récupérer les gens les plus intelligents du monde, suggéra-t-il. Et on les laisse choisir de quoi ils veulent parler5. » Brand trouva un nom, The WELL, rétroactivement défini comme l’acronyme de Whole Earth ’Lectronic Link. « Il était toujours intéressant d’avoir une apostrophe facétieuse dans un nom », dirait-il plus tard6.
Brand se fit le champion d’un concept abandonné par de nombreuses communautés virtuelles ultérieures, mais capital pour faire de The WELL un service fondateur. Les participants ne pouvaient pas être totalement anonymes : s’ils pouvaient recourir à un pseudo, il leur fallait toutefois décliner leur véritable identité lors de l’inscription, et les autres membres pouvaient savoir qui ils étaient. Le credo de Brand, qui s’affichait sur l’écran d’accueil, était : « Vos propos vous appartiennent. » Autrement dit, l’usager était responsable du contenu de ses messages.
Comme Internet lui-même, The WELL devint un système aménagé par ses utilisateurs. En 1987, ses forums de discussion regroupés en « conférences » abordaient des sujets qui allaient des Grateful Dead (le plus populaire) à la programmation sous UNIX, en passant par l’éducation des enfants, les extraterrestres et l’écriture de logiciels. Il y avait très peu de hiérarchie ou de contrôle, si bien que le réseau évolua de manière collaborative. Ce qui en fit à la fois une expérience dont on avait du mal à se passer et une expérimentation sociale fascinante. Des ouvrages entiers furent écrits sur The WELL, donc ceux des influents chroniqueurs technologiques Howard Rheingold et Katie Hafner. « Le simple fait d’être sur The WELL, de parler avec des gens dont vous n’envisageriez pas de faire des amis dans tout autre contexte, voilà en quoi résidait sa séduction », écrivait Katie Hafner7. D’après Rheingold, « c’est comme si on était au bar du coin, avec les vieux potes, les adorables nouveaux arrivants, et de nouveaux outils à rapporter chez soi, des graffitis et des lettres tout frais, sauf qu’au lieu de prendre ma veste, d’éteindre mon ordinateur et d’aller au coin de la rue, je n’ai qu’à invoquer mon programme de télécommunications et tout le monde est là8. » Lorsque Rheingold découvrit que sa fille de deux ans avait une tique sur le cuir chevelu, il trouva comment s’en débarrasser grâce à un médecin sur The WELL avant que son propre généraliste l’ait rappelé.
Les conversations en ligne pouvaient être animées. Un animateur de discussions, Tom Mandel, qui devint un personnage central de l’ouvrage de Katie Hafner et aida par ailleurs mes collègues et moi-même à gérer les forums en ligne de Time, se lançait régulièrement dans des confrontations explosives, les flame wars, avec d’autres membres. « J’exprimais mon opinion sur tout, racontait-il. J’ai même déclenché une altercation qui a entraîné la moitié du cyberespace de la côte Ouest dans une bagarre électronique et j’ai été exclu du WELL9. » Mais lorsqu’il révéla qu’il était en train de mourir d’un cancer, le soutien fut unanime. « Je suis triste, terriblement triste, je ne peux pas vous dire à quel point je suis triste, à quel point j’ai du chagrin de ne pas pouvoir rester plus longtemps à jouer et à me disputer avec vous », écrivit-il dans un de ses derniers messages10.
The WELL était l’un des modèles du type de communauté intime et réfléchie qui exista un temps sur Internet. Au bout de trois décennies, il demeure une communauté unie par des liens serrés, mais il a été depuis longtemps dépassé en popularité par des services en ligne plus commerciaux, puis par des sites de discussion moins communautaires. Le repli répandu sur l’anonymat en ligne a sapé la conviction de Brand que les gens devraient être responsables de leurs propos, ce qui rend beaucoup de commentaires en ligne plus superficiels et les discussions moins intimes. Tandis qu’Internet passe par différentes phases – plate-forme pour le temps partagé, les communautés, l’édition, les blogs et le réseautage social –, le jour viendra où le désir naturel qu’ont les humains de former des communautés fiables, à la manière du bistrot du coin, se réaffirmera, et où The WELL ou des start-up qui en reproduiront l’esprit seront la prochaine innovation à la mode. Parfois l’innovation implique de recouvrer ce qui a été perdu.
America Online
William von Meister était l’un des premiers exemples de ces nouveaux pionniers qui impulseraient l’innovation numérique à partir de la fin des années 1970. Comme Ed Roberts d’Altair, von Meister était un turbo-entrepreneur en série. Alimentée par la prolifération des capital-risqueurs, cette race d’innovateurs jetait des idées comme des étincelles, recevait une poussée d’adrénaline en prenant des risques et vantait les nouvelles technologies avec un zèle évangélique. Von Meister en était à la fois un exemple et une caricature. Contrairement à Noyce, Gates et Jobs, il ne s’appliquait pas à édifier des entreprises, mais à les lancer et voir où elles retomberaient. Loin d’avoir peur de l’échec, il en tirait son énergie, et les personnages de sa trempe firent du pardon des insuccès un trait de l’ère d’Internet. Crapule magnifique, il lança neuf sociétés en dix ans, dont la plupart soit firent faillite, soit le congédièrent. Mais à travers ses échecs en série il contribua à définir l’archétype de l’entrepreneur Internet et, dans la foulée, à inventer le commerce en ligne11.
La mère de von Meister était une comtesse autrichienne, et son père, filleul de l’empereur Guillaume II, dirigeait la division américaine de la compagnie allemande de zeppelins qui exploitait le Hindenburg jusqu’à son explosion en 1937 ; il dirigea ensuite une succursale d’une société de produits chimiques jusqu’au jour où il fut inculpé de fraude. Son style déteignit sur le jeune Bill, né en 1942, qui semblait bien parti pour égaler l’extravagance ou même la gravité des exploits paternels. Il avait grandi aux Blue Chimneys, une résidence en brique blanchie à la chaux sur un terrain de quatorze hectares au New Jersey. Il adorait s’échapper au grenier pour bricoler son poste de radioamateur et construire des gadgets électroniques. L’une de ses créations était un émetteur radio que son père avait dans sa voiture et dont il se servait pour signaler quand il approchait de la maison en rentrant du travail de façon que les domestiques puissent lui préparer son thé.
Après une scolarité universitaire décousue partagée entre divers établissements de Washington, von Meister entra chez Western Union. Il gagna de l’argent avec un tas de projets commerciaux, dont l’un consistait à recycler du matériel Western Union au rebut, puis lança un service permettant aux gens de dicter des lettres importantes à des centres d’appel pour qu’elles soient distribuées le lendemain. Le service eut du succès, mais, dans ce qui deviendrait une habitude, von Meister fut forcé de partir après avoir dépensé sans compter et sans se préoccuper de la marche de l’entreprise*3.
Von Meister était de la race originelle des entrepreneurs des médias – pensez plutôt à Ted Turner qu’à Mark Zuckerberg –, qui vivaient dans la démesure et mélangeaient si bien la folie et la sagacité qu’elles finissaient presque par se confondre. Il aimait les femmes voyantes et les vins rouges millésimés, les voitures de course et les avions privés, le scotch pur malt et les cigares de contrebande. « Bill von Meister n’était pas seulement un entrepreneur en série, c’était un entrepreneur pathologique, d’après Michael Schrage, qui l’a suivi pour le compte du Washington Post. Avec le recul, la plupart des idées de Bill von Meister ne nous semblent pas stupides. Mais à l’époque elles passaient pour farfelues. Le gros risque avec un hurluberlu pareil, c’était de confondre son excentricité avec ses idées, tellement elles s’interpénétraient12. »
Von Meister continua de se révéler apte à trouver de nouveaux concepts et à lever des fonds auprès des capital-risqueurs, mais pas à gérer quoi que soit. Parmi ses start-up : un système de routage téléphonique groupé pour les entreprises, un restaurant dans la banlieue de Washington, appelé Mc Lean Lunch and Radiator, où les clients pouvaient passer gratuitement des appels longue distance à partir des téléphones sur leurs tables, et un service appelé Infocast qui envoyait des informations à des ordinateurs en squattant les fréquences de données numériques inutilisées des signaux radio FM. Puis, en 1978, lassé de ces entreprises ou mis à l’écart, il combina ses intérêts pour la téléphonie, les ordinateurs et les réseaux de transmission de l’information pour créer un service qu’il appela The Source.
The Source connectait des ordinateurs domestiques via des lignes téléphoniques à un réseau qui offrait des panneaux d’information, des messageries, des articles de journaux, des horoscopes, des guides de restaurants, le classement des vins, du commerce en ligne, la météo, les horaires des avions et les cours de la Bourse. Autrement dit, c’était l’un des premiers services en ligne orientés vers le consommateur. (L’autre était CompuServe, un réseau à temps partagé à vocation commerciale qui, en 1979, s’aventurait timidement sur le marché des consommateurs connectés par modem.) « Il peut emmener votre ordinateur personnel partout dans le monde », proclamait une des premières brochures promotionnelles. Von Meister déclara au Washington Post que The Source deviendrait un « service » qui fournirait des informations « comme de l’eau qui coule du robinet ». En plus d’acheminer des informations à domicile, The Source encourageait la création d’une ambiance communautaire avec des forums, des salons de discussion (chat rooms) et des zones de partage de fichiers privées où les usagers pouvaient afficher leurs propres écrits pour que d’autres les téléchargent. Lors du lancement officiel du service en juillet 1979 à l’hôtel Plaza de Manhattan, l’écrivain de science-fiction Isaac Asimov assura la promotion en proclamant : « Voici le commencement de l’ère de l’information13 ! »
Comme d’habitude, von Meister ne tarda pas à commettre des erreurs de gestion et à gaspiller de l’argent, ce qui lui valut d’être évincé au bout d’un an par son principal bailleur de fonds, avec ce commentaire : « Billy von Meister est un entrepreneur génial, seulement il ne savait pas quand s’arrêter d’entreprendre. » Le service finit par être vendu au Reader’s Digest, qui le revendit plus tard à CompuServe. Mais, en dépit de sa brève existence, The Source avait inauguré l’ère des réseaux en ligne en montrant que les consommateurs ne voulaient pas seulement recevoir passivement des informations, mais aussi avoir l’occasion de se connecter avec leurs amis et de générer eux-mêmes un contenu à partager.
L’idée suivante de von Meister, elle aussi légèrement en avance sur son époque, était un disquaire à domicile qui vendrait de la musique en flux continu via les réseaux de télévision câblés. Les chaînes de magasins de disques et les maisons de disques se liguèrent pour bloquer cet accès aux chansons, si bien que von Meister, jamais à court d’idées, se tourna vers les jeux vidéo. C’était une cible encore plus mûre : à l’époque, il y avait quatorze millions de consoles de jeux Atari. Ainsi naquit la Control Video Corporation (CVC). Le nouveau service de von Meister permettait aux usagers de télécharger des jeux pour les acheter ou les louer. Il nomma ce service GameLine et commença à le fournir lié avec certains des services d’information qui avaient été proposés par The Source. « Nous allons transformer le jockey des jeux vidéo en un junkie de l’info », proclamait-il14.
Gameline et CVC s’installèrent dans une allée commerciale du côté de l’aéroport Dulles de Washington. Von Meister choisit un conseil d’administration qui symbolisait le passage officiel du flambeau à une nouvelle race de pionniers d’Internet. Il y avait entre autres Larry Roberts et Leonard Kleinrock, architectes de l’ARPANET originel, et aussi l’audacieux capital-risqueur Frank Caufield, dont l’établissement financier, Kleiner Perkins Caufield & Byers, était devenu le plus influent de Silicon Valley. La banque d’investissement Hambrecht & Quist était représentée par Daniel H. Case III, un suave et énergique natif de Hawaï qui avait étudié à Oxford grâce à une bourse Rhodes, puis était sorti diplômé de Princeton.
Dan Case retrouva von Meister à Las Vegas pour le Consumer Electronics Show de janvier 1983, où la GameLine de CVC espérait faire un malheur. Von Meister, en bon maître des cérémonies, fit fabriquer une montgolfière en forme de joystick et frappée du nom GameLine qui flotterait au-dessus de la ville, et loua une immense suite au Tropicana Hotel, qu’il décora d’une troupe de girls15. Dan Case apprécia le spectacle. Tapi dans l’ombre, son frère cadet Steve était plus réticent, avec son sourire énigmatique et son visage neutre plus difficiles à déchiffrer.
Né en 1958 et élevé à Hawaï, avec un tempérament placide qui donnait l’impression qu’il avait été nourri par des dauphins, Steve Case présentait une façade pacifique. Surnommé par certains « le Mur » parce que son visage manifestait rarement la moindre émotion, il était timide mais ne manquait pas d’assurance. Pour certaines personnes qui ne le connaissaient pas vraiment, cela passait, et à tort, pour de la hauteur ou de l’arrogance. En grandissant, il apprit à plaisanter et à échanger des insultes amicales d’un ton nasal et monocorde, comme un première année dans une corpo d’étudiants. Mais sous ce badinage il était profondément sérieux.
Quand ils étaient encore au lycée, Dan et Steve transformèrent leurs chambres en bureaux depuis lesquels ils dirigèrent une série de petites entreprises qui, entre autres, vendaient des cartes de vœux et distribuaient des magazines. « La première leçon d’esprit d’entreprise à la Case, raconte Steve, c’est lorsque j’ai eu l’idée, qu’il a assuré le financement et qu’ensuite il a possédé la moitié de l’affaire16. »
Steve fréquenta Williams College, où l’historien réputé James MacGregor Burns nota sèchement : « Il était au nombre de mes étudiants moyens17. » Il passait plus de temps à tirer des plans sur de futures entreprises qu’à étudier le programme. « Un jour, raconte Case, un professeur m’a pris à part et m’a suggéré de mettre entre parenthèses mon intérêt pour le monde des affaires et de me concentrer sur mes études, parce que l’université représentait une occasion unique, qui ne se répéterait pas. Il va sans dire que je n’étais pas d’accord. » Il sécha l’informatique après la première heure de cours, qu’il détesta « parce que c’était à l’époque des cartes perforées : on écrivait un programme et ensuite il fallait attendre des heures pour avoir le résultat18 ». La leçon qu’il retint, c’était qu’il fallait rendre les ordinateurs plus accessibles et plus interactifs.
Les ordinateurs l’intéressaient avant tout parce qu’ils permettaient de se brancher sur des réseaux. « Ces connexions lointaines avaient quelque chose de magique, confiait-il à la journaliste Kara Swisher. Pour moi, c’était l’usage le plus évident qu’on pouvait en faire, le reste, c’était pour les matheux maniaques de l’informatique19. » Après avoir lu La Troisième vague du futurologue Alvin Toffler, il fut fasciné par le concept de la « frontière électronique », dans lequel la technologie connecterait les gens les uns avec les autres et avec toutes les informations disponibles dans le monde20.
Au début de 1980, il postula pour un emploi à l’agence publicitaire J. Walter Thomson. « Je crois fermement que les avancées technologiques dans le domaine des communications sont en passe de modifier de manière significative notre mode de vie, écrivait-il dans la lettre de motivation. Les innovations en matière de communications (en particulier les systèmes de liaisons câblées interactifs) transformeront notre téléviseur (à grand écran, évidemment !) en agence de presse, journal, école, ordinateur, machine à référendum et catalogue21. » Il n’obtint pas le poste et sa candidature fut également rejetée une première fois chez Proctor & Gamble. Mais il réussit à convaincre P & G de lui accorder une deuxième chance (il se déplaça à Cincinnati à ses frais) et se retrouva chef de marque adjoint dans un groupe qui commercialisait Abound, une lingette après-shampooing bientôt défunte. Il y apprit le procédé consistant à donner des échantillons gratuits pour lancer un nouveau produit. « C’est de là, entre autres, qu’est venue l’inspiration derrière la stratégie d’AOL avec sa disquette d’essai gratuite une décennie plus tard22. » Au bout de deux ans, il quitta P & G pour travailler dans la division Pizza Hut de Pepsi-Cola. « Si j’ai fait ça, c’est que ça exaltait l’esprit d’entreprise. C’était une société fonctionnant en franchise, presque l’inverse exact de Procter & Gamble, qui est plutôt une société hiérarchisée et bureaucratique où toutes les décisions importantes sont prises à Cincinnati23. »
Jeune célibataire basé à Wichita, au Kansas, où il n’y a pas grand-chose à faire le soir, Steve Case devint un fan de The Source. C’était le refuge idéal pour quelqu’un comme lui, à la fois timide et désireux de se connecter. Il apprit deux leçons : que les gens aiment faire partie d’une communauté et que la technologie doit être simple si elle veut plaire aux masses. La première fois qu’il essaya de se connecter à The Source, il eut du mal à configurer son ordinateur portable Kaypro : « C’était comme l’ascension de l’Everest, et ma première pensée a été de me demander pourquoi il fallait que ce soit si difficile. Mais quand j’ai enfin réussi à entrer dans le réseau et me suis trouvé connecté à tout le pays à partir de ce sinistre petit appartement de Wichita, c’était sublime24. »
Discrètement, Case fonda sa petite société de conseil en marketing. Il avait l’âme d’un entrepreneur à une époque où la plupart des autres diplômés cherchaient à se faire recruter par de grosses sociétés. Il loua une boîte postale avec une adresse chic à San Francisco qu’il fit imprimer sur son papier à en-tête, et s’arrangea pour faire réexpédier sa correspondance commerciale à Wichita. Il s’était découvert une passion – aider les sociétés qui voulaient faire œuvre de pionnier sur la frontière électronique –, aussi lorsque son frère Dan rejoignit Hambrecht & Quist en 1981, commença-t-il à communiquer à Steve des projets commerciaux concernant des entreprises intéressantes. L’une d’elles était la Control Video Corporation de von Meister. En décembre 1982, pendant des vacances de sport d’hiver au Colorado, ils se demandèrent si Dan devrait investir dans la CVC, et décidèrent aussi de se rendre ensemble au Consumer Electronics Show de Las Vegas le mois suivant25.
À Las Vegas, l’irrépressible Bill von Meister, le très réservé Steve Case et son frère consacrèrent un dîner prolongé à débattre de la commercialisation de GameLine. Steve et von Meister s’entendirent bien, peut-être parce qu’ils partageaient les mêmes intérêts, mais avec des personnalités différentes. Au milieu du repas bien arrosé, von Meister se retrouva aux toilettes avec Dan Case et lui demanda s’il ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’il recrute le jeune Steve. Dan concéda que ce serait bien. Steve débuta à la CVC comme consultant à temps partiel, puis fut employé à plein temps en septembre 1983 et s’installa à Washington : « J’ai pensé que l’idée de GameLine était vraiment prometteuse. Mais j’avais aussi l’impression que, même en cas d’échec, ce que j’apprendrais en travaillant aux côtés de Bill serait une expérience pédagogique précieuse. Et cela s’est assurément vérifié26. »
Au bout de quelques mois, la Control Video Corporation était au bord de la faillite. Von Meister n’avait toujours pas appris à devenir un prudent gestionnaire, et le marché des jeux vidéo Atari s’était dégonflé. Lorsqu’on lui communiqua le chiffre des ventes lors d’une réunion du conseil d’administration, le capital-risqueur Frank Caufield ironisa : « On aurait cru qu’il y aurait eu plus de vol à l’étalage. » Aussi insista-t-il sur le recrutement d’un gestionnaire discipliné. La personne qu’il sollicita était un ami proche et un ancien condisciple de West Point, Jim Kimsey, qui sous la rude apparence d’un membre des Forces spéciales dissimulait le cœur sociable d’un tenancier de bar.
Kimsey n’était pas la personne qu’on aurait attendue pour remettre sur les rails un service numérique interactif : il maniait plus facilement les armes et les verres à whisky que les claviers. Mais il possédait ce mélange de ténacité et d’esprit de rébellion qui fait les bons entrepreneurs. Né en 1939, il grandit à Washington ; en terminale, il fut exclu de la Gonzaga High School, le meilleur lycée catholique de la ville, pour son comportement perturbateur. Il parvint néanmoins à décrocher un entretien à West Point, où il s’intégra bien à une ambiance qui célébrait, canalisait et contrôlait l’agressivité. À sa sortie de cette école militaire, il fut affecté en République dominicaine, puis pour deux campagnes au Vietnam à la fin des années 1960. Pendant qu’il y servait comme major dans les rangers aéroportés, il prit sur lui de construire un orphelinat pour une centaine d’enfants vietnamiens. S’il n’avait pas eu tendance à répondre à ses supérieurs hiérarchiques, il aurait peut-être pu faire une carrière militaire27.
Au lieu de quoi il rentra à Washington en 1970, acheta un immeuble de bureaux au centre-ville dont il loua une grande partie à des sociétés de courtage tandis qu’au rez-de-chaussée il ouvrait un bar, The Exchange, doté comme il se doit d’un téléscripteur boursier fonctionnel. Après le succès du premier, il ouvrit bientôt d’autres bars pour célibataires avec des noms comme Madhatter et Bullfeathers tout en se lançant dans de nouveaux projets immobiliers. Il était dans ses habitudes de partir à l’aventure avec son pote de West Point Frank Caufield et leurs fils. Ce fut lors d’un circuit de rafting que Caufield le recruta comme chaperon de von Meister et, finalement, comme directeur général de la CVC.
En réaction aux ventes médiocres, Kimsey licencia la plupart des employés, à l’exception de Steve Case, qui fut promu vice-président du marketing. Kimsey avait le langage pittoresque et scatologique d’un tenancier de saloon : « Mon job, c’est de faire de la salade de poulet avec de la merde de poulet. » Il avait un faible pour la vieille blague du jeune garçon qui fouille allègrement dans un tas de fumier de cavalerie et qui, quand on lui demande pourquoi, déclare : « Y doit bien y avoir un poney quelque part dans cette merde. »
C’était un insolite triumvirat : le générateur d’idées indiscipliné von Meister, le froid stratège Case et le rude militaire Kimsey. Tandis que von Meister faisait son numéro et que Kimsey jouait les patrons de bistrot qui vous tapent dans le dos, Case restait dans son coin à observer la scène et à trouver de nouvelles idées. À eux trois, ils montraient une fois de plus comment une équipe hétérogène pouvait promouvoir l’innovation. Ken Novack, un juriste extérieur à l’entreprise, remarquerait plus tard : « Ce n’est pas un hasard s’ils ont monté cette affaire ensemble28. »
Case et von Meister s’intéressaient depuis longtemps à l’édification de réseaux informatiques qui puissent connecter des usagers ordinaires. Lorsque CBS, Sears et IBM unirent leurs forces en 1984 pour lancer pareil service, qui s’appellerait Prodigy, d’autres fabricants d’ordinateurs se rendirent compte qu’il pourrait y avoir là un vrai marché. Commodore s’adressa à la CVC et lui demanda de créer un service en ligne. Kimsey reconfigura donc la CVC pour en faire une société appelée Quantum, qui lança un service baptisé Q-Link pour les usagers d’ordinateurs Commodore en novembre 1985.
Pour dix dollars par mois, Q-Link avait tout ce que von Meister – qu’on poussait alors gentiment vers la sortie – et Case avaient envisagé : des informations, des jeux, la météo, l’horoscope, des critiques, la Bourse, des résumés des feuilletons, une galerie marchande, et plus encore, avec les plantages et les interruptions de service périodiques qui devinrent endémiques dans l’univers en ligne. Mais, par-dessus tout, Q-Link comportait une zone remplie de serveurs télématiques actifs et de dialogues en direct, surnommée People Connection, qui permettait aux membres de former des communautés.
En l’espace de deux mois, début 1986, Q-Link avait dix mille membres. Mais la croissance commença à plafonner, essentiellement parce que les ventes de Commodore fléchissaient devant la concurrence d’Apple et d’autres fabricants. « Il faut que nous prenions le contrôle de notre destin », dit Kimsey à Case29. Il était clair que, pour réussir, Quantum serait obligé de créer des services en ligne comme Q-Link pour d’autres fabricants d’ordinateurs, au premier chef Apple.
Avec la ténacité que lui donnait sa personnalité patiente, Case visa les cadres Apple. Même quand son brillant fondateur Steve Jobs eut été évincé de la société, momentanément du moins, il était difficile de former un partenariat avec Apple. Case traversa donc les États-Unis pour s’installer à Cupertino dans un appartement proche d’Apple. C’est de là qu’il mena son siège. Il y avait chez Apple beaucoup de services qu’il pourrait essayer de convaincre, et il finit par obtenir un petit bureau à l’intérieur de la société. Malgré sa réputation de froideur, il avait un certain sens de l’humour ; sur son bureau, il avait posé une pancarte « Steve Retenu en Otage » avec le nombre de jours ad hoc*430. En 1987, après une campagne quotidienne de trois mois, il parvint à ses fins : le service clients d’Apple accepta de passer un accord avec Quantum pour un réseau appelé AppleLink. Quand il fut lancé un an plus tard, le premier forum en direct avait en vedette le sympathique cofondateur d’Apple Steve Wozniak.
Case passa ensuite un marché similaire avec Tandy pour lancer PC-Link. Mais il se rendit bien vite compte qu’il lui fallait réviser la stratégie consistant à créer des services en ligne séparés pour chaque nouvelle marque d’ordinateur. Les usagers d’un service ne pouvaient pas se connecter avec ceux d’un autre. En outre, c’étaient les fabricants d’ordinateurs qui contrôlaient les produits, le marketing et l’avenir de Quantum. « Écoutez, nous ne pouvons plus compter sur ce type de partenariat, dit Case à son équipe. Nous avons vraiment besoin d’être autonomes et d’avoir comme qui dirait notre propre marque31. »
Ce qui devint un problème plus pressant – mais aussi une chance –, lorsque les relations avec Apple se détériorèrent. « Les dirigeants d’Apple ont décidé qu’ils n’aimeraient pas voir une société extérieure se servir de la marque déposée Apple, explique Case. Leur décision de nous couper l’herbe sous le pied nous a obligés à redéfinir notre marque32. » Case et Kimsey décidèrent d’associer les usagers de leurs trois services dans un service en ligne intégré unique doté de sa propre marque commerciale. La démarche inaugurée par Bill Gates pour le logiciel s’appliquerait aussi au domaine en ligne : les services en ligne seraient indépendants du matériel utilisé et fonctionneraient sur toutes les plates-formes.
Il leur fallait maintenant un nom. Il y eut de nombreuses propositions, telles que « Crossroads » et « Quantum 2000 », mais elles évoquaient des centres d’accueil religieux ou des fonds de placement. Case trouva « America Online », qui fit s’étrangler beaucoup de ses collègues. C’était cucul et gauchement patriotique. Mais cela plaisait à Case. Il savait, à l’instar de Jobs quand il avait baptisé sa société Apple, qu’il importait, comme il le dirait plus tard, « de faire simple, rassurant et même un peu nunuche33 ». Sans budget de promotion, Case avait besoin d’un nom qui décrive clairement ce que faisait le service. Et le nom America Online remplissait cette fonction.
L’expérience AOL, c’était comme si on entrait en piste avec des roulettes stabilisatrices : c’était rassurant et facile. Case mit en application les deux leçons qu’il avait apprises chez Proctor & Gamble : rendre le produit simple et le lancer avec des échantillons gratuits. L’Amérique fut bombardée de logiciels sur disquette offrant deux mois d’abonnement gratuit. Elwood Edwards, un comédien spécialisé dans le commentaire en voix off et qui était le mari d’une des employées d’AOL d’alors, enregistra des messages d’accueil plein d’entrain – « Bienvenue ! » et « Vous avez du courrier ! » qui donnaient au service une apparence de convivialité. Et c’est ainsi que l’Amérique se retrouva en ligne.
Case l’avait compris – l’ingrédient secret n’était pas les jeux ou la publication de contenus, mais le désir de connexion : « Nous avons misé gros, même en 1985, sur ce que nous appelions la “communauté”. Maintenant on parle de médias sociaux. Nous avons pensé que l’appli Internet qui enterrerait toutes les autres serait les gens. Des gens qui interagissent avec des gens qu’ils connaissaient déjà mais sur des modes nouveaux et plus pratiques, mais aussi des gens qui interagissent avec des gens qu’ils ne connaissaient pas encore, mais qu’ils devraient connaître parce qu’ils avaient des intérêts communs34. » Parmi les prestations de base chez AOL, on trouvait les salons de discussion, la messagerie instantanée, les listes d’amis et une « messagerie textuelle ». Comme sur The Source, il y avait des infos, du sport, la météo et l’horoscope. Mais le réseautage social était au centre de tout cela. « Tout le reste – le commerce, le divertissement et les services financiers – était secondaire. Nous pensions que la communauté passait avant le contenu35. »
Les salons de discussion où se retrouvaient les gens aux intérêts similaires – l’informatique, le sexe, les séries télévisées – avaient beaucoup de succès. On pouvait même s’isoler par consentement mutuel dans des « salons privés » ou, à l’autre extrême, visiter l’un des « auditoriums » où risquait de se dérouler une session avec une célébrité. Les usagers d’AOL n’étaient pas qualifiés de clients ou d’abonnés : c’étaient des membres. AOL prospéra en contribuant à créer un réseau social. CompuServe et Prodigy, qui avaient débuté principalement comme services d’information et de commerce en ligne, firent pareil avec des outils comme le CB Simulator de CompuServe, qui imitait sous forme de texte le plaisir farfelu de s’entretenir sur les fréquences de la CB.
Kimsey le patron de bar ne pigeait pas tout à fait pourquoi des gens sains d’esprit passeraient leurs samedis soir dans des salons de discussion ou des forums spécialisés. « Allez, avoue-le, tu crois pas que tout ça c’est la merde ? » demandait-il à Case en plaisantant à moitié36. Case secouait la tête. Il savait qu’il y avait un poney là-dedans.
Al Gore et l’Éternel Septembre
Les services en ligne tels qu’AOL se sont développés indépendamment d’Internet. Un enchevêtrement de lois, de réglementations, de traditions et de pratiques empêchaient les entreprises commerciales d’offrir un accès Internet direct aux citoyens ordinaires qui n’étaient pas affiliés à un établissement d’enseignement ou de recherche. « Ça paraît stupide aujourd‘hui, mais jusqu’en 1992 il était illégal de connecter un service commercial comme AOL à Internet », rappelle Steve Case37.
Mais à partir de 1993 les barrières s’abaissèrent et Internet devint accessible à tout un chacun. Ce qui perturba les services en ligne, qui étaient jusque-là des jardins clos à l’intérieur desquels les membres étaient dorlotés dans un environnement contrôlé. Cela transforma aussi Internet en produisant un flot de nouveaux usagers. Mais le plus important était que ce processus amorça le réseautage de la révolution numérique telle que l’avaient envisagée Bush, Licklider et Englebart. Les réseaux d’ordinateurs et de télécommunications et les banques d’informations numérisées tissèrent une trame commune qui les mit à la disposition de chaque individu.
Le mouvement commença sérieusement lorsque AOL, sur les traces d’un concurrent de moindre envergure, Delphi, ouvrit en septembre 1993 un portail qui permettait à ses membres d’avoir accès aux groupes de discussion et aux serveurs télématiques d’Internet. Dans le folklore des internautes, ce déluge fut qualifié, surtout par des vétérans aigris et méprisants, d’« Éternel Septembre ». Ce nom vient du fait qu’à chaque rentrée universitaire de septembre une nouvelle vague d’étudiants de première année avait accès à Internet depuis les réseaux de leurs campus. Les messages qu’ils affichaient avaient tendance à être agaçants au début, mais en quelques semaines la plupart avaient acquis assez de nétiquette pour se couler dans la culture Internet. Les vannes ouvertes en 1993 produisirent toutefois un flot ininterrompu de petits nouveaux qui bousculèrent les normes sociétales et l’ambiance « club » du réseau. « Septembre 1993 restera dans l’histoire du Net comme le septembre qui n’en finissait plus », afficha un internaute du nom de Dave Fischer en janvier 199438. Des vieux de la vieille créèrent le groupe de discussion alt.aol-sucks sur Usenet pour y afficher leurs diatribes*5. On y lisait par exemple que les intrus d’AOL « seraient incapables de se faire la moindre idée, même déguisés en idées et douchés de phéromones dans un champ d’idées en rut39 ». En fait, la démocratisation d’Internet amorcée par l’Éternel Septembre fut une bonne chose, mais les vétérans mirent un certain temps à s’en rendre compte.
Cet élargissement d’Internet, qui ouvrit la voie à une stupéfiante ère de l’innovation, ne se produisit pas par hasard. Il résulta d’un ensemble de mesures gouvernementales, soigneusement élaborées dans une atmosphère sérieuse et bipartite, qui placèrent l’Amérique en première position dans l’édification d’une économie digne de l’ère de l’information. La personne la plus influente dans ce processus – et cela risque de surprendre ceux qui ne connaissent de son rôle que l’image qu’en ont donné certaines plaisanteries – fut le sénateur Al Gore Jr du Tennessee.
Le père de Gore était sénateur lui aussi. « Je me rappelle avoir fait en voiture le trajet Carthage-Nashville avec mon père, raconte Al Gore Jr. Il me disait qu’il nous faudrait absolument quelque chose de mieux que ces routes à deux voies qui ne correspondaient pas à nos besoins40. » Gore Sr aida à l’élaboration de la législation bipartite relative au programme national d’autoroutes, et son fils s’en inspira pour promouvoir ce qu’il surnomma « l’autoroute de l’information ».
En 1986, Gore lança dans le cadre du Congrès une étude qui examinait divers sujets, dont la création de centres de super-ordinateurs, l’interconnexion des réseaux de recherche, l’augmentation de leur bande passante et leur ouverture à d’autres usagers. Cette commission était présidée par le pionnier d’ARPANET Leonard Kleinrock. Gore dirigea ensuite des auditions détaillées qui aboutirent en 1992 au High Performance Computing Act, auquel son nom est associé, et au Scientific and Advanced Technology Act en 1993. Ces lois autorisèrent le raccordement de réseaux commerciaux tels qu’AOL au réseau de recherche géré par la National Science Foundation, et, par là, à Internet lui-même. Après son élection à la vice-présidence en 1992, Gore fit voter en 1993 le National Information Infrastructure Act qui rendait Internet largement accessible au grand public et le faisait entrer dans la sphère du commerce afin que sa croissance puisse être financée par des investissements aussi bien privés que publics.
Quand je disais autour de moi que j’écrivais un livre sur les gens qui avaient contribué à l’invention de l’informatique et d’Internet, la réaction la plus prévisible, surtout de la part de ceux qui connaissaient mal l’histoire d’Internet, était : « Oh, vous voulez dire Al Gore, c’est ça ? » Et d’éclater de rire. C’est un trait significatif de notre discours politique que l’une des réussites bipartites les plus importantes pour l’innovation américaine soit ridiculisée à cause d’une chose que Gore n’a jamais vraiment dite – qu’il aurait « inventé » Internet. Lorsqu’en mars 1999 Wolf Blitzer, de la chaîne CNN, lui demanda d’énumérer les références l’autorisant à postuler pour la présidence, Gore avait dit, entre autres : « Pendant la période où j’étais au service du Congrès des États-Unis, j’ai pris l’initiative dans la création d’Internet41. » La formulation était peu élégante, comme le sont souvent les réponses dans les JT des chaînes câblées, mais Gore n’avait aucunement dit « j’ai inventé ».
Vinton Cerf et Bob Kahn, deux des personnes qui inventèrent réellement Internet, s’exprimèrent pour soutenir Gore : « Aucune personnalité publique ne s’est plus activée à créer le climat propice à l’épanouissement d’Internet que le vice-président42. » Il fut même défendu par le républicain Newt Gingrich : « C’est une chose sur laquelle Gore travaillait depuis longtemps […] Gore n’est pas le père d’Internet, mais, soyons honnêtes, Gore est la personne qui, au Congrès, a œuvré le plus systématiquement pour faire en sorte que nous ayons Internet43. »
Le « démontage » d’Al Gore était le signe avant-coureur d’une ère nouvelle de polarisation partisane accompagnée d’un manque de foi dans ce que pouvait faire le gouvernement. Aussi vaut-il la peine de réfléchir à ce qui conduisit à l’Éternel Septembre de 1993. En plus de trois décennies, le gouvernement fédéral américain, travaillant avec le secteur privé et la recherche universitaire, avait élaboré et mis en œuvre un projet d’infrastructure massif, comme le réseau national d’autoroutes, mais immensément plus complexe, puis l’avait ouvert aux simples citoyens et aux entreprises commerciales. Il était financé à l’origine par de l’argent public, mais il le remboursa des milliers de fois en impulsant une nouvelle économie et une ère de prospérité.

Marc Andreessen (né en 1971).

Justin Hall (né en 1974) et Howard Rheingold (né en 1947) en 1995.
*1. Elle avait commencé en France fin 1982 avec le réseau Télétel, dont les terminaux passifs de faible encombrement (Minitels) incorporant modem, écran et clavier étaient loués gratuitement par les PTT à leurs abonnés ; en contrepartie, le temps de connexion aux nombreux services payants, notamment la messagerie instantanée, était facturé avec les communications téléphoniques. (NdT)
*2. Aujourd’hui, une liaison Ethernet ou WiFi peut transmettre des données à un milliard de bps, soit plus de trois millions de fois plus vite.
*3. Western Union racheta plus tard cette affaire et la transforma en son service Mailgram.
*4. Allusion à la crise de 1980 à Téhéran quand le personnel de l’ambassade américaine fut retenu en otage 444 jours quotidiennement décomptés.
*5. Le préfixe alt. pour « alternative » dans le nom d’un newsgroup Usenet indiquait un groupe non conformiste ou marginal, ici « AOL fait chier ». (NdT)