3
UN DOUBLÉ BIEN TROUBLANT
Aux yeux de la nature, Isaac Walton{1} n’est qu’un amateur. Considéré comme le plus célèbre pêcheur du monde il écrit en 1954, de son leurre favori : « Je possède un vairon artificiel […] si curieusement ouvragé et si exactement contrefait que, dans un courant vif, il tromperait toute truite à la vue fine. »
Dans un chapitre de mon premier livre, Darwin et les grandes énigmes de la vie, j’ai raconté l’histoire de la Lampsilis, une palourde d’eau douce dont la partie postérieure s’orne d’un « poisson » en trompe l’œil. Ce leurre remarquable est doté d’un « corps » fuselé, d’extensions latérales simulant les nageoires et la queue et, pour parfaire l’effet général, d’une tache représentant l’œil ; les nageoires ondulent même en cadence, imitant les mouvements de la nage. Ce « poisson », constitué d’une poche où sont couvés les œufs fécondés (le corps) et de la peau externe de la palourde (nageoires et queue), attire ses congénères, authentiques ceux-là, vers lesquels la Lampsilis projette les larves contenues dans la poche. Ces dernières ne pouvant se développer qu’en vivant en parasites sur des branchies de poisson, on conviendra aisément du rôle particulièrement utile joué par ce leurre.
Je fus récemment étonné d’apprendre que la Lampsilis n’était pas seule à utiliser un tel stratagème. Les ichtyologistes Ted Pietsch et David Grobecker ont recueilli un spécimen unique d’une étonnante baudroie des Philippines, non pas à la suite d’aventures mouvementées dans des jungles lointaines, mais en un lieu qui est une source de mainte nouveauté scientifique, chez le marchand de poissons d’aquarium. (L’identification, plus que le machismo, est souvent à l’origine des découvertes exotiques.) En attirant les poissons, la baudroie pense plus à son déjeuner qu’à offrir un voyage gratuit à sa descendance. Sa nageoire dorsale comporte, fixé au bout du museau, un rayon épineux qui a subi des modifications importantes. À l’extrémité de ce filament est en effet placé un leurre. Certaines espèces des bas-fonds marins, vivant dans un monde obscur qui ne reçoit pas de lumière de la surface, pêchent avec leur propre source lumineuse : des bactéries phosphorescentes concentrées dans leurs appâts. Les baudroies des hauts-fonds ont généralement un corps rebondi et coloré, et présentent une ressemblance remarquable avec des rochers recouverts d’éponges et d’algues. Elles reposent sur le fond sans esquisser le moindre mouvement et agitent leur leurre près de leur bouche, de façon bien visible. Les « amorces » diffèrent selon les espèces, mais la plupart ressemblent – souvent imparfaitement – à toute une variété d’invertébrés, vers ou crustacés.
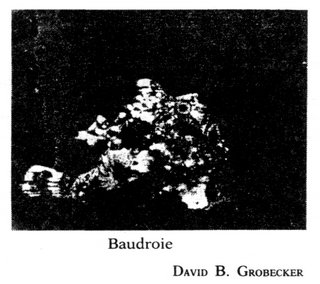
La baudroie de Pietsch et Grobecker a cependant mis au point un poisson trompe-l’œil en tous points aussi impressionnant que l’appelant fixé à la partie postérieure de la Lampsilis : une première chez les baudroies. (Leur rapport s’intitule, comme il va de soi : Le Parfait Pêcheur à la ligne{2} et donne en épigraphe le passage de Walton que je cite plus haut.) Ce paragraphe raffiné comporte lui aussi, au bon endroit, la mention des taches pigmentées en forme d’œil. En outre, des filaments serrés le long de la partie inférieure du corps représentent des nageoires pectorales et pelviennes, des extensions sur le dos ressemblent à des nageoires dorsales et anales et même un prolongement arrière a toute l’apparence d’une queue. Pietsch et Grobecker concluent ainsi leur article : « L’appât est une réplique presque exacte d’un petit poisson qui pourrait aisément appartenir à l’une des nombreuses familles de percoïdés communes à la région des Philippines. » Le poisson-pêcheur promène même son appât dans l’eau, « simulant les ondulations latérales du poisson qui nage ».
Ces artifices presque identiques chez un poisson et une moule pourraient sembler, à première vue, clore la discussion sur l’évolution darwinienne. Si la sélection naturelle peut réaliser par deux fois le même phénomène, elle peut sûrement faire n’importe quoi. Cependant – en poursuivant le thème des deux chapitres précédents et en concluant cette trilogie – l’argument de la perfection fonctionne aussi bien pour les créationnistes que pour les évolutionnistes. Le psalmiste n’a-t-il pas affirmé : « Les cieux proclament la gloire de Dieu ; et le firmament montre son œuvre » ? Les deux essais précédents soutenaient que l’imperfection témoignait en faveur de l’évolution. Celui-ci expose la réponse darwinienne à la perfection.
La seule chose qui soit plus difficile à expliquer que la perfection est la perfection répétée chez des animaux très différents. Un poisson sur la partie postérieure d’une moule et un autre devant le nez d’une baudroie – le premier formé à partir d’une poche d’œufs fécondés et d’une peau extérieure, le second à partir d’un rayon épineux de nageoire – font plus que multiplier la difficulté par deux. C’est là un doublé bien troublant. Je n’ai pas de peine à justifier l’origine des deux « poissons » par l’évolution. On peut concevoir une série plausible de phases intermédiaires dans le cas de la Lampsilis. Le fait que la baudroie utilise un rayon de nageoire comme appât n’est qu’une illustration de ce principe d’improvisation, de l’emploi d’organes disponibles qui, dans le cas du pouce du panda et du labelle des orchidées, plaide avec tant d’éloquence en faveur de l’évolution (voir le premier chapitre de cette trilogie). Mais les darwiniens ne doivent pas seulement démontrer l’évolution ; ils doivent établir que le mécanisme fondamental de la variation fortuite et de la sélection naturelle est bien la cause première du changement évolutif.
Les évolutionnistes antidarwiniens ont toujours présenté le développement répété d’adaptations très similaires au sein de souches différentes comme un argument contre la notion pivot du darwinisme selon laquelle l’évolution se déroule sans plan et sans direction. Le fait que des organismes différents convergent à plusieurs reprises vers les mêmes solutions n’indique-t-il pas que certaines directions du changement sont préétablies et ne sont pas une conséquence de la sélection naturelle agissant sur la variation fortuite ? Ne devrions-nous pas considérer la forme répétée elle-même comme la cause finale de nombreux phénomènes évolutifs qui y conduisent ?
Tout au long de sa dernière demi-douzaine de livres, Arthur Koestler a mené campagne contre sa propre conception erronée du darwinisme. Il s’y efforce d’y trouver une quelconque force directrice, quelque évolution contraignante menant dans certaines directions et annulant l’influence de la sélection naturelle. L’existence de caractères parfaits répétés au cours de l’évolution dans des lignées séparées est son rempart. À mainte et mainte reprises, il cite « les crânes presque identiques » des loups et du thylacine ou « loup de Tasmanie ». (Ce marsupial carnivore ressemble au loup, mais est, par sa généalogie, un parent proche du wombat, du kangourou et du koala.) Dans son dernier livre, Janus, Koestler écrit : « Même l’évolution d’une seule espèce de loup par la mutation fortuite renforcée par la sélection offre, comme nous l’avons vu, des difficultés insurmontables. Reproduire ce processus de façon indépendante sur une île et sur le continent équivaudrait à un miracle. »
À cette argumentation, les darwiniens répondent à la fois par une dénégation et par une explication. D’abord la dénégation : il est catégoriquement inexact de dire que des formes fortement convergentes sont effectivement identiques. Le grand paléontologiste belge, Louis Dollo, mort en 1931, a établi un principe, largement incompris, l’« irréversibilité de l’évolution », connu également sous le nom de loi de Dollo. Certains hommes de science mal informés pensent que Dollo se faisait l’avocat d’une mystérieuse force directrice poussant l’évolution de l’avant sans lui permettre jamais de jeter un coup d’œil en arrière. Et ils le classent parmi les non-darwiniens pour qui la sélection naturelle ne peut pas être la cause de l’ordre de la nature.
En fait, Dollo était un darwinien intéressé par l’évolution convergente, c’est-à-dire par le développement répété d’adaptations similaires dans des lignées différentes. Selon lui, un calcul élémentaire des probabilités garantit, de fait, l’impossibilité pour la convergence de jamais rien reproduire qui s’approche de la ressemblance parfaite. Les organismes ne peuvent pas effacer leur passé. Deux lignées peuvent présenter des similitudes superficielles remarquables, résultats de l’adaptation à un mode d’existence commun. Mais les organismes renferment tant d’éléments complexes et indépendants que la probabilité d’atteindre deux fois exactement le même résultat est en réalité nulle. L’évolution est irréversible ; des signes de l’ascendance sont toujours préservés ; la convergence, aussi impressionnante soit-elle, est toujours superficielle.
Examinons celui qui, à mes yeux, présente la plus étonnante des convergences : l’ichtyosaure. Ce reptile des mers, dont les ancêtres étaient des animaux terrestres, a convergé si fortement vers les poissons qu’il s’est effectivement doté d’une nageoire dorsale et d’une queue, à la bonne place et avec le bon profil hydrodynamique. Ces structures sont d’autant plus remarquables qu’elles se sont développées à partir de rien ; le reptile terrestre qui fut son ancêtre n’avait ni bosse sur le dos ni lame sur la queue qui puisse servir d’élément précurseur. Néanmoins l’ichtyosaure n’est pas un poisson, ni dans sa conception générale ni dans la complexité de ses détails. (Chez l’ichtyosaure, par exemple, la colonne vertébrale passe dans la partie basse de la lame caudale ; chez le poisson doté de vertèbres de queue, elle passe dans la partie supérieure.) L’ichtyosaure demeure un reptile depuis ses poumons et sa respiration aérienne jusqu’à ses pattes transformées en palettes natatoires et non pas en nageoires proprement dites.

Les carnivores de Koestler racontent la même histoire. Le loup placentaire et le « loup » marsupial sont tous deux conçus pour la chasse, mais aucun expert ne pourrait confondre leur crâne. La convergence dans la forme extérieure et la fonction ne fait pas disparaître les marques de marsupialité, petites mais nombreuses.
Vient ensuite l’explication : le darwinisme n’est pas la théorie du changement capricieux que Koestler imagine. La variation fortuite est bien la matière première du changement, mais la sélection naturelle parvient à concevoir des organes efficaces en rejetant la plupart des variantes tout en acceptant et en accumulant celles qui améliorent l’adaptation à l’environnement local.
La raison fondamentale d’une forte convergence, aussi prosaïque qu’elle puisse apparaître, réside simplement dans le fait que certaines façons d’assurer sa subsistance imposent des critères exigeants de forme et de fonction. Les mammifères carnivores doivent courir et mordre ; ils n’ont pas besoin de molaires broyeuses puisqu’ils déchirent et avalent leur nourriture. Le loup placentaire et le loup marsupial sont tous deux bâtis pour courir longtemps, possèdent des canines longues, effilées et acérées et des molaires réduites. Les vertébrés terrestres se déplacent grâce à leurs membres et peuvent utiliser leur queue pour maintenir leur équilibre. Les poissons s’équilibrent à l’aide de leurs nageoires et se propulsent de l’arrière avec leur queue. Les ichtyosaures, vivant comme des poissons, se sont dotés d’une large queue motrice (comme les baleines le firent plus tard, bien que la nageoire caudale horizontale de la baleine batte de haut en bas, alors que la queue verticale des poissons et de l’ichtyosaure bat d’un côté et de l’autre).
Personne n’a abordé ce thème biologique de la perfection répétée plus éloquemment que D’Arcy Wentworth Thompson dans son traité publié en 1942, On Growth and Form (« De la croissance et de la forme »), ouvrage toujours disponible et toujours aussi pertinent. Sir Peter Medawar, généralement avare de superlatifs et évitant l’exagération, a dit de ce livre qu’il s’agissait, « sans aucune comparaison possible, de la plus belle œuvre littéraire de toutes les annales de la science de langue anglaise ». Thompson, zoologiste, mathématicien, humaniste et écrivain de grand style, fut adulé durant sa vieillesse, mais passa toute sa vie professionnelle dans une petite université écossaise parce que ses idées étaient trop peu orthodoxes pour lui valoir les chaires prestigieuses de Londres et d’Oxbridge{3}.
Thompson était plus un réactionnaire brillant qu’un visionnaire. Il prenait Pythagore au sérieux et travaillait comme les géomètres grecs. Il éprouvait un grand plaisir à découvrir les formes abstraites d’un monde idéalisé qui s’incarnait indéfiniment dans les productions de la nature. Pourquoi retrouve-t-on toujours des hexagones dans les cellules d’une ruche et dans les plaques jointives de certaines carapaces de tortue ? Pourquoi les spirales du tournesol ou de la pomme de pin (et souvent les feuilles sur leur tige) suivent-elles la série de Fibonacci ? (Un système de spirales rayonnant à partir d’un point peut être regardé comme tournant à gauche ou à droite. Les spirales gauches et droites ne sont pas égales en nombre, mais représentent deux chiffres consécutifs de la série de Fibonacci. Celle-ci se construit en additionnant le nombre précédent pour former le suivant : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. La pomme de pin, par exemple, peut avoir 13 spirales gauches et 21 droites.) Pourquoi de si nombreuses coquilles d’escargot et cornes de bélier – et même le parcours d’une mite se dirigeant vers la lumière – suivent-elles une courbe appelée spirale logarithmique ?
La réponse de Thompson fut la même dans chaque cas : ces formes abstraites sont les solutions optimales répondant à des problèmes communs. Elles ont été choisies à plusieurs reprises dans des groupes distincts, car il s’agit de la meilleure voie, et souvent la seule, menant à l’adaptation. Les triangles, les parallélogrammes et les hexagones sont les seules figures planes qui remplissent complètement l’espace sans laisser de trous. Les hexagones sont fréquemment préférés car ils s’approchent du cercle et portent au maximum la surface intérieure inscrite entre les parois porteuses (construction minimale pour le plus grand stockage de miel par exemple). La série de Fibonacci apparaît automatiquement dans tout système de spirales rayonnantes construit en additionnant un par un de nouveaux éléments à la pointe de l’organe, dans le plus grand espace disponible. La spirale logarithmique est la seule courbe qui ne change pas de forme en accroissant sa taille. Je peux voir dans les formes thompsoniennes abstraites des adaptations optimales, mais devant la question métaphysique plus générale qui consiste à se demander pourquoi la « bonne » forme présente toujours une régulation numérique si simple, je ne peux que reconnaître mon ignorance et mon émerveillement.
Jusqu’à présent, je n’ai abordé que la moitié de ce sujet que constitue le problème de la perfection multiple. Je n’ai traité que le pourquoi. J’ai montré que la convergence ne rend jamais deux organismes complexes totalement identiques (un tel état de choses sous-entendrait des processus darwiniens beaucoup plus puissants qu’il n’est raisonnable d’imaginer) et j’ai tenté de présenter les solutions proches et répétées comme des adaptations optimales à des problèmes communs ne comportant que peu de solutions.
Mais qu’en est-il du comment ? Nous pouvons savoir à quoi servent le poisson de la Lampsilis et le leurre de la baudroie, mais comment se sont-ils développés ? Ce problème devient particulièrement ardu lorsque l’adaptation finale est complexe et singulière, mais qu’elle a été obtenue à partir d’organes familiers affectés anciennement à une fonction différente. Si le poisson-appât de la baudroie a nécessité 500 modifications totalement distinctes pour aboutir à cette parfaite imitation, comment le processus a-t-il donc commencé ? Et pourquoi s’est-il poursuivi en l’absence d’une quelconque force non darwinienne, instruite du but final ? Quel bénéfice a bien pu être tiré de la première phase seule ? Un cinq centième de pastiche de poisson est-il suffisant pour susciter la curiosité d’un vrai poisson ?
La réponse de D’Arcy Thompson à ce problème est très générale, mais en même temps prophétique, ce qui est bien dans sa manière. Il soutient que la forme est donnée directement aux organismes par des forces physiques agissant sur eux : les optimums de ces forces ne sont rien d’autre que les états naturels d’un matériau plastique mis en présence des forces physiques appropriées. Les organismes sautent directement d’un optimum à un autre lorsque le régime des forces physiques se modifie. Nous savons maintenant que les forces physiques sont, dans la plupart des cas, trop faibles pour influer directement sur la forme et, à présent, nous voyons dans ce résultat l’action de la sélection naturelle. Mais nous sommes déroutés si, pour construire cette adaptation complexe, la sélection ne peut agir que d’une façon patiente, au coup par coup, par étapes successives.
Je crois qu’une solution peut être trouvée dans l’essence même de l’intuition de Thompson, une fois qu’on l’a débarrassée de cet argument non fondé selon lequel les forces physiques agissent directement sur les organismes. C’est souvent un ensemble de facteurs constitutifs beaucoup plus simple (et parfois d’une très grande simplicité) qui élabore les formes complexes. Au cours de la croissance, les éléments de ces organismes sont liés entre eux de multiples façons compliquées ; la modification d’un seul de ces éléments peut entraîner des conséquences dans l’organisme tout entier et le transformer de la manière la plus variée et la plus inattendue. David Raup, du Field Museum of Natural History de Chicago, a étudié les intuitions de D’Arcy Thompson à l’aide d’un ordinateur et a montré que les formes de base des coquilles en spirale – du nautile à la palourde, en passant par l’escargot – peuvent toutes être obtenues en ne faisant varier que trois gradients simples de croissance. Avec le programme de Raup, on peut transformer un escargot de nos jardins en palourde en ne modifiant que deux des trois gradients. Et, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il existe effectivement un genre particulier d’escargots qui possède une coquille bivalve si semblable à celle d’une palourde que je fus tout étonné de voir, dans une surprenante séquence filmée, une tête d’escargot apparaître en gros plan entre les valves.

Dans ces figures tracées à l’ordinateur (il ne s’agit pas de
véritables mollusques malgré les similitudes), la forme de droite
qui ressemble fortement à certaines moules peut-être convertie en
« escargot » (figures de gauche) par la simple diminution
du taux d’accroissement de l’ellipse génératrice lors de la
croissance de la « coquille » et par l’accroissement du
taux de translation de cette ellipse le long de l’axe
d’enroulement. Toutes ces figures ont été tracées en ne jouant que
sur quatre paramètres.
Photo reproduite avec l’autorisation de D.M. Raup.
Ainsi se termine ma trilogie sur la perfection et l’imperfection comme signes de l’évolution. Mais le tout n’est qu’une longue dissertation sur le « pouce du panda », objet unique et concret qui, en dépit de mes digressions et de mes vagabondages, a bien donné naissance à ces trois essais. Pour expliquer le processus menant du panda à l’ours, Dwight Davis se trouva fort embarrassé devant l’impuissance de la sélection naturelle si celle-ci devait se décomposer en une suite innombrable d’étapes. Il se tourna alors vers la solution de D’Arcy Thompson qui se réduisait à l’action d’un système simple de facteurs. Il montra comment le dispositif complexe du pouce, avec ses muscles et ses nerfs, a pu se développer en une série de conséquences automatiques découlant du simple accroissement de l’os sésamoïde radial. Ensuite il expliqua que, selon lui, les changements complexes du crâne, dans la forme et dans la fonction – la transition d’un régime omnivore au mâchonnement presque exclusif du bambou, pouvaient être considérés comme des conséquences d’une ou deux modifications sous-jacentes. « Un très petit nombre de mécanismes génétiques, conclut-il, certainement inférieur à une demi-douzaine, furent à l’origine de la transformation adaptative d’Ursus [ours] en Ailuropoda [panda]. L’action de la plupart de ces mécanismes peut être identifiée avec une certitude raisonnable. »
Ainsi nous pouvons passer de la continuité génétique sous-tendant le changement – un postulat darwinien essentiel – aux modifications épisodiques et à leur résultat manifeste – à savoir une succession d’organismes adultes complexes. Des facteurs réguliers agissant sur des systèmes complexes peuvent entraîner des changements épisodiques. C’est là un paradoxe essentiel qui explique notre propre présence et qu’on retrouve dans la quête de nos origines. Sans ce niveau de complexité dans notre construction, nous n’aurions pas pu acquérir le cerveau qui nous permet de poser ces questions. Mais, avec ce niveau de complexité, nous ne pouvons pas espérer trouver des solutions dans les réponses simples que notre cerveau se plaît à concevoir.