Chapitre 7
Deuxième et troisième générations de crises
financières : modalités, causes et conséquences
Les années 1980, dans le domaine des marchés de
capitaux internationaux, sont marquées par les crises résultant de
l’essor, au cours de la décennie précédente, de l’économie
internationale d’endettement, et en particulier par la crise de la
dette des pays en développement.
À cette période de crises dites « de
fondamentaux » (« crises de première génération »),
succède au cours de la décennie suivante une période au cours de
laquelle les déterminants des crises sont généralement plus
complexes à cerner. Les déséquilibres majeurs des fondamentaux
macro-économiques sont moins clairement identifiables, voire
absents. En revanche, les comportements micro-économiques, sur le
plan interne comme sur le plan externe, jouent un rôle déterminant
(« crises de deuxième génération », « crises de
troisième génération »).

Schéma 6 : Chronologie des crises
financières, 1992-2002
Chronologiquement (schéma 6 ci-dessus), la
récurrence des crises à partir des années 1990 et 2000 suit un
schéma en trois étapes : la première moitié des années 1990
est avant tout marqués par les crises du Système Monétaire Européen
(7.1.) ; à partir de 1994-1995, les marchés financiers
émergents sont touchés par deux crises aux conséquences globales
majeures, la crise mexicaine de 1994-1995 et la crise des monnaies
asiatiques de 1997 (7.2.) ; puis ces crises, à partir de la
deuxième moitié de la décennie 1990, deviennent récurrentes, avec
pour dernière manifestation notable la crise argentine de
2001-2002, dont la particularité est de ne pas avoir occasionné
d’effets de propagation durables (7.3.).
Du SME à la monnaie unique : crises,
enseignements et incidences
Le tournant décisif pris par le processus
d’intégration européenne à l’occasion de la réalisation de la
monnaie unique est, historiquement, la résultante des mutations du
système de financement international au cours des trois décennies
précédentes : ainsi, le SME se conçoit comme la réponse
européenne au flottement généralisé des monnaies, et les crises de
ce système, en liaison avec l’extension du processus de
globalisation financière (7.1.1.) ont fourni aux États membres
l’expérience nécessaire à la marche vers la monnaie unique
(7.1.2.). De manière symétrique, la réalisation de l’Union
Économique et Monétaire a transformé le système de financement
international au niveau des relations entre les grandes monnaies
internationales. Actuellement, le poids de l’euro, bien que
toujours sensiblement inférieur à celui du dollar, détermine une
configuration de bicentrisme. Schématiquement, le dollar est en
tête quel que soit l’indicateur retenu, l’euro se classe en seconde
position, et les autres monnaies représentent des proportions peu
significatives (7.1.3.).
Les crises du SME : crises de
fondamentaux ou crises auto-réalisatrices ?
L’histoire du SME montre que si ce dernier a bien
« absorbé » l’instabilité de l’environnement
international des années 1980 (second choc pétrolier, fortes
fluctuations du dollar, krach boursier
de 1987, etc.), il n’en va pas de même pour la décennie 1990.
Ainsi, le SME enregistre une première crise, durant le second
semestre 1992, en raison du relèvement des taux courts décidé par
la Bundesbank lié au financement de la
réunification, et de l’incertitude provoquée par le
« non » des électeurs danois à la ratification du Traité
de Maastricht.
Cette crise se caractérise, après la dévaluation
de la lire (3,5 %) vis-à-vis de l’ensemble des autres monnaies
du SME, par des sur-réactions (overshooting) des marchés, débouchant sur la
suspension de la participation de la livre sterling et celle des
interventions obligatoires de la Banque d’Italie au mécanisme de
change européen (MCE) (17 septembre), les dévaluations de la
peseta et de l’escudo de 6 % (23 novembre) puis de la
livre irlandaise de 10 % (30 janvier 1993) et, à nouveau,
de la Peseta et de l’Escudo (respectivement de 8 et 6,5 %, le
13 mai), de fortes pressions sur le Franc français et
l’abandon du rattachement des monnaies périphériques de l’Europe du
Nord (Finlande, Suède, Norvège) à l’Ecu.
Durant l’été 1993, le SME est confronté à une
seconde crise majeure qui se manifeste par de violentes attaques
spéculatives contre le franc français, et s’achève (2 août)
par une décision d’élargissement à (+/- 15 %) des marges
de fluctuation des monnaies participant au MCE, qui ne signifie pas
l’abandon des principes fondamentaux du SME mais s’apparente à une
mesure de sauvegarde du système, à nouveau mis à l’épreuve, en
1995, en raison de la chute du dollar et des incertitudes sur
l’orientation de la politique monétaire en France.
Encadré 46 : Causes conjoncturelles des
crises du Système Monétaire Européen
Les causes
conjoncturelles des crises du SME sont liées à
l’affaiblissement du dollar et, corrélativement, de
l’affermissement du mark ; au ralentissement économique en
Europe (voire la récession de 1992-1993) rendant moins soutenable une politique d’ancrage au mark, en
raison des niveaux élevés des taux d’intérêt à court terme ; à
l’incertitude quant à la crédibilité du projet d’Union Monétaire
Européenne (UME) avec les difficultés du processus de ratification
du traité de Maastricht et le manque de convergence nominale ;
et au doute sur la solidité de l’axe franco-allemand (1993). En
résumé, les crises du SME sanctionnent l’échec relatif des
politiques de lutte contre la spéculation caractérisées par une
mobilisation massive des réserves de change assortie d’une forte
hausse des taux d’intérêt, avec le risque subséquent de provoquer
une récession économique, dans la mesure où ces politiques sont
inefficaces pour enrayer la défiance
contagieuse, car les opérateurs doutent qu’elles puissent
réussir (crédibilité) et/ou qu’elles
soient longtemps praticables (soutenabilité).
Outre un faisceau de causes
conjoncturelles (encadré 46, ci-dessus), les
causes structurelles de ces crises
tiennent à trois séries de facteurs [d’Arvisenet Petit, 1997,
344-6] :
1 Tout d’abord,
l’extrême rigidité de la grille des parités fixes entre janvier
1987 (réévaluations du mark et du florin de 3 %, des francs
belges et luxembourgeois de 2 %) et novembre 1992 (exception
faite de la réduction de la marge de fluctuation de la lire de 6 à
+/- 2,25 %, avec ajustement implicite du cours pivot à la
baisse de 3,7 %, le 5 janvier 1990) est confrontée à
l’insuffisance de convergence (inflation et finances publiques,
notamment) entre pays membres. Il résulte de ce hiatus, d’une part, une dégradation de la
compétitivité/prix des pays les plus inflationnistes du système
(Europe du Sud, Royaume-Uni). D’autre part, l’absence de tout
réajustement monétaire est interprétée, par les opérateurs, comme
illustrative d’une situation de convergence. Partant, la prise de
conscience par les marchés de la nécessité d’une révision de la
grille de parités, en 1992, eu égard au creusement des
différentiels macro-économiques entre pays membres et à la
détérioration globale de l’emploi, devient brutale. Plus
spécifiquement, les marchés cherchent, en attaquant la lire et la
livre, à sanctionner deux gestions macro-économiques oublieuses de
la rigueur budgétaire contenue dans le traité de Maastricht ;
en attaquant le franc français, ce sont la solidité de la
coopération franco-allemande et la crédibilité de l’engagement de
la Bundesbank aux côtés de la Banque de France qui sont mises à
l’épreuve. De même, en 1993, les marchés sanctionnent la mauvaise
coordination des politiques monétaires allemande et
française.
2 La deuxième
cause structurelle de ces crises est liée à la gestion du choc
asymétrique1
occasionné par la réunification allemande, pays leader de la zone. En théorie, dans une
zone multidevises, la survenance d’un choc asymétrique provoque un
alignement correcteur du taux de change. Il est, ainsi,
« absorbé » par une modification concertée de parité en
changes fixes (i.e. réalignements
« à froid »), ou par des
mouvements spontanés d’appréciation et de dépréciation relatives
des différentes devises en changes flottants, scénarios différents
de celui de la réunification. D’abord, contrairement aux
recommandations de la Bundesbank, l’union économique et monétaire
entre la RFA et la RDA (effective au 1er juillet 1990) se réalise au taux symbolique
de 1 mark/ouest pour 1 mark/est, taux nettement surévalué
au regard des écarts de compétitivité entre les deux économies.
Ensuite, un choc de demande asymétrique de cette ampleur, provenant
de l’injection massive de pouvoir d’achat, politiquement
nécessaire, associé à l’effondrement de la capacité productive des
länder de l’Est, génère un important
besoin de financement qui nécessite, a
priori, une appréciation réelle du mark. Or, le policy mix allemand se traduit par une politique
budgétaire expansive (financement de la réunification2) et une politique monétaire restrictive
(hausse des taux) afin de lutter contre les tensions
inflationnistes internes.
Considérant la nature asymétrique du SME, cette
hausse des taux allemands se transmet, augmentée des spreads, aux autres pays du MCE, en accentuant les
tendances dépressives au moment où la croissance ralentit. En
particulier, compte tenu du poids de l’endettement privé
(Royaume-Uni, pays nordiques) et public (Italie), les politiques
d’ancrage au mark deviennent insoutenables, d’où une anticipation
des marchés qui jugent que les gains de crédibilité liés à
l’appartenance au SME sont insuffisants comparativement à ses coûts
à court terme, remettant, ipso facto,
en cause la solidité de la solidarité du Système européen des
Banques centrales (SEBC) quant au maintien des parités, autant
d’opportunités pour lancer une attaque spéculative.
3 La troisième
cause de ces crises, non spécifique au SME, réside dans
les effets déstabilisants de la globalisation financière. La
libéralisation complète des mouvements de capitaux, prévue par une
directive communautaire de 1988, est réalisée en Europe dès le
1er juillet 1990. Inévitablement,
la pérennité d’un système de changes fixes se complique en contexte
de globalisation financière dès lors qu’il suppose une
certaine flexibilité des prix et des salaires pour maîtriser
l’évolution des taux de change réels, et un certain
volontarisme en termes d’ajustements réels afin d’asseoir la
crédibilité. Les pays se heurtent, alors, à une incohérence
temporelle entre, d’une part, l’ampleur des flux associée à la
forte réactivité des marchés de capitaux, et, d’autre part, la
relative inertie de l’ajustement réel, assortie d’une faiblesse des
moyens de réaction de court terme des autorités (i.e. les réserves de change, voir
graphique 32_Ref239319575
p. 205REF _Ref241247937).
En conséquence, la résilience du SME aux attaques
spéculatives, voire aux crises financières
(encadré 47_Ref239431043,
ci-dessous_Ref239431075), nécessite, au
début des années 1990, une accélération de la convergence nominale
des pays membres au moment où les ressorts de la croissance se
dégradent. Dès lors, les policy makers
se trouvent confrontés à de véritables dilemmes : un pays à
fort taux de chômage (i.e. la France)
peut difficilement pallier le creusement mécanique de son déficit
budgétaire par une politique restrictive. Dans un pays à monnaie
faible et dette publique élevée (i.e.
l’Italie), le maintien de taux d’intérêt élevés renchérit les
charges de la dette publique, et empêche la résorption des déficits
publics. Dans un pays moins développé que ses partenaires
(i.e. l’Espagne, le Portugal), la lutte
contre l’inflation, exigée par la convergence nominale, peut se
traduire par un ralentissement de la croissance, donc un blocage du
processus de rattrapage économique et un accroissement du
chômage.
Encadré 47 : Trois générations de modèles
de crises financières
Les crises du SME posent, du point de vue de la
théorie économique, le problème de l’identification des causes, qui
peuvent être initialement situées dans la sphère réelle, ou dans la
sphère financière. En réponse à cette interrogation, les modèles de
crises financières permettent d’opérer une classification des
crises en fonction de leurs facteurs déclenchants (fondamentaux
dans les modèles de première génération, liés aux modifications
d’anticipations des agents privés dans les modèles de deuxième
génération, ou déterminés par la fragilité des systèmes de
financement domestiques dans un contexte de finance globalisée dans
les modèles de troisième génération).
Modèles de première génération
Dans les modèles de première génération – on
parle, aussi bien, de modèles de première, deuxième et troisième
génération, que de crises de première, deuxième et troisième
génération – l’attaque spéculative est la sanction d’une
politique économique incohérente et, plus particulièrement, d’un
conflit entre l’objectif de cours de change de l’Autorité publique,
et les politiques mises en œuvre. Dans une interprétation plus
large (Krugman [1996]), sont inclus des « fondamentaux »
supplémentaires, par exemple le taux de chômage.
Modèles de deuxième génération
Le déclenchement de la crise est, dans les
modèles de deuxième génération, lié à une modification dans les
anticipations des agents privés, concernant la même gamme de
fondamentaux que dans le cas des modèles de première génération. De
même que précédemment, est qualifiée de crise de deuxième
génération toute crise autoréalisatrice (« du bas vers le haut
de la balance »). Il s’agit d’un problème de liquidité :
si les opérateurs anticipent qu’elle viendra à manquer, la crise
survient, alors que l’assèchement repose sur leur propre
comportement. Notons que la pertinence de la distinction entre
première et deuxième génération de modèles de crises financières
est remise en cause par Garber [1996] : les deux types de
modèles sont, selon lui, strictement équivalents dans tous les cas
de modifications des anticipations induites d’événements non
observables, ou non observés.
Modèles de troisième génération
La recherche d’un cadre d’analyse des crises
financières récentes, et notamment de la crise asiatique de
1997-1998, conduit à définir une troisième génération de modèles.
Il s’agit de considérer le rôle explicatif des fragilités des
systèmes de financement (éléments caractéristiques de
l’intermédiation et des marchés de titres domestiques), qui
constituent la spécificité des crises en question. Dans un univers
d’équilibres multiples (figure 4 p. 222REF _Ref239384536), la crise de troisième
génération est alors définie comme « crise de première
génération, mais avec des traits sous-jacents que l’on peut
attribuer à des fondamentaux dégradés […], découlant eux-mêmes des
comportements micro-économiques des agents privés » (Aglietta
et de Boissieu [1999]).
On retrouve, en définitive, la logique
d’extension du phénomène de globalisation financière : les
crises de première génération trouvent leur origine dans la sphère
réelle (haut de la balance des paiements) et se propagent ensuite à
la sphère financière (bas de la balance des paiements) ; les
crises de deuxième et de troisième génération évoluent à l’inverse
(du bas vers le haut de la balance des paiements), dans une logique
d’anticipations autoréalisatrices ; et les crises de troisième
génération présentent des traits distinctifs directement liés à
l’extension aux pays émergents des phénomènes de
« déréglementation » et de « décloisonnement »
des marchés de capitaux.
En définitive, la recherche de crédibilité de la
politique économique, dans un contexte d’étroites marges de
manœuvre des autorités, risque de provoquer, via la suspicion de non soutenabilité, une crise de
défiance à l’encontre des monnaies et, plus généralement, des pays
concernés en période d’atonie de la croissance. En effet, la
persistance de la rigueur ne suffit pas pour asseoir une réputation
et pour obtenir une structure de taux d’intérêt favorable. Encore
faut-il que cette rigueur soit jugée cohérente (consistent) par rapport aux équilibres
macro-économiques, politiques et sociaux, de moyen et de long
termes [Gilles, 1992]. En outre, la récurrence, depuis 1992, des
crises affectant le SME illustre le défaut de coordination des politiques économiques au sein de
l’Union européenne, comme l’illustre la gestion sous optimale de la
réunification3. Et
cette mainmise des marchés opère, non seulement sur les politiques
monétaires, contraintes en changes fixes (a
fortiori dans le cadre de l’UEM et de la monnaie unique),
mais aussi sur les politiques budgétaires.
Dans ce dernier cas, toute relance budgétaire
contracyclique peut accroître les déficits publics et se traduire
par une hausse des taux d’intérêt à long terme, situation
instantanément anticipée par les marchés financiers (via les primes de risque) comme non soutenable. Par
conséquent, les opérateurs ne souscrivent pas aux nouvelles
émissions de titres publics, anticipant un reniement de l’objectif
de change (i.e. une dévaluation), donc
une élimination de tout ou partie des gains induits des taux
d’intérêt. En d’autres termes, lorsqu’une politique économique
n’est pas tenable, le coût de sa continuation s’en trouve
considérablement accru. Dans ce contexte, l’union monétaire est
susceptible de desserrer cette emprise des marchés par l’émergence
d’une identité financière européenne enlevant toute opportunité
spéculative consécutive à la concurrence des monnaies au sein d’un
espace financièrement intégré.
Les leçons des crises du SME et la marche vers
la monnaie unique
En ce sens, la conception et la mise en œuvre du
traité de Maastricht
(encadré 48_Ref239432276
ci-dessous_Ref239432279) tiennent
compte des déficiences du SME révélées par les crises monétaires
européennes. D’abord, le gradualisme du processus d’intégration,
qui implique une convergence des performances économiques et une
relative coordination des politiques économiques nationales, a
permis d’éviter le risque d’enlisement, tout en prohibant un
basculement brutal vers la monnaie unique. Ce passage graduel en
trois phases [Beitone, Gilles, Parodi, 2006, 365-9] a répondu aux
risques de la formation prématurée d’une union monétaire en cas
d’hétérogénéité des économies concernées, facteur de comportement
de free riding, donc de fragilisation
de la future zone.
Encadré 48 : Le traité de Maastricht
(1992) et la marche vers la monnaie unique
En juin 1988, les Douze, réunis au sommet de
Hanovre, décident de nommer un groupe d’experts chargé
« d’étudier et de proposer les étapes concrètes devant mener à
l’Union Économique et Monétaire ». Le Rapport, publié en avril
1989 par ce comité (« le Rapport Delors »), a constitué
la base des négociations qui ont abouti à la signature du
« traité sur l’Union européenne » au sommet de Maastricht
(7 février 1992), entré en vigueur le 1er novembre 1993 à la suite de la procédure de
ratification. La marche vers la monnaie unique s’est,
effectivement, engagée lors du sommet de Cannes (juin 1995) fixant
comme date butoir irrévocable, le 1er janvier 1999. Parallèlement, le nom de
« l’euro » pour la monnaie unique est adopté au sommet de
Madrid (15-16 décembre 1995). Plus spécifiquement, en France,
le passage à l’euro est adopté, le 22 avril 1998, par
334 députés contre 49. Le 23 avril, le Bundestag approuve, massivement, le passage à la
monnaie unique par 575 voix sur 615.
Le traité de Maastricht prévoit un schéma de
passage graduel à l’UEM, en trois
phases. La phase I débute, en juillet 1990, avec la
libéralisation des mouvements de capitaux entre les pays membres.
Les principaux éléments de cette étape ont été l’achèvement du
Marché unique (1993), le renforcement de la coordination des
politiques monétaires et la poursuite de la convergence
économique ; objectifs institutionnalisés lors du sommet du
Luxembourg (13-14 décembre 1997). Ainsi, quatorze des quinze
États membres ont présenté, depuis 1991, des « programmes de
convergence » en vue de se conformer aux critères de passage à
la monnaie unique (en matière d’inflation, de taux d’intérêt à long
terme, et de finances publiques). La phase II a débuté le
1er janvier 1994, et astreint les
États membres à certaines obligations telles que l’interdiction des
financements monétaires des déficits publics et d’accès privilégié
des collectivités publiques aux institutions financières, de même
que l’application de la clause de “no bailing
out”, c’est-à-dire l’absence de cautionnement mutuel entre
États.
Cette phase II se caractérise, également, par la
création de l’Institut Monétaire Européen (IME), précurseur de la
future Banque Centrale Européenne (BCE), organisme consultatif se
substituant à l’ancien Comité des Gouverneurs des Banques centrales
entré en fonction le 1er juin 1998,
après la désignation de la composition de son directoire lors du
sommet de Bruxelles (2-3 mai 1998). L’IME a pour mission de
renforcer la coopération et la coordination des Banques centrales
nationales en matière de politique monétaire, de superviser le
fonctionnement du SME (en reprenant les fonctions de compensation
assurées par le FECOM), et de faciliter l’usage de même que le
développement de l’écu. La phase III se caractérise par la
fixation irrévocable des taux de conversion et la mise en place de
la monnaie unique. Considérant les critères de convergence
nominale, la majorité des États membres ne pouvait accéder à la
phase III, fin 1996. En conséquence, elle a débuté le
1er janvier 1999, avec onze
participants4, soit
290 millions d’habitants, après que les ministres des Finances
concernés aient fixé les taux de conversion définitifs de leurs
monnaies avec l’euro, comme 6,55957 francs français et
1,95583 deutsche mark pour 1 euro5. Simultanément, les dettes publiques des
onze pays de l’euroland ont été
converties en euros, créant un marché obligataire d’environ
6 300 milliards de dollars (5 375 milliards
d’euros), se rapprochant du marché obligataire des États-Unis
(environ 10 000 milliards de dollars, soit
8 532 milliards d’euros). Enfin, ce processus s’est
concrétisé, le 1er janvier 2002,
dans l’ensemble des pays membres, par la circulation effective de
l’euro en tant que monnaie métallique de paiement, se substituant
progressivement à l’ensemble des monnaies nationales constitutives
de l’UEM.
Une autre leçon induite des crises du SME concerne
la nécessité, pour la stabilité et l’efficacité de la future UEM,
de renforcer la coordination des politiques économiques
(budgétaires, fiscales, etc.) et d’élargir la gamme des indicateurs
(prix, endettement privé, mouvements de capitaux, etc.) encadrant
le processus coopératif. Ainsi, afin de pallier les risques de
free riding budgétaire, le Conseil des
ministres de l’Économie et des Finances a défini, lors du sommet de
Dublin (13-14 décembre 1996), le « Pacte de stabilité et
de croissance »6
destiné à prévenir les situations de « déficit excessif »
et à activer les procédures de correction « à froid ». La
troisième leçon s’applique aux futures relations de change entre la
zone euro et les pays « pré-in », traitées lors du Conseil des Ministres
de l’Économie et des Finances réuni à Vérone (avril 1996) par la
création d’un « SME bis »
prévoyant un arrimage des monnaies « pré-in » à l’euro, de même qu’une spécification
des efforts de convergence préalables à un ralliement futur.
L’objectif est, ainsi, de réduire le risque que certains pays,
membres du Marché unique, usent de leurs taux de change
via une dépréciation compétitive
vis-à-vis de l’euro à des fins commerciales (dumping monétaire).
Plus spécifiquement, l’entrée dans l’Union
européenne de dix nouveaux pays7,
parmi lesquels huit Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO), le
1er mai 2004, a redynamisé le
chantier de l’élargissement de l’UEM puisque l’adoption de l’euro
sera la prochaine étape de l’intégration de ces nouveaux
membres.
Incidences globales de la réalisation de
l’Union Économique et Monétaire européenne sur le système de
financement international
La réalisation de l’UEM a transformé le système de
financement international aux niveaux, d’une part, des relations
entre l’euro et les autres grandes monnaies internationales (dollar
et yen), soit la configuration du polycentrisme représenté par la
« triade monétaire » (États-Unis, Europe, Japon) ;
d’autre part, de la demande et de la composition des réserves
internationales, notamment celles des pays européens qui
détiennent, dans les années 1990 jusqu’au début des années 2000, un
tiers des réserves mondiales et représentent près de la moitié du
commerce mondial.
La nouvelle donne monétaire et financière
internationale est, principalement, caractérisée par l’essor du
polycentrisme monétaire spécifié par l’existence d’une monnaie de
réserve dominante (le dollar), progressivement
« épaulée » par d’autres devises, spécialement le yen et
le deutsche mark puis l’euro, qui demeurent des monnaies souvent
partielles8 à
l’échelle mondiale. En l’occurrence, la part des différentes
devises dans le total des avoirs officiels en devises des Banques
centrales illustre le rythme très graduel auquel les autorités
monétaires ont été amenées à diversifier leurs réserves de change
(tableau 24_Ref239432598,
ci-dessous_Ref239432604).
Tableau 24 : Part des monnaies dans le total
des avoirs officiels en devises de l’ensemble des pays, 1973-2008,
fin d’années, taux de change constants, en %

Entre 1999 et 2003, la monnaie unique a gagné
7 points de pourcentage de part dans les réserves de change
mondiales. Par la suite, la période de large accumulation de
réserves par les Banques centrales des pays émergents (triplement
au niveau mondial entre 2000 et 2007) marque une stabilisation de
la part de l’euro. Il faut cependant noter que la Russie, entre
2005 et 2007, a porté la part de l’euro dans ses réserves de 10 à
45 %.
Sources : FMI,
BCE.
Sur le marché des actifs privés, la part des
monnaies européennes passe, entre 1981 et 1995, de 13 à 37 %
du portefeuille mondial, tandis que, corrélativement, celle du
dollar a diminué, passant de 67 à 40 %. Cette proportion est
relativement stable : par exemple, à fin 2007, 43 % des
emprunts internationaux en obligations étaient en dollars, contre
32 % en euros. Sur le marché international des fonds
empruntés, les transactions en dollar et en euro présentent des
proportions comparables et également stables (autour de 40 et
30 %, respectivement). Le dollar reste prédominant, dans la
mesure où, pour les émetteurs, la monnaie américaine présente des
avantages substantiels en termes de moindres coûts d’utilisation
(coûts d’information et de transaction) liés à l’étendue de son
marché et à une liquidité élevée. De manière générale, l’euro
progresse dans les pays relevant de sa zone d’influence, mais ne
parvient pas à percer en Asie, en Amérique latine ou au
Moyen-Orient.
En tant qu’instrument de transaction et unité de
compte, le recul du dollar est faible. Il reste, d’abord, le
principal instrument de transaction sur le marché des changes (90,
83 et 86 % respectivement en 1989, 1995 et 20079 ; à cette dernière date l’euro
représente 37 %, la livre sterling et le yen 15 à 16 %),
même si l’euro a fait disparaître les transactions
intra-européennes. S’agissant des transactions commerciales,
29 % des exportations mondiales étaient libellées en euros en
2007 (contre 18 % en 2001). Cependant, alors que les
États-Unis facturent en dollars 99,8 % de leurs exportations
et paient en dollars 92 % de leurs importations, l’Allemagne,
premier exportateur mondial, ne facture que 68 et 59 %,
respectivement, de ses exportations et importations en dehors de la
zone euro. Le dollar reste, également, la seule monnaie de fixation
des cours des matières premières, et notamment de l’énergie, dont
le marché est l’un des premiers mondiaux. En outre, le dollar reste
prédominant dans le libellé de la dette des PED (fin 2007, environ
50 % de la dette africaine, 60 % de la dette de la zone
Asie-Pacifique et 80 % de la dette sud-américaine et
moyen-orientale). Par ailleurs, si le nombre de pays rattachant
leur devise au dollar a régressé, le « billet vert »
demeure, toutefois, une valeur d’ancrage essentielle, en
particulier en Asie et en Amérique latine. Sur la base des
pratiques « réelles » des Banques centrales, qui ne sont
pas toujours conformes à leurs déclarations, les parts respectives
du dollar et de l’euro sont ainsi estimées, respectivement à 40 et
30 % fin 2007.
Ces données illustrent une forme faible de
polycentrisme monétaire [de Boissieu dans Walrafen, [1994],
229-244], dans laquelle la part du dollar, que ce soit dans les
réserves officielles de change des Banques centrales, dans la
facturation des échanges commerciaux internationaux, ou sur les
marchés financiers, reste largement prépondérante, relativisant,
par là même, la « triade monétaire ». Toutefois, l’euro
est un candidat naturel au rôle de « monnaie totale »
internationale (international
currency), et, dispose d’avantages significatifs pour
modifier cette situation. D’abord, c’est la monnaie domestique d’un
vaste territoire (représentant, en 2008, 20 % du PIB mondial,
soit une part équivalente à celle des États-Unis). En outre, les
actifs financiers des pays membres devenant davantage substituables
en raison de la suppression du risque de change intra-zone, le
marché financier européen va gagner en liquidité et, ainsi, devenir
plus attractif. Ensuite, la part de l’euro dans les réserves de
change est appelée à s’accroître, notamment par convergence de la
structure des réserves des Banques centrales des pays tiers sur
celle de leurs exportations. L’Union attire, également, les pays
européens restés à l’extérieur (pays « pré-in », les Pays d’Europe Centrale et Orientale
PECO ; cf. ci-après) : pour
incorporer l’UEM, ils ont ancré leurs monnaies à l’euro et
financent leurs déficits extérieurs dans cette monnaie, d’autant
que la structure de leur commerce extérieur, de leurs
investissements, et de leur endettement extérieur, abonde en ce
sens. Enfin, l’abondance d’épargne domestique et la faiblesse des
taux dans la zone euro devraient favoriser l’activité d’emprunts en
euro de la part des non résidents.
Par ailleurs, les tailles des marchés d’actions et
d’obligations européens sont comparables à ceux des États-Unis, ce
qui devrait conduire l’euro à devenir une monnaie internationale
comparable au dollar, a fortiori dans
le contexte de crise des années 2007 à 2009 où la défiance
vis-à-vis du dollar ou des titres libellés dans cette monnaie peut
opérer. Cet argument comporte, toutefois, certaines limites.
D’abord, si dans certain cas (i.e.
swaps de taux), la fusion des marchés et la constitution d’un
marché unique important sont avérées, dans d’autres cas (dettes
publiques, euro-obligations ou eurocrédit), le passage à une
monnaie unique (l’euro) n’équivaut pas, ipso
facto, à l’existence d’un marché plus liquide. Ainsi, pour
les dettes publiques, les techniques d’émission, la fiscalité, et
la qualité de signature (spreads)
diffèrent entre les émetteurs, dès lors qu’il n’y a pas fusion
totale des lignes d’emprunt, ni agence européenne d’émission de la
dette. En outre, si la substituabilité entre les différentes dettes
est accrue avec l’élimination du risque de change, elle n’est pas
parfaite : le maintien de politiques budgétaires autonomes
induit un éventuel « risque de spread » (i.e. les
« primes de risque ») entre émetteurs, destiné à
valoriser le risque de signature. Parallèlement, l’offre nette de
titres en euros, disponibles pour les non-résidents, est
susceptible d’être faible en raison de l’excès d’épargne
longue.
En définitive, au terme d’un ajustement
relativement rapide au cours des premières années d’introduction de
l’euro, son poids international semble relativement stable. Il n’en
va pas de même de son cours de change par rapport au dollar. Ainsi,
durant la seconde moitié des années 1990, les bonnes performances
boursières américaines et les fortes perspectives de croissance
liées à la « nouvelle économie » ont attiré, vers les
États-Unis, des flux importants de capitaux, en particulier en
provenance d’Europe, qui ont renforcé la valeur du dollar. Les
investisseurs européens, dans le but d’accroître le rendement de
leur portefeuille, ont affaibli l’euro en se portant sur des actifs
américains. Un second élément, plus structurel, explique cet
affaiblissement. La création de l’euro et son corollaire, une
politique monétaire commune à l’ensemble des pays membres de l’UEM,
ont augmenté les corrélations entre les places boursières
européennes. Dès lors, pour diversifier leurs portefeuilles, les
investisseurs augmentent leur détention d’actifs en dehors de la
zone euro, ce qui peut expliquer les réactions asymétriques
(2000-2) des marchés financiers à l’égard de l’euro : l’euro
s’affaiblit lorsque les nouvelles sont mauvaises, mais ne
s’apprécie pas forcément lorsqu’elles sont bonnes… Un an après sa
naissance, l’euro avait perdu plus de 15 % de sa valeur,
passant de 1,17 $ (le 4 janvier 1999) à 1,03 $ (le
7 janvier 2000) pour 1 euro, après que la BCE ait relevé,
en novembre, d’un demi point son taux directeur à 3 %. L’euro
atteint son plus bas niveau depuis sa création le 26 octobre
2000, en cotant 0,823 dollar, malgré plusieurs interventions
de la BCE, particulièrement celle concertée avec le FED et la
Banque du Japon du 22 septembre 2000.
Tableau 25 : Historique de la parité
euro/dollar, 2000-2009

(*) cours officiel de lancement au
1er janvier : 1,16650
(**) août 2009
(**) août 2009
Source :
www.stox-office.com
Aujourd’hui (2009), l’euro est relativement bien
orienté par rapport au dollar, pour se « stabiliser »
dans un « canal horizontal » de 1,25/1,40. Si la monnaie
unique a parfaitement impulsé l’unification des marchés de capitaux
née de la création de l’Euroland (en 1999, 450 milliards
d’euros ont été émis sur le marché obligataire international contre
540 milliards d’émission en dollars), avec la suppression du
risque de change interne, sa volatilité face au dollar l’a privé,
pour l’instant, de la réelle stature internationale que lui aurait
conférée, en particulier, le rééquilibrage des réserves de change
des pays asiatiques (7.1.2.) au profit de l’euro.
Dans une perspective de long terme, deux thèses
principales quant aux niveaux et aux fluctuations de change de
l’euro (« euro fort » vs « euro
faible ») peuvent être avancées : d’une part, les
tenants d’une dépréciation, à moyen terme, de l’euro dès lors que
la crédibilité des institutions monétaires de l’UEM n’équivaudra
pas, à moyen et long termes, celle de la Bundesbank ; d’autre
part, ceux qui avancent le risque d’appréciation de l’euro
résultant des choix d’allocation de portefeuille, notamment des
non-résidents. La thèse en faveur de l’euro faible est que la
première assertion relative à la crédibilité de la BCE ne renvoie
pas à la constitution monétaire de l’Union, dès lors que les
traités afférents affirment, sans ambiguïté, que l’objectif de la
BCE est la stabilité des prix (encadré 49_Ref239492122 ci-dessous_Ref239492125), dans un cadre institutionnel
d’indépendance la préservant des pressions politiques, mais plutôt
à la composition, voire à la solidité, de l’Union. En effet,
l’Union Européenne incluant des pays à tradition inflationniste
(l’Italie, par exemple), l’objectif de stabilité des prix pourrait
se heurter à des comportements nationaux de free riding. Ainsi, certains États membres, sous le
couvert de l’Union, particulièrement en période de crise, comme
celle de 2008-2009, pourraient avoir la latitude d’adopter des
politiques imposant à leurs partenaires les conséquences
financières négatives de leurs choix (externalité véhiculée par une
hausse des taux d’intérêt) ; comportements susceptibles de
remettre en cause la solidité de l’UEM via une moindre coopération et solidarité internes
en rupture avec la logique de l’intérêt mutuellement avantageux, et
de provoquer une défiance vis-à-vis de l’euro ; phénomènes
amplifiés avec l’élargissement européen (7.1.2.).
Encadré 49 : Statuts et fonctionnement de
la BCE
La Banque centrale européenne (BCE) a,
statutairement, l’obligation de veiller à la stabilité des prix,
conformément à l’article 105 du traité consolidé instituant la
Communauté européenne, selon la définition quantitativiste,
confirmée par le Conseil des Gouverneurs du 8 mai 2003,
suivante : « La stabilité des prix est définie comme une
progression sur un an de l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) inférieure à 2 % dans la zone euro. »
L’analyse monétaire conduite par la BCE pour apprécier les
tendances de moyen et long termes repose sur la relation étroite
supposée entre la quantité de monnaie en circulation et les prix
sur longues périodes. Elle s’appuie sur différents indicateurs,
notamment les composantes et les contreparties (en particulier le
crédit) de M3. Le Conseil des Gouverneurs de la BCE, lors de sa
réunion du 5 décembre 2002, a confirmé la valeur de référence
de 4,5 % de progression annuelle de M3 sur le moyen terme,
puis a annoncé (8 mai 2003) qu’il ne procéderait plus à
l’examen annuel de cette valeur, tout en continuant à en étudier
périodiquement les conditions et hypothèses sous-jacentes ;
cette orientation à moyen terme de la politique monétaire étant
confirmée par J.-C. Trichet lors de son entrée en fonction
(1er novembre 2003) comme second
Président de la BCE (pour plus de détails, voir 8.1.).
L’autre argument en « faveur » d’une
dépréciation à terme de l’euro concerne les stratégies de
diversification du risque des opérateurs privés. Lorsque ces
derniers ont à leur disposition une multiplicité de monnaies
européennes face à une seule monnaie internationale (le dollar),
ils optent pour une structure de portefeuille en évaluant l’excès
de rendement anticipé de chaque devise comparativement au dollar
ainsi que les variances et covariances (corrélations) de ces
rendements. Ainsi, la pluralité des devises européennes permettait
une meilleure diversification du risque de change pour un
investisseur basé en dollars. Ce phénomène est amplifié par la
faiblesse du rendement de l’euro comparativement à celui obtenu,
avant l’unification, avec les monnaies européennes
« périphériques ».
La seconde thèse (« euro fort ») repose,
également, sur la composition du portefeuille des non-résidents,
mais dans une optique différente. Si les opérateurs internationaux
privilégiaient la détention d’euros, une demande excédentaire sur
le marché des changes, renforcée par un différentiel de taux
d’intérêt favorables, pourrait provoquer, temporairement, une
sur-appréciation au regard des fondamentaux ; l’euro étant, en
l’occurrence, victime de son succès. Un second argument, en faveur
de l’euro « fort », réside dans la capacité d’attraction
de l’UEM sur les flux financiers des investisseurs non européens.
Ces mouvements de capitaux sont, néanmoins, fortement dépendants du
degré de liquidité du marché obligataire européen, qui reste limité
par l’absence de dette fédérale et par la segmentation persistante
des marchés des titres d’État.
En tout état de cause, la question en suspens
concerne la contribution de l’euro à la stabilité monétaire
internationale. Avec l’essor du poids international de l’euro, la
BCE sera probablement confrontée, à moyen terme, à une instabilité
de la demande de monnaie et d’actifs libellés en euros, avec le
risque subséquent, en cas de réponse à une demande excédentaire par
un accroissement de l’offre de monnaie, d’une révision à la baisse
de sa crédibilité. Du point de vue de la parité de la monnaie
unique, la zone euro formant un grand ensemble modérément ouvert
(comparable à celui des États-Unis), la BCE pourrait accorder
relativement peu d’importance à la valeur externe de l’euro,
celle-ci n’étant pas utilisée comme arme commerciale (i.e le canal externe de la politique monétaire),
d’où une relative stabilité du taux de change. Alternativement, la
BCE, libérée de la contrainte externe, pourrait à l’image de la FED
mobiliser sa politique monétaire à des fins internes de
stabilisation économique (croissance et inflation) dans une optique
contra-cyclique. Dans ce contexte, le taux de change entre l’euro
et le dollar deviendrait plus volatile afin d’absorber les chocs
asymétriques concernant les deux zones.
L’essor des marchés émergents et les premières
crises
Outre les mutations liées aux processus
préparatoires puis à la mise en œuvre de la monnaie unique, le
système de financement international à partir des années 1990 est
marqué par l’essor et les crises des marchés émergents,
apparaissant comme un sous-groupe distinct au sein des pays en
développement. En effet, alors que ces derniers restent dans leur
ensemble confrontés à un phénomène chronique de rationnement du
crédit, les marchés émergents ont accès aux financements extérieurs
privés (7.2.1.). Pourtant, ces flux privés, extrêmement importants
en « période tranquille », sont également extrêmement
instables. Ainsi, dès 1994-1995, la « crise mexicaine »
entraîne un retrait massif des capitaux investis dans les économies
émergentes (7.2.2.). Les créanciers seront plus profondément
déstabilisés encore par la crise généralisée dite « des
monnaies asiatiques », qui touche en 1997 l’Asie du Sud-Est,
alors considérée comme un modèle de développement économique
(7.2.3.).
Les Marchés financiers émergents (MFE) et la
montée de nouveaux risques
Au début des années 1980, les nouveaux pays
industrialisés d’Asie et d’Amérique latine deviennent des acteurs
majeurs de la finance internationale, impulsant le phénomène des
« Marchés financiers émergents » (MFE). L’essor et la
place des MFE dans la capitalisation boursière mondiale (de
2,5 % à 13 % de 1983 à 1995) s’inscrivent dans un
mouvement général de libéralisation financière des pays en
développement caractérisé par un double processus de dérégulation
des taux d’intérêt et de libéralisation des activités financières
afin de stimuler la croissance, par le biais de l’ouverture du
marché à de nouvelles banques, aux institutions non bancaires, de
la privatisation des banques domestiques, etc.
(encadré 50_Ref239505505,
ci-après_Ref239505510).
Parallèlement, se développent les marchés de
capitaux, favorisés par la modernisation des marchés monétaires et
des changes, la création de marchés financiers classiques (actions
et obligations), voire de marchés de produits dérivés (Singapour, Hong-Kong,
Kuala Lumpur). Les marchés actions puis
les marchés obligataires sont rapidement confrontés à plusieurs
obstacles inhérents aux économies émergentes, comme la situation
d’excédent budgétaire pour la plupart des pays est-asiatiques, le
manque de crédibilité des institutions, la faiblesse du système de
compensation et de règlement, l’étroitesse des possibilités de
couverture en l’absence – la plupart du temps – de
marchés dérivés, la rareté des agences de rating, etc. Ces marchés obligataires enregistrent,
toutefois, une forte croissance nourrie d’un flux croissant
d’émissions du secteur privé, pour atteindre 800 milliards de
dollars en 1995, soit les deux tiers de la capitalisation des
marchés actions, pour une capitalisation boursière multipliée par
dix entre 1985 et 1995 (soit 13 % de la capitalisation
boursière mondiale contre 4 % en 1985).
Encadré 50 : Du rationnement du crédit à
la surcouverture du besoin de financement : Libéralisation
financière et décentralisation des décisions de financement
extérieur
Les afflux de capitaux ayant précédé les crises
des années 1990 et 2000 sont caractérisés par un trait
spécifique : le processus de dérèglementation des activités
financières, désormais étendu au pays émergents, permet aux
emprunteurs privés un large accès aux marchés financiers
internationaux. Dès lors, la dette extérieure de ces pays n’est
plus seulement souveraine – c’est-à-dire, contractée par le
gouvernement – elle est aussi, de plus en plus, privée. En
pratique, deux types de dette privée coexistent ainsi : la
dette garantie, reprise par l’État en cas de difficultés de
paiement de l’emprunteur ; et la dette non garantie.
Toutefois, de facto, la distinction est
beaucoup plus floue, les États en situation de crise ayant tendance
autant que possible à reprendre à leur compte toutes les dettes
contractées par des agents privés, pour éviter une trop forte
dégradation de leurs conditions d’accès aux marchés de capitaux. Ce
trait de comportement constitue, d’ailleurs, le principe clef du
modèle de crises de troisième génération fondateur de Dooley [1997]
(figure 5REF _Ref239580395 \h
p. 271PAGEREF _Ref239580398
\h).
Décisions d’emprunt décentralisées
Lorsque les entreprises ont accès, de même que
les gouvernements, aux marchés de capitaux internationaux
(« décentralisation des décisions d’emprunt »), les flux
de capitaux et l’endettement global du pays dépendent de plusieurs
éléments :
- D’abord, les
emprunteurs privés ne supportent pas la totalité du coût lié au
défaut : les dettes dont ils sont titulaires sont en effet
garanties, au moins de facto, par
l’État. Ceci peut occasionner un suremprunt.
- Par
ailleurs, si l’aversion au risque du secteur privé est en moyenne
inférieure à celle du gouvernement, la déréglementation conduit
également à un montant d’endettement extérieur plus
important.
Tragédie des communs
Le troisième effet correspond au principe de la
« tragédie des communs » et présente une importance
déterminante dans l’explication de l’apparition de situations de
surendettement. La « tragédie des communs » (Hardin
[1968]) est un cadre d’analyse de l’épuisement d’une ressource rare
librement accessible – son seul coût correspondant à
l’impossibilité d’exercer simultanément une autre activité
rémunératrice. Pour cette raison, la ressource est utilisée tant
que son produit moyen (c’est-à-dire la part que chacun peut
s’approprier) excède le rendement de l’activité alternative la plus
rémunératrice, ce qui conduit à son épuisement. Habituellement,
l’explication du phénomène de « tragédie des communs »
fait appel à une image : la ressource librement accessible est
alors un lac peuplé de poissons que chacun peut pêcher sans
restriction. À long terme, cette absence de coordination occasionne
un phénomène de sur-pêche et une disparition de l’espèce
pêchée.

On note f(x) la technologie de production
correspondant à la ressource commune, (x) la somme des facteurs
consacrés à l’exploitation du commun, et (p) le rendement de
l’activité alternative la plus rentable. L’illustration graphique
du phénomène de « tragédie des communs » fait alors
apparaître une surexploitation dans le cas II. (exploitation libre)
par rapport au cas I. (exploitation organisée par une Autorité
publique).
Représentation graphique du phénomène de
« tragédie des communs »
Dans le cas de l’endettement extérieur des pays
en développement et émergents, la ressource susceptible
d’épuisement est l’accès au financement extérieur (évaluation du
risque pays satisfaisante). Cette ressource est exploitée au-delà
de son seuil d’efficience dès lors que les prêts réalisés, ne
répondant plus au critère de soutenabilité, conduisent à une
dégradation rédhibitoire de l’évaluation dont le pays fait l’objet.
Par rapport à l’aléa moral, l’intérêt du concept de « tragédie
des communs » est double :
- D’abord, la
prise de décision décrite est décentralisée : il est donc
possible de traiter des conséquences de comportements non
coordonnés ou non coopératifs.
- D’autre
part, l’appropriation par des acteurs privés d’une ressource
publique au delà du seuil d’efficience en constitue la dimension
déterminante, ce qui correspond bien à la relation entre l’essor de
la dette extérieure des entreprises privées dans le cadre du
processus de dérèglementation et la dégradation de l’évaluation du
risque pays susceptible de s’ensuivre au niveau national.
D’autre part, les MFE se caractérisent par
l’instabilité de leurs régimes de financement interne. En effet, le
recours à des financements de marché importants, dans le cadre
d’une stratégie de développement à moyen terme, substitue à une
contrainte intertemporelle, une
contrainte financière instantanée sur le compte courant, voire le
solde budgétaire. Dans ce contexte, les MFE, fragiles et totalement
ouverts (dépendants) sur l’extérieur, sont particulièrement
vulnérables à de brutales crises financières, monétaires et
bancaires, caractérisées par trois phénomènes principaux.
D’une part, la fuite massive de capitaux liquides
et, en premier lieu, ceux du secteur bancaire domestique qui
convertit ses avoirs en monnaie étrangère dès l’annonce, voire dès
les premières rumeurs, de « réajustement » du cours de la
monnaie nationale, accentuant ainsi sa dépréciation (surréaction).
D’autre part, le désengagement très rapide des capitaux étrangers
placés sur le marché obligataire sous la forme de Bons du Trésor
liés à la titrisation de la dette. Enfin, le retrait des
investissements de portefeuille placés sur les Bourses nationales.
Dès lors, l’effondrement des cours de la Bourse, la dépréciation
des monnaies nationales et les sorties nettes de capitaux à court
terme se conjuguent au sein d’un seul et même mouvement.
Au-delà du poids de la dette héritée, la demande
de monnaie dans ces pays (i.e. leur
capacité d’absorption) est souvent trop réduite comparativement à
leur taille financière, soit une couverture excessive des besoins
de financement par de la hot money,
d’où les tensions sur les liquidités et les difficultés de
placement de la dette publique. Ainsi, si les risques de défaut
affectent, exclusivement, les pays dont les efforts d’ajustement
sont insuffisants, les risques de marché (liés au retournement des
flux financiers en cas de modification du différentiel d’intérêt
avec les pays industrialisés et/ou des anticipations de change sur
la monnaie locale) concernent tous les pays, notamment lorsque la
part de besoin de financement structurel couverte par des capitaux
stables est restreinte, quand les dettes extérieures à court terme
excèdent les réserves en devises, et en cas de croissance du crédit
supérieure à celle du PIB nominal. Enfin, la connexion des marchés
de la dette publique avec une mobilité « parfaite » des
capitaux privés, entraîne un facteur de risque supplémentaire, à
savoir l’appel excessif du secteur privé à l’épargne extérieure,
notamment par l’intermédiation bancaire.
Plus précisément, les entrées massives de capitaux
privés vers les MFE, en principe favorables à la croissance des
pays récipiendaires, ont, cependant, engendré des « bulles
spéculatives »10 car
elles créent l’illusion de la réussite
économique et financière11,
d’où les surévaluations des monnaies locales, vecteur de
pénalisation de la croissance. En outre, jusqu’au début des années
1990, ces entrées de capitaux concernaient, essentiellement, des
capitaux longs sous la forme d’Investissements Directs à l’Étranger
(IDE), d’où un accroissement du stock de capital et un transfert de
savoir-faire qui ont consolidé le processus de développement des
économies concernées.
À partir de la décennie 1990, la plus forte
intégration des pays émergents dans la finance internationale a,
principalement, consisté en la libéralisation des flux de capitaux
à court terme, par nature plus volatils. Alors, les réactions des
marchés financiers sont susceptibles de provoquer de graves crises
économiques et financières en raison de la tendance des opérateurs
à répondre avec exubérance aux succès et à réagir de façon exagérée
lorsque l’orientation du marché se modifie. En d’autres termes,
tant que les investisseurs étrangers ont confiance, les
« bulles » sur les marchés les plus spéculatifs
(immobilier, marché actions) enflent selon une logique
d’autovalidation des anticipations ; mais dès qu’un mouvement
de défiance survient, le reflux brutal des capitaux précipite
l’éclatement de la bulle amplifié par les difficultés d’évaluer le
risque inhérent à des pays plus instables que des pays
industrialisés et délivrant une information économique et
financière moins crédible.
La crise mexicaine : un effet de surprise
relatif
La crise mexicaine (décembre 1994) et son effet de
contagion (« effet tequila »), de même que la crise des
monnaies asiatiques (été 1997) puis russe (1998) et, dans un
contexte singulier de currency board,
argentine (2001) s’inscrivent dans ce cadre, et doivent être
analysées en fonction des difficultés éprouvées par les États à
gérer leurs économies (maîtrise de l’évolution de la masse
monétaire, notamment) dans une situation de libéralisation des
mouvements de capitaux. En effet, ces crises ont en commun d’avoir
été nourries par la coexistence, non pacifique, d’une surévaluation
de la monnaie domestique (avérée, objectivement, par rapport aux
fondamentaux, ou ressentie comme telle, subjectivement, par les
investisseurs non résidents) avec un endettement extérieur à court
terme hypertrophié.
Encadré 51 : Le rôle des fragilités
structurelles dans l’explication de la crise mexicaine de
1994-1995
La crise mexicaine de 1994-1995 est symptomatique
de la précarité du redressement latino américain. En effet, durant
la période [1990-1993], le Mexique a maîtrisé ses déséquilibres
externes (prix et déficit budgétaire) par une politique économique
d’assainissement assortie de réformes structurelles, mais au prix
d’une forte dégradation de ses comptes extérieurs. Le déficit de la
balance courante atteint 47 milliards de dollars en 1994, soit
7,5 points de PIB contre 3 milliards en 1990, résultant
des effets combinés de l’accroissement des importations (de biens
d’investissement notamment), de la forte dégradation de la
compétitivité/prix des produits mexicains liée à l’appréciation du
taux de change réel (plus de 20 % sur la période [1990-mi
1994]), de la baisse des tarifs douaniers due à la mise en œuvre de
l’ALENA, et de l’accroissement de la charge d’intérêts liée à la
progression de l’endettement extérieur dans un contexte de
désinflation mondiale [d’Arvisenet Petit, 1997, 167 et s.]. D’où
une forte croissance du besoin de financement extérieur (somme du
déficit de la balance des paiements courants et du remboursement du
principal de la dette) s’élevant, en 1994, à près de 10 points
de PIB, intenable dans la durée12.
Durant cette période, les IDE n’ont représenté
que 2 points de PIB au Mexique, et les financements par crédit
à moyen et long terme sont passés de 5 % à 2 % du PIB. Le
bouclage du financement extérieur a été assuré par des émissions
d’obligations internationales et, surtout, par le placement de
titres publics en pesos auprès de
non-résidents, ainsi que par des dépôts bancaires ouverts par ces
derniers (94 milliards de dollars mi 1994, la part des valeurs
gouvernementales détenues par les non-résidents passant de
33 % fin 1992 à près de 60 % à l’automne 1994).
L’attractivité de ces placements a débouché sur une
« surcouverture » des besoins de financement en 1992 et
1993, conduisant à un gonflement artificiel des réserves de change
(28 milliards de dollars en février 1994). La libéralisation
financière conjuguée à des taux d’intérêt élevés liés à une
politique monétaire restrictive ont attiré des capitaux extérieurs,
d’où une surévaluation du peso.
À partir de 1992, deux mouvements
contradictoires, à savoir la baisse des financements stables et la
hausse des besoins de financement, s’amplifient pour atteindre, en
1993-1994, un écart de près de 6 points de PIB couvert par des
capitaux volatils ; illustrant, par là même, la compatibilité
entre un risque souverain et une situation d’équilibre
budgétaire13, dès
lors que le financement du déficit des paiements extérieurs est
assuré par une substitution de détenteurs non-résidents à des
détenteurs résidents d’une dette publique interne titrisée.
Au début de l’année 1994, outre l’élévation du
déficit courant, les marchés financiers latino-américains (dette
souveraine, Bourse) se sont orientés à la baisse avec le relèvement
des taux d’intérêt américains, ce qui, associé à une forte
instabilité politique (i.e. la révolte
des paysans pauvres et de la guérilla zapatiste du Chiapas de
même que l’assassinat du candidat officiel à la Présidence,
L.D. Colosio, dauphin désigné du président Salinas), facteur
aggravant de la fébrilité des marchés, provoque une crise de change
(mars 1994). Les sorties de capitaux afférentes génèrent, alors,
une hausse des taux d’intérêt domestiques et une dépréciation
de facto du peso de 9 %, malgré la
mobilisation de 10 milliards de réserves de change, entre
février et avril. Lors des mois suivants, malgré le contexte de
morosité, les capitaux volatils, attirés par le niveau exceptionnel
des rendements et le résultat « positif » des élections
(i.e. la perspective de privatisations
fructueuses pour les investisseurs internationaux), reviennent
massivement pour se placer sur les titres gouvernementaux indexés
sur le dollar (Tesobonos), couvrant,
ainsi, le besoin de financement extérieur.
En décembre 1994, les marchés prennent conscience
de l’importance du déficit extérieur ce qui, considérant
l’aggravation de la crise politique du Chiapas, provoque de nouvelles sorties de capitaux
via la vente des obligations d’État,
dont une proportion importante arrivait de
toute façon à échéance posant, par là même (i.e. indépendamment des ventes de détresse
-distress sales- liées à la crise), le
problème du financement de forts déficits commerciaux et des
transactions courantes par des flux de capitaux privés à court
terme. Le 20 décembre, le plancher de la bande de fluctuation
autorisée de la monnaie nationale est relevé de 15 %, puis le
flottement libre du peso est décidé, dont le cours oscille entre 5
et 5,70 par dollar, les réserves de change passant de 13 à
6,3 milliards de dollars de novembre à décembre.
Parallèlement, les cours boursiers et ceux de la dette souveraine
chutent, le taux interbancaire passant de 19 % en novembre
1994 à 40 % début janvier 1995. En phase avec le flottement du
peso, un plan de lutte contre l’inflation (blocage des prix des
produits de première nécessité), de réduction des dépenses
publiques et de privatisations est mis en œuvre par le Président
Zedillo (janvier/mars 1995), épaulé par un dispositif d’aide
financière internationale de près de 50 milliards de dollars,
soit l’équivalent du total des flux d’investissements à destination
des pays en développement en 1993, année particulièrement
faste.
Plus précisément, le Fonds Monétaire International
met à la disposition du Mexique une « stand-by facility » de
18 milliards de dollars, le Trésor américain
« offre » une facilité de 20 milliards de dollars à
court et moyen terme sous forme de swaps de garantie sur les
recettes pétrolières, auxquelles s’ajoutent 10 milliards
injectés par la BRI. L’intégralité du sauvetage est, donc,
d’origine publique ; les banques commerciales, qui devaient
initialement apporter 3 milliards de dollars, s’étant
désistées quelques semaines avant l’annonce de ce plan. Ce dernier
s’accompagne de conditionnalités (baisse des salaires et du crédit,
élargissement des programmes de privatisation) qui vont accentuer
la récession. Par ailleurs, ces conditionnalités mettent fin à la
souveraineté nationale du Mexique, désormais sous tutelle, dont la
politique étrangère était, malgré son virage libéral des années
1980 et le contrecoup de la crise de la dette de 1982, l’une des
plus indépendantes d’Amérique latine.
La survenance de la crise mexicaine n’a quasiment
pas été prévue, donc anticipée, par les opérateurs. Par conséquent,
les lourdes pertes enregistrées par les détenteurs de titres
mexicains ont provoqué une logique de défiance contagieuse à
l’encontre de l’ensemble des MFE, perçus par les investisseurs
internationaux comme appartenant à la même classe de risques, d’où
un mouvement de contagion appelé « effet tequila ». Trois
séries de raisons peuvent expliquer la proximité temporelle des
crises monétaires.
1 D’abord, les
crises peuvent avoir une cause identique comme, par exemple, des
chocs économiques dans les pays industrialisés qui se répercu tent,
sous forme de crise, dans les pays émergents (« effet de
mousson »). Ainsi, la forte hausse des taux d’intérêt aux
États-Unis, au début des années 1980 (5.1.1.), a constitué un
facteur important de la crise de la dette en Amérique latine. De
même, la forte appréciation du dollar, surtout vis-à-vis du yen
durant la période [1995-7] a contribué à affaiblir le secteur
extérieur des pays d’Asie du Sud-Est.
2 La seconde
raison tient au couplage des échanges et des marchés de capitaux
internationaux (la dévaluation de la monnaie d’un pays rend les
autres moins concurrentiels, par exemple) voire aux
interdépendances dans les portefeuilles des créanciers
(l’illiquidité d’un marché peut contraindre les intermédiaires
financiers à liquider leurs actifs sur d’autres marchés). Les
« débordements » dus à ces interconnexions ont favorisé
et amplifié la propagation de la crise en Asie orientale.
3 Enfin, la
troisième raison tient à ce qu’un choc survenant dans un pays peut
inciter les créanciers à réévaluer les facteurs économiques
déterminants d’autres pays, ou à réduire le coefficient de risque
de leur portefeuille, et adopter un comportement de « fuite
vers les actifs de qualité » (“flight to
quality”). Ce dernier effet de contagion est lié à un
comportement « moutonnier » des investisseurs
(grégarisation des comportements) consistant « à anticiper
ceux des changements prochains dans l’ambiance et l’information que
l’expérience fait apparaître comme les plus propres à influencer la
psychologie de masse du marché » [Keynes, 1996, 170], dû à un
effet d’entraînement alimenté par des informations asymétriques,
voire à la réaction des gérants de fonds aux fortes
incitations.
Ces effets de débordement et de contagion ont joué
un rôle important dans la crise mexicaine de 1994-1995. Dans ce
contexte, le resserrement, après la crise, de la corrélation entre
les mouvements des prix des actions et les remboursements
d’obligations Brady entre les pays émergents d’Amérique latine est
traditionnellement expliqué, considérant les différentiels
macro-économiques de ces pays, soit par un comportement grégaire
des investisseurs, soit par le fait que les opérateurs liquidaient
des actions de plusieurs MFE, en dépit de leurs singularités
nationales, afin de mobiliser des fonds pour faire face à
l’accroissement attendu des demandes de remboursement sur d’autres
marchés ; en d’autres termes, par des interdépendances dans
les portefeuilles des créanciers. [Calvo Reinhart, 1996]
Certains analystes soutiennent qu’il est difficile
de déceler les données macro-économiques fondamentales susceptibles
d’expliquer cet « effet tequila », ce dernier étant, au
contraire, perçu comme la manifestation du « pessimisme »
ambiant des opérateurs. Dans ce cas, les événements survenus au
Mexique auraient incité les investisseurs à anticiper des
difficultés similaires dans d’autres économies émergentes,
déclenchant ainsi des sorties nettes de capitaux et une attaque
contre d’autres monnaies, alors que les données économiques de base
restaient inchangées. [Calvo, 1996] Selon d’autres observateurs, le
retournement induit des anticipations de la crise mexicaine
n’aurait affecté que les pays dont la situation économique était
défaillante. Ces pays auraient été vulnérables au pessimisme
auto-réalisateur des investisseurs, c’est-à-dire à la contagion
(encadré 52_Ref239517591
ci-dessous_Ref239517595), alors que les
pays dont les déterminants économiques restaient sains n’auraient
subi que des baisses momentanées de leurs entrées de capitaux
[Sachs, Tornell, Velasco, 1996]. Il est, en effet, apparu
rapidement que, dans un grand nombre de cas, le reflux des
mouvements de capitaux est resté éminemment temporaire, et n’a été
durable que pour un nombre très limité de pays, notamment, outre le
Mexique, l’Argentine et les Philippines.
Encadré 52 : Principaux déterminants des
différences de vulnérabilité des pays à l’« effet
tequila »
Trois éléments permettent de cerner les
différences de vulnérabilité des pays à « l’effet
tequila » :
- Le niveau du
taux de change réel (“The crucial real
exchange rate”) : l’appréciation du taux de change réel
de la monnaie domestique dans la période précritique conduit à une
nette dégradation des résultats à l’exportation. Il en résulte que
plus une monnaie est, initialement, surévaluée, et plus la
probabilité d’une correction brutale est forte ;
- L’essor du
crédit (“lending boom”) : une
forte croissance du crédit intérieur réel, en fragilisant les
bilans bancaires, augmente la vulnérabilité du pays face à une
érosion de la confiance des investisseurs. Une chute des dépôts
provoquée par une anticipation de dévaluation et/ou la faiblesse de
la couverture en devises des engagements extérieurs du système
bancaire, peuvent provoquer une panique (“run”) ou un rationnement du crédit lorsque la
Banque centrale ne relâche pas sa politique monétaire, souvent
incompatible avec le régime de change ;
- Les réserves
(“low reserves”) : en cas
d’inversion des mouvements de capitaux, les détenteurs de titres en
monnaie domestique ou de dépôts bancaires convertissent leurs
avoirs en monnaie étrangère, d’où une ponction sur les réserves. Le
risque de dévaluation (i.e. la
soutenabilité du régime de change) est, alors, étroitement lié au
niveau des engagements non couverts du secteur bancaire domestique,
à savoir le ratio M2/réserves internationales ; autrement dit,
le rapport des réserves au stock de crédit, qui rend compte de la
capacité de l’économie à résister aux pressions spéculatives sans
correction brutale du cours de change.
De ce qui précède, on peut établir « un
scénario type » de crise financière et/ou
bancaire :
En premier lieu, une période prolongée de
« surchauffe » de l’économie durant laquelle l’inflation
est relativement élevée et la monnaie surévaluée, avec des
conséquences défavorables pour les secteurs exportateurs
(i.e. forts déficits courants).
Parallèlement, la politique monétaire est sensiblement
expansionniste, avec une forte progression du crédit intérieur
(liée en particulier à des entrées massives de capitaux à court
terme, non stérilisées, c’est-à-dire supérieures aux besoins réels
de l’économie, dues à la libéralisation du système financier) qui,
dans les pays dont le régime de change est fixe ou inflexible
(comme dans le cas des pays asiatiques), compromet l’objectif de
taux de change. De ce fait, la vulnérabilité financière de l’éco
nomie s’accroît, amplifiée par la hausse des engagements du système
bancaire non couverts par des réserves de change et par la baisse
des prix des actifs. Dès lors, un choc, tel qu’une baisse de
l’activité réelle, un ralentissement des entrées de capitaux, une
dégradation des termes de l’échange, une chute marquée des prix des
actifs ou une hausse des taux d’intérêt mondiaux, vient affaiblir
un système bancaire trop exposé.
La crise des monnaies asiatiques : un
effet de surprise profondément déstabilisant
Considérant leur rythme de croissance14, les économies est-asiatiques sont parmi
les MFE les plus prospères des décennies 1980 et 1990. En outre,
l’orientation prudente de leurs politiques budgétaires, associée à
des taux d’épargne privée élevés, en font un modèle de
développement. Cet environnement favorable et son corollaire, la
sous-estimation des risques par les opérateurs en quête de
meilleurs rendements à un moment où les placements au Japon et en
Europe sont moins rentables du fait de leurs demandes domestiques
et, conséquemment, des faibles niveaux de leurs taux d’intérêt,
provoquent, à partir de 1992-1993, un afflux massif de capitaux
privés vers les MFE. Face à ces importantes entrées de capitaux
(82 milliards de dollars sur la période 1991-6), largement
supérieures à l’écart épargne/investissement (47 milliards de
dollars pour la même période), la politique de change d’ancrage au
dollar conduit logiquement les
autorités monétaires des pays d’Asie à augmenter leurs réserves de
change afin d’éviter l’appréciation de leurs monnaies. La
stérilisation des entrées de capitaux entraîne une hausse des taux
d’intérêt à court terme alimentant de nouveaux flux. Simultanément,
la distribution des crédits s’accélère malgré l’évolution des taux
d’intérêt.
L’allocation des ressources n’est alors plus
affectée, à l’instar des flux de capitaux longs, directement par
les créditeurs étrangers sur des investissements productifs, mais
par les systèmes bancaires domestiques, souvent inaptes à apprécier
le risque dans un contexte de faible supervision bancaire, dont
l’orientation du crédit alimente les marchés spéculatifs. En outre,
avec la libéralisation financière, les banques locales empruntent
en devises étrangères (en dollars, essentiellement) afin de prêter
en monnaies nationales. En conséquence, ces banques cumulent trois
types de risques : un risque de crédit, lié au possible défaut
de solvabilité de leurs débiteurs ; un risque de
transformation, en empruntant à court terme pour prêter à long
terme ; un risque de change puisqu’elles empruntent en devises
en anticipant une tradition de garantie publique, manifestation
d’un aléa moral (7.2.3.), qui
déresponsabilise l’ensemble des opérateurs.
Dans ce contexte, face aux tensions sur la parité
du baht depuis la crise de change
d’août 1996, les autorités thaïlandaises persistent, dans un pre
mier temps, à stabiliser le taux de change contre un panier de
devises au sein duquel le dollar occupe une place prépondérante
(environ 80 %), d’où la mise en place (mai 1997) d’un contrôle
des changes destiné à empêcher les banques à consentir des prêts en
bahts aux étrangers. La baisse des réserves et le niveau élevé des
taux d’intérêt, dans un environnement bancaire et financier
fragilisé par l’éclatement de la « bulle spéculative »,
remettent en cause la crédibilité de ce programme. En fait, la
rigidité de la politique d’ancrage du baht, au sein d’une étroite
bande d’intervention (+/- 0,02 %), favorise, en donnant
l’illusion tant aux prêteurs qu’aux emprunteurs d’une
neutralisation du risque de change, l’endettement en monnaie
étrangère (via le Bangkok International Banking Facilities, BIBF) et
la négligence du recours aux opérations de couverture de change
(pour un récapitulatif synthétique des causes internes de la
« crise des monnaies asiatiques », voir
encadré 53_Ref239518415
ci-dessous_Ref239518418).
Encadré 53 : La « crise des monnaies
asiatiques » : causes internes des attaques
spéculatives
Cinq causes internes de ces attaques spéculatives
peuvent être avancées :
1 la
« surchauffe » progressive des économies qui se manifeste
par le creusement d’importants déficits extérieurs et par une
hausse des prix de l’immobilier et des cours des
actions ;
2 le maintien
coûte que coûte de taux de change fixes
pendant une période longue, ce qui complique la réponse de la
politique monétaire à la « surchauffe » et finit par
apparaître comme une garantie implicite du cours de change des
monnaies, encourageant les emprunts extérieurs (souvent à court
terme), d’où une exposition excessive des établissements financiers
et des firmes au risque de change ;
3 les carences
de la gestion des établissements et des risques financiers,
l’application laxiste des règles prudentielles et l’insuffisance
des contrôles, associées à l’orientation du crédit et à l’octroi de
prêts privilégiés par l’État entraînent une grave détérioration du
portefeuille des banques ;
4 des
difficultés dans la diffusion des données et le manque de
transparence empêchent les marchés de se faire une opinion
« réaliste » des fondamentaux et accroissent le niveau
d’incertitude ;
5 les
déficiences dans la gestion des affaires publiques et privées
conjuguées à l’instabilité politique exacerbent la crise de
confiance, accroissent la réticence des créanciers extérieurs à
renouveler les prêts à court terme et intensifient les pressions à
la baisse des marchés des changes et boursiers.
En pratique, de 1985 à 1995, le baht montre une
grande stabilité nominale (25 bahts par dollar, en moyenne
annuelle), mais subit une première attaque spéculative des
non-résidents en août 1996. Une deuxième attaque similaire survient
le 16 mai 1997, face à laquelle les autorités thaïlandaises,
avec l’aide des Banques centrales asiatiques, mobilisent
5 milliards de dollars pour soutenir la parité, et scindent le
marché des changes en deux compartiments (offshore et domestique) [d’Arvisenet Petit,
1997].
Le scénario de la crise des monnaies asiatiques
est, alors, le suivant : l’appréciation tendancielle du baht
affecte la compétitivité/prix des exportations thaïlandaises,
illustrée par le gonflement du déficit de sa balance commerciale.
En outre, la baisse des actifs immobiliers et financiers rend ces
placements moins attractifs, alors que, simultanément, le rendement
des placements monétaires devient aléatoire compte tenu des
anticipations de dévaluation. Au total, les autorités doivent
abandonner, le 7 juillet 1997, l’ancrage monétaire datant de
1985. La dépréciation du baht est immédiate (près de 25 % de
sa valeur par rapport au dollar en deux semaines), d’où une grave
crise de liquidités pour les banques et les firmes, dont la charge
réelle d’endettement contracté en monnaie étrangère s’alourdit
considérablement. Dans ce contexte, l’altération de la confiance
des opérateurs nourrit des mouvements de panique, amplifiant les
retraits de capitaux, de même que les ressorts de la contagion de
la crise à l’ensemble de la zone disposant du même régime de change
(« effet tequila », 4.2.2.), consacrant la dimension
collective des comportements financiers qui transcende les cadres
nationaux. Le 8 octobre, les autorités indonésiennes
sollicitent l’intervention du Fonds Monétaire International (un
plan de sauvetage de 23 milliards de dollars est prévu) ;
le 23 octobre, la Bourse de Hong-Kong subit un krach ; le
19 novembre, la Corée du Sud requiert, à son tour, l’appui du Fonds
Monétaire International. L’effet de propagation affecte, alors,
toutes les monnaies de la zone, le flottement devenant de facto le régime de change de l’ensemble de ces
devises.
Tableau 26 : Les monnaies asiatiques avant
et après la crise de 1997 : tableau de synthèse
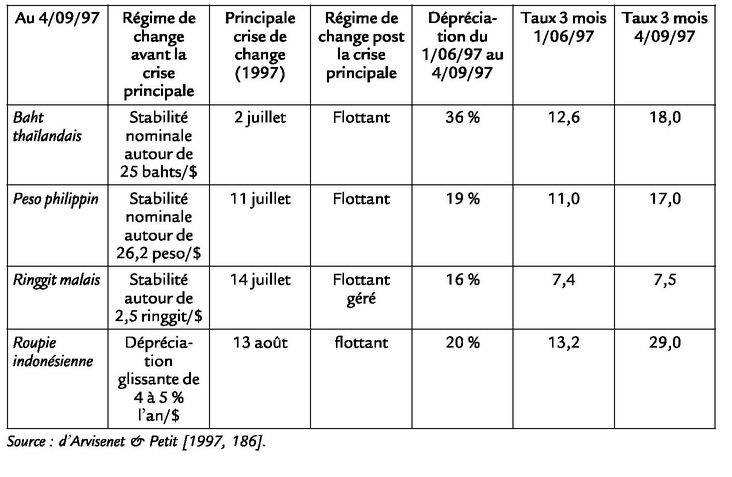
Source : d’Arvisenet
Petit [1997, 186].
Toutefois, les effets classiques de relance et de
compétitivité de la dévaluation sont, dans le cas des pays
asiatiques, érodés, d’abord, en raison de l’accélération de
l’inflation due au renchérissement consécutif des biens
importés ; ensuite, parce que dans des économies caractérisées
par une faible capacité d’absorption et de fortes inégalités de
revenus, l’effondrement des marchés extérieurs ne peut être
compensé par la demande intérieure ; enfin, en raison du choc
en retour de l’effet de contagion. En effet, l’extension de la
dépréciation aux monnaies de la zone entame une partie des gains de
compétitivité/prix espérés dans la mesure où ces pays entretiennent
d’importantes relations commerciales entre eux, et sont en
concurrence sur les marchés tiers. Enfin, le surajustement des
marchés financiers alourdit la charge de la dette des firmes
endettées en dollars auprès des banques offshore alors que leurs
ressources sont libellées en monnaie nationale, d’où une
dégradation additionnelle du bilan des banques. En définitive, la
crise du baht montre les limites de l’intervention de la Banque
centrale et des accords de coopération monétaire lorsque les agents
privés perdent confiance dans la parité. [d’Arvisenet Petit, 1997,
185]
Un plan de stabilisation macro-économique et de
restructuration du système financier est élaboré (5 août),
afin de répondre aux conditionnalités du Fonds Monétaire
International quant à l’octroi d’aides supplémentaires. Il s’agit,
d’une part, de ramener le déficit des paiements courants de
8 % du PIB en 1996 à 5 % en 1997, et à 3 % en 1998,
par des mesures de restriction budgétaire (modération des dépenses
publiques, relèvement des taux de TVA). L’application de l’autre
volet de ce plan, relatif à l’assainissement des secteurs financier
et bancarisé, se traduit par la suspension de la moitié des
sociétés financières, afin d’alléger la contrainte pesant sur la
Banque centrale et d’assurer la continuité des paiements intérieurs
en améliorant la solvabilité du système bancaire. L’annonce de ce
programme permet le déblocage, sous l’égide du Fonds Monétaire
International, d’une contribution bi et multilatérale de
17 milliards de dollars afin de permettre à la Thaïlande
d’honorer ses engagements à court terme tout en maintenant son
niveau de réserves.
La mise en œuvre de ce programme ne permet pas,
cependant, une réorientation des marchés, d’où la nécessité de
maintenir des taux d’intérêt élevés, ce qui, combiné avec une
baisse du taux de croissance, accroît la fragilité des systèmes
financier et bancaire. Cette situation résulte du haut degré de
défiance des opérateurs face à la gestion de la crise. Ainsi, au
regard de l’importance des engagements à court terme contractés
auprès des créanciers étrangers, la situation des réserves de
change s’avère plus dégradée comparativement aux annonces
officielles. En outre, la fragilité politique accroît l’incertitude
sur la capacité des autorités à appliquer, dans la continuité,
l’intégralité du plan annoncé, différence notable avec le Mexique
de 1994-1995. À cette singularité, s’ajoutent le caractère
principalement privé de l’endettement extérieur auprès des banques
internationales ; l’interconnexion d’économies dépendantes des
marchés extérieurs ; l’incapacité du Japon, en raison de ses
propres difficultés, à jouer auprès des premiers pays touchés (la
Thaïlande et l’Indonésie) le rôle de prêteur en dernier ressort
tenu par les États-Unis à l’égard du Mexique ; l’entrée en
crise de la Corée du Sud et du Japon, pays industrialisés
exportateurs majeurs mais aussi principaux clients des économies
concernées. À ces difficultés internes s’additionne celle liée aux
fortes fluctuations de la parité yen/dollar durant la période
[1994-1997], qui contribuent à créer les conditions d’une crise en
modifiant « artificiellement » la compétitivité
internationale de ces pays.
En définitive, la complexité des causes et des
conséquences de la crise des monnaies asiatiques déstabilise
profondément les investisseurs. La crise mexicaine de 1994-1995
avait eu des effets de propagation importants mais généralement peu
durables, en partie parce que les marchés financiers ont l’habitude
des défauts de paiement des débiteurs latino-américains – il
suffit de se souvenir que la crise de la dette de 1982 a éclaté à
la suite des moratoires brésilien et mexicain. Il en va tout à fait
différemment des pays du Sud-Est asiatique, qui étaient
généralement cités en exemple (le « modèle asiatique »)
de développement économique. Postérieurement à la crise qui frappe
ces pays en 1997-1998, les investisseurs internationaux dans leur
ensemble, à l’exception des fonds spécialisés qui représentent des
montants peu importants, prennent l’habitude de pratiquer, en cas
d’alerte locale sur les marchés émergents, une réappréciation de
risque globale, en matière de volumes de capitaux investis aussi
bien que de conditions de financement.
La période de crises récurrentes des marchés
financiers émergents
À la fin de la décennie 1990, les crises
financières des marchés émergents prennent un caractère récurrent.
La logique d’autorenforcement favorise d’ailleurs cette
récurrence : chaque défaut individuel d’un pays émergent
entraîne un renchérissement des conditions d’emprunt de tous les
autres, et donc fragilise leurs situations. Deux épisodes de
crises, au cours de cette période, vont avoir des effets
particulièrement notables : d’abord, la crise russe de 1998,
avec la crainte de matérialisation d’un risque systémique. Pour
éviter ce risque, la gestion de la crise, sous la coordination des
Institutions Financières Internationales, s’effectue en dehors des
contraintes usuelles de conditionnalité (7.3.1.). La crise
argentine de 2000-2001, au contraire, marque la rupture de la
causalité liant crise financière locale et déstabilisation du
système de financement international, ce qui permet d’éviter le
renflouement massif et systématique (7.3.2.). En effet, les
comportements d’aléa moral des prêteurs, qui ne supportent
habituellement qu’une partie de leurs pertes à l’issue des
différents mécanismes d’intervention publique déclenchés par les
crises, semblent être un trait dominant majeur des crises des
marchés émergents (7.3.3.).
La crise russe et ses effets de
propagation
En 1998, c’est la débâcle du rouble, dont la
convertibilité vis-à-vis du dollar a été suspendue (26 août)
qui a, grandement, menacé la stabilité du Système monétaire
international. Cette crise est la résultante de la conjugaison de
trois principaux facteurs : des mouvements de capitaux
spéculatifs, aussi bienvenus qu’incontrôlables ; des économies
en transition contraintes d’appliquer, ex
abrupto (i.e. de manière non
gradualiste, cf. supra), des réformes
de libéralisation économique et financière définies par les pays de
capitalisme évolué ou par les Organisations internationales, sans
s’être véritablement et préalablement dotées d’assises économiques,
financières et politiques saines [Andreff, 1993] ; enfin, des
marchés boursiers et des changes livrés à eux-mêmes, en temps
réel.
À cette étiologie, s’ajoute une cause spécifique à
la Russie : la dérive du déficit du Budget fédéral qui
s’élève, en 1997, à 6,1 % du PIB, donnée préoccupante en
raison de la faiblesse des rentrées fiscales, en dépit de
nombreuses privatisations. Simultanément, la hausse de taux
d’intérêt liée à la crise des monnaies asiatiques (voir ci-dessus),
conjuguée à la baisse des prix du pétrole, ont accru l’inquiétude
quant à la soutenabilité des finances publiques, d’où l’annonce de
réformes destinées à accroître le recouvrement fiscal, et, de façon
générale, à respecter les conditionnalités émises par le FMI,
aussitôt rejetées par la Chambre basse du Parlement, la
Douma.
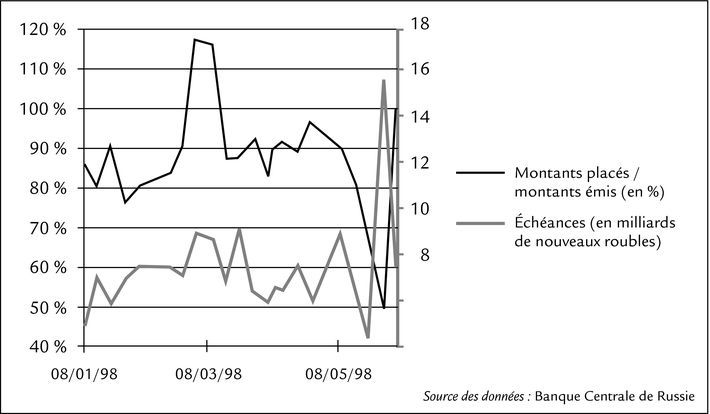
Dès le mois d’avril 1998, le taux de souscription
des titres publics, déjà généralement inférieur à 100 % depuis
le début de l’année, chute nettement. Simultanément, les échéances
de titres anciennement émis connaissent un pic autour de
16 milliards de roubles, c’est-à-dire environ le double des
échéances habituelles.
Graphique 35 : Taux de couverture des
émissions de titres publics russes et échéances, janvier
1998-juin1998
L’étroitesse de l’épargne domestique a conduit les
autorités russes à faire appel à l’extérieur pour financer leurs
déficits publics, notamment par l’émission de Bons du Trésor
(GKO et OFZ) à destination des opérateurs
internationaux15
(graphique 35_Ref239566073
ci-dessus_Ref239566076). L’irréalisme,
tant des hypothèses adoptées lors de la préparation du Budget 1998,
que des taux d’intérêt prévisionnels (compris entre 12 et
14 %) retenus lors de l’accord de février 1998 conclu entre le
Fonds Monétaire International et la Russie, conjugué à
l’impuissance du gouvernement face à la Douma à faire adopter son plan de redressement des
finances publiques, ont généré une crise de confiance de la part
des investisseurs internationaux sensibilisés par les mauvais
chiffres des rentrées fiscales du premier trimestre 1998. Cette
défiance s’est, alors, concrétisée par un reflux des
Investissements Directs à l’Étranger et des investissements de
portefeuille à destination de la Russie qui, associé à des sorties
nettes de capitaux, a contraint la Banque centrale de Russie (BCR)
à mobiliser ses réserves de change à des fins de stabilisation
interne, pour atteindre, en mai, 15 milliards de $ contre
20 milliards de dettes souscrits par les non résidents.
Dans ce contexte, le risque d’épuisement des
réserves de la BCR conduit les opérateurs à anticiper une
dévaluation du rouble, donc à vendre massivement (distress sales) les titres d’État sur le marché
secondaire, d’où la décision de la BCR d’élever ses taux d’intérêt,
soit 30 % pour le taux de refinancement et 50 % pour le
taux des prises de pension. Face à l’ampleur des problèmes à
résoudre, le retour (raté16) du
Premier ministre V. Tchernomyrdine, après le limogeage de
S. Kirienko, et l’annonce de son plan de restructuration de la
dette intérieure (relatif aux titres venant à échéance le
31 décembre 1999, soit l’équivalent de 33 milliards de $)
n’ont pas dissipé les graves menaces qui pesaient sur les
différentes places financières : le 26 août 1998, en
moins de deux heures, le rouble perdait 5 % de sa valeur
contre le dollar (8,26 roubles pour 1 $ contre
7,86 roubles la veille), pour s’effondrer à 13,3 puis
17 roubles pour 1 $, le 29 août (bien au-delà de la
marge haute de fluctuation de 9,5 roubles instaurée, le
17 août, par la BCR), alors que le mark s’appréciait,
corrélativement, de 69 % !
En définitive, la Russie aura cumulé dévaluation
et défaut sur sa dette, l’effondrement financier s’étant propagé
via le marché de la dette publique
interne. Différents signes négatifs (privatisation ratée de
l’entreprise pétrolière Rosneft, plan
de redressement de la Tokobank,
incertitudes et intrigues politiques, grève des mineurs contre les
impayés de salaires, relance de la crise asiatique, critiques du
Fonds Monétaire International à l’encontre du plan de redressement
budgétaire, etc.) ont conduit les détenteurs de Bons du Trésor à
court terme à vendre, sans souscrire aux nouvelles émissions, d’où
une hausse des taux. La défiance s’est alors propagée au marché
actions, qui est retombé à son niveau du début de l’année 1987,
point de départ du gonflement de la « bulle spéculative »
la plus spectaculaire de tous les MFE. Pour les investisseurs, le
niveau et la structure de la dette interne de la Russie plaçaient,
désormais, ce pays dans une situation de « cessation de
paiement ».
En effet, durant les années 1990, les banques
russes ont obtenu des lignes de crédit leur permettant d’acquérir
des Bons du Trésor russes, une opération a
priori sans risques importants, dès lors que les rendements
de certaines émissions atteignaient jusqu’à 200 %. Dans
l’impossibilité de rembourser les obligations arrivant à échéance,
l’État a donc décidé de restructurer sa dette et de transformer les
Bons du Trésor à court terme en Bons du Trésor à long terme
(remboursement de toutes ces obligations dans trois ou cinq ans
avec des taux d’intérêt compris entre 20 et 30 %), d’où un
important risque de faillite pour les banques, fortement
détentrices de titres courts et exposées à la dévaluation du rouble
(i.e. l’équivalent de 70 milliards
de dollars de GKO) ; de même pour
les assureurs, dont 60 % des réserves sont investies en Bons
d’État. Les banques étrangères, principalement allemandes, qui
possédaient l’équivalent de 20 milliards de $ de Bons du
Trésor russes, ont, alors, annoncé des provisions afin de couvrir
les pertes encourues, annonce à l’origine de la rechute des marchés
financiers occidentaux. La plupart des grandes places ont,
conséquemment, enregistré un net recul et le mark s’est affaibli
face au dollar, les investisseurs trouvant l’Allemagne et ses
banques trop exposées sur la Russie.
Les craintes de propagation inhérente à une forte
défiance des investisseurs à l’égard des MFE, perçus comme
appartenant à une même classe de risque, ont fait chuter les
Bourses latino-américaines (l’indice des valeurs boursières
Bovespa du Brésil a baissé de 25 %
et celui du Venezuela de 63 % durant le mois d’août), alors
que le bolivar vénézuélien, le peso mexicain et le réal brésilien
étaient attaqués17. En
Colombie les autorités monétaires ont décidé, dans l’urgence
(2 septembre), d’élargir à 23 % (contre 14 %) la
bande de fluctuation du peso face au dollar, alors que les
autorités équatoriennes décidaient (14 septembre) de dévaluer
leur monnaie, le sucre, de 15 % ; tandis qu’au Mexique,
les rendements des certificats de trésorerie (CETES) se sont envolés, passant de 36,94 % à
47,86 %, cette élévation des taux visant à freiner la hausse
du $ qui, en six semaines, avait progressé de 20 % par rapport
au peso. En Asie, la Malaisie a adopté la solution la plus radicale
en instaurant un contrôle des changes sur les comptes extérieurs
interdisant les règlements en ringgits à l’étranger, de même qu’une
parité fixe de 3,80 ringgits pour 1 dollar pendant une
période indéterminée, le ringgit ayant perdu 40 % de sa valeur
face au dollar depuis juillet 1997.
Encadré 54 : La propagation de la crise
russe de 1998 : effets de déstabilisation sur les pays
industrialisés
La défiance occasionnée par la crise russe se
propage aux pays industrialisés considérés comme les plus
« fragiles » : le dollar canadien se trouve au plus
bas face au dollar américain depuis plus d’un siècle à 1,565 pour
1 $. La couronne norvégienne recule de 1,4 % face au mark
(son plus bas cours depuis 1995). Même la couronne danoise, qui
souffre de ne pas faire partie de la zone euro, est attaquée et
doit être défendue par la Banque centrale. Parallèlement, les
États-Unis sont, particulièrement, exposés, dès lors qu’ils sont
entourés de pays ayant dévalué de facto
leurs monnaies, d’où un risque accru de creusement du déficit de la
balance commerciale américaine.
Cet accroissement de la mobilité des capitaux
devant l’addition de la crise russe, de la récession dans les pays
asiatiques et des difficultés de financement de certains pays
latino-américains, conduisent à une appréciation globale dégradée
du risque par les agents. Dès lors, la « fuite vers la
sécurité » (“flight to safety”) a
succédé à la « fuite vers des actifs de qualité »
(“flight to quality”). D’amples choix
de portefeuille se sont polarisés sur les titres publics les plus
liquides et bénéficiant de meilleures signatures (“flight to safe quality”) en délaissant,
temporairement, les actions de même que les titres obligataires,
publics ou privés, de moindre signature. Ce phénomène,
particulièrement visible aux États-Unis et en Europe occidentale, a
pris de revers certains acteurs s’appuyant sur de forts effets de
levier (comme le fonds spéculatif LTCM,
Long Term Capital Management, qui avait
engagé plus de 25 fois son capital de départ [égal à
4 milliards de dollars]), et nourri le phénomène de
« repli sur son habitat monétaire » (note 10
p. 190REF _Ref239561240).
Cet engouement des opérateurs pour les emprunts
d’État n’est pas sans risque pour les pays de la zone euro, souvent
victimes de leurs propres succès. Ainsi, le marché des taux
allemands, grand bénéficiaire du mouvement de fuite vers la
qualité, enregistre l’afflux régulier et massif de capitaux en
provenance du Japon et des MFE qui alimentent une demande, sans
précédent, pour les emprunts d’État allemands, confrontée à la
parcimonie des autorités allemandes quant aux émissions de Bons à
dix ans (seulement 60 milliards de marks sur les deux premiers
trimestres 1998). Ainsi, sur le marché dérivé de la dette allemande
(Eurex Deutschland), la position des
acheteurs à moyen terme représente 170 milliards de marks,
alors que le montant des obligations livrables avoisine
70 milliards. Conséquemment, les opérateurs sont obligés de
reporter leurs positions sur l’échéance suivante (décembre),
dysfonctionnement symptomatique du fait que le marché européen est
perçu, par les investisseurs internationaux, comme le deuxième
marché mondial alors qu’il n’est pas encore structuré pour remplir
cette fonction.
Face au risque de propagation mondiale des crises
russe et asiatique, le G7 se réunit (14 septembre 1998) à New York,
à l’initiative des États-Unis, dont les déclarations marquent un
tournant dans l’appréciation par les responsables de la conjoncture
internationale : en l’occurrence, la principale menace n’est
plus l’inflation mais l’instabilité financière des économies. Les
pays industrialisés se sont, donc, fermement engagés à
« soutenir une approche de coopération internationale pour
aider les pays qui ont été atteints par les développements récents
sur les marchés financiers », et ont exprimé « leur
préoccupation à l’égard de l’ampleur des retraits de capitaux
généralisés des marchés émergents qui ne prennent pas en compte la
diversité des perspectives économiques et les progrès significatifs
qui ont été réalisés dans de nombreux pays18 ».
La crise argentine et la décorrélation des
marchés de capitaux internationaux aux situations individuelles des
débiteurs émergents
Par rapport aux crises précédentes, la singularité
de la crise argentine (2002) tient au régime de change auquel elle
est associée. En effet, un currency
board 19 fut
instauré le 1er avril 1991, sous
l’égide du Président péroniste Carlos Menem, par une « loi de
convertibilité » (la “convertibilitad”) entre le peso argentin et le
dollar américain (i.e. 1 peso =
1 US$) associée à un durcissement des lois sur les faillites
d’entreprises, une loi de supervision bancaire et une abolition du
contrôle des changes. Simultanément, un vaste programme de
privatisation est engagé, concernant les banques, les firmes du
secteur exposé (principalement le secteur pétrolier), et les
services publics (électricité, télécommunications, eau). Ainsi,
entre 1990 et 1995, les recettes globales des privatisations
s’élèvent à près de 7 milliards de pesos. [Chauvin Villa,
2003]
Tableau 27 : Endettement et solde budgétaire
argentins (1996-2002)

Sources : d’après
[Chauvin Villa, 2003, 23].
Toutefois, « l’effet tequila »
(cf. supra) de la crise mexicaine de
1995 se traduit, pour l’Argentine, par des sorties de capitaux, des
transferts massifs des dépôts domestiques en pesos vers des comptes
en dollars argentins, et une forte hausse des taux d’intérêt sur
les actifs en monnaie nationale. Par conséquent, la Banque centrale
réduit les réserves obligatoires en pesos des banques commerciales,
convertit en $ la totalité du système de règlement interbancaire,
et met en place un « filet de sécurité » afin de garantir
la liquidité bancaire. Ce dispositif est complété (avril 1996) par
la création de deux « fonds fiduciaires » via des emprunts domestique et étranger, afin de
financer les réformes du système bancaire (fermeture des banques
insolvables, privatisation des banques publiques régionales,
resserrement du dispositif prudentiel, etc.).
À partir de 1998, les fondamentaux de l’Argentine
se détériorent sous l’action conjuguée de la dévaluation du réal
brésilien, principal partenaire commercial, qui dégrade la
compétitivité-prix des exportations argentines ; de la
politique monétaire restrictive (i.e.
taux d’intérêt réels élevés) des États-Unis ; des effets de
propagation des crises asiatique et russe prenant la forme
d’importantes sorties de capitaux et d’une élévation des primes de
risque. La récession est, en outre, accentuée par la rigidité du
currency board, lequel exige un
accroissement des rentrées fiscales (création de nouveaux impôts
[1999], hausse de la TVA et des taxes sur les opérations
bancaires). Malgré ces mesures, le déficit budgétaire s’aggrave,
les autorités décidant de le financer par les privatisations et
l’endettement en dollar, précipitant le pays dans une dynamique de
défaut.
Cette situation de création monétaire par
endettement, incompatible avec un currency
board, débouche (décembre 2001-janvier 2002) sur une loi
d’urgence économique proposée par le nouveau président péroniste
E. Duhalde (après les deux mandats présidentiels éphémères de
Fernando de la Rua et celui d’Adolfo Rodriguez Saà), laquelle
consacre l’abandon du currency board et
la normalisation juridique aux changes flottants. Le
2 décembre 2001, le « corralito » et le « corralon » fixent des mesures de
restriction (250 pesos par semaine et par compte) sur les
retraits en espèces des dépôts bancaires en pesos. Le
23 décembre, les autorités suspendent, pour 60 jours, le
service de la dette extérieure. Le 30 décembre, le
currency board est abandonné, avec
suspension de la supervision bancaire et de la loi sur les
faillites des entreprises (février 2002).
Cette loi ouvre la voie à une dévaluation de près
de 29 % du peso, malgré plusieurs plans de relance (notamment
celui de novembre 2000) et l’injection d’une aide financière de
39,7 milliards de $, dont 13,7 du FMI en décembre 2000. Après
onze ans d’un modèle ultralibéral, c’est une nouvelle étape marquée
par un retour en force de l’interventionnisme public pour tenter
d’enrayer la récession, en privilégiant la production nationale et
en instaurant un nouveau système de change dual avec un dollar à
1,40 peso pour le commerce extérieur et un flottement libre de
la monnaie pour les autres opérations. Afin d’amortir les effets de
la dévaluation (tableau 28_Ref239576779 ci-après), la loi établit une
conversion en pesos d’une partie des dettes contractées en dollars
par les particuliers et les PME, tout en maintenant le « corralito ». Ce régime du taux de
change dual sera progressivement abandonné durant l’année 2002, de
même que le « corralito » (29 novembre 2002) puis le
« corralon » (février 2003). [Chauvin Villa, 2003]
Tableau 28 : Les effets internes de la crise
argentine

Source : Ministère de
l’Économie argentin
En définitive, l’éclatement du currency board montre qu’il n’unifie qu’en
apparence les monnaies nationale et étrangère, publique et
privée ; la globalisation financière n’exonérant pas les
opérateurs de la nécessaire distinction entre monnaies domestiques,
devises, et la monnaie internationale. Du point de vue des effets
de propagation, la crise argentine est la première crise de marchés
émergents sans effets de propagation : à partir de janvier
2003, on observe, en effet, une décorrélation entre la prime de
risque du pays en difficulté (l’Argentine) et la prime de risque
moyenne des MFE (9.1.).
Les crises des marchés émergents ou
« crises de troisième génération » comme conséquence de
la généralisation des comportements d’aléa moral
Au-delà des fragilités internes des MFE, la
récurrence des crises touchant ces pays entre 1994 et 2001-2002
pose la question centrale de l’aléa moral des prêteurs. L’aléa
moral correspond au comportement d’un acteur, qui assuré contre la
réalisation d’un risque, adopte par ce fait même un comportement
plus risqué – et, donc, accroît la probabilité de réalisation
du risque en question. La traduction directe et immédiate de ce
principe conduit à l’une des principales critiques formulées à
l’égard du Fonds Monétaire International : si un gouvernement
pense pouvoir bénéficier de prêts des Institutions Financières
Internationales en cas de difficultés concernant sa dette
extérieure, il pourrait avoir tendance à opter pour une gestion
moins rigoureuse de ses finances publiques. L’objet de la
conditionnalité est pré cisément d’éviter cette dérive. L’aléa
moral mis en cause dans la littérature économique relative aux
mécanismes des crises des MFE n’est cependant pas celui des
gouvernements, mais celui des prêteurs privés. En réalité le
problème n’est pas nouveau : dans le cas de la crise de la
dette des pays en développement de 1982, les banques
internationales qui avaient prêté sans discernement ont largement
absorbé les pertes correspondantes par le biais du provisionnement
des pertes, avec déductibilité des sommes provisionnées de leurs
bénéfices imposables. [Bourguinat, 1992] Cependant, l’intervention
publique, notamment multilatérale, dans les crises des MFE, prend
une ampleur inédite, qui conduit à une prise de conscience
généralisée des bénéfices indirectement retirés de cette
intervention par les investisseurs internationaux.
Schématiquement, on peut définir deux types
d’asymétrie d’information concernant les prêteurs sur les marchés
financiers internationaux :
- L’asymétrie
d’information sur la nature des
emprunteurs ou émetteurs de titres : dans ce cas,
l’investisseur ignore quel degré de risque présentent réellement
ceux-ci. Il s’agit de la « sélection inverse »
(encadré 30_Ref236839809
p. 145REF _Ref236839817).
- L’asymétrie
d’information sur le comportement des
emprunteurs ou émetteurs de titres : ici, l’investisseur
ignore quel type de projets ceux-ci vont réellement mettre en
œuvre. Il s’agit de l’aléa moral. L’observation des mécanismes de
résolution des crises survenues depuis le début des années 1980
(crise de la dette de 1982, crises des pays émergents survenues à
partir de la crise mexicaine de 1994/1995) conduit à constater que
l’assurance contre le risque concerne non seulement les
emprunteurs, mais également les prêteurs (garantie des dettes des
entreprises élargie aux créances non garanties de jure, utilisation des transferts bilatéraux et
multilatéraux pour rembourser les dettes contractées auprès de
prêteurs privés, provisionnement des pertes…). En conséquence,
l’analyse de risque pratiquée par les investisseurs risque de
s’avérer moins rigoureuse, et les montants investis d’être plus
importants qu’en l’absence de tels mécanismes de garantie.
Encadré 55 : Aléa moral et stratégies
indirectes de réduction de l’asymétrie d’information
En pratique, en situation d’aléa moral dans les
décisions d’investissements internationaux, l’importance des
critères habituels de décision se trouve relativisée au profit de
stratégies de réduction indirecte de l’asymétrie d’information,
voire de logiques purement spéculatives. La réduction de l’aléa
moral par celle de la sélection inverse fait partie de ces
stratégies indirectes. Si l’on en revient à la distinction entre
sélection inverse et aléa moral, c’est-à-dire entre nature et
comportement des emprunteurs, il paraît ainsi raisonnable de poser
que la première peut être connue des prêteurs plus facilement, et à
moindre coût, que le second. Dans cette hypothèse, ceux-ci peuvent
souhaiter limiter l’aléa moral auquel ils sont confrontés en
réduisant la sélection inverse : si la qualité moyenne de
l’emprunteur est intrinsèquement meilleure, les effets des
variations de taux d’intérêt (par exemple) sur leurs comportements
seront probablement moins dommageables. Il en résulte une
polarisation des flux de capitaux, en direction d’un petit nombre
de pays, sélectionnés comme a priori
moins risqués.
Parmi les stratégies indirectes de réduction de
l’asymétrie d’information, on peut également citer, notamment,
l’observation des comportements des emprunteurs supposés similaires
(dans ce cas, l’analyse de risque-pays se fait par zone, et non au
niveau individuel de chaque État) ; l’observation des
comportements des autres prêteurs (l’emprunt lui-même devenant
alors signal de solvabilité) ; l’utilisation de la dette à
court terme (en cas d’erreur d’appréciation, la dette n’est pas
renouvelée) ; l’ancrage du taux de change nominal conçu comme
une garantie implicite (le prêteur raisonne alors comme s’il
existait un système de parités fixes entre la monnaie de libellé du
prêt et celle de l’emprunteur).
En conséquence, les débiteurs sont exposés à des
comportements de panique des créanciers dès lors que leur
réputation, ou celle d’emprunteurs supposés similaires, se dégrade
significativement. L’assèchement du crédit déclenche sans délai
l’illiquidité et le défaut. Il s’agit alors, selon la configuration
de l’emprunteur, d’une crise de deuxième génération (si
l’assèchement des flux de capitaux répond à une dégradation de la
réputation de l’emprunteur sans véritable fondement, ou à une
logique de contagion pure) ; ou d’une crise de première ou
troisième génération (si le renversement d’anticipation des
investisseurs est lié à leur appréciation d’une dégradation
rédhibitoire des fondamentaux macro-économiques ou du système de
financement domestique, encadré 47_Ref239431043 p. 238). En définitive, l’aléa
moral des prêteurs fournit donc une explication à trois phénomènes
structurants des flux de capitaux internationaux actuels :
d’abord, l’importance de l’afflux de financements dont font l’objet
certains pays dont les fondamentaux, a
posteriori, ne le justifient pas toujours ; ensuite, la
polarisation de ces flux au profit d’un petit nombre de
destinataires ; et, enfin, leur réversibilité en cas de
mauvaises nouvelles, même si celles-ci ne concernent pas
directement l’emprunteur, ou ne seraient pas considérées comme
rédhibitoires dans le cadre d’une analyse de risque
« classique ».
Le modèle de Dooley [1997], premier schéma
formalisé d’analyse de la crise asiatique de 1997-1998, est
précisément construit sur l’hypothèse d’une large diffusion des
comportements d’aléa moral des prêteurs, dans un contexte où les
emprunteurs privés ont accès aux marchés de capitaux
internationaux20 : il s’agit du mécanisme selon lequel
l’anticipation d’une garantie des dettes privées par les prêteurs
les conduit à y associer un différentiel d’intérêt strictement
positif. L’arbitrage risque-rendement habituel en matière de
gestion de portefeuille (c’est-à-dire le choix entre « haut
risque/haut rendement », par exemple un placement dans les
pays émergents ; et « faible risque/faible
rendement », par exemple, un placement dans les pays
industrialisés) se trouve de facto
exclu d’un tel univers, au profit d’un arbitrage
« rendement-rendement » (le niveau de risque représenté
par le placement dans les pays émergents ne compense plus le
rendement qu’il permet de réaliser, puisqu’il existe un mécanisme
de garantie).

Figure 5 : Dette publique, dette privée et
différentiels d’intérêt : le modèle de Dooley [1997]
Dans cette grille de lecture
(figure 5_Ref239580395
ci-dessus_Ref239580398), le
déclenchement de la crise n’est toutefois pas inévitable. En effet,
la croissance des dettes privées (PL, principalement contractées
par les banques) dépend de l’efficacité de la supervision bancaire.
Par ailleurs, le taux de garantie de facto
(s) de ces dettes est également déterminé par l’attitude du
gouvernement. En conséquence, si la Banque centrale exerce un
contrôle efficace sur son réseau de banques de second rang (en
s’appuyant éventuellement sur l’expertise d’autres Banques
centrales et/ou sur celle des Institutions financières inter
nationales21) et
que le taux de garantie des créances privées n’est pas trop
important, il est tout à fait concevable que le passif du
gouvernement reste inférieur à son actif. Dans ce cas, le processus
de libéralisation financière et l’endettement extérieur des banques
n’entraînent pas de crise, dès lors que les investisseurs
n’anticipent pas l’insolvabilité globale du pays.
En pratique, ceci suppose que le gouvernement soit
à même de déterminer le taux de garantie optimal sur les dettes
privées : nul ou trop faible, il ne permet pas de compenser
l’aversion au risque des investisseurs internationaux ; trop
élevé, il entraîne un afflux de capitaux incontrôlé qui, outre
l’insolvabilité globale qui s’ensuit, perturbe le fonctionnement
des systèmes d’intermédiation domestique (surliquidité des banques
nationales qui analysent alors moins finement le risque de leurs
emprunteurs).
Finalement, le modèle de Dooley permet donc, en
plus de la grille de lecture de la crise des monnaies asiatiques,
de dégager un « code de bonnes pratiques » en matière de
libéralisation financière, articulées autour du contrôle du volume
et des modalités de l’endettement extérieur des agents privés, et
d’une réflexion approfondie sur les signaux qu’il convient de
transmettre au secteur privé pour ce qui concerne l’ampleur des
garanties publiques exercées aux niveaux national et multilatéral.
Dans les faits, après la crise argentine, les MFE n’ont plus
enregistré de crise majeure, l’effet d’apprentissage des
investisseurs internationaux étant généralement invoqué comme
principale cause. Sans entrer dans le débat relatif au rôle de
l’amélioration des fondamentaux – l’exemple de la crise des
monnaies asiatiques montre que l’appréciation portée sur les mêmes
variables est susceptible de renversements d’opinions radicaux,
aussi bien parmi les investisseurs que parmi les théoriciens, il
faut noter que les MFE ont libéralisé le fonctionnement de leurs
systèmes de financement domestiques au cours de la même période,
quelques années avant la période de crises récurrentes les
affectant. La normalisation de l’accès aux financements extérieurs
privés d’une partie des pays en développement devrait les conduire
au même type de réformes, avec en germe la possibilité d’une
nouvelle série de crises.
1 C’est-à-dire tout choc perturbant l’équilibre
macro-économique de l’un des membres de la zone, les autres n’étant
pas, immédiatement, directement et également concernés.
2 L’indemnisation du chômage et les dépenses de
« reconstruction » de l’économie est-allemande provoquent
un transfert annuel de ressources publiques de l’ouest vers l’est
du pays de 150 milliards de marks, de 1990 à 1995, soit 6 % du
PIB de l’ex-RFA et 40 % de celui de l’ex-RDA ! En outre,
le gouvernement allemand décide de financer ces dépenses par
l’emprunt et non par l’impôt. Dès la chute du Mur de Berlin, cette
perspective est anticipée par les marchés et les taux longs
augmentent en quelques mois de 2 points, en Allemagne, mais
aussi, par l’intégration des marchés, dans les autres pays
européens.
3 Ce défaut de coordination est encore manifeste
aujourd’hui eu égard à la nature désordonnée des différents plans
de relance et/ou de renflouement des banques.
4 C’est au sommet de Bruxelles (2-3 mai 1998) que le
Conseil des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union a dévoilé la
liste des onze pays « élus » pour le passage à l’euro,
soit l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande
la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le
Portugal. La Grande-Bretagne, le Danemark et la Suède ont décidé de
repousser leurs adhésions ; quant à la Grèce, elle ne
satisfait pas encore aux critères : la drachme sera, effectivement, réévaluée de
3,5 % en janvier 2000, afin d’incorporer la zone euro, et la
Grèce deviendra le douzième État membre de l’UEM à la suite du
Conseil européen de Feira du 19 juin 2000, qui fixe son entrée
au 1er janvier 2001. Le taux de
conversion est de 340,75 drachmes pour 1 euro.
5 Les parités contre euro, fixées le
31 décembre 1998, s’établissent comme suit :
1,95583 deutsche mark ; 6,55957 francs
français ; 13,7603 schillings autrichiens ;
40,3399 francs belges ; 40,3399 francs
luxembourgeois ; 166,386 pesetas espagnoles ;
5,94573 marks finlandais ; 0,787564 punt
irlandais ; 1 936,27 lires italiennes ;
2,20371 florins néerlandais ; 200,482 escudos
portugais.
6 Décrié par les autorités française et allemande en
2003, confrontées au creusement de leurs déficits budgétaires
(autour de 4 % de leurs PIB respectifs) et de leurs
endettements publics, le « Pacte de stabilité et de
croissance » énonce que les pays participant à l’UEM ne
peuvent afficher un déficit budgétaire supérieur à 3 % de leur
PIB. En cas de dépassement, des sanctions financières peuvent être
appliquées à l’État membre « déviant », sauf si celui-ci
peut arguer de « circonstances exceptionnelles », comme
une catastrophe naturelle ou une récession « grave »
(i.e. un recul d’au moins de 2 %
du PIB sur un an).
7 Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie
et la Slovénie.
8 C’est-à-dire, selon la conception de Hicks [1967,
1-16], une monnaie unité de compte et
moyen de paiement mais sans attribut de
réserve de valeur.
9 La somme des transactions étant égale à 200 %
puisque faisant intervenir un couple de devises.
10 Voir note 9REF
_Ref239505252 p. 187.
11 Comme nous l’avons déjà relevé en introduction
générale, l’histoire, quelquefois, bégaie. J.-K. Galbraith
[1995], réfléchissant aux crises des années 1930 en faisant
référence aux illusions des années 1920, à la spéculation boursière
et à l’inflation des actifs financiers prises pour de la création
de richesses, relevait que : « Le monde de la haute
finance se laisse seulement comprendre si l’on a conscience que le
maximum d’admiration va à ceux-là mêmes qui fraient la voie aux
plus grandes catastrophes. » N’est-ce pas, également, la
manière adéquate de caractériser les illusions de l’époque récente
liées à la globalisation financière, a
fortiori la période de crise de 2008-2009 avec le
comportement des banques et de ses traders, sur la question des bonus
notamment ?
12 À la différence du Mexique, certains pays d’Asie
du Sud-Est ont supporté des besoins de financement extérieur élevés
et durables sans crise financière majeure, car les déficits étaient
financés par une épargne domestique forte et des flux
internationaux de capitaux peu volatils, essentiellement sous forme
d’IDE.
13 En 1993 et 1994, le solde de financement du
secteur public est quasi équilibré avec un encours en valeurs
gouvernementales stable autour de 130 milliards de
pesos.
14 Le taux de croissance annuel moyen du PIB réel
des « nouvelles économies industrielles d’Asie » (Corée
du Sud, Hong-Kong, Singapour et Taiwan) est de 7,8 % pour la
période [1980-9] et de 6,1 % pour [1990-9].
15 Les GKO, Bons du
Trésor à court terme, représentaient 3,5 % du PIB en 1995,
pour atteindre 14,4 % du PIB en 1997.
16 La candidature de V. Tchernomyrdine, présentée
deux fois par B. Eltsine, a été, en définitive, rejetée le
7 septembre 1998 par la Douma.
C’est E. Primakov, ancien ministre des Affaires étrangères,
qui a, le 11 septembre, été investi.
17 En définitive, les autorités brésiliennes ont
dévalué, le 15 janvier 1999, de
facto de quelque 20 % le réal pour atteindre une
stabilisation du cours à 140 pour 1 $. En découplant le réal
du lien glissant (i.e. le crawling peg, soit, en l’occurrence, une mini
dévaluation programmée de 0,6 % par mois) qui l’unissait au
dollar depuis le 1er juillet 1994,
le « plan réal » perdait beaucoup de signification.
18 L’examen de la controverse suscitée par les
opérations de renflouement des MFE est réalisé en 9.1.3.
19 Le principe du currency
board consiste en ce que la monnaie Banque centrale (M0),
soit les réserves et la monnaie fiduciaire, soit gagée à 100 %
sur ses réserves de change (or et devises), dont les variations
déterminent directement celles de l’encours bancaire. Ceci
nécessite que le taux de change soit rigoureusement fixe et que la
Banque centrale s’interdise toute émission autonome de monnaie,
tant au bénéfice de l’État (déficit budgétaire) qu’à destination
des banques commerciales. Il n’y a donc plus d’opération autonome
de refinancement d’actifs bancaires par l’institut
d’émission : l’accroissement, éventuel, de la masse monétaire
totale ne peut, alors, découler que de l’augmentation de l’épargne
domestique ou d’entrées de capitaux.
20 Pour le détail des conséquences de ce dernier
point, voir (encadré 50_Ref239505505 p. 249).
21 Cet appui peut être obtenu, en particulier, dans
le cadre du Programme d’Évaluation du Secteur Financier (PESF).
Lancé en mai 1999 par le FMI et la Banque mondiale, ce programme a
pour but d’appuyer les efforts entrepris par les pays membres pour
assainir leurs systèmes financiers (réseaux de banques privées et
marchés de titres). Il s’agit, avec l’appui d’experts issus
d’administrations nationales et d’organismes de normalisation, de
recenser les forces et les faiblesses des systèmes financiers
nationaux ; de déterminer comment les principales sources de
risques sont gérées ; d’évaluer les besoins de développement
et d’assistance technique du secteur ; et de contribuer à
l’établissement des priorités de programmes d’action.