Mardi 16 juillet. — La pluie tomba dans la nuit, soudaine et à grand bruit, comme toujours dans les Gilbert. Le cri du coq me réveilla avant le jour, et j'allai me promener dans l'établissement et le long de la rue. La tempête était calmée, la lune brillait d'un éclat incomparable, l'air était immobile comme dans une pièce close, et pourtant, l'île entière résonnait comme sous une forte ondée, le rebord des toits ruisselait, et les hautes palmes s'égouttaient à des intervalles plus espacés, avec un bruit plus marqué. Dans cette claire lumière nocturne, l'intérieur des maisons était impénétrable et ne présentait que des masses d'obscurité, sauf quand la lune glissait sous les toits, leur faisait une ceinture d'argent et dessinait sur le sol les ombres obliques des colonnes. Aucune lampe, aucun foyer ne brillaient dans toute la ville ; aucune créature ne bougeait ; je me croyais seul à veiller ; mais la police était fidèle à son poste, secrètement vigilante, tenant compte du temps; et un peu plus tard, le veilleur de nuit frappa sur la cloche de la cathédrale des coups lents et répétés : 4 heures, le signal avertisseur. Et cela semblait étrange que, dans une ville adonnée à l'ivrognerie et aux tumultes, le couvre-feu et le réveil fussent encore sonnés et toujours obéis.
Le jour vint et apporta peu de changement. La place était toujours silencieuse ; le peuple dormait, la ville dormait. Les quelques réveillés eux-mêmes, femmes et enfants, pour la plupart, restaient en paix sous l'ombre épaisse du chaume à travers lequel il fallait regarder pour les voir. Par les rues désertes, le long des maisons dormantes, une députation matinale se rendait au palais ; il fallut réveiller le Roi subitement et il dut entendre (probablement avec un mal de tête) des vérités désagréables. Mrs Rick, possédant assez bien cette langue difficile, était le porte parole ; elle expliqua au monarque malade que j'étais un ami personnel et intime de la reine Victoria ; que dès mon retour je lui ferais un rapport sur Butaritari ; et que, si ma maison était envahie une seconde fois par les naturels, un cuirassé serait envoyé, chargé de représailles. Ce n'était pas précisément le fait exact — mais plutôt une parabole juste et nécessaire du fait, arrangée pour la latitude; elle impressionna clairement le Roi. Il paraissait très ému ; il avait bien une vague notion (dit-il), que j'étais un homme de quelque importance, mais il ne soupçonnait pas que ce fût si grave ; et la maison du missionnaire fut tabouée à raison d'une amende de cinquante dollars.
Voilà ce qui nous fut raconté au retour de la députation ; rien de plus ; mais j'appris plus tard qu'il s'était passé bien autre chose. La protection accordée fut la bienvenue. C'avait été le côté le plus ennuyeux et non le moins alarmant du jour précédent, d'avoir notre maison régulièrement remplie d'indigènes ivres, par vingt ou trente à la fois, mendiant à boire, tripotant nos affaires, difficiles à déloger, insupportables si l'on en venait à la discussion. L'ami de la reine Victoria (qui fut bientôt regardé comme son fils), fut libéré de ces intrusions. Non seulement ma maison, mais mon voisinage fut laissé en paix ; même durant nos promenades à terre, nous étions escortés et annoncés partout; et comme de grands personnages visitant un hôpital, nous ne voyions plus que le beau côté des choses. Ainsi, pendant une semaine, nous pûmes aller et venir dans un paradis imaginaire, avec l'illusion que le Roi avait tenu sa parole, que le tabou sévissait de nouveau et que l'île, était une fois de plus, ramenée à la sobriété.
Mardi 23 juillet. — Nous dînions sous un simple treillis érigé pour le 4 juillet ; et nous nous attardions là en fumant autour du café. Le soir arrive dans ces climats sans amener de fraîcheur sensible ; le vent tombe avant le coucher du soleil ; le ciel brille encore un peu, puis se fane, puis s'assombrit jusqu'à ce bleu profond des nuits tropicales ; doucement et insensiblement, les ombres s'épaississent, les étoiles se multiplient ; vous regardez autour de vous, et le jour a fui. C'est à ce moment que notre serviteur chinois arrivait dans une auréole de lumière vacillante divisée par son ombre ; et avec la lampe, la nuit cessait autour de la table. Les visages des assistants, les barreaux du treillis se détachaient tout à coup en lumière sur un fond bleu et argent vaguement dessiné par la cime des palmiers et les toits en pointes des maisons. Ici et là un reflet sur une feuille ou une cassure de pierre renvoyaient une étincelle solitaire. Tout le reste s'était évanoui. Nous restions là, illuminés comme un groupe d'étoiles in vacuo; nous restions assis, évidents et aveugles, parmi l'embûche générale des ténèbres; et les insulaires, passant à pas légers, et parlant à voix basse, sur le sable de la route, invisibles, s'attardaient à nous observer.
En ce mardi, le crépuscule venait de se faire, la lampe d'être apportée, quand un projectile vint frapper la table avec un bruit sec et rebondit en m'effleu-rant l'oreille. Trois centimètres de plus et cette page n'eut jamais été écrite, car la chose passa comme un boulet de canon. On crut que c'était une noisette, quoique déjà alors elle me parut bien petite et tombée d'étrange façon.
Mercredi 24 juillet. — L'obscurité s'était faite une fois de plus et la lampe venait d'être apportée quand le même incident se répéta. Et de nouveau le projectile siffla à mon oreille. J'avais bien voulu accepter une première noix ; je n'en acceptai pas une seconde. Une noix de coco n'arrive pas ainsi, comme lancée par une fronde, par un soir sans brise, faisant un angle d'environ quinze degrés à l'horizon ; les noix de coco ne tombent pas plusieurs nuits de suite, à la même heure, juste au même endroit ; dans les deux cas d'ailleurs, un moment déterminé semblait avoir été choisi, celui où la lampe venait d'être apportée ; et une personne déterminée visée, le chef de la famille. J'ai pu me tromper, mais je me crus l'objet de quelque intimidation et crus que le projectile était une pierre lancée, non pour frapper, mais pour effrayer.
Aucune idée n'irrite un homme davantage. Je courus à la route où les naturels se promenaient comme d'habitude dans l'obscurité ; Maka me rejoignit avec une lanterne ; et je courus de l'un à l'autre, dévisageai d'un air terrible des figures parfaitement innocentes, posai des questions inutiles et proférai des menaces oiseuses. Puis je portai chez les Rick mon courroux (qui était bien digne du fils de n'importe quelle reine de l'histoire !). Ils m'écoutèrent d'un air déprimé ; m'assurèrent que cette façon de lancer une pierre au milieu d'un diner de famille n'était pas nouvelle ; qu'elle était de mauvais augure, et liée à la disposition inquiétante des naturels. Et finalement, la vérité, si longtemps cachée à nos yeux, se fit jour. Le Roi avait rompu sa promesse ; il avait bravé la députation; le tabou dormait toujours ; le Land we live in débitait encore de la boisson et ce quartier de la ville était troublé et menacé par des disputes continuelles. Mais il y avait pire : une fête se préparait pour l'anniversaire de la petite princesse ; et les chefs tributaires de Kuma et de la Petite Makin étaient attendus de jour en jour.
Puissants dans un parti d'hommes de clan nombreux et quelque peu sauvages, on les croyait, comme autant de Douglas, d'une fidélité douteuse. Kuma (petit personnage bedonnant), n'allait jamais au Palais, n'entrait jamais dans la ville, mais restait sur la plage, assis sur une natte, son fusil sur ses genoux, affichant sa méfiance et son dédain ; Karaïti, de Makin, quoique plus entreprenant, ne témoignait pas des sentiments plus amicaux ; et non seulement les vassaux étaient jaloux du trône, mais leur suite, de part et d'autre, s'associait à leur animosité. Des querelles avaient déjà éclaté; des coups avaient été échangés qui, d'un moment à l'autre, pouvaient être payés dans le sang. Quelques-uns des étrangers étaient déjà arrivés et avaient de suite commencé à boire ; si la débauche continuait après l'arrivée du gros d'entre eux, une collision, peut-être même une révolution était fatale.
Le débit de la boisson donne, dans ce groupe, la mesure de la jalousie des commerçants entre eux ; l'un commence, l'autre est tenu de suivre ; et celui qui a le plus de gin et qui en vend le plus, est sûr d'avoir la part du lion dans la distribution du copra. Tous sentent que c'est là un expédient de dernier ordre, ni sûr ni digne, ni convenable. Un trafiquant de Tarava, excité par une rivalité active, apporta de nombreuses caisses de gin. Il m'a raconté qu'il resta ensuite nuit et jour sur pied, dans sa maison, jusqu'à ce que la provision fût épuisée, n'osant pas interrompre la vente, n'osant pas sortir, le fourré résonnant tout autour de lui des hurlements des ivrognes. La nuit, par dessus tout, quand, n'osant pas même dormir, il entendait des coups de fusil et des cris autour de lui dans l'obscurité, ses remords devenaient affreux. « Mon Dieu ! — se dit-il, — si j'allais perdre la vie pour une si misérable besogne ! » Que de fois dans l'histoire des Gilbert pareil fait s'est renouvelé ! et le négociant repentant restait assis près de sa lampe, aspirant au jour, l'oreille tendue, dans une véritable agonie, vers les bruits de meurtre, prenant des résolutions pour l'avenir. Car la chose est aisée à lancer, mais difficile à arrêter. Les naturels sont, dans leur genre, un peuple juste et soumis aux lois, fidèles à leurs dettes, dociles à la voix de leurs propres institutions ; que le tabou soit réimposé, ils cesseront de boire ; mais le blanc qui cherche à prévenir le mouvement en leur refusant les liqueurs, le fait à ses risques et périls.
De là, jusqu'à un certain point, l'anxiété et l'impuissance de Mr. Rick. Lui et Tom, alarmés par l'envahissement du Sans-Souci, avaient arrêté le débit; ils l'avaient fait sans danger, parce que le Land we live in continuait à vendre; on remarqua pourtant qu'ils avaient été les premiers à commencer. Quelle démarche pouvait-on faire ? Mr. Rick pouvait-il aller visiter Mr. Muller (avec qui il n'était pas en relations), et lui dire : « J'étais en train de vous dépasser, c'est vous qui me dépassez à présent ; je vous demande d'abandonner votre bénéfice. J'ai pu fermer mon établissement sans danger grâce à ce que vous laissiez le vôtre ouvert ; mais je trouve maintenant que vous feriez mieux de vous retirer. Je commence à être alarmé ; et parce que j'ai peur, je vous demande d'affronter un certain danger ? » Il n'y avait pas à y songer. Il fallait trouver autre chose ; et il n'y avait qu'une personne au bout de la ville qui, au moins, était très intéressée dans la question du copra. Il n'y avait guère que cela à dire en ma faveur comme ambassadeur. J'étais arrivé dans la goélette des Wightman, j'étais l'associé quotidien de la coterie Wightman ; ce n'était pas une petite affaire» pour moi, de me mêler, sans en être prié, des affaires privées de l'agent de Crawford, et d'obtenir de lui le sacrifice de ses intérêts et le risque de sa vie. Mais, si minces que fussent mes titres, on n'avait personne de mieux ; d'ailleurs, depuis l'affaire de la pierre, j'étais avide d'action, l'idée d'un interview délicat me séduisait et il me parut de bonne politique de me montrer à terre.
La nuit était très sombre. Il y avait un office à l'église, et l'édifice luisait doucement par toutes ses crevasses, comme quelque obscure Kirk Allowa'. Je vis peu d'autres lumières, mais j'eus vaguement conscience d'un grand nombre de gens s'agitant dans les ténèbres, et d'un bourdonnement de paroles furtif et ininterrompu. Je crois que, tandis que j'allais, ma barbe était (comme dit la vieille formule), quelquefois sur mon épaule. L'habitation de Müller n'était éclairée qu'en partie, et complètement silencieuse, et la grille était fermée. Je ne pus arriver à ouvrir le loquet. Cela s'explique, car j'ai vérifié depuis qu'il avait quatre ou cinq pieds de long, et constituait à lui tout seul une véritable fortification. Comme je tâtonnais, un chien parut à l'intérieur et renifla mes mains avec méfiance, si bien que je fus réduit à appeler : « Y a-t-il quelqu'un dans la maison ? » Mr. Müller descendit et appuya son menton, dans le noir, sur la palissade. « Qui est là ? » dit-il, comme quelqu'un peu disposé à accueillir des étrangers.
— « Stevenson est mon nom », dis-je.
— « Oh, Mr. Stevens ! je ne vous reconnaissais pas. Entrez. »
Nous pénétrâmes dans le magasin sombre où je m'appuyai au comptoir et lui contre le mur. Toute la lumière venait de la chambre à coucher où je distinguais les membres de sa famille dans leurs lits ; elle m'éclairait en pleine figure, mais Mr. Müller était dans l'ombre. Sans doute, il s'attendait à ce qui allait suivre et cherchait à prendre l'avantage de la position ; mais pour un homme désireux de convaincre et n'ayant rien à cacher, la mienne était préférable.
— « Voyons, — commençai-je, — j'entends dire que vous débitez de la boisson aux naturels ? »
— « D'autres l'ont fait avant moi », répliqua-t-il, d'un ton pointu.
— « Sans doute, — dis-je, — et je n'ai rien à faire avec le passé, mais bien avec l'avenir. Je voudrais que vous me promettiez de montrer plus de circonspection dans le débit de ces spiritueux ? »
— « Mais, quel est votre motif pour agir ainsi ?» — demanda-t-il ; puis, sarcastique : « Craignez-vous pour votre vie ? »
— « Ceci n'a rien à faire avec la question. Je sais, et vous savez aussi, que ces spiritueux ne devraient pas être en circulation. »
— « Tom et Mr. Rick en ont vendu avant moi. »
— « Je n'ai rien à faire avec Tom et Mr. Rick. Tout ce que je sais, c'est que je les ai entendus tous deux refuser d'en vendre. »
— « Non, je suppose que vous n'avez rien à voir avec eux. C'est donc que vous craignez pour votre vie. »
— « Allons, voyons, — m'écriai-je, peut-être un peu piqué, — au fond de votre cœur, vous savez bien que ce que je demande est raisonnable. Je ne vous demande pas l'abandon de vos bénéfices — quoiqu'en effet, je préférerais ne plus voir apporter d'alcool ici, mais vous... »
— « Je ne dis pas que je ne veux pas. Mais ce n'est pas moi qui ai commencé », reprit-il.
— « Non," je sais que ce n'est pas vous, » dis-je ; « et je ne vous demande pas de perdre ; je vous demande seulement de me donner votre parole, d'homme à homme, qu'aucun naturel ne s'enivrera plus par votre faute. »
Jusque-là, l'attitude gardée par Mr. Mûller avait mis ma patience à une dure épreuve ; d'ailleurs, il l'avait conservée avec peine étant, au fond, de mon avis ; mais voici qu'il abandonnait le terrain pour un terrain pire : « Ce n'est pas moi qui débite ». dit-il. —- « Non, c'est ce nègre ; d'accord. Mais c'est pour
vous qu'il achète et qu'il vend ; vous avez la main sur sa nuque ; et je vous demande — j'ai ma femme ici avec moi, — d'user de l'autorité que vous avez. » Bien vite il se remit en garde. « Je ne dis pas que je ne le ferais pas si je voulais », dit-il ; « mais il n'y a aucun danger ; les naturels sont tout à fait tranquilles ; vous avez simplement peur pour votre vie. »
Je n'aime pas à être traité de poltron, même implicitement ; et à ce moment, je perdis patience et posai un ultimatum prématuré. « Vous ferez mieux de l'avouer clairement », m'écriai-je ; « votre intention est-elle de refuser ce que je vous demande ? »
— « Je ne veux ni le refuser ni l'accorder », répliqua-t-il.
— « Vous apprendrez qu'il faut faire une chose ou l'autre, et tout de suite », — criai-je ; puis, m'attaquant à une corde plus favorable — « allons », dis-je, « vous valez mieux que cela. Je vois ce qui vous indispose; vous croyez que je viens du camp opposé ? Je sais bien quel homme vous êtes, et vous savez bien que ce que je vous demande est raisonnable ? »
De nouveau il changea de terrain. « Si les naturels commencent à boire, ce n'est pas prudent de les arrêter », objecta-t-il.
— « Je répondrai du bar », dis-je; « nous sommes trois hommes et quatre revolvers ; au premier mot nous accourrons et défendrons la place contre tout le village. »
— « Vous ne savez pas de quoi vous parlez », s'écria-t-il ; « c'est trop dangereux. »
— « Ecoutez », lui dis-je; « je me soucie peu de perdre cette vie dont vous parlez tant ; mais je tiens à la perdre de la façon qui me plaira, c'est-à-dire, en mettant fin à toutes ces vilenies. »
Il s'étendit pendant quelque temps sur ses devoirs envers la maison de commerce ; je m'en souciais peu ; j'étais sûr de la victoire. Il attendait seulement pour capituler, et cherchait de tous côtés un secours qui lui adoucit l'effort. Dans le rais de lumière qui filtrait par la porte de la chambre à coucher, j'aperçus un porte-cigare sur le bureau. « Voilà un joli objet », dis-je.
— « Voulez-vous un cigare ? » dit-il.
J'en pris un et le tins un instant en l'air sans l'allumer.
— « Allons, fis-je, vous me promettez ? »
— « Je vous promets que vous n'aurez plus d'ennuis causés par des naturels qui auront bu chez moi », répliqua-t-il.
— « C'est tout ce que je demande », dis-je, et je lui prouvai que ce n'était pas absolument tout en demandant tout de suite la permission de goûter à sa provision.
Le côté critique de notre entrevue avait pris fin. Mr. Müller avait cessé de me regarder comme un émissaire de ses rivaux ; il avait abandonné son attitude défensive et parlait selon sa pensée. Je compris qu'il aurait déjà fermé son débit de lui-même s'il avait osé. Mais n'osant pas, on conçoit comme il pouvait accepter de voir s'ingérer dans sa conduite ceux qui (suivant son récit), l'avaient lancé, puis abandonné sur la brèche, et qui maintenant (étant eux-mêmes en sûreté), le poussaient vers un nouveau péril qui était tout profit pour eux, toute perte pour lui. Je lui demandai ce qu'il pensait du danger de la fête.
— « J'en pense plus de mal qu'aucun de vous », répondit-il: « Ils tiraient tout autour d'ici la nuit dernière et j'entendais les balles. Je me dis : voilà qui va mal ; ce qui m'intrigue, c'est pourquoi vous faites tout ce bruit et vous mêlez de tout cela, car enfin c'est moi qui suis destiné à être la première victime. »
Ce fut un miracle spontané. La consolation d'être second n'est pas grande. Le fait — et non l'ordre de la marche — voilà ce qui nous intéressait.
Scott parle avec modération d'un temps où il regardait venir le moment de se battre « avec un sentiment qui ressemblait au plaisir ». La ressemblance, ici, touche à l'identité. La vie moderne ne connaît plus le contact direct ; l'homme s'impatiente en des manœuvres sans fin ; et approcher du fait, se trouver là où toutes ses qualités peuvent s'exercer et courir un beau risque, et se rendre compte enfin de ce qu'on a en soi vous excite le sang. C'est du moins ce qu'éprouva toute ma famille qui bouillonna de plaisir à l'approche du danger ; et nous veillâmes tard dans la nuit, comme un groupe d'écoliers, préparant nos revolvers et dressant des plans pour le lendemain. La journée s'annonçait pleine et chargée d'événements. Les Vieux-Hommes devaient être convoqués pour m'interviewer sur la question du tabou ; Müller pouvait nous appeler à tout instant pour défendre le bar ; et dans le cas où Müller nous abandonnerait, nous décidâmes, dans un conseil de famille, de prendre toute la chose en mains, de nous emparer du Land we live in à la force des pistolets et de faire entendre une nouvelle musique au polysyllabique Williams. Et, me souvenant de l'humeur où nous étions, je crois que les mulâtres en auraient vu de dures.
Mercredi 24 juillet. — Il est heureux, et pourtant, ce fut pour nous un désappointement que ces menaces d'orage se soient dissipées en silence. Soit que les Vieux-Hommes aient reculé devant une interview avec le fils de la reine Victoria, soit que Müller fût secrètement intervenu, soit que ce fût une conséquence naturelle de la crainte qu'éprouvait le Roi et des .récents souvenirs de la fête, ce matin-là, de bonne heure, le tabou fut imposé de nouveau ; — pas un jour trop tôt, à en juger par le nombre de bateaux qui commençaient à arriver et l'affluence dans la ville, des grands et turbulents vassaux de Karaïti.
L'effet se prolongea pendant quelque temps sur l'esprit des trafiquants; ce fut avec l'approbation de toutes les personnes présentes que je collaborai à une pétition demandant aux Etats-Unis une loi contre le commerce des liqueurs aux Iles Gilbert ; et c'est à cette requête que je joignis, signé de mon propre nom, un bref rapport de ce qui s'était passé ; — peine inutile ! depuis, le tout repose, probablement jamais lu, peut-être jamais ouvert, dans un casier à papiers, à Washington.
Dimanche, 28 juillet. — Ce jour-là, nous eûmes la suite de la débauche. Le Roi et la Reine, en costumes européens, et suivis de gardes en armes, vinrent à l'église pour la première fois, et s'assirent, perchés en l'air, dans une dignité précaire, sous leurs cercles de tonneaux. Avant le sermon. Sa Majesté sortit de sous ce dais, se tint debout, de travers, sur le sol sablonneux, et, en quelques mots, fit le serment de renoncer à la boisson. La Reine suivit avec une allocution plus brève encore. Tous les hommes présents furent cités à leur tour ; chacun éleva sa main droite et l'affaire fut terminée ; — le trône et l'église étaient réconciliés.
chapitre vi
Le festival de cinq jours
Jeudi 25 juillet.— La rue était, ce jour-là, très animée par la présence des hommes de la Petite Makin; ils étaient d'une taille plus élevée que les Butaritariens et, étant en congé, ils allaient, enguirlandés de feuillages jaunes, somptueux sous des couleurs vives. On les dit plus sauvages, et fiers de cette distinction. En réalité, ils nous rappelaient, tandis qu'ils se pavanaient dans la ville, les Higlanders avec leurs plaids, traversant les rues d'Inverness, conscients de leurs vertus barbares.
Dans l'après-midi, la résidence d'été était remplie de monde ; d'autres, restés dehors, regardaient sous le rebord des toits, dans l'intérieur, comme font les enfants, chez nous, autour d'un cirque. C'était la compagnie de Makin répétant pour le jour du concours. Karaïti était assis au premier rang, près des chanteurs, où nous fûmes invités à prendre place auprès de lui, (en l'honneur, je suppose, de la reine Victoria). Une chaleur lourde, étouffante, régnait sous le toit de zinc, et l'air était chargé du parfum des guirlandes. De fines nattes autour des reins, des fibres de noix de coco roulées en anneaux autour de leurs doigts, et couronnés de feuilles jaunes, les chanteurs étaient assis par compagnies sur le sol. Un nombre varié de solistes étaient debout, pour chanter diverses chansons, et ils remplissaient, dans l'ensemble, le rôle principal. Mais toutes les compagnies, même sans chanter, contribuaient continuellement à l'effet général et marquaient la mesure, mimant, grimaçant, levant leurs têtes, leurs yeux, agitant les plumes fixées au bout de leurs doigts, claquant des mains ou se frappant le sein gauche avec un son de timbale. La cadence était exquise, la musique barbare, mais pleine d'un art conscient. J'ai noté quelques formules constamment employées. Ainsi, un changement (de clef, je crois) survenait subitement, sans changement de mesure, mais amplifié par une élévation soudaine et dramatique des voix et un balancement des gestes général. Les voix des solistes s'élevaient chacune sur une note différente, terriblement discordantes, puis se rapprochaient graduellement jusqu'à l'unisson; et quand elles l'avaient atteint, le chœur entier se joignait à elles et les dominait. Parfois, le mouvement habituel des voix, précipité, rauque et anti-mélodieux était rompu et exalté par un courant de mélodie en forme de psaume, souvent bien construite, ou paraissant telle par contraste. La mesure était très variable et, vers la fin de chaque morceau, quand le rythme devenait pressé et furieux, cette figure revenait :
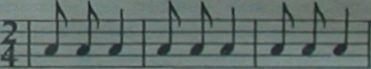
On peut difficilement concevoir à quel feu. quel mouvement endiablé ils arrivent dans ces finales martelées; tout marche ensemble, les voix, les têtes, les yeux, les feuillages et les anneaux ailés des doigts; sous les regards, le chœur oscille; les chants palpitent aux oreilles ; les visages sont convulsés par les efforts et l'enthousiasme.
Tout à coup, la troupe se leva tout d'une pièce, les tambours formant un demi-cercle autour des solistes, ceux-ci au nombre de cinq et quelquefois plus. Les chansons qui suivirent étaient extrêmement dramatiques ; quoique personne ne pût me donner aucune explication, je devinai de temps en temps quelque indice obscur, mais décisif, d'une intrigue, qui me rappelait certaines scènes de disputes de nos grands opéras ; ainsi les voix isolées s'élèvent de la masse et y retombent ; ainsi les acteurs se séparent, se rassemblent, brandissent leurs mains en l'air, et lèvent les yeux au ciel, — ou vers la galerie ! Déjà ceci dépasse le modèle Thespien ; l'art de ce peuple a dépassé l'état embryonnaire ; le chant, la danse, les tambours, les quartettes et les soli : c'est le drame pleinement développé, quoique encore en miniature. De toutes les danses ainsi nommées des mers du Sud, celle que j'ai vue à Butaritari est la principale. La hula, telle que les globe-trotters affolés peuvent la voir à Honolulu, est sûrement la plus ennuyeuse des inventions humaines, et le spectateur, tandis qu'elle se déroule, interminable, bâille comme à une lecture du collège ou à un débat du Parlement. Mais la danse des îles Gilbert captive l'esprit; elle frémit, excite, subjugue; elle possède l'essence de tout art, une signification inexplorée, imminente.
Là, où un si grand nombre de personnes sont engagées et où toutes doivent faire (à un moment donné), le même mouvement rapide, précis et souvent arbitraire, le travail préparatoire est extrême. Mais ils commencent tout jeunes. On peut voir souvent dans un maniap' un homme et un enfant : l'homme chantant et gesticulant, l'enfant debout devant lui, ruisselant de larmes, et copiant en tremblant ses gestes et ses chants; c'est l'artiste des îles Gilbert apprenant (comme font tous les artistes) son art dans la souffrance.
Je parais peut-être trop enthousiaste ; voici un passage du Journal de ma femme qui prouve que je ne fus pas seul ému, et qui complète le tableau : « Le conducteur donna le signal et tous les danseurs, agitant leurs bras, balançant leur corps et se frappant la poitrine en mesure, ouvrirent la danse en forme d'introduction. Les artistes restèrent assis, excepté deux et une fois trois, deux fois un seul des solistes. Ceux-ci alors restaient debout, au milieu du groupe, faisant un léger mouvement avec les pieds, et leurs corps frissonnant en mesure tandis qu'ils chantaient. Après l'introduction il y eut une pause, puis la véritable trame de l'opéra — car ce n'était pas moins — commença de se dérouler ; un opéra où chaque chanteur se montrait un acteur parfait. Le premier sujet, dans une extase passionnée qui le possédait de la tête aux pieds, semblait transfiguré. Un moment, on eût dit qu'un vent violent passait sur l'estrade ; — leurs bras, leurs doigts empennés frissonnant d'une émotion qui s'empara de mes nerfs : têtes et corps suivaient comme un champ de blé sous une rafale. Je sentis mon sang bouillonner, puis se glacer ; des larmes me venaient aux yeux, ma tête tournait, une impulsion presque irrésistible me poussait à me joindre aux danseurs. Je crois avoir assez bien compris un des drames. Un vieillard fier et sauvage prit la partie de solo. Il chanta la naissance d'un prince, et comme sa mère le berçait tendrement dans ses bras; son enfance, quand il dépassait tous ses compagnons dans l'art de nager, de grimper et dans tous les sports athlétiques ; sa jeunesse, quand il allait sur la mer, dans son bateau et Péchait ; son âge d'homme quand il épousa une femme Qui, à son tour, berça un enfant dans ses bras. Puis vinrent les alarmes de la guerre ; puis une grande bataille dont l'issue, quelque temps, demeura douteuse ; mais le héros était victorieux comme toujours, et aux transports indicibles des vainqueurs. la pièce se termina. Il y avait aussi des pièces comiques qui provoquèrent beaucoup de gaieté. Pendant l'une d'el- les, un vieillard qui était derrière moi, me saisit par le bras, me menaça du doigt avec un sourire malin et murmura quelque chose avec un ricanement qui me parut signifier : « Oh ! vous femmes ! vous femmes ! c'est aussi vrai de vous toutes. » Et je crains qu'il ne s'agit pas là d'un compliment. A aucun moment nous ne saisîmes le moindre signe de la vilaine indécence des îles orientales. Tout était poésie pure et simple. La musique elle-même était aussi complexe que la nôtre, quoique construite sur une base entièrement différente ; une ou deux fois je fus surprise par un éclair de quelque chose qui ressemblait étrangement à notre meilleure musique sacrée, mais pour un instant seulement. A la fin, il y eut une pause plus longue, et cette fois, tous les danseurs furent sur pied. L'intérêt allait croissant à mesure que le drame se déroulait. Les acteurs s'adressèrent les uns aux autres, puis à l'auditoire, puis au ciel ! ils prirent conseil les uns des autres ; les conspirateurs se groupèrent ensemble; c'était tout à fait un opéra, les tambours intervenant à des intervalles propres, le ténor, le baryton, la basse, tous à leur place, — seulement les voix étaient toutes du même calibre. Une femme chanta à un moment, du dernier rang, avec une très jolie voix de contralto, gâtée parce qu'elle la rendait artificiellement nasillarde ; et je remarque que toutes les femmes ont ce défaut désagréable. Une autre fois, le solo fut chanté par un garçon d'une beauté angélique ; une autre, fois encore, un enfant de six à huit ans, sans doute un petit phénomène, fut placé au centre. Le pauvre petit semblait, au début, désespérément effrayé et embarrassé ; mais vers la fin il prit feu et déploya un grand talent dramatique. Les changements d'expression sur la figure des danseurs étaient si éloquents qu'il y avait, semblait-il, une vraie stupidité à ne pas les comprendre. »
Notre voisin à cette représentation, Karaïti, met quelque peu en valeur, par comparaison, Sa Majesté Butaritarienne, dans sa silhouette et ses traits, étant comme elle corpulent, barbu et oriental. Moralement, il parait être tout l'opposé : alerte, souriant, jovial, plaisant et industrieux. Chez lui, dans son île, il travaille en personne comme un esclave et fait travailler son peuple comme un surveillant d'esclaves. Il s'intéresse aux idées. Georges, le négociant, lui ayant parlé de machines volantes : « Est-ce vrai, Georges ? » demanda-t-il. — « C'est dans les journaux », répliqua Georges. — « Eh bien », dit Karaïti, « si cet homme peut faire cela avec une machine, moi, je peux le faire sans machine. » Il dessina et fabriqua une paire d'ailes, les attacha à ses épaules, alla au bout d'une jetée, se lança dans l'espace et tomba lourdement dans la mer. Ses femmes le repêchèrent car les ailes l'empêchaient de nager. « Georges », — dit-il, en s'arrê-tant tandis qu'il allait se changer, — « Georges, vous mentez. » Il avait huit épouses, car son royaume était encore soumis aux anciennes coutumes ; mais il montra quelque embarras quand on expliqua cela à ma femme. « Dites-lui que je n'en ai amené qu'une ici », dit-il avec angoisse. Tel qu'il était, ce Douglas noir nous plaisait beaucoup ; et comme nous entendions de nouveaux détails sur le malaise du Roi, et remarquions aussi que toutes les armes de la Résidence d'été avaient été cachées, nous observions avec une admiration d'autant plus grande la cause de toutes ces anxiétés, roulant sur ses grandes jambes avec sa large face souriante apparemment sans armes, et certainement sans escorte, à travers la ville hostile. Le Douglas Rouge, Kuma le bedonnant, ayant peut-être eu quelque écho de la débauche, resta sur son fief ; ses vassaux vinrent sans chef à la fête et grossirent la suite de Karaïti.
Vendredi 26 juillet. — Cette nuit-là, dans l'obscurité, les chanteurs de Makin paradèrent sur la route devant notre maison et chantèrent la chanson de la Princesse.
« Voici le jour ; elle naquit en ce jour ; Nei-Kamaunave est née en ce jour — une ravissante princesse, Reine de Butaritari. » Cela pouvait durer ainsi, me dit-on, indéfiniment. Bien entendu, la chanson était hors de saison et la représentation, une simple répétition. Mais c'était en outre une sérénade et, à notre endroit, une délicate attention de notre nouvel ami, Karaïti.
Samedi 27 juillet. — Nous avions annoncé une représentation de lanterne magique, cette nuit, à l'église; et ceci nous valut la visite du Roi. En l'honneur du Douglas noir (je suppose), ses deux gardes habituels s'étaient élevés au nombre de quatre ; et l'escouade faisait une singulière figure tandis qu'elle le suivait à la débandade, en chapeaux de paille, kilts et jacquettes. Trois d'entre eux portaient leurs armes à l'envers, la crosse sur leur épaule, le bout menaçant le dos replet du Roi ; le quatrième l'avait passée derrière sa nuque et la maintenait ainsi, les bras levés, comme une planche pour redresser le dos. La visite dura un temps infini. Le Roi, n'étant plus galvanisé par le gin, ne disait ni ne faisait rien. Il était affaissé sur une chaise et laissait éteindre son cigare. Il faisait chaud ; l'atmosphère était endormante et pesante à un degré cruel ! pas d'autre ressource que d'observer, dans la contenance de Tubureimoa quelque rappel de Mr. Cor-pse, le boucher. Son nez d'épervier, brusquement déprimé et aplati du bout, nous semblait encore imprégné du parfum des meurtres nocturnes. Quand nous prîmes congé de lui, Maka me fit remarquer la façon dont il descendait l'escalier (ou plutôt l'échelle) de la Véranda. « Un vieillard », me dit Maka. - « Oui », dis-je « et pourtant, je suppose, moins vieux qu'il ne parait ? » — « Jeune », répliqua Maka, « peut-être qua'ante ». Et depuis, j'ai entendu dire qu'il était plus jeune encore.
Pendant que la lanterne magique fonctionnait, je me glissai dehors dans l'obscurité. La voix de Maka, expliquant les scènes de l'Ecriture, représentées sur les verres, d'un air excité, semblait remplir non seulement l'église, mais le voisinage. Tout le reste était silencieux. Tout à coup, un bruit lointain de chants s'éleva et se rapprocha, une procession s'avançait le long de la route, et le parfum tiède et pur des hommes et des femmes me frappait le visage délicieusement. Au coin, arrêtés par la voix de Maka et les alternatives de lumière et d'ombre qui se produisaient dans l'église, ils firent une pause. Ils ne désiraient pas s'approcher davantage, c'était clair. C'étaient des gens de Makin, je crois, et probablement des païens endurcis, méprisant le missionnaire et ses œuvres. Tout à coup, pourtant, un homme sortit des rangs, prit ses jambes à son cou et fonça dans l'église; l'instant d'après, trois autres l'avaient suivi ; un peu après encore, ils étaient une vingtaine, tous risquant leur vie. Ainsi la petite bande de païens s'arrêta, irrésolue, au coin de la route, et fondit devant les attractions de la lanterne magique comme un glacier au printemps. Les plus endurcis, en vain, blâmaient les déserteurs ; trois s'enfuirent encore dans un silence coupable, mais s'enfuirent quand même ; et quand, à la fin, le chef eut retrouvé assez de présence d'esprit ou d'autorité pour remettre sa troupe en marche, et faire reprendre les chants, ce fut avec des forces très diminuées qu'ils passèrent, mélodieusement, le long de la sombre route.
Pendant ce temps, à l'intérieur, les scènes lumineuses brillaient et disparaissaient. Je restai quelque temps, ignoré, dans les rangs des spectateurs, et remarquai juste devant moi une paire d'amoureux qui suivaient le spectacle avec intérêt, le mile jouant le rôle d'interprète et (comme Adam) entremêlant ses explications de caresses. Les animaux sauvages, le tigre en particulier, et ce vieux favori des écoliers, « le dormeur et la souris », furent salués avec joie ; mais la série des Evangiles fut la merveille et les délices principales. Maka, de l'avis de sa femme offensée, ne profita pas suffisamment de l'occasion. « Qu'est-ce qui lui prend ? pourquoi ne parle-t-il pas davantage ? » criait-elle. Le fait est, je crois, que le pauvre homme, devant cette solennelle opportunité, chancelait sous le poids de sa bonne fortune ; et, qu'il ait bien ou mal fait, la seule vue de ces pieux « fantômes » suffit à elle seule à imposer silence, dans toute cette partie de l'île, à la voix de la raillerie. « Mais alors », — le mot circulait à la ronde — « mais alors, la Bible est donc vraie ?» Et quand nous nous revîmes plus tard, on nous dit que l'impression en était plus vivace encore, et l'on entendait ceux qui y avaient assisté le raconter à ceux qui n'étaient pas là : « Oh oui, tout cela est vrai ; toutes ces choses sont arrivées, nous avons vu les images. » L'argument n'est pas si puéril qu'il paraît ; car je doute que ces insulaires connaissent d'autre mode de reproduction que la photographie ; de sorte que la représentation par l'image d'un événement (d'après le principe du vieux mélodrame : « La chambre noire ne peut mentir Joseph ! ») est pour eux la meilleure preuve de sa réalité. La chose nous amusa d'autant plus que quelques-uns de nos verres étaient d'une niaiserie risible, et l'un d'eux (le Christ devant Pilate) fut accueilli avec des cris d'allégresse auxquels Maka lui-même ne résista pas à se joindre.
Dimanche 28 juillet. — Karaïti vint demander une répétition des « fantômes », — c'était le terme reçu,— et ayant obtenu la promesse de notre part, tourna les talons et quitta mon humble toit sans l'ombre d'une salutation. Je sentis que je ne devais pas avoir l'air un instant d'empocher un manque d'égards; les temps avaient été trop difficiles et étaient encore trop incertains ; le fils de la reine Victoria était tenu de maintenir l'honneur de sa maison. En conséquence, Karaïti fut convoqué ce soir-là chez les Rick ; Mrs. Rock se répandit en invectives a son adresse, et le fils de la reine Victoria l'assaillit de regards indignés. J'étais l'âne dans la peau du lion ; je ne pouvais gronder dans la langue des îles Gilbert ; mais je pouvais le foudroyer du regard. Karaïti déclara qu'il n'avait pas voulu m'offenser ; il s'excusa d'une façon bien fondée, chaleureuse, et comme un gentleman, et fut tout de suite à son aise. Il avait chez lui un poignard à vérifier et nous dit qu'il viendrait le lendemain nous le faire estimer, parce que c'était aujourd'hui dimanche; ce scrupule chez un païen avec huit épouses me surprit. Le poignard était « bon pour tuer le poisson », dit-il avec malice ; et il était censé avoir l'œil sur les poissons à deux pattes. II est assez étrange que, dans la Polynésie orientale, le poisson soit l'euphémisme reçu par lequel on désigne les sacrifices humains. Interrogé sur la population de son ile, Karaïti appela ses vassaux qui l'attendaient assis au-dehors, et ils l'estimèrent à quatre cent cinquante habitants ; mais (ajoute Karaïti d'un air jovial), il y en aura bientôt beaucoup plus, car toutes les femmes sont en train d'accroître leur famille. Bien avant que nous nous séparions, j'avais complètement oublié son insulte. Lui, cependant, en gardait le souvenir ; et par une inspiration très courtoise revint le lendemain de bonne heure, nous fit une longue visite et nous fit en partant des adieux pointilleux.
Lundi 29 juillet. — Le grand jour arriva enfin. Aux premières heures, la nuit tressaillit du bruit des mains qui claquaient et du chant de Nei-Kamaunava ; son . rythme lent, mélancolique et quelque peu menaçant, rompu de temps à autre par une exclamation formidable. Cette petite parcelle d'humanité qui célébrait ainsi les heures de la nuit, fut aperçue à midi, jouant sur la prairie, dans une complète nudité, loin des regards et insouciante.
La résidence d'été, sur son ilot artificiel, se détachant sur le lagon étincelant, étincelante elle-même sous le soleil et sous son revêtement de tôle, fut
pendant tout le jour remplie d'hommes et de femmes impatients. A l'intérieur, elle regorgeait d'insulaires de tous âges et de toutes tailles, et dans tous les degrés de nudité et de parure. Nous étions si tassés qu'à un moment j'avais sur mes genoux une grande belle femme et derrière moi deux moutards entièrement nus, les pieds appuyés contre mon dos. On pouvait voir une dame revêtue de tous ses atours : holoku, chapeau et guirlandes de fleurs; et sa voisine, l'instant d'après, faire glisser de ses épaules un bout de chemise et apparaître, monument de chair, dessiné plutôt que couvert par le ridi « large comme un cheveu ». On voyait de petites dames qui se trouvaient trop grandes pour paraître sans voiles dans une si grande fête, s'arrêter un instant au-dehors, en plein soleil, leur ridi minuscule à la main ; un moment après elles étaient complètement habillées et pénétraient dans la salle de concert.
A chaque extrémité, les compagnies de chanteurs alternées se levaient pour chanter ou s'asseyaient pour se reposer ; Kuma et la Petite Makin au nord, Butari-tari et ses villages réunis au sud; les deux groupes, remarquables par leur air de bravoure barbare. Au milieu, un banc était placé entre ces deux camps de troubadours rivaux ; c'est là que trônaient le Roi et la Reine, à deux ou trois pieds du sol où trônait l'assistance — Tebureimoa, comme d'habitude, dans son pyjama rayé, une gibecière en bandoulière, destinée probablement (à la mode des îles), à contenir ses pistolets ; la Reine, dans un holoku de pourpre, son abondante chevelure dénouée, un éventail à la main. Le banc était tourné, face aux étrangers, comme une preuve d'amabilité et quand ce fut au tour de Butari-tari de chanter, le couple dut se tortiller sur son bac, appuyer ses coudes à la rampe, et nous offrir le spectacle de ses larges dos. Le ménage royal se consolait à l'occasion avec une pipe d'argile ; et le prestige de l'Etat achevait d'être rehaussé par les fusils d'un piquet de gardes.
La monarchie dans cette attitude, et nous-mêmes pressés sur le sol, nous entendîmes plusieurs chants des deux côtés. Puis, leurs Royautés se retirèrent avec leurs gardes et le fils de la reine Victoria et sa belle-fille furent portés avec des acclamations sur le trône vacant. Notre fierté se trouva seulement un peu atteinte quand nous nous vîmes rejoints à ces places éminentes par un blanc, sorte de vagabond sans le sou ; d'un autre côté, je m'en réjouis, car il baragouinait quelques mots du pays et put me donner quelque idée du sujet des chants. L'un était patriotique et excitait à une invasion Tembinock d'Apemama, la terreur du groupe. L'un mêlait la plantation du taro à la moisson de chez nous. Quelques-uns étaient historiques et célébraient les rois et les faits illustres de leur temps tels que des parties de boire ou des guerres. L'un, tout au moins, était un drame d'un intérêt domestique, extrêmement bien joué par la troupe de Makin. Il disait l'histoire d'un homme qui avait perdu sa femme, pleurait d'abord sa perte puis en épousait une autre ; les premiers couplets (ou actes) sont joués exclusivement par des hommes; mais à la fin, une femme apparaît qui vient de perdre son mari ; et je suppose que le couple se console ensemble car le finale semble d'heureux augure. A propos de quelques-uns de ces chants, mon cicerone me dit sommairement qu'il « s'agissait de femmes... ». J'aurais pu le deviner tout seul. Chaque côté, eût-on dit, était renforcé par une ou deux femmes. C'étaient toutes des solistes; elles ne chantaient pas très souvent dans l'ensemble, mais se tenaient, librement, à l'arrière-plan de l'estrade et ressemblaient absolument (avec leur ridi. leurs colliers et leurs cheveux relevés), à des danseuses de ballet européennes. Quand le chant était quelque peu grossier, ces dames venaient se placer en avant ; et c'était curieux de voir que. après chaque entrée, la première danseuse simulait une extrême confusion comme si elle s'était laissé entraîner au-delà de ses intentions, et ses partenaires mâles feignaient de la chasser comme quelqu'un qui s'est disqualifié. Des affectations de ce genre accompagnent certaines danses vraiment risquées à Samoa où elles sont à leur place. Ici c'était différent. Peut-être les paroles, en ces libres contrées, étaient-elles assez grossières pour faire rougir un charretier ; mais la figure la plus suggestive était cette feinte de honte. Les femmes montraient assez de dispositions dans cette partie : elles étaient impertinentes, elles étaient pimpantes, elles étaient acrobates, elles étaient parfois vraiment amusantes et quelques-unes d'entre elles étaient jolies. Mais ceci n'est pas du domaine de l'artiste ; il y a toute l'étendue du ciel entre ces entrechats et ces oeillades et les gestes rythmés, étranges, les étranges, ravissantes et délirantes expressions avec lesquelles les danseurs mâles nous retinrent, fascinés, tout le temps d'un ballet des îles Gilbert.
Presque dès le début, il fut évident que le peuple de la ville avait le dessous. Je les aurais trouvés bons si je n'avais pas eu l'autre troupe sous les yeux pour corriger mon arrêt et me rappeler continuellement « le rien de plus et tout ce que cela fait... ». Se sentant battu, le chœur de Butaritari se troubla, s'embrouilla et resta court. Au milieu de ce grabuge de mesures étranges, je n'aurais pas, quant à moi, remarqué la faute; mais l'assistance ne fut pas longue à la relever et à s'en moquer. Pour couronner le tout, la troupe de Makin commença une danse d'un mérite vraiment supérieur. J'ignore de quoi il s'agissait ; j'étais trop absorbé pour le demander. Dans un acte, une partie du choeur, criant dans une sorte d'étrange fausset, produisait étonnamment l'effet de nos orchestres; dans un autre, les danseurs, sautant comme des diables en boîtes, les bras étendus, se mêlaient et s'entremêlaient avec une rapidité, un précision, une fougue extraordinaires. Je n'ai jamais rien vu d'un effet aussi risible ; dans n'importe quel théâtre européen, la salle eût croulé ; mais les spectateurs insulaires éclataient en rires et en applaudissements. Cela fit déborder la coupe pour la troupe rivale et ils oublièrent toute tenue. Après chaque acte ou chaque figure de ballet, les acteurs s'arrêtent un instant, debout, et ceux qui suivent sont introduits par des applaudissements en triolets. Ils ne s'assoient pas jusqu'à la fin de tout le ballet, ce qui alors, seulement, permet aux concurrents de se lever. Mais maintenant, toutes les règles étaient violées. Durant l'intervalle qui suivit ces applaudissements, la troupe de Butaritari sauta sur ses pieds, et, sans grâce aucune, se lança dans un spectacle de sa façon. Ce fut une chose étrange de voir les hommes de Makin les contempler avec stupeur ; j'ai vu en Europe un ténor affronter avec un regard pareil les sifflets d'une salle ; mais cette fois, à ma grande surprise, ils reprirent leur calme, renoncèrent au reste de leur ballet, retournèrent à leurs sièges, et laissèrent leurs peu galants adversaires continuer jusqu'à la fin. Mais rien ne leur suffit. De nouveau, au premier intervalle, Butaritari intervint avec le même manque de délicatesse ; Makin, irrité à son tour, suivit l'exemple ; et les deux troupes de danseurs restèrent debout en permanence, claquant des mains continuellement et se coupant régulièrement à chaque pause. Je m'attendais d'un moment à l'autre à des coups ; et notre position, au beau milieu, était des moins stratégiques. Mais les gens de Makin eurent une meilleure inspiration; et à la prochaine interruption, ils tournèrent bride et sortirent en masse de la salle. Nous les suivîmes, premièrement parce qu'ils étaient les vrais artistes; deuxièmement parce qu'ils étaient des invités et avaient été bassement maltraités. Un grand nombre de nos voisins fit de même, de sorte que la jetée fut couverte d'un bout à l'autre par une procession des déserteurs ; et le chœur de Butaritari fut laissé, chantant pour son propre plaisir dans une salle vide, ayant gagné le but et perdu l'auditoire. Ce fut sûrement une bonne fortune qu'il n'y eût là aucun ivrogne ; mais, ivre ou non, où donc une scène aussi irritante se fût-elle terminée sans coups ?
C'est nous qui pourvûmes à la dernière phase et au dernier éclat de cette journée de bon augure par la seconde et dernière exhibition des « fantômes ». Tout autour de l'église, des groupes étaient assis dans la nuit d'où ils ne pouvaient rien voir ; peut-être confus d'entrer, goûtant certainement quelque obscur plaisir dans la seule proximité de la fête. A l'intérieur, la moitié environ du vaste hangar était bondée de monde. Au centre, sur le dais royal, les lanternes fumaient, lumineuses ; un rayon de lumière éclairait la grave contenance de notre Chinois, occupé à moudre l'orgue de barbarie ; une lueur plus faible dessinait les poutres et leurs ombres dans le creux de la toiture; les images brillaient et s'évanouissaient sur l'écran, et à l'apparition de chacune d'elles, un « chut » courait à travers la foule, suivi d'un murmure et d'un long frémissement. Le contre-maître d'une goélette naufragée était assis à côté de moi : « Ils trouveraient le spectacle étrange en Europe ou aux Etats-Unis — me dit-il, — se déroulant dans un édifice comme celui-ci, tout attaché avec des bouts de ficelle ! »
chapitre vii
Mari et femme
Le trafiquant, accoutumé aux mœurs de la Polynésie orientale, reçoit un enseignement aux îles Gilbert. Le ridi n'est qu'une parure légère. Il y a trente ans encore, les femmes allaient jusqu'à leur mariage sans aucun vêtement ; la coutume a mis dix ans à disparaître, et ces faits, surtout vus à travers les descriptions des voyageurs, propagèrent une idée très fausse des mœurs de ce groupe. « Paradis de femmes », comme le nommait un missionnaire ; c'était un Paradis tout platonique. Depuis 1860, quarante blancs ont péri sur une seule île, tous pour la même raison, tous découverts là où ils n'avaient rien à faire, et transpercés par la lancer de quelque père de famille indigné. L'étrange persistance de ces quarante martyrs semble causée par la monomanie ou par des passions romantiques : le gin en est la cause plus vraisemblable. Au lieu d'un Paradis, le trafiquant trouve un archipel de maris farouches et de femmes vertueuses. « Bien entendu, — observait l'un d'eux ingénument — si vous voulez leur faire la cour, il en va là comme partout ailleurs » ; mais ses compagnons et lui s'y risquaient rarement.
Il faut d'ailleurs accorder au négociant cette vertu : il fait souvent un bon et loyal mari. J'ai rencontré sur ma route quelques-uns des pires écumeurs de mer, les derniers de la vieille école ; quelques-uns étaient parfaits vis-à-vis de leurs femmes indigènes, et l'un d'eux
fit un veuf désespéré. D'ailleurs rien n'est plus digne d'envie que la position d'une femme de négociant dans les Gilbert. Elle partage les privilèges de son époux. Le couvre-feu, à Butaritari, sonne en vain pour elle. Longtemps après que la cloche a sonné, et que les grandes dames de l'île sont retenues pour la nuit sous leur propre toit, elle peut, légalement libre, courir et folâtrer à travers les rues désertes ou descendre se baigner dans l'obscurité. Les ressources du magasin sont à sa disposition ; elle va, parée comme une reine, et se nourrit chaque jour de festins délicats, servis dans des plats d'étain. Et elle, qui n'avait peut-être parmi les naturels ni rang ni considération, s'asseoit avec des capitaines et est reçue à bord des goélettes. Cinq de ces dames privilégiées furent, un temps, nos voisines. Quatre d'entre elles étaient de belles et capricieuses filles, et sujettes, comme des enfants, à des accès de bouderie. Elles portaient des robes pendant le jour, mais avaient une tendance quand venait la nuit, à secouer ces vêtements d'emprunt, à courir et chanter à travers l'établissement dans le ridi aborigène. Elles jouaient sans cesse aux cartes avec des coquillages comme jetons. Elles altéraient souvent les règles en trichant ; et chaque partie (surtout si un homme en était), se terminait régulièrement par une dispute à propos des jetons. La cinquième était une matrone. C'était une scène à peindre de la voir, le dimanche, se diriger vers l'église, une ombrelle à la main, une nourrice suivant, et le baby, enseveli sous un chapeau bourgeois et armé d'un biberon breveté. L'office était égayé par la façon dont elle surveillait sa suivante et ne cessait de la corriger. Il était impossible de ne pas se représenter le baby comme une poupée et l'église comme quelque salle de jeu européenne. Toutes ces femmes étaient légitimement mariées. Il est vrai que le contrat de l'une d'elles, qu'elle nous exhiba avec orgueil, portait cette clause, qu'elle était « mariée pour un jour » et que son gracieux partenaire était libre de « l'envoyer au diable » le lendemain ! Mais cette lâche ruse ne la rendait ni meilleure ni pire. Une autre, me dit-on, fut mariée sur une de mes œuvres, dans une édition de contrefaçon qui tint lieu de Bible. Malgré la séduction de ces distinctions sociales, la qualité des aliments et le prix des vêtements, l'abstention relative de tout travail et le mariage légitime contracté sur une édition plagiaire, le trafiquant est parfois obligé de chercher longtemps avant de pouvoir se marier. Quand j'étais dans le groupe, l'un d'eux, au bout de huit mois de recherches, était encore célibataire !
Dans la société strictement indigène, les vieilles lois et coutumes étaient sévères, mais non sans un certain caractère de magnanimité. Toute trahison conjugale avérée était punie de mort ; un enlèvement affiché était, par comparaison, un acte de vertu et puni d'une amende en terres. Il est de bonne éducation pour un homme jaloux de se pendre ; une femme jalouse a un autre remède — elle mord sa rivale! Le ridi est considéré comme un emblème sacré. Supposez qu'à Butaritari un lopin de terre soit l'objet de contestations, le prétendant qui, le premier, aura accroché un ridi sur le poste tabou aura gagné sa cause, étant donné que personne autre que lui-même n'a le droit d'y toucher et de le changer de place.
Le ridi est l'attribut non de la femme, mais de l'épouse ; la marque, non de son sexe, mais de son état. C'est le collier au cou de l'esclave ; l'empreinte sur la marchandise. A l'heure qu'il est, encore, Karaiti appelle ses huit épouses « ses chevaux », quelque négociant lui ayant expliqué l'emploi qu'on faisait de ces animaux dans les fermes ! Et Nanteitei embauchait les siennes pour des travaux de maçonnerie. Les maris, tout au moins ceux d'un rang élevé, avaient droit de vie ou de mort sur leurs épouses ; des blancs mêmes semblent l'avoir possédé ; et leurs femmes, quand elles étaient tombées dans une faute impardonnable, se hâtaient de prononcer la formule de conjuration : I kana kim. Ces trois mots avaient une telle vertu qu'un criminel condamné qui les adressait au Roi à un certain jour, devait être relâché instantanément. C'est une offre d'abaissement, et, chose étrange, le contraire — l'imitation — est une insulte vulgaire commune en Grande Bretagne de nos jours. Je veux donner un aperçu d'une scène entre un trafiquant et sa femme gilbertine, maintenant un des plus anciens résidents, mais alors nouvellement arrivé dans le groupe.
— « Allez allumer du feu — dit le négociant — et quand j'aurai apporté cette huile, je ferai cuire un peu de poisson. »
La femme lui répond en grognant à la manière des îles.
— « Je ne suis pas un porc pour que vous vous adressiez à moi en grognant », dit-il.
— « Je sais que vous n'êtes pas un porc — dit la femme, — et aussi que je ne suis pas votre esclave. »
— « Certainement vous n'êtes pas mon esclave, et si vous ne tenez pas à rester avec moi vous ferez mieux de rentrer dans votre famille » — dit-il ; — « mais en attendant allez et allumez le feu; et quand j'aurai apporté cette huile, je ferai cuire un peu de poisson. »
Elle alla comme pour obéir, et quand le négociant regarda ce qu'elle faisait, il vit qu'elle avait fait un tel feu que la cuisine était en flammes.
— « I kana kim », s'écria-t-elle quand elle le vit venir; mais il n'en tint pas compte et la frappa avec une marmite ; le pied lui fendit le crâne, le sang jaillit, on la crut morte, et les naturels entourèrent la maison dans une attente pleine de menaces. Un autre blanc était présent, homme d'une plus vieille expérience. « Vous nous ferez tuer tous les deux si vous continuez ainsi », cria-t-il, elle avait dit « I kana kim ». Si elle n'avait pas dit « I kana kim », il aurait pu la frapper avec le chaudron. Ce n'est pas le coup qui avait fait le crime, mais le mépris d'une formule consacrée.
La polygamie, la vertu particulière des femmes, leur condition à demi-servile, leur réclusion dans les harems royaux, jusqu'à leur privilège de mordre, tout semble indiquer une société mahométane et l'opinion que les femmes n'ont pas d'âme. Il n'en est rien. C'est une pure apparence. Après que vous avez étudié ces extrêmes dans un intérieur, vous pouvez, dans un autre, trouver tout l'opposé, la femme toute-puissante, et l'homme seulement le premier de ses esclaves. L'autorité ne vient pas de l'homme en lui-même ni de la femme en elle-même. Il vient de ce qu'il est chef et de ce qu'elle est cheffesse ; de ce que lui ou elle a hérité des terres du clan, et se trouve lié aux hommes du clan par des liens de parenté, leur imposant le service, responsable de leurs amendes. Voilà l'unique source du pouvoir, le seul fondement de la dignité : le rang. Le Roi épousa une cheffesse ; elle devint sa servante et dut travailler de ses mains à la jetée de MM. Wightman. Le roi divorça avec elle ; immédiatement elle reprit son ancienne condition et son pouvoir. Elle a épousé un matelot hawaïen ; cet homme est son valet et peut être mis à la porte à son gré. Bien mieux, ces seigneurs de basse extraction reçoivent même des corrections corporelles et comme des enfants, grands mais obéissants, ils doivent se soumettre à la discipline.
Nous étions intimes dans une maison de ce genre, celle de Nei-Takauti et Naa Tok' ; je cite la femme en premier, comme de juste. Pendant huit jours d'un paradis imaginaire, Mrs. Stevenson avait été seule chercher des coquillages sur le rivage de l'île. Je suis sûr que c'était très imprudent, et bientôt, elle s'aperçut qu'un homme et une femme la surveillaient. Quoi qu'elle fît, ses gardiens ne la perdaient pas de vue ; et quand le jour commença de décliner, et qu'ils jugèrent qu'elle était restée là assez longtemps, ils la persuadèrent de rentrer et par des signes et des mots anglais entrecoupés, ils la ramenèrent à la maison. En route, la dame enleva de son trou à boucle d'oreille une pipe d'argile, le mari l'alluma et la tendit à ma malheureuse femme qui ne savait comment se soustraire à cette incommode faveur ; et quand ils furent tous arrivés chez nous, le couple s'assit auprès d'elle sur le sol et paracheva la rencontre par des prières. Depuis lors ils furent nos amis ; trois fois par jour ils nous apportaient les magnifiques guirlandes de fleurs blanches des îles ; ils nous visitaient tous les soirs, et souvent ils nous emmenaient à leur tour jusqu'à leur maniap', la femme conduisant Mrs. Stevenson par la main, comme font les enfants entre eux.
Nan Tok', le mari, était jeune, extrêmement beau, de la plus inaltérable bonne humeur, et souffrant, dans sa condition précaire, de sentir ses ambitions annihilées. Nei-Takauti, la femme se faisait vieille ; son fils, né d'un premier mariage, venait de se pendre de désespoir sous ses yeux, à la suite d'une réprimande bien méritée. Elle n'avait sans doute jamais été belle, mais ses traits étaient pleins de caractère, et ses yeux pleins d'un sombre feu. C'était une grande-cheffesse, mais, par une exception étrange chez une personne de son rang, elle était petite, mince, nerveuse, avec de petites mains maigres et un cou en cordes. Elle était, le soir, invariablement vêtue d'une chemise blanche, — et comme parure, des feuilles vertes (ou parfois des fleurs blanches), fixées dans ses cheveux et passées à travers ses larges trous d'oreilles. Le mari, au contraire, changeait à vue d'accoutrement, comme un kaléidoscope. Quelque jolie chose que ma femme offrit à Nei-Takauti, — un collier de perles, un ruban, un bibelot brillant, — le lendemain soir, elle apparaissait sur la personne de Nan Tok'. Il est clair qu'il n'était qu'une housse ; qu'il portait la livrée ; qu'en un mot, il était, la femme de sa femme. Ils renversèrent les rôles d'ailleurs jusqu'aux plus extrêmes limites ; à l'heure de l'épreuve, c'est le mari qui remplit le rôle de l'ange tutélaire, tandis que la femme déploya l'apathie et le manque de cœur proverbiales de l'homme.
Quand Nei-Tahauti avait mal à la tête, Nan-Tok' était plein de soins et d'attentions. Quand son mari avait un rhume ou une rage de dents, la femme ne le remarquait que pour s'en moquer. C'est toujours le rôle de la femme de bourrer et d'allumer la pipe ; Nei-Takauti tendait la sienne, en silence, au page conjugal ; mais elle la portait elle-même comme si ledit page n'était pas digne d'une confiance absolue. C'est elle qui gardait l'argent tandis qu'il faisait les courses, anxieux et diligent. Un nuage sur son visage obscurcissait instantanément ses yeux lumineux ; lors d'une visite matinale à leur maniap', ma femme vit qu'il avait quelques raisons de bien se tenir. Nan-Tok' avait avec lui un ami, jeune étourdi de son âge et ils avaient travaillé ensemble, dans cet état d'excitation joyeuse où les conséquences des actes sont rarement calculées. Nei-Takauki prononça son propre nom. A l'instant, Nan-Tok' éleva deux doigts et son ami de même, tous deux dans une extase feinte. Il était évident que la dame avait deux noms ; et à en juger par leur gaieté et par le courroux qui plissa son front, il devait y avoir quelque chose de critique dans le second. Le mari le prononça ; une noix de coco, bien dirigé par la main de la femme l'atteignit aussitôt à la tête; et les voix et la gaieté des deux jeunes indiscrets s'éteignirent pour le reste de la journée.
Les habitants de la Polynésie orientale ne sont jamais en défaut ; leur étiquette est absolue et complète ; dans n'importe quelle circonstance elle leur enseigne ce qu'il y a à faire et comment. Les Gilbertins sont plus libres, et (comme nous-mêmes), payent leur liberté par de fréquentes perplexités. C'était souvent le cas pour ce couple paradoxal. Nous leur avions une fois, au cours d'une visite, offert une pipe et du tabac, et quand ils eurent fumé et voulurent se retirer, ils se trouvèrent en face d'un problème : devaient-ils prendre ou laisser ce qui restait de tabac ? Ils ramassèrent ce reste, le remirent à sa place, se le passèrent, le déposèrent de nouveau, argumentèrent jusqu'à ce que la femme eût l'air tout à fait hagard et le mari vieilli par l'angoisse. Ils finirent par le prendre et je parie qu'à peine sortis de l'établissement ils étaient sûrs d'avoir agi contre les règles. Une autre fois, nous leur avions versé libéralement, à chacun, une tasse de café et Nan-Tok' vint à bout de la sienne sans joie et avec de grandes difficultés. Nei-Takauti en avait bu un peu, et peu disposée à l'achever, sentant que ce serait une marque de mauvaise éducation de laisser sa tasse inachevée, ordonna à son suivant conjugal de finir ce qui restait. « J'ai avalé tout ce que je pouvais, je ne puis en avaler davantage, c'est une impossibilité physique », semblait-il dire; et son chef sans pitié réitérait ses ordres avec de secrets et impérieux signaux. Pauvre chien infortuné ! mais la simple humanité nous fit venir à la rescousse et enlever les tasses.
Je ne puis m'empêcher de sourire au souvenir de ce drôle d'intérieur; et pourtant je me rappelle ces bonnes âmes avec affection et respect. Leurs attentions pour nous étaient surprenantes. Les guirlandes sont très estimées ; les fleurs doivent en être cherchées très loin ; et quoiqu'ils eussent beaucoup de subalternes à même de les aider, nous les vîmes souvent parcourir les champs en quête de ces fleurs et la femme les tressant de ses propres mains. Ce n'est pas le manque de cœur, mais cette insouciance, si particulière aux maris, qui lui faisait mépriser les souffrances de Nan-Tok'. Quand ma femme fut souffrante, elle se montra une garde diligente et douce ; et le couple, au grand embarras de la patiente, s'implanta sans en plus bouger, dans sa chambre de malade. Cette rude, capable, impérieuse vieille dame, avec ses yeux farouches, avait des qualités profondes et tendres. Elle semblait dissimuler la fierté que lui inspirait son jeune mari, dans la crainte, peut-être, de le gâter; et lorsqu'elle parlait de son fils mort, quelque chose de tragique passait sur sa figure. Pourtant je crus discerner chez les Gilbertins une certaine virilité dans les sentiments qui (ainsi que leur langue âpre et rude) les distingue de leurs pères des îles orientales.
Quatrième partie
chapitre premier
Le Roi d'Apemama : un négociant royal
Il y a un grand personnage dans les Gilbert : Tembi-nok' d'Apemama ; seul en évidence, le héros des chants, le pivot des conversations. Dans le reste du groupe, les rois ont été massacrés ou sont tombés en tutelle : Tembinok' seul demeure, dernier tyran, dernier vestige encore debout d'une société disparue. Les blancs sont partout ailleurs, se construisant des maisons, buvant leur gin, se tirant d'affaire avec les faibles gouvernements insulaires. Il n'y a qu'un blanc à Apemama, tout juste toléré, vivant loin de la cour, épié et surveillé comme une souris sous la patte d'un chat. A travers toutes les autres îles, un flot de visiteurs indigènes va et vient, voyageant par bandes, prolongeant ce voyage pendant des années. Apemama, seule, est laissée de côté, le touriste redoutant de se risquer à portée de la griffe de Tembinok'. Et la crainte de cette Gorgone les suit et les trouble jusque chez eux. Maiana lui paya une fois le tribut ; il envahit son territoire et s'empara de Nonuti : premier pas vers l'empire de l'archipel. Un navire de guerre anglais étant apparu sur la scène, le conquérant fut obligé de dégorger; sa carrière, dès le début, se trouva en échec, son arsenal de guerre, si chèrement acheté, tomba au fond de son propre lagon ; Mais l'impression avait été produite; la crainte qu'il inspire agite encore périodiquement les îles ; la rumeur publique le dépeint rassemblant ses canots en vue d'une nouvelle invasion ; la même rumeur dit même à quelle destination ; et Tembinok' figure dans les chants de guerre patriotiques des Gilbert comme Napoléon dans ceux de nos grands-pères.
Nous étions en mer, partis de Mariki, à destination de Nonuti et Tapituea, quand un vent favorable se leva soudain et nous poussa vers Apemama. Notre itinéraire fut immédiatement modifié ; tous les bras furent employés à nettoyer le bateau, les ponts passés à la pierre ponce, les cabines lavées, les magasins soigneusement inspectés. Durant toute notre croisière, jamais l'Équateur n'avait été pomponné comme il le fut pour Tembinok'. Et le capitaine ne fut pas le seul à faire de ces coquetteries ; car une autre goélette étant, par hasard, arrivée pendant mon séjour à Apemama, je constatai qu'elle aussi avait fait du « dandysme » à cette occasion. Ce sont les deux seuls cas de ce genre que me rappellent mes souvenirs des mers du Sud.
Nous avions à bord une famille de touristes indigènes, depuis l'aïeul jusqu'au baby en maillot, s'efforçant (à travers une incroyable série de malchances) de regagner leur île natale de Peru16. Cinq fois déjà ils avaient payé leur traversée et pris le bateau ; cinq fois ils avaient été déçus, débarqués sans un sou sur des iles étrangères, ou ramenés à Butaritari, leur point de départ. Cette dernière tentative n'avait pas été plus heureuse ; leurs provisions étaient épuisées. Il n'était plus question d'atteindre Peru, et ils avaient gaiement pris leur parti d'un nouveau séjour d'exil à Tapituea ou Nonuti. Avec cette saute de vent, leur but hasardeux fut, une fois de plus, modifié ; et comme le pilote du Calendar, quand les « montagnes noires » apparurent; ils changèrent de couleur et se frappèrent la poitrine. Leur campement qui était dans l'entrepont résonna de leurs lamentations. Ils seraient mis au travail ! ils seraient réduits en esclavage ! tout espoir de fuite était vain ; il leur faudrait vivre, travailler et mourir à Apemama, dans l'antre du tyran. Ils terrifièrent si bien leurs enfants avec des discours de ce genre que l'un d'eux, un grand garçon dégingandé, dut être emporté de sur le pont, tout en larmes. Leurs terreurs n'avaient aucun fondement. J'ai tout lieu de croire qu'on les abandonna à leur paresse et je puis assurer qu'on les traita avec bonté et générosité. Car, environ un an après, je me trouvai être de nouveau compagnon de bord de ces instables vagabonds, sur le Janet-Nicoll. Leur traversée était payée par Tembinok'; eux que l'Equateur avait débarqués, dénués de tout, reparurent sur le Janet avec des vêtements neufs, chargés de nattes et de présents, emportant avec eux un magasin de vivres sur lesquels ils vécurent, tout le long du voyage, comme des coqs de combat; je les vis, à la fin, rapatriés, et je dois dire qu'ils montrèrent plus de chagrin en quittant Apemama que de joie en retrouvant leur patrie.
Nous arrivâmes par le passage du Nord (le dimanche 1er septembre), louvoyant entre les récifs. C'était un jour de soleil équatorial, féroce ; mais la brise était forte et fraîche ; et le second, qui inspectait la goélette de fond en comble, remonta en grelottant sur le pont. Le lagon se soulevait en d'innombrables petites vagues multicolores ; le mugissement continu du large résonnait tout autour du mouillage ; et le long et profond croissant des palmiers s'ébouriffait et étincelait sous le vent. En face de nous, le rivage était dominé à quelque distance par une terrasse de corail blanc de sept à huit pieds de haut ; elle-même, couronnée par les constructions éparpillées et hétéroclites du palais. Le village se déploie au Sud, groupe de maniap's aux hautes toitures. Et village et palais semblaient déserts.
Et voici qu'à peine étions-nous amarrés, des figures lointaines et affairées surgirent sur la plage, une embarcation fut mise à l'eau et un équipage se dirigea vers nous à force de rames, apportant l'échelle du Roi. Tembinok' ayant eu une fois un accident, a toujours redouté depuis, de risquer sa personne sur les échelles vermoulues des bateaux marchands des mers du Sud, et il imagina, en conséquence, un cadre de bois qu'on apporte à bord sitôt qu'un navire apparaît et qui demeure accroché à son flanc jusqu'à ce qu'il reparte. L'équipage du canot, ayant placé son engin, regagna de suite le rivage. Ils n'avaient pas le droit de venir à bord ; nous n'avions pas davantage celui de descendre à terre, sans risquer une offense aux usages ; le Roi seul pouvait nous y autoriser. Un temps s'écoula pendant lequel le diner fut différé pour le Grand Homme ; le prélude de l'échelle, nous donnant quelque pressentiment de sa corpulence et de son caractère ingénieux et sensé, avait aiguisé au plus haut point notre curiosité ; et ce fut avec une réelle excitation que nous vîmes la plage et la terrasse subitement couvertes de vassaux, le Roi s'embarquer avec sa suite, l'embarcation (une chaloupe de cuirassé), voler vers nous, tenant tête au vent, et le royal patron nous aborder adroitement, monter à l'échelle avec une défiance jalouse et descendre lourdement sur le pont.
Il était alors envahi par la graisse et, la vue obscurcie, un fardeau pour lui-même. Depuis, des capitaines qui visitaient l'île, lui ont conseillé de marcher; et quoiqu'il dût rompre pour cela avec les habitudes de sa vie et les traditions de son rang, il pratiqua le remède avec profit. Sa corpulence est, maintenant, supportable ; il est plutôt robuste que gros ; mais sa démarche est toujours lourde, trébuchante et éléphantine. Il ne s'arrête ni ne se presse jamais, mais vaque à ses affaires avec une décision implacable. Jamais nous ne le vîmes sans être frappés de ses extraordinaires dispositions naturelles pour la scène ; un profil en bec d'aigle rappelant le masque du Dante, une crinière de longs cheveux noirs, l'œil brillant, impérieux et scrutateur : pour qui eût su en jouer, un tel physique était une fortune. Sa voix le complétait bien, aiguë, puissante, fantastique, avec des notes d'oiseau de mer. Là où il ne règne pas de modes, personne qui les lance, peu qui les suivraient si elles étaient lancées et personne pour les critiquer, il s'habille — comme Sir Charles Grandison vivait, — « selon son propre cœur ». Tantôt il porte une robe de femme, tantôt un uniforme de marine ; parfois (et le plus souvent), un déguisement de sa propre invention : des pantalons et une jaquette singulière avec des pans de chemise; la coupe étonnante pour un travail insulaire, l'étoffe toujours belle, quelquefois de velours vert, quelquefois d'une soie rouge cardinal. Ce costume lui sied à ravir. En robe de femme' il paraît incroyablement sombre et menaçant. Je le vois encore venir vers moi, sous le cruel soleil, solitaire, comme un héros d'Hoffmann.
Une visite à bord, comme celle que nous recevions, est une partie importante et la principale distraction de la vie de Tembinok'. Il n'est pas seulement le seul Maître, il est le seul marchand de son triple royaume. Apemama, Aranuka et Kuria, Iles fertiles. Le taro va aux chefs qui le partagent à leur guise entre leur suite immédiate ; mais certains poissons, les tortues — qui abondent à Kuria — et la récolte entière des cocotiers sont la propriété exclusive de Tembinok'. « Tout . cobra17 à moi », observe Sa Majesté, avec un signe de la main ; et il le compte et le vend par maisons pleines. « Vous avez du copra. Roi ? » entendis-je un commerçant lui demander. « J'en ai deux, trois maisons ». — répondit Sa Majesté, — « je crois trois ». De là. l'importance commerciale d'Apemama. le commerce de trois îles étant concentré là dans une seule main ; de
là, l'impossibilité qu'ont rencontrée tant de blancs d'y acquérir ou d'y conserver un établissement. Voilà pourquoi les vaisseaux sont parés, pourquoi les cuisiniers reçoivent des ordres spéciaux et pourquoi les capitaines se répandent en sourires pour saluer le Roi. S'il est satisfait du menu et de l'accueil qu'il a reçu, il peut rester des jours à bord et chaque jour, et parfois chaque heure, rapporte quelque profit au bateau. Il oscille entre la cabine où des mets étranges lui sont servis et l'entrepôt des marchandises où il jouit du plaisir d'acheter sur une échelle en rapport avec sa corpulence. Quelques courtisans obséquieux veillent à la porte, guettant son moindre signe. Dans la chaloupe qui a été suspendue à l'arrière, une ou deux de ses femmes gisent, abritées du soleil par des nattes, ballottées par les. vagues courtes du lagon et endurant des agonies de chaleur et d'ennui. Cette sévérité se relâche de loin en loin et elles sont alors admises à bord. Trois ou quatre d'entre elles reçurent cette faveur le jour de notre arrivée : de substantielles « ladies », vêtues de ridis vaporeux. Chacune avait une ration de copra, son peculium, dont elle devait disposer à son gré. L'étalage du magasin, — les chapeaux, les rubans, les robes, les parfums, les boîtes de saumon en conserve,— joie pour les yeux et convoitise pour la chair — ne les tentèrent pas. Elles n'avaient qu'une pensée : le tabac, monnaie des îles qui, pour eux, équivaut à des pièces d'or ; — elles en emportèrent une provision à terre, chargées mais heureuses ; et bien avant dans la nuit, nous les vîmes sur la terrasse royale, comptant les paquets au grand air, à la lueur d'une lampe.
Le Roi n'est pas un économiste de ce genre. Il est avide de choses nouvelles et étrangères. Des maisons et des maisons, des coffres et des coffres, dans l'enceinte du palais, sont bourrés de pendules, de boîtes à musique, de lunettes bleues, de parapluies, de tricots, de ballots d'étoffes, d'outils, de carabines, de fusils de chasse, de médecines, de comestibles européens, de machines à coudre et, ce qui est le plus extraordinaire, de poêles : tout ce qui a jamais frappé ses regards, excité son appétit, lui a plu pour son usage et l'a intrigué par son apparente inutilité. Et malgré cela, sa convoitise n'est pas encore satisfaite. Il est possédé par les sept démons du collectionneur. Qu'il entende parler d'une chose, une ombre s'étend sur son visage. « Je crois moi pas l'avoir », dira-t-il ; et les trésors qu'il possède perdent toute valeur en comparaison. Lorsqu'un navire met à la voile vers Apemama, le marchand se torture l'esprit pour apporter quelque nouveauté. Il la laisse négligemment traîner dans la pièce principale ou la dissimule à moitié dans sa propre cabine, en sorte que le Roi puisse la découvrir lui-même. « Combien en demandez-vous ? » dit Tembi-nok' en passant ; désignant l'objet. « Non, Roi; trop cher », réplique le commerçant. « Je pense qu'il me plaît », dit le Roi. C'était un bassin de poissons rouges. Une autre fois, c'était du savon parfumé. « Non, Roi ; cela coûte trop cher », dit le commerçant, « trop bon pour un Canaque. » — « Combien en avez-vous ? Je prends tout », réplique Sa Majesté, qui devint propriétaire de dix-sept boites de savon à deux dollars le pain ; Ou bien encore, le marchand lui fait croire que l'article n'est pas à vendre, est propriété privée, un souvenir de famille ou un présent ; et la ruse réussit infailliblement. Contrariez le Roi et vous le tenez. Sa nature autocratique se cabre devant l'affront d'une opposition. Il la prend pour un défi ; serre les dents comme un chasseur qui fonce sur l'obstacle ; et sans manifester aucune émotion, pas même d'intérêt, en offre, stupidement, un prix de plus, en plus élevé: C'est ainsi que, pour nos péchés, il fut séduit par le nécessaire de ma femme, chose complètement inutile pour un homme; et, lamentablement endommagé par des années de service. Un matin, de bonne heure, il vint dans notre maison, s'assit et, brusquement, nous offrit de l'acheter. Je lui dis que je ne vendais rien et que, de toute façon, le sac était le présent d'un ami ; mais il était accoutumé de longue date à cette sorte de prétextes, savait ce qu'ils valaient et le cas qu'il convenait d'en faire. Adoptant ce qu'on appelle, je crois « la méthode objective », il sortit un sac d'or anglais, de couronnes et de demi-couronnes et commença à les empiler en silence sur la table, scrutant nos physionomies à chaque nouvelle pièce. En vain je continuais à protester que je n'étais pas un commerçant : il ne daigna pas répondre. Il devait y avoir environ vingt pounds sur la table, il allait toujours, et notre embarras commençait à se mêler d'irritation quand une heureuse idée vint à notre aide. Puisque Sa Majesté faisait un tel cas de ce sac, dîmes-nous, nous la priions de l'accepter en souvenir. C'était la chose la plus étonnante qui fût encore arrivée à Tembinok' ! Il s'aperçut trop tard que son insistance était de mauvais ton ; baissa la tête quelque temps en silence, puis, d'un air penaud : « Moi honteux », dit le tyran ! C'est la première et la dernière fois que nous le vîmes confesser une erreur de conduite. Une demi-heure après, il nous envoya un coffre en bois de camphrier qui ne valait pas plus de quelques dollars, — mais Dieu sait combien Tembinok' avait dû le payer !
Rusé de nature et versé depuis quarante ans dans le gouvernement des hommes, il ne faut pas croire qu'il soit aveuglément trompé ni qu'il se soit résigné sans résistance à être la vache à lait des trafiquants qui passent. Ses efforts ont même été héroïques. Comme Nakaeia, de Makin, il a eu des goélettes à lui ; plus fortuné que Nakaeia, il a trouvé des capitaines. Ses navires ont été jusqu'aux colonies. Il a trafiqué directement, sur ses propres bâtiments, avec la Nouvelle-Zélande. Et même ainsi, et là même, la malhonnêteté du blanc, qui enveloppe le monde entier, lui fit obstacle ; ses bénéfices furent anéantis, son bâtiment revint endetté, l'argent de l'assurance fut frauduleusement détourné, et le jour où le Coronet se perdit, il fut étonné de découvrir qu'il avait tout perdu avec. Sur ce, il rendit les armes ; avoua qu'il y aurait autant d'espoir à lutter avec les vents du ciel ; et, comme un mouton expérimenté, abandonna dès lors sa toison aux tondeurs. Il est l'homme du monde le moins disposé à gaspiller sa colère sur l'irrémédiable ; il l'accepte avec un sang-froid cynique ; ne réclame de ceux avec lesquels il traite qu'un peu de décence et de modération ; tâche de faire le meilleur marché possible ; et quand il se voit volé plus encore que de coutume, l'enregistre dans sa mémoire en face du nom du marchand. Il m'exhiba un jour une liste de capitaines et subrécargues avec lesquels il avait fait des affaires et qu'il avait classés sous ces trois en-têtes : « Il trompe un peu », — « Il trompe beaucoup », — et « Je crois qu'il trompe trop ». Il témoignait pour les deux premières classes d'une parfaite tolérance, de même quelquefois, — mais pas toujours, — pour la troisième. J'étais présent un jour qu'il avait des démêlés avec un marchand et je m'efforçais (ayant depuis l'histoire du sac une influence considérable), d'arranger les choses. Le jour même de notre arrivée, un accroc faillit se produire avec le capitaine Reid, dont la cause vaut la peine d'être racontée. Parmi les matières exportées spécialement pour Tembinok' se trouve un breuvage connu (et étiqueté) sous le nom de brandy Hennessy. Ce n'est ni un produit Hennessy ni du brandy ; il a vaguement la couleur de la cerise, mais n'est pas de la cerise ; il a goût de kirsch, mais n'est pas non plus du kirsch. Cependant, le Roi est habitué à cette marque étonnante et il est fier de son bouquet ; il considère la moindre substitution comme une double offense représentant une duperie à son endroit et un doute à l'endroit de la finesse de son palais. Une faiblesse semblable est d'ailleurs remarquable chez tous les connaisseurs. Il se trouva que la dernière caisse, vendue par l'Equateur, contenait un produit différent et, je le croirais volontiers, supérieur, et la conversation débuta assez mal pour le capitaine Reid. Mais Tembinok' est un homme modéré. On lui rappela, et il admit que tous les hommes sont sujets à l'erreur, et lui-même aussi ; accepta l'idée qu'une faute, dûment reconnue, doit être pardonnée; et clôtura l'incident par cette offre : « Tuppoté18 moi me tompé, vous pa'donnez moi. — Tuppote vous tompé moi, moi pa'donné vous. Moi meilleu'. »
Après un diner et un souper dans la cabine, un verre ou deux de « Hennetti », — l'article authentique cette fois, avec le kirsch bouquet et cinq heures de flânerie dans le magasin, sa royauté s'embarqua pour retourner chez lui. En trois bordées, l'embarcation fut devant le palais ; les femmes furent portées à terre sur le dos des vassaux ; Tembinok' descendit sur une plate-forme à rails comme une passerelle de steamer et fut porté, à hauteur d'épaules, à travers les récifs, en haut de la plage, et, par un plan incliné, pavé de cailloux, vers la terrasse éblouissante où il demeure.
chapitre ii
Le Roi d'Apemama : fondation d'Equateur-Ville
Notre première entrevue avec Tembinok' était pour nous tous un sujet d'inquiétude, voire même d'alarme. Nous avions une faveur à obtenir ; nous devions l'approcher dans une attitude convenable de courtisans ; et il fallait lui plaire ou manquer le but principal de notre voyage. Notre désir était d'atterrir et de séjourner à Apemama, et de voir de plus près le singulier caractère de l'homme, et la singulière (ou plutôt ancienne) condition de son île. Dans toute autre île des mers du Sud, un blanc peut débarquer avec sa malle, s'installer pour le reste de ses jours s'il en a envie et s'il a de l'argent ou un commerce ; rien ne peut s'y opposer. Mais Apemama est une île fermée, posée là, sur la mer, portes closes ; et le Roi en personne, comme un vigilant officier, veille au guichet pour scruter et repousser les envahisseurs. De là tout l'attrait de notre entreprise ; non seulement parce qu'elle était un peu difficile, mais parce que cette quarantaine sociale, une curiosité en elle-même, en a préservé d'autres.
Tembinok', comme presque tous les tyrans, est un conservateur ; comme beaucoup de conservateurs, il accueille avec empressement les idées neuves et, excepté sur le terrain politique, incline aux réformes pratiques. Lorsque les missionnaires vinrent, professant la connaissance de la Vérité, il les reçut de bonne grâce, assista à leurs offices, prit l'habitude de la prière publique et se montra leur humble disciple. C'est ainsi, — par l'exploitation de semblables occasions de hasard — qu'il a appris à lire, à écrire, à calculer et à parler son étrange anglais, personnel, si différent du « Beach-la-Mar » habituel et tellement plus obscur, plus expressif et plus condensé. Son éducation ainsi accomplie, il trouva le temps de critiquer les nouveaux venus. Comme Nakaeia de Makin, il admire le silence dé l'île ; veille sur elle comme une vaste oreille ; il a des espions qui, chaque jour, lui rendent compte de tout, et il préfère voir ses sujets chanter que parler. A ce compte, le service, et en particulier le sermon, devaient fatalement l'offenser. « Ici, dans mon île, moi pa'ler », me dit-il une fois ; « chefs à moi, pas pa'ler; fai' ce que moi dis. » Il regarda le missionnaire et que vit-il ? « Ou Kanaka pa'ler dans glande maison ! » s'écriait-il avec un rire sarcastique. Cependant il endura ce spectacle subversif et aurait peut-être continué à l'endurer si un nouveau point de contestation ne se fût élevé. Il regarda encore, pour employer sa propre image ; et le Canaque ne parlait plus, il faisait pire — il bâtissait une maison de copra ! Le Roi était atteint dans ses principaux intérêts : revenus et prérogative étaient lésés ! De plus, il considérait (et d'autres pensent comme lui), que le commerce est incompatible avec les prétentions des missionnaires. « Tuppoté' mitonaire pense « bon homme : tlé bien. — Tuppoté' il pense : cobla pas bon ? Je l'ai (envoyé bateau. » Telle fut son abrupte histoire des évangélisateurs d'Apemama.
De semblables déportations sont fréquentes : « Je l'ai lenvoyé bateau », est l'épitaphe d'un grand nombre. Sa Majesté payant le passage des exilés jusqu'à la première escale. Par exemple, étant passionnément friand de la cuisine européenne, il a plusieurs fois adjoint à son personnel des cuisiniers blancs qui tous, l'un après l'autre, ont été déportés. Ceux-ci, de leur côté, jurent qu'on ne leur payait pas leurs gages ; lui, du sien, assure qu'ils le volaient ou le trompaient outrageusement ; les deux choses étaient peut-être exactes. Un cas plus important fut celui d'un agent, délégué (m'a-t-on dit) par une maison de commerce, pour s'introduire dans les bonnes grâces du Roi, devenir, si possible, son premier ministre et diriger la traite du copra dans l'intérêt de cette maison. Il obtint la permission d'atterrir, pratiqua son système de séductions, fut patiemment écouté par Tembinok', se crut sur le chemin du succès et, voyez ! au premier navire qui toucha à Apemama, l'aspirant premier fut Jeté dans une embarcation hissé à bord,— son passage payé, — et sur ce, bonsoir ! Mais il est inutile de multiplier les exemples; c'est à manger le pudding qu'on goûte s'il est bon. Quand nous vînmes à Apemama, de tant d'hommes qui avaient lutté pour une place sur ce riche marché, un seul demeurait — un silencieux, sobre, solitaire, ladre reclus, de qui le Roi remarque : « Moi pense lui bon ; lui pas pa'ler. »
Je fus averti au début que nous pourrions fort bien échouer dans notre dessein ; mais pas un instant, je n'imaginai ce qui adviendrait et que nous serions laissés vingt-quatre heures en suspens, et à deux doigts de nous voir finalement repoussés. Le capitaine Reid s'était préparé ; sitôt que le Roi fut à bord, et la question « Hennetti » réglée à l'amiable, il procéda à l'expression de ma requête et à un exposé de mes titres et de mes vertus. La plaisanterie sur le fils de la Reine Victoria pouvait passer à Butaritari ; il ne pouvait en être question ici ; je figurai cette fois comme un des « Vieux-Hommes » de l'Angleterre : personnage d'un profond savoir, venu tout exprès pour visiter les états de Tembinok' et impatient d'en rapporter des récits à la non moins impatiente Reine Victoria. Le Roi ne répondit rien et commença à parler d'autre chose. C'était à croire qu'il n'avait pas entendu ou pas compris, si nous ne nous étions sentis les objets d'un examen constant. Comme nous étions à table, il nous entreprit l'un après l'autre, fixant sur chacun de nous, pendant près d'une minute, le même regard dur et pensif. Tandis qu'il nous dévisageait ainsi, il semblait s'oublier lui-même, et le sujet, et la société, et être entièrement absorbé par la suite de ses pensées ; ce regard était complètement impersonnel : j'ai vu le même dans les yeux de peintres de portraits. Les motifs qui ont fait déporter tant de blancs sont au nombre de quatre : ou ils trompaient Tembinok', ou ils se mêlaient de la vente du copra qui est la source de sa richesse et un des nerfs de son pouvoir, ou ils « pa'laient », ou ils se livraient à des intrigues politiques. Je me sentais innocent de tout cela ; mais comment le prouver ? Je n'aurais pas accepté de copra même en présent : comment le faire ressortir de la composition même de mes menus ? Mes compagnons partageaient mon innocence et mon embarras. Ils partagèrent aussi mon humiliation lorsque après deux repas entiers et les pénibles intervalles d'un après-midi passé dans cette inspection, Tembinok' prit congé de nous en silence. Le lendemain matin, même examen, non déguisé, même silence ; et le second jour touchait à sa fin quand je fus. informé brusquement que j'étais sorti vainqueur de l'épreuve. « Moi rega'dé œil à vous. Vous, homme bon. Vous pas menti' », dit le Roi : compliment douteux pour un romancier ! Un peu plus tard, il nous expliqua qu'il ne jugeait pas seulement par l'œil, mais aussi par la bouche. « Tuppoté' moi vois homme », — nous dit-il, — « moi pas savoi' homme bon, homme mauvais. Moi, rega'der œil; rega'der bouche. Alo' savoi'. Rega'der oeil, rega'der bouche », répétait-il. Et effectivement, dans notre cas, la bouche fut le principal de l'affaire et c'est par notre conversation que nous acquîmes droit d'entrée dans l'île, le Roi se promettant (et je crois réellement amassant) un vaste apport de connaissances utiles avant notre départ.
Voici quelles étaient les conditions de notre admission : nous devions choisir un emplacement sur lequel le Roi nous bâtirait une ville. Son peuple travaillerait pour nous, mais lui seul devait donner des ordres. Un de ses cuisiniers viendrait tous les jours aider le mien et s'instruire auprès de lui. Au cas où nos provisions s'épuiseraient, il nous fournirait le nécessaire et serait remboursé au retour de l'Equateur. D'autre part, il viendrait prendre ses repas avec nous chaque fois qu'il en aurait envie ; quand il resterait chez lui, un plat de notre table devait lui être envoyé, et je m'engageai solennellement à ne donner à ses sujets ni liqueur, ni argent (deux choses dont la possession leur est interdite), ni tabac qu'ils ne devaient recevoir que de la main royale. Je me souviens d'avoir protesté contre la rigueur de ce dernier article ; à la fin il fut adouci et j'obtins la permission, lorsqu'un homme aurait travaillé pour moi, de lui donner une pipe de tabac sur les lieux, mais pas à emporter.
L'emplacement d'Equateur-Ville — nous lui donnâmes le nom de notre goélette — fut bientôt choisi. Les rives immédiates du lagon sont éventées et aveuglantes ; Tembinok' lui-même est heureux de se promener à tâtons sur sa terrasse avec des lunettes bleues ; et nous fuîmes le voisinage de la cunjunctiva rouge, des prunelles suppurantes et des mendiants qui poursuivent et implorent le passant étranger pour se faire laver les yeux. Derrière la ville, le pays est varié ; ici, découvert, sablonneux, inégal, et semé de palmiers nains; là, coupé par des tranchées de taro, sombres et basses et, suivant la croissance des plantes, présentant l'aspect, tantôt d'une tannerie sableuse, tantôt d'un jardin aux allées verdoyantes. Un sentier conduit à la mer et monte, abrupt, jusqu'au point culminant de l'île — à vingt ou même trente pieds d'altitude, quoique Findlay n'en reconnaisse que cinq ; et, juste en haut de la montée, là où les palmiers commencent à s'épanouir, nous trouvâmes un bosquet de pandanus et un bout de terrain agréablement planté d'arbustes verts. Un puits se trouvait tout près de là, sous un toit rustique ; et, plus près encore, une mare où nous pourrions laver nos vêtements. La place était à l'abri du vent, à l'abri du soleil et hors de vue du village. Nous la désignâmes au Roi et la ville nous fut promise pour le lendemain.
Le lendemain vint. Mr. Osbourne descendit à terre, constata que rien n'était fait et alla se plaindre à Tembinok'. Celui-ci l'écouta, se leva, demanda un Winchester, franchit la palissade royale et tira deux coups en l'air. Une décharge en l'air est le premier des avertissements à Apemama ; il a force de proclamation en de plus loquaces contrées ; et Sa Majesté remarqua avec agrément que cela presserait ses ouvriers. En moins de trente minutes, les hommes étaient rassemblés, l'ouvrage en train, et on nous avertit que nous pouvions apporter nos bagages quand nous voudrions.
Il était 2 heures de l'après-midi quand la première embarcation accosta sur la plage, et la longue procession de malles, de paniers et de sacs commença de se dérouler à travers le désert de sable vers Equateur-Ville. Le bosquet de pandanus n'était plus qu'un souvenir. Du feu s'élevait tout autour et de la fumée s'élevait du vert taillis. On entendait, dans un vaste circuit, résonner le bruit des cognées. La première pensée du Roi avait été d'abolir les avantages mêmes pour lesquels l'emplacement avait été choisi, et, au milieu de cette dévastation, s'élevait déjà un maniap' d'une bonne dimension et une petite maison bien close. Une natte était étendue auprès pour Tembinok' c'est là qu'il se tenait, dirigeant tout, en rouge cardinal, un casque de liège sur la tète, une pipe en écume de mer à la bouche, une femme étendue derrière lui, veillant sur les allumettes et le tabac. A vingt ou trente pas devant lui, le gros des travailleurs était accroupis sur le sol ; quelques buissons survivaient à cet endroit ; et au milieu d'eux, ses sujets ne présentaient aux regards qu'un arc de faces brunes, de têtes noires et d'yeux attentifs fixés sur Sa Majesté. De longues pauses s'écoulaient pendant lesquelles les sujets fixaient le Roi et le Roi fumait. Ensuite, Tembinok' élevait la voix et parlait sur un ton aigu et bréf. Aucune parole ne lui répondait jamais ; mais, si le discours était facétieux, la réponse se traduisait par un rire discret, obséquieux — comme on en entend dans des salles d'études ; et, s'il était pratique, par la levée soudaine et le départ de l'escouade. Deux fois ils disparurent ainsi et revinrent avec les éléments futurs de la cité : une seconde maison et un second maniap'. C'était une chose curieuse d'épier de loin, à travers les stipes des cocotiers, l'arrivée silencieuse du maniap', tout d'abord flottant (semblait-il), spontanément dans les airs, — puis, à mesure qu'il approchait, trahissait sous les bords de sa toiture, plusieurs vingtaines de mouvantes jambes nues. Toute la chose n'était pas moins remarquable par une servile délibération que par cette obéissance servile. La brigade s'était rassemblée au signal d'une arme mortelle; l'homme qu'ils regardaient était le maître indiscuté de leurs vies ; et, à la civilité près, ils s'agitaient comme autant d'employés d'hôtels américains. Le spectateur avait conscience d'une inertie discrète, mais invincible, capable de faire s'arracher les cheveux à un capitaine de vaisseau marchand.
Pourtant, l'ouvrage s'acheva. Au crépuscule, quand Sa Majesté se retira, la ville était fondée et complète, le nouveau et plus rude Amphion l'ayant fait surgir du néant en trois coups de fusil. Et le lendemain matin, le même magicien nous favorisa d'un nouveau miracle : un rempart mystique nous entourait de telle sorte que le sentier qui passait devant nos portes devenait soudain impraticable et qu'il fallait, pour se rendre de l'autre côté de l'Ile, faire un immense circuit, et nous nous trouvions au milieu, voyant, en vue, mais inap-prochables comme des abeilles dans une ruche de verre. Le signe extérieur et visible de cette protection occulte consistait en guirlandes de feuilles de cocotier reliant entre elles les stipes des palmiers en bordure; mais son symbole reposait sur la redoutable sanction du tabou et sur les fusils de Tembinok'.
Nous fîmes, ce soir-là, notre premier repas dans la cité improvisée où nous devions passer deux mois et qui — sitôt notre départ — devait, en un jour, disparaître comme elle était apparue, ses éléments retournant d'où ils étaient venus, le tabou abrogé, le va-et-vient sur le sentier restauré, et la lune et le soleil épièrent vainement au travers des palmes les constructions disparues, tandis que le vent soufflait sur un site désormais désert. Cependant ce lieu qui, maintenant, n'est plus qu'un épisode dans quelques mémoires, semblait avoir été élevé pour durer des années. C'était un hameau plein d'activité. Un des maniap's fut notre salle à manger, l'autre la cuisine. Les maisons furent réservées au sommeil. Elles étaient construites sur le plan admirable d'Apemama : le meilleur type de maisons des mers du Sud ; élevée sur pilotis à trois pieds du sol ; les côtés faits de panneaux tressés et mobiles, qui peuvent être levés pour laisser entrer la lumière et l'air ou baissés pour protéger du vent ou de la pluie : elle est aérée, saine, propre et étanche. Nous possédions une poule d'une espèce remarquable : unique en son genre dans mes souvenirs, car c'était une poule qui, à l'occasion, pondait des œufs. Non loin de là, Mrs. Stevenson avait fait une plantation de salade et d'échalotte. La salade fut dévorée par la poule — ce qui fut sa perte. L'échalotte nous fut servie feuille par feuille, et accueillie et savourée comme des pêches. Des grogs et des noix de coco vertes nous étaient apportés tous les jours. Le Roi nous fit une fois présent de poisson et une autre fois d'une tortue. Parfois, nous tirions des soi-disant pluviers sur le rivage, et parfois, dans le taillis, des poulets sauvages. Le reste de notre régime consistait en conserves.
Nos occupations étaient très variées. Tandis que les uns dessinaient, Mr. Osbourne et moi. nous travaillions diligemment à un roman. Nous lisions Gibbon et Carlyle à haute voix ; nous soufflions dans des flageolets, nous tapions sur des guitares, nous prenions des photographies à la lumière du soleil, de la lune et du magnésium ; quelquefois nous jouions aux cartes. La chasse au pot-au-feu occupait une bonne part de nos loisirs. J'ai passé moi-même des après-midi entiers, armé d'un revolver, à l'excitante mais inoffensive poursuite du gibier; fort heureusement, il y avait parmi nous de meilleurs tireurs et heureusement aussi, le Roi nous prêta une meilleure arme sous la forme d'un fusil de chasse, sans quoi notre régime eût été plus maigre encore.
C'est la nuit qu'il fallait voir notre cité, quand la lune était levée, les lampes allumées et que le feu brillait encore dans la cuisine. Nous étions victimes d'une plaie de mouches et de moustiques comparable à celle de l'Egypte ; notre table (prêtée par le Roi. comme tout le mobilier), devait être recouverte d'une tente de filet, notre citadelle et notre refuge ; celle-ci devenait entièrement lumineuse, s'enflait et s'irradiait sous les bords de la toiture comme le globe de quelque lampe monstrueuse, sertie d'une marge sombre. Nos cabines, don! les cloisons étaient étayées à des inclinaisons variées. Projetaient au dehors d'étranges morceaux angulaires de clarté. Dans sa cuisine voûtée et grande ouverte, on Pouvait voir Ah-Fu près de sa lampe et de son feu, s'agitant parmi ses casseroles. Sur tout cela, s'épandit Pendant la saison la splendeur d'un doux clair de lune. Le sable étincelait comme de la poussière de diamants ; les étoiles s'étaient évanouies. De temps en temps un sombre oiseau de nuit, d'un vol lourd et bas, traversait la colonnade des troncs d'arbres et poussait un cri rauque et strident.
chapitre iii
Le Roi d'Apemama : le palais de beaucoup de femmes
Le palais, ou plutôt le terrain qu'il englobe, couvre une étendue de plusieurs arpents. Une terrasse le borne du côté du lagon ; du côté de la terre, une palissade avec plusieurs grilles. Celles-ci ne sont pas des moyens de défense; un homme un peu vigoureux jetterait facilement la palissade à bas ; et point n'est besoin d'une agilité extraordinaire pour sauter de la plage sur la terrasse. Aucun étalage de gardes, de soldats ou d'armes ; l'arsenal est sous clef ; et les seules sentinelles sont certaines vieilles femmes insignifiantes, tapies nuit et jour devant les grilles. Le jour, ces vieilles s'occupaient souvent à faire du sirop ou à quelque autre fonction domestique; la nuit, elles s'embusquaient dans l'ombre ou rampaient le long de la palissade, eunuques de ce harem, seules gardes de la vie du tyran.
Une garde féminine était l'avant-poste indiqué pour ce palais de nombreuses femmes. Je n'ai aucune idée du nombre des épouses du Roi ; et une idée vague, seulement, de leurs fonctions. Lui-même se montrait embarrassé lorsqu'on faisait attention à elles comme étant ses femmes, les appelait « ma pamille ». et expliquait qu'elles étaient ses « cutcheons » — cousines. Nous en distinguâmes quatre dans la foule : la mère du Roi ; sa soeur, une femme grave, touchante, ayant beaucoup de l'intelligence de son frère ; la Reine propre à qui (et à qui seule), ma femme fut formellement présentée ; et la favorite du moment, une gracieuse et jolie fille, toujours assise aux côtés du Roi, et qui, une fois (comme il pleurait), le consola avec des caresses. On m'a assuré que c'était un sentiment tout platonique. A l'arrière-plan figurait une multitude de dames, les maigres, les grosses et les éléphantines, quelques-unes en sarreau, d'autres dans l'imperceptible ridi; nobles et obscures, esclaves et maîtresses, de la Reine au souillon, de la favorite aux sentinelles décharnées de la palissade. Bien entendu, toutes ne sont pas de « ma pamille » — beaucoup sont de simples servantes ; pourtant, un nombre surprenant d'entre elles se partageait la confiance du Roi. Celles-ci étaient porte-clefs, trésorières, gardiennes de l'arsenal, de la lingerie et des magasins. Chacune connaissait et remplissait sa partie dans la perfection. Avait-on besoin de quoique ce soit — un fusil spécial, un morceau d'étoffe, — la reine voulue était requise ; elle venait, apportant le coffre indiqué, l'ouvrait en la présence du Roi et déployait les choses commises à sa garde dans un parfait état de conservation — le fusil nettoyé et huilé, les étoffes bien pliées. Sans interruption et sans hâte, le vaste établissement, tout entier, tournait sur ses roues comme une machine. Je n'ai vu nulle part un ordre aussi parfait. Et pourtant, je pensais tout le temps aux Contes de Norse, aux ogres qui gardaient leur cœur enseveli dans la terre pour plus de sûreté et confiaient ce secret à leurs femmes. Car la vie de Tembinok' est à la merci de ces armes. Il ne vise pas à la popularité ; mais il mène et brave ses sujets avec une simplicité dans la domination qu'il est impossible de ne pas admirer et qui force la sympathie. Que l'une d'elles soit tentée de trahir, que les verrous de l'arsenal soient retirés, que les vieilles se soient endormies auprès de la palissade et que les armes aient été, en secret, introduites dans le village, et l'esprit du tyran d'Apemana s'envolerait rejoindre ses prédécesseurs de Mariki et Tapituea. Et cependant, celles à qui il se confie ainsi sont des femmes et toutes rivales entre elles.
Il y a bien, en réalité, un ministre et un état-major de mâles : cook, stewart et subrécargue, — la hiérarchie d'une goélette. Les espions, « les gazettes quotidiennes de Sa Majesté », comme nous les appelions, viennent tous les jours au rapport et repartent. Le cook et le steward ne s'occupent que de la table. Les subrécargues, qui sont chargés de la taille du copra à raison de trois pounds par mois avec le pourcentage, sont rarement dans le palais ; et deux au moins d'entre eux sont dans d'autres Iles. Le charpentier, c'est vrai, ce joyeux et vieux rusé de Rubam — peut-être Reuben ? — promu, lors de ma dernière visite, à la dignité supérieure de gouverneur, est là chaque jour, transformant, agrandissant, poursuivant la série interminable des inventions royales ; et Sa Majesté passe quelquefois toute une après-midi à surveiller l'ouvrage de Rubam en causant avec lui. Mais ces mâles sont tous relégués à l'extérieur; nul ne semble armé ; nul n'a la garde d'aucune clef ; le soir ils sont tous consignés en dehors du palais et le poids de la monarchie ainsi que la vie du monarque reposent, sans partage, sur les femmes.
Voilà un état de maison qui ressemble bien peu aux nôtres ; moins encore au harem oriental : un homme âgé, sans enfants, menacé dans ses jours, demeurant seul au milieu d'une troupe de femmes de tous les âges, de tous les rangs et de tous les degrés de parenté. — la mère, la sœur, la cousine, la femme légitime, la concubine, la favorite, la plus ancienne et celle d'hier ; — lui, au milieu, le seul maitre, le seul mâle, le seul dispensateur d'honneurs, de vêtements, de richesses, le seul but d'ambitions et de désirs sans nombre. Je doute qu'on puisse trouver en Europe un homme assez sûr de lui pour assumer un pareil tour de force, de tact et de gouvernement. Et il semble bien que Tembinok', lui-même, ait eu des difficultés au début. On m'a conté qu'il avait tiré, à bord d'une goélette, sur une femme qui se conduisait mal. Une autre, l'ayant plus gravement offensé, il la tua sur le coup ; il exposa son corps dans une caisse ouverte et (pour rendre la leçon plus mémorable), la laissa se putréfier devant la grille du palais. Sans doute, les années sont venues à son aide ; sur une si vaste échelle, il est plus aisé de jouer au père qu'au mari. Et aujourd'hui, aux yeux d'un étranger tout au moins, tout semble aller sans difficulté, et les épouses sont fières de cette confiance, fières de leur rang et fières de leur astucieux seigneur.
Il était à leurs yeux une sorte de héros, et sa situation était un peu celle d'un professeur à la mode dans une école de jeunes filles. Seulement le professeur n'est pas obligé de manger, de dormir, de vivre et de laver son linge sale au milieu de ses admiratrices ; il peut s'échapper, il a son appartement, il a une vie privée; n'eût-il rien d'autre, il a les vacances, et le moins fortuné Tembinok' est toujours sur la scène et toujours sur la brèche.
Dans toutes mes allées et venues, je ne l'ai jamais entendu s'exprimer avec rudesse, ni mécontentement. Ses manières étaient plutôt marquées d'une bénignité extrême, assez lourde, — la bénignité de quelqu'un sûr d'être obéi ; de sorte qu'il me faisait parfois souvenir de Samuel Richardson dans son cercle d'admiratrices. Ses femmes prenaient la parole et semblaient donner leur opinion comme nos propres femmes — ou encore comme certaines tantes radoteuses mais respectables. De tout ceci, je conclus qu'il gouvernait son sérail bien plus par la diplomatie que par la terreur, et ceux qui en donnent une idée différente (et dont aucun n'a eu mes facilités d'observation) ont peut-être négligé de distinguer entre les degrés des rangs, entre « ma pamille » et les parasites, les blanchisseuses et autres...
Un trait à noter est la partie de cartes du soir, quand les lampes ont été apportées sur la terrasse et que « moi et ma pamille » jouent pendant une heure pour du tabac. Une des caractéristiques de Tembinok' est qu'il tient à inventer le jeu lui-même ; une des caractéristiques de son dévot entourage, qu'ils ne jurent que par cette absurde invention. Elle est basée sur le poker, se joue avec les figures de plusieurs jeux et est d'une inconcevable monotonie. Mais tous les jeux me passionnent ; j'étudiai celui-ci, et je suis, parait-il, le seul blanc qui en ait jamais saisi les principes : un fait pour lequel les femmes (près de qui je n'étais pas autrement populaire) m'acclamèrent avec admiration. On ne pouvait pas s'y tromper, c'était un sentiment naturel : elles étaient fières de leur jeu privé, avaient été piquées au vif par le manque d'intérêt montré par d'autres et s'épanouissaient sous ma flatteuse attention. Tembinok' met une double mise, et on lui tend en retour deux mains entre lesquelles il doit choisir : un facile artifice que les femmes, jusqu'en ces derniers temps, n'ont pas encore approfondi. Lui-même, quand nous causions en particulier, ne faisait aucun mystère de sa certitude de gagner; et c'est ainsi qu'il m'expliqua sa libéralité récente à bord de l'Equateur. Il laissa les femmes acheter leur propre tabac ce qui leur fit plaisir sur le moment. Il le gagna de nouveau aux cartes, ce qui le rendit derechef, et sans nouvelles dépenses, ce qu'il devait être — la source unique de toutes les indulgences. Et il résuma la chose par cette phrase, qui est d'ailleurs la conclusion de tous ses récits : « Bien meilleu'. »
Le palais et ses entours étaient pavés de fragments de corail, un supplice pour les yeux et pour les pieds nus, mais délicieusement sarclé et ratissé. Une vingtaine de constructions et plus s'alignaient en une sorte de rue le long de la palissade, et dispersées sur la bordure de la terrasse ; habitations pour les femmes et servantes ; magasins pour les curiosités et les trésors du Roi ; spacieux maniap's pour les fêtes et les conseils, élevés les uns sur des piliers de bois, d'autres sur une chaussée en maçonnerie. L'une d'elles était encore inachevée : dernière invention du Roi : c'était une charpente européenne élevée en vue de la fraîcheur à l'intérieur d'un vaste maniap' : le toit fait de planches, comme un pont de bateau, de façon à constituer une promenade élevée, ombragée et pourtant privée. C'est là que le Roi passait des heures avec Rubam ; là que j'allais parfois les rejoindre ; la place avait un aspect des plus singuliers ; et je dois dire que l'idée, m'ayant séduit au plus haut point, je me joignis avec plaisir aux conseils des architectes.
Supposez maintenant que quelque affaire nous amenât chez le Roi dans la journée : nous déambulions sur le sable, le long des palmiers nains, échangions un « Kom ma ori » avec la vieille de service et entrions dans l'enceinte. La grande nappe de corail étincelait, déserte, devant nous ; tous s'étant réfugiés sous des toiles sombres pour fuir cet excès d'étendue. Il m'est arrivé de parcourir de long en large cette place-labyrinthe, à la recherche du Roi ; et la seule créature vivante que je rencontrai fut lorsque, jetant un coup d'oeil dans un maniap', je vis le corps brun de l'une des épouses étendues sur le sol, sombre Amazone plongée dans un sommeil silencieux. Si c'était encore l'heure des « Journaux du matin », la recherche était plus aisée," la demi-douzaine de coquins, obséquieux et serviles, tapis sur le sol, devant la maison, aussi serrés que possible à son ombre, et tournant vers le Roi une rangée de regards en coulisse. Tembinok' était là à l'intérieur, les panneaux de la cabine relevés, celle-ci balayée par l'alizé, et lui, écoutant le rapport. Comme certains journalistes plus proches de nous, plus insignifiantes étaient les nouvelles du jour, plus il les délayait en paroles; et j'en ai vu un remplir une matinée, vide de tout événement avec une conversation imaginaire entre deux chiens. Quelquefois le Roi daigne rire ; quelquefois il les questionne ou plaisante avec eux, sa voix résonnant, stridente, du fond de la pièce. Il arrivait qu'il eût à ses côtés son héritier présomptif, Paul, son neveu et fils adoptif, âgé de six ans, complètement nu, un modèle de jeune beauté humaine. Et toujours aussi la favorite et parfois deux autres femmes réveillées ; les quatre autres couchées nonchalamment sur des nattes et perdues dans le sommeil. Ou si nous venions plus tard et tombions sur une heure plus intime, nous trouvions Tembinok', retiré dans sa maison avec la favorite, entre un crachoir, un encrier de plomb et un grand-livre de commerce.
C'est dans ce dernier que, jour après jour, couché à plat ventre, il écrit l'histoire inaccidentée de son règne; et quand il était plongé dans cette occupation, il ne pouvait dissimuler un mouvement de mauvaise humeur en se voyant interrompu, ce que j'étais à même de comprendre. Le royal chroniqueur me lut un jour une ou deux pages de son manuscrit, traduisant au fur et à mesure ; mais le passage étant généalogique, et l'auteur barbottant à l'excès au cours de sa version, j'avoue avoir connu des heures plus divertissantes. Il ne se confine pas dans la prose, mais s'attaque aussi à la lyre, en ses moments de loisir, et passe pour le premier barde de son royaume, de même qu'il est son unique personnage public, son premier architecte et son seul négociant. Sa compétence, toutefois, ne s'élève pas jusqu'à la musique, et, quand ses vers sont écrits, il les confie à un musicien professionnel qui les met en musique et les apprend à un chœur. Questionné sur les sujets de ses poèmes. Tembinok' répondit : « Amou'eux — a'bres, — mer. Pas tous la même ve'ité. Tous le même mensonge ! » Pour une vue condensée de la poésie lyrique (sauf qu'il semble avoir oublié les étoiles et les fleurs) ; ceci parait difficile à corriger ?
Cette multitude d'occupations témoignent (chez un prince indigène et absolu) d'une activité d'esprit peu commune.
La cour du palais, au clair de lune, est un lieu dont on se souvient avec effroi. Le visiteur s'y traînait sur les pierres disjointes dans un cauchemar splendide de lumière et de feu ; mais le souffle du vent le débarrassait des mouches et des moustiques, et, avec le coucher du soleil, il devenait divin.
Je me le rappelle mieux encore par des nuits sans lune. L'air était comme un bain de lait. Innombrables étaient les étoiles sur nos têtes et le lagon était pavé de leurs reflets. Des troupeaux de femmes étaient accroupies, par groupes, sur le gravier, babillant d'une voix douce. Tembinok' rejetait sa jaquette et demeurait nu et silencieux, méditant peut-être des chansons; la favorite était généralement à ses côtés, également silencieuse. Entre temps, au milieu de la cour, les lanternes du palais étaient allumées et alignées en rang sur le sol, à six ou huit mètres l'une de l'autre. Cette vue donnait une idée étrange du nombre de « ma pamille » : un aperçu comme on peut en avoir, le soir, dans un coin de quelque terminus de chez nous. Puis, ces lanternes s'éloignaient dans toutes les parties de l'enceinte, éclairant les derniers travaux du jour, éclairant, l'une après l'autre, sur le chemin de leur repos, cette prodigieuse réunion de femmes. Quelques-unes s'attardaient au milieu de la cour, autour d'une partie de cartes et regardaient mêler et distribuer les figures et Tembinok' réfléchissant entre ses deux mains et les reines perdant leur tabac. Puis celles-ci, à leur tour, se dispersaient et disparaissaient ; et leur place était prise par un grand feu de joie, la veilleuse de nuit du palais. Quand celui-ci était consumé, d'autres feux plus petits brûlaient devant les grilles. Auprès de celles-ci veillaient les vieilles, invisibles, en éveil — pas toujours muettes. Que n'importe qui approchât dans la nuit, une alerte faisait le tour de la palissade : chaque sentinelle avertissant sa voisine par une pierre; le cliquetis d'une grêle de cailloux s'éteignait et mourait ; et les gardes de Tembinok' se blottissaient de nouveau à leurs places, silencieuses comme devant.
chapitre iv
Le Roi d'Apemama : Equateur-Ville et le palais
Cinq personnes furent préposées à notre service. Oncle Parker, qui nous apportait du toddy et des noix, était un homme d'un certain âge, presque un vieillard, mais ayant la mentalité, les ruses et la morale d'un garçon de dix ans. Sa figure était flétrie, bizarre et diabolique, la peau tendue sur les os comme une voile le long d'un cordage, et il souriait de tous les muscles de sa tête. Il fallait recompter ses noix chaque jour, sans quoi il nous aurait trompés sur leur quantité; chaque jour il fallait les examiner pour être sûr qu'elles n'étaient pas vides; le nom du Roi seul, et à peine, le maintenait dans le devoir. Quand il avait fini son ouvrage, on lui donnait une pipe, des allumettes et du tabac et il s'asseyait sur le plancher du maniap et fumait. Il semblait ne pas changer un instant de position ; cependant chaque jour, au moment de rendre ces objets, la blague à tabac avait disparu ; il avait trouvé le moyen de la dissimuler dans le toit d'où il pouvait la retirer et la produire triomphalement le lendemain matin. Bien que ce tour de passe-passe s'accomplit régulièrement devant trois ou quatre paires d'yeux, nous ne pûmes jamais le prendre sur le fait ; en vain nous cherchions le tabac après son départ ; jamais nous ne pûmes le découvrir. Tels étaient les divertissements de l'oncle Parker, un homme de près de soixante ans. Mais il fut puni comme il le méritait.
Mrs. Stevenson eut la fantaisie de faire son portrait et les souffrances que les séances de pose firent endurer au modèle dépassent toute description.
Trois jeunes filles venaient du Palais pour faire notre lessive, à grand fracas, avec Ah-Fu. Elles appartenaient à la classe la plus inférieure, parasites qu'on gardait pour la commodité des bateaux marchands, venues on ne sait d'où, peut-être d'îles étrangères, dépourvues de tout raffinement dans leurs manières et leur aspect, d'assez belles et joyeuses filles dans leur genre. Nous en appelions une Guttersnipe, car vous pouvez voir sa pareille dans les quartiers pauvres de n'importe quelle ville ; le même visage maigre, ardent, vulgaire, aux yeux sombres; le même rire brusque et rauque, les mêmes façons impulsives et inquiètes à la fois, avec comme un coup d'œil sur le policeman : mais ici, le policeman était le Roi et son bâton un fusil. Je doute que vous puissiez trouver, où que ce soit, en dehors des îles et même là, l'équivalent de Fatty, un monument de fille qui devait peser autant de « stones »19 qu'elle comptait de printemps ; elle eût fait un superbe life-guard, elle avait une figure de bébé et appliquait ses vastes forces mécaniques presque exclusivement au jeu. Toutes trois étaient également gaies. Notre lessive s'accomplissait au milieu de danses et de gambades, et elles fuyaient et se poursuivaient, s'aspergeaient et s'éclaboussaient et se roulaient dans le sable avec un bruit ininterrompu de cris et de rires comme des enfants en vacances. En réalité et pour étranges que fussent leur fonctions dans cet austère établissement, n'étaient-elles pas échappées pour un jour de la plus importante et la plus stricte école de fille» des mers du Sud ?
Notre cinquième serviteur n'était pas moins que le cuisinier royal. Il était d'une beauté remarquable, de corps et de visage, paresseux comme un esclave et insolent comme un garçon boucher. Il dormait et fumait chez nous dans des attitudes variées et pleines de grâce ; mais, loin d'aider Ah-Fu, il ne s'occupait même pas de lui. On peut dire de lui qu'il était venu pour apprendre et demeurait pour enseigner ; et ses leçons étaient parfois difficiles à digérer. C'est ainsi qu'envoyé une fois à la fontaine pour remplir un seau d'eau, à mi-chemin, il rencontra une femme, arrosant ses oignons, changea de seau avec elle et, lui laissant celui qui était vide, s'en revint à la cuisine avec celui qui était plein. Une autre fois on lui confia un plat de « dumplings »20 pour le Roi, en lui disant qu'ils devaient être mangés très chauds et qu'il devait les porter aussi vite que possible. Le misérable s'en fut à la vitesse d'un mille à l'heure, traînant ses pieds, le nez en l'air. A cette vue, ma patience, à l'épreuve déjà depuis un mois, m'échappa. Je le poursuivis, le pris par les épaules et, le poussant devant moi, je lui fis dévaler ainsi la colline, traverser les salles et je l'entraînai au milieu des applaudissements du village, jusqu'au Parlement où le Roi tenait un « pow-wow »21. Il eut l'impudence de prétendre que ma violence lui avait occasionné des contusions internes et de manifester des craintes sérieuses pour sa vie.
Nous supportâmes tout cela, car Tembinok' est plutôt sommaire dans ses façons d'agir et je n'étais pas mûr encore pour tremper dans la mort d'un homme. Mais, entre-temps, mon infortuné Chinois avait dû travailler pour deux et tomba malade. Je me trouvai dès lors dans la situation de Cimondain Lantenac et d'ailleurs de tous les personnages de quatre-vingt-treize : obligé pour épargner le coupable de sacrifier l'innocent. J'employai le moyen habituel, avec ses conséquences toujours défectueuses, en essayant de sauver les deux. Ayant bien répété mon rôle, je m'en fus au Palais, je trouvai le Roi seul, et lui tins les plus interminables discours. Le chef était trop vieux pour apprendre : je craignais qu'il ne fît pas de progrès ; ne vaudrait-il pas mieux avoir un garçon ? ? — Les jeunes gens sont plus aptes à apprendre... Ce fut en vain ; le roi ne se laissa pas prendre à mes artifices oratoires et vint droit au fait ; il comprit que le chef avait eu une conduite déplorable et resta un moment sombre et silencieux. « I think he tavoy too much », dit-il à la fin avec une concision chagrine ; et il fit dévier la conversation vers d'autres sujets. Le jour même, un autre grand officier, le steward, apparut à la place du cook et se montra, je dois dire, poli et plein de zèle.
A peine étais-je parti que le Roi se fit donner un fusil et s'en fût rôder de l'autre côté de la palissade, guettant le coupable. Tembinok' était ce jour-là revêtu d'une robe de femme et son déguisement était complété par un casque de liège et des lunettes bleues. Représentez-vous l'étendue éblouissante des sables, les palmiers nains projetant leurs ombres crues, la ligne de la palissade, les vieilles sentinelles (accroupies, chacune, près d'un petit feu clair), faisant cuire du sirop à leur poste, — et cette chimère aux aguets, avec son engin de mort ! Bientôt, vers lui, s'en vint le cook, déambulant la colline sablonneuse d'Equateur-Ville, insouciant, vain et plein de grâce, sans penser au moindre danger. Dès qu'il fut à sa portée, le monarque travesti tira ses six coups au-dessus de sa tête, à ses pieds et sur chacune de ses mains : c'était le second avertissement d'Apemama, terrible en lui-même et d'une signification sans appel, car la prochaine fois. Sa Majesté viserait pour atteindre son but. On m'a conté que le Roi est un excellent fusil ; que lorsqu'il a décidé de tuer, on peut d'avance préparer la tombe ; et que, lorsqu'il a décidé de manquer le but, il le manque de si peu que le coupable goûte, par six fois, l'amertume de la mort. J'eus l'occasion de constater par moi-même l'impression produite sur le cook par cet incident. Comme nous revenions, ma femme et moi, du rivage de l'île, nous aperçûmes quelqu'un venant à notre rencontre à une allure désordonnée, moitié marchant, moitié courant. En approchant, nous reconnûmes le chef, hors de lui d'émotion, sa chaude couleur habituelle de mulâtre transformée en une pâleur bleuâtre. Il nous croisa sans un mot, sans un geste, nous fixant avec une expression satanique et fonça à travers bois vers les parties inhabitées de l'île et la longue plage déserte où il pourrait rager sans témoins et exhaler sa colère, sa peur et son humiliation. Nul doute que le nom de Kaupoi — l'homme riche, — ne revint fréquemment parmi les malédictions qu'il proféra aux lames bondissantes et aux oiseaux des tropiques. J'avais fait de lui la risée du rivage dans l'affaire des dumplings du Roi; j'avais, par mes machinations, provoqué sa disgrâce et mis ses jours en danger; et finalement, — pour sa plus grande amertume, — il avait fallu qu'il me trouve sur son chemin pour cracher sur lui à l'heure de la plus grande confusion !
Le temps passa, et nous n'entendîmes plus parler de lui. Le moment de la pleine lune était venu où dormir semble une honte ! — et je m'attardai — jusqu'à minuit ou une heure du matin environ — à errer sur le sable brillant, dans l'ombre balancée des palmes. Tout en marchant, je jouais du flageolet, ce qui absorbait mon attention. Les éventails bruissaient au-dessus de ma tête avec un tintement métallique ; et le bruit d'un pied nu sur ce sol mouvant est impossible à saisir. Pourtant, quand je revins à Equateur-Ville où toutes les lumières étaient éteintes, et que ma femme (qui ne dormait pas encore et m'avait suivi des yeux) me demanda qui donc m'accompagnait, je crus qu'elle plaisantait. « Pas le moins du monde », dit-elle ; — « je l'ai vu deux fois tandis que vous passiez, marchant sur vos talons. Il ne vous a lâché qu'au coin du maniap' ; Il doit être encore derrière la maison du chef. » J'y courus — comme un fou, sans aucune arme, — et me trouvai face à face avec le cook. Il était dans mon enceinte tabou, ce qui déjà méritait la peine de mort ; il ne pouvait avoir là rien à faire que voler ou tuer ; la conscience de sa faute le rendait timoré; et, me tournant le dos, il s'enfuit devant moi, dans la nuit, en silence. Comme il allait, je lui allongeai un coup de pied dans cette partie où réside l'honneur et il donna de la voix, faiblement, comme une souris blessée. J'ose dire qu'à cet instant, il se crut certainement atteint par un instrument mortel.
Quel avait été son but ? J'ai toujours vu ma musique plus apte à disperser un auditoire qu'à le retenir ! Vu mon talent d'amateur, je ne pouvais croire qu'il prit quelque intérêt à m'entendre déchiffrer Le Carnaval de Venise, ni qu'il ne fût arraché à son repos pour suivre mes variations sur Le Laboureur. Et quel que fût son dessein, je ne pouvais admettre qu'il rodât ainsi la nuit autour des habitations. Un mot du Roi et l'homme n'était plus, son cas était impardonnable. Mais tuer un homme soi-même est une chose ; se plaindre de lui. dans son dos, et le faire tuer par un tiers en est une autre ; et je décidai d'en finir avec l'individu grâce à une méthode de ma façon.
Je contai l'histoire à Ah-Fu et le priai de m'amener le cuisinier dès qu'il pourrait le saisir. J'avais cru que ce serait-là une grande difficulté ; loin de là. il vint de son propre gré : ce qui semblait vraiment un acte désespéré, étant donné que sa vie dépendait de mon silence et que ce qu'il pouvait espérer de mieux était l'oubli ! Il se présenta cependant avec une contenance assurée, ni risqua aucune défense ni aucune explication, se plaignit d'avoir été injurié et prétendit qu'il lui était impossible de s'asseoir. Je crois être l'homme le plus faible que Dieu ait jamais créé; je l'avais atteint dans la partie la moins vulnérable de sa forte carcasse ; j'étais pieds nus et je ne m'étais pas même fait mal au pied ! Ah-Fu ne pouvait contenir son hilarité. Quant à moi, sachant de quelle nature devaient être ses appréhensions, je trouvai qu'une telle impudence touchait à l'héroïsme et j'admirais en moi-même le personnage. Je lui dis que je ne rapporterais rien au Roi de son aventure de la nuit ; que je continuerais à l'autoriser, lorsqu'il aurait une commission à faire, de franchir l'enceinte de mon tabou durant le jour : mais que, si jamais je le rencontrais là après le coucher du soleil, je le tuerais sur place; et je lui montrai un revolver comme argument à l'appui. Nul doute qu'il ne ressentit un soulagement inexprimable ; mais il n'en montra rien, se retira avec sa nonchalance habituelle et nous ne le vîmes désormais presque plus.
Ainsi donc, ces cinq serviteurs, avec la substitution du stewart au cuisinier, allaient et venaient et étaient nos seuls visiteurs. Le cercle du tabou tenait à distance les habitants du village. Quant à « ma pamille », elles étaient comme des religieuses, cloîtrées dans leur enclos ; une seule fois j'en rencontrai une : c'était la sœur du Roi, et le lieu où je la rencontrai (l'infirmerie de l'île), était probablement un lieu privilégié. Il me reste à parler du Roi. Il avait l'habitude de venir en flânant, toujours seul, un peu avant l'heure du repas, prenait une chaise et causait en mangeant avec nous comme un vieil ami de la famille.
La façon de prendre congé semble être le point défectueux de l'étiquette des îles Gilbert. On se souvient des difficultés que nous avions, à ce propos, avec Karaïti ; et il y avait quelque chose de puéril et de déconcertant dans le brusque : « J'ai besoin de rentrer maintenant » de Tembinok', accompagné d'une sorte de plongeon et suivi d'une retraite précipitée. C'était le seul défaut de ses manières qui, en dehors de cela, étaient simples, convenables, sensées et dignes. Il ne restait jamais longtemps, ne buvait pas trop et s'appliquait à copier ce qui, dans notre conduite, lui semblait différer de la sienne. C'est ainsi, par exemple, qu'il cessa de très bonne heure de manger avec son couteau. Il était décidé, c'était clair, à tirer profit de notre visite, sur toutes choses et principalement sur les points d'étiquette. La qualité de ses blancs visiteurs l'intriguait et le préoccupait; il les nommait l'un après l'autre, demandant s'ils étaient « un grand chef » ou même un « chef » tout court, — ce qui ne laissait pas d'être embarrassant, quelques-uns étant mes chers et excellents amis et aucun d'entre eux n'étant né dans la pourpre ! Il fut surpris d'apprendre que chez nous, les classes se distinguent par leur façon de s'exprimer et qu'ainsi (par exemple), certains mots sont tabou sur le pont d'un cuirassé ; et il nous pria en conséquence de l'éclairer et de le corriger sur ce point. Nous pûmes l'assurer qu'il n'avait besoin d'aucune correction. Son vocabulaire est étendu et adéquat à un degré rare. Dieu sait où il l'a ramassé; mais, par quelque instinct ou quelque hasard, il a su éviter toutes les expressions profanes ou grossières. « Obligé », « poignardé », « renifler », « loger », « pouvoir », « compagnie », « svelte », « poli », et « merveilleux » sont parmi les termes inattendus qui enrichissent son dialecte. Mais rien ne lui plut autant que l'idée de baiser le pont d'un cuirassé. Dans sa gratitude pour cette indication, il devint lyrique. « Schooner cap'n no tell me », criait-il ; *« I think no tawy ! You tavoy too much ; tavvy 'teama, tavvy man-a-wa'. I think you tavvy everything ! » Cependant, il ne laissait pas que de m embarrasser assez souvent avec ses perpétuelles questions.
Je me souviens d'un incident en particulier. Nous donnions une séance de lanterne magique ; un film de Windsor passa et je lui dis que c'était « the outch »1 (1. La demeure.) de Victoria. « Quelle est sa hauteur ? » demanda-t-il, et je restai muet devant lui. C'était le constructeur, l'infatigable architecte de palais qui avait parlé ; collectionneur comme il l'était, il ne collectionnait pourtant pas d'informations inutiles et toutes ses questions avaient un but. Après les questions d'étiquette, le gouvernement, les lois, la police, l'argent et la médecine, étaient ses sujets préférés, — sujets d'une importance vitale pour lui en tant que Roi et Père de son peuple. Je m'attachai non seulement à lui fournir de nouvelles informations, mais aussi à corriger les anciennes. Tous ses discours débutaient ainsi : « Mon père, il m'a dit »; ou « homme blanc, il m'a dit », — « Vous croire il ment ?» Je le pensais quelquefois, en effet. Tembinok' me soumit une fois une difficulté de ce genre que je mis longtemps à élucider. Un capitaine de goélette lui avait parlé du capitaine Cook; l'histoire avait vivement intéressé le Roi ; il s'enquit de détails supplémentaires, — non pas dans le Dictionnaire de Mr. Stephen, non dans le Britannica, mais bien dans la version insulaire de la Bible, qui consiste surtout dans le Nouveau Testament et les Psaumes ; il y trouva Paul et Festus.et Alexandre le chaudronnier : pas un mot de Cook. La conclusion fut évidente : l'explorateur était un mythe. Tant il était difficile, même à un homme très doué, comme l'était Tembinok', de réaliser les idées d'une société et d'une culture nouvelles.
chapitre v
Le Roi et le peuple
Nous vîmes peu les gens de l'Ile. Au début, nous les rencontrions à la fontaine où ils lavaient leur linge et où nous puisions notre eau de table. La combinaison était détestable et, ayant un tyran à nos ordres, nous nous adressâmes au Roi et obtînmes de lui la permission d'enclore l'endroit dans notre tabou. C'est une des rares faveurs que Tembinok' hésita à nous accorder, et on conçoit combien elle contribua à rendre les étran" gers impopulaires. Beaucoup d'habitants du village passaient chaque jour devant nous en se rendant aux champs ; mais ils faisaient un grand détour autour de notre tabou et affectaient de détourner les yeux. De temps en temps, nous allions nous-mêmes au village, — étrange endroit. Hollandais par ses canaux, oriental par la hauteur et la pente abrupte de ses toits qui, au crépuscule, ressemblaient à des temples ; mais on nous invitait rarement à entrer dans une maison; nous ne rencontrions ni bienvenue ni amitié ; et, de leur vie d'intérieur, nous n'eûmes que cette seule vision : la veillée d'un mort, triste et lugubre tableau : la veuve tenant sur ses genoux le corps glacé et bleuissant de son époux et, tantôt prenant sa part des rafraîchissements qui faisaient le tour de la compagnie, tantôt pleurant et baisant la bouche décolorée. (« Je crains que vous ne soyez dans une affliction profonde », disait le ministre écossais. — « Ah ! sir, vous dites vrai ! » répliquait la veuve ; « j'ai pleuré toute la nuit ; maintenant je vais à peine manger un tout petit peu de porridge et après, je recommencerai à pleurer. ») J'ai toujours supposé que les insulaires nous évitaient, au cours de nos promenades aux environs, soit par dégoût, soit parce qu'ils en avaient reçu l'ordre ; et, quand nous en rencontrions quelques-uns, c'était généralement par surprise. La surface de l'île est couverte d'une végétation variée, composée de bouquets de palmiers, de fourrés et de vallons romantiques, profonds de quatre pieds, vestiges des anciennes plantations de taro ; et l'on peut ainsi tomber à l'improviste sur des gens au repos ou négligeant leur ouvrage. A une portée de fusil environ de notre commune, une mare s'étendait au bout de la jungle ; les jeunes filles de l'île venaient s'y baigner et furent plusieurs fois alarmées par notre arrivée. Ce n'est pas pour elles que sont les fraîches et brillantes rivières de Tahiti ou de Upolu, ni les rires et les ébats joyeux, à l'heure du crépuscule, avec tous les gais compagnons du village ; il leur faut venir là, à la dérobée et se vautrer et se laver (si cela peut s'appeler se laver), dans une boue tiède, aussi brune que leur peau. D'autres rencontres, mais toujours rares, me reviennent à la mémoire. J'avais été plusieurs fois arrêté par un tendre son de voix, parlant dans le taillis, douces comme des flûtes et avec de suaves intonations. Déjà mon imagination partait... j'écartai les feuilles et, voyez ! au lieu des dryades attendues, j'aperçus deux solides vieilles dames, accroupies avec une pipe de terre et revêtues du disgracieux ridi. La beauté de la voix et des yeux était tout ce qui restait à ces vastes dames ; mais celle de la voix était vraiment exquise. Et n'est-ce pas étrange que j'aie entendu le parler de la plus prenante douceur dans ce dialecte qui est remarquable pour ses consonances rauques, désagréables et grossières; au point que Tembinok' lui-même disait que sa langue le fatiguait et que c'était un repos pour lui de parler anglais.
Quant à la condition de ce peuple, j'en ai vu si peu de chose que je ne puis guère que la deviner. Le Roi lui-même explique la situation non sans art. « Non, je ne les paye pas », nous dit-il une fois ; « je leur donne du tabac. Ils travaillent pour moi comme des frères. » Ils ont tous les caractères de la servilité — une insouciance d'enfants, une incurable paresse, un placide contentement d'eux-mêmes. L'insolence du cuisinier est un trait qui lui était propre ; mais non son insouciance qu'il partageait avec l'innocent oncle Parker. Tous deux, avec la même indifférence, gambadaient à l'ombre de la potence et prenaient avec la mort des libertés qui auraient surpris un psychologue superficiel. J'ai dit de Parker qu'il se conduisait comme un enfant de dix ans : qu'était-il de plus, étant un esclave de soixante ? Il avait passé toute sa vie à l'école, nourri, habillé, n'ayant qu'à obéir et sans penser à rien ; la crainte des punitions lui était familière et il était en coquetterie avec elle. On mène les hommes longtemps par la terreur, mais on ne les mène pas loin. Ici, à Apemama, ils travaillent au péril constant et immédiat de leurs vies et sont plongés dans une sorte de paresse léthargique. On voit couramment l'un ou l'autre s'en aller aux champs dans sa natte raide, sans ceinture, et obligé de marcher les coudes au corps, comme un poulet ficelé ; et quoique sa main droite puisse avoir à faire, l'autre est forcée de s'employer à maintenir son vêtement. On voit fréquemment des hommes se mettre à deux pour porter sur une perche un unique seau d'eau. Que l'on fasse deux parts d'une cerise, passe encore ; mais se mettre à deux pour porter la charge d'un soldat, sur une distance d'environ deux cents mètres, dépasse toute mesure. La femme, étant le moins puéril des animaux, est moins avachie par la servilité. Même en l'absence du Roi, même livrées à elles-mêmes, j'ai vu les femmes d'Apemama travailler consciencieusement. Mais d'un homme, le plus qu'on doive espérer, est qu'il se mette à sa besogne par de courts accès languissants et qu'il se promène entre temps. Ainsi ai-je vu un peintre, fumant sa pipe avec un ami au coin du feu de son atelier. On pourrait croire que la race manque de politesse, voire de vitalité, jusqu'au moment où on les voit danser. Nuit après nuit et parfois jour après jour, ils déroulaient leurs choeurs dans le Grand Parlement, — solennels andantes et adagios, rythmés par le claquement des mains, et clamés avec une énergie qui ébranlait la toiture. La mesure n'était pas extrêmement lente, quoiqu'elle fût lente pour les îles, mais j'ai surtout noté l'effet qu'elle produisait sur l'auditeur. Leur musique avait, entendue de près, un caractère religieux et paraissait, à l'oreille d'un Européen, plus régulière que la musique habituelle des îles. Deux fois, j'ai entendu une dissonance se résoudre régulièrement. Entendues de plus loin, d'Equateur-Ville, par exemple, les mesures s'élevaient et retombaient et crépitaient comme des abois de chiens dans un chenil éloigné.
Les esclaves ne sont pas surmenés — des enfants de dix ans en font plus sans fatigue, — et les travailleurs d'Apemama ont congé quand les chants doivent commencer de bonne heure dans l'après-midi. Le régime est sévère : le copra et un entremets de pandane pilé sont les seuls mets que j'aie rencontrés en dehors du palais ; mais on ne leur mesure pas la quantité et le Roi partage ses tortues avec eux. Il en arriva trois durant notre séjour, dans un bateau de Kuria ; on en garda une pour le palais ; la seconde nous fut envoyée; la troisième offerte au village. Les insulaires ont l'habitude de faire cuire les tortues dans leur carapace ; comme on nous avait promis celles-ci, nous demandâmes un tabou sur cette pratique absurde. La figure de Tembinok s'assombrit et il ne répondit rien. J'avais compris
sans hésitation dans la question de la fontaine, l'eau étant rare sur une île basse ; mais qu'il refusât d'intervenir dans un détail purement culinaire dépassait ma compréhension ; je supposai (à tort ou à raison), qu'il se faisait scrupule de toucher en quoi que ce soit à la vie privée et aux habitudes de ses esclaves. Comme quoi, jusque là-bas, en plein despotisme, l'opinion publique a du poids ; jusque-là, en plein esclavage, la liberté revendique ses droits.
Régulière, sobre et innocente, la vie s'écoule dans l'île, jour après jour, comme dans une plantation modèle sous un planteur modèle. Les bienfaits de cette règle sévère sont indiscutables. Une politesse curieuse, des manières douces et gracieuses, quelque chose d'efféminé et courtois tout ensemble, distingue les insulaires d'Apemama ; tous les négociants le remarquent ; des résidents, même aussi peu aimés que nous l'étions, en avaient conscience jusque chez le cuisinier et même aux heures de la pire insolence de ce gredin. Le Roi, avec sa tenue simple et virile, était seul en vedette ; il semblait le seul insulaire des Gilbert dans Apemama. Les actes de violence, si communs à Butari-tari, y semblent inconnus. Tels y sont le vol et l'ivrognerie. On m'a assuré qu'on avait fait l'expérience de laisser des souverains sur la plage, devant le village : personne n'y toucha. Une seule fois, pendant tout notre séjour dans l'Ile, on me demanda de quoi boire. Et celui qui me le demanda était un grand et vigoureux garçon, portant des vêtements européens et parlant un anglais excellent ; — Tamaïti était son nom, et plu tôt; comme l'ont transformé les blancs. « Tom White » : il était l'un des subrécargues du Roi, à trois pounds par mois, plus le pourcentage ; vaguement médecin pardessus le marché et sorcier à ses moments perdus. Il me rencontra un jour sur les confins du village dans un endroit solitaire, chaud et privé, où les sillons de taro sont profonds et les plantes élevées. Il me prit par le bouton de ma veste et, jetant tout autour de lui des regards de conspirateur, il me demanda si j'avais du gin ?
Je lui dis que j'en avais. Il observa que le gin était prohibé, loua cette proscription pendant quelque temps, puis commença à m'expliquer qu'il était un docteur, un « dogstar », comme il disait, que le gin lui était nécessaire pour ses infusions médicales, qu'il n'en avait plus du tout et qu'il me serait bien obligé de lui en donner un petit flacon. Je lui dis que j'avais donné ma parole au Roi en venant à terre, de ne jamais en procurer à personne ; mais que, devant un cas aussi exceptionnel que le sien, j'allais me rendre de suite au Palais et ne doutais pas que Tembinok' ne me dégageât de ma promesse. Aussitôt, Tom White fut bouleversé par le trouble et la terreur, me supplia dans les termes les plus pathétiques de ne pas le trahir et s'empressa de fuir mon voisinage. Il était loin d'avoir la bravoure du cuisinier ; des semaines se passèrent sans qu'il osât se montrer à mes yeux ; et il ne le fit plus que par un ordre du Roi ou pour quelque affaire particulière.
Plus je constatais et admirais le triomphe d'une règle sévère, plus j'étais hanté et troublé par un problème, le problème de demain (peut-être) pour nous-mêmes ? Je voyais là un peuple à l'abri de toute sérieuse infortune, débarrassé de toute anxiété grave, et privé de ce que nous appelons notre liberté. En étaient-ils satisfaits? et quelle sorte de sentiment leur inspirait leur maître ? Il m'était difficile de leur poser la première question, et à eux, peut-être, d'y répondre. La seconde, elle-même, était délicate ; à la fin, pourtant, et dans des circonstances aussi charmantes qu'étranges, je trouvai une occasion de la poser et un homme pour y répondre. C'était peu avant la pleine lune et la brise était délicieuse ; l'île était aussi claire qu'en plein jour — dormir eût été sacrilège, et j'errais dans le fourré — jouant de la flûte. Sans doute est-ce le son de ce qu'il me plaît d'appeler ma musique qui attira dans ma direction un autre promeneur nocturne. C'était un jeune homme vêtu d'une fine natte, les cheveux ornés d'une guirlande, car il venait de danser et de chanter dans la salle publique ; son corps, son visage, ses yeux étaient d'une beauté parfaite. On trouve à chaque instant, dans les Gilbert, des jeunes gens d'une aussi absurde perfection. J'ai vu, un jour, cinq d'entre nous rester une demi-heure en admiration devant un garçon de Mariki ; et déjà, j'avais plusieurs fois remarqué Te-Kop (mon ami à la fine natte et à la guirlande) et l'avais depuis longtemps classé comme un des plus charmants animaux d'Apemama. Le filtre de l'admiration est, sans doute, bien puissant, ou bien ces naturels sont particulièrement sensibles à ses effets, car j'ai rarement admiré un habitant quelconque des îles qu'il n'ait de suite sollicité mon amitié. Ainsi fit Te-Kop. Il me mena au bord de l'océan, et pendant une heure ou deux, nous demeurâmes assis là, devisant et fumant, sur le sable resplendissant et sous l'ineffable éclat de la lune. Mon ami se montrait très sensible à la beauté et à la douceur de l'heure. « Belle nuit ! beau vent ! » s'écriait-il sans cesse. Il y a bien longtemps, j'avais inventé des expressions d'enchantement pareillement répétées pour un caractère (celui de Felipe, dans Olalla), que je voulais rendre en partie bestial. Mais il n'y avait rien de bestial en Te-Kop ; rien que le plaisir puéril d'un moment. Il se montrait également satisfait de son compagnon et avait la bonté de me le dire ; il me fit, avant de me quitter, la faveur de m'appeler Te-Kop ; m'apostropha comme « mon nom » avec une intonation d'une tendresse exquise, posant sa main doucement sur mon genou ; et après nous être levés, comme nos sentiers commençaient à se séparer dans le fourré, par deux fois il me cria avec une sorte de gentille extase : « Je vous aime trop ! » — Dès le début, il n'avait fait aucun mystère de la terreur que lui inspirait le Roi ; il ne s'assit et ne se risqua à parler, et encore à voix basse, que lorsqu'il eût mis toute la largeur de l'île entre lui et son monarque alors endormi et inoffensif; et jusque-là, à une portée de pierre de la grande mer, nos voix couvertes par le bruit des vagues et le tumulte du vent dans les palmiers, il continuait à parler en sourdine, adoucissant sa voix argentée (qui s'élevait assez haut dans les chœurs), et regardait tout autour de lui comme un homme qui se croit espionné. Le plus étrange de la chose est que je ne le revis jamais. Dans n'importe quelle autre île des mers du Sud, si je m'étais avancé à moitié autant avec un naturel, dès le lendemain matin il eût été à ma porte, m'apportant des présents et espérant en recevoir. Mais Te-Kop, disparut dans la brousse pour toujours. On ne pouvait, c'est vrai, approcher de ma maison ; mais il savait où me trouver sur la grève de l'océan où j'allais tous les jours. J'étais le kaupoi, l'homme riche ; mon tabac et mes provisions passaient pour être inépuisables : il était sûr d'avoir un cadeau. Je me perds en conjectures sur sa conduite, à moins d'admettre qu'il se souvînt avec terreur et regret d'un passage de notre conversation. Voici quel était ce passage :
— « Le Roi, lui brave homme ? » demandai-je.
— « Supposez lui aime vous, lui bon homme, — répliqua Te-Kop ; — pas vous aimer, pas bon. »
C'est une manière de voir, évidemment. Il ne semble pas que Te-Kop lui-même fût un favori ; car il ne me parut pas représenter un travailleur modèle ! Et il doit y en avoir beaucoup d'autres que le Roi « n'aime pas > (pour adopter cette formule). Ces malheureux aiment-ils le Roi ? ou plutôt, la répulsion n'est-elle pas réciproque ? et le consciencieux Tembinok' de même que le consciencieux Brasfield, avant lui, et bien d'autres juges et législateurs consciencieux avant eux, ne sont-ils pas entourés d'une masse d'éternels mécontents ?
Prenez par exemple le cuisinier, quand il passa devant nous, bleu de rage et de terreur. Il était très irrité contre moi ; je crois, d'après tous les plus vieux principes qui régissent la nature humaine, qu’il n’était pas très satisfait de son souverain. C'est contre l'homme riche qu'il dressa ses embûches ; je crois qu'il ne s'en était fallu que d'un cheveu qu'il ne les dressât contre le Roi. Et le Roi en donne, ou semble en donner, de nombreuses occasions ; jour et nuit, il se promène tout seul, avec ou sans armes, je ne sais ; et les champs de taro, où l'appellent si souvent ses affaires, semblent un lieu d'assassinat tout désigné. Le cas du cook pesait réellement sur ma conscience. Je ne pouvais supporter l'idée de faire tuer mon ennemi par un tiers ; mais, avais-je le droit de dissimuler au Roi qui m'avait donné sa confiance, le caractère ignoré et dangereux de son serviteur ? Et supposez que le Roi fût tué, quel serait le sort réservé à ses amis ? Notre opinion avait toujours été que nous payerions cher la clôture de la fontaine et que notre vie était entre les mains du Roi ; que si, par hasard, le Roi était, un beau jour, assommé dans un champ de taro, les habitants tant philosophes que musiciens d'Equateur-Ville n'auraient qu'à mettre de côté leurs instruments d'agrément et se nantir de tous les moyens de défense à leur portée, car même alors leurs chances de succès resteraient douteuses. Ces réflexions nous furent suggérées par un incident que je trahis à ma honte. La goélette H.-L-.Haseltine (qui depuis s'est perdue en mer avec onze hommes) aborda à Apemama à un moment très favorable pour nous qui étions presque au bout de nos provisions. Le Roi, fidèle à son habitude, passait toutes ses journées à bord ; le gin se trouvait malheureusement à son goût ; il en rapporta une provision à terre ; et pour quelque temps, le tyran de l'île se montra à moitié gris. Il n'était pas positivement ivre, — l'homme n'est pas un 'ivrogne ; il a toujours des provisions de liqueur à portée de la main, dont il use avec modération — mais il était muet, dolent et confus. Il vint un jour déjeuner avec nous et s'endormit sur sa chaise pendant qu'on mettait le couvert. Sa confusion, lorsqu'il se réveilla et se vit découvert, n'eut d'égale que notre embarras. Quand il ne fut plus là, nous restâmes assis, parlant des périls auxquels il s'exposait et qui, en quelque sorte, nous menaçaient aussi ; avec quelle facilité il pouvait, dans cet état, être surpris par des « gromble to mans » ; des scènes terribles qui suivraient — le trésor royal et les magasins à la merci de la populace, le palais envahi, la garnison de femmes abandonnée sans ressources. Et voilà que pendant que nous causions, un coup de fusil et un cri brusque et sauvage nous firent sursauter. Je crois que tous nous changeâmes de couleur ; mais ce n'était que le Roi faisant feu sur un chien et un écho des chœurs qui se chantaient dans le Parlement. Un ou deux jours après, j'appris que le Roi était très souffrant ; je me rendis auprès de lui et diagnostiquai le cas ; j'acquis instantanément à ses yeux les plus hautes capacités médicales en lui administrant du bicarbonate de soude. Sur l'heure Richard redevenait lui-même ; je le retrouvai dans la maison inachevée, jouissant du double plaisir de diriger Rubam et de dîner avec un chausson aux noix de coco, et très anxieux d'avoir la formule de cette nouvelle espèce de tueur de peine, — car tueur de peine est, aux îles, le nom générique donné à tous les médicaments. Ainsi se terminèrent la modeste bombance du Roi et notre inquiétude.
D'après toutes les apparences, je dois dire que le loyalisme paraissait inébranlé. Quand la goélette revint enfin, après avoir essuyé de bien mauvais temps. elle nous apporta la nouvelle que Tebureimoa avait déclaré la guerre à Apemama. Tembinok', subitement, devint un autre homme; sa figure s'illumina ; son attitude, un jour que je le vis présider un concile de