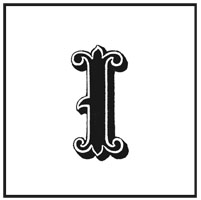
I
La conquête de l’indépendance politique par le Mexique ne peut pas se séparer des autres mouvements qui, pour des raisons souvent similaires, secouent le vieil empire colonial espagnol. Ainsi Simon Bolivar, El Libertador, né en 1783, obtient à la même époque l’indépendance du Venezuela et plus tard de la Colombie. Quant aux États-Unis, les voisins du Nord, ils ont proclamé leur indépendance en 1776, mené une lutte victorieuse contre l’Angleterre et promulgué en 1787, deux ans avant la prise de la Bastille, la première constitution démocratique, toujours en vigueur aujourd’hui, véritable texte sacré américain.
En fait, vers la fin du XVIIIe siècle, l’Amérique tout entière est en train de se détacher de l’Europe comme une énorme chaloupe quittant le vaisseau amiral. Tout un continent prend le large. Au Mexique, le mécontentement s’est clairement manifesté dès le début du XVIIIe siècle. Outre les différences de conditions de vie qui séparent les Indiens, totalement assujettis, avec statut d’esclaves, des colons blancs, ceux-ci, au sommet de l’échelle sociale, se séparent entre peninsulares, nés en Espagne, très conservateurs, qui tiennent le haut du pavé, occupant tous les postes élevés de l’administration centrale, et criollos, nés au Mexique de parents espagnols. Ces derniers, de plus en plus nombreux et de loin les plus entreprenants, supportent mal la tutelle lointaine et exigeante de Madrid, dont ils ne comprennent pas la nécessité, dont ils contestent la légitimité.
Malgré quelques tentatives de réforme assez bien venues, la bureaucratie espagnole, disent-ils, les étouffe, les harcèle. Ils estiment excessifs et injustifiés les prélèvements de la « métropole », d’autant plus que l’Espagne, dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, est un royaume affaibli, quelque peu attardé dans la marche des siècles, où l’Inquisition n’a pas été abolie, où les religions autres que la catholique romaine sont encore strictement prohibées, où les idées libérales des philosophes anglais et français, et surtout celles qui naissent chaque jour de la Révolution française, sont interdites d’accès (même si les contrebandiers se chargent de les faire pénétrer en douce).
L’expulsion du Mexique des Jésuites, pour la plupart des criollos, renforce cette grogne, cette incompréhension, ce désir d’autre chose.
Des mots comme « liberté, progrès, nation » commencent à apparaître. Et même, on ose les imprimer. Les esprits éclairés, les ilustrados du Mexique, reçoivent des livres d’Europe. Ils lisent, ils se réunissent, ils parlent.
De moins en moins ils se sentent espagnols. Le lien ancien, originel, s’est rompu.
À souligner que cet isolement volontaire de l’Espagne, qui ne veut rien voir et rien entendre, n’est pas le fait des hauts personnages des territoires coloniaux. Simon Bolivar, par exemple, a fait le voyage à Paris. Il a rencontré des intellectuels, il a lu Rousseau et Condorcet. Il a même vu Napoléon entrer à Notre-Dame pour s’y faire couronner, en 1804. D’une certaine manière, on peut dire que les idées nouvelles, qui s’affirment justes et universelles, traversent plus facilement l’Atlantique que les Pyrénées.
Autre fait surprenant : tout en s’efforçant, contre vents et marées, de maintenir la suprématie espagnole sur le Nouveau Monde, le roi Charles IV, en 1805, 1806 et 1807, commandite trois expéditions archéologiques (parmi les premières) qu’il confie au capitaine Dupaix. Ces expéditions difficiles, qui embarquaient un dessinateur nommé Castañeda, s’intéressaient surtout au site de Mitla, dans la région d’Oaxaca, et à celui de Palenque, dans le Chiapas. Elles furent brutalement interrompues par le début des insurrections qui devaient conduire à l’indépendance.
Plus tard, en 1828, un voyageur français, Henri Baradère, obtint du gouvernement mexicain une copie du journal de Dupaix et les dessins de Castañeda. L’ensemble devait être publié à Paris.
La défaite de Trafalgar, en 1805, a détruit une grande partie de la flotte de guerre espagnole, limitant les possibilités d’intervention dans les territoires lointains. L’invasion de l’Espagne par Napoléon en 1808 (une décision qu’il devait regretter) et l’installation sur le trône de son frère Joseph Bonaparte, en discréditant encore un pouvoir central déjà usé par la routine, la crainte des mouvements nouveaux, le désintérêt (aucun souverain espagnol n’a jamais daigné traverser l’océan pour aller visiter en personne les immenses terres du Nouveau Monde – le premier sera Juan Carlos au XXe siècle, lorsque tous ces pays seront indépendants depuis longtemps) et les intrigues, rivalités marchandes, insurrections locales et conspirations de toutes sortes, vont précipiter les choses.
Au début l’invasion de l’Espagne, la déposition des Bourbons et la nomination abrupte d’un nouveau roi, d’un roi qui n’est pas noble et qui n’est pas espagnol, sont choses si surprenantes que les responsables mexicains (pour la plupart des peninsulares d’origine espagnole) se posent mille questions : faut-il obéir au roi déchu ? Au nouveau roi héréditaire, Ferdinand, désigné par son père Charles IV, qui lui-même vient d’abdiquer ? Faut-il se rallier à ce Bonaparte inconnu qui vient du royaume de Naples ?
Ou bien faut-il profiter de ce cadeau de l’histoire pour attraper au vol l’autonomie ?
Dès 1808 – sans doute la très dure sècheresse qui frappa le Mexique dans ces années-là a-t-elle aussi joué un rôle –, des protestations publiques vigoureuses éclatent à Valladolid, dans l’État de Michoacan, avec même une tentative de coup d’État, qui se calme assez vite. En 1810, c’est une rébellion véritable, armée (parfois de pics, de fourches et de socs de charrue), populaire, qui s’engage dans la région de Queretaro. Le 16 septembre de cette année, dans la petite ville de Dolores, un groupe de révoltés, menés par un prêtre et ses paroissiens, Miguel Hidalgo y Costilla (plus simplement appelé Hidalgo), lancent un manifeste resté célèbre sous le nom – qui est un jeu de mots – de Grito de Dolores (« Cri de Dolores », mais aussi « Cri de douleurs »).
Né en 1778, Miguel Hidalgo était auparavant un recteur de collège. Sans doute fut-il dénoncé à l’Inquisition pour lecture de mauvais livres et propos insolents. Il était un personnage tumultueux, parlant haut et fort. On disait aussi qu’il dansait en public et même qu’il entretenait une maîtresse. L’Inquisition, après enquête, se contenta de demander sa mutation. C’est ainsi qu’il se retrouva simple curé dans la petite ville de Dolores.

Leur appel lancé, les insurgés passent à l’offensive, aux cris de « Vive la Vierge de Guadalupe ! Meurent les Espagnols ! ». Hidalgo leur a donné leur premier étendard, qui offre précisément une image de la Vierge de Guadalupe et qui est aujourd’hui pieusement conservé, à Mexico, dans une salle du château de Chapultepec. C’est sous l’emblème de la mère de Dieu, « reine du ciel », qu’ils se révoltent sur cette terre. Ils remportent assez vite une série de victoires spectaculaires, rassemblent une troupe armée et disparate qui compte jusqu’à 80 000 hommes et femmes, s’emparent de Guanajuato après une lutte cruelle et attaquent Guadalajara.
L’évêque excommunie le curé Hidalgo pour « hérésie, apostasie et sédition » mais, quand il voit que la ville va tomber, il se hâte de retirer l’excommunication.
Hidalgo menace même la ville de Mexico – alors la plus grande ville du continent américain –, mais hésite à donner l’assaut final, sans que les historiens puissent comprendre pourquoi. Peut-être craignait-il, disent certains, de voir se reproduire les excès de violence qu’il avait connus à Guanajuato et qu’il désapprouvait. Peut-être, disent d’autres, attendait-il des alliés qui ne sont pas venus, de Toluca par exemple. En tout cas, quelques jours plus tard, bande hétéroclite et désorganisée, marchant avec femmes et enfants, les rebelles sont mis en déroute par des loyalistes disciplinés, et bien commandés par un certain Calleja.
Hidalgo repoussé se réfugie à Guadalajara, où il est reçu avec enthousiasme. Là, loin de s’avouer vaincu, il organise son gouvernement, distribue titres et fonctions, publie un journal qui s’intitule El Despertador Americano (« Le Réveil américain »), abolit l’esclavage et déclare que les terres communales sont exclusivement réservées aux indigènes, c’est-à-dire aux Indiens, qui constituent plus de 60 % de la population.
Retrouvant des accents de Bartolomé de Las Casas, il affirme que les Espagnols ne sont pas de véritables catholiques car ils ne sont au Mexique que pour violer les femmes et exploiter à leur guise le pays tout entier. Aussi ne se sent-il plus redevable d’un devoir d’obéissance au lointain pouvoir de Madrid, tombé aux mains des Français. Ainsi, au mépris des règlements de la Couronne, qui interdisent des cultures pouvant entrer en concurrence avec celles de la métropole, il fait élever des vers à soie, planter des oliviers et des vignes. Il lance des fabriques d’objets en terre cuite, qui sont encore en activité.
Autre décision, celle-ci critiquable (et critiquée) : il fait exécuter des prisonniers espagnols.
Calleja, cependant, marche sur Guadalajara. Le 17 janvier 1811, au lieu-dit pont de Calderon, le curé Hidalgo est battu sévèrement. C’en est fini de lui. Il tente de s’enfuir vers le Nord, il est trahi, arrêté, jugé. Au cours de ses deux procès, il déclare regretter l’exécution des Espagnols qui, dit-il, étaient innocents. Mais il est trop tard. Il est condamné à mort et exécuté.
La tête de Miguel Hidalgo, le prêtre au crâne dégarni et aux longs cheveux gris (dont l’effigie est omniprésente au Mexique), est exposée à Guanajuato, pour servir d’exemple. Elle y restera dix ans. Son crâne est aujourd’hui vénéré dans le monument de l’Indépendance, érigé au centre de Mexico.
Un autre prêtre, élève du premier et doué d’un vrai talent militaire, prend alors la relève. Il s’appelle Jose Maria Morelos y Pavon. L’histoire n’a retenu de son nom que « Morelos », qui est aujourd’hui le nom d’un État du Mexique. Hidalgo et Morelos, deux curas, deux curés, sont les deux héros de l’indépendance. Et les deux martyrs inoubliables. Tous les écoliers mexicains peuvent réciter leurs exploits.
Morelos reprend la lutte (une lutte particulièrement atroce, avec violences et massacres des deux côtés), assiège Mexico, réunit une assemblée à Chilpancingo et fait proclamer – sous le titre de Sentimientos a la nacion – une série de principes qui serviront de première base constitutionnelle, plus tard, au futur État. Parmi ces principes, nous trouvons – déjà – le suffrage universel (bien avant qu’il ne soit instauré en France), mais aussi l’abolition de l’esclavage, la souveraineté populaire et la séparation des trois pouvoirs. Le texte souhaite également des lois égales pour tous, telles qu’elles puissent « modérer l’opulence et l’indigence ».
Morelos, vainqueur à Acapulco mais vaincu à Valladolid, est à son tour fait prisonnier, jugé et fusillé le 22 décembre 1815.
L’Espagne, débarrassée depuis Waterloo de la présence française (Joseph Bonaparte, éphémère roi d’Espagne, a trouvé refuge aux États-Unis, où il va devenir planteur), tente de préserver ce qui peut l’être. Un nouveau vice-roi propose une amnistie générale. Mais le roi Ferdinand VII, incapable de la moindre concession, se montre par ailleurs d’une maladresse et d’une cruauté insignes, au point qu’on l’appellera « le Caligula espagnol ». Personne, là-bas, ne veut de lui. La vieille couronne espagnole a perdu toute espèce d’autorité. Quel usage en ferait-on ? D’ailleurs, en Espagne même, le roi est destitué et incarcéré, puis libéré par les Français en 1823, au terme d’une expédition militaire qu’avait étrangement souhaitée Chateaubriand, alors ministre des Affaires étrangères.
La perte de prestige de la monarchie espagnole ne cesse de s’aggraver. L’indépendance véritable est proche, chacun le sent, qu’il la désire ou non. Le Venezuela est maintenant indépendant. Au Mexique, la lutte reprend, cette fois sous la forme de guérillas harcelantes. Un des guérilleros les plus fameux s’appelle Vicente Guerrero. Il a donné lui aussi, plus tard, comme son ancien chef Morelos, son nom à un État.
En 1821, le général loyaliste Iturbide, un criollo, sentant peut-être que la victoire va changer de camp, rejoint les troupes rebelles. Ce geste décisif va conduire à l’indépendance (vivement souhaitée par les criollos), que le vice-roi espagnol doit accorder cette même année 1821. Un projet, dit « plan de Iguala », prévoit, dans le nouvel État qui s’annonce, la primauté maintenue de l’Église catholique, une monarchie constitutionnelle et l’égalité des droits entre peninsulares et criollos, lesquels la réclamaient depuis longtemps. Pas question dans ce texte, on le voit, d’une république démocratique. Pas encore.
Le « plan de Iguala » est bien reçu et le général Iturbide, en compagnie de Vicente Guerrero, fait une entrée triomphale à Mexico avec guirlandes de fleurs, chœurs de jeunes filles, orchestres et feux d’artifice. Toutes les factions jusque-là opposées paraissent se mettre d’accord et Iturbide, dès 1822, est proclamé empereur sous le titre d’Agustin Ier (c’était son prénom). À peine un an plus tard, il est déposé par une armée rebelle aux ordres d’un homme qui fera longtemps parler de lui, le général Santa Anna, qui se « prononce » contre lui au mois de décembre, à Vera Cruz.
Iturbide menacé décide de s’embarquer avec sa famille et il choisit l’Italie pour son exil. S’il revient au Mexique, il y sera exécuté. Prudence et oubli.
En 1824 – pour faire vite –, un nouveau texte constitutionnel est promulgué, créant, puisque la tentative monarchique, et même impériale, a échoué, les Estados Unidos Mexicanos. Il s’agit cette fois d’une République fédérale, groupant 19 États, 4 territoires et un district fédéral. Le premier président de la république du Mexique s’appelle Guadalupe Victoria.
Il était temps. Le pays n’en pouvait plus. Des années de luttes désordonnées et de pillages laissaient des mines abandonnées, des champs incultes, des greniers vides, un commerce extérieur paralysé, des populations mal réconciliées. C’est dans une atmosphère souvent proche de la misère que les nouveaux États-Unis du Mexique s’installent parmi les nations. Le Mexique portera longtemps cette marque d’une naissance dans la douleur.
Voir aussi : Époque coloniale, Guanajuato, Révolution mexicaine, Santa Anna.