Chapitre II - LA CITÉ IMPÉRIALE (VIIIe-XIIe SIÈCLE)
Produit d'une imitation plus volontaire souvent que réfléchie, voué tout entier à la centralité (la création d'une capitale) et à l'uniformité (par la rédaction de codes appliqués idéalement partout), l'État antique, du fait de son caractère systématique, se présente davantage, en ses débuts, comme un objet statique à décrire, que comme un rapport de force dynamique à analyser.
I. - Les institutions
La capitale (kyo) fut plusieurs fois déplacée et reconstruite en des sites variés durant les VIIe et VIIIe siècles. À partir de la fondation de Heijo-kyo (Nara), en 710, cette mobilité diminua. Elle prit fin lors de la fondation de Heian-kyo, en 794. Plusieurs codes furent compilés. Mais seul celui de Yoro (daté de 718) est conservé. Toutefois dans ses deux manifestations, le sens des changements resta identique.
1. La capitale. - Il s'agit certes d'une agglomération urbaine qui finit par être considérable, mais destinée dès l'origine à rester unique (d'où l'emploi du singulier), parce que la centralisation impliquait l'unicité. Devaient y résider, outre l'empereur et sa parenté, les aristocrates devenus tous des fonctionnaires et formant la Cour. Les gardes, les domestiques, les artisans n'y séjournaient qu'en proportion de l'utilité de leur présence ; les moines en fonction de leurs liens avec le pouvoir.
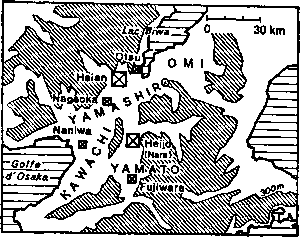
Fig. 2. - Les capitales antiques
Le plan était emprunté à la Chine :
quadrangulaire, avec recoupement d'artères nord-sud et est-ouest,
mais traversé par une large voie axiale nord-sud, longue, dans les
deux derniers sites, Heijo (Nara), puis Heian, de 4,7 km, terminée,
au nord, par le Palais impérial, au sud, par la porte rajomon. Cependant en Chine ce type de
cité était protégé par des remparts. Au Japon, la sécurité l'en
dispensait.
La mobilité des sites eut plusieurs causes. Les
interdits venus du shinto -
l'obligation de fuir la souillure de la mort, lors du décès du
souverain -, longtemps importants, furent effacés ensuite par le
bouddhisme. La Cour dut compter aussi avec la répartition
géographique des uji, dont
elle émanait, ainsi qu'avec le problème des ressources et de la
main-d'œuvre (des dizaines de milliers de corvéables) venues des
provinces. La capitale fut déplacée au cours de la vie d'un même
empereur : une explication trop simple est à écarter. On verra
que, dans le cas de Heian, le souci d'éviter la pression des
monastères fut décisive.
2. Les codes. - Ils comprenaient un droit
pénal (ritsu), un droit
constitutionnel (ryo), des
lois complémentaires et des règles d'application. L'abrégé
ritsu. ryo. seido évoque en
fait le système (seido)
politique lui-même.
On peut y voir une tentative d'étatisation absolue,
accompagnée cependant, dès l'origine, de tels correctifs, que la
volonté de renforcer les privilèges hérités du Yamato semble en
avoir été l'inspiration.
A) Le travail, la terre, la production sont
entièrement contrôlés, grâce à une extension à toute la population
des registres de familles et du recensement des outils, et à tout
le territoire d'un cadastre connu, mais d'un usage limité au
VIe siècle. Jardins et terrains bâtis, cependant, sont
laissés à leurs occupants. Dans chaque catégorie sociale reconnue,
les individus étaient classés selon leur sexe et leur âge. Toutes
les rizières (den) étant
publiques (koden), chaque
sujet recevait une part (kubun) de surface, pour sa
subsistance, adaptée à son statut.
D'où le nom de ces rizières, kubunden, appelées aussi handen (rizières de redistribution), le
sol cultivable étant révisé tous les six ans. L'impôt foncier ne
dépassait pas 3 % de la récolte. Les charges les plus lourdes
(livraison de produits, par exemple textile, et corvées) pesaient
sur les personnes.
B) Dans les provinces, les kuni furent changés, afin de faire oublier les anciens cadres politiques. Un gouverneur (kami) et trois administrateurs, envoyés de la capitale, formaient le gouvernement provincial (kokushi). Le personnel subalterne recruté sur place parmi les anciens notables constituait une « fonction publique territoriale ». Des inspecteurs surveillaient les kuni en parcourant des circuits (do). Près de l'actuelle ville de Fukuoka, le Dazaifu, office spécial, surveillait Kyushu et les contacts avec le continent.
C) Dans la capitale, une élite de 5 000
à 10000 fonctionnaires (les estimations varient selon les
dates choisies et les méthodes de calcul) devait se consacrer au
service de l'État et ses membres ne devaient qu'à lui seul leur
survie au double plan honorifique et matériel. Cette noblesse de
fonction, formée uniformément dans et par l'État, était, à
l'exception des princes impériaux, répartie en 30 échelons
officiels (regroupés en huit « rangs » et un
« rang » de début), chacun ouvrant la voie à une possible
nomination dans des postes, selon des procédures régulières. Il en
résultait théoriquement un principe de mobilité sociale : donc
un enseignement et des examens. En fait, les hauts fonctionnaires
répartis dans les cinq rangs supérieurs (correspondant à environ
130 postes) avaient le double privilège de très hauts traitements,
et d'un droit de transmission héréditaire leur permettant d'assurer
à leurs fils, voire à leurs petits-fils, des débuts de carrière,
que, même à la fin de leur vie, ne pouvaient espérer les
administrateurs subalternes.
De cette description, la Cité impériale ressort comme
une évidence. Mais les institutions autorisent-elles à qualifier
d'État l'organisation du Japon antique ?
II. - L'espace antique et le mouvement économique
Autour de la Cité impériale, l'espace antique est remodelé : éloigné du continent, dilaté dans l'archipel par la guerre et les défrichements.
1. Le repli dans l'espace insulaire. - Après
sa défaite à Hakusunko (663), la Cour n'eut en vue que des
relations extérieures pacifiques : des ambassades furent
échangées avec la Chine, une vingtaine jusqu'en 838 à l'initiative
du Japon. Chaque fois des jonques transportaient environ quatre
cents représentants laïques et moines bouddhiques. Ambassades
coûteuses (vu le nombre des naufrages), qui prouvent l'intérêt de
la capitale pour les marchandises importées : drogues
médicinales, parfums, livres et images bouddhiques.
Puis vint le temps de la rupture. La conception
chinoise du monde qui reléguait le Japon au rang d'État tributaire
était gênante. Par réaction Shotoku Taishi, dans ses adresses à la
Cour des Sui, avait nommé le souverain du Yamato « Fils du
Ciel, dans le pays où le Soleil se lève ». Estimant ne plus
avoir à apprendre, la Cour supprima les ambassades : celle de
894 ne partit pas. Le commerce continua, assuré par des Coréens,
puis par des Chinois qui, venant à Hakata, près du Dazaifu, et à
Naniwa, introduisirent leur monnaie de cuivre au Xe
siècle. Le Japon n'était que le pays des métaux bruts : or,
argent, mercure.
2. La conquête intérieure. - Face aux populations périphériques du Jomon tardif (touchées néanmoins par l'usage du fer et la riziculture irriguée), le Yamato demeura pacifique. Une conquête systématique commença après le retrait de Corée. Des provinces furent créées dans l'extrême sud de Kyushu (Osumi, Stasuma) et dans l'extrême nord (Dewa et Mutsu). Chaque étape de la pacification voyait surgir des centres administratifs japonais nommés « barrière » ou « redoute ». Brassages de populations, alliances de lignages et commerce hâtèrent l'assimilation. Des groupes d'Ezo avaient été déportés dans les régions centrales sous le nom de fushu (captifs). Dès 816, des rizières leur furent attribuées. Au Xe siècle, à l'exception de l'Hokkaido actuel, la Cité impériale rayonnait dans tout l'archipel.
3. Les défrichements. - Dans les terres conquises, tout comme au centre de l'État, prolongeant le travail des époques Yayoi et Kofun, paysans, moines et aristocrates entreprirent d'étendre l'espace cultivé. La faim de terres, générée par l'essor démographique, y contribua. Mais encore des intérêts sociaux : d'une part, pour les particuliers, un droit privilégié d'occupation (sinon d'appropriation qui n'était pas conceptualisé) à perpétuité en 743, qui attira les fonctionnaires et les moines ; d'autre part, le luxe de la Cour et des monastères qui exigeait l'ouverture de chantiers forestiers pour la fourniture en bois de construction (champs et rizières devaient alors s'y adjoindre pour l'entretien des bûcherons). Une partie de la main-d'œuvre n'était pas fixée. On peut imaginer une masse paysanne mobile s'intégrant dans une foule de petites entreprises, conduites par des notables locaux, patronnées par l'aristocratie et les monastères. Nombre de chantiers furent sans lendemain. Dès le XIe siècle, des « rizières de redistribution » étaient en friche.
4. L'expansion économique. - Elle fut
continue, mais lente. Il faut y distinguer l'apparence et la
réalité.
Au VIIIe siècle, au moment où Heijokyo
(Nara) va être construite, la Cour tente d'organiser une économie
commerciale. De 708 à 958, des monnaies sont émises. Mais la frappe
de l'argent cesse dès 709. Seules circulent des pièces de cuivre,
métal dont l'extraction fut accrue. A Nara et à Kyoto, le plan
urbain prévoyait deux marchés (de « droite » et de
« gauche »). Pendant la construction des capitales,
monnaies et marchés n'étaient en usage que pour la rémunération et
l'approvisionnement du personnel mobilisé. Bien que le long de la
rivière Yodo, entre Heiankyo et le golfe d'Osaka (appellation
actuelle), sake (alcool de
riz) et poissons séchés aient été vendus sur des marchés
secondaires, puis acheminés vers les marchés officiels de la
capitale, la fiscalité demeura le principal moteur des échanges.
Les artisans travaillaient sous contrôle.
Au Xe siècle, la fin du monnayage, des
contacts officiels avec la Chine, la fermeture des grands marchés,
l'extension des friches ne révélaient pas une régression comme
celle que connut l'Occident après la division de l'Empire romain.
Il y eut simplement effacement de superstructures économiques
inutiles. En revanche au XIIe siècle, les signes
annonciateurs d'une phase d'expansion se multiplient. Des marchés
s'animent à Kyoto (Heian), où des marchands-artisans forment des
guildes, ainsi qu'à Hakata et à Naniwa, lieu d'arrivée des navires
chinois.
III. - Union et désunion de l'aristocratie
Face aux mondes extérieurs, la sécurité et une
abondance suffisante en produits de nécessité et de luxe étaient
d'une importance vitale pour la Cité impériale, Heijo-kyo, puis
surtout Heian-kyo. Mais il ne semble pas que, des siècles durant,
il y eut là des motifs d'inquiétude graves. Ni l'étranger
continental, ni le pourtour archaïque du Japon rizicole n'étaient
menaçants. De tels contacts, la paix et les échanges furent les
traits constants.
Le vrai danger potentiel était représenté par le monde
provincial dominé, où une contre-civilisation risquait de se
former : la preuve en fut administrée à la fin du
XIIe siècle, entrevue par les habitants de Heian,
comme la confirmation de l'apocalypse annoncée déjà par le
bouddhisme. Mais la société provinciale évoluait lentement et
jusqu'à l'irruption des cataclysmes, c'est à l'intérieur des
aristocraties laïques et monastiques que résida le danger.
1. Les forces profondes. - Plus qu'aux institutions, la capitale doit sa capacité de durer à la cohésion de ceux qui y résident. Mais elle ne se transforme pas en coercition, parce que la cohabitation quotidienne dans un espace limité y a modifié les comportements de l'élite supérieure et subalterne.
A) La démilitarisation. - C'est la ville qui
supporte les structures politiques et culturelles de l'État
antique. Or les 5 ou 10 000 fonctionnaires qui en sont le noyau et
la raison d'être ont eu des ancêtres guerriers durant tout le
VIIe siècle, en particulier sous les empereurs Tenchi et
Temmu. À Heijo-kyo (dite époque de Nara), la violence ne disparaît
pas complètement. À Heian, au IXe siècle, elle est
impensable, d'autant plus qu'elle est cause d'incendies. La
pratique guerrière de l'équitation et de l'escrime recule
rapidement. La capitale s'isole : une sortie, fût-elle de
quelques kilomètres, suffit à remplir d'effroi ceux qui s'y
risquent. Certes, les voleurs sont nombreux dans l'agglomération,
sans inspirer toutefois la même terreur. Une démilitarisation
complète (et irréversible) de l'élite fut donc le prix
psychologique à payer pour la stabilité de l'Etat. On se risquera à
évoquer, malgré d'immenses différences, la « Société de
Cour » décrite par Norbert Elias, où, un millénaire plus tard,
le noble remplace l'épée par la canne et adopte l'autocontrainte
comme seule conduite naturelle.
Plutôt que d'administrer l'État, en tant qu'espace
productif, la tâche prépondérante de la Cour fut de se gouverner
elle-même, de se discipliner, de faire respecter par chacun de ses
membres la position hiérarchique où il trouvait et ses limites et
sa sécurité. Ce qui supposait néanmoins qu'à cette démilitarisation
répondit, dans les provinces productrices, un semblable renoncement
à l'usage de la force, bien que les contraintes de la cohabitation
urbaine y fussent absentes. Quoique les preuves soient difficiles à
réunir, on admettra que, parallèlement à la création de la
capitale, les uji
provinciaux ont été affaiblis soit par un processus
d'autodissolution endogène, la sécurité étant suffisante
localement, soit par migration d'une partie de leurs élites vers la
Cour.
Loin de la ville toutefois, la démilitarisation
n'était que temporaire : le mouvement s'inversa dès que revint
le danger. De là, l'un des traits originaux de la civilisation
japonaise : une cassure persistante dans les élites entre le
kuge (noble de Cour) et le
bushi (guerrier), qui,
concrétisée au XIIe siècle, dura jusqu'au Japon de
Meiji.
B) Les
sécessions. - La capitale, malgré sa cohésion séculaire ne
put pas conserver dans son cadre géographique la totalité des
forces qui s'y étaient coagulées.
Les nouvelles sectes bouddhiques, Tendai et Shingon,
furent les premières à s'en éloigner. Les six sectes plus
anciennes, en fait des écoles dogmatiques localisées dans un seul
monastère et directement empruntées à la Chine, n'existaient qu'à
l'intérieur même de l'État, dont elles assuraient par leurs
cérémonies la protection. À Heijo-kyo, une colossale statue de
bronze (le grand bouddha de Nara) fut inaugurée en faveur de la
paix. Les moines participaient à la construction des routes, des
ponts, des réservoirs nécessaires à l'irrigation.
Sous le règne de Kammu-Tenno, la fondation de Heian
représentait déjà une forte réaction contre cette symbiose. Mais,
en outre, le monachisme des deux nouvelles sectes s'organisa
sociologiquement d'une manière autonome : chacune avec son
orthodoxie, sa hiérarchie, sa discipline austère, ses localisations
dans des montagnes plus ou moins éloignées, ses possessions
foncières. Dès le Xe siècle, les moines se mêlent aux
rivalités de la Cour, recrutent des guerriers, puis s'arment
eux-mêmes en masse. Néanmoins, malgré des heurts avec la capitale,
ils lui restent liés culturellement par l'élitisme de leurs
doctrines.
Plus tardif, et avec des conséquences plus graves à
long terme, fut le départ de groupes d'aristocrates vers des
provinces souvent lointaines, dans le Nord-Est et le Kanto. Il ne
s'agissait pas d'y occuper provisoirement des postes de gouverneur,
mais de s'y fixer définitivement, en y regroupant des terres, en
s'y alliant par mariages avec les notables locaux, les
« fonctionnaires résidents », qu'ils pouvaient regrouper
en clientèles. Nostalgiques de la capitale, ils ne s'en posaient
pas moins en concurrents.
2. Les pouvoirs familiaux.
A) Précarité et
stratégies de survie. - Une noblesse de fonction est par
nature soumise à la précarité. Elle ne dispose pas de titres
héréditaires, mais simplement d'une « inégalité des
chances », étroitement conditionnée par la fonction
qu'exercent le père ou le grand-père du futur fonctionnaire :
que ces derniers viennent à disparaître trop tôt, l'avantage de la
naissance s'évanouit également. Les privilèges dont bénéficiait la
strate supérieure des fonctionnaires de la capitale exigeait ainsi
une reconduction continue, d'une génération à l'autre, de
l'obtention de l'un, au moins, des postes dominants. En outre,
faute d'adversaires réels, l'État antique (dont les fonctions
spécifiquement étatiques étaient atrophiées) était incapable de
procurer une gloire (victoire militaire, entreprise audacieuse de
réforme) capable de mettre en valeur le talent individuel, et donc
d'inverser la chute d'un lignage entraîné vers l'obscurité. S'en
remettre aux études et aux concours (qui du reste ne
s'appliquaient, hors d'éventuelles prouesses culturelles, qu'à une
parodie de gouvernement) eût été en contradiction avec le désir
fondamental de la continuité des lignages. Ces derniers, pour
maintenir leur rang, durent donc s'orienter soit vers des
stratégies d'influence, à base de constructions familiales
complexes, soit vers une reconstitution des patrimoines fonciers
transmissibles héréditairement.
Seuls les lignages illustres sont connus : il est
donc hasardeux de généraliser leurs pratiques. Cependant, il semble
sûr que, seuls, ils avaient les moyens de multiplier et les
mariages et les adoptions (en mettant à profit des libertés plus
larges que celles de la Chine antique), et que les stratégies
familiales eurent pour finalité moins l'acquisition que la
conservation des privilèges. Il en résulta des systèmes de parenté
d'une stupéfiante complexité : écarts d'âge de plus d'une
génération entre les épouses, entre demi-frères ou
demi-sœurs ; mariages entre tante et neveu, oncle et
nièce ; adoption d'un frère cadet par un frère aîné ;
adoption encore de l'enfant de l'une des épouses par une autre
épouse, donc un transfert d'enfant tenu pour banal. Sans qu'il
faille négliger le cas de la « fille oubliée » (thème
littéraire noté dans le Dit du
Genji), dont on se souvient à un moment donné pour faire
face à un vide stratégique. Car sous l'anarchie apparente, c'est la
politique qui domine. Tout d'abord le besoin d'héritiers, à une
époque où les épidémies pouvaient être dévastatrices, mais aussi de
filles à placer, dans un lignage prestigieux, et, espérance ultime,
dans celui du Tenno ou de
son successeur prévu. Batardise et légitimité étant secondaires,
l'adoption permettant de pallier bien des déficiences, le nombre
des héritiers était une force et il a semblé réaliste de voir dans
ces parentés tentaculaires une renaissance des uji, tels qu'ils avaient existé avant
la stabilisation de la Cour. En fait, les différences sont
décisives.
Les postes visés sont ceux de l'État, donc limités en
nombre et impropres à un partage. Les nominations sont
individuelles, nullement collectives, même si les liens familiaux y
jouent un rôle capital.
Il s'ensuit qu'une parenté trop tentaculaire pose
les questions insolubles de sa hiérarchie interne et d'un
droit successoral qui, à Heian, resta dans un flou persistant.
Faiblesse générale des régimes polygamiques, la transmission des
pouvoirs était conçue selon une ligne verticale - de père à fils -
ou horizontale - de frère à frère. Les conflits internes étaient
aussi intenses que ceux qui opposaient globalement un faisceau de
parentés à un autre. La situation multirelationnelle des membres du
groupe familial faisait obstacle à la persistance des fidélités
au-delà d'une génération. Avoir de nombreux fils pouvait être un
avantage pour le père : pour son principal héritier, le nombre
des frères devenait facilement une nuisance. Certains chefs de
lignage en ayant conscience, à un désir d'élargissement de la
parenté, substituèrent une stratégie de resserrement, dont
l'adoption du cadet par l'aîné est un exemple. La logique
« verticale » du lignage était en contradiction avec
celle de Yuji (de la
parenté tentaculaire), même si elle devait utiliser ce moyen, en le
réduisant en fait à une clientèle viagère, dissimulée sous
l'apparence d'une stratégie simplement familiale.
La reconstitution des patrimoines allait dans le même
sens. Désignés comme shoen,
il s'agissait non de terres à cultiver, mais d'une attribution,
individuelle (tout comme les nominations à un poste), de pouvoirs
régaliens, principalement fiscaux, sur un espace donné.
Privatisation du prélèvement des taxes et impôts divers, sans
réellement le souci d'organiser une exploitation domaniale, le
shoen procurait à des
aristocrates fonctionnaires des revenus sûrs, indépendants des
aléas de leur carrière et du lieu de leur résidence, liés le plus
souvent à la capitale. Il faut ajouter que les femmes (exclues dans
l'ensemble des postes officiels) pouvaient être héritières de tels
biens et les transmettre par testament.
B) Immobilisme et
fractionnement de la Cour. - Si l'histoire du Japon et celle
de la Cour avaient été mêlées, cette dernière aurait été troublée à
l'extrême par les stratégies de survie du petit groupe des hauts
fonctionnaires. Mais au contraire, à Heian, la séparation ayant
duré jusque vers le milieu du XIIe siècle, leurs actions
(s'assurer des nominations, bâtir des organisations familiales et
des clientèles, privatiser une partie des revenus fonciers dont
jouissait la capitale) exigeaient, et eurent pour conséquence,
l'immobilisme du cadre formel dans lequel elles se déroulaient,
parce que ce dernier conditionnait la prévisibilité des résultats.
Par immobilité, il faut entendre une administration répétitive, le
ritualisme, l'expression littéraire comme champ unique de
créativité et le cantonnement du Tenno dans l'activité
cérémonielle : donc une politique dépolitisée, sans projets
collectifs, et sans drames.
Cependant, dans deux cas les stratégies dynastiques
parvinrent à des succès suffisants pour qu'il en résultât la
formation, parallèlement à l'État, mais dans la Cour, de deux
sous-systèmes politiques stables : 1 / celui des
régents-chanceliers (seikan-seiji), titres de fonctions
nouvelles, non prévues par les codes et attribuées, empiriquement,
à quelques familles Fujiwara, puis, dès le Xe siècle,
monopolisées par un seul de leurs lignages (non sans de violentes
compétitions internes) ; 2 / celui, au siècle suivant, des
empereurs retirés (in-sei),
théoriquement retirés dans une vie monastique (en fait dorée et
active), qui permit à certains membres de la famille impériale de
se pourvoir d'une position d'autonomie que son cantonnement
cérémoniel interdisait au souverain régnant.
Les deux cas semblent a priori divergents : les
régents-chanceliers accédaient à une fonction officielle ; les
empereurs quittaient la leur. Mais ni les uns ni les autres
n'avaient d'attributs précis de pouvoir. La localisation du pouvoir
dans l'État ne fut jamais institutionnalisée à Heian : elle
dépendait d'un jeu d'influence variable. Ces titres ou qualités
toutefois se situaient d'emblée, et également au-dessus ou tout au
moins au-dehors de la hiérarchie. En revanche, les Fujiwara du
lignage privilégié obtinrent très vite que le titulaire unique du
titre soit de régent ou soit de chancelier fut reconnu comme le
premier de sa parenté, avec la charge de « chef de
Yuji » (la réalité de
ce dernier méritant maintes restrictions). Dans la famille
impériale, il fut plus long de faire admettre que le premier, en
termes de parenté, n'était pas le souverain régnant, mais l'un ou
l'autre de ses prédécesseurs (souvent par ordre
d'ancienneté) : fait qui retarda la formation de son
sous-système politique.
Cependant, dans les deux cas, l'acquisition des
shoen fut la cause décisive
de l'émergence de ces « gouvernements » privés : ils
s'imposaient pour la gestion des revenus privatisés, leur
acheminement des lieux de production vers la capitale, lieu de
stockage et de consommation, sans intervention étatique. Des
fonctionnaires privés étant nécessaires, ils furent recrutés
dans les strates moyennes et inférieures de la Cour, déjà pourvue
de fonctions publiques : de là, une imbrication des carrières,
et d'immenses possibilités de cumul et de clientélisme. À la
gestion s'ajoutèrent divers offices et un tribunal.
Dans la seconde moitié du XIIe siècle,
eurent lieu d'autres tentatives - celles de certains Minamoto et
Taira (branches dérivées et détachées de la souche impériale) -
pour créer des autonomies identiques. Mais elles se heurtèrent à
l'irruption de la violence militaire dans la Cour, non conforme à
son immobilisme séculaire.
IV. - La dynamique de la société provinciale
« L'espace, ennemi n° 1 » : cette
formule qui sert de titre à l'un des chapitres de Fernand Braudel
dans sa Méditerranée au temps de Philippe II serait vraie pour le
Japon de Heian, à la condition de la nuancer selon les distances.
Le monde provincial y avait été considérablement dilaté par la
conjonction de l'assimilation des populations du Jomon tardif, d'un
réchauffement climatique, sensible dès le VIIIe siècle, qui
favorisait l'extension de la riziculture, et d'un essor
démographique qui, à la fin du XIIe siècle, donna à la plaine si
excentrée du Kanto une densité d'habitants capable d'équilibrer
celle des régions ayant servi de cœur à l'État antique. Plus grand
est l'éloignement - qui peut exiger des semaines de voyages par
terre, la voie maritime étant trop dangereuse, hors de la Mer
Intérieure -, plus faible est l'emprise de la capitale. Or c'est
précisément en ses terres lointaines qu'une interaction put le
mieux se produire entre diverses formes de dissociations
(privatisation des revenus fiscaux soustraits grâce aux shoen à la
communauté aristocratique ; émigration définitive) à l'œuvre
dans la Cour, d'une part, et la pression ascendante d'une strate
paysanne moyenne, stimulée par la possession de la terre, d'autre
part.
1. « Shoen » et
« Myoden ». - Ces deux institutions visant également
l'appropriation de la terre cultivable, différenciées fortement par
leur nature juridique, leurs conséquences sociales, leurs
dimensions respectives sur le terrain, la période de leur
généralisation, finirent toutefois par devenir complémentaires, la
seconde s'intégrant dans la première.
Pour le shoen, une charte de fondation était
nécessaire - précisant ses limites, sa surface, l'étendue de son
immunité fiscale - que seuls le Conseil suprême (dajokan) ou le
ministère des Affaires populaires avaient originellement qualité
d'accorder. Pour le myoden, le fait précédait le droit :
l'usager d'un terrain (rizières, - den -, champs, friches) lui
donnait son nom (myo), manière symbolique de l'enclore et d'en
écarter les concurrents. Aucune charte n'était nécessaire :
mais présence sur place et mise en valeur s'imposaient, ainsi qu'un
rapport de force favorable, face soit au gouverneur et à ses
délégués, soit au bénéficiaire d'un shoen (nommé ryoshu), selon que
le terrain concerné était soumis à une fiscalité publique ou
privée. La question de la main-d'œuvre était cruciale pour le
myoshu (maître de myoden) : souvent, chef d'une famille
paysanne étendue, il rejetait ses collatéraux vers la condition de
tenancier (sakunin), et s'appropriait tout ou partie des terres
indivises du groupe familial. Mais finalement, à la fois paysan
riche, chef d'exploitation et rentier du sol simultanément, le
myoshu se rendit dès le Xe siècle indispensable aux autorités qui
auraient pu le combattre : il devint collecteur d'impôt. Le
versement du nengu, taxe annuelle payée en riz, tomba partout sous
sa responsabilité : il la remettait (en prélevant sa part)
soit au bénéficiaire du shoen ou encore à son administrateur
(shokan), soit aux agents publics. Pour longtemps, le myoden
demeura l'unité fiscale de base.
Dans les régions centrales où l'enchevêtrement des
droits était extrême, où shoen, terre d'état (koryo), et myoden
étaient composés de parcelles dispersées, cette solution fut une
commodité technique. Dans les provinces lointaines, récemment
défrichées, et sous-administrées, la question mérite d'être posée
différemment. À l'intérieur des vastes dimensions d'un shoen,
plusieurs myoden purent s'emboîter sans difficulté. D'où une
conjonction d'intérêts privés, dont il est permis de penser que,
loin de nuire à la cohésion de l'État antique, elle a contribué,
plus que n'en eut été capable une centralisation bureaucratique, à
faire pénétrer, par exemple jusque dans le Kanto, le rayonnement de
la capitale : une conclusion qui toutefois doit tenir compte
du retour de la guerre.
2. La remilitarisation. - Ce n'est pas la
privatisation de l'administration et de l'exploitation de la terre,
mais le retour en force du guerrier (bushi) qui, dans la dynamique
de la société provinciale, devient de plus en plus le trait
marquant. La Cour avait compris la nécessité ponctuelle d'une
présence armée. Mais elle ne sut pas l'organiser, et c'est, hors de
son initiative, que, au XIe siècle, des groupes de bushi
(bushi-dan) se forment, toujours plus nombreux, pour défendre non
l'Etat, mais leurs biens propres ou leur autorité contre des
dangers diffus dans les campagnes.
Toutefois, d'une comparaison succincte avec
l'Occident, il ressort que, au Japon, certains synchronismes
fondamentaux font défaut. Le cadre politique et social dans lequel
se constituent les bushidan évolue différemment : on ne voit
vraiment ni vassalité, ni seigneurie châtelaine, ni spécialisation
militaire affirmée.
Contre le danger, comme en Occident, la force n'est
pas l'unique recours et, selon un processus analogue à la
« recommandation », les bénéficiaires des myoden et des
shoen, se sentant menacés, cherchent la protection de personnages
plus puissants, auxquels ils « remettent » leurs biens.
Or il ne s'agit nullement d'un engagement d'homme à homme, mais, le
sol et ses revenus étant seuls concernés, d'un partage de ces
derniers. Il n'est pas question non plus d'une délégation implicite
de pouvoir. Selon une hiérarchie descendante, du haut protecteur,
ryoke (un personnage puissant de la capitale ou un grand
monastère), jusqu'au myoshu et même au tenancier (sakunin), avec en
position intermédiaire, l'ancien ryoshu et le shokan, il n'existe
d'association que pour fixer des parts (shiki) de récoltes. Ces
dernières sont librement transmissibles par héritages ou encore
vendues, en totalité ou en partie : première pénétration d'une
économie de marché, faisant obstacle à la fidélité vassalique et à
la seigneurie. Le commerce et la guerre se déploient parallèlement,
laissant un rôle protecteur à l'aristocratie de l'État antique.
Les bushidan reflètent ces ambiguïtés. Le terme
désigne soit de petits groupes assez stables, de formation locale,
soit de grandes solidarités guerrières d'une durée très aléatoires,
quoique leur fréquence augmente durant la seconde moitié du XIIe
siècle.
Dans les premiers dominent les petits notables
ruraux : il faut en effet de l'aisance pour se procurer des
armes, des loisirs pour s'exercer au sabre et à l'arc, enfin un
certain prestige. De même que les myoshu, ces chefs de groupes
recrutent leur personnel (cette fois-ci, leurs compagnons de
combat) dans leur parenté proche ou lointaine, ainsi que dans leur
domesticité. La hiérarchie interne est de type familial. La guerre
n'est pas leur occupation exclusive et tous préfèrent ne pas
s'éloigner longtemps de la terre qui les nourrit.
À la tête des grands bushidan, on retrouve au
contraire les noms dominants de l'aristocratie : princes
impériaux, Fujiwara, Minamoto, Taira, divisés en lignages qui ont
tantôt fait choix d'un départ définitif vers le monde provincial,
où ils ont retrouvé des habitudes guerrières, tantôt décidé au
contraire de demeurer dans la capitale. C'est sous la bannière des
uns ou des autres que les petits bushidan, guerriers à temps
partiel, entrent dans la grande histoire, espérant y trouver
l'occasion de consolider leur situation locale, encore plus
fragilisée que ne l'est, dans la Cour, celle des lignages
illustres, par l'habitude du partage successoral.
V. - La fin de l'État antique
Il est impossible de préciser quand prit fin l'État antique. Car il s'agit, au sens que H. I. Marrou donne à ce mot, en l'appliquant au passage du monde païen au monde chrétien dans un même empire (Décadence romaine ou antiquité tardive ?), d'une « pseudomorphose ». Certes, pour la capitale, les bushi provinciaux représentent bien une contre-civilisation. Mais ce n'est pas pour ce motif qu'ils se sont armés, et c'est sous des chefs issus de l'aristocratie, qu'ils s'emparent (répartis en armées rivales) de Kyoto entre 1183 et 1185. Quoique extrêmes, ces brefs épisodes militaires, qui affectent le sentiment de sécurité séculaire de la Cour, non son existence, ne créent une modification irréversible que dans la mesure où ils émanent de l'émergence du Kanto, donc d'un second « foyer central » dans la géopolitique interne du Japon, sans lequel la remilitarisation de la société provinciale n'aurait pas atteint sa masse critique. De plus, l'État antique n'avait cessé d'être un gouvernement symbolique plus que réel : le non-pouvoir du Tenno, qui en est l'expression, peut s'accommoder sans peine de la démultiplication des centres d'autorité, puisqu'il suffit à les empêcher de sécréter leur propre légitimité.