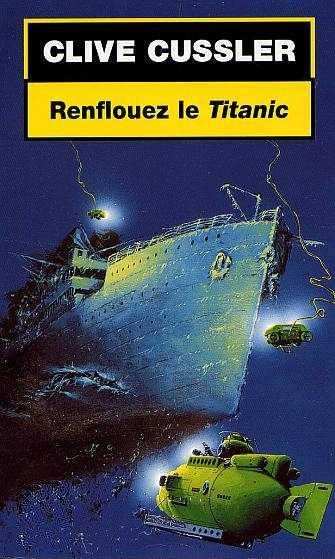
RENFLOUEZ LE TITANIC !
Clive Cussler
Avril 1912
PRÉLUDE
L'homme qui occupait la cabine 33 sur le Pont A s'agita et se retourna sur son étroite couchette, perdu dans les profondeurs d'un cauchemar. Il était petit, guère plus d'un mètre cinquante-cinq, avec des cheveux blancs clairsemés et un visage sans caractère, dont le seul trait frappant était une paire de sourcils sombres et broussailleux. Il avait les mains croisées sur sa poitrine, les doigts crispés. Il paraissait la cinquantaine. Sa peau avait la couleur et le grain du macadam et les rides sous ses yeux étaient très marquées. Et pourtant, il lui faudrait attendre dix jours encore pour atteindre son trente-quatrième anniversaire. Le labeur épuisant et les tortures morales des cinq derniers mois l'avaient amené au bord de la folie. Lors de ses heures de veille, il se retrouvait l'esprit errant dans des dédales sans fin, perdant toute notion du temps et de la réalité. Il lui fallait sans cesse se rappeler où il était et quel jour on était. Il était en train de devenir fou : c'était un processus lent mais irréversible, et le pire de tout, c'était qu'il savait qu'il devenait fou.
Ses yeux s'ouvrirent et son regard se fixa sur le ventilateur fixé au plafond de sa cabine. Il se passa les mains sur le visage et sentit sa barbe de deux jours. Il n'avait pas besoin de regarder ses vêtements : il savait qu'ils étaient salis, froissés, tachés de sueur. Après s'être embarqué, il aurait dû prendre un bain et se changer mais, au lieu de cela, il s'était jeté sur sa couchette et avait dormi d'un sommeil terrible et hanté pendant près de trois jours.
Il était tard dans la soirée du dimanche, et le navire ne devait accoster à New York que tôt le mercredi matin, dans un peu plus de cinquante heures.
Il essaya de se dire qu'il était en sûreté maintenant, mais son esprit refusait de l'accepter, en dépit du fait que le butin qui avait coûté tant de vies était parfaitement à l'abri. Pour la centième fois, il tâta la poche de son gilet. S'étant assuré que la clef était toujours là, il passa une main sur son front baigné de sueur et referma les yeux.
Il ne savait pas très bien combien de temps il s'était assoupi. Quelque chose l'avait brusquement éveillé. Pas un bruit très fort, ni un mouvement violent : on aurait dit plutôt un tremblement qui était parvenu jusqu'à son matelas et un étrange grincement qui venait de quelque part très en dessous de la cabine qu'il occupait à tribord. Il se redressa et s'assit, les jambes pendantes. Quelques minutes s'écoulèrent et il perçut un silence insolite, une absence de vibrations. Son esprit embrumé en comprit alors la raison. Les machines avaient stoppé. Il resta là, L'oreille tendue, mais les seuls bruits qui lui parvenaient c'étaient les plaisanteries qu'échangeaient des stewards dans la coursive et des conversations étouffées dans les cabines voisines.
Il sentit comme un tentacule glacé l'envelopper d'un malaise. Un autre passager aurait pu n'attacher aucune importance à cette interruption et se rendormir aussitôt, mais il était à deux doigts de la dépression nerveuse, et ses cinq sens surmenés grossissaient la moindre impression. Trois jours enfermé dans sa cabine sans manger ni boire, à revivre les horreurs des cinq derniers mois, n'avaient servi qu'à alimenter les flammes de la démence dans son esprit qui déclinait rapidement.
Il ouvrit la porte et s'avança d'un pas incertain dans la coursive jusqu'au grand escalier. Des gens riaient et bavardaient, en regagnant leur cabine. Il jeta un coup d'oeil à la lourde pendule en bronze flanquée de deux bas-reliefs au-dessus du palier intermédiaire de l'escalier. Les aiguilles dorées indiquaient 11 h 51.
Un steward, planté au pied d'un énorme lampadaire au bas de l'escalier, lui lança un regard dédaigneux, sans cacher l'agacement manifeste qu'il éprouvait à voir un passager aussi peu soigné déambuler entre les salons des premières classes pendant que tous les autres foulaient les somptueux tapis d'Orient en élégantes tenues de soirée.
« Les machines... elles ont stoppé, fit-il d'une voix rauque.
- Sans doute pour un léger réglage, monsieur, répondit le steward. Vous savez ce que c'est, un navire tout juste sorti des chantiers, le voyage inaugural; c'est normal qu'il y ait quelques petites mises au point à faire. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le bateau est insubmersible, vous savez.
- S'il est en acier, il peut couler. » II frotta ses yeux injectés de sang. « Je crois que je vais aller jeter un coup d'oeil dehors. »
Le steward secoua la tête. « Je vous le déconseille, monsieur. Il fait bigrement froid là-haut. »
Le passager au costume fripé haussa les épaules. Il avait l'habitude du froid. Il tourna les talons, gravit un étage et franchit une porte qui donnait sur le côté du pont des embarcations. Il suffoqua comme s'il avait été piqué par une aiguille. Après trois jours passés dans le tiède cocon de sa cabine, le choc était rude de se retrouver par quelques degrés au-dessous de zéro. Il n'y avait pas le moindre souffle de brise, rien qu'un froid mordant et immobile qui tombait du ciel sans nuage comme un linceul.
Il se dirigea vers le bastingage et remonta le col de sa veste. Il se pencha mais ne vit que la mer noire, calme comme un étang. Il regarda vers l'avant, puis vers l'arrière. Depuis le toit surélevé du fumoir des premières classes jusqu'à la timonerie au-delà du carré des officiers, le pont des embarcations était tout à fait désert. Seules la fumée qui montait en volutes nonchalantes de trois des énormes cheminées jaunes et noires, les lumières qui brillaient aux fenêtres du salon et de la salle de lecture trahissaient le moindre signe de vie. L'écume blanche qui bordait la coque se fit plus grêle et disparut peu à peu tandis que l'énorme navire continuait sur son erre et glissait sans bruit sous la couverture infinie des étoiles. Le commissaire de bord sortit du carré des officiers et regarda par-dessus bord.
« Pourquoi avons-nous stoppé ?
- Nous avons heurté quelque chose, répondit le commissaire sans se retourner.
- C'est sérieux?
- Sans doute pas, monsieur. S'il y a la moindre voie d'eau, les pompes devraient maîtriser ça. »
Brusquement, un grondement fracassant pareil au tonnerre de cent locomotives s'engouffrant en même temps dans un tunnel jaillit des huit conduits d'échappement. À l'instant même où il se bouchait les oreilles, le passager en reconnut la cause : il avait assez longtemps fréquenté
les salles de machines pour savoir que c'était le surplus de vapeur provenant des machines à
mouvement alternatif du navire qui s'échappait par les soupapes de dérivation. Le formidable fracas rendit impossible toute autre conversation avec le commissaire. L'homme se retourna pour voir d'autres membres de l'équipage faire leur apparition sur le pont des embarcations. Une crainte affreuse lui serra le ventre lorsqu'il les vit commencer à ôter les bâches des canots de sauvetage et à dégager les cordages pour les fixer sur les daviers.
II resta là pendant près d'une heure tandis que le vacarme des conduits d'échappement s'éteignait peu à peu dans la nuit. Cramponné au bastingage, indifférent au froid, ce fut à
peine s'il remarqua les petits groupes de passagers qui commençaient à s'aventurer sur le pont des embarcations dans une sorte d'étrange confusion silencieuse.
Un des lieutenants du navire passa. Il était jeune, une vingtaine d'années, et son visage avait le teint d'un blanc laiteux caractéristique des Anglais et l'expression d'indicible ennui qu'arborent souvent les Britanniques. Il s'approcha de l'homme appuyé au bastingage et lui tapa sur l'épaule.
« Je vous demande pardon, monsieur. Mais il faut mettre votre gilet de sauvetage. »
L'homme se retourna lentement et le dévisagea. « Nous allons couler, n'est-ce pas ? »
demanda-t-il d'une voix sans timbre.
L'officier hésita un moment, puis acquiesça. « Nous prenons l'eau plus vite que les pompes ne parviennent à la rejeter.
- Pour combien de temps en avons-nous ?
- C'est difficile à dire. Peut-être encore une heure si l'eau n'arrive pas au niveau des chaudières.
- Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait aucun autre navire dans les parages. Qu'est-ce que nous avons heurté ?
- Un iceberg. Ça a déchiré la coque. Un vrai coup de malchance. »
II serra le bras de l'officier si fort que le jeune homme en tressaillit. « II faut que je descende dans la cale.
- H y a peu de chances, monsieur. La salle du courrier du Pont F est inondée et les bagages flottent déjà dans la cale.
- Il faut que vous me guidiez jusque-là. » L'officier essaya de se libérer le bras, mais l'homme le maintenait comme dans un étau.
« Impossible ! Mes ordres sont de m'occuper des canots de sauvetage de tribord.
Un autre officier peut surveiller les canots, dit le passager d'une voix sourde. Vous allez me montrer le chemin de la cale. »
Ce fut alors que l'officier remarqua deux détails forts déplaisants. D'abord, l'air crispé, dément du passager et ensuite le canon du pistolet qui s'enfonçait dans son bas-ventre.
« Faites ce que je vous demande, murmura l'homme, si vous souhaitez voir un jour vos petitsenfants. »
L'officier contempla le pistolet puis leva les yeux. Il se sentit soudain malade. Pas question de discuter ni de résister. Les yeux rougis qui le fixaient avaient un éclat qui ne devait rien à la raison.
« Je peux toujours essayer.
- Alors essayez! Ricana le passager. Et pas de blague. Je serai toujours derrière vous. Une bêtise et je vous tire une balle qui vous cassera le dos en deux. »
Pour plus de discrétion, il fourra le pistolet dans une poche de sa veste, appuyant le canon contre les reins de l'officier. Ils se frayèrent sans mal un passage à travers la foule de ceux qui encombraient maintenant le pont des embarcations. Ce n'était plus le même navire : plus de rires ni de gaieté, plus de distinction de classe; riches et pauvres étaient unis dans une commune terreur. Les stewards étaient les seuls à sourire et à plaisanter tout en distribuant les gilets de sauvetage d'un blanc fantomatique.
Les fusées de détresse s'élevaient dans les airs, semblant toutes petites et inutiles dans la nuit noire, leur jaillissement d'étincelles n'étant vu que par ceux qui se trouvaient à bord du vaisseau condamné. Cela faisait une toile de fond irréelle aux adieux déchirants, aux expressions d'espoir contraint qu'on lisait dans le regard des hommes tandis qu'ils soulevaient avec précaution leurs femmes et leurs enfants pour les déposer dans des chaloupes. La terrible irréalité de la scène se trouva accentuée encore lorsque l'orchestre de huit musiciens du navire se rassembla sur le pont des embarcations, l'air absurde avec leurs instruments et leurs gilets de sauvetage blêmes. Ils commencèrent à jouer « Alexander's Ragtime Band » d'Irving Berlin. Le jeune lieutenant, poussé par le canon de pistolet, parvint à descendre le grand escalier à
contre-courant du flot des passagers qui se précipitaient vers les canots de sauvetage. L'inclinaison de la proue était de plus en plus prononcée à mesure que le navire donnait de la bande, et cela les déséquilibrait lorsqu'ils descendaient l'escalier. Sur le Pont B, ils prirent un ascenseur jusqu'au Pont D.
L'officier se retourna et toisa l'homme dont l'étrange caprice l'avait inexorablement rapproché
d'une mort certaine. Les lèvres étaient retroussées sur les dents, les yeux brillaient d'un éclat lointain. Le passager s'aperçut que le jeune lieutenant le dévisageait. Un long moment, leurs regards se croisèrent.
« Ne vous inquiétez pas...
- Bigalow, monsieur.
- Ne vous inquiétez pas, Bigalow. Vous vous en tirerez avant qu'on coule.
- Quelle partie de la cale cherchez-vous ?
- Le coffre du navire dans la cale numéro Un, Pont G.
- Le Pont G est certainement sous l'eau maintenant.
- Nous le saurons quand nous y serons, n'est-ce pas ? » Le passager fit un geste avec le pistolet dans sa poche de veste tandis que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Ils descendirent et se frayèrent un chemin à travers la cohue.
Bigalow arracha son gilet de sauvetage et se précipita dans l'escalier qui menait au Pont E. Là
il s'arrêta et, regardant en bas, il vit l'eau qui montait peu à peu, poursuivant marche par marche son impitoyable avance. Quelques lumières brûlaient encore sous l'eau verte et glacée, projetant une lueur vacillante, inquiétante. « Inutile. Voyez vous-même.
- Il y a un autre accès ?
- Les portes étanches ont été fermées juste après la collision. Nous pourrions descendre par une des échelles de secours.
- Alors, allez-y. »
Le trajet ne fut pas trop long par les coursives, puis par l'interminable labyrinthe des couloirs et des échelles. Bigalow s'arrêta, souleva un panneau d'écoutille et regarda par l'étroite ouverture. Chose étonnante, dans la cale en dessous, l'eau ne montait qu'à une cinquantaine de centimètres.
« Rien à faire, dit-il sans vergogne. C'est inondé. »
Le passager écarta sans douceur l'officier pour regarder lui-même.
« C'est bien assez sec pour moi », dit-il lentement. Du canon de son arme il désigna l'écoutille.
« Continuez. »
L'éclairage électrique du plafond brûlait encore dans la cale, éclairant les deux hommes qui pataugeaient vers la chambre forte du navire. La faible lumière faisait briller les cuivres d'une énorme limousine Renault attachée au pont.
Tous deux trébuchèrent et tombèrent à plusieurs reprises dans l'eau glacée qui leur engourdissait les membres. Trébuchant comme des hommes ivres, ils arrivèrent enfin au coffre. C'était un cube installé au milieu de la cale et qui mesurait environ deux mètres cinquante de côté ; ses robustes parois étaient construites en acier de Belfast épais de trente centimètres.
Le passager tira une clef de la poche de son gilet et l'introduisit dans l'orifice. La serrure était neuve et un peu dure, mais le pêne finit par se déplacer avec un cliquetis bien perceptible. Il poussa la lourde porte et pénétra dans le coffre. Puis il se retourna et sourit pour la première fois. « Merci de votre aide, Bigalow. Vous feriez mieux de remonter sur le pont. Vous avez encore le temps.
- Vous restez ? fit Bigalow, abasourdi.
- Oui, je reste. J'ai tué huit valeureux gaillards. Je ne peux pas vivre avec ça. » II avait dit cela d'un ton neutre, mais définitif. « C'est fini. Tout est fini. »
Bigalow voulut parler, mais les mots ne venaient pas.
Le passager hocha la tête et commença à tirer la porte pour la refermer derrière lui.
« Dieu soit loué, dit-il, il y a Southby. » Là-dessus il disparut, englouti dans les ténèbres du coffre.
Bigalow survécut.
Il battit à la course l'eau qui montait, parvint à regagner le pont des embarcations et se jeta pardessus bord quelques secondes à peine avant que le navire ne sombrât. Tandis que la masse du paquebot géant disparaissait aux regards, son pavillon rouge frappé de l'étoile blanche qui jusque-là pendait mollement, tout en haut du grand mât, se déroula soudain en touchant la mer, comme dans un ultime salut aux quinze cents hommes, femmes et enfants qui étaient en train de mourir de froid ou de se noyer dans les eaux glaciales qui leur servaient de tombeau.
En proie à un instinct aveugle, Bigalow tendit la main et saisit le pavillon au moment où il passait devant lui. Avant d'avoir pu réfléchir, avant d'avoir compris tout le danger de son imprudence, il se trouva entraîné sous l'eau. Cependant il tenait bon, refusant de lâcher prise. Il était à près de six mètres au-dessous de la surface quand enfin les estropes du pavillon s'arrachèrent à la drisse et il se retrouva le tenant toujours. Ce ne fut qu'alors qu'il se débattit pour remonter à travers ces ténèbres liquides. Après ce qui lui parut une éternité, il émergea de nouveau dans l'air de la nuit, bien heureux que la succion du navire en train de couler et à
quoi il s'attendait ne l'eût pas emporté.
L'eau à moins deux degrés faillit le tuer. Dix sept minutes de plus dans sa morsure glaciale, et il n'aurait été qu'une victime de plus à mettre au bilan de cette terrible tragédie. Ce fut une corde qui le sauva ; sa main effleura et empoigna une corde qui traînait d'un canot chaviré. Rassemblant les dernières ressources de ses forces déclinantes, il parvint à hisser à
bord son corps à demi gelé pour partager avec trente autres hommes le sourd engourdissement du froid jusqu'au moment où quatre heures plus tard ils furent sauvés par un autre navire. Les pitoyables cris des centaines de malheureux qui mouraient retentiraient à jamais dans l'esprit des survivants. Mais, comme il se cramponnait à la chaloupe renversée et à demi submergée, les pensées de Bigalow s'attardaient sur un autre souvenir : l'homme étrange à
jamais enfermé dans le coffre du navire.
Qui était-il?
Qui étaient les huit hommes qu'il prétendait avoir assassinés ? Quel était le secret du coffre ?
Telles étaient les questions qui devaient hanter Bigalow pendant les soixante-seize années suivantes, jusqu'aux toutes dernières heures de son existence.
PREMIÈRE PARTIE
LE PROJET SICILE
Il avait enfreint tous les tabous politiques que devait respecter un candidat pour réussir. Non seulement il était divorcé, mais il ne pratiquait pas, fumait le cigare en public et arborait en outre une grosse moustache. Il avait fait campagne sans s'occuper de ses adversaires et en assenant de solides vérités aux électeurs. Et ils avaient adoré ça. Il avait eu la chance d'arriver à une époque où l'Américain moyen en avait par-dessus la tête des candidats aux airs de petits saints qui souriaient tout le temps et faisaient l'amour aux caméras de télévision, qui ne s'exprimaient que par banalités, en phrases nulles que la presse n'arrivait pas à déformer, où
elle ne parvenait pas à trouver de sens caché à inventer entre les mots. Encore dix-huit mois et son second mandat serait terminé. C'était la seule pensée qui lui permettait de tenir. Son prédécesseur avait accepté le poste de doyen de l'Université de Californie. Eisenhower s'était retiré dans sa ferme de Gettysburg, et Johnson dans son ranch du Texas. Le Président sourit tout seul. Pas question pour lui de ces formules style vieil homme d'État sur la touche. Son projet, c'était de s'exiler dans le Pacifique sud sur un voilier de douze mètres. Là-bas, il ne saurait rien de toutes les crises qui agiteraient le monde pendant que lui siroterait du rhum en lorgnant les filles au nez plat et à la poitrine ronde qui déambuleraient devant lui. Il ferma les yeux et s'abandonnait à cette agréable vision quand son secrétaire entrouvrit la porte et s'éclaircit la voix.
« Pardonnez-moi, monsieur le Président, mais M. Seagram et M. Donner attendent. »
Le Président se retourna vers son bureau et passa ses doigts dans ses cheveux argentés. « Bon, faites-les entrer. »
Son visage s'éclaira. Gène Seagram et Mel Donner avaient toujours accès au Président à toute heure du jour ou de la nuit. Ils étaient les principaux experts de la Section Méta, un groupe de savants qui travaillaient dans un secret total sur des projets dont on ne soufflait encore mot, des projets qui s'efforçaient de faire faire à la technologie actuelle un bond de vingt à trente ans.
La Section Méta était une idée du Président. Il l'avait conçue durant la première année de son mandat ; c'était lui qui avait trouvé et manipulé les fonds secrets illimités, lui encore qui avait recruté personnellement le petit groupe d'hommes brillants et dévoués qui en constituaient le noyau. Dans le secret de son cour, il était très fier de ce projet. Même la CIA et l'Agence nationale de Sécurité ne savaient rien de son existence. Il avait toujours rêvé de soutenir une équipe d'hommes qui pourraient consacrer leur habileté et leur talent à des projets impossibles, des projets fantastiques avec une chance de réussite sur un million. Le fait que la Section Méta n'eût encore marqué aucun point au bout de cinq ans ne troublait en rien sa confiance.
Il n'y eut pas de poignées de main, simplement un bonjour cordial. Puis Seagram ouvrit un porte-documents au cuir fatigué dont il tira un dossier bourré de photographies aériennes. Il les déposa sur le bureau du Président et désigna plusieurs régions entourées d'un cercle sur des feuilles transparentes.
« La région montagneuse de l'île septentrionale de Nouvelle-Zemble, au nord du continent russe. Toutes les indications fournies par les sondes de nos satellites font état d'une vague possibilité dans cette zone.
- La barbe ! murmura le Président. Chaque fois que nous découvrons quelque chose comme ça, il faut que ce soit en Union soviétique ou dans quelque autre endroit impossible. » II examina les photographies, puis leva les yeux vers Donner. « La terre est grande. Il doit quand même y avoir d'autres régions prometteuses ? »
Donner secoua la tête. « Je suis désolé, monsieur le Président, mais les géologues recherchent le byzanium depuis qu'Alexander Beesley a découvert son existence en 1902. À notre connaissance, personne n'en a jamais trouvé en quantité suffisante.
- Sa radioactivité est si extrême, dit Seagram, qu'il a depuis longtemps disparu des continents, où il n'en subsiste plus que des traces infimes. Les rares fragments de cet élément que nous avons rassemblés ont été glanés sur de petites particules préparées artificiellement.
- Vous ne pouvez pas nous en fournir par synthèse ? demanda le Président.
- Non, monsieur, répondit Seagram. La particule ayant la plus grande longévité que nous soyons parvenus à produire avec un accélérateur à haute énergie s'est décomposée en moins de deux minutes. »
Le Président se renversa dans son fauteuil et regarda Seagram. « Quelle quantité vous faut-il pour mettre au point votre programme ? »
Seagram regarda Donner, et puis le Président. « Vous vous rendez compte bien sûr, monsieur le Président, que nous sommes encore au stade des hypothèses...
- Combien vous en faut-il ? répéta le Président.
- À mon avis, environ deux cent cinquante grammes.
- Je vois.
- Ce n'est que la quantité nécessaire pour faire une expérience valable sur le principe, ajouta Donner. Il faudrait six kilos de plus pour avoir un équipement tout à fait opérationnel à des emplacements stratégiques aux frontières du pays. »
Le Président se laissa retomber dans son fauteuil. « Alors, je pense que nous renonçons à cette affaire et que nous passons à autre chose. »
Seagram était un grand gaillard dégingandé, avec une voix calme, des manières courtoises et, à part un grand nez aplati, il aurait presque pu passer pour un Lincoln sans barbe. Donner était tout l'opposé de Seagram. D était petit et semblait presque aussi large que haut. Il avait des cheveux couleur de blé, un regard mélancolique et il avait toujours l'air dans les nuages. Il se mit à parler avec une rapidité de mitrailleuse. « Le projet Sicile est trop proche de sa réalisation pour qu'on l'enterre et qu'on l'oublie. Je conseille vivement que nous poursuivions. Bien sûr c'est un peu chercher une quinte par le ventre, mais si nous réussissons, mon Dieu, monsieur le Président, les conséquences sont fantastiques.
- Je suis ouvert à toutes les suggestions », dit le Président d'un ton tranquille. Seagram prit une profonde inspiration et se lança. « Primo, nous aurions besoin de votre autorisation pour construire les installations nécessaires. Secundo, des fonds indispensables. Et tertio de l'assistance de l'Agence Nationale de Recherches Océanographiques. »
Le Président jeta à Seagram un regard interrogateur. « Je comprends vos deux premières requêtes, mais je ne vois pas ce que vient faire l'ANRO là-dedans.
- Nous allons être obligés de débarquer clandestinement des experts en minéralogie en Nouvelle-Zemble. Comme c'est un territoire entouré d'eau, une expédition océanographique de l'ANRO fournirait une parfaite couverture pour notre mission.
- Combien de temps vous faudra-t-il pour tester, construire et installer le système ?
- Seize mois et une semaine, répondit Donner sans hésiter.
- Jusqu'où pouvez-vous aller sans byzanium ?
- Jusqu'au dernier stade », répondit Donner.
Le Président se carra dans son fauteuil et son regard se posa sur une pendule marine posée sur son bureau. Pendant près d'une minute il resta silencieux. Puis il dit : « Si je comprends bien, messieurs, vous voulez que je finance pour vous à concurrence de plusieurs millions' de dollars la construction d'un système complexe que nous n'avons pas testé et qui ne fonctionnera pas parce qu'il nous manque l'ingrédient primordial que nous allons peut-être être obligés de dérober à un pays non ami. »
Seagram tripota son porte-documents cependant que Donner se contentait de hocher la tête.
« Et si vous me disiez, poursuivit le Président, comment expliquer le foisonnement de ces installations aux quatre coins du pays à quelque membre du Congrès près de ses sous qui se mettrait dans la tête de se renseigner.
- C'est la beauté du système, dit Seagram. Il est petit et peu encombrant. Les ordinateurs nous assurent qu'un bâtiment construit suivant les dimensions d'une petite centrale électrique conviendra à merveille. Ni les satellites espions russes ni un fermier des environs ne remarquera rien d'extraordinaire. »
Le Président se frotta le menton. « Pourquoi voulez-vous accélérer ainsi le projet Sicile avant d'être cent pour cent prêts ?
- C'est un pari, monsieur le Président, fit Donner. Nous parions que dans les seize mois à venir nous allons pouvoir soit faire une découverte qui nous permette de produire du byzanium en laboratoire, soit trouver quelque part sur la terre un gisement exploitable.
- Même si cela nous prend dix ans, lança Seagram, les installations seraient là, toutes prêtes. Nous n'aurions perdu que du temps. »
Le Président se leva. « Messieurs, je vous suis dans votre projet qui sent fort la sciencefiction, mais à une condition. Vous avez exactement dix-huit mois et dix jours. C'est la date à
laquelle le nouveau Président, quel qu'il puisse être, va prendre le pouvoir. Alors si vous voulez jusque-là vous garder l'affection de votre papa-gâteau, obtenez-moi quelques résultats.
»
Les deux hommes firent triste mine. Seagram parvint enfin à parler. « Merci, monsieur le Président. Je ne sais pas comment, mais d'une façon ou d'une autre, l'équipe va trouver le filon. Vous pouvez compter là-dessus.
- Bon. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Il faut que je pose dans la Roseraie, avec toute une bande d'abominables Filles de la Révolution Américaine. » II leur tendit la main. «
Bonne chance, et n'oubliez pas, que tout ça reste clandestin. Je ne veux pas me retrouver comme Eisenhower avec une autre affaire U-2. Compris? »
Sans laisser à Seagram ni à Donner le temps de répondre, il tourna les talons et sortit par une porte de côté.
La Chevrolet de Donner franchit les grilles de la Maison-Blanche. Il se glissa dans le flot de la circulation et traversa le Potomac. Il osait à peine regarder dans le rétroviseur de crainte que le Président n'eût changé d'avis et redoutant d'apercevoir un motard lancé à leur poursuite pour leur signifier son refus. Il abaissa la vitre et respira l'air humide de l'été.
« On s'en est bien tiré, dit Seagram. Je pense que tu le sais.
- Tu parles. S'il avait su que voilà plus de deux semaines nous avons envoyé un homme en territoire soviétique, ça aurait bardé.
- Ça le pourrait encore, marmonna Seagram. Ça le pourrait encore si l'ANRO ne peut pas récupérer notre homme. »
Sid Koplin était certain qu'il était en train de mourir. Il avait les yeux fermés et le sang qui ruisselait de son côté venait tacher la neige blanche. Un jaillissement de lumière tourbillonna dans l'esprit de Koplin tandis qu'il reprenait peu à peu connaissance, la nausée déferla sur lui et il fut secoué de vomissements incontrôlables. Avait-il reçu une balle, ou bien deux? Il ne savait même pas.
Il ouvrit les yeux et roula pour se mettre à genoux. Sa tête martelait affreusement. En se tâtant le crâne, il rencontra le sang figé d'une plaie qui lui entaillait la peau au-dessus de la tempe gauche. À part cette douleur à la tête, il ne ressentait rien; les sensations étaient atténuées par le froid. Mais rien ne venait émousser la brûlure lancinante qui lui mordait le côté gauche, juste au-dessous de la cage thoracique, là où la seconde balle l'avait touché, et il sentait la viscosité sirupeuse du sang qui filtrait sous ses vêtements, sur ses cuisses et le long de ses jambes.
Une rafale d'armes automatiques retentit sur les pentes de la montagne. Koplin regarda autour de lui, mais il ne vit rien d'autre que les tourbillons de neige blanche fouettée par le terrible vent polaire. Une nouvelle rafale déchira l'air glacé. Il calcula que cela venait d'à peine cent mètres. Une patrouille soviétique devait tirer à l'aveuglette dans le blizzard avec le vague espoir de le toucher encore.
Tout espoir de fuite était maintenant anéanti. C'était fini. Il savait qu'il n'arriverait jamais à
regagner la crique où il avait ancré son sloop. Il n'était pas davantage en état de piloter le petit cotre de huit mètres à travers les cinquante milles de mer qui le séparaient du lieu de rendezvous avec le navire océanographique américain qui l'attendait. Il se laissa retomber dans la neige. Le sang qu'il avait perdu l'avait affaibli au point de rendre impossible tout nouvel effort physique. Il ne fallait pas que les Russes le trouvent. Cela faisait partie de son contrat avec la Section Méta. S'il devait mourir, on ne devrait pas découvrir son corps.
II se mit à gratter péniblement la neige pour s'ensevelir. Il ne serait bientôt plus qu'un petit monticule blanc sur une pente désolée du mont Bednaya, enterré pour toujours sous la plaque de glace qui ne cessait de s'amonceler.
Il s'arrêta un instant et tendit l'oreille. Les seuls sons qu'il percevait, c'étaient sa respiration haletante et le vent. Il écouta encore, mettant ses mains en cornet autour de ses oreilles. À
travers les hurlements du vent il perçut à peine les aboiements d'un chien.
« Oh, mon Dieu », pensa-t-il. Tant que son corps serait encore chaud, les narines sensibles du chien ne manqueraient pas de flairer sa trace. Il s'écroula, effondré. Il ne lui restait plus rien à
faire que de rester là en laissant la vie s'écouler goutte à goutte.
Mais une petite flamme tout au fond de lui refusait de s'éteindre. Dieu miséricordieux, pensat-il dans son délire, il ne pouvait tout de même pas rester là à attendre que les Russes viennent le prendre. Il n'était qu'un professeur de minéralogie, pas un agent secret entraîné. Son esprit et son corps de quadragénaire n'étaient pas prêts à supporter un interrogatoire intensif. S'il vivait, on pourrait lui arracher toute l'histoire en quelques heures. Il ferma les yeux : l'accablement de l'échec vint effacer toute souffrance physique.
Lorsqu'il les rouvrit, son champ visuel était tout entier envahi par la tête d'un énorme chien. Koplin reconnut un Komondor, un berger hongrois, une bête puissante, haute, de quatrevingts centimètres, couverte d'une épaisse toison de poils blancs. Le grand chien poussait des grognements sauvages et aurait sauté à la gorge de Koplin s'il n'avait pas été tenu en laisse par la main gantée d'un soldat soviétique. L'homme avait un air indifférent, il était planté là à
contempler sa proie désemparée, serrant la laisse dans sa main gauche pendant que sa main droite tenait un fusil-mitrailleur. Il était impressionnant dans sa grande capote qui tombait sur ses bottes jusqu'aux chevilles, et ses yeux pâles et impassibles ne témoignaient d'aucune compassion pour les blessures de Koplin. Le soldat mit son arme en bandoulière et se pencha pour aider Koplin à se relever. Puis, sans un mot, le Russe se mit à traîner l'Américain blessé
vers le poste de sécurité de l'île.
Koplin faillit s'évanouir de douleur. Il avait l'impression qu'on l'avait traîné dans la neige pendant des kilomètres alors qu'en fait il ne s'agissait que d'une cinquantaine de mètres. Il n'avait guère parcouru plus lorsqu'une vague silhouette apparut dans la tourmente, brouillée par le rideau de flocons blancs. Dans la brume de sa demi-conscience, Koplin sentit le soldat se crisper.
Un petit « plop » retentit dans le vent et l'énorme Komondor s'abattit sans bruit sur le flanc dans la neige. Le Russe lâcha Koplin et s'efforça frénétiquement d'épauler son fusilmitrailleur, mais le bruit bizarre se répéta et un petit trou qui s'étoila aussitôt de rouge apparut soudain au milieu du front du soldat. Puis le regard devint vitreux et l'homme s'effondra auprès du chien.
Il se passait quelque chose d'inexplicable ; tout ça n'était pas normal, se dit Koplin, mais son esprit épuisé était incapable de tirer la moindre conclusion valable. Il tomba à genoux et vit un homme de grande taille en parka grise surgir de la brume blanche et regarder le chien.
« Dommage », dit-il sèchement.
L'homme était imposant. Le visage tanné comme un chêne paraissait déplacé dans l'Arctique. Les traits étaient fermés, presque cruels. Mais ce furent les yeux qui frappèrent Koplin : il n'en avait jamais vu de pareils. Ils étaient verts comme de l'eau de mer et rayonnaient d'une sorte de chaleur pénétrante, qui contrastait avec les traits durs du visage. L'homme se tourna vers Koplin en souriant; « Dr Koplin, je présume ? » II parlait d'une voix douce et sans effort.
L'étranger fourra dans sa poche un pistolet muni d'un silencieux, s'agenouilla auprès du blessé
et hocha la tête en voyant le sang qui suintait à travers le tissu de la parka de Koplin. « Je ferais mieux de vous emmener à un endroit où je puisse regarder ça. » Puis il prit Koplin comme on pourrait charger un enfant sur son épaule et se mit à descendre en direction de la mer.
« Qui êtes-vous ? murmura Koplin.
- Je m'appelle Pitt. Dirk Pitt.
- Je ne comprends pas... D'où veniez-vous? » Koplin n'entendit jamais la réponse : le voile noir de l'inconscience s'abattit brusquement et il se laissa sombrer sans protester.
Seagram terminait un Margarita tout en attendant, dans un petit restaurant à deux pas de Capitol Street, de retrouver sa femme pour déjeuner. Elle était en retard. Jamais depuis huit ans qu'ils étaient mariés il ne l'avait vue arriver nulle part à l'heure. Il héla le garçon et commanda un autre verre.
Dana Seagram entra enfin et s'arrêta un moment dans la salle en cherchant son mari du regard. Elle le repéra et commença à naviguer entre les tables dans sa direction. Elle portait un chandail orange et une jupe de tweed marron avec une telle jeunesse qu'on aurait dit une étudiante. Elle avait les cheveux blonds rassemblés dans une écharpe et ses yeux couleur café
avaient une lueur amusée, vive et joyeuse.
« Ça fait longtemps que tu attends ? dit-elle en souriant.
- Dix-huit minutes pour être précis, répondit-il. Soit dix minutes, dix secondes de plus que d'habitude.
- Je suis désolée, fit-elle. L'amiral Sandecker a convoqué une réunion et ça a duré plus tard que je ne pensais.
- Quelle est sa dernière marotte?
- Une nouvelle aile pour le musée de la Marine. Il a obtenu le budget et maintenant il fait des plans pour se procurer les pièces.
- Les pièces ? interrogea Seagram.
- Toutes sortes d'objets sauvés sur des navires célèbres. » Le garçon arriva avec la consommation de Seagram et Dana commanda un Daïquiri. « C'est extraordinaire comme il reste peu de choses : un ou deux gilets de sauvetage du Lusitania, une manche à air du Maine par-ci, une ancre du Bounty par-là, et rien de tout cela n'est décemment abrité sous un même toit.
- Il y a, me semble-t-il, de meilleures façons de claquer l'argent des contribuables. » Elle rougit. « Comment ça?
- Collectionner de vieux débris, dit-il en avançant prudemment, exposer des cochonneries rouillées et bouffées par les ans, impossibles à identifier dans une vitrine pour qu'on puisse béer devant : c'est du gaspillage. »
Les hostilités étaient ouvertes.
« La conservation de navires et de bateaux fournit un élément important du passé historique de l'homme. » Les yeux bruns de Dana flamboyaient. « Contribuer à la connaissance est une entreprise à laquelle un trou du cul comme toi n'entend rien.
- Voila qui est parlé comme une véritable archéologue de la Marine », dit-il. Elle eut un sourire torve. « Ça te casse encore les couilles que ta femme ait fait une carrière, n'est-ce pas?
- La seule chose qui me casse les couilles, mon trésor, c'est ton langage de salle de garde. Pourquoi donc chaque femme libérée trouve-t-elle chic de s'exprimer de façon ordurière ?
- Tu es mal placé pour me donner une leçon de savoir-vivre, répliqua-t-elle. Cinq ans dans la capitale et tu continues à t'habiller comme un vendeur d'enclumes d'Omaha. Tu ne peux donc pas te coiffer comme tout le monde? Cette façon d'avoir les cheveux taillés en brosse, ça ne se fait plus depuis des années. Ça me gêne quand on nous voit ensemble.
- Ma position dans l'Administration ne me permet pas d'avoir l'air d'un nipple des années 60.
- Mon Dieu, mon Dieu, fit-elle en secouant la tête d'un air las. Pourquoi n'ai-je pas pu épouser un plombier ou un horticulteur? Pourquoi a-t-il fallu que je tombe amoureuse d'un physicien né dans la cambrousse ?
- C'est réconfortant de savoir que tu m'as aimé jadis.
- Je t'aime encore, Gène, dit-elle, son regard s'adoucissant. Cette brèche entre nous ne s'est ouverte que depuis deux ans. Nous ne pouvons même plus déjeuner ensemble sans essayer de nous faire du mal. Pourquoi ne pas envoyer tout ça au diable et passer le reste de l'après-midi à faire l'amour dans un motel ? Je suis d'humeur à me sentir délicieusement excitable.
- Est-ce qu'à la longue ça changerait quelque chose ?
- Ce serait toujours un début.
- Je ne peux pas.
- Toujours ton foutu sens du devoir, dit-elle en détournant la tête. Tu ne vois donc pas? Nos métiers nous ont séparés. Nous pouvons nous sauver, Gène. Nous pouvons tous les deux donner notre démission et revenir à l'enseignement. Avec ton doctorat de physique et mon doctorat d'archéologie, sans parler de notre expérience et de nos références, nous pourrions choisir l'université de notre choix. Nous appartenions à la même faculté quand nous nous sommes rencontrés, tu te souviens. Ce sont les plus heureuses années que nous ayons vécues ensemble.
- Je t'en prie, Dana, je ne peux pas démissionner. Pas maintenant.
- Pourquoi?
- Je suis sur un projet important...
- Depuis ces cinq dernières années tous les projets sont importants, je t'en prie, Gène, je te supplie de sauver notre mariage. Il n'y a que toi qui puisses faire le premier geste. Si nous réussissons à quitter Washington, je serai d'accord avec tout ce que tu décideras. Mais si nous attendons encore, cette ville anéantira tout espoir de sauver notre vie commune.
- Il me faut encore un an.
- Même un mois de plus, ce sera trop tard.
- Je suis engagé dans une affaire qui ne souffre pas de délai.
- Quand cesseront donc ces ridicules projets secrets? Tu n'es qu'un instrument de la MaisonBlanche.
- Je n'ai pas besoin que tu me prodigues tes généreuses foutaises libérales.
- Gène, au nom du ciel, renonce !
- Ça n'est pas au nom du ciel, Dana, c'est au nom de mon pays. Je suis désolé si je n'arrive pas à te faire comprendre ça.
- Renonce, répéta-t-elle, des larmes se formant dans ses yeux. Personne n'est indispensable. Laisse Mel Donner prendre ta place. »
II secoua la tête. « Non, dit-il d'un ton ferme. J'ai créé ce projet à partir de rien. C'est ma matière grise qui l'a engendré. Il faut que je veille à son aboutissement. »
Le serveur réapparut en demandant s'ils étaient prêts à commander !
Dana secoua la tête. « Je n'ai pas faim. » Elle se leva et le regarda. « Tu rentreras pour dîner?
- Je vais travailler tard au bureau. »
Elle ne parvenait plus maintenant à retenir ses larmes.
« Quoi que tu fasses, j'espère que ça en vaut la peine, murmura-t-elle. Parce que ça va te coûter un prix terrible. »
Sur quoi elle tourna les talons et s'éloigna à grands pas. Contrairement à l'officier de renseignement russe si souvent représenté dans les films américains, le capitaine André
Prevlov n'avait ni une carrure de taureau ni le crâne rasé. C'était un bel homme, bien bâti, qui portait les cheveux assez longs et arborait une fine moustache. Son image, bâtie autour d'une voiture de sport italienne orange et d'un appartement meublé de façon cossue et dominant la Moskova, n'enthousiasmait pas ses supérieurs du Service de Renseignement de la Marine soviétique. Toutefois, malgré les tendances irritantes de Prevlov, il n'était guère possible de l'évincer de la haute position qu'il occupait dans le service. La réputation qu'il s'était soigneusement bâtie d'être le plus brillant spécialiste du renseignement de la Marine et le fait que son père fût le numéro douze du Parti s'alliaient pour rendre le capitaine Prevlov intouchable.
Du mouvement nonchalant de quelqu'un qui en a l'habitude, il alluma une Winston et se versa un verre de gin de Bombay. Puis il se carra dans son fauteuil et se plongea dans la pile de dossiers que son adjoint, le lieutenant Pavel Marganine, avait déposée sur son bureau.
« C'est un mystère pour moi, mon capitaine, fit doucement Marganine, de voir avec quelle facilité vous vous adaptez à toute cette corruption occidentale. »
Prevlov leva les yeux et lança à Marganine un regard froid et dédaigneux. « Comme tant de nos camarades, vous ne connaissez pas le vaste monde.
Je pense comme un Américain, je bois comme un Anglais, je conduis comme un Italien et je vis comme un Français. Et savez-vous pourquoi, lieutenant ? »
Marganine rougit et marmonna : « Non, mon capitaine.
- Pour connaître l'ennemi, Marganine. La clef, c'est de connaître votre ennemi mieux qu'il ne vous connaisse, mieux qu'il ne se connaisse lui-même. Faites-lui alors ce que vous ne souhaiteriez pas qu'il vous fit.
- C'est une citation du camarade Nerv Tchetsky ? »
Prevlov eut un haussement d'épaules désespéré. «Non, espèce d'idiot; je parodie la Bible chrétienne. » É inhala puis rejeta un flot de fumée par les narines et but une gorgée de gin. «
Étudiez les moeurs occidentales, mon ami. Si nous n'en apprenons rien, alors notre cause est perdue. » II se replongea dans ses dossiers. « Voyons maintenant. Pourquoi adresse-t-on cela à notre service ?
- La seule raison, c'est que l'incident a eu lieu sur une côte ou à proximité d'une région côtière.
- Qu'est-ce que nous savons là-dessus ? fit Prevlov en ouvrant le dossier suivant.
- Très peu de choses. Un soldat chargé de patrouiller dans l'île septentrionale de NouvelleZemble a disparu avec son chien.
- Il n'y a guère de quoi semer l'affolement dans les services de Sécurité. La Nouvelle-Zemble est pratiquement déserte. Une station de missiles démodés, un poste de garde, quelques pêcheurs-aucune installation secrète à des centaines de kilomètres. C'est vraiment une perte de temps de se donner même la peine d'envoyer un homme et un chien patrouiller là-bas.
- Les Occidentaux penseraient sans doute la même chose à l'idée d'envoyer un agent là-bas. »
Prevlov pianota sur la table tout en lorgnant le plafond.
« Un agent? Finit-il par dire. Il n'y a rien là... rien qui présente un intérêt militaire... et pourtant... » II s'interrompit et abaissa une manette de son téléphone intérieur. « Apportez-moi le relevé de la route du navire de l'Agence Nationale de Recherches Océanographiques depuis ces deux derniers jours. »
Marganine haussa les sourcils. « Ils n'oseraient pas envoyer une mission océanographique près de la Nouvelle-Zemble. C'est en plein dans les eaux territoriales soviétiques.
- Nous n'avons aucun droit sur la mer de Barentsz, expliqua Prevlov avec patience. Ce sont des eaux internationales. »
Une jolie secrétaire blonde, vêtue d'un élégant tailleur marron, entra dans la pièce, remit un dossier à Prevlov et ressortit en fermant sans bruit la porte derrière elle. Prevlov feuilleta les papiers jusqu'à ce qu'il trouvât ce qu'il cherchait. « Nous y voici. Le First Attempt, navire de l'ANRO, repéré pour la dernière fois par un de nos chalutiers à trois cent vingt milles nautiques au sud-ouest de la Terre François-Joseph.
- Donc pas loin de la Nouvelle-Zemble, dit Marganine.
- Bizarre, murmura Prevlov. D'après le Plan d'Opérations des Navires Océanographiques américains, le First Attempt aurait dû, à l'époque où on l'a repéré là, faire des études sur le plancton au large des côtes de Caroline du Nord. » II but le reste de son gin, écrasa le mégot de sa cigarette et en alluma une autre. « Une coïncidence bien intéressante.
- Qu'est-ce que ça prouve? demanda Marganine.
- Ça ne prouve rien, mais cela permet de supposer que le soldat qui patrouillait en NouvelleZemble a été tué et que l'agent qui en est responsable s'est échappé, fort probablement pour retrouver le First Attempt. Cela donne à penser que les États-Unis ont une idée derrière la tête quand un navire de recherche de l'ANRO dévie sans explication de son plan de travail prévu.
- Qu'est-ce qu'ils pourraient bien chercher ?
- Je n'en ai pas la moindre idée. » Prevlov se renversa dans son fauteuil et se lissa la moustache. « Demandez des agrandissements des photos prises par satellite des environs immédiats à l'heure de l'événement en question. »
Les ombres du soir obscurcissaient les rues derrière les fenêtres du bureau, lorsque le lieutenant Marganine étala les agrandissements sur le bureau de Prevlov et lui tendit une puissante loupe.
« Votre intuition a payé, mon capitaine. Nous avons ici quelque chose d'intéressant. »
Prevlov examina avec attention les photographies. « Je ne vois rien d'insolite à propos du navire; l'équipement de recherche typique, pas de matériel de détection militaire apparent. »
Marganine désigna une photo prise avec un objectif grand angle et qui révélait à peine un navire sous la forme d'une petite tache blanche sur l'émulsion. « Veuillez noter la petite forme à environ deux mille mètres du First Attempt dans le coin supérieur droit. »
Prevlov regarda à la loupe pendant près d'une demi-minute. « Un hélicoptère !
- Oui, mon capitaine, c'est pourquoi je vous apporte les agrandissements avec un peu de retard. J'ai pris la liberté de faire analyser les photos par la Section R.
- Un appareil de nos patrouilles de sécurité, j'imagine.
- Non, mon capitaine. »
Prevlov fronça les sourcils. « Suggérez-vous que cet hélicoptère appartienne au navire américain?
- C'est leur hypothèse, mon capitaine. » Marganine déposa deux autres photos devant Prevlov.
« Ils ont examiné des clichés antérieurs pris par un autre satellite de reconnaissance. Comme vous pouvez le voir en les comparant, l'hélicoptère suit une route qui va de la NouvelleZemble en direction du First Attempt. Ils ont estimé son altitude à trois mètres et sa vitesse à
moins de quinze nouds.
- De toute évidence pour éviter notre surveillance radar, dit Prevlov.
- Faut-il alerter nos agents en Amérique? dit Marganine.
- Non, pas encore. Je ne veux pas qu'ils risquent leur couverture avant que nous soyons certains de ce que recherchent les Américains. »
II rassembla les photographies et les rangea avec soin dans un dossier, puis consulta son chronomètre Oméga. « J'ai tout juste le temps de prendre une légère collation avant le ballet. Rien d'autre, lieutenant ?
- Juste le dossier sur l'Expédition du Courant Lorelei. Le dernier rapport en date signale le sous-marin américain dans quinze mille pieds d'eau au large de Dakar. »
Prevlov se leva, prit le dossier et le fourra sous son bras. « Je vais étudier ça quand j'en aurai l'occasion. Il n'y a sans doute rien là-dedans qui intéresse la sécurité navale. Malgré tout, ça devrait être une bonne lecture. Comptez sur les Américains pour avoir d'étranges et merveilleux projets. »
« Merde, merde et remerde ! lança Dana. Regarde les pattes-d'oie que je commence à avoir autour des yeux. » Assise à sa coiffeuse, elle contemplait avec consternation son reflet dans le miroir. « Qui donc a dit que la vieillesse était une forme de l'être ? »
Seagram arriva derrière elle, lui souleva les cheveux et posa un baiser sur la chair tiède de son cou.
« Trente et un ans à ton dernier anniversaire, et tu te crois déjà au troisième âge. »
Elle le regarda dans la glace, étonnée de cette rare manifestation d'affection. « Tu as de la chance, les hommes n'ont pas de problème.
- Les hommes souffrent aussi du vieillissement et des pattes-d'oie. Qu'est-ce qui fait croire aux femmes que nous ne craquons pas aux coutures, nous aussi?
- La différence, c'est que vous vous en foutez.
- Nous sommes plus enclins à accepter l'inévitable, dit-il en souriant. À propos d'inévitable, quand vas-tu avoir un bébé ?
- Salaud ! Tu ne renonces jamais, hein ? » Elle jeta une brosse à cheveux sur la coiffeuse, abattant du même coup tout un régiment de flacons de produits de beauté soigneusement rangés sur l'étagère de verre. « Nous en avons discuté cent fois. Je refuse de me soumettre aux épreuves de la grossesse. Je ne veux pas rincer dix fois par jour des langes pleins de merde dans un lavabo. Que quelqu'un d'autre s'occupe de la repopulation. Je ne m'en vais pas me diviser comme une vulgaire amibe.
- Ce sont des raisons bidons. En toute honnêteté, tu n'y crois pas toi-même. »
Elle se retourna vers le miroir sans répondre.
« Un bébé pourrait nous sauver, Dana », dit-il avec douceur.
Elle se prit la tête à deux mains. « Je ne veux pas plus renoncer à ma carrière que toi à ton précieux projet. »
II caressa sa douce chevelure blonde en regardant son image dans le miroir. « Ton père était un alcoolique qui a abandonné sa famille quand vous n'aviez que dix ans. Ta mère travaillait dans un bar et ramenait des hommes à la maison pour gagner de quoi boire. Ton frère et toi étiez traités comme des animaux jusqu'au jour où vous avez eu l'âge de vous enfuir de cette poubelle que vous appeliez votre maison. Il a mal tourné et il s'est mis à attaquer les débits de boisson et les stations-service; charmante occupation qui lui a valu une condamnation pour meurtre et la prison à vie à San Quentin. Dieu sait que je suis fier de la façon dont tu t'es arrachée à cet égout en travaillant dix-huit heures par jour pour faire tes études. Oui, tu as eu une sale enfance, Dana, et tu as peur d'avoir un bébé à cause de tes souvenirs. Mais il faut que tu comprennes : ton cauchemar n'appartient pas à l'avenir; tu ne peux pas refuser à un fils ou à
une fille une chance de vivre. »
La muraille de pierre demeura sans brèche. Elle repoussa les mains toujours posées sur ses cheveux et se mit à s'épiler les sourcils avec rage. La discussion était close; elle l'avait fait taire de façon aussi définitive que si elle l'avait amené à quitter la pièce. Lorsque Seagram sortit de sous la douche, Dana était plantée devant une glace en pied. Elle s'étudiait d'un oeil aussi critique qu'un modéliste en train d'observer pour la première fois une création terminée. Elle portait une simple robe blanche qui lui moulait le torse avant de tomber jusqu'à ses chevilles. Le décolleté était vague et offrait une vue généreuse sur ses seins.
« Tu ferais mieux de te dépêcher », dit-elle d'un ton très naturel. On aurait dit que la querelle n'avait jamais eu lieu. « II ne s'agit pas de faire attendre le Président.
- Il y aura plus de deux cents personnes là-bas. Personne ne nous mettra une mauvaise note si nous sommes en retard.
- Ça m'est égal. » Elle eut une petite moue. « Ça n'est pas tous les jours que nous sommes invités à la Maison-Blanche. J'aimerais au moins faire une bonne impression en arrivant à
l'heure. »
Seagram soupira et s'attaqua au délicat rituel qui consistait à faire son noud de cravate, puis à
passer ses boutons de manchette d'une seule main.
S'habiller pour ces soirées officielles était une corvée qu'il abhorrait. Pourquoi donc les réceptions à Washington ne pouvaient-elles se passer en songeant au confort des invités ?
C'était peut-être pour Dana un événement excitant, mais pour lui, c'était une perspective assommante.
Il acheva de frotter ses chaussures et de se peigner, puis passa dans le salon. Dana était assise sur le divan, à examiner des rapports, son porte-documents ouvert sur la table basse. Elle était si absorbée qu'elle ne leva pas les yeux lorsqu'il entra.
« Je suis prêt.
- Je suis à toi dans un instant, murmura-t-elle. Pourrais-tu s'il te plaît aller me chercher mon étole?
- C'est le plein été. Pourquoi diable veux-tu transpirer dans une fourrure ? »
Elle ôta ses lunettes à monture d'écaillé et dit : « Je trouve que l'un de nous au moins devrait avoir un peu de classe, tu ne penses pas ? »
II passa dans le vestibule, décrocha le téléphone et composa un numéro. Mel Donner répondit au milieu de la première sonnerie.
« Donner.
- Toujours pas de nouvelles? demanda Seagram.
- Le First Attem.pt...
- C'est ce navire de l'ANRO qui était censé recueillir Koplin ?
- Oui. Il est passé au large d'Oslo il y a cinq jours.
- Mon Dieu? Pourquoi? Koplin devait débarquer et prendre de là un avion commercial pour rentrer.
- Pas moyen de savoir. Suivant tes instructions, le navire observe un total silence radio.
- Ça ne sent pas bon.
- Ça n'était pas prévu, en tout cas.
- Je serai à la soirée du Président jusque vers onze heures. Si tu apprends quoi que ce soit, appelle-moi.
- Tu peux y compter. Amuse-toi bien. » Seagram raccrochait juste au moment où Dana arriva du salon. Elle vit l'expression songeuse de son visage. « Mauvaises nouvelles ?
- Je ne suis pas encore certain. »
Elle l'embrassa sur la joue. « C'est quand même dommage que nous ne puissions pas vivre comme des gens normaux pour que tu puisses me confier tes problèmes. »
II lui pressa la main. « Si seulement je pouvais...
- Ces secrets d'État. Quel ennui! Elle eut un petit sourire. Eh bien?
- Eh bien quoi ?
- Tu ne vas pas te conduire en gentleman ?
- Pardonne-moi. J'allais oublier. » II prit son étole dans la penderie et la lui glissa sur les épaules.
« C'est une mauvaise habitude que j'ai de ne pas m'occuper de ma femme. »
Un sourire moqueur s'épanouit sur ses lèvres. « Pour te punir, tu seras fusillé à l'aube. »
Bonté divine, pensa-t-il avec horreur, je ne serai peut-être pas si loin du peloton d'exécution si Koplin a déconné en Nouvelle-Zemble.
Les Seagram s'installèrent derrière la foule rassemblée à l'entrée du Salon Est et attendirent leur tour dans la cohue des invités. Dana était déjà venue à la Maison-Blanche, mais le cadre l'impressionnait encore.
Le Président était là, élégant et diablement bel homme. La cinquantaine à peine passée, il était très séduisant. Il n'y avait d'ailleurs qu'à voir debout auprès de lui, accueillant chaque invité
avec la ferveur qu'on met à découvrir un parent fortuné, Ashley Fleming, la divorcée la plus élégante et la plus sophistiquée de Washington.
« Oh, merde ! » s'exclama Dana.
Seagram la regarda en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?
- La pépée à côté du Président.
- Figure-toi que c'est Ashley Fleming.
- Je sais, chuchota Dana en essayant de se dissimuler derrière la carrure rassurante de Seagram. Regarde sa robe. »
Seagram ne comprit pas tout de suite, puis la vérité le frappa, et il eut toutes les peines du monde à maîtriser une violente envie de rire... « Bon sang, mais vous portez toutes les deux la même robe !
- Ça n'est pas drôle, dit-elle d'un ton sévère.
- Où as-tu acheté la tienne ?
- Je l'ai empruntée à Annette Johns.
- La lesbienne qui habite en face de chez nous, le mannequin?
- Le modèle lui a été donné par Claude d'Orsini, le couturier. »
Seagram la prit par la main. « En tout cas, ça montre quel bon goût a ma femme. »
Avant qu'elle eût le temps de répondre, la file avança de quelques pas et ils se trouvèrent soudain plantés devant le Président.
« Gène, ravi de vous voir. » Le Président eut un sourire poli.
« Merci de nous avoir invités, monsieur le Président. Vous connaissez ma femme, Dana. »
Le Président l'examina, ses yeux s'attardant sur le décolleté. « Bien sûr, charmante, tout à fait charmante. » Puis il se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Dana ouvrit de grands yeux et devint toute rouge.
Le Président se redressa et dit : « Puis-je vous présenter ma délicieuse hôtesse, Miss Ashley Fleming. Ashley, M. et Mrs Gène Seagram.
- Je suis enchanté de faire enfin votre connaissance, Miss Fleming », murmura Seagram. Il aurait aussi bien pu s'adresser à un arbre. Le regard d'Ashley Fleming découpait en lambeaux la robe de Dana.
« II me semble évident, Mrs Seagram, dit Ashley d'un ton suave, que dès demain matin, l'une de nous va se mettre en quête d'un nouveau couturier.
- Oh, je ne pourrai pas changer, répondit Dana avec une charmante innocence. Je vais chez Jacques Pinnegh depuis que je suis petite fille. »
Les sourcils soigneusement dessinés d'Ashley Fleming se mirent en accent circonflexe.
« Jacques Pinnegh ? Je n'ai jamais entendu parler de lui.
- Il est plus connu sous le nom de J.C. Penney, fit Dana avec un exquis sourire. Ils font des soldes le mois prochain au rayon de prêt-à-porter. Ce serait drôle d'y aller ensemble. Comme ça, nous ne nous retrouverions pas ayant l'air de deux jumelles. »
Le visage d'Ashley Fleming n'était qu'un masque d'indignation tandis que le Président était pris d'une violente quinte de toux. Seagram fit un petit salut de la tête, empoigna Dana par le bras et l'entraîna à grands pas vers le coeur de la foule.
« Tu étais obligée de faire ça? grommela-t-il.
- Je n'ai pas pu résister. Cette femme n'est qu'une putain de haut vol. » Là-dessus Dana leva vers lui un regard abasourdi. « II m'a fait des propositions, fit-elle, incrédule. Le Président des États-Unis m'a fait des propositions.
- Harding et Kennedy avaient la réputation d'être de joyeux viveurs. Lui n'est pas différent. Après tout, ce n'est qu'un être humain.
- Un paillard comme Président. C'est répugnant.
- Tu vas le prendre au mot ? fit Seagram en souriant.
- Ne sois pas ridicule, riposta-t-elle.
- Puis-je me joindre à la bataille ? » La question venait d'un petit homme aux cheveux d'un roux flamboyant, et qui portait une pimpante veste de smoking bleu vif. Il avait une barbe taillée avec soin de la même couleur que ses cheveux et qui faisait ressortir ses yeux noisette au regard perçant. La voix parut vaguement familière à Seagram, mais le visage ne lui disait rien.
« Ça dépend dans quel camp vous êtes, dit Seagram.
- Connaissant le penchant de votre femme pour le MLF, dit l'inconnu, je serais trop heureux de rallier les rangs de son mari.
- Vous connaissez Dana?
- Je devrais. Je suis son patron. »
Seagram le considéra avec stupéfaction. « Alors vous devez être...
- L'amiral James Sandecker, intervint Dana en riant, Directeur de l'Agence Nationale de Recherches Océanographiques ; puis-je vous présenter Gène, mon mari, qui se démonte facilement.
- Très honoré, amiral, dit Seagram en tendant la main. J'attendais avec impatience l'occasion de vous remercier en personne de cette petite faveur. »
Dana parut surprise. « Vous vous connaissez tous les deux? »
Sandecker acquiesça. « Nous nous sommes parlé au téléphone mais nous ne nous étions jamais rencontrés. »
Dana prit les deux hommes par le bras. « Mes deux hommes préférés qui complotent derrière mon dos. Qu'est-ce que ça veut dire ? »
Seagram regarda Sandecker droit dans les yeux. « J'ai un jour appelé l'amiral pour lui demander un petit renseignement. Voilà tout. »
Sandecker prit Dana par la main et lui dit : « Pourquoi ne pas vous gagner la reconnaissance éternelle d'un vieil homme en allant lui chercher un scotch. »
Elle hésita un moment, puis posa un baiser léger sur la joue de Sandecker et, docile, entreprit de se frayer un chemin au milieu des groupes qui stationnaient aux environs du buffet. Seagram secoua la tête avec admiration. « Vous savez vous y prendre avec les femmes. Si je lui avais demandé d'aller me chercher un verre, elle m'aurait craché à la figure.
- Moi, dit Sandecker, je lui paie un salaire. Vous pas. »
Ils sortirent sur le balcon et Seagram alluma une cigarette tandis que Sandecker tirait sur un énorme cigare à la Churchill. Ils marchèrent en silence jusqu'à ce qu'ils fussent seuls dans un coin à l'écart, sous une haute colonne.
« Pas de nouvelles du First Attempt de votre côté ? demanda Seagram.
- Il a accosté à notre base sous-marine du Firth of Clyde à treize heures, heure de Washington.
- Ça fait près de huit heures. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu ?
- Vos instructions étaient très claires, dit Sandecker d'un ton froid. Aucune communication émanant de mon navire tant que votre agent n'était pas de retour sain et sauf sur le sol américain.
- Mais alors comment?...
- J'ai eu mes renseignements d'un vieil ami de la Marine. Il m'a téléphoné il n'y a pas une demi-, heure, fou de rage, en exigeant de savoir au nom de quoi le commandant de mon bateau utilisait sans autorisation des installations de la Marine de guerre.
- Il y a eu un cafouillage quelque part, dit Seagram. Votre navire était censé faire escale à
Oslo et laisser mon homme débarquer. Qu'est-ce qu'il fout en Ecosse ? »
Sandecker regarda Seagram sans douceur. « Mettons les choses bien au point, M. Seagram, l'ANRO n'est pas une branche de la CIA, du FBI ni d'aucun autre service de renseignements, et je n'aime pas beaucoup risquer la vie de mes gens juste pour que vous puissiez fourrer votre nez en territoire communiste et jouer aux petits espions. Notre travail, c'est la recherche océanographique. La prochaine fois que vous voudrez jouer les James Bond, demandez à la Marine ou aux Garde-côtes de faire votre sale boulot. N'allez pas intriguer auprès du Président pour qu'il donne des ordres à l'un de mes navires. Vous comprenez, M. Seagram ?
- Je suis désolé du dérangement que cela a pu occasionner à votre agence, amiral. Je ne voulais absolument pas être désagréable, mais vous devez comprendre mon inquiétude.
- J'aimerais la comprendre. » L'expression de l'amiral parut s'adoucir un peu. « Mais vous rendriez les choses fichtrement plus simples si vous vouliez bien me faire confiance et me dire ce que vous cherchez.
- Je suis désolé, dit Seagram en détournant la tête.
- Je vois, fit Sandecker.
- Pourquoi, à votre avis, le First Attempt n'a-t-il pas fait escale à Oslo ? demanda Seagram.
- Je pense que votre agent a estimé trop dangereux de prendre un avion civil pour quitter Oslo et qu'il a choisi un avion militaire. Notre base sous-marine nucléaire du Firth of Clyde est celle qui est la plus proche d'un terrain, alors il a sans doute ordonné au commandant de mon navire océanographique de passer au large de la Norvège et de mettre le cap sur l'Ecosse.
- J'espère que vous avez raison. Mais je crains que ce changement apporté à notre plan initial ne soit signe de difficultés. »
Sandecker aperçut Dana debout sur le seuil du balcon, un verre à la main. Elle les cherchait. Il lui fit un signe qu'elle aperçut et elle s'approcha d'eux.
« Vous êtes un heureux homme, Seagram. Votre femme est une fille tout à fait remarquable. »
Mel Donner apparut tout d'un coup, se précipita devant Dana et arriva le premier auprès d'eux. Il présenta ses excuses à l'amiral Sandecker.
« Un avion de transport de la Marine vient de se poser il y a vingt minutes, avec Sid Koplin à
bord, murmura Donner. On l'a conduit à l'hôpital Walter Reed.
- Pourquoi Walter Reed ?
- Il a été assez salement blessé.
- Seigneur, gémit Seagram.
- J'ai une voiture qui attend. Nous pouvons être là-bas dans un quart d'heure.
- Bon, donne-moi quelques minutes. » II revint vers Sandecker et demanda à l'amiral de bien vouloir raccompagner Dana, puis il exprima ses regrets au Président, et il suivit Donner jusqu'à la voiture.
« Je suis navré, mais on lui a administré des calmants et je ne peux autoriser aucun visiteur pour l'instant. » La voix aristocratique était calme et courtoise, mais il était impossible de ne pas voir la colère qui flamboyait dans les yeux gris du médecin.
« Est-il capable de parler ? demanda Donner.
- Pour un homme qui a repris connaissance voilà quelques minutes à peine, ses facultés mentales sont tout à fait remarquables. » Les yeux étincelaient toujours. « Mais ne vous y laissez pas tromper : il ne va pas jouer au tennis d'ici quelque temps.
- Dans quelle mesure son état est-il sérieux? demanda Seagram.
- Son état est exactement ça : sérieux. Le médecin qui l'a opéré à bord du navire de l'ANRO a fait du beau travail. La blessure par balle qu'il a au côté gauche cicatrisera sans problème. Mais l'autre blessure a laissé une toute petite fissure dans la boîte crânienne. Votre ami Koplin aura de temps en temps des migraines.
- Il faut que nous le voyions maintenant, dit Seagram d'un ton ferme.
- Comme je vous l'ai dit, je regrette, mais pas de visite. »
Seagram fit un pas en avant et vint se planter devant le médecin, presque à le toucher. «
Mettez-vous ça dans la tête, docteur. Mon ami et moi allons entrer dans cette chambre, que ça vous plaise ou non. Si vous essayez personnellement de nous en empêcher, nous vous déposerons sur une de vos tables d'opération. Si vous appelez vos infirmiers à l'aide, nous leur tirerons dessus. Si vous alertez la police, ils respecteront nos pouvoirs et feront ce que nous leur dirons. » Seagram s'arrêta et ses lèvres esquissèrent un sourire satisfait. « Maintenant, docteur, à vous de choisir. »
Koplin était allongé dans le lit, le visage aussi blanc que la taie d'oreiller derrière la tête, mais son regard était étonnamment vif.
« Avant que vous ne le demandiez, dit-il d'une voix sourde et rauque, je me sens très mal foutu. Et c'est vrai. Mais ne me dites pas que j'ai l'air bien. Parce que ce serait un mensonge éhonté. »
Seagram approcha une chaise du lit et sourit. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, Sid, alors si vous vous sentez» d'attaque, nous irons droit au fait. »
Koplin désigna du menton les tuyaux branchés sur son bras. « Ces saloperies m'embrument l'esprit, mais j'essaierai de tenir le coup aussi longtemps que possible. »
Donner hocha la tête. « Nous sommes venus vous poser la question à vingt millions cash.
- Si c'est ce que vous voulez dire, j'ai trouvé des traces de byzanium.
- Vous en avez trouvé! Vous êtes certain?
- Mes essais sur le terrain ne sont évidemment pas aussi précis qu'aurait pu l'être une analyse en labo, mais je suis sûr à 99 % que c'était du byzanium.
- Dieu soit loué, soupira Seagram. Avez-vous obtenu un chiffre de titrage ? demanda-t-il.
- Mais oui.
- Combien... combien de kilos de byzanium estimez-vous qu'on puisse extraire du mont Bednaya?
- Avec de la chance, peut-être une cuillerée à café. »
Seagram ne comprit pas tout de suite, mais la vérité le frappa de plein fouet. Donner était assis, pétrifié et sans expression, les mains crispées sur les bras de son fauteuil.
« Une cuillerée à café, murmura Seagram, accablé. Vous êtes sûr?
- Vous n'arrêtez pas de me demander si je suis sûr. » Le visage aux traits tirés de Koplin rougit d'indignation. « Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, envoyez donc quelqu'un d'autre dans ce foutu bled.
- Un instant, fit Donner en posant une main apaisante sur l'épaule de Koplin. La NouvelleZemble, c'était notre seul espoir. Vous en avez bavé là-bas plus que vous ne pouviez vous y attendre. Nous vous sommes reconnaissants, Sid, vraiment reconnaissants.
- Tout espoir n'est pas encore perdu », murmura Koplin. Ses paupières s'abaissèrent. Seagram n'avait pas entendu, il se pencha vers le lit. « Quoi donc, Sid?
- Vous n'avez pas encore perdu. Le byzanium était bien là. »
Donner s'approcha. « Comment ça, le byzanium était bien là ?
- Disparu... Extrait...
- Je ne vous comprends pas.
- Je suis tombé sur des débris minéraux au fond de la montagne. » Koplin hésita un moment. «
J'ai creusé un peu...
- Vous voulez dire que quelqu'un a déjà extrait du byzanium du mont Bednaya? fit Seagram, incrédule.
- Oui.
- Bonté divine, fit Donner. Les Russes sont sur la même piste que nous.
- Non... non... », chuchota Koplin.
Seagram colla son oreille contre les lèvres de Koplin.
« Pas les Russes... »
Seagram et Donner échangèrent des regards déconcertés.
Koplin essaya de serrer la main de Seagram. « Les... Les... gars du Colorado... »
Là-dessus, ses yeux se fermèrent et il sombra dans l'inconscience.
Ils traversèrent à pas lents le parc de stationnement tandis qu'au loin gémissait la sirène d'une ambulance. « Qu'est-ce que tu crois qu'il a voulu dire ? demanda Donner.
- Je n'en sais rien, répondit Seagram d'un ton vague. Je n'en sais vraiment rien. »
« Qu'est-ce qu'il y a de si important pour vous faire me réveiller le jour où je ne suis pas de service ? » grommela Prevlov. Sans attendre de réponse, il ouvrit la porte sans douceur et fit signe à Marganine d'entrer dans l'appartement. Prevlov portait un peignoir de soie japonais; il avait les traits tirés, l'air fatigué.
Tout en traversant à la suite de Prevlov la salle de séjour pour passer dans la cuisine, le regard professionnel de Marganine s'attarda sur le mobilier, en inventoriant chaque pièce. Pour quelqu'un qui vivait dans une petite chambre de caserne de deux mètres cinquante sur trois mètres cinquante, le décor, les vastes proportions de l'appartement évoquaient plutôt le Palais d'Été de Pierre le Grand. Tout y était, les lustres de cristal, les tapisseries tombant du plafond jusqu'au parquet, les meubles français. Ses yeux remarquèrent aussi deux verres et une bouteille à demi vide de Chartreuse sur le dessus de la cheminée ; et sur le sol, sous le divan, dépassait une paire de chaussures de femme. Des chaussures chères, occidentales d'après l'aspect. Il saisit au passage un cheveu et se surprit à contempler la porte fermée de la chambre à coucher. Elle devait être fort séduisante : le capitaine Prevlov était difficile.
Prevlov se pencha sur l'intérieur du frigidaire et y prit un carafon de jus de tomate. « Vous en voulez? »
Marganine secoua la tête.
« Vous mélangez ça avec les ingrédients qu'il faut, murmura Prevlov, comme font les Américains, et vous avez un excellent médicament contre la gueule de bois. » II but une gorgée du jus de tomate et fit la grimace. « Alors, que voulez-vous ?
- Le KGB a reçu hier soir un message d'un de ses agents à Washington. Ils n'en comprenaient absolument pas la signification et espéraient que nous pourrions peut-être les éclairer un peu.
»
Marganine rougit. La ceinture du peignoir de Prevlov s'était dénouée et il pouvait constater que le capitaine ne portait rien dessous.
« Bon, soupira Prevlov, continuez.
- Le message disait : « Américains brusquement intéressés recueillir cailloux. Opération ultrasecrète sous nom de code Projet Sicile. »
Prevlov le regarda par-dessus son Bloody Mary. « Qu'est-ce que c'est que cette foutaise ?» Il vida son verre d'une gorgée et le reposa avec brutalité sur le bord de l'évier. « Notre illustre service de renseignement frère, le KGB, est-il devenu une maison de fous ? » C'était la voix impassible et efficace du Prevlov officiel : froide et sans inflexion aucune, sinon un ennui qui confinait à l'irritation. « Et vous, lieutenant? Pourquoi venez-vous me déranger maintenant avec cette charade puérile? Est-ce que ça n'aurait pas pu attendre demain matin que je sois de retour au bureau ?
- Je... j'ai pensé peut-être que c'était important, balbutia Marganine.
- Naturellement. » Prevlov eut un sourire glacé. « Chaque fois que le KGB siffle, les gens sautent. Les menaces voilées ne m'intéressent pas. Les faits, mon cher lieutenant, les faits, voilà ce qui m'intéresse. Que trouvez-vous donc de si important dans ce Projet Sicile ?
- Il m'a semblé que l'allusion à la collection de cailloux pouvait avoir un rapport avec le dossier sur la Nouvelle-Zemble. »
Vingt secondes peut-être s'écoulèrent avant que Prevlov répondît. « C'est possible. C'est possible, mais nous n'avons aucune certitude qu'il y ait un rapport.
- Je... j'ai pensé...
- Je vous en prie, lieutenant, laissez-moi penser tout seul. » II resserra la ceinture de son peignoir. « Maintenant, si vous n'avez plus d'autre chasse aux sorcières de ce genre à me proposer, j'aimerais bien me recoucher.
- Et si les Américains recherchent quelque chose ?
- Oui, mais quoi? demanda sèchement Prevlov. Quel minéral est si précieux pour eux qu'ils doivent aller le rechercher dans un pays qui n'est pas ami? »
Marganine haussa les épaules.
« Répondez à cette question, et vous aurez la clef de l'énigme. »
Le ton de Prevlov se fit un peu plus dur. « En attendant, je veux des solutions. N'importe quel crétin de paysan peut poser des questions stupides. »
Le visage de Marganine s'empourpra de nouveau. « Les Américains ont parfois des sens cachés dans leurs noms de code.
- En effet, dit Prevlov avec une feinte gravité. Ils ont un penchant pour la publicité. »
Marganine se lança. « J'ai fait des recherches sur les expressions américaines faisant allusion à la Sicile, et ce qui domine, ce semble être leur obsession concernant une fraternité de bandits et de gangsters.
- Si vous aviez bien fait vos devoirs... fit Prevlov en bâillant... vous auriez découvert que cela s'appelle la Mafia.
- Il existe aussi un ensemble musical qui s'appelle les Stylets de Sicile. »
Prevlov tourna vers Marganine un regard glacial.
« II y a aussi une grosse usine de produits alimentaires du Wisconsin qui fabrique une huile d'olive sicilienne.
- Assez ! fit Prevlov en levant la main. De l'huile d'olive. Je ne me sens pas de taille à
affronter de telles stupidités à une heure aussi matinale. » II désigna la porte du palier. « Je suis sûr que vous avez d'autres projets à notre bureau plus stimulants que le ramassage des cailloux. »
Dans le salon il s'arrêta devant une table sur laquelle était posé un échiquier en ivoire sculpté
et il déplaça une des pièces. « Dites-moi, lieutenant, vous jouez aux échecs ? »
Marganine secoua la tête. « Pas depuis longtemps. Je jouais un peu quand j'étais cadet à
l'Académie navale.
- Le nom d'Isaak Boleslavski vous dit-il quelque chose ?
- Non, mon capitaine.
- Isaak Boleslavski était un de nos plus grands maîtres d'échecs, déclara Prevlov, comme s'il faisait la leçon à un collégien. Il a conçu un grand nombre de remarquables variations du jeu. L'une d'elles s'appelait La Défense sicilienne. » II lança d'un geste nonchalant le roi noir à
Marganine qui l'attrapa au vol. « Un jeu fascinant, les échecs. Vous devriez vous y remettre. »
Prevlov se dirigea vers la porte de la chambre et l'entrebâilla. Puis il se retourna et adressa à
Marganine un sourire indifférent. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Vous pouvez disposer. Au revoir, lieutenant. »
Une fois sorti, Marganine contourna l'immeuble où se trouvait l'appartement de Prevlov et passa derrière. La porte qui donnait sur le garage était fermée à clef; il jeta un coup d'oeil furtif dans la ruelle, puis frappa à petits coups avec son poing sur le carreau d'une fenêtre de côté
jusqu'à ce que le verre se brisât. Il ramassa avec soin les morceaux pour pouvoir passer la main à l'intérieur et débloquer la fermeture. Encore un coup d'oeil autour de lui, puis il poussa le châssis, enjamba l'appui de la fenêtre et pénétra dans le garage. Une limousine noire, une Ford américaine, était garée auprès de la Lancia orange de Prevlov. Marganine eut tôt fait de fouiller les deux voitures et d'apprendre par cour les numéros de la plaque diplomatique de la Ford. Pour faire croire que c'était l'ouvre d'un cambrioleur, il ôta les balais d'essuie-glace - ce genre de vol était un passe-temps national en Union soviétique - puis ouvrit de l'intérieur la porte du garage et sortit.
Il revint à grands pas vers la façade de l'immeuble et n'eut que trois minutes à attendre pour le tramway suivant. Il régla le contrôleur, s'installa sur une banquette et regarda par la fenêtre. Puis il se mit à sourire. C'avait été une bien bonne matinée.
Rien ne pouvait être plus loin de ses pensées que le Projet Sicile.
DEUXIÈME PARTIE
LES GARS DU COLORADO
Août 1987
Mel Donner vérifia par habitude que la pièce ne comportait aucun dispositif d'écoute électronique et mit en marche le magnétophone. « Essai de niveau de voix. » II parla dans le microphone d'une voix sans timbre. « Un, deux, trois. » D régla les manettes de volume et de tonalité, puis fit signe à Seagram.
« Nous sommes prêts, Sid, fit Seagram avec douceur. Dès que ça commencera à vous fatiguer, dites-le-nous, et nous interromprons jusqu'à demain. »
Le lit de l'hôpital avait été réglé de façon que Sid Koplin était assis presque droit. Le minéralogiste semblait en bien meilleur état que lors de leur dernière rencontre. Il avait repris des couleurs et ses yeux brillaient d'un éclat plus vif. Seul le bandage autour de son crâne chauve portait témoignage [qu’il avait été blessé. « Je tiendrai jusqu'à minuit, dit-il. Tout pour me distraire de cet ennui. Je déteste les hôpitaux. Les infirmières ont toutes des mains glacées et la couleur n'arrête pas de changer sur ce foutu poste de télé. »
Seagram sourit et posa le microphone entre les jambes de Koplin. « Si vous commenciez par votre départ de Norvège.
- Sans histoire, dit Koplin. Le chalutier norvégien Godhawn a remorqué mon sloop jusqu'à
deux cents milles de la Nouvelle-Zemble, comme prévu. Le capitaine a ensuite offert au condamné un somptueux repas de rôti de renne avec de la sauce au fromage de chèvre, l'a généreusement gratifié de six bouteilles d'Aquavit, a largué l'amarre et expédié votre serviteur vers les eaux de la mer de Barentsz.
- Pas de problèmes de temps ?
- Aucun : vos prévisions météorologiques étaient parfaites. Il faisait un froid à geler les testicules d'un ours polaire, mais j'ai eu sur tout le trajet un temps excellent pour naviguer. »
Koplin s'arrêta pour se gratter le nez. « C'était un joli petit sloop que vos amis norvégiens m'avaient procuré. On l'a récupéré ? »
Seagram secoua la tête. « II faudra que je vérifie, mais je suis presque sûr qu'on a dû le détruire. Il n'y avait pas moyen de l'embarquer à bord du navire océanographique de l'ANRO, et on ne pouvait pas le laisser dériver sur la route d'un bateau soviétique. Vous comprenez.
- Dommage, fit Koplin avec tristesse. J'avais fini par m'y attacher.
- Continuez, je vous prie, dit Seagram.
- J'ai relevé l'île septentrionale de la Nouvelle-Zemble à la fin de l'après-midi du second jour. J'étais à la barre depuis plus de quarante heures, à sommeiller de temps en temps et je commençais à être incapable de garder les yeux ouverts. Dieu merci, j'avais l'Aquavit. Après quelques lampées, j'avais l'estomac qui me brûlait comme un feu de forêt et ça m'a réveillé
d'un coup.
- Vous n'avez pas aperçu d'autres navires ?
- Je n'en ai jamais repéré un seul à l'horizon, répondit Koplin. La côte, poursuivit-il, s'est révélée être une étendue apparemment sans fin de falaises rocheuses. Je n'ai vu aucun endroit où tenter de débarquer : d'ailleurs la nuit commençait à tomber. Alors j'ai remis le cap au large, je me suis mis en panne et j'ai réussi à dormir quelques heures. Au matin j'ai longé les falaises jusqu'au moment où j'ai repéré une petite crique abritée et je suis alors entré en utilisant le moteur diesel.
- C'est votre bateau qui vous a servi de camp de base?
- Pendant les douze jours suivants. Je faisais deux, parfois trois voyages d'exploration par jour à ski, en prospectant avant de revenir prendre un repas chaud et passer une bonne nuit de repos dans une couchette douillette.
- Et jusque-là, vous n'aviez vu personne ?
- J'ai évité avec soin la base de missiles de Kelva et le poste de garde de Kama. Je n'ai vu aucune trace des Russes jusqu'au dernier jour de la mission.
- Comment avez-vous été découvert?
- Un soldat russe en patrouille ; son chien avait dû croiser ma piste et flairer mon odeur. Pas étonnant. Ça faisait près de trois semâmes que je n'avais pas pris de bain. »
Seagram eut un bref sourire. Donner reprit l'interrogatoire, sur un ton plus froid, plus agressif.
« Revenons à vos voyages d'exploration. Qu'avez-vous trouvé ?
- Je ne pouvais pas parcourir toute l'île à ski, alors je me suis concentré sur les régions prometteuses qui avaient été localisées d'après les calculs fournis par l'ordinateur du satellite.
» II regarda le plafond. « L'île septentrionale ; - la continuation dans l'océan des chaînes de l'Oural et du Yougorski, quelques vastes plaines, des plateaux et des montagnes, dont la plupart sont couvertes d'une couche de glace éternelle. En général, des vents violents. Le froid est meurtrier. Je n'ai trouvé aucune autre végétation que quelques lichens. S'il y avait des animaux à sang chaud, ils ne se montraient pas.
- Revenons-en à la prospection, fit Donner, et gardons la conférence de voyage pour une autre fois.
- C'était juste pour expliquer ce qu'est le terrain, fit Koplin en lançant à Donner un regard de reproche, et il reprit d'un ton glacial : Si je puis poursuivre sans être interrompu...
- Bien sûr », dit Seagram. Il installa sa chaise dans une position stratégique entre le lit et Donner. « C'est à vous de jouer, Sid, et nous suivrons vos règles.
« Merci. » Koplin se réinstalla de façon plus confortable. « Du point de vue géographique, l'île est très intéressante. Une description des failles et des soulèvements de roches qui n'étaient jadis que des sédiments constitués au fond d'une ancienne mer pourrait emplir plusieurs ouvrages. Sur le plan minéralogique, la paragénèse magmatique est nulle.
- Voudriez-vous avoir l'obligeance de traduire cela ? »
Koplin sourit. « L'origine et l'apparition géologiques d'un minerai s'appelle paragénèse. Le magma, d'autre part, est la source de toute matière ; ce sont des roches liquides, chauffées sous pression et qui deviennent solides pour former une roche éruptive, peut-être plus connue sous le nom de basalte ou de granit.
- Fascinant, dit sèchement Donner. Alors, ce que vous affirmez, c'est que la Nouvelle-Zemble ne contient pas de minerai.
- Vous êtes étonnamment perceptif, M. Donner, fit Koplin.
- Mais comment avez-vous trouvé des traces de byzanium? demanda Seagram.
- Le treizième jour, je fouillais sur la pente nord du mont Bednaya et je suis tombé sur un amas de déblais.
- Un amas de déblais ?
- Un entassement de rochers qui avaient été enlevés lors de l'excavation d'un puits de mine. J'ai repéré parmi ces déblais des traces infimes de minerai de byzanium. »
Le visage de ceux qui l'interrogeaient se fit soudain grave.
« L'entrée du puits était habilement dissimulée, poursuivit Koplin. Il m'a fallu presque tout un après-midi pour la découvrir.
- Une minute, Sid, fit Seagram en touchant le bras de Koplin. Voulez-vous dire que l'entrée de cette mine avait été cachée de propos délibéré ?
- Un vieux truc espagnol. L'orifice est comblé jusqu'à ce qu'il soit au niveau de la pente naturelle de la colline.
- Est-ce que l'amas de déblais ne devrait pas se trouver dans le prolongement de l'entrée ?
demanda Donner.
- Dans des circonstances normales, oui. Mais dans ce cas, les déblais étaient répartis sur une centaine de mètres, suivant un arc qui parcourait le flanc de la montagne vers l'ouest.
- Mais avez-vous quand même découvert l'entrée ? Insista Donner.
- On avait ôté les rails et les traverses pour les wagons de minerai et recouvert l'emplacement de la voie, mais j'ai réussi à en retrouver le tracé en m'éloignant à environ quinze cents mètres et en étudiant la pente de la montagne à la jumelle. Ce qu'on ne pouvait pas voir quand on était dessus devenait évident avec le recul. L'emplacement exact de la mine était dès lors facile à déterminer.
- Qui irait se donner tout ce mal pour cacher une mine abandonnée en plein Arctique ?
demanda Seagram dans le vide. Ça n'a ni méthode ni logique.
- Vous n'avez qu'à moitié raison, Gène, dit Koplin. La logique de cette affaire, je le crains, reste une énigme. Mais la méthode a été brillamment exécutée par des professionnels : les gars du Colorado. »
II avait dit cela avec lenteur, presque avec respect. « Ce sont les hommes qui ont creusé la mine du mont Bednaya. Les corniauds, les pétaradeurs, les creuseurs, les foreurs, les gars de Cornouailles, d'Irlande, d'Allemagne et de Suède. Pas des Russes. Mais des hommes qui ont émigré aux États-Unis et sont devenus les mineurs légendaires des Rocheuses du Colorado. Comment ils se sont trouvés sur les pentes glacées du mont Bednaya, c'est un autre problème, mais ce sont ces hommes-là qui sont venus extraire le byzanium et puis qui ont disparu dans les ténèbres de l'Arctique. »
Une expression de totale incompréhension se peignit sur le visage de Seagram. Se tournant vers Donner, il vit le même ahurissement. « Ça semble dingue, absolument dingue.
- Dingue? répéta Koplin. Peut-être, mais ça n'en est pas moins vrai.
- Vous avez l'air rudement sûr de vous, marmonna Donner.
- Je le reconnais. J'ai perdu la preuve tangible de ce que je vous dis lorsque j'ai été pris en chasse par le garde du poste ; vous n'avez que ma parole, mais pourquoi en douter? En tant que savant, je ne fais que rapporter des faits, et je n'ai 'aucun motif tortueux de mentir. Alors, si j'étais vous, messieurs, je me contenterais tout simplement de ma parole.
- Vous avez parlé de preuve tangible, fit Donner, calme et d'une froide efficacité.
- Après avoir pénétré dans le puits de mine - j'ai dégagé sans trop de mal les déblais à la main
: je n'ai eu qu'à creuser un tunnel d'un mètre. La première chose contre laquelle je me sois cogné la tête dans l'obscurité, c'était un convoi de wagonnets. À la quatrième allumette, j'ai découvert une vieille paire de lampes à pétrole. Elles étaient toutes les deux en état de marche et à la troisième tentative, j'ai réussi à les allumer. » Les yeux d'un bleu délavé semblaient contempler on ne sait quoi au-delà du mur de la chambre d'hôpital. « C'était une scène étrange qui dansait à la lueur de la lampe : des pics et des pioches bien rangés sur les râteliers, des wagonnets vides immobilisés sur des rails à voie étroite tout rouilles, du matériel de forage prêt à attaquer la roche ; on aurait dit que la mine attendait que l'équipe suivante vienne extraire le minerai et sortir les déblais.
- Pourriez-vous nous dire si on avait l'impression de gens partis précipitamment?
- Pas du tout. Tout était à sa place. Les couchettes dans un petit dortoir étaient faites, la cuisine était en ordre, tous les ustensiles à leur place. Même les mules qui servaient à
remorquer les wagonnets avaient été emmenées dans une salle et abattues très proprement : leur crâne portait chacun un petit trou rond à leur centre. Non, à mon avis, le départ a été très méthodique.
- Vous n'avez pas encore expliqué ce qui vous a amené à conclure qu'il s'agissait de mineurs du Colorado, dit Donner.
- J'y arrive. » Koplin tapota un oreiller et se tourna tant bien que mal sur le côté. « Tous les indices étaient là, bien sûr. Le matériel lourd portait encore la marque de fabrique de l'usine. Les wagonnets avaient été construits par la fonderie Guthrie et Fils, à Pueblo, dans le Colorado ; le matériel de forage venait des Forges et Ateliers Thor, de Denver, et le petit outillage portait les noms de divers forgerons qui les avaient fabriqués. La plupart provenaient de Central City et d'Idaho Springs, deux villes minières du Colorado. »
Seagram se renversa en arrière sur sa chaise. « Les Russes auraient pu acheter cet équipement au Colorado et l'acheminer jusqu'à l'île.
- Possible, dit Koplin. Toutefois, il y avait quelques autres éléments qui eux aussi désignaient le Colorado.
- Par exemple ?
- Eh bien, le corps allongé dans une des couchettes. » Seagram fronça les sourcils. « Un corps
?
- Avec des cheveux roux et une barbe rousse, précisa Koplin, sans se démonter. Admirablement conservé sous cette température polaire. C'est l'inscription gravée dans le bois au-dessus des montants de la couchette qui m'a le plus intrigué. Elle disait, en anglais, je dois l'ajouter : « Ici repose Jake Hobart, né en 1874. Un bien brave gars mort de froid dans une tempête, 10 février 1912. »
Seagram se leva et se mit à marcher autour du lit. « Un nom : voilà au moins un début. » II s'arrêta pour regarder Koplin. « Restait-il des effets personnels?
- Tous les vêtements avaient disparu. Chose étrange, les étiquettes sur les boîtes de conserve étaient françaises. Mais il y avait une cinquantaine d'emballages vides de tabac à chiquer américain répandus sur le sol. Mais la dernière pièce du jeu de patience, celle qui désigne sans équivoque les gars du Colorado, c'était un vieil exemplaire jauni de L'Écho des Rocheuses, daté du 17 novembre 1911. C'est cette preuve-là que j'ai perdue. »
Seagram prit dans sa poche un paquet de cigarettes et le secoua pour en faire tomber une. Donner lui tendit un briquet et Seagram le remercia de la tête.
« Alors, il se peut que les Russes n'aient pas de byzanium en leur possession, dit-il.
- H y a encore autre chose, ajouta Koplin d'un ton calme. On avait découpé avec soin le coin supérieur droit de la page trois du journal. Cela ne veut peut-être rien dire, mais d'un autre côté, une vérification dans les archives de la publication pourrait vous apprendre quelque chose.
- C'est possible en effet, fit Seagram en regardant Koplin d'un air songeur. Grâce à vous, voici notre plan de travail tout préparé. »
Donner acquiesça. « Je vais prendre une place sur le prochain vol pour Denver. Avec un peu de chance, je devrais revenir avec quelques réponses.
- Va d'abord au journal, puis essaie de retrouver la trace de Jake Hobart. D'ici, je vais faire faire des vérifications sur les vieux états militaires. Contacte donc aussi sur place un spécialiste de l'histoire de l'extraction minière dans l'Ouest et vois les noms des fabricants que Sid nous a indiqués. Si improbable que cela soit, l'un d'eux pourrait être encore en activité. »
Seagram se leva et regarda Koplin. « Nous vous devons plus que nous ne pourrons jamais vous rendre, fit-il avec douceur.
- J'estime que ces mineurs de jadis ont dû extraire à peu près une demi-tonne de minerai à
haute teneur de byzanium des entrailles de cette saloperie de montagne, dit Koplin, en passant sa main sur sa barbe d'un mois. Il a bien fallu entreposer ce minerai quelque part dans le monde. D'un autre côté, s'il n'a toujours pas réapparu depuis 1912, il est peut-être à jamais perdu. Mais, si vous le retrouvez, disons plutôt quand vous le retrouverez, vous pourrez me remercier en m'en donnant un petit échantillon pour ma collection.
- Considérez que c'est chose faite.
- Et, pendant que vous y êtes, donnez-moi l'adresse du type qui m'a sauvé la vie, pour que je puisse lui envoyer une caisse de bon vin. Il s'appelle Dirk Pitt.
- Vous parlez sans doute du médecin du navire océanographique qui vous a opéré.
- Je parle de l'homme qui a tué le garde soviétique et son chien et qui m'a fait quitter l'île. »
Donner et Seagram échangèrent un regard consterné.
Donner fut le premier à se remettre. « Qui a tué un garde soviétique ! » C'était plus une affirmation qu'une question. « Mon Dieu, il ne manquait plus que ça !
- Mais c'est impossible ? Parvint enfin à balbutier Seagram. Quand vous avez rallié le navire de l'ANRO, vous étiez seul.
- Qui vous a dit ça ?
- Ma foi... personne. Nous avons supposé...
- Je ne suis pas un surhomme, dit Koplin d'un ton sarcastique. Le garde qui patrouillait a repéré mes traces, s'est approché à moins de deux cents mètres et m'a tiré dessus à deux reprises. Après cela, je n'étais guère en état de distancer un chien à la course et ensuite de barrer un sloop sur cinquante milles de mer.
- D'où venait ce Dirk Pitt?
- Je n'en ai pas la moindre idée. Le garde était bel et bien en train de me traîner jusqu'à son commandant quand Pitt a surgi dans le blizzard comme un dieu vengeur Scandinave et calmement, comme s'il faisait ça tous les jours avant le petit déjeuner, il a sans crier gare abattu le chien puis le garde.
- Les Russes vont en faire tout un foin, gémit Donner.
- Comment ça? interrogea Koplin. Il n'y avait pas de témoin. Le garde et son chien sont sans doute maintenant enfouis sous un mètre cinquante de neige : on ne les retrouvera peut-être jamais. Et quand bien même? Ça va prouver quoi? Vous vous affolez tous les deux pour rien.
- C'était un fichu risque à prendre de la part de ce type, dit Seagram.
- Je suis bien content qu'il l'ait pris, murmura Koplin. Sans cela, au lieu d'être sain et sauf bien au chaud dans mon lit d'hôpital stérile, je croupirais dans une cellule de prison russe à cracher tout ce que je sais sur la section Méta et le byzanium.
- Il y a du vrai dans ce que vous dites, reconnut Donner.
- Décrivez-le, ordonna Seagram. Taille, stature, vêtements, tout ce dont vous pouvez vous souvenir. »
Koplin s'exécuta. Le signalement qu'il donna manquait de précisions sur certains points, mais sur d'autres il put donner des détails d'une remarquable précision.
« Avez-vous parlé avec lui durant le voyage jusqu'au navire de l'ANRO ?
- Impossible. J'ai tourné de l'oeil juste après qu'il m'a ramassé et je n'ai repris connaissance qu'en me retrouvant ici, à Washington, à l'hôpital. »
Donner fit un geste à Seagram. « Nous ferions mieux de mettre la main sur ce type, et vite. »
Seagram acquiesça. « Je vais commencer par l'amiral Sandecker. Pitt a dû être en liaison avec le navire océanographique. Peut-être quelqu'un à l'ANRO peut-il l'identifier.
- Je me demande bien ce qu'il sait », dit Donner en fixant le plancher, Seagram ne répondit pas. Il pensait à une silhouette fantomatique sur une île enneigée de l'Arctique. Dirk Pitt : il se répéta tout bas le nom. Sans qu'il sût pourquoi, ce nom lui semblait étrangement familier.
Le téléphone sonna à minuit dix. Sandecker ouvrit un oeil et posa quelques instants sur l'appareil un regard meurtrier. Puis il finit par céder et décrocha à la huitième sonnerie.
« Oui, qu'est-ce que c'est? demanda-t-il.
- Gène Seagram à l'appareil. Amiral, vous étiez couché ?
- Oh, bien sûr que non, fit Sandecker en bâillant. Je ne me mets jamais au lit sans avoir écrit cinq chapitres de mon autobiographie, cambriolé au moins deux magasins de liqueurs et violé
la femme d'un ministre. Bon, qu'est-ce que vous voulez, Seagram?
- Il est arrivé quelque chose.
- Laissez tomber. Je ne veux plus risquer aucun de mes hommes ni de mes navires pour aller repêcher vos agents en territoire ennemi. »
II employait le mot ennemi comme si le pays était en guerre.
« Ça n'est pas ça du tout.
- Quoi alors?
- J'ai besoin de tuyaux sur quelqu'un.
- Pourquoi vous adresser à moi en pleine nuit ?
- Je pense que vous le connaissez sans doute.
- Son nom?
- Pitt. Dirk. Son nom de famille est Pitt, sans doute P-I-T-T.
- Rien que pour satisfaire la curiosité d'un vieil homme, qu'est-ce qui vous fait croire que je le connais ?
- Je n'ai aucune preuve, mais je suis certain qu'il a un rapport avec l'ANRO.
- J'ai environ deux mille personnes sous mes ordres. Je ne peux pas me rappeler tous leurs noms.
- Pourriez-vous vérifier? Il est indispensable que je lui parle.
- Seagram, grommela Sandecker, vous me cassez les pieds à un point à peine croyable. L'idée ne vous est jamais venue d'appeler mon directeur du personnel pendant les heures de bureau ?
- Pardonnez-moi, dit Seagram. Je travaillais tard et...
- Bon, si je retrouve ce personnage, je lui dirai de prendre contact avec vous.
- Je vous en serais reconnaissant. » Le ton de Seagram demeurait très impersonnel. « Au fait, l'homme que vos gens ont sauvé dans la mer de Barentsz se remet très bien. Le médecin du First Attempt a fait un très beau travail en extrayant la balle.
- Koplin, c'est ça?
- Oui, il devrait être sur pied dans quelques jours.
- Nous l'avons échappé belle, Seagram. Si les Russes nous étaient tombés sur le paletot, nous aurions maintenant sur les bras un bel incident.
- Qu'est-ce que je peux dire ? fit Seagram.
- Vous pouvez me dire bonsoir et me laisser me rendormir, marmonna Sandecker. Mais ditesmoi d'abord ce que Pitt vient faire dans le tableau.
- Koplin allait être capturé par un garde soviétique quand ce type a surgi du blizzard, abattu le garde, transporté Koplin en pleine tempête sur cinquante milles, sans parler du fait qu'il a réussi à arrêter l'hémorragie de ses blessures et à le déposer je ne sais comment à bord de votre navire de recherches, prêt à être opéré.
- Que comptez-vous faire quand vous l'aurez trouvé ?
- Ça ne regarde que Pitt et moi.
- Je vois, dit Sandecker. Eh bien, bonne nuit, M. Seagram.
- Merci, Amiral. Au revoir. »
Sandecker raccrocha puis resta assis quelques instants, l'air songeur. « II a tué un garde soviétique et sauvé un agent américain. Dirk Pitt... Eh bien, mon salaud. »
Le premier vol de l'United Air Lines se posa sur l'aéroport Stapleton, à Denver, à 8 heures du matin. Mel Donner traversa rapidement la salle de livraison des bagages et s'installa au volant d'une Plymouth de location pour effectuer les quinze minutes de trajet jusqu'au 400 West Colfax Avenue où se trouvaient les bureaux de L'Écho des Rocheuses. Il suivit le flot de la circulation, son regard allant du pare-brise à un plan de la ville étalé auprès de lui sur la banquette.
Il n'était encore jamais venu à Denver, et il fut quelque peu surpris de voir un voile de brume planer au-dessus de la ville. Il s'attendait à ce genre de nuages gris et brun sale au-dessus d'endroits comme Los Angeles et New York, mais Denver avait toujours évoqué dans son esprit l'image d'une ville baignant dans un air d'une pureté de cristal, blottie sous l'ombre protectrice des Rocheuses. Même à cet égard il fut déçu : Denver était plantée à la lisière des grandes plaines, à quarante kilomètres au moins des pentes les plus proches. Il gara sa voiture et se fit expliquer où étaient les archives du journal. La fille assise derrière le comptoir le regarda par-dessus ses petites lunettes aux verres en forme de larmes en lui adressant un sourire aimable.
« Puis-je vous aider?
- Avez-vous un numéro de votre journal en date du 17 novembre 1911 ?
- Oh, mon Dieu, ça remonte loin. » Elle plissa les lèvres. « Je peux vous donner une photocopie, mais les originaux sont à la Société historique de l'État.
- Je n'ai besoin que de voir la page 3.
- Si vous voulez bien attendre, cela va prendre environ un quart d'heure de retrouver le film du 17 novembre 1911 et de passer la page qu'il vous faut sur la machine à photocopier.
- Merci. Au fait, y a-t-il par hasard un annuaire du Colorado par professions ?
- Certainement. » Elle fouilla sous le comptoir et posa sur la planche plastifiée un petit annuaire.
Donner s'assit pour le consulter tandis que la fille disparaissait pour aller faire ses recherches. Il n'y avait pas trace d'une Fonderie Guthrie et Fils à Pueblo. Il passa aux T. Rien là non plus pour les Forges et Ateliers Thor de Denver. C'était quand même beaucoup demander, se dit-il, de trouver deux établissements existant encore au bout de presque quatre-vingts ans. Les quinze minutes s'écoulèrent et la fille n'était pas revenue, alors il se mit à feuilleter l'annuaire pour passer le temps. À quelques exceptions près, il y avait très peu d'entreprises dont le nom lui était familier. Soudain il tressaillit. À la lettre J son regard tomba sur Jensen et Thor, métallurgiste à Denver. Il arracha la page, la fourra dans sa poche et remit l'annuaire sur le comptoir.
« Voici, monsieur, dit la fille. Ce sera cinquante cents. »
Donner paya et parcourut rapidement le gros titre dans le coin supérieur droit de la page photocopiée. C'était un article à propos d'une catastrophe minière.
« C'est ce que vous cherchiez ? demanda la fille.
- Il faudra que je m'en contente », dit-il en s'éloignant.
L'entreprise métallurgique Jensen et Thor était située entre la gare de triage de la ligne Burlington-Northern Pacific et la rivière de South Flatte. C'était une gigantesque horreur aux toits de tôle ondulée qui aurait masqué n'importe quel paysage, sauf celui qui l'entourait. Dans l'atelier, des ponts roulants déplaçaient d'énormes longueurs de tuyaux rouilles d'une pile à
l'autre, cependant que des emboutisseuses martelaient le métal dans un fracas infernal que les tympans de Donner avaient du mal à supporter. Les bureaux étaient installés sur un côté, derrière des murs de béton insonorisés creusés de hautes fenêtres cintrées. Une charmante hôtesse à la poitrine plantureuse l'escorta le long d'un couloir couvert d'une épaisse moquette jusqu'à un vaste bureau aux murs lambrissés. Karl Jensen fit le tour de son bureau pour venir serrer la main de Donner. Il était jeune - pas plus de vingt-huit ans -, les cheveux longs, une moustache soigneusement taillée et il portait un costume à carreaux de bonne coupe. Le type même du diplômé de l'Université de Californie.
« Merci de prendre le temps de me recevoir, M. Jensen. »
Jensen eut un sourire prudent. « Ça semblait important. Un important personnage de Washington et tout ça. Comment pouvais-je refuser ?
- Comme je vous l'ai expliqué au téléphone, je vérifie d'anciennes archives. »
Le sourire de Jensen pâlit un peu. « Vous n'êtes pas des contributions directes, j'espère. »
Donner secoua la tête. « Pas du tout. L'intérêt du gouvernement est purement historique. Si vous les avez encore, j'aimerais consulter vos états de vente de juillet à novembre 1911.
- C'est une plaisanterie, fit Jensen en riant.
- Je vous assure, c'est très sérieux. » Jensen le regarda. « Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé de société ?
- Certain, dit Donner d'un ton sec, si cette maison a pour origine les Forges et Ateliers Thor.
- La vieille entreprise de mon arrière-grand-père, reconnut Jensen. Mon père a racheté toutes les actions et a changé de nom en 1942.
- Auriez-vous encore les vieilles archives ? »
Jensen haussa les épaules. « Nous avons jeté toute l'histoire ancienne il y a quelque temps. Si nous avions conservé chaque reçu de vente depuis que mon arrière-grand-père a ouvert ses bureaux en 1897, il nous faudrait un entrepôt grand comme un gratte-ciel rien que pour les ranger. »
Donner prit un mouchoir et essuya les gouttes de sueur qui perlaient sur son visage. Il se tassa un peu dans son fauteuil.
« Toutefois, reprit Jensen, vous pouvez rendre grâce à la prévoyance de mon père, nous avons tous nos vieux livres sur microfilms.
- Sur microfilms ?
- Après cinq ans, nous filmons tout. L'efficacité personnifiée, c'est nous. »
Donner ne pouvait en croire sa chance. « Alors vous pouvez bel et bien me montrer les états de vente des six derniers mois de 1911 ?»
Jensen ne répondit pas. Il se pencha sur son bureau, parla dans le téléphone intérieur, puis se renversa dans son fauteuil directorial.
« Pendant que nous attendons, puis-je vous offrir une tasse de café, M. Donner ?
- Je préférerais quelque chose d'un peu plus corsé.
- Voilà qui ne m'étonne pas de la part d'un homme qui vient de la grand-ville. » Jensen se leva et s'approcha d'un petit bar aux parois de glace où il prit une bouteille de Chivas Régal. «
Vous allez trouver Denver très province. Un bar dans un bureau, c'est en général mal vu. L'idée qu'on se fait de la façon de recevoir des visiteurs de passage, c'est de leur offrir un grand Coca Cola puis un somptueux déjeuner à base de hamburgers. Heureusement pour nos honorables clients de l'extérieur, j'ai fait mon apprentissage commercial à Madison Avenue. »
Donner prit le verre qu'on lui offrait et le vida d'un trait.
Jensen le considéra en connaisseur, puis lui versa une nouvelle rasade. « Dites-moi, M. Donner, qu'est-ce que vous comptez trouver au juste ?
- Rien d'important, fit Donner.
- Allons donc. Le gouvernement ne ferait pas traverser à un homme la moitié du pays afin d'éplucher des états de vente vieux de soixante-six ans simplement pour plaisanter.
- Le gouvernement a souvent une drôle de façon de traiter ses secrets.
- Un secret qui remonte à 1911 ? fit Jensen en secouant la tête d'un air stupéfait. C'est très étonnant.
- Disons que nous nous efforçons de trouver la solution d'un crime ancien dont l'auteur s'est acquis les services de votre arrière-grand-père. »
Jensen sourit et, en homme courtois, accepta ce mensonge.
Une fille brune en jupe longue et chaussée de bottes entra en virevoltant dans la pièce, lança à
Jensen un regard séducteur, posa sur le bureau des documents photocopiés et se retira. Jensen prit le papier et l'examina. « De juin à novembre, ça a dû être une période de récession pour mon ancêtre. Les ventes sur ce mois-là sont minimes. Y a-t-il un article en particulier auquel vous vous intéressiez, M. Donner ?
- Du matériel minier.
- Oui, ça doit être ça... Du matériel de forage. Commandé le 10 août et l'acquéreur en a pris livraison le 1er novembre. » Un large sourire éclaira le visage de Jensen. « On dirait, monsieur, que les rieurs vont être de mon côté.
- Je ne vous suis pas.
- L'acheteur, ou comme vous me l'avez confié, le criminel... » Jensen marqua un temps théâtral... « C’était le gouvernement américain. »
Le quartier général de la Section Méta était enfoui dans un vieil immeuble grisâtre auprès de l'arsenal de Washington. Un grand panonceau dont les lettres peintes s'écaillaient sous le double assaut de l'humidité et de la chaleur estivale annonçait modestement que c'était le siège des garde-meubles Smith.
Les plates-formes de chargement avaient un air tout à fait normal : des caisses et des cartons s'entassaient à des emplacements stratégiques, et pour les gens qui passaient sur l'autoroute de Suit-land, les camions garés dans la cour derrière des murs de quatre mètres cinquante surmontés de barbelés avaient tout à fait l'aspect que devraient avoir des camions de déménagement. Il aurait fallu regarder de plus près pour découvrir dès le départ qu'il manquait des moteurs et que l'intérieur inutilisé était couvert de poussière. C'était un décor qui aurait réchauffé le coeur d'un accessoiriste de cinéma.
Gène Seagram relisait les rapports sur les achats immobiliers pour les installations du Projet Sicile. Quarante-six au total. Les plus nombreux étaient le long de la frontière canadienne, suivis de près par la côte atlantique. On prévoyait huit sites pour la côte Pacifique, alors qu'il n'y en avait que quatre le long de la frontière du Mexique et du golfe du Mexique. Les transactions s'étaient passées sans heurts ; l'acquéreur dans chaque cas s'était présenté sous le couvert du Département des Études sur l'Énergie. On n'aurait aucune raison de se méfier. Les installations étaient conçues pour ressembler à de petits relais électriques. Même les esprits les plus soupçonneux ne trouveraient en apparence rien d'extraordinaire. Il examinait les estimations des frais de construction lorsque le téléphone sonna sur sa ligne directe. Par habitude, il rangea avec soin les rapports dans leurs dossiers et les glissa avec soin dans son bureau, puis décrocha.
« Ici Seagram.
- Bonjour, M. Seagram.
- Qui est à l'appareil ?
- Commandant McPatrick, Bureau des Archives de l'Armée. Vous m'avez demandé de vous appeler à ce numéro si je trouvais quelque chose à propos d'un mineur du nom de Jake Hobart.
- Oui, bien sûr. Pardonnez-moi, j'avais l'esprit ailleurs. »
Seagram imaginait fort bien son interlocuteur. Ancien élève de West Point, moins de trente ans : la voix assez jeune et les phrases sèches trahissaient tout cela. Il serait sans doute général à quarante-cinq ans, à condition de s'être fait les relations nécessaires lors de son passage au Pentagone.
« Qu'est-ce que vous avez, Commandant?
- J'ai trouvé votre homme. Jason Cleveland Hobart. Né le 23 janvier 1874 à Vinton, lowa.
- Au moins l'année correspond.
- L'occupation aussi : il était mineur.
- Quoi d'autre ?
- Il s'est engagé dans l'armée en mai 1898 et a servi dans le Premier Régiment de Volontaires du Colorado aux Philippines.
- Vous avez bien dit Colorado ?
- Exact, monsieur. » McPatrick marqua un temps et Seagram l'entendit qui feuilletait des papiers. « Hobart avait d'excellents états de service. Il a été promu sergent. Il a été
sérieusement blessé en combattant les rebelles philippins et a été décoré deux fois pour conduite exceptionnelle au feu.
- Quand a-t-il été démobilisé?
- En ce temps-là on disait « rayé des contrôles », dit McPatrick d'un ton docte. Hobart a quitté
l'armée en octobre 1901.
- C'est la dernière trace que vous avez de lui ?
- Non, sa veuve touche toujours une pension.
- Attendez, l'interrompit Seagram. La veuve de Hobart est toujours en vie ?
- Elle met tous les mois à la banque son chèque de 50 dollars et 40 cents, comme une horloge.
- Elle doit avoir plus de quatre-vingt-dix ans. Ça n'est pas un peu extraordinaire de servir une pension à la veuve d'un ancien combattant de la guerre hispano-américaine ? On imaginerait que la plupart d'entre elles seraient mortes et enterrées maintenant.
- Oh, pas du tout. Nous avons encore sur nos rôles près d'une centaine de veuves de la Guerre de Sécession. Aucune n'était même née quand Grant a pris Richmond. Les mariages du printemps et de l'hiver entre de jeunes créatures et de vénérables anciens combattants édentés étaient tout à fait courants en ce temps-là.
- Je croyais qu'une veuve n'avait droit à une pension que si son mari avait été tué au combat.
- Pas nécessairement, répondit McPatrick. Le gouvernement verse des pensions aux veuves dans deux cas. Le premier en cas de décès en service commandé. Cela comprend, bien sûr, la mort sur le champ de bataille, une maladie ou une blessure fatale dont ils ont été victimes entre telle ou telle date fixée par le Congrès. Le second cas est celui du décès en dehors du service commandé. Tenez, vous, par exemple. Vous avez servi dans la Marine lors de la guerre au Viêtnam entre les dates requises pour ce conflit particulier. Cela donne droit à votre femme, ou à toute autre future épouse, à une petite pension si vous étiez renversé par un camion dans quarante ans d'ici.
- Je mentionnerai cela dans mon testament, dit Seagram, mal à l'aise à l'idée que ses états étaient à la disposition de n'importe quel clown du Pentagone. Pour en revenir à Hobart...
- Nous en arrivons maintenant à une étrange négligence dans les archives de l'Armée.
- Négligence?
- Les états de service de Hobart omettent de mentionner son réengagement, et pourtant il est enregistré comme « Mort au Service de son pays ». Aucune indication de la cause du décès, rien que la date... 17 novembre 1911. »
Seagram se redressa soudain dans son fauteuil. « Je tiens de bonne source que Jake Hobart est mort en tant que civil le 10 février 1912.
- Comme je l'ai dit, il n'y a pas trace de la cause du décès. Mais, je vous assure, Hobart est mort en tant que soldat, et non pas civil le 17 novembre. J'ai dans son dossier une lettre datée du 25 juillet 1912, signée de Henry L. Stimson, secrétaire à la Guerre sous le Président Taft, ordonnant à l'Armée d'accorder à la femme du sergent Jason Hobart une pleine pension de veuve jusqu'à la fin de ses jours. Comment Hobart a éveillé l'intérêt personnel du secrétaire à
la Guerre est un mystère, mais cela ne laisse aucun doute sur le statut de notre homme. Seul un soldat de haut mérite aurait bénéficié de cette sorte de traitement préférentiel, assurément pas un mineur.
- Ce n'était pas un mineur, lança Seagram.
- Enfin, peu importe.
- Avez-vous une adresse pour Mrs Hobart ?
- Je l'ai quelque part. » McPatrick hésita un moment. «Mrs Adeline Hobart, 261-B Calle Aragon, Laguna Hills, Californie. Elle habite une de ces grandes résidences pour troisième âge au sud de Los Angeles.
- Parfait, dit Seagram. Je vous remercie de votre concours dans cette affaire, Commandant.
- Je suis navré de vous le dire, M. Seagram, mais je crois que nous avons ici deux hommes différents.
- Vous avez peut-être raison, répondit Seagram. Il se pourrait bien que je sois sur la mauvaise piste.
- Si je puis vous être encore de quelque utilité, je vous en prie, n'hésitez pas à m'appeler.
- Je n'y manquerai pas, grommela Seagram. Merci encore. »
Après avoir raccroché, il laissa tomber sa tête dans ses mains et s'affala dans le fauteuil. Il resta assis dans cette position, sans bouger, pendant près de deux minutes. Puis il posa les mains à plat sur son bureau et eut un large sourire épanoui.
Deux hommes différents auraient fort bien pu exister avec le même nom de famille, la même année de naissance et travailler dans le même État et le même métier. Cette partie de l'énigme aurait pu être une coïncidence. Mais pas le rapport, le fantastique rapport à 365 contre 1 qui unissait les deux hommes par un lien mystérieux et n'en faisait qu'un : la mort de Hobart inscrite dans les registres de l'état civil et le vieux journal découvert par Sid Koplin dans la mine du mont Bednaya qui portaient la même date : 17 novembre 1911.
Il abaissa la manette du téléphone intérieur pour appeler sa secrétaire. « Barbara, appelez-moi Mel Donner au Brown Palace Hôtel à Denver.
- Pas de message à laisser s'il n'est pas là?
- Demandez simplement qu'il m'appelle sur ma ligne directe quand il sera rentré.
- Entendu.
- Et encore une chose, prenez-moi pour demain matin de bonne heure un billet d'avion pour Los Angeles.
- Bien, monsieur. »
II coupa le contact et se renversa dans son fauteuil d'un air songeur. Adeline Hobart, quatrevingt-dix ans passés. Il priait le ciel qu'elle ne fût pas gâteuse.
Donner ne descendait pas en général dans un hôtel du centre. Il préférait le décor plus discret d'un motel des faubourgs, mais Seagram avait insisté en arguant qu'un enquêteur trouve les indigènes plus enclins à coopérer s'il leur fait savoir qu'il a pris une chambre dans le plus vieil hôtel et le plus prestigieux de la ville. Enquêteur, le mot l'écoeurait. Si un de ses collègues du campus de l'université de Californie du Sud lui avait dit, voilà cinq ans, que son doctorat en physique l'amènerait à jouer un pareil rôle clandestin, il se serait étranglé de rire. Mais aujourd'hui, Donner ne riait pas. Le Projet Sicile était bien trop vital pour les intérêts du pays pour qu'il prît le risque d'une fuite en acceptant une aide extérieure. Seagram et lui avaient conçu et créé le projet tout seuls et il était entendu qu'ils le pousseraient seuls aussi loin que possible.
Il laissa sa voiture de location au gardien du parc de stationnement et traversa Tremont Place, franchit les vieilles portes tournantes de l'hôtel et pénétra dans le hall plaisamment décoré où
le jeune employé moustachu de la réception lui remit un message sans même esquisser un sourire. Donner le prit sans même articuler un merci, puis gagna l'ascenseur et sa chambre. Il claqua la porte derrière lui, jeta sur le bureau la clef et le message de Seagram, puis alluma la télévision. C'avait été une longue et fatigante journée, et il vivait encore à l'heure de Washington. Il téléphona pour se commander à dîner, puis se débarrassa de ses chaussures, desserra sa cravate et s'allongea sur le lit.
Pour la dixième fois peut-être, il inspecta la photocopie de la page du vieux journal. C'était une lecture intéressante, c'est-à-dire si Donner s'intéressait aux petites annonces d'accordeurs de piano, de ceintures électriques pour hernies et d'étranges remèdes, sans parler d'éditoriaux sur la détermination du conseil municipal de Denver de débarrasser telle ou telle rue de coupables lieux de plaisir ; et il y avait aussi d'étonnants petits encadrés destinés à faire béer d'horreur innocente les lectrices du début du siècle.
RAPPORT D'AUTOPSIE
« La semaine dernière, les habitués de la Morgue de Paris ont été fort étonnés par une étrange jambe en caoutchouc exposée aux fins d'identification sur une des tables. On avait repêché
dans la Seine le corps d'une femme élégamment vêtue et âgée apparemment d'une cinquantaine d'années, mais le corps était dans un tel état de décomposition qu'il avait été
impossible de le conserver. On avait remarqué, toutefois, que la jambe gauche, amputée à la hauteur de la cuisse, avait été remplacée par une jambe en caoutchouc de conception fort ingénieuse, que l'on exposait dans l'espoir qu'on parviendrait ainsi à en identifier la propriétaire. »
Donner sourit en lisant cette historiette et son attention revint à la partie supérieure droite de la page, cette partie dont Koplin disait qu'elle manquait sur l'exemplaire du journal qu'il avait découvert en Nouvelle-Zemble.
CATASTROPHE MINIÈRE
« Tragique accident de bonne heure ce matin : l'explosion d'une charge de dynamite a provoqué un effondrement à la mine du Petit Ange, près de Central City, emprisonnant neuf mineurs de la première équipe, parmi lesquels Joshua Hays Brewster, le célèbre ingénieur des mines respecté de tous. « Les sauveteurs épuisés et hagards annoncent que les espoirs de retrouver les hommes vivants sont bien minces. Bull Mahoney, le vaillant contremaître de la mine de Satan, a fait des efforts herculéens pour atteindre les mineurs prisonniers, mais il a rencontré un véritable mur d'eau qui a inondé le puits principal. « Les pauvres gars ont eu leur compte, c'est sûr, a déclaré Mahoney à des journalistes venus sur les lieux de la catastrophe. L'eau a jailli à près de deux étages au-dessus de là où ils travaillaient. Ils ont dû être noyés comme des rats sans savoir ce qui leur arrivait. »
« La foule silencieuse et consternée qui se pressait devant l'entrée de la mine est accablée à
l'idée que c'est là un de ces accidents où les corps des mineurs ensevelis ne seront pas dégagés et ramenés à la surface pour être enterrés dans les règles. « On sait de source sûre que M. Brewster avait l'intention de rouvrir la mine du Petit Ange, fermée depuis 1880. Selon des amis et des relations d'affaires, Brewster avait souvent déclaré que les premier travaux d'extraction avaient manqué le filon à haute teneur et, qu'avec de la chance et du courage, il allait, lui, le découvrir.
« Comme on lui demandait un commentaire, M. Ernest Bleser, ancien propriétaire, aujourd'hui à la retraite, de la mine du Petit Ange, a dit à notre envoyé spécial sur le perron de sa maison de Golden : "Cette mine est maudite depuis le jour où je l'ai ouverte. Elle n'a jamais donné que de la houille de basse qualité et n'a jamais rapporté." M. Bleser a ajouté : "Je pense que Brewster avait tout à fait tort. Il n'y a jamais eu aucun indice permettant de croire à
l'existence d'un filon plus riche. Je suis très étonné qu'un homme de sa réputation ait pu le croire."
« À Central City, aux dernières nouvelles, on estimait que, si la situation est entre les mains du Tout-Puissant, le puits sera scellé pour servir de tombe et que les disparus reposeront à
jamais dans les ténèbres, sans jamais revoir la surface ni la lumière.
« Voici la liste des victimes de cette terrible catastrophe :
Joshua Hays BREWSTER, Denver Alvin COULTER, Fairplay Thomas PRICE, Leadville Charles P. WIDNEY, Cripple Creek Vernon F. HALL, Denver John CALDWELL, Central City Walter SCHMIDT, Aspen Warner E. O'DEMING, Denver Jason C. HOBART, Boulder
« Puisse Dieu veiller sur ces braves ouvriers de la mine. »
Le regard de Donner avait beau parcourir et reparcourir l'article, il revenait toujours au dernier nom sur la liste des mineurs disparus. Lentement, comme un homme en transe, il posa le journal sur ses genoux, décrocha le téléphone et composa un numéro de l'interurbain.
« Le Monte Christo ! s'exclama Harry Young avec ravissement. J'approuve de tout cour le Monte Christo. L'assaisonnement au Roquefort est excellent, lui aussi. Mais tout d'abord, j'aimerais un Martini très sec, avec un zeste de citron.
- Un sandwich Monte Christo et un assaisonnement au Roquefort pour votre salade. Bien, monsieur, répéta la jeune serveuse, se penchant sur la table si bien que sa courte jupe se retroussa pour révéler une petite culotte blanche. Et pour vous, Monsieur?
- La même chose. » Donner hocha la tête. « Seulement je commencerai par un Manhattan. »
Young suivit des yeux par-dessus la monture de ses lunettes la petite serveuse qui s'éloignait vers la cuisine. « Si seulement quelqu'un me donnait ça pour Noël », dit-il en souriant. Young était un petit homme décharné. Jadis, on l'aurait traité de vieux sot habillé avec trop de recherche. Mais aujourd'hui, c'était un bon vivant de soixante-dix-huit ans, alerte et toujours à
l'affût de la beauté. Il était assis en face de Donner, vêtu d'un chandail bleu à col roulé et d'une veste de sport à grands carreaux.
« M. Donner ! fit-il avec entrain. C'est vraiment un plaisir. Le Broher est mon restaurant favori. » II désigna de la main les murs et les niches lambrissés de noyer. « Vous savez qu'autrefois c'était une chambre forte.
- C'est ce que j'ai remarqué quand j'ai dû franchir cette énorme porte.
- Vous devriez venir ici pour dîner. On vous sert un énorme plateau de crevettes en guise d'apéritif. » II rayonnait rien qu'à cette pensée.
« Je m'en souviendrai pour ma prochaine visite.
- Alors, monsieur, fit Young en le regardant droit dans les yeux. Que voulez-vous ?
- J'ai quelques questions à vous poser. » Young haussa les sourcils. « Oh, mon Dieu, mon Dieu, mais vous avez chatouillé ma curiosité. Vous n'êtes pas du FBI, n'est-ce pas ?
- Au téléphone, vous m'avez simplement dit que vous apparteniez au gouvernement fédéral.
- Non, je ne suis pas du FBI. Et je ne suis pas non plus un employé du fisc. Ma partie, c'est la Sécurité sociale. C'est mon travail que de vérifier le bien-fondé des demandes de pensions.
- En ce cas, comment puis-je vous aider?
- Le projet qui m'occupe actuellement, c'est une enquête sur une catastrophe minière survenue il y a soixante-seize ans et qui a coûté la vie à neuf hommes. L'une des descendantes de la victime fait une demande de pension. Je suis ici pour m'assurer de la validité de cette revendication. Votre nom, M. Young, m'a été recommandé par la Société historique de l'État, qui vous a décrit avec chaleur comme une encyclopédie ambulante de l'histoire minière de l'Ouest.
- C'est un peu exagéré, dit Young, mais je n'en suis pas moins flatté. »
Les consommations arrivèrent et, pendant une minute, ils les burent à petites gorgées sans rien dire. Donner en profita pour examiner les photographies des rois de l'argent du Colorado au début du siècle, qui étaient accrochées aux murs. Leurs visages affichaient tous les mêmes regards intenses, comme s'ils essayaient de faire fondre les lentilles de l'appareil de photo avec leur arrogance fortifiée par la richesse.
« Dites-moi, M. Donner, comment quelqu'un peut-il réclamer une pension à la suite d'un accident survenu il y a soixante-seize ans ?
- Il semble que la veuve n'ait pas reçu ce à quoi elle avait droit, répondit Donner, sentant qu'il avançait sur un terrain délicat. Sa fille demande le versement des arriérés, pour ainsi dire.
- Je vois », dit Young. Son regard se perdit dans le vide, puis il se mit à tambouriner sur la table avec sa cuillère. « Auquel des hommes qui ont péri dans la catastrophe de la mine du Petit Ange vous intéressez-vous ?
- Mes compliments, fit Donner, évitant son regard et dépliant sa serviette avec gêne. Vous êtes très fort.
- Ça n'est rien, vous savez. Une catastrophe minière datant d'il y a soixante-seize ans. Neuf disparus. Ça ne pouvait être que l'accident du Petit Ange.
- L'homme en question s'appelait Brewster. »
Young le regarda un moment, puis cessa de tambouriner avec sa cuillère qu'il reposa dans un claquement sec. « Joshua Hays Brewster, murmura-t-il. Fils de William Buck Brewster et d'Ettie Mas-ters, né à Sidney, Nebraska, le 4 avril... ou était-ce le 5 avril 1878. »
Donner ouvrait des yeux ronds comme des soucoupes. « Comment pouvez-vous savoir tout cela?
- Oh, j'en sais bien plus encore, fit Young en souriant. Les ingénieurs des mines, ou la Brigade des Bottines, comme on les appelait jadis, forment un petit groupe assez fermé. C'est l'une des rares professions où les fils suivent leurs pères et épousent également des soeurs ou des filles d'autres ingénieurs des mines.
- Allez-vous me dire que vous êtes apparenté à Joshua Hays Brewster?
- Mon oncle. » Young sourit.
La glace venait de céder et Donner se sentit patauger lamentablement.
« Vous m'avez l'air capable de prendre encore un verre, Mr Donner. » Young fit signe à la serveuse. « Inutile de dire qu'il n'y a pas de fille qui réclame une pension; le frère de ma mère est mort célibataire et sans enfant.
- Le mensonge ne réussit jamais, fit Donner avec un pâle sourire. Je suis navré si je vous ai embarrassé en me mettant dans cette situation grotesque.
- Pouvez-vous m'éclairer?
- Je préférerais ne pas le faire.
- Vous êtes bien du gouvernement ? » Demanda Young.
Donner lui montra ses papiers.
« Alors, puis-je vous demander pourquoi vous faites une enquête sur la lointaine disparition de mon oncle ?
- J'aimerais autant pas, répondit Donner. Du moins pas pour l'instant.
- Que désirez-vous savoir?
- Tout ce que vous pouvez me dire sur Joshua Hays Brewster et l'accident de la mine du Petit Ange. »
Les consommations arrivèrent en même temps que la salade. Donner convint que l'assaisonnement était excellent. Ils déjeunèrent en silence. Quand Young eut terminé et essuya sa petite moustache blanche, il prit une profonde inspiration et s'appuya contre le dossier de la niche.
« Mon oncle était le type même de ces hommes qui ont développé les mines au début des années 1900; blond, plein d'ardeur et bourgeois; et à part sa petite taille - il n'avait qu'un mètre cinquante-cinq - il aurait fort bien pu passer pour ce que les romanciers de l'époque décrivaient avec entrain comme un gentleman mineur, insouciant, toujours prêt à l'aventure et à se servir de ses poings, avec bottes étincelantes, culotte de cheval et chapeau à large bord.
- On dirait un héros de roman-feuilleton.
- Un héros de roman n'aurait pas pu être à la hauteur, dit Young. C'est un domaine très spécialisé aujourd'hui, bien sûr, mais un ingénieur de la vieille école devait être aussi dur que la roche qu'il creusait, et il devait avoir des talents variés : être mécanicien, électricien, arpenteur, métallurgiste, géologue, avocat, arbitre entre une direction près de ses sous et des travailleurs qui avaient plus de muscles que de tête; voilà le genre d'homme qu'il fallait pour diriger une mine. Joshua Hays Brewster était comme ça. »
Donner garda le silence, faisant lentement tourner l'alcool dans son verre.
« Lorsque mon oncle est sorti de l'École des Mines, poursuivit Young, il a exercé sa profession dans le Klondike, en Australie et en Russie avant de revenir dans les Rocheuses en 1908 pour diriger Malroche et Bison, deux mines de Leadville appartenant à un groupe de financiers français de Paris qui n'avaient jamais mis les pieds au Colorado.
- Les Français possédaient des intérêts miniers aux États-Unis ?
- Mais oui. Leurs capitaux se déversaient dans tout l'Ouest. Or et argent, bovins, moutons, immobilier; ils avaient un doigt partout.
- Quelle idée a pris Brewster de rouvrir la mine du Petit Ange ?
- C'est en soi une étrange histoire, dit Young. La mine ne valait rien. Le Sillon d'Alabama, à
trois cents mètres de là, a donné deux millions de dollars en argent avant que l'eau des niveaux inférieurs ait commencé à arriver trop vite pour les pompes. C'est celui-là, le puits qui est tombé sur le filon à haute teneur de minerai. Il n'en a jamais été question avec la mine du Petit Ange. » Young s'interrompit pour boire une gorgée, puis contempla son verre comme s'il distinguait une vieille image dans les glaçons.
« Lorsque mon oncle a annoncé à qui voulait l'entendre son intention de rouvrir la mine, les gens qu'il connaissait bien ont été choqués. Oui, M. Donner, choqués. Joshua Hays Brewster était un homme prudent, minutieux. Ses moindres gestes étaient calculés avec soin en termes de réussite. Il ne jouait jamais qu'après avoir mis toutes les chances de son côté. Pour lui, annoncer publiquement un projet aussi écervelé était impensable. Tout le monde considéra que c'était là l'acte d'un fou.
- Peut-être avait-il découvert un indice que les autres n'avaient pas vu.
Young secoua la tête. « J'ai été géologue pendant soixante ans, M. Donner, et un rudement bon géologue. J'ai pénétré dans la mine du Petit Ange pour l'examiner jusqu'aux étages inondés, j'ai analysé tout ce qui était accessible dans le Sillon d'Alabama, et je vous affirme sans aucune équivoque qu'il n'y a pas là-bas aujourd'hui un filon argentifère intact, pas plus qu'il n'y en avait en 1911. »
Les sandwiches Monte Christo arrivèrent et on leur retira les assiettes de salade.
« Suggérez-vous que votre oncle était devenu fou?
- C'est une possibilité que j'ai envisagée. Les tumeurs au cerveau n'étaient en général pas diagnostiquées en ce temps-là.
- Pas plus que les dépressions nerveuses. » Young engloutit le premier quart de son sandwich et éclusa son second Martini. « Comment est votre Monte Christo, Mr Donner? »
Donner avala non sans peine quelques bouchées. « Excellent, et le vôtre ?
- Tout à fait délicieux. Voulez-vous que je vous expose ma théorie personnelle? Ne vous donnez pas le mal d'être poli; vous pouvez rire sans gêne. Tout le monde le fait quand on m'entend la formuler.
- Je vous promets de ne pas rire, fit Donner d'un ton infiniment grave.
- Ne manquez pas de tremper votre Monte Christo dans la confiture de raisin, M. Donner. Ce n'en est que plus délectable. Donc, comme je vous l'ai dit, mon oncle était un homme qui avait le souci du détail. J'ai recueilli la plupart de ses carnets et journaux; cela occupe une bonne partie des rayonnages de ma bibliothèque. Ses remarques concernant les mines de Malroche et du Bison, par exemple, couvrent 527 pages de croquis fort précis et d'une écriture très lisible. Toutefois les pages du carnet sous la rubrique « Mine du Petit Ange » sont restées vierges.
- Il n'a rien laissé derrière lui concernant la mine du Petit Ange, pas même une lettre, vous en êtes sûr? »
Young haussa les épaules et secoua la tête. « On aurait dit qu'il n'y avait rien à noter. On aurait dit que Joshua Hays Brewster et son équipe de huit hommes sont descendus dans les entrailles de la terre sans avoir jamais l'intention de remonter.
- Qu'en pensez-vous ?
- Pour ridicule que cela paraisse, reconnut Young, l'idée d'un suicide collectif m'a un jour traversé l'esprit. Des recherches approfondies m'ont montré que les neuf hommes étaient tous soit célibataires, soit veufs. La plupart étaient des solitaires itinérants qui allaient d'un site minier à l'autre, cherchant n'importe quelle excuse pour continuer leur chemin lorsqu'ils commençaient à s'ennuyer ou à en avoir assez du contremaître ou de la direction de la mine. Il ne leur restait pas grand-chose pour vivre lorsqu'ils étaient devenus trop vieux pour travailler à la mine.
- Mais Jason Hobart avait une femme, dit Donner.
- Quoi ? Comment ça ? fit Young en ouvrant de grands yeux. Je n'ai trouvé trace d'épouse pour aucun d'eux.
- Croyez-moi sur parole.
- Bonté divine! Si mon oncle avait su ça, il n'aurait jamais engagé Hobart.
- Pourquoi donc?
- Vous ne voyez donc pas? Il lui fallait des hommes auxquels il pouvait faire confiance, des hommes qui n'avaient pas d'amis ou de parents proches pour poser des questions si jamais ils disparaissaient.
- Je ne vous comprends pas, fit Donner.
- C'est tout simplement que la réouverture de la mine du Petit Ange et la tragédie qui a suivi, tout cela n'était qu'un prétexte, une imposture. Je suis convaincu que mon oncle était en train de devenir fou. Comment, ce qui a causé sa maladie mentale, on ne le saura jamais. Son caractère s'est modifié de façon radicale, jusqu'au point de donner un homme différent.
- Un dédoublement de la personnalité ?
- Exactement. Ses valeurs morales ont changé; sa chaleur, son affection pour ses amis ont disparu. Quand j'étais plus jeune, j'ai parlé à des gens qui se souvenaient de lui. Ils étaient tous d'accord sur un point : le Joshua Hays Brewster qu'ils avaient tous connu et aimé est mort des mois avant la catastrophe du Petit Ange.
- En quoi cela prouve-t-il une imposture ?
- Démence mise à part, mon oncle était quand même un ingénieur des mines. Il était parfois capable de dire en quelques minutes si une mine serait rentable ou non. Le filon du Petit Ange ne pouvait rien donner, il le savait. Il n'avait aucune intention de découvrir un filon à haute teneur en minerai. Je n'ai pas la moindre idée de la partie qu'il jouait, M. Donner, mais il y a une chose dont je suis certain : si jamais on pompe l'eau des étages inférieurs de ce vieux puits, on ne trouvera pas d'ossements. »
Donner termina son Manhattan et regarda Young d'un air interrogateur. « Alors, vous pensez que les neuf hommes qui sont descendus dans la mine en ont réchappé ?
- Personne ne les a jamais vus entrer, M. Donner, fit Young en souriant. On a supposé, et c'était bien normal, qu'ils étaient morts là sous ces eaux noires parce qu'on n'a plus jamais entendu parler d'eux.
- Ça ne fait pas assez de preuves, fit Donner.
- Oh, j'en ai d'autres, bien d'autres, répondit Young avec enthousiasme.
- Je vous écoute.
- Premier indice : la galerie la plus basse du Petit Ange était à trente bons mètres au-dessus du niveau moyen de l'eau. En mettant les choses au pire, les parois n'ont dû que suinter un peu. Les puits des niveaux inférieurs étaient déjà inondés parce que l'eau s'était peu à peu amassée au cours des années pendant lesquelles la mine avait été fermée. Il était donc impossible que l'explosion d'une charge de dynamite ait pu faire déferler une muraille d'eau sur mon oncle et son équipe.
«Deuxième indice: l'équipement qu'on est censé avoir retrouvé dans la mine après la catastrophe était du vieux matériel usé. Ces hommes étaient des professionnels, M. Donner. Ils ne seraient jamais descendus au fond avec de l'équipement de second ordre.
« Troisième indice : bien qu'il ait fait savoir à tout le monde qu'il rouvrait la mine, mon oncle n'a jamais consulté ni discuté le projet avec Emest Bloeser, le propriétaire du Petit Ange. Bref, mon oncle faisait de l'extraction illicite. Un geste impensable chez un homme de sa réputation.
« Quatrième indice : le premier signe d'une catastrophe possible ne s'est manifesté que le lendemain après-midi, lorsque le contremaître de la mine Satan, un certain Bill Mahoney, a trouvé sous la porte de sa cabane un mot qui disait : « Au secours ! Mine du Petit Ange. Venez vite ! » Une façon bien étrange de donner l'alarme, vous ne trouvez pas ? Bien entendu, le mot n'était pas signé.
« Cinquième indice : le shérif de Central City a déclaré que mon oncle lui avait donné une liste des membres de son équipe en lui demandant de la communiquer aux journaux en cas d'accident. Une étrange prémonition, c'est le moins qu'on puisse dire. On aurait dit qu'Oncle Joshua voulait être certain qu'on ne se méprendrait pas sur l'identité des victimes. »
Donner repoussa son assiette et but un verre d'eau. « Votre théorie pique ma curiosité, mais elle ne me convainc pas pleinement.
- Ah, mais enfin, mais peut-être surtout, M. Donner, j'ai gardé pour la bonne bouche le plat de résistance.
« Sixième indice : plusieurs mois après la tragédie, mon père et ma mère, qui faisaient un voyage à travers l'Europe, ont vu mon oncle sur le quai du ferry à Southampton, en Angleterre. Ma mère a souvent raconté comment elle s'était approchée de lui en lui disant : «
Seigneur Dieu, Joshua, c'est vraiment toi ? » Le visage qui la contemplait était barbu et d'une pâleur mortelle, l'oeil hagard. « Oublie-moi », murmura-t-il, puis il s'éloigna en courant. Mon père l'a poursuivi sur le quai, mais ne tarda pas à le perdre dans la foule.
- La réponse logique me paraît être un simple cas d'erreur d'identité.
- Une soeur qui ne connaît pas son propre frère? fit Young d'un ton sarcastique. Allons donc, M. Donner, vous pourriez sûrement reconnaître votre frère au milieu d'une foule.
- Je crains que non. Je suis fils unique.
- Quel dommage. Vous manquez une des grandes joies de la vie.
- En tout cas, je n'ai pas eu à partager mes jouets. » L'addition arriva et Donner posa une carte de crédit sur la soucoupe. « Alors, ce que vous dites, c'est que la catastrophe du Petit Ange était une couverture.
- C'est ma théorie, fit Young en s'essuyant la bouche. Pas moyen de la prouver, bien sûr, mais j'ai toujours l'impression obsédante que la Société des Mines de Lorraine était derrière tout ça.
- Qui était-ce?
- Ils étaient et ils sont toujours pour la France ce que Krupp est pour l'Allemagne, ce que Mitsubishi est pour le Japon, ce qu'Anaconda est pour les Etats-Unis.
- Qu'est-ce que la Société... peu importe son nom... vient faire là-dedans?
- C'étaient des financiers français qui avaient engagé Joshua Hays Brewster comme directeuringénieur de l'exploration. C'étaient eux qui avaient assez d'argent pour payer neuf hommes afin qu'ils disparaissent de la surface de la terre.
- Mais pourquoi? Où est le motif? » Young eut un geste d'impuissance : « Je n'en sais rien. »
II se pencha en avant et une flamme s'alluma dans son regard. « Mais ce que je sais, c'est que, quel qu'en ait été le prix, quelle que soit l'influence qui s'est exercée, cela a suffi à entraîner mon oncle et son équipe de huit hommes dans je ne sais quel enfer inconnu hors de ce pays.
- Jusqu'à ce qu'on retrouve les corps, qui dira que vous vous trompez ?
- Vous êtes un homme courtois, M. Donner, dit Young en le regardant. Je vous remercie.
- Pourquoi donc? Pour un déjeuner aux frais du gouvernement?
- Pour n'avoir pas ri », murmura Young.
Donner hocha la tête sans rien dire. L'homme assis en face de lui venait de remettre en place une des pièces du puzzle qui menaient au squelette à la barbe rousse de la mine du mont Bednaya. Il n'y avait pas de quoi rire, absolument pas de quoi rire.
Seagram rendit son sourire d'adieu à l'hôtesse, franchit la porte de l'appareil et s'apprêta à
parcourir les quelque quatre cents mètres qui le séparaient de la sortie de l'Aéroport international de Los Angeles. Il finit par arriver dans le hall d'entrée où il alla aussitôt louer une Lincoln. Il s'engagea dans Century Boulevard et au bout de quelques blocs, prit la bretelle sud qui menait à l'autoroute de San Diego. C'était un jour sans nuages, la brume était étonnamment légère et permettait de distinguer les contours de la Sierra Madré. Il roulait sans se presser sur la voie de droite de l'autoroute à cent kilomètres à l'heure, se laissant dépasser par des voitures de la région roulant à cent vingt ou cent trente avec une belle indifférence pour les panneaux annonçant que la vitesse était limitée à 90 kilomètres à l'heure. Il eut bientôt dépassé la raffinerie de Torrance et les puits de pétrole qui entouraient Long Beach pour pénétrer dans l'immensité du comté d'Orange où le terrain soudain s'aplatissait et se couvrait d'une mer sans fin de petites maisons banlieusardes toutes semblables. Il lui fallut plus d'une heure pour atteindre la sortie menant au Nouvel Éden. Le cadre était idyllique : des terrains de golf, des piscines, des écuries, des parcs et des pelouses entretenues avec soin, des retraités au teint doré qui pédalaient sur leur bicyclette. Il s'arrêta à l'entrée principale où un gardien, du troisième âge lui aussi, lui indiqua où se trouvait le 261-B Calle Aragon. C'était un charmant petit duplex bâti au flanc d'une colline qui donnait sur un parc immaculé. Seagram gara la Lincoln contre le trottoir, traversa un petit patio plein de rosiers et alla sonner. La porte s'ouvrit et ses craintes se dissipèrent : Adeline Hobart n'avait rien du genre sénile.
« M. Seagram? fit-elle d'une voix enjouée.
- Oui. Mrs Hobart?
- Entrez, je vous en prie. » Elle tendit la main. Elle avait la poigne ferme comme celle d'un homme. « Seigneur, personne ne m'appelle plus comme ça depuis plus de soixante-dix ans. Quand j'ai reçu votre coup de fil concernant Jake, j'ai été si surprise que j'ai failli en oublier de prendre mon Géritol. »
Adeline était trapue, mais elle portait sans mal ses kilos supplémentaires. Ses yeux bleus semblaient rire à chaque phrase et son visage avait une expression affable et chaleureuse. C'était tout à fait l'idée qu'on se faisait de la délicieuse petite vieille dame aux cheveux de neige.
« Je n'ai pas l'impression que vous ayez besoin de médicament », dit-il. Elle lui tapota le bras. « Si c'est de la flatterie, je l'accepte. » Elle lui indiqua un fauteuil dans un salon meublé avec goût. « Venez-vous asseoir. Vous allez rester déjeuner, n'est-ce pas ?
- Avec plaisir, si ça ne vous dérange pas.
- Bien sûr que non. Bert va passer sa journée au golf, et j'apprécie la compagnie. » Seagram leva les yeux. « Bert ?
- Mon mari.
- Mais je croyais...
- Que j'étais toujours la veuve de Jake Hobart, termina-t-elle pour lui avec un sourire innocent. En vérité, je suis devenue une Mrs Bertram Austin il y a soixante-deux ans.
- L'Armée le sait?
- Oh, Seigneur oui. J'ai écrit voilà longtemps plusieurs lettres au ministère de la Guerre pour les informer de ma situation conjugale mais ils ont tout simplement envoyé des réponses polies et vagues tout en continuant à m'expédier mes chèques.
- Bien que vous soyez remariée ? » Adeline haussa les épaules. « Je ne suis qu'une faible femme, M. Seagram. Pourquoi discuter avec le gouvernement? Si ces gens-là insistent pour envoyer de l'argent, est-ce à moi de leur dire qu'ils sont fous ?
- Un petit arrangement lucratif? »
Elle acquiesça. « Je ne le nierai pas, surtout compte tenu des dix mille dollars que j'ai reçus à
la mort de Jake. »
Seagram se pencha en avant en fronçant les sourcils. « L'armée vous a versé une indemnité de dix mille dollars? Est-ce que ça n'était pas beaucoup pour 1912?
- Vous n'auriez pas pu être aussi surpris que je l'ai été sur le moment, fit-elle. Oui, en ce temps-là, c'était une petite fortune.
- On ne vous a donné aucune explication ?
- Aucune, répondit-elle. Je vois encore le chèque après toutes ces années. Ça disait seulement
« versement veuve » et c'était à mon ordre. Rien d'autre.