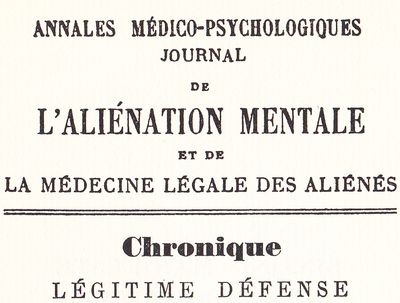
Ann. méd. psych., 12e série, t. II, novembre 1929.
Dans le dernier numéro des Annales Médico-Psychologiques, le docteur A. Rodiet, au cours d’une intéressante chronique, parlait des risques professionnels du médecin d’asile. Il citait les attentats récents dont ont été victimes plusieurs de nos confrères et il cherchait les moyens de nous protéger utilement contre le péril que représente le contact permanent du psychiatre avec l’aliéné et sa famille.
Mais l’aliéné et sa famille constituent un danger que je qualifierai « d’endogène », il est lié à notre mission, il en est l’obligatoire corollaire. Nous l’acceptons simplement. Il n’en est pas de même d’un danger que j’appellerai cette fois « exogène » et qui, lui, mérite tout particulièrement notre attention. Il semble qu’il devrait motiver, de notre part, des réactions plus remarquables.
En voici un exemple particulièrement significatif : un de nos malades, maniaque revendicateur, persécuté et spécialement dangereux, me proposait, avec une douce ironie, la lecture d’un livre qui circulait librement dans les mains d’autres aliénés. Ce livre, récemment publié par les éditions de la Nouvelle Revue Française, se recommandait par son origine et la présentation correcte et inoffensive. C’était « Nadja », d’André Breton. Le surréalisme y fleurissait avec sa volontaire incohérence, ses chapitres habilement décousus, cet art délicat qui consiste à se payer la tête du lecteur. Au milieu de dessins bizarrement symboliques, on rencontrait la photographie du professeur Claude. Un chapitre, en effet, nous était tout spécialement consacré. Les malheureux psychiatres y étaient copieusement injuriés et un passage (marqué d’un trait de crayon bleu par le malade qui nous avait si aimablement offert ce livre) attira plus particulièrement notre attention, il contenait ces phrases : « Je sais que si j’étais fou, et depuis quelques jours interné, je profiterais d’une rémission que me laisserait mon délire pour assassiner avec froideur un de ceux, le médecin de préférence, qui me tomberaient sous la main. J’y gagnerais au moins de prendre place, comme les agités, dans un compartiment seul. On me ficherait peut-être la paix. »
On ne peut pas trouver excitation au meurtre mieux caractérisée. Elle ne provoquera que la superbe de notre dédain ou même elle effleurera à peine notre nonchalante indifférence.
En appeler, en des cas semblables, à l’autorité supérieure, nous paraîtrait témoigner d’une turbulence si déplacée que nous n’oserions même pas y penser. Et cependant des faits de ce genre se multiplient tous les jours.
J’estime que notre torpeur est grandement coupable. Notre silence peut laisser suspecter notre bonne foi et il encourage toutes les audaces.
Pourquoi nos sociétés, notre amicale ne réagiraient pas à des incidents semblables, qu’il s’agisse d’un fait collectif ou d’un cas individuel ? Pourquoi ne pas faire parvenir un envoi de protestation à un éditeur qui publie un ouvrage comme « Nadja » et ne pas tenter une poursuite contre un auteur qui a dépassé à notre égard les limites de la bienséance ?
Je crois qu’il y aurait intérêt (et ce serait notre seul moyen de défense) d’envisager, dans le cadre de notre amicale par exemple, la formation d’un comité chargé spécialement de ces questions.
Le docteur Rodiet terminait sa chronique en concluant : « Le médecin d’asile peut à juste titre revendiquer le droit d’être protégé sans restriction par la société qu’il défend lui-même… »
Mais cette société semble oublier quelquefois la réciprocité de ses devoirs. C’est à nous de les lui rappeler.
Paul Abély.
Séance du 28 octobre 1929
M. Abély ayant fait une communication sur les tendances des auteurs qui s’intitulent surréalistes et sur les attaques qu’ils dirigent contre les médecins aliénistes, cette communication donna lieu à la discussion suivante :
DISCUSSION
Dr DE CLÉRAMBAULT : Je demande à M. le Professeur Janet quel lien il établit entre l’état mental des sujets et les caractères de leur production.
M. P. JANET : Le manifeste des surréalistes comprend une introduction philosophique intéressante. Les surréalistes soutiennent que la réalité est laide par définition ; la beauté n’existe que dans ce qui n’est pas réel. C’est l’homme qui a introduit la beauté dans le monde. Pour produire du beau, il faut s’écarter le plus possible de la réalité.
Les ouvrages de surréalistes sont surtout des confessions d’obsédés et de douteurs.
Dr DE CLÉRAMBAULT : Les artistes excessivistes qui lancent des modes impertinentes, parfois à l’aide de manifestes condamnant toutes les traditions, me paraissent, au point de vue technique, quelques noms qu’ils se soient donnés (et quels que soient l’art et l’époque envisagés), pouvoir être qualifiés tous de « Procédistes ». Le Procédisme consiste à s’épargner la peine de la pensée, et spécialement de l’observation, pour s’en remettre à une facture ou une formule déterminées du soin de produire un effet lui-même unique, schématique et conventionnel : ainsi l’on produit rapidement, avec les apparences d’un style, et en évitant les critiques que des ressemblances avec la vie faciliteraient. Cette dégradation du travail est surtout facile à déceler sur le terrain des arts plastiques ; mais dans le domaine verbal, elle peut être démontrée tout aussi bien.
Le genre de paresse orgueilleuse qui engendre ou qui favorise le Procédisme n’est pas spécial à notre époque. Au XVIe siècle, les Concettistes, Gongoristes et Euphuistes ; au XVIIe siècle, Les Précieux ont été tous des Procédistes. Vadius et Trissotin étaient des Procédistes, seulement des Procédistes beaucoup plus modérés et laborieux que ceux d’aujourd’hui, peut-être parce qu’ils écrivaient pour un public plus choisi et plus érudit.
Dans les domaines plastiques, l’essor du Procédisme semble ne dater que du siècle dernier.
M. P. JANET : À l’appui de l’opinion de M. de Clérambault, je rappelle certains procédés des surréalistes. Ils prennent par exemple cinq mots au hasard dans un chapeau et font des séries d’associations avec ces cinq mots. Dans l’Introduction au Surréalisme, on expose toute une histoire avec ces deux mots : dindon et chapeau haut de forme.
M. DE CLÉRAMBAULT : À un moment de son exposé, M. Abély vous a montré une campagne de diffamation. Ce point mérite d’être commenté.
La diffamation fait partie essentiellement des risques professionnels de l’aliéniste ; elle nous attaque à l’occasion, et en raison de nos fonctions administratives ou de notre mandat d’experts : il serait juste que l’autorité qui nous commet nous protégeât.
[…]
Contre tous les risques professionnels, de quelque nature qu’ils puissent être, il faudrait que le technicien fût garanti par des dispositions précises lui assurant des secours immédiats et permanents. Ces risques ne sont pas seulement d’ordre matériel, mais d’ordre moral. La préservation contre ces risques comporterait secours, subsides, appui juridique et judiciaire, indemnités, enfin pension parfois permanente et totale. À la phase d’urgence, les frais d’assistance peuvent être couverts par une Caisse d’Assurance Mutuelle ; mais en dernier ressort ils doivent incomber à l’autorité même au service de laquelle les dommages ont été subis.
[…]
La séance est levée à 18 heures.
Un des secrétaires, Guiraud.