L'Illustration, No. 0043, 23 Décembre 1843

Bureaux, rue de Seine, 33.
Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--Un an, 30 fr.
Prix de chaque Nº, 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75.
Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--Un an, 32 fr.
pour l'étranger -- 10 -- 20 -- 40
SOMMAIRE.
Casimir Delavigne. Notice biographique et littéraire. Portrait de Casimir Delavigne.--Courrier de Paris.--Théâtres. Portrait de Marie-Joseph Chénier. Théâtre-Français: Une scène de Tibère. Cirque-Olympique: Dernière scène du Vengeur; la Mer calme et la Mer agitée, caricatures. Théâtre-Italien: Une scène de Il Fantasma.--L'Horloge qui chante, nouvelle, par Albert Aubert. (Suite et fin).--Histoire de la Semaine. Ouverture du cours de M. Raoul-Rochette; Portrait du duc de Nassau.--Algérie. Arrivée de M. le duc d'Aumale à Constantine. Une Gravure.--Le Procédé Rouillet. Six gravures.--Publications Illustrées. Les faits mémorables de l'histoire de France. Une Gravure. Aventures de Tom Pouce. Dix Gravures. La Chine ouverte. Deux Gravures. Impressions de voyage de M. Boniface. Dix Gravures.--Annonces.--Modes. Bijouterie. Cinq Gravures.--Caricature.--Rébus.

Casimir Delavigne
NOTICE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE.
«Notre armée au cercueil eut mon premier hommage...
... Poète et Français, j'aime à vanter la France;
Qu'elle accepte en tribut des périssables fleurs.
Malheureux de ses maux et fier de ses victoires,
Je dépose à ses pieds ma joie et mes douleurs;
J'ai des chants pour toutes ses gloires,
Et des larmes pour ses douleurs. »
Ainsi chantait, aux premiers jours de la Restauration, le jeune auteur des Messéniennes; ainsi, en ces heures de deuil national, le poète, à peine âgé de vingt-trois ans, prenait le pieux engagement de consacrer sa lyre à la patrie, que tant d'autres avaient reniée publiquement; à la France, que l'étranger occupait encore! Noble serment, que le poète ne trahit jamais! foi patriotique qui fut par lui religieusement gardée! Après avoir pleuré les malheurs de l'invasion, après avoir réchauffé de ses vers généreux l'amour de la patrie, qui semblait se mourir dans tous les cœurs; après avoir chanté les vieilles gloires nationales, c'est encore au nom de la France, au nom de la liberté, que M. Delavigne célèbre et Parthénope révoltée contre L'Étranger, et l'héroïque soulèvement des Hellènes. Napoléon meurt sur son rocher, le poète chante Napoléon; lord Byron va chercher une tombe glorieuse à Missolonghi, le poète chante lord Byron. Plus tard paraîtront encore sept autres Messéniennes, et toujours reviendront ces mots sacrés de liberté et de patrie; toujours le porte s'inspirera des généreux sentiments, des nobles indignations qui avaient arraché de son cœur la première et la plus belle de ses hymnes, le Chant funèbre de Waterloo! Enfin, c'est à lui encore qu'appartiendra la gloire de fournir une autre Marseillaise aux vainqueurs de Juillet. Ainsi fut noblement remplie la tâche que le poète s'était imposée aux premiers jours de sa jeunesse, et auteur des Messéniennes put dire avec un modeste orgueil:
« ..........Cette liberté
Qui séduit ma raison à sa mâle beauté,
Que ma muse poursuit de son ardent hommage,
Et dont mes fleurs d'un jour ont couronné l'image. »(1).
Note 1: Épître à M. de Lamartine.
Que d'autres, venus plus tard, aient donc par des strophes plus éclatantes, par des accents plus poétiques, enlevé à M. Delavigne le prix de la lyre, nul ne pourra se vanter d'avoir mieux fait battre les cœurs, nul ne pourra se parer d'une gloire plus pure, nul ne pourra dire mieux que lui: Exegi monumentum! Et la France n'oubliera point ces chants qu'elle seule inspira; et, quand l'illustre poète vient de descendre dans la tombe, sa plus belle, sa plus glorieuse épitaphe demeure encore: «Ci-gît l'auteur des Messéniennes!
Oui, la France a perdu un noble cœur, une âme sincère, un esprit honnête et généreux. Sont-ce là aujourd'hui des pertes aisément réparables? et sommes-nous assez riches en pareilles vertus pour ne point regretter amèrement ceux qui les possédaient et qui viennent à mourir? Rendons au moins cette justice à notre pays, que la mort de M. Delavigne a été marquée par la douleur publique, et que si quelques-uns, de son vivant, furent sévères pour le poète, le regret universel atteste aujourd'hui l'estime sincère que tous avaient pour son beau talent et son noble caractère!
Rappelons en quelques mots l'histoire de cette vie glorieuse, que prématurément la mort vient du trancher, en la maturité du talent et la force du génie.--Jean-François-Casimir Delavigne naquit au Havre, en avril 1795; son père, honorable négociant, avait acquis quelque fortune dans le commerce de la porcelaine. L'enfance du poète, comme celle de Boileau, n'offre rien de remarquable; le jeune Casimir, non plus qu'autrefois le jeune Nicolas, n'était rien moins qu'un enfant sublime! et comme le père de Despréaux assurait d'avance que son fils Nicolas ne dirait jamais de mal de personne, ainsi le père de M. Delavigne disait un jour à l'auteur futur de Louis XI: «Toi, mon pauvre Casimir, tu continueras mon commerce de faïence.»--«Que deviennent donc tous ces génies de douze ans?» demandait Johnson; et d'Alembert ne félicitait-il pas Boileau d'avoir été le contraire de ces petits prodiges, qui souvent sont à peine des hommes ordinaires, esprits avortés, que la nature abandonne comme si elle ne se sentait pas la force de les achever.
Cependant, le jeune Delavigne, éclipsé par ses frères, ne tarda pas à les surpasser à son tour. Élève brillant du Lycée Napoléon, il faisait sa rhétorique en 1811 lorsque naquit le roi de Rome; l'enthousiasme public échauffa sa verve poétique, et il composa un dithyrambe dont l'empereur se montra satisfait. Plusieurs autres essais poétiques signalèrent, dès le collège, la veine naissante du jeune Delavigne, et à dix-huit ans il avait déjà tenté l'épopée et la tragédie de rigueur. Ces ébauches ne se recommandaient guère que par une pureté de versification, assez, commune d'ailleurs dans l'école de Delille, alors florissante.--Des revers de fortune avaient frappé le père de M. Delavigne, et, au sortir du collège, le jeune poète se vit contraint d'accepter un emploi administratif.--1815 arrive: la France est vaincue, asservie; le cœur du poète se gonfle amèrement: «facit indignatio versus!» et les trois premières messéniennes rendent aussitôt le nom de Delavigne cher à tous les Français. En même temps sont écrites les Vêpres siciliennes, où semble vibrer encore la généreuse colère, l'indignation patriotique qui avaient déjà retenti dans les chants lyriques de l'auteur. Deux ans une lecture est sollicitée au Théâtre-Français, et enfin obtenue. Le comité reçoit la pièce, «à cette petite condition seulement, dit un biographe, que l'auteur n'exigerait jamais qu'elle fût jouée; une actrice, qui faisait partie du comité, la rejeta même sans condition, en déclarant qu'il y aurait inconvenance à mettre le mot vêpres sur une affiche de théâtre, et que, pour sa part, elle ne souffrirait jamais ce scandale.»
M. Delavigne rentre chez lui indigné, et, en trois mois, il écrit sa pièce des Comédiens, dont les malicieuses épigrammes devaient le venger un jour de messieurs les sociétaires.--A quelque temps de là, l'Odéon renaissait de ses cendres (1819), et Picard, le nouveau directeur de ce théâtre, demanda les Vêpres siciliennes à l'auteur refusé. Le succès fut prodigieux, et le poète, redemandé à grands cris, se vit traîné de vive force sur la scène, où il fut salué par des applaudissements incroyables; la pièce eut trois cents représentations consécutives, dont les cent premières versèrent 400,000 fr. dans la caisse du théâtre.--L'année suivante les Comédiens furent joués sur la même scène, et le succès du cette nouvelle pièce vengea suffisamment l'auteur des injustes dédains de la Comédie-Française. Déjà le Paria était achevé, et au mois de décembre 1821, cette tragédie fut représentée à l'Odéon: le poète, pour écrire sa nouvelle pièce, avait consulté tous les livres qui traitaient de l'Orient; il avait longtemps étudié Bernardin de Saint-Pierre, Tavernier et Raynal. On reconnaît là l'écrivain sincère qui prit plus tard pour texte de son discours de réception à l'Académie: «De l'influence de la conscience en littérature.» Et certainement, jusqu'à la fin de sa vie, M. Delavigne s'est montré fidèle à ce principe d'honnêteté littéraire, si méconnu de nos jours.
«Cette tragédie du Paria, qui venait confirmer et couronner d'une manière brillante des succès déjà si nombreux, semblait devoir ouvrir à l'auteur les portes de l'Académie. Il se mit deux fois sur les rangs; la première fois on lui préféra M. l'évêque d'Hermopolis; la seconde fois, M. l'archevêque de Paris; ses amis l'engageaient à se présenter encore une fois il s'y refusa, «craignant, disait-il en riant, qu'on ne lui opposât le pape (2).»
[Note 2: Biographie de M. Casimir Delavigne, par un Homme de Bien, page 21.]
A cette époque M. C. Delavigne, bibliothécaire à la Chancellerie, se vit frappé d'une brutale destitution par le ministère Villèle. La presse prit hautement le parti du poète, et le duc d'Orléans écrivit à M. Delavigne, pour lui proposer une place de bibliothécaire au Palais-Royal. La lettre se terminait par ces mots, également honorables pour le prince et pour le poète; «Le tonnerre est tombé sur votre maison; je vous offre un appartement dans la mienne.» M. Delavigne accepta cette place, si gracieusement offerte, et conçut des lors un sincère attachement pour son protecteur. Plus tard, à l'occasion du sacre de Charles X, la maison du roi offrit au poète une pension de l,200 livres, qu'il refusa.
Cependant le Théâtre-Français, auquel M. Delavigne n'avait point tenu rancune, représentait avec un grand succès la comédie de l'École des vieillards (1823); Talma, pour la première fois, avait consenti à jouer un rôle de comédie; il créa le rôle de Danville auprès de mademoiselle Mars, qui remplissait celui d'Hortense.--Le triomphe fut tes que l'Académie se vit bien forcée d'ouvrir ses portes au poète; il obtint vingt-neuf suffrages sur trente(1825). Son discours de réception, prononcé au mois de juillet de la même année, présente une sorte de profession de foi littéraire. L'auteur, déjà préoccupé par les nouveautés qui se faisaient jour, et songeant dès lors à fondre en un seul les deux systèmes poétiques, se déclare pour «l'audace réglée par la raison;» mots remarquables, qui doivent éclairer la critique dans l'appréciation qu'elle fera du théâtre et des odes de M. Delavigne. La tragédie de Louis XI était commencée; les laborieuses recherches auxquelles l'auteur se livra pour composer cette nouvelle pièce altérèrent sa santé: il s'embarqua pour l'Italie à bord de la Madone, et à son retour (1827), il publia les sept nouvelles Messéniennes, qui n'eurent point le succès des premières.--L'année suivante, la princesse Aurélie n'obtint au Théâtre-Français qu'un succès d'estime; la presse se montra généralement hostile à cette nouvelle comédie, qui ne demeure pas moins, comme la Popularité, un des meilleurs ouvrages de M. Delavigne.--Enfin, fauteur des Vêpres siciliennes, abandonnant la voie purement classique qu'il avait jusqu'alors suivie, sembla obéir au mouvement littéraire de l'époque en composant ces pièces mixtes, qui ne sont proprement ni des drames ni des tragédies. Marino Faliero, joué à la Porte-Saint-Martin en 1829; Louis XI, au Théâtre-Français en 1832; les Enfants d'Édouard, au même théâtre, l'année suivante, puis Don Juan d'Autriche (1835); une Famille sous Luther (même date); La Popularité (1838) et la Fille, du Cid, marquèrent les différents pas que fit M. Delavigne dans cette nouvelle route dramatique. Le succès couronna presque toujours les tentatives du poète, et celles d'entre ces pièces qui ne restèrent point à la scène obtinrent du moins un succès de lecture incontestable.
Nous aurons achevé cette biographie, monotone peut-être parce qu'elle n'offre qu'un enchaînement de triomphes, si nous ajoutons que M. Delavigne, depuis longtemps malade et presque condamné par les médecins, poursuivait sans relâche l'accomplissement de ses nouveaux projets littéraires. Le travail était devenu toute sa vie, et, sur son lit de mort, le poète travaillait encore, composant sans doute un nouveau chef-d'œuvre, dont malheureusement rien ne nous restera; car M. Delavigne avait, dit-on, l'habitude de faire ses pièces tout entières en son cerveau avant d'en écrire le premier vers. Singulière puissance d'esprit, qui ne pouvait être ébranlée par les souffrances les plus aiguës! Don Juan d'Autriche, cette comédie si vive et si gaie, fut composée au plus fort d'une maladie nerveuse, qui inspirait à la famille du poète de mortelles inquiétudes.
M. Casimir Delavigne est mort à Lyon, dans la nuit du 11 au 12 décembre; il se rendait à Montpellier, espérant trouver, sous le ciel du Midi, un adoucissement à ses continuelles souffrances. Sa femme et son fils ont reçu son dernier soupir.--Les restes mortels du grand poète ont été ramenés à Paris pour y recevoir les derniers honneurs.
Et maintenant, puisque déjà la postérité est commencée pour M. Delavigne, nous sera-t-il permis de joindre à cet éloge funèbre quelques mots de critique littéraire, pour essayer de marquer précisément la place qu'a occupée l'auteur des Messéniennes et de Louis XI parmi les poètes contemporains, et de distinguer le rôle particulier qu'il fui appelé à remplir dans cette grande tourmente poétique, dans ce conflit violent des systèmes ennemis, dans cet antagonisme acharné de la vieille el de la jeune poésie? Un homme seul, de nos jours, fut assez heureux ou assez grand pour demeurer tout à fait neutre entre les deux partis rivaux, et se voir honoré à la fois par les romantiques et par les classiques. Ce poète, c'est Béranger.
M. Delavigne ambitionnait aussi cette neutralité glorieuse; mais, pour y arriver, il prit une mauvaise route: il se fit conciliateur. Or, Molière nous a appris que l'on ne gagne rien de bon à empêcher les gens de se battre. Les tentatives conciliatrices de M. Delavigne n'eurent donc d'autre effet que de lui rendre hostiles et l'un et l'autre camp.
Un homme s'est rencontré en Allemagne assez fort, assez audacieux pour tailler cette synthèse littéraire et la réaliser en apparence. L'étonnant génie de Gœthe, en des œuvres immortelles, enferma la pensée poétique des anciens et celle des modernes, et, à force d'art, il parvint à se créer cette langue prodigieuse qui s'inspire à la fois de Sophocle et de Shakspere, du Virgile et de Dante. Mais, dans ce merveilleux travail, le poète s'effaça sous l'artiste. L'Allemagne elle-même appela tous ses chefs-d'œuvre des statues, et condamna son plus beau génie par le surnom qu'elle lui donna de grand païen. Ce que Gœthe n'avait pu faire, était-il réservé à Delavigne de l'accomplir? L'auteur de Louis XI devait-il espérer cette gloire suprême, réservée sans doute aux poètes à venir, de fondre en une poésie souveraine les deux génies jusqu'alors opposés des classiques et des romantiques?--La première qualité qui fût nécessaire pour opérer une semblable liaison, c'était évidemment un don presque divin d'invention une double imagination de fond et de forme. Or,--ses admirateurs eux-mêmes en conviennent,--M. Delavigne ne fut pas moins qu'un inventeur. Au lieu d'imaginer de son propre chef, il se reposait volontiers de ce soin sur Shakspere ou Byron, et se contentait de «se tailler un pourpoint dans ces manteaux de rois.» Quant au style, l'auteur des Messéniennes était essentiellement conservateur; ses propres paroles en font foi: «Plein de respect pour les maîtres qui ont illustré notre scène par tant de chefs-d'œuvre, je regarde comme un dépôt sacré cette langue belle et flexible qu'ils nous ont léguée.» (Préface de Marino Faliero.)
M. Delavigne avait été élevé et nourri dans le classicisme le plus pur, le plus absolu, je veux dire le classicisme impérial. Il avait grandi dans l'admiration passionnée de Delille et de Ducis; et à les regarder de près les Messéniennes ne sont-elles pas écrites dans la langue du poème des Jardins, comme les Vêpres Siciliennes dans celle d'Othello et du Roi Lear? M. Delavigne, comme toute l'école impériale, fut d'abord et avant tout un homme d'esprit, un littérateur bien élevé, un versificateur attique, de ceux-là que chérissait du préférence le bonhomme Andrieux.--Que ces mots d'ailleurs n'aillent pas être pris, en mauvaise part. Pour peu que l'on soit familier avec l'esprit de notre littérature classique, ou accordera que l'inspiration du bon ton et de la convenance a régné presque uniquement dans les vers et la prose de nos deux grands siècles. De là cette fleur d'urbanité, ce parfum d'exquise politesse qui rendirent les lettres françaises chères à toutes les cours européennes. Tous nos écrivains classiques furent gens de bonne compagnie, et leur plus digne représentant, c'est le comte de Buffon, mettant, pour écrire, ses manchettes de dentelle.--Or, ce fut là le mérite singulier de M. Delavigne, de demeurer le fidèle et dernier représentant de la convenance polie et discrète, en ces temps d'anomalies souvent monstrueuses et de licences, pour la plupart, impertinences. Homme d'esprit à côté d'hommes passionnés, il conserva, dans son style comme dans ses créations, le respect constant de ces limites chaque jour violées. Peut-être pécha-t-il par défaut, mais non par excès; et, en somme, le monument qu'il a élevé garde une rare dignité, qui ne sera pas son moindre titre aux yeux de l'avenir.
Cependant, on ne peut le nier, malgré cette éducation, cette seconde nature classique, qui désormais ne pouvait point se refaire, M. Delavigne, âme avidement ouverte à toutes les émotions du jour, à tous les sentiments généreux qui remuaient la France, ne demeura pas insensible à ce souffle poétique qui s'élevait tout à coup, et gonflait les voiles des jeunes poètes. Assis dans son esquif classique (Voyez l'épître à M. de Lamartine: «Sous nos deux pavillons nous voguons séparés.»), l'auteur dus Messéniennes osa livrer, aussi lui, sa voile au vent inconnu; mais il ne se hasarda pas sur cette mer nouvelle assez loin pour perdre de vue les rivages accoutumés.
Il semble que M. Delavigne, au lieu d'adopter par antipathie les nouveautés littéraires, les ait comme subies à son corps défendant. Il y a dans ses innovations une telle timidité, une telle réserve, que le poète paraît faire un sacrifice à la mode du temps, prenant la cocarde romantique, mais restant au fond du cœur fidèle à ses premières muses. Regardez Louis XI, les Enfants d'Édouard, Marino Faliero; l'enveloppe est à demi romantique, mais le fond demeure classique; le style s'enrichit de quelques couleurs nouvelles, mais il est toujours tissu sur la trame élégante et quelque peu lâche de Delille et de Ducis. M. Planche disait, trop sévèrement sans doute, mais avec quelque justice: «On prétend que M. Delavigne a travaillé à son Louis XI quatorze ans. Je ne m'étonne pas que sa tragédie réfléchisse toutes les révolutions qui se sont accomplies au sein de la poésie dramatique, qu'il y ait dans son poème un peu de tout, une imitation de toutes les manières..... M. Delavigne n'est ni de ce siècle, ni du siècle passé, ni du siècle précédent. Je défie le plus habile de surprendre une parenté, si lointaine qu'elle soit, entre M. Delavigne et les choses ou ses hommes de ce temps-ci. Les Enfants d'Édouard m'ont semblé une gageure d'emprunter à toutes les querelles, à tous les systèmes, ce qu'ils ont d'inoffensif et de superficiel.»
Il faut bien, en effet, le reconnaître: n'ayant pas le don d'initiative, qui eût été nécessaire pour jouer ce grand rôle de médiateur entre les deux écoles, et subissant, par conscience peut-être, les innovations poétiques, M. Delavigne ne put atteindre le but sublime qu'il se proposait, c'est-à-dire de fonder, par la réunion et la fusion pacifique des principes ennemis, cette grande école littéraire qui semble être promise aux destinées futures de notre pays. Et il arriva, chose étrange, qu'au lieu de prendre les devants, l'auteur de Louis XI rétrogradait plutôt. Sa poésie mixte, son inspiration mêlée et confuse, pour ainsi dire, semblent en effet former comme une sorte de transition entre l'école impériale, qui se mourait, et l'école romantique, qui naissait pour lui succéder. Si donc M. Delavigne était apparu aux derniers jours du dix-huitième siècle, avant les Natchez et les Martyrs, il eût tenu à cette époque une place éminence, joué un rôle salutaire, rempli une mission féconde. Mais, poète transitoire, alors que MM. Lamartine et Hugo avaient décidé déjà le grand mouvement poétique, il lui fut seulement réservé d'initier la masse, toujours retardataire, aux nouvelles idées qui triomphaient déjà dans les régions plus hautes. De là, sans limite, les grands succès populaires de M. Delavigne; et c'est en ce sens qu'il fait entendre ces dures paroles de M. Plauche: «L'esprit, l'imagination et le style de M. Delavigne sont à la taille du plus grand nombre.»
Jusqu'ici nous n'avons apprécié que la valeur relative, pour ainsi dire de M. Delavigne; il nous fallait bien juger le poète au vis-à-vis de ses contemporains, puisqu'il avait prétendu lui-même servir de lien entre les partis apposés de son temps.--Si, maintenant, nous considérons absolument les œuvres de M. Delavigne, non-n'aurons qu'à répéter les louanges légitimes que chacun a déjà donnés au talent ingénieux, à l'esprit élégant, au style toujours pur et choisi de l'auteur des Messéniennes. Mais nous vanterons surtout cette conscience poétique, cette honnêteté littéraire, qui ne se rencontrent plus de nos jours, et qui respirent dans toutes les œuvres de M. Delavigne. Jamais il ne fit trafic de sa muse, jamais il ne trempa dans ces basses pratiques, familières à nos écrivains les plus en renom; jamais enfin le poète ne cessa d'être un honnête homme. Aussi son nom conservait-il auprès du public tout son premier crédit, et ses plus minces productions étaient accueillies avec l'estime respectueuse que l'on devait à l'auteur. M. Delavigne, d'ailleurs, trouva en sa probité littéraire la récompense qu'elle méritait; il fui presque le seul de nos auteurs fameux qui ne vit point décroître, avant l'âge, son talent et son génie; jusqu'au dernier moment, il se préserva de la limite des œuvres indignes, et jamais peut-être ne s'est-il élevé plus haut, comme écrivain, que dans sa comédie de la Popularité, composée si longtemps après ses premiers chefs-d'œuvre.
Donnons donc un nouveau regret à cet homme éminent, si tôt enlevé aux lettres et à la patrie. Personne, hélas! parmi la génération nouvelle, ne se levant pour remplacer ceux qui s'éteignent, la mort de chaque grand poète doit sembler deux fois douloureuse, et par la perte d'un beau génie, et par le vide qu'elle laisse après elle, et qui ne sera point comblé.
Les obsèques de M. Casimir Delavigne ont eu lieu mercredi, 21 décembre. Toutes les classes de la société avaient des représentants à cette triste solennité; ou évaluait à plus de six mille le nombre des assistants. Les notabilités littéraires, artistiques et politiques s'étaient particulièrement empressées de venir rendre ce dernier devoir à l'illustre poète.
Le deuil était conduit parle fils du défunt, et par MM. Germain et Fortuné Delavigne.
L'Académie Française, la commission des auteurs dramatiques et la Comédie-Française, assistaient en corps aux obsèques.--Le roi et le duc de Nemours avaient envoyé leurs voitures.
Des discours ont été prononcés sur la tombe de M. Delavigne par MM. Montalivet, Victor Hugo, Frédéric Soulié, Tissot, ancien professeur de M. Delavigne, Samson et Léonard Chodsko: celui-ci parlait au nom de la nation polonaise.
Une souscription va, dit-on, être ouverte pour élever un monument au grand porte que la France a perdu. Les théâtres, et d'abord la Comédie-Française, contribueraient par des représentations à cette œuvre nationale.
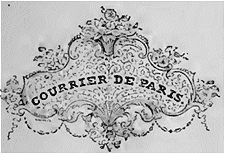
Ces derniers jours ont été attristés par plus d'une mort; je ne parle pas des morts vulgaires: celles-là suivent leurs cours habituel et s'accomplissent sans bruit. Je veux parler des morts qui emportent un homme d'esprit ou de talent, interrompent tout à coup celui-ci au milieu d'un bon mot, celui-là dans la méditation d'une œuvre importante, et obtiennent dans le journal du lendemain les honneurs de l'article nécrologique. Ainsi nous avons à regretter Casimir Delavigne, mort illustre! Presqu'en même temps que le noble poète, un autre homme mourait, qui n'était qu'un homme intelligent, d'humeur originale et plaisante; mais il avait poussé si loin la singularité et la verve folle, qu'il était arrivé par là à une véritable célébrité, du moins dans le monde où il vivait et dans le cercle de ses nombreux amis.--Casimir Delavigne a droit à une place à part, à un hommage sérieux, complet, à l'abri de tout voisinage et tout mélange; cette place particulière, l'Illustration l'a réservée au poète.--Quant à Wollis, l'autre mort, ce n'est pas un de ces fiers enfants de la Muse, un de ces bardes inspirés dont on n'approche qu'avec respect et qui demandent un sanctuaire; on peut donc placer ici Wollis sans façon, et lui faire un simple signe d'adieu. Certes, l'ombre de ce gros, intéressant et joyeux philosophe ne se fâchera point d'être ainsi traitée sans plus, de cérémonie; il n'est pas possible que Wollis soit plus exigeant sur le décorum après sa mort que de son vivant: Wollis était certainement l'adversaire le plus déclaré de toute pompe et de toute étiquette.
Tant qu'il a vécut, il fut avocat. Dieu seul aujourd'hui sait ce que Wollis est maintenait!! Mais le n'était pas un de ces avocats jaunes, roides, étiques, amaigris par les vieux rêves et le Digeste; il avait la panse ronde les joues dodues et fleuries, la lèvre pleine d'appétit, l'œil au champagne. Comme, après tout, les dieux et les rois sont soumis à de rudes épreuves dans la succession des résolutions et des métamorphoses religieuses et politiques, on aurait pu croire, à voir notre Wollis, que c'était le dieu Bacchus ou le roi de Cocagne que la charte du paganisme ou l'établissement du système représentatif avaient obligé de se réfugier sous la toge, et de se faire inscrire au tableau des avocats près la Cour Royale de Paris.
Il était de la philosophie épicurienne de feu Étienne Béquet, le prédécesseur de M. Jules Janin au Journal des Débats, et pratiquait la religion de maître Adam:
Aussitôt que la lumière
Vient redorer nos coteaux.
Je commence ma carrière
Par visiter mes tonneaux.
Wollis plaidait souvent. On écoutait avec plaisir sa parole vive, spirituelle, fine... et fréquemment trempée de chambertin et d'aïl, generosa plena Baccho, suivant l'expression d'Horace. Comme orateur, Wollis se couronna de pampres encore plus que de lauriers.
Tous ses confrères l'aimaient,--la tendresse est rare entre avocats,--ils l'aimaient pour sa rondeur, la facilité de ses mœurs, sa gaieté, ses saillies, pour les mots piquants et comiques qu'il semait à pleines mains avec une verve intarissable. Les graves présidents eux-mêmes ne pouvaient s'empêcher de tempérer leur rigidité d'un sourire, en voyant Wollis prendre place à la barre.--Wollis fut un des fondateurs de la Gazette des Tribunaux: il excellait dans le compte-rendu pathétique ou burlesque; le drame, la comédie, la parade judiciaires avaient en lui un historiographe pittoresque qu'on remplacera difficilement.
Il a fini par une attaque d'apoplexie,--comme il devait finir.--La veille, il s'arrosait encore amplement et plaidait pour une pauvre femme dont il obtenait l'acquittement. C'était mourir à peu près comme il avait vécu, entre un verre et une Cour d'assises. Du reste, Wollis ne regrette pas la vie, on peut en être sur. Il était d'avance trop bien préparé à toutes les fortunes; et puis, le siècle commençait à lui sembler assez maussade.
Aimant la vie et les couplets,
Nos pères étaient gais et frais.
On change de coutume:
Nos jeunes gens au teint blafard
Sont joyeux comme un corbillard.
Amis, voilà, oui c'est bien là.
C'est cela qui m'enrhume!
«Tous ces gens-là, sont insipides, disait-il deux jours avant sa fin; il est temps que j'aille un peu m'égayer chez les morts!»--O Wollis! peux-tu nous dire si en effet l'autre monde est plus gai que celui-ci?
Paris n'est pas encore remis de la surprise mêlée d'effroi que lui a causée l'assassinat de la malheureuse veuve Senépart. Jamais l'Ambigu-Comique, dont le mari de cette pauvre vieille femme a été longtemps directeur, n'a offert, dans ses plus noirs mélodrames, un crime plus singulièrement horrible que ce crime commis en plein jour, avec une audace et un sang-froid épouvantables. Ou sait que l'assassin se nomme Ducros; il est âgé de vingt et un ans et appartient à une honorable famille de Toulouse. Ducros était venu perfectionner à Paris ses études de pharmacie, disent les journaux. Quel perfectionnement! Trois jours après son arrivée il étranglait madame veuve Senépart et la volait. Ducros a la voix douce, les manières douces, le regard doux. On peut dire,--qu'on me pardonne cet humble assemblage de mots,--qu'il assassinait son monde avec politesse. Au moment où il sortait d'étrangler sa victime, tandis qu'elle était palpitante et râlant encore, quelqu'un le vit, le chapeau à la main, s'inclinant sur le seuil de la porte, dans l'attitude d'un homme qui se défend contre un excès de prévenance: «Non, madame, disait-il, ne vous dérangez pas; rentrez chez vous, je vous en supplie; je ne souffrirai pas que vous me reconduisiez plus loin.» Il parlait ainsi pour donner le change et faire attester au besoin, si ou l'accusait, qu'à l'instant où il avait quitté la veuve Senépart, elle vivait encore, puisqu'elle voulait à toute force le reconduire jusque sur le palier.
On a raconté comment, après le meurtre, il était allé chez M. Senépart fils, auquel il était particulièrement, recommandé par d'honorables habitants de Toulouse, et comment il se rendait chez une nièce de sa victime au moment où il fut reconnu et arrêté; mais voici un fait qui n'a pas été publié. Deux jours avant le crime, M. Senépart fils, voulant faire honneur à ces lettres de recommandations, invita Ducros à dîner. Ducros vint: on dîna bien et gaiement; l'homme qui devait bientôt étrangler la mère reçut de la main confiante du fils le vin et le pain de l'hospitalité. Le dîner fini, M. Senépart s'excusa, pour raison d'affaires, d'être obligé de sortir: «Eh bien, dit Ducros, je finirai la soirée avec madame.»--M. Senépart, récemment marié, n'habitait pas avec sa mère.--D'abord il fut sur le point de céder à la proposition de Ducros; puis, toute réflexion faite, il fit comprendre à son hôte qu'il ne serait pas convenable de sa part de rester toute une soirée seul avec une jeune femme qui le voyait et le recevait pour la première fois. Cette insinuation parut vivement contrarier Ducros. Il se retira cependant en disant: «J'irai au spectacle!» II alla en effet au théâtre des Variétés, où il se divertit beaucoup à voir Bourré et Le Gamin de Paris.
La jeune dame Senépart raconte avec terreur ce dîner, et l'insistance que mit Ducros à vouloir rester près d'elle pendant l'absence de M. Senépart. L'horrible catastrophe qui suivit cette soirée, certaines marques d'impatience, certains regards rapides et inquiets, qui n'avaient alors aucun sens pour madame Senépart, et qu'elle explique aujourd'hui, peuvent faire soupçonner que Ducros aurait tenté ce soir-là contre la bru le crime qu'il accomplit le surlendemain sur la belle-mère.
On annonce l'arrivée à Paris de l'ex-régent Espartero. L'ordre est arrivé de lui préparer un appartement à l'hôtel Meurice. Espartero s'ennuie à Londres; le spleen le gagne; ses médecins lui ont conseillé Paris. Il faut donc compter sur Espartero, et le mettre un nombre des curiosités de cet hiver. Mais qu'il s'y attende: quand on l'aura vu une fois manger un bifteck au Café de Paris prendre sa demi-tasse chez Torloni, et jouer sa partie de whist au Cercle des étrangers, tout sera dit, personne ne le regardera plus. Zurbano durerait un peu plus longtemps; mais Zurbano ne viendra pas; il s'est fait définitivement ermite, et habite, suivant les correspondances de Madrid, un petit village des environs de Valence, où il a ouvert un débit de cigarettes. O vanitas vanitatum!
Quelque chose fait plus de bruit que la prochaine arrivée d'Espartero. Ce quelque chose vaut bien la peine en effet qu'on s'en occupe.--Ah! de grâce, dites-nous ce quelque chose?--M. Berryer va convoler en secondes noces. Si nous nous mariions, vous, moi ou mon voisin, l'affaire ne ferait pas le moindre bruit; à peine si le bedeau de la paroisse s'en douterait. Mais M. Berryer, diable! prenons garde; toutes les cloches de la vieille monarchie vont carillonner. M. Berryer était veuf depuis à peu près un an. Veuf, il épouse une veuve, madame de Sommariva. Feu M. de Sommariva était, comme ou sait, un grand amateur des beaux-arts; sa galerie de tableaux et de sculpture passait pour une des plus riches qu'un simple particulier eût jamais possédées. Elle a été vendue publiquement après sa mort. Quoi qu'il en soit, M. Berryer, en prenant possession de l'hôtel de Sommariva, y trouvera bien encore quelque statue de Démosthène ou de Cicéron pour lui tenir compagnie.
Puisque nous voici à parler de statues, parlons de la statue qu'il est question d'élever à Rossini dans le foyer de l'Opéra. Nous ne sommes pas pour les statues qu'on dresse aux gens de leur vivant; c'est leur donner de l'encensoir dans le nez; cela fait mal. Ce n'est pas que nous contestions la gloire du Rossini ni son génie; si quelqu'un a droit à la statue lyrique, c'est lui assurément; il y a droit au même titre que Gluck et Mozart. Mais si nous rendons cet honneur à l'auteur de Guillaume-Tell et du Barbier, gare! nous sommes perdus! Les statues vont nous écraser; chaque croque-note voudra avoir sa statue. Sous savez de quels effrayants amours-propres sont doués les petits hommes de ce temps-ci: il n'y en a pas un qui ne se croie l'égal d'un colosse. Allons! vite, sculpteur, taille-moi en marbre, coule-moi en bronze, je veux avoir ma statue! Rossini a bien la sienne! Et en effet, les voici déjà qui s'ameutent; depuis que le bruit est répandu qu'un comité d'artistes s'est formé pour aviser au moyen de mettre Rossini en statue, ils se récrient et réclament; le dernier numéro de la Gazette musicale leur sert d'interprète. Une statue à Rossini, fi donc! vous vous trompez! Il n'y a dans le monde que moi qui mérite une statue. «Oubliez-vous donc mes barcarolles, dit celui-ci; et mes nocturnes, ajoute cet autre; et mes chansonnettes, s'écrie l'un, et mes petites opéras-comiques,» fulmine l'autre. Si bien, au train dont vont les choses, que Rossini court risque de ne pas avoir sa statue; mais, en revanche, nous pourrions bien voir sur le piédestal M. de Flottow ou M. Pilati.
Mademoiselle Plessis vient de se hasarder avec succès dans le rôle d'Elmire de Tartufe. Ce rôle était un de ceux que mademoiselle Mars aimait et qu'elle jouait souvent; ce n'est pas, qu'il soit brillant, mais il est correct, sage, modéré, d'un grand goût; il faut un art exquis pour y réussir et lui conserver sa décence spirituelle et son aimable honnêteté. Mademoiselle Mars y excellait; mademoiselle Plessis n'a pas été mademoiselle Mars, mais elle s'est mise en route pour y arriver. Quelle charmante Elmire, d'ailleurs! quels yeux! quelle jeunesse épanouie! et que monsieur Tartufe est bien là! en pleine tentation! On remarque cependant, non sans quelque regret, que mademoiselle Plessis, depuis quelque temps, tombe dans le sérieux. L'autre jour, elle était quakeresse dans l'Eve, de M. Gozlan; le lendemain, chanoinesse dans la Tutrice, de M. Scribe; et la voici la sage et prudente Elmire. C'est un bien grave office pour votre belle jeunesse, mademoiselle, et vous commencez de bonne heure à entrer en sagesse. Quel grand mal, si vous étiez, Célimène un peu plus longtemps; Elmire vient toujours assez tôt, et vraiment vous n'êtes pas faite pour être chanoinesse, et quakeresse encore moins! Dans vingt ans, suit, on vous le passerait!
Nous avons quitté tout à l'heure Rossini un peu brusquement; voici une anecdote qui nous ramène à lui: il en est le héros. La scène se passe à Paris, pendant la dernière visite que l'illustre maestro a bien voulu faire à la moderne Babylone. Rossini vient de recevoir chez lui un de nos pianistes les plus excentriques et les plus échevelés; «Voulez-vous que je vous joue quelque chose de ma façon?» dit notre homme. Rossini de s'en défendre; il a divorcé avec la musique, et ne veut plus entendre une note. Mais le pianiste insiste; le pianiste est tenace de sa nature, le pianiste échevelé surtout; il s'installe donc, et fait courir ses doigts sur les touches sonores, çà et là, avec une fureur à tous crins. Après une demi-heure d'ouragan, il se lève pâle et inondé de sueur: «Eh bien! dit-il à Rossini, comment trouvez-vous cela?» Le maestro garde le silence; «Comment trouvez-vous cela? mio carissimo? répète le pianiste avec insistance et d'un air triomphant.--Je trouve, répond Rossini avec sa railleuse bonhomie, je trouve cela étonnant; vous êtes plus fort que Dieu: Dieu avait fait le monde, vous venez de faire le chaos!»
Il est question de mettre un impôt sur les voitures de luxe et sur les chiens, à l'imitation de l'Angleterre; cela fera aboyer beaucoup de gens, les portières surtout et les vieilles filles.
M. Alexandre Dumas continue son commerce; il vient de présenter au Théâtre-Français une nouvelle comédie cinq actes et en prose, Une conspiration sous Louis XV, le tout sans préjudice d'une autre comédie en cinq actes reçue au même théâtre, et d'un drame non moins en cinq actes, Lord Danbiki, que l'Odéon annonce pour la semaine prochaine. M. Dumas a des drames et des comédies plein ses poches; il ne tire pas son mouchoir ou sa tabatière sans en faire tomber deux ou trois à chaque fois: les passants marchent dessus.
Le sultan a fait mander en France un professeur de langue française et de géographie. Un des élèves les plus distingués de l'École Normale vient de partir pour donner des leçons à. Sa Majesté turque. O ombres de Soliman et de Selim, qu'allez-vous dire? Avant un an peut-être votre héritier lira couramment Voltaire, le Contrat social et les Lettres persanes. Par Mahomet! où allons-nous?
Théâtres.
Tibère, tragédie de Marie-Joseph Chénier (Théâtre-Français).--le Vengeur (Cirque-Olympique).
Proscrit par la censure impériale, le Tibère de Chénier était depuis vingt ans réfugié dans les œuvres du poète. L'interdit enfin vient d'être levé, et Tibère a pris possession de la scène. Toutes ces énergiques beautés que la tragédie recèle, beautés jusqu'ici réservées seulement à la curiosité du lecteur, le parterre vient de les reconnaître à la lueur de la rampe, et de les saluer de ses bravos. Le succès public a confirmé le succès de la lecture solitaire.

Portrait de Marie-Joseph Chénier.
Comme le titre l'indique, le sujet de l'ouvrage de Chénier est la peinture du caractère de Tibère. Le poète prend le terrible et tortueux empereur au moment de la mort de Germanicus, son fils adoptif; toute cette héroïque et fatale histoire de Germanicus a été tracée, ou le sait, par la main de Tacite en traits impérissables. L'étude de Chénier n'est pas indigne de la vigoureuse peinture de l'historien. Tibère a empoisonné Germanicus par la main de Pison, ou du moins, suivant Chénier. Pison a connu les préparatifs du crime et ne l'a point empêché. Maintenant tout est dit: Germanicus est mort; il ne reste plus que la fière douleur d'Agrippine sa veuve, et le remords tardif de Pison. Tous deux viennent à Rome, et arrivent en même temps. Agrippine portant dans son sein les cendres de son époux, comme dit Tacite. Agrippine veut poursuivre Pison; de son côté, Pison est déterminé à se défendre; il compte d'ailleurs sur l'appui de Tibère, son secret complice.
Telle est donc la position de Tibère: il faut qu'il feigne de pleurer Germanicus avec Agrippine, et de s'associer à sa vengeance, cependant qu'il ménage Pison, dont il craint les révélations et le désespoir. La tragédie s'engage sur cette situation à double race. C'est un jeu de bascule perpétuelle que joue Tibère; de l'exposition au dénoûment s'efforçant de pleurer Germanicus d'un œil, si on peut se servir d'une expression si bourgeoise, en un sujet se terrible, et de l'autre; œil désignant à Séjan Agrippine et Pison, qui le gênent tous deux, et dont il veut se défaire en même temps.
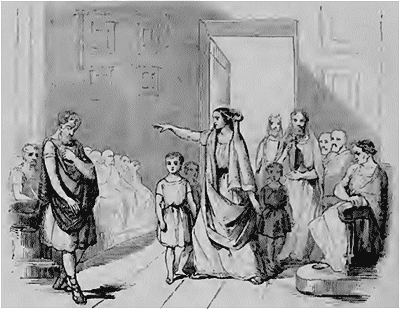
Théâtre-Français.--Tibère, acte II, scène II. Agrippine,
accompagnée de ses enfant, accuse Pison dans le sénat
en présence de Tibère.
Le mensonge, la ruse, l'hypocrisie, toute l'habileté tortueuse et souterraine de l'âme de Tibère est mise en œuvre dans cette lutte difficile: tantôt il flatte la douleur d'Agrippine, tantôt il ménage Pison; une autre fois il cherche à corrompre, par la séduction du pouvoir, Cnéius, le fils de Pison, le jeune Cnéius, qui a conservé la vertu des vieux Romains dans ce temps de bassesses et de vices.
Mais Tibère a beau faire, Agrippine et Pison finissent par lire dans la nuit de son âme: l'une y découvre la fausseté de sa pitié menteuse; l'autre, le secret de l'abandon que le tyran fait de lui et de la ruine qu'il lui prépare. Le ressentiment et le remords élèvent alors le coupable Pison jusqu'au courage d'une expiation publique: il déclarera son crime en plein sénat, à la face de Rome, et il nommera son complice, c'est-à-dire Tibère lui-même, voilà ce qu'il annonce au tyran, voilà ce qu'il promet à son fils Cnéius; mais Tibère a dit un mot à Séjan, et ce, mot suffit. Tandis que le sénat et Tibère, et Cnéius, et Agrippine sont en présence, attendant Pison, Séjan vient dire que Pison s'est donné une mort volontaire; une mort volontaire annoncée par Séjan! vous sentez ce que cela veut dire; on devine que Tibère a passé par là. Il ne reste à Cnéius que le poignard de son père, et il s'en sert pour échapper à la tyrannie:
Il est temps du placer Tibère au rang des dieux.
Cette tragédie est d'un ton constamment énergique et grave; la pensée a de la force, le style une concision et une fermeté peu commune. On a remarqué surtout quatre belles scènes: l'arrivée d'Agrippine, suivie de ses deux fils et présentant au sénat l'urne de Germanicus en demandant vengeance, l'entrevue de Tibère et de Pison, où Pison déclare qu'il est résolu à dévoiler le terrible secret qui les lie; l'aveu qu'il fait de son crime à son fils Cnéius, et enfin le dénoûment de la tragédie, où Cnéius, frappant Tibère d'anathème, se poignarde.
Ligier s'est fait remarquer dans le rôle de Tibère par des études habiles et tout à fait dans le caractère du personnage; mademoiselle Araldi, malgré son inexpérience, Guyon, malgré ses cris, et Geoffroy méritent bien aussi quelques éloges.
--Le nom de Marie-Joseph Chénier est sorti honoré et glorieux de l'épreuve.

Cirque-Olympique.--Dernière scène du Vengeur:
le navire disparaît sous les flots.
Tout le monde connaît le dévouement héroïque du Vengeur; c'est un des plus beaux, faits du nos annales maritimes. Le glorieux événement s'accomplit le 28 mai 1791. Le Vengeur, séparé de la flotte commandée par Villaret-Joyeuse, qui soutenait contre les Anglais un combat terrible; le Vengeur, environné de forces supérieures, désemparé, criblé de boulets, faisant eau de toutes parts, après avoir repoussé deux fois l'abordage; le Vengeur refuse de se rendre; et quand l'heure est venue, quand les canons, arrivés à fleur d'eau, sont près de disparaître, le Vengeur lance aux Anglais une dernière et terrible bordée; puis, tandis que l'équipage crie: Vive la France! vive la République, le vaisseau disparaît lentement dans les flots avec ses combattant héroïques.