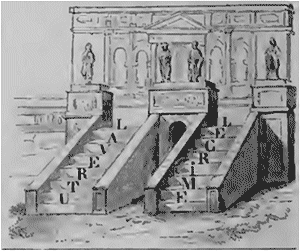MARGHERITA PUSTERLA.
CHAPITRE XIV.
PISE.
 ersuadé
qu'Alpinolo ne reviendrait plus dans cette cabane, Ramengo marchait
en cherchant à se mettre sur les traces du jeune page. Le désir de
trouver son fils lui avait fait quitter la piste qu'il avait
jusque-là suivit; avec l'anxiété de la haine. Dans une de ses
promenades à l'aventure, un jour qu'il côtoyait le Pô, il entendit
sortir d'un buisson comme la voix d'un homme qui appelle. Il
s'approche: un batelier lui demande humblement: «Le seigneur
cavalier veut peut-être passer?
ersuadé
qu'Alpinolo ne reviendrait plus dans cette cabane, Ramengo marchait
en cherchant à se mettre sur les traces du jeune page. Le désir de
trouver son fils lui avait fait quitter la piste qu'il avait
jusque-là suivit; avec l'anxiété de la haine. Dans une de ses
promenades à l'aventure, un jour qu'il côtoyait le Pô, il entendit
sortir d'un buisson comme la voix d'un homme qui appelle. Il
s'approche: un batelier lui demande humblement: «Le seigneur
cavalier veut peut-être passer?
--Pourquoi cette demande?
--Je connais au drap de vos habits que votre seigneurie est de Milan. J'en ai beaucoup passé de Milanais pendant ces semaines.»
Ces paroles donnèrent l'impulsion à la volonté indécise de
Ramengo, qui répondit affirmativement plutôt à ses propres pensées
qu'à la question  du batelier. On fit entrer le cheval dans la barque, et pendant que
le rameur s'efforçait de couper obliquement le fil de l'eau,
Ramengo le questionna sur les passagers, sur leurs babils, leurs
discours, leur route. Il lui demanda, en outre, s'il n'avait pas vu
un beau jeune homme, et il lui lit le portrait d'Alpinolo.
du batelier. On fit entrer le cheval dans la barque, et pendant que
le rameur s'efforçait de couper obliquement le fil de l'eau,
Ramengo le questionna sur les passagers, sur leurs babils, leurs
discours, leur route. Il lui demanda, en outre, s'il n'avait pas vu
un beau jeune homme, et il lui lit le portrait d'Alpinolo.
«Eh! eh! répondait le batelier, s'il fallait les avoir tous dans l'esprit. Mais, celui que vous me décrivez, je crois l'avoir vu; oui: un homme entre trente et trente-cinq ans, n'est-ce pas?...
--Non, non: beaucoup moins, pas même vingt: des cheveux noirs.
--Précisément; à présent, je me rappelle: des yeux gris, courtaud, trapu...
--Au contraire: des yeux noirs, plus grand que moi, bien taillé; impossible de le voir et de ne pas s'en souvenir.
--Ah! il y tant d'ânes qui se ressemblent!» Ramengo arrivé à l'autre rive, paya maigrement le passeur, et partit à l'aventure. Il erra encore de lieu en lieu, questionna tout le monde sur son passage; on lui répondit partout qu'on avait, en effet, vu beaucoup de Milanais, mais qu'on ignorait qui ils étaient et où ils se dirigeaient. On savait généralement qu'ils quittaient leur patrie à cause de la tyrannie de Luchino.
Il vit d'autres tyrans régner sur les diverses cités de la Romagne; à Ituvium, les Malatesta; les Ordelaffi, à Fouli; à Faenza, Francesco di Manfredi; les Palenta, à Ravenne. Rome pleurait son veuvage depuis que les papes, se retirant à Avignon, l'avaient abandonnée à la tyrannie de ses barons, contre lesquels devait, peu d'années après, s'élever la généreuse mais impuissante voix de Cola de Rieuri. Bologne recevait la vie et la splendeur des quinze nulle Italiens et Allemands qui étudiaient dans son adversité, orgueilleuse de son titre de docte, qu'elle a conservé jusqu'à nos jours, comme elle a conservé dans ses armoiries le mot de liberté, quoique déjà, dès cette époque, elle eût subi le joug des papes. Puis, passant l'Apennin, Ramengo entra dans la belle Toscane. Dans cette contrée, la liberté était d'autant plus en honneur, qu'on avait vu a quels excès s'étaient portés les petits seigneurs de la Romagne et de la Lombardie. Toutes les communes défendaient hardiment leurs franchises, et repoussaient avec haine le gouvernement d'un seul. Mais comment espérer qu'une vierge se conserve pure au milieu d'une troupe de courtisanes? Les voisins dépravés de ces républiques, s'ils n'osaient point encore attenter ouvertement à la liberté de la Toscane, préparaient son assujettissement par la corruption et en fomentaient les discordes. Sous cette dégradante influence, les inimitiés de cité à cité s'aigrissaient de plus en plus; les noms des Guelfes et des Gibelins, qui, dans les autres pays, avaient presque perdu leur signification, conservaient là une vitalité tenace: Pise et Avezzo étaient gibelines; guelfes étaient Pistole, Prato, Volterra, Samminiato, Sienne, Péronne, et principalement, Florence. Au lieu de laisser se mûrir dans les cœurs le sentiment d'une nationalité unique, qui seule pouvait porter des fruits dans l'avenir, ils se combattaient et se repoussaient les uns les autres. Il n'y avait de patrie que le coin où on était né. On appelait étrangers et ennemis tous ceux qui ne foulaient pas la même terre, et plus ils étaient voisins, plus on avait contre eux de dispositions hostiles; et au milieu de leurs querelles, ils invoquaient toujours ou les armes ou la médiation plus funeste encore de leurs véritables ennemis.
Cependant, au milieu de ces luttes, il y avait une activité puissante. Chacun éprouvait sa valeur et ce qu'il pourrait faire de concert avec ses concitoyens. Le commerce, l'agriculture, les arts étaient à leur plus haut point d'épanouissement; la peinture, la sculpture, l'architecture, offraient des modèles que notre siècle difficile n'a pas cessé d'admirer; et la langue sortie des mains de Dante Alighiéri, mort vingt années auparavant, perfectionnée par Pétrarque et par Boccace, encore jeunes, acquérait cette suprématie sur les autres dialectes de l'Italie, que rien ne pourra désormais lui enlever.
De même que dans cette Grèce, avec laquelle notre patrie a tant de rapports, on oubliait les mutuelles inimitiés pour se rassembler aux jeux d'Olympie, ainsi la vive humeur des Toscans les réunissait à de splendides fêtes, où les diverses cités venaient se réjouir dans les solennités consacrées à leurs patrons, dans la célébration d'anciens faits mémorables ou de hauts faits nouveaux. Pise avait, précisément, vers cette époque, remporté des avantages contre les Maures, qui, s'élançant des côtes de l'Afrique, infestaient la Méditerranée et l'Italie. Pour célébrer ce triomphe et la prise de quelques galères, le carnaval devait finir par la fête du Pont. Ramengo n'entendait parler que de cette fête dans toute la Toscane. Tous ceux qui le pouvaient se préparaient à y assister; les autres s'en mouraient d'envie: «Pourquoi n'irais-je pas aussi, moi, se dit Ramengo? C'est parmi un tel concours qu'il est le plus probable de rencontrer celui que je cherche.» Il se dirigea donc vers Pise; elle était alors dans toute la fleur de sa beauté. Son port était aussi fréquenté, toute proportion gardée, que le sont aujourd'hui les ports, d'Amsterdam et de Londres. Unissant au génie des spéculations l'amour des beaux-arts, inné dans notre patrie, ils tiraient des contrées de l'Asie, redevenue barbare, des marbres, des colonnes, des sculptures, dont ils embellissaient la patrie. Aujourd'hui Pise est bien différente de ce qu'elle a été. Un bourg voisin de la mer, alors à peine remarqué, lui a enlevé le reste de commerce que les changements des relations européennes ont laissé à la Toscane. Ses 150,000 habitants sont réduits au moins des six septièmes. Sa cathédrale de marbre, l'admirable loggia des marchands, les autres monuments de son antique majesté, font un mélancolique contraste avec l'herbe qui croit dans les rues solitaires, avec le silence des ateliers muets, avec le vide désolé de son lungarno, et la merveilleuse tour semble se pencher avec compassion pour pleurer sur toutes ces grandeurs évanouies.
«Poteurinterra! votre seigneurie doit venir de l'autre bout du monde, si jamais elle n'a entendu parler de la fête du Pont.» C'est ce que disait à Ramengo Phole Aquevino, qui, venu jeune de Pontudera, sans le bec d'un quattrino, comme il disait, avait d'abord élevé sur la route de Pise une ramée où il donnait à boire aux muletiers, faisant ses frais avec quelques niaiseries de profit. Puis, avec des quattrini faisant d'autres quattrini, et donnant des noms illustres aux petits vins qu'il débitait, et que la soif faisait paraître superflus, il bâtit une petite hôtellerie. Si quelqu'un la trouvait exiguë, il répondait, sans avoir jamais lu Socrate, qu'il aurait voulu l'avoir toujours pleine de voyageurs. Il y avait, devant la maison, un terre-plein pour jouer au mail, et que devaient côtoyer ceux qui se rendaient à la ville. De là on dominait aussi la vaste plaine qui, d'un côté, descend à la mer, et de l'autre est fermée par des collines couvertes par la blanchissante verdure des oliviers, et est traversée par l'Arno, qui va partager Pise en forme de demi-cercle. Là Aquevino, parvenu à la maturité en ayant pris du ventre, mais frais, toujours jovial, grand bavard, grand admirateur des beautés de son pays, du beau ciel, du bon air, des bonnes gens, presque autant qu'un poète de l'Académie des Arcades, logeait les étrangers, en leur faisant expier, au moment de payer l'écot, la faute de n'être pas Toscans. Il servait de joyeuses bourdes et du vin aux voituriers et aux piétons, et conservait, dans une intégrité religieuse, des jambons du Casentin, et des flacons d'aleatico et de monte Suriano, qu'un professeur de l'Université avait comparés à l'ambroisie et au nectar des dieux. Aquevino, depuis vingt ans, répétait cette comparaison, qu'il donnait toujours pour nouvelle à tous les seigneurs «qui, disait-il, lui faisaient l'honneur de visiter son désert.»

En voyant arriver Ramengo vers le soir, seul et avec une maigre valise, Aquevino lui avait d'abord fait les gros yeux, et s'était tenu avec lui sur ses grands chevaux; mais quant il lui eut entendu commander la chambre la meilleure, les mets les plus choisis, les vins les plus exquis, et qu'il vit briller les luisants florins d'or dont la bourse du voyageur était remplie, il changea de ton, et, au milieu de ses occupations, vint avec empressement régaler de sa conversation l'hôte à la belle bourse.
Il lui apprit ce qu'était cette fête du Pont: elle était instituée en mémoire de la belle action de Cinrica de Sismundi qui, une nuit que la ville avait été envahie par les Sarrasins, sans bruit et à l'improviste, et qu'ils massacraient sans résistance les citoyens épouvantés, eut seule l'idée d'aller avertir la seigneurie. Les infidèles occupaient déjà le pont de l'Arno; mais les chefs de la ville ayant rassemblé les troupes en toute hâte, et rallié les fuyards, repoussèrent les Sarrasins, qui retournèrent à leurs vaisseaux avec une grande perte.
La cité et le territoire de Pise se divisaient en deux factions dites de Saint-Antoine et de Sainte-Marie. C'étaient ces deux factions qui fournissaient les combattants pour la fête du Pont; ils se réunissaient sur le pont de l'Arno, où les Sarrasins avaient été repoussés; et là chacune des deux troupes s'efforçait de rester maîtresse du terrain. Il y avait beaucoup de morts dans ce jeu militaire, et les plus heureux étaient encore ceux qui étaient précipités dans l'Arno, parce qu'il y avait là des barques toutes prêtes à leur porter secours. Les esprits étaient si passionnés pour cette fête, et on la prenait tellement au sérieux, que lorsqu'on annonçait aux mères, aux sœurs, aux amantes, les blessures ou même la mort d'un des combattants, elles demandaient quel parti avait remporté la victoire; et si la réponse était conforme à leurs désirs, ces grotesques Spartiates oubliaient les plus tendres et les plus sacrées affections pour éclater en cris de triomphe.
Ce jeu, qui, du temps de la république, avait au moins le mérite d'entretenir et d'exercer l'esprit militaire, se prolongea, sans autre raison que celle de la coutume, jusque dans le dix-huitième siècle, où Léopold d'Autriche, trouvant que c'était trop pour un jeu, trop peu pour un combat, abolit la fête.
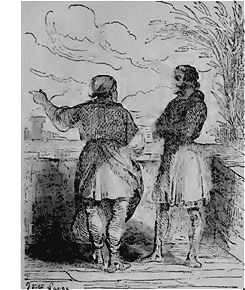
«Avez-vous jamais vu, seigneur étranger, dans toute votre vie et par tout le monde, un tel concours de chrétiens?» demandait l'hôte à Ramengo, qui, le matin du jour du combat, se tenait sur une petite terrasse ombragée par un laurier, observant Pise et la foule qui s'y portait; et décrivant un cercle avec la main étendue, il poursuivait: «Cela vous paraît-il peu de chose? quelle pompe! quelle beauté! quelle ardeur! on reconnaîtrait un toscan au milieu même de la foule de la vallée de Josaphat. Ceux qu'on voit en robes majestueuses sont des Florentins, gens d'une richesse sans bornes, ils spéculeront encore sur la fête; ces autres, tout empanachés et recherchés dans leurs habits, sont des Pistolais; ceux-ci, de Sienne, la race la plus loyale et la plus sincère des trois parties du monde. Le désir de voir nos fêtes leur a fait oublier les vieilles querelles; ils seront tous bien accueillis à Pise, et personne ne craindra qu'ils y apportent la peste. Oh! voyez la belle cavalcade! Ce sont les seigneurs de la Versuba et de la Lumgiana, non moins terribles dans leurs châteaux que sur la mer: les passants le savent bien. Observez les belles et robustes figures; ils ont tous en croupe des jeunes filles et des femmes qui, sans contredit, n'ont point d'égales dans tout l'univers. Vive le beau soleil! vive les belles femmes de Toscane!»
Cependant on voyait sur l'Arno un grand nombre de barques glisser légèrement au milieu des gros navires à l'ancre. Une vive joie régnait parmi toute cette multitude, les railleries capricieuses, les saillies bizarres se croisaient de toutes parts dans un doux et agile langage. Un chœur de jeunes gens jouant de la flûte accompagnait les accords des autres, qui chantaient la ballade bien connue:
Vaghe le mentanine pastorelle
Donde venite si leggiadre e belle?
Lorsqu'ils eurent fini, une jeune fille que ses grands yeux et ses joues roses faisaient remarquer parmi toutes ses compagnes, répondit d'une voix plus puissante que délicate, pendant qu'elle passait sous le balcon où se tenait Ramengo:
E s'is son gella, is son bella permene,
Ne' mi curo d'aver de' vagheggini;
E non mi curo niun mi voglia bene
Ne manco vi' ch'altri mi faccia inchini.
Et si je suis belle, je suis belle pour moi seule,
Je ne me soucie point d'avoir des amants,
Je ne m'inquiète point qu'on m'aime.
Il ne manque pas d'autres gens que vous pour me faire des révérences.

«Regardez la belle fille!» s'écria un jeune homme en sortant de la taverne voisine et en s'avançant hardiment vers la jeune chanteuse. Au son de la voix et à l'accent étranger, Ramengo se retourna et reconnut un groupe de Lombards. Il les regarda d'un œil scrutateur, et, s'étant assuré que parmi tous les visages il n'y en avait pas un seul dont il fût connu, il descendit près d'eux et se fit reconnaître à son langage, pour un de leurs compatriotes. On l'entoura aussitôt et tous lui serrèrent la main, quoiqu'il leur fût inconnu, parce que la communauté de la patrie est toujours un titre à amitié sur la terre étrangère.
Ramengo salua, répondit à leurs demandes, à leurs embrassements, et serra toutes les mains qui se présentèrent. Quoiqu'il eût pu espérer que parmi ces bannis, son nom serait reçu comme celui d'un compagnon d'infortune, il lui parut cependant plus prudent de le dissimuler, et il se donna pour un certain Hanterio de Bescapé, né à l'ombre du dôme de Milan, demeurant aux Cinq Voies, et fugitif comme eux.
Puis il leur donna des nouvelles de leurs amis. «Qu'a-t-on fait des Aliprandi? lui demanda-t-on.
--Morts de faim.
--Et Bronzin-Canno, ce grandissime modéré, tient-il toujours pour le tyran?
--Il se tient en prison pour avoir osé défendre la vérité, si pourtant il ne lui est pas arrivé pis.
--Et Matteo Visconti?
--Confiné à Morano di Monferrato.
--Et Barnabé?
--A la cour du Scaliger.
--Et Galéas, toujours beau, toujours galant, toujours adorateur de madame Isabelle?
--Bon Dieu! le seigneur Luchino ne dort qu'autant qu'il le veut bien; le beau Galéas erre par pauvreté et pour faire perdre la trace à son oncle. On le dit pourtant en Flandre.»

Ainsi répondait Ramengo aux diverses demandes, joyeux de se montrer bien informé, pour acquérir une plus grande confiance, et de raconter ce qu'il savait, afin d'apprendre ce qu'il voulait savoir. Comme le marin, lorsqu'il revoit les ondes tranquilles, comme le voleur en présence d'une occasion favorable, comme le buveur à la porte du cabaret, oublient toutes leurs belles résolutions, ainsi Ramengo oublia tous ses projets de vertu lorsqu'il se vit dans la possibilité de nuire. D'abord, il ne voulait que mentir, afin de découvrir, s'il le pouvait, la retraite d'Alpinolo; puis, à l'ordinaire, comme une faute en amène une autre, il se trouva entraîné à faire le mal pour le mal.
«Mais qu'est-ce donc, lui demandaient les exaltés, qu'est-ce que la vie à Milan, aujourd'hui?
--Ce qu'elle est, répondait-il, dans tous les pays asservis; Luchino s'enhardit de jour en jour, parce qu'il voit venir à lui les cités épouvantées, comme le bœuf qui vient de lui-même à la tuerie. Acouez avait déjà dix villes en son pouvoir, n'est-il pas vrai? eh bien! celui-ci en a sept autres de plus; mais il ne faudrait pas croire pour cela qu'il augmente sa puissance. Ses voisins le jalousent; guelfes et gibelins sont traités par lui de la même manière, mais ils lui en veulent également de ne point faire de différence. En somme, c'est le colosse de Nabuchodonosor, dont les pieds étaient d'argile.
«Mais où est le caillou qui suffit pour le renverser? ajouta Caccino Ponzone de Crémone.
--Oh! le caillou, nous l'aurons bien, répondait le traître; et si.. mais taisons-nous...» et il se fermait les lèvres.
C'était le meilleur moyen de les mettre en goût; aussi le pressèrent-ils davantage: «Quoi? dites-nous, qu'y a-t-il de nouveau? Avons-nous des espérances? Nous voyons bien que vous allez au fond des choses. Pourquoi nous faire des mystères? la cause des Milanais n'est-elle pas la nôtre à tous? et nous sommes là pour l'épauler de toutes nos forces. Nous n'attendons que le moment du Seigneur, le dies irae. Mais qui serait notre chef?
--Si Franciscolo Pusterla... dit Ramengo en s'interrompant pour observer l'effet produit par ce nom.
--Eh quoi! répondirent-ils, êtes-vous encore du parti de Pusterla?
--Comment, si je suis des siens, reprenait Ramengo; j'ai là pour lui des lettres du seigneur Martino della Scala... mais silence; la prudence n'est jamais de trop, ils ont des espions de tous les côtés.»
Ramengo prononçait ces paroles par saccades et en tournant ses regards de tous côtés. Ils croyaient que c'était par défiance; en réalité, c'était pour attendre qu'on lui donnât quelques renseignements. Mais quand il vit qu'on ne se disposait pas à lui en donner, il continua: «Mais qu'est-ce que les hommes? qui l'aurait cru? lui qui pouvait seul, qui voulait seul devenir le chef et le sauveur de la patrie, maintenant, il dort... il se fait petit... il s'échappe comme un faible mendiant...
--Il s'arrête à faire des mea culpa aux pieds d'un fournier,» répondit quelqu'un.
Le père du pape Benoît II, qui siégeait à Avignon, avait été boulanger, ou fournier, de son métier, et de là surnommé Fournier. La réponse du Milanais suffisait pour indiquer à Ramengo la retraite de Pusterla; aussi il continua; «Certainement, il s'est réfugié à Avignon comme un clerc qui aspire au chapeau vert ou au chapeau rouge; comme un coupable de bas étage, qui cherche la sécurité en lâchant son estoc homicide sous les robes et les capuchons. Mais nous le réveillerons de ce lâche sommeil, nous le réveillerons.
--Vous trouverez ici de ses amis, ajouta Pouzone, qui vous appuieront.
--Vous avez, je pense, reprit Ramengo, son frère Zurione, Maffino da Besorro, celui de Pietra Santa; et on lui répondait:--Oui, mais nous avons celui qui montre le plus d'amour et de dévouement, son écuyer Alpinolo.
--Alpinolo! répéta Ramengo, se sentant frémir depuis la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Alpinolo, où est-il? que je le voie aussitôt. J'ai un besoin extrême de lui parler pour une chose qui le touche de près. Où est-il, où est-il?
--Quelle furie! reprenait un des seigneurs; finissons de boire, et puis venez avec nous; là-bas, nous vous les ferons trouver tons; quelle fête pour eux de vous revoir!

--Mais je veux d'abord parler à Alpinolo, en tête à tête avec lui; je sais comme il faut que les choses soient conduites.» Et pendant qu'il était dominé par l'anxiété de retrouver un fils, et par l'espérance que celui-ci en le découvrant pour son père, lui accorderait pardon et amour, les seigneurs continuaient à boire en faisant l'éloge d'Alpinolo, vantant sa conduite dans une affaire où il avait souffleté un de ses amis qui lui rappelait qu'il n'avait pas de père. Comme ce nom de père le comblait d'orgueil! comme il voyait près de lui la réalisation de ses espérances! et ce fut le cœur agité par autant de palpitations que, dans cette nuit où il épiait l'amant prétendu de Rosalie, qu'il se dirigea dans Pise au milieu des seigneurs lombards qui, les bras enlacés, entonnaient les chants de leur patrie,--ces chants que l'exilé finit toujours par un soupir.
Bulletin bibliographique.
Histoire de Dix ans; par M. Louis Blanc. 1 vol. in-8.--Paris, 1843. Pagnerre. (Tome IVe.) 1 fr.
La librairie française prend ses vacances. Cette année comme les années précédentes, elle n'a mis au jour, pendant les mois du septembre et d'octobre, qu'un très-petit nombre d'ouvrages nouveaux; occupée à préparer la campagne d'hiver, elle atteint la rentrée des cours et tribunaux pour lancer en avant quelques sentinelles perdues, et se promettre de petites escarmouches. Dans un mois seulement la bataille sera sérieusement engagée sur toute la ligne... Si nous en croyons certaines indiscrétions, quelques-uns des combattants se signaleront par de brillants exploits. Ce qui paraît positif, c'est qu'avant la fin de la campagne prochaine M. Paulin aura commencé la publication de l'Histoire du Consulat et de l'Empire, par M. Thiers.
Parmi les rares ouvrages qui ont osé naître durant la saison des promenades en Suisse, de la chasse et des vendanges, nous mentionnerons en première ligne l'Histoire de Dix ans. Toutefois, nous devons l'avouer, l'audace de M. Louis Blanc et de son intelligent éditeur M. Pagnerre ne nous cause aucune surprise, et ne nous arrachera pas le plus faible cri d'admiration; s'ils se sont décidés, en effet, à lutter contre d'aussi redoutables adversaires c'est qu'ils étaient sûrs d'avance d'en triompher. Quand, dans l'espace de quinze mois, les trois premiers volumes d'un ouvrage ont déjà eu trois éditions, le quatrième peut descendre dans l'arène au jour et à l'heure qui lui convient: toute saison lui est favorable; le passé de ses aînés lui répond de son avenir. Alors même qu'il ne leur ressemblerait en rien, sa parenté seule lui assurerait un accueil empressé et une victoire éclatante.
Le volume que vient de publier M. Louis Blanc n'a pas à craindre, d'ailleurs, de comparaison désavantageuse; il a toutes ces qualités solides et brillantes qui ont fait la fortune de ses trois frères. Impartial comme eux, à son point de vue, bien entendu, rempli comme eux de révélations piquantes et d'anecdotes inédites, illustré par un nombre égal de portraits littéraires, non moins soigné sous le rapport de la mise en scène, écrit avec un style aussi élégant et aussi pittoresque, il jouit déjà de la même popularité. «Ce n'est pas de l'histoire, ce sont des mémoires,» s'écrieront quelques esprits trop difficiles à satisfaire. Mais est-il donc possible de s'élever jusqu'à la hauteur de l'histoire, lorsqu'un entreprend de raconter des événements contemporains? est-il possible de porter dès aujourd'hui un jugement définitif sur des faits accomplis d'hier, dont toutes les conséquences ne sont pas encore réalisées, ou ne sauraient être prévues? sur des hommes politiques qui ont à peine, pour la plupart, achevé la moitié de leur rôle. Quant à nous, nous félicitons hautement M. Louis Blanc d'avoir refusé de céder aux avis d'un critique qui lui conseillait «d'ouvrir dans ce monument,»--nous citons ses propres paroles,--«quelques fenêtres sur le ciel, à travers lesquelles ou aperçut trembler dans les incommensurables solitudes de l'infini les étoiles contemporaines de l'éternité, lampes silencieuses allumées autour du vaste atelier de la création.»
Il faut, en vérité, que M. Louis Blanc ait un bien grand talent dramatique, pour que ses lecteurs assistent avec un si vif intérêt à la représentation d'événements dont ils connaissent d'avance les péripéties et le dénouement, et qui leur rappellent à tous, quelles que soient leurs opinions politiques, de bien douloureux souvenirs. Le quatrième volume de l'Histoire de Dix ans commence avec l'année 1833, et finit en mars 1836; il comprend les plus tristes et les plus sanglants épisodes du règne actuel; et pourtant,--tel est le mérite de l'écrivain,--qu'on le lit tout entier aussi avidement peut-être qu'un roman. La réserve politique imposée à un journal qui s'adresse à toutes les classes de la société, ne nous permet pas d'apprécier dans une analyse rapide les faits que M. Louis Blanc a entrepris de raconter, et jusqu'à un certain point de juger; nous nous contenterons d'indiquer en quelques lignes les sujets principaux dont traitent les douze chapitres de ce quatrième et avant-dernier volume; ce sont: l'emprisonnement et l'accouchement de la duchesse de Berri à Blaye, le procès de la Tribune devant la Chambre des Députés, le manifeste de la Société des Droits de l'Homme et le procès des 27, la question d'Orient, l'expédition de Savoie, les lois contre les crieurs publics et les associations, les insurrections de Lyon et de Paris en 1834, la quadruple alliance, les révolutions ministérielles de la même année, le ministère du 11 octobre succédant au ministère des trois jours, l'affaire des 25 millions réclamés par l'Amérique, le procès d'Armand Carret devant la chambre des Pairs, le procès d'avril, l'horrible attentat de Fieschi, les lois de septembre, et la dissolution du ministère du 11 octobre.
De l'Influence du Christianisme, sur le Droit civil des Romains; par M. Troplong, 1 vol. in-8°.--Paris, 1843, Hingray. 7 fr. 50 cent.
Le nouveau mémoire de M Troplong, De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains, est un de ces livres qui peuvent impunément braver les influences toujours redoutables de la saison des vacances. Il ne s'adresse qu'aux hommes sérieux dont l'esprit ne prend jamais de repos. Le nom et le mérite de son auteur, la nature même du sujet qu'il traite, lui garantissent d'avance qu'à toute époque de l'année il occupera vivement l'attention publique. D'ailleurs, lu à diverses reprises devant l'Académie des Sciences morales et politiques, il y avait déjà obtenu, avant d'être publié en volume, tout le succès qu'il mérite et qu'il nous reste seulement à constater.
M. Troplong n'a pas entrepris de montrer l'influence du christianisme sur l'ensemble des institution et moins encore sur la civilisation romaine. Son sujet est plus restreint. Il s'est renfermé dans l'observation des influences par lesquelles le christianisme, est venu modifier les rapports civils, le droit privé; il ne fait d'excursions ailleurs qu'autant qu'il y a nécessité pour éclairer son sujet et montrer le jeu des ressorts auxquels le christianisme est venu mêler son action.
M. Troplong divise le droit romain en trois grandes périodes: la période aristocratique, la période philosophique, la période chrétienne. Pour se faire des idées justes sur la dernière, il faut, dit-il, saisir exactement le sens des deux premières.
La civilisation romaine s'est développée sous l'influence de deux éléments contraires qui, après une longue alternative de luttes et de rapprochements, ont fini par se mêler et se confondre. Ce dualisme se fait remarquer dans le droit privé comme dans la religion et dans le droit politique. Sa formule la plus large et la plus haute, c'est le jus civile et l'aequitas, le droit strict et l'équité, sans cesse opposés l'un à l'autre comme deux principes distincts et inégaux. D'abord le jus civile triomphe du patriciat religieux, militaire et politique, qui gouverne Rome naissante, génie formaliste, jaloux, dominateur, nourri à l'école sombre et forte de la théocratie étrusque, et qui aggrave dans le droit civil ses souvenirs de conquêtes et ses instincts d'immobilité. Qu'on n'y cherche point l'action efficace de l'équité naturelle, et cette voix de l'humanité qui parle si haut dans les peuples civilisés. La notion simple du juste et de l'injuste y est défigurée par la farouche enveloppe d'institutions qui sacrifient la nature à la nécessité politique, la vérité innée aux artifices légaux, la liberté aux formules sacramentelles. Dans l'ordre civil comme dans l'État, Rome ne vise qu'à former des citoyens; et plus elle accorde de privilèges et de grandeur à ce titre éminent, plus elle exige de celui qui le porte des sacrifices à la patrie, voulant qu'il abdique pour l'intérêt public ses affections, ses volontés et jusqu'à sa raison intime. A l'appui de cette vérité, M. Troplong cite de nombreux et frappants exemples pris dans la famille, dans la propriété, dans les obligations.
Cependant la société romaine ne pouvait pas rester éternellement opprimée parce droit si esclave de la lettre et si rebelle à l'esprit. Partout l'équité se posa à côté du droit civil, la philosophie brise le cercle inflexible tracé par ce patriciat. Du siècle de Cicéron date la période philosophique du droit romain. Le stoïcisme imprime ensuite une impulsion nouvelle à cette révolution qu'avaient en partie commencée la doctrine d'Épicure et la philosophie de Platon. Il donne aux jurisconsultes postérieurs à Cicéron des règles sévères et précises de conduite entre les hommes. S'élevant à des formes plus pures et plus belles, moins intolérant, moins âpre, dégagé des superstitions que la raison lui reprochait lors de ses premières conquêtes à Rome, il devient de plus en plus une philosophie spiritualiste qui proclame le gouvernement de la Providence divine la parente de tous les hommes, la puissance de l'équité naturelle. Mais le droit civil se défend si énergiquement dans son inflexible formulaire, dans son originalité jalouse, que la philosophie n'osa pas procéder avec lui par voie de révolution, elle y aurait échoué. L'équité demanda donc sa part d'influence, non comme une souveraine qui veut déposséder un usurpateur, mais comme une compagne qui radie sous des dehors timides ses vues de domination. «Toutefois, il ne faut pas s'y tromper, dit M. Troplong, sous ces dehors de conciliation et de bon ménage se cachait une antithèse redoutable pour le droit civil; ce qu'on voulait au fond, c'était de réduire à l'impuissance tout en lui prodiguant les témoignages de respect. Aussi le droit, depuis l'époque de Cicéron, est-il en lutte incessante; les deux éléments sont aux prises. Mais le droit civil se trouve tout d'abord réduit au plus mauvais rôle, à celui de la défensive; c'est chez lui, dans ses propres foyers, que la guerre est sourdement portée, et l'équité aspire à y réaliser l'apologue de la lice et ses petits.» Ces prémisses posées, M. Troplong montre par quels efforts ingénieux l'équité continue à agrandir son domaine tout en groupant ses innovations autour de l'ancien droit civil, si restreint dans ses conceptions, si matériel dans ses applications. «Le droit, ajoute-t-il, tend à simplifier dans le fond, et il se complique; dans ses rouages; deux éléments hétérogènes sont juxtaposés; quelquefois ils se rapprochent et se confondent; le plus souvent ils se séparent et se jalousent. L'harmonie manque dans ce majestueux travail; on aperçoit à chaque, pas qu'il est le prix de concessions pénibles, de combats opiniâtres. Le chef-d'œuvre eut été de pouvoir amener entre ces deux éléments une fusion complète; mais le plus ancien avait été trop fortement trempé pour se laisser effacer si vite, et le droit de l'époque impériale, qu'on a coutume s'appeler l'époque classique, porte la marque profonde de son passage; aussi laisse-t-il de grands, d'immenses progrès à désirer. On sent qu'il est loin d'être le dernier mot d'une science complète: il est plutôt l'expression d'une situation transitoire, d'un état transactionnel.»
Pendant la période philosophique, le christianisme avait déjà exercé une influence immense, quoique latente et indirecte, sur les mœurs, les idées, et par une conséquence nécessaire, sur les lois de la société romaine. Dès le règne de Néron, la vérité évangélique avait pris racine dans la capitale du monde; elle y était à côté de Sénèque, levant son front serein sur les calomnies par lesquelles on préludait aux persécutions, à ces supplices d'une persécution raffinée qui étaient aussi un moyen de faire connaître le christianisme et d'appeler sur lui l'intérêt et la sympathie. Depuis lors, elle avait germé, elle s'était développée, elle avait porté ses fruits, elle avait modifié, épuré, à son insu et peut-être malgré elle, l'esprit et le langage de la philosophie du Portique. «Epitecte n'était pas chrétien, a dit M. Villemain, mais l'empreinte du christianisme était déjà sur le monde.» Marc Aurèle, qui persécutait les chrétiens, était plus chrétien qu'il ne croyait dans ses belles méditations. Le jurisconsulte Alpien, qui les faisait crucifier, parlait leur langue en croyant parler celle du stoïcisme dans plusieurs de ses maximes philosophiques. Pour ne citer qu'un seul exemple, les idées avaient fait un si grand chemin sur la question de l'esclavage depuis Platon et Aristote, qu'Alpien lui-même écrivait: «En ce qui concerne le droit naturel, tous les hommes sont égaux.» (L. 32. D. de veg. juris.) Et ailleurs: «Par le droit naturel, tous les hommes naissent libres. (L. A. D. de just. et jure.) N'était-ce pas au christianisme que l'humanité devait cet immense progrès?
La période chrétienne date de Constantin. Avant ce prince, le mouvement marchait avec lenteur par la philosophie stoïcienne, indirectement influencée depuis Tibère par la religion chrétienne. L'avènement de Constantin plaça son point d'appui principal, ostensible, direct, dans le christianisme. Ce furent les évêques, les pères de l'Église et les conciles qui donnèrent l'impulsion réformatrice et accélérèrent sa marche. La jurisprudence dut moins ses perfectionnements à elle-même qu'à la théologie.
Toutefois, l'erreur serait grande de s'imaginer que la révolution religieuse qui porta sur le trône le premier empereur chrétien eut pour conséquence immédiate d'opérer une refonte radicale et absolue des institutions. Constantin réforma beaucoup, mais il ne nivela pas; il ne l'aurait pas pu. Si l'empereur était chrétien, l'empire était encore à demi païen. Avant de convertir les institutions, il fallait s'attacher surtout à convertir les cœurs. Il y avait en outre des intérêts positifs à ménager. Enfin l'Église, ayant été déchirée de bonne heure par les hérésies, s'occupa plus activement de formuler les dogmes fondamentaux sur lesquels reposait l'unité de la foi, que de reformer les mœurs à l'aide des lois civiles.--Cette dualité qui avait développé la philosophie, le christianisme, ne la transforma donc pas en unité. Ce fut toujours la lutte du droit strict et de l'équité, et le difficile arrangement de leurs prétentions contraires.--Il est vrai que l'équité, secondée immédiatement par le christianisme, gagna sur-le-champ un terrain considérable. Bien des choses que la philosophie païenne avait considérées comme étant de droit naturel, la philosophie chrétienne, partant d'un point plus large les considéra comme de droit strict. Les éléments du combat se trouvèrent ainsi souvent déplacées. En cela consista le progrès. Mais le combat resta l'âme de son développement, et tout le poids du christianisme porté d'un seul côté ne put le faire cesser.
Les réformes, opérée et commencées par Constantin, furent maintenue et continuées par ses successeurs. Un moment la réaction polythéiste de Julien l'Apostat arrêta ces progrès du droit. Cette tentative rétrograde ayant avorté, et les idées nouvelles ayant repris leur libre cours, le polythéisme, d'abord toléré, devint l'objet d'une proscription générale sous Théodose le Grand. Cependant tous les empereurs chrétiens acceptèrent le poids du passé et s'efforcèrent seulement de l'alléger. Le code Théodosien fut une œuvre précipitée, mal faite et pleine de lacunes. L'effroi d'une société tremblante à l'approche des Huns pouvait-il produire autre chose que le chaos? Du reste, il est intéressant d'étudier, dans cette défectueuse compilation, le dualisme de l'élément romain jetant ses dernières lueurs, et de l'équité associée désormais à la fortune du christianisme. La sagesse italique se débat encore pour conserver ce qui lui reste de ses antiques privilèges. L'équité, ne connaissant pas toutes ses forces, consent à transiger; elle fait des concessions; mais ses traités de paix ressemblent à ceux qu'Attila arrache au faible Théodose; tous enlèvent au vieux droit quelques-uns de ses lambeaux, et préparent la crise qui, renversant l'idole de son piédestal, ne laissera sur la terre que des débris.
Dans l'opinion de M. Troplong, Justinien fut un grand législateur. La mobilité de ses idées, les jactances orientales de ses conseillers, leur ignorance des antiquités historiques du droit, leur style ampoulé et diffus, ont été l'objet de vives censures. On a critiqué aussi la forme de leurs compilations, l'emploi malhabile des matériaux, l'impitoyable dissection des chefs d'œuvre du troisième siècle, consommée par Tribonien avec l'orgueil d'un novateur et l'infidélité d'un faussaire. Tous ces reproches, M. Troplong les accorde, mais il l'avoue, le droit dont Justinien a été l'interprète lui paraît bien supérieur à celui qu'on admire dans les écrits des jurisconsultes classiques du siècle d'Alexandre Sévère. Qu'importe la forme, si le fond est excellent Or, il surpasse le droit de l'époque classique autant que le génie du christianisme surpasse le génie du stoïcisme. Presque toujours Justinien a rapproché le droit du type simple et pur que lui offrait le christianisme: il a fait pour la philosophie chrétienne ce que les Labeon et les Caius avaient fait pour la philosophie du Portique. Sans doute, il l'a fait avec moins d'art; mais il y a mis autant et plus de persévérance et de fermeté. C'est là son mérite immortel.
«Justinien fut un novateur résolu, continua M. Troplong; en lui le génie grec éclipsait le génie romain, et le théologien dominait le jurisconsulte; de là ses défauts et ses qualités. Il était subtil, verbeux, disputeur; mais un bon sens naturel, puisé aux sources de la philosophie chrétienne, prévenait les écarts du sophiste: la vieille originalité romaine et son matériel lourd et composé provoquèrent de sa part d'amères railleries. L'homme de Constantinople, le représentant du sixième siècle, ne comprenait rien à des systèmes usés et dépourvus de convenance avec les habitudes contemporaines. Constantin ne les avait respectés que parce que le christianisme n'en avait pas encore vu l'esprit; mais les mêmes motifs de ménagements n'existaient plus. Deux siècles écoulés depuis la fondation de Constantinople avaient décomposé l'élément de la cité romaine. Le monde n'appartenait plus à Rome; il était acquis à la foi catholique. Le temps était donc venu d'en finir avec le fétichisme du droit strict, si contraire à l'esprit chrétien, et qui n'avait que trop retardé le développement du droit naturel. Justinien l'attaqua corps à corps, le pourchassa dans tous les replis de la jurisprudence au profit de l'équité. Sa noble ambition de législateur fut de l'amener de sa chaise curule, comme sa petite vanité d'homme avait fait descendre Théodose de sa colonne d'argent: c'est ce qui explique son travail de démolition des livres des Papinien, des Ulpien, et autres grands interprètes du troisième siècle. Il prit en eux tout ce qui lui parut de droit cosmopolite, et rejeta tout ce qui portait un caractère trop romain. Il les accommoda bon gré mal gré, et même par des altérations de texte, à des idées plus avancées que les leurs, à un droit plus simple, plus équitable, plus philosophique que celui qu'ils avaient expliqué. Peut-être méconnut-il en cela le respect dû à de grands génies; mais son but fut bon et louable. Il voulut affranchir la jurisprudence du sixième siècle d'une tutelle rétrograde. Chrétien et homme de son époque, il osa trancher dans le vif les racines d'un passé aristocratique et païen. Alors s'assoupit sur presque tous les points le long antagonisme qui avait partagé la jurisprudence... Quoi qu'on en puisse dire, Justinien a épuré, rationalisé le droit; il l'a élevé à un niveau que le Code civil a pu seul dépasser après treize siècles de préparations et d'épreuves Or, tandis que, sous tant de rapports, la société convergeait vers la barbarie, il a fait marcher en avant l'une des branches les plus importantes du gouvernement des hommes. C'est que le christianisme était l'âme de ses travaux, et qu'avec cette grande lumière il n'y a pas d'éclipse centrale à redouter pour la civilisation...»
Le Mémoire De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains, a pour but la démonstration des idées fondamentales que nous venons d'analyser. Il se divise en deux parties. Dans la première, M. Troplong expose les vérités qu'il a découvertes, et il les appuie sur un certain nombre d'exemples.--Il suit, comme on l'a vu, le christianisme dans ses influences générales tantôt obliques, tantôt directes. La seconde comprend l'histoire des faits particuliers qui ont été plus spécialement soumis à son action. Les onze chapitres sont consacrés à l'esclavage, au mariage, aux secondes noces, aux empêchements pour parenté, au divorce, à la célébration, au concubinage, à la puissance paternelle, à la condition des femmes et à la succession ab intestat.--Enfin, la conclusion de son travail est celle-ci: le droit romain a été meilleur sous l'époque chrétienne que dans les âges antérieurs les plus brillants; tout ce qu'on a dit de contraire n'est qu'un paradoxe ou un malentendu. Mais il a été inférieur aux législations modernes nées à l'ombre du christianisme et mieux pénétrées de son esprit.
M. Troplong s'arrêtera-t-il à Justinien? Ne complétera-t-il pas ce beau travail? Ne montrera-t-il pas, dans un second mémoire, quelle influence la Révolution française a eue sur le droit civil de la France, et quelle influence la Révolution française et le christianisme doivent exercer un jour, lorsqu'ils auront reçu tous leurs développements, sur la législation beaucoup trop romaine et féodale qui nous régit aujourd'hui? Ne nous fera-t-il pas assister aux dernières victoires de l'équité sur le droit strict, ou, en d'autres termes, de l'égalité future sur le privilège actuel?

Modes.
Dans un trousseau que nous avons eu occasion de voir ces jours derniers, il y avait un kakzavadeka pour la chambre, charmant vêtement en velours, garni de ganses d'or, qui ressemble assez, à la veste turque; puis un plus grand en satin, destiné à la promenade, que l'on nomma kazaveka; ce dernier avait un collet de velours formant la pointe par derrière, et des bandes pareilles garnissant les devants. Mais ce qui nous paraît prendre chaque jour plus d'importance dans les modes, c'est la dentelle: il n'est pas aujourd'hui un coffret de mariage qui ne contienne de superbes points d'Alençon, des dentelles anciennes, des barbes, des écharpes, des voiles d'une grande finesse de travail. La robe de mariage est toujours garnie de deux volants d'Angleterre, et quelquefois couverte en dentelle de manière à figurer une tunique; ainsi était celle du splendide trousseau dont nous parlions tout à l'heure et dont nous avons admiré la recherche.
Une toilette qui a paru l'autre jour un instant au Théâtre-Italien, et sans doute s'est montrée ensuite dans quelque brillante réunion, a été dessinée, pour l'Illustration. La voici.
La robe est lacée sur les côtés, au corsage et sur le milieu de la petite manche. Quant à la coiffure, nous pouvons affirmer son origine, car nous l'avions vue la veille chez Lucy Hocquet, avec d'autres coiffures d'une grâce tout à fait remarquable.
Nous citerons d'abord la coiffure Élizabeth, velours et petite tête de plume; puis la coiffure Anne Boleyn, en velours épinglé bleu, orné de franges d'or et d'argent avec tête de plume posée très-coquettement; ensuite, un petit bonnet douairière en blonde tuyautée et chaperon du coque en ruban, dont les grands bouts retombent derrière la tête; et enfin le chapeau comtesse en lacet d'or orné de plumes et d'une torsade en velours grenat, coiffure de jeune châtelaine.
Le costume d'homme élégant sort toujours de chez Humann; pour habit habillé, les basques sont larges et le collet tombe assez sur l'épaule.
L'habit demi-habillé est peu échancré sur les devants, les basques sont larges, l'échancrure est carrée.
Les cravates de satin noir reprennent la faveur qu'elles doivent à l'hiver; on les porte longues, et de petits bouquets ou de petites guirlandes viennent égayer un peu la sombre couleur.
Les gilets se font toujours à chaste et très-longs; les étoffes sont riches; c'est le satin broché, le velours brodé et souvent broché d'or et de soie.
Pour le matin, le tweed est plus en faveur que jamais; ou y met des collets et des parements en velours, afin du le rendre nouveau.
Amusements des Sciences.
SOLUTIONS DES QUESTIONS PROPOSÉES DANS L'AVANT-DERNIER NUMÉRO.
I. Ce problème n'a de difficulté que celle de reconnaître la volonté du testateur. Or, on a coutume de l'interpréter ainsi: puisque ce testateur a ordonné que, dans le cas où sa femme accoucherait d'un garçon, cet enfant aura les deux tiers de son bien et la mère un tiers, il s'ensuit que son dessein a été de faire à son fils un avantage double de celui de la mère; et puisque, dans le cas où celle-ci accouchera d'une fille, il a voulu que la mère eût les deux tiers de son bien et la tille l'autre tiers, on en doit conclure que son dessein a été que la part de la mère fût double de celle de la fille. Pour allier ces deux conditions, il faut partager la succession de manière que le fils ait deux fois autant que la mère et la mère deux fois autant que la fille. Ainsi, en supposant que le bien à partager soit de 30,000 fr. la part du fils serait de 17 142 fr. 6/7, celle de la mère de 8 571 fr. 3/7 et celle de la fille de 4 285 fr. 5/7.
On propose ordinairement, à la suite de ce problème, une autre difficulté; on suppose que cette mère accouche de deux garçons et d'une fille, et l'on demande quel sera, dans ce cas, le partage de la succession?
Il n'y a d'autre réponse à faire que celle que feraient les jurisconsultes; savoir, que le testament serait nul dans ce cas; car, y ayant un enfant d'omis dans le testament, toutes les lois connues en prononceraient la nullité, attendu 1° que la loi est précise; 2º qu'il est impossible de démêler quelles auraient été les dispositions du testateur s'il avait eu deux garçons, ou s'il avait prévu que sa femme en eut mis deux au monde.
II. Ou trouvera que le vin de Bourgogne leur a coûté 50 c. la bouteille, et celui de Champagne 75 c. Il est aisé de le prouver.
III. On voit aisément que, pour résoudre ce problème, il est question de trouver un nombre qui, divisé par 7, ne laisse aucun reste, et, étant divisé par 2, par 3, par 5, laisse toujours 1.
Plusieurs méthodes plus ou moins savantes peuvent y conduire, mais voici la plus simple.
Puisque, le nombre des pièces étant compté sept à sept, il ne reste rien, ce nombre est évidemment un multiple de 7; et puisqu'en les comptant deux à deux, il reste l, ce nombre est un multiple impair; il est donc compris dans la suite des nombres 7, 21, 35, 48, 65, 77, 91, 105, etc.
De plus ce nombre doit, étant divisé par 3, laisser l'unité pour reste. Or, dans la suite des nombres ci-dessus, on trouve que 7, 48, 91, qui croissent arithmétiquement, et dont la différence est 42, ont la propriété demandée. On trouve de plus que le nombre 91 étant divisé par 5 il reste 1; d'où on conclut que le premier nombre qui satisfait à la question est 91, car il est multiple de 7; et, étant divisé par 2, par 3. et par 5, il reste toujours 1.
Le nombre 91 est le premier qui satisfait à la question, car il y en a plusieurs autres qu'on trouvera par le moyen suivant: combinez, la progression ci-dessus, 7, 49, 91, 133, 175, 217, 259, 301, jusqu'à ce que vous trouviez un autre terme divisible par 5, en laissant l'unité, ce terme sera 301, qui satisfera encore à la question. Or, la différence avec 91 est 210; d'où on conclut que, formant cette progression,
91, 301, 511, 721, 951, 1 161, etc.,
tous ces nombres remplissent également les conditions du problème.
Il serait donc incertain quelle somme était dans la bourse perdue, à moins que son maître ne sût à peu près quelle somme elle contenait. Ainsi, s'il disait savoir qu'il y avait environ 500 pièces, on lui répondrait que le nombre des pièces était de 511.
Supposons maintenant que l'homme à qui appartient la bourse eût dit que, comptant son argent deux à deux pièces, il en restait une; qu'en les comptant trois à trois, il en restait deux; que, comptées quatre à quatre, il en restait trois; que, comptées cinq à cinq, il en restait quatre; que, comptées six à six, il en restait cinq, et enfin, qu'en les comptant sept à sept, il n'en restait aucune. On demande ce nombre.
Il est évident que ce nombre est, comme ci-dessus, un multiple impair de 7 et conséquemment un de ceux de la suite
7, 21, 35, 49, 65, 77, 91, 105, etc.
Or, dans cette suite, les nombres 35, et 77 satisfont à la condition d'avoir 2 pour reste quand on les divise par 3; leur différence est 42. C'est pourquoi on forme une nouvelle progression arithmétique dont la différence est 42, savoir:
35, 77, 119, 161, 203, 245, 287, etc.
On y cherche deux nombres qui, divisés par 4, laissent 3 pour reste, et on trouve que ce sont les nombres 35, 119, 203, 287.
C'est pourquoi ou forme cette nouvelle progression, où la différence des termes est 84:
35, 119, 203, 287, 371, 455, 539, 623, etc.
On cherche encore ici deux termes qui, divisés par 5, laissent un reste égal à 4, et on aperçoit bientôt que ces deux nombres sont 119 et 539, dont le différence est 420. Ainsi la suite des termes répondant à toutes les conditions du problème, hors une, est
119, 539, 959, 1 379, 1 799, 2 219, 2 639, etc.
Or, la dernière condition du problème est que, le nombre trouvé étant divisé par 6, il reste 5. cette propriété confient à 119, 959, 1 799, etc., en ajoutant toujours 840. Conséquemment le nombre cherché est un des termes de cette progression. C'est pourquoi, aussitôt qu'on saura dans quelles limites à peu près il est contenu, on sera en état de le déterminer.
Si donc le maître de la bourse perdue dit qu'il y avait environ 100 pièces, le nombre cherche sera 119; s'il disait qu'il y en avait à peu près 1 000, ce serait 959, etc.
Ce problème serait résolu imparfaitement par la méthode que donne M. Ozanam; car, ayant trouve le plus petit nombre 119, qui satisfait aux conditions du problème, il se borne à dire que, pour avoir les autres nombres qui y satisfont, il faut multiplier de suite les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ajouter leur produit 5, 040 au premier nombre trouvé, 119 et qu'on aura par là le nombre 5,159, qui remplit aussi les conditions proposées. Or, il est aisé de voir qu'il y a plusieurs autres nombres entre 119 et 5159, qui remplissent ces conditions, savoir: 959, 1 799, 2 639, 3 479, 4 519.
NOUVELLES QUESTIONS A RÉSOUDRE.
I. Diophante passa la sixième partie de sa vie dans la jeunesse et la douzième dans l'adolescence; après un septième de sa vie et cinq ans, il eut un fils qui mourut après avoir atteint la moitié de l'âge de son père, et ce dernier mourut quatre ans après. Combien Diophante a-t-il vécu de temps?
II. La somme de 500 francs ayant été partagée entre quatre personnes, il se trouve que les deux premières ensemble ont eu 285, fr., la seconde et la troisième, 220 fr.; enfin la troisième et la quatrième, 215; de plus, le rapport de la part de la première à celle de la derrière est de 1 à 5. Ou demande combien chacune a eu?
III. Faire qu'une boule rétrograde sans aucun obstacle apparent.
IV. Trouver les parties d'un poids que deux personnes soutiennent à l'aide d'un levier ou d'une barre qu'elles portent par les extrémités.
Logogriphe musical
Explication du Logogriphe musical.--M. B... nous écrit que le logogriphe musical de notre dernière livraison est «la récompense la re qu'on pense.» M. B... ayant deviné, nous lui donnons la récompense honnête (la re qu'on pense au net)

Rébus
EXPLICATION DU DERNIER RÉBUS.
Le nègre aura beau faire, il aura la peau noire.