
SUR LE COL DE TOMGHENT.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
De temps à autre, le cri aigu d'une marmotte nous donne un moment d'émotion. On galope de ce côté, Zurbriggen met pied à terre, épaule son fusil et attend patiemment que le rongeur sorte de son terrier. Puis un coup part, et la pauvre victime de la civilisation vient augmenter le trophée accroché à la selle du guide.

J'ÉTAIS ENCHANTÉ DES APTITUDES ALPINISTES DE NOS COURSIERS (page 472).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
Ne sachant que faire, j'observe notre troupeau de moutons qu'un garçonnet kirghize chasse devant lui. Comme on devient parfois terre-à-terre, en un tel voyage! Une des plus grandes consolations, c'est trop souvent de penser qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent. Ce n'est pas la perspective d'un mets délicat qui nous tente. L'art culinaire n'a rien à voir ici. À force de caracoler, de suer et de respirer à pleins poumons l'air vivifiant de la montagne, on aiguise un appétit formidable, et, à l'heure du repas, on est bien aise de faire bonne chère et d'absorber les plats que maître Abbas nous prépare. Pourvu qu'on mange, et le plus possible, cela suffît. On devient d'une voracité pantagruélique.
Les pauvres petits agneaux, avec l'étrange sac de graisse qui se dandine sur leur postérieur, tondus à grands coups de ciseaux, n'avaient guère le temps de mordre les brins d'herbe, l'inexorable berger ne leur laissait pas un moment de répit. Il fallait que leurs jambes fissent un triple travail, pour suivre l'allure des chevaux. Quand, par malheur, ils rencontraient un ruisseau, c'était un bêlement à vous fendre le cœur, car ils n'avaient que fort peu de goût pour l'eau, bien qu'ils nageassent à merveille. Mais souvent l'eau était profonde et le courant très prononcé, et alors c'était un naufrage général, une émouvante noyade, où les pauvres petits animaux étaient entraînés bien loin à la dérive. Aussi, le soir, quand elles arrivaient à l'étape et qu'on ne s'occupait plus d'elles, ces pauvres bêtes, au lieu d'aller chercher le peu de nourriture dont elles avaient besoin, s'accroupissaient, exténuées, sur le sol.
Les deux bœufs, par exemple, étaient d'un grotesque achevé avec leur anneau en bois passé au museau, leur carcasse anguleuse, et surtout leur charge de troncs d'arbres attachés à l'une de leurs extrémités sur une sorte de bât rudimentaire, et traînant de l'autre par terre, en décrivant sur le sable de menus zigzags à chaque pas qu'ils faisaient. Quand ils devaient traverser un terrain en pente, c'était un mauvais quart d'heure pour eux. Pensez donc! le tronc qui se trouvait en amont les poussait en aval, tandis que l'autre, suspendu dans le vide, les y entraînait. Au passage d'une rivière, ils ne trouvaient quelquefois rien de mieux que de s'arrêter tout à coup au beau milieu de l'eau, narguant l'impatience des conducteurs qui ne savaient comment s'y prendre pour les faire sortir de leur stupide immobilité.
Le soir, faute de trouver un endroit propice, nous campâmes tout près d'un marécage. L'eau de celui-ci, qu'on nous servit pendant le dîner, nous octroya certaines coliques, qui nous tinrent éveillés pendant toute la nuit.

LE PLATEAU DE SARIDJASS, PEU TOURMENTÉ, EST POURVU D'UNE HERBE SUFFISANTE POUR LES CHEVAUX (page 477).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
Peu après notre départ du camp, nous laissons à gauche le vallon du Berkout, dont le col donne dans la vallée de Kizil-tao. Le contrefort qui la sépare du Saridjass semble une gigantesque moraine, entièrement recouverte de pâturages crevés par quelques îlots de roches, qui rompent un peu la maussade uniformité de cet interminable dos d'âne.
À un certain moment, nous remarquons un groupe d'ovispoli de l'autre côté du fleuve, paissant tranquillement dans une combe. Ces animaux sont de la taille d'un veau, mais d'une carrure plus accentuée, avec un manteau aux poils touffus et blonds, et portent sur le crâne une paire d'énormes cornes en spirales. Les Kirghizes les appellent: koudja. Ce mouton sauvage se tient de préférence sur les hauts plateaux du Pamir et du Tian-Chan. Il est inutile de le chercher sur les pentes abruptes des montagnes, où il ne peut circuler, vu que ses cornes, qui sortent latéralement de la tête, se heurteraient contre les rochers. En automne, les mâles se livrent des batailles acharnées. Le plus souvent, à force de se choquer le crâne, un des combattants tombe assommé sur le terrain, et son cadavre ne reste pas longtemps avant d'être écartelé et dépecé par les oiseaux de proie et les fauves des environs. Les cornes seules demeurent sur place, recueillies quelquefois par les nomades qui les étalent sur des rochers dont les formes étranges attirent leur attention.

NOUS PASSONS À GUÉ LE KIZIL-SOU.—D'APRÈS DES PHOTOGRAPHIES.
Le plateau du Saridjass est surtout peuplé de milliers de chevaux, partagés en plusieurs troupeaux, et disséminés un peu partout dans la haute vallée. C'est un endroit très favorable à l'élevage hippique. Le terrain est peu tourmenté, et si l'herbe n'est pas très fournie, elle est suffisante cependant pour nourrir quelques centaines de milliers de bêtes.
Pour surveiller autant de chevaux, il y a relativement peu de gardiens. À vrai dire, leur tâche se résume à bien peu de chose: elle consiste à ne pas perdre de vue les bêtes pendant le jour et à les rassembler le soir autour de leurs tentes. Mais, s'ils n'ont rien à faire, ces pauvres diables de bergers ne jouissent pas d'une vie très enviable. Ils logent, soit sous un rocher, soit sous un feutre jeté en forme de tente, rarement dans une yourte. Leur nourriture n'est autre que le koumiss. Ils n'ont pas autre chose. Tous ces chevaux appartiennent à des Kozaques de la Sémiretchié et de la Dzoungarie. Deux fois par an, ils viennent faire un choix et conduisent des troupes de chevaux aux foires de Kouldja, d'Ak-sou ou de Kachgar, où ils les vendent de 30 à 60 francs la tête.
Le sol sur lequel nous marchons est sillonné d'une multitude d'ornières tracées parallèlement, comme si le terrain avait été labouré par une charrue. Ce sont les chevaux qui ont cannelé ainsi le gazon, parce que, comme les chameaux, ils aiment à marcher côte à côte; de cette manière, ils creusent autant de sentiers réguliers qu'il y a d'espace disponible.
Le torrent a tout à coup disparu de notre vue et il semble que la toison végétale ne doive pas discontinuer d'un côté à l'autre de la vallée. Le fleuve est dissimulé dans un fossé profond, coupé à pic. Un peu plus haut, il réapparaît, et partage ses eaux en de nombreux canaux.
Mais le plateau, ou ce qui de loin nous parut comme tel, a pris fin, et nous nous trouvons bientôt dans la région de la haute montagne. L'air même est devenu très vif et nous annonce le voisinage des glaciers. En effet, sur notre droite, le flanc gauche de la vallée se dresse brusquement et se brise en plusieurs conques, où des glaciers montrent leur tête crevassée au-dessus de leurs moraines frontales. Vers le soir, nous sommes au débouché de la vallée de Kachkateur, qui s'ouvre à droite du Saridjass, et mène par deux cols dans les vallées de Kokdjart et de Kapkak, dans le bassin de l'Ili.
19 juillet.—Le Khan Tengri, le «prince des cieux», comme le désignent les Mongols dans leur langue imagée, est le pic géant de toute la chaîne des monts Célestes. Cette dénomination pompeuse n'a rien de déplacé, si l'on considère sa position exceptionnelle et surtout son élévation considérable, qui, selon quelques voyageurs, dépasse 7 200 mètres d'altitude.
Presque tous les peuples barbares vivant en contact continuel avec la nature sauvage sont enclins à glorifier des choses inanimées, à donner un sens, une signification à des objets dont la singularité dépasse les bornes de leur compréhension. Pour ne parler ici que de l'Asie centrale, on peut dire que le nom des villes, des fleuves, des lacs et des montagnes se rapporte le plus souvent à une impression que l'habitant de ces contrées a reçue au moment où il en a aperçu le site. Nous avons déjà eu l'occasion de relever ce fait dont l'exactitude ne saurait être mise en doute. Il serait désirable que les explorateurs eussent le tact de respecter ces règles de nomenclature géographique d'un cachet beaucoup plus original, en évitant de la remplacer par les noms de savants, qui n'ont quelquefois aucun rapport avec les localités ou les objets qu'il s'agit de désigner.
La situation du Khan Tengri n'a jamais été exactement établie. Les géographes l'ont casé un peu partout, sauf à sa vraie place. Les rares voyageurs qui l'approchèrent ne sont même pas tous d'accord; cela provient sans doute de ce qu'on n'a fait que l'entrevoir d'une certaine distance, et presque toujours du fond d'une des vallées qui rayonnent autour de sa base.
Tandis qu'il est visible des plaines du Tekès, à plus de 200 verstes au nord, et même de la route de Kachgar à Koutcha, il demeure partout ailleurs masqué par les contreforts qui constituent sa vaste assise. Sur quelques-unes des cartes que nous avions sous les yeux, le Khan Tengri semblait s'élever isolément au nord de la petite ville de Baï, sur le chemin d'Ak-sou.
Suivant l'enquête que nous avions faite à Prjevalsk et selon les indications de la carte russe dont nous étions nantis, le 18 juillet nous devions être tout près du pic, nous trouvant à une vingtaine de verstes du point terminus de la vallée du Saridjass, où il était placé. Nous brûlions de le voir et de l'étudier, même d'une certaine distance, impatients de présenter nos hommages à cette mystérieuse souveraineté, qui, depuis des mois, hantait notre esprit.
Nous décidâmes donc d'escalader un pic quelconque de la vallée de Kachkateur, mais dont l'élévation fût assez considérable pour jouir d'une vaste étendue de montagnes. À dix heures, nous arrivons sur le col de Kachkateur, passage très fréquenté par les nomades qui s'adonnent à l'élevage des chevaux sur le plateau du Saridjass. De ce col, en suivant la vallée de Kokdjart, on arrive aux villages de Tald-boulak, de Dgilkarkara et de Kheghen.
Au sud du col, s'élevait une blanche pyramide de glace, dont les angles se hérissaient de rochers. C'est par là que nous dirigeâmes nos pas, et au bout de deux heures nous atteignîmes sans difficulté aucune le sommet, formé par une calotte de neige surplombant en une gigantesque corniche la vallée de Kapkak.

PANORAMA DU MASSIF DU KHAN TENGRI.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
En ôtant nos lunettes à neige pour mieux voir, nous éprouvâmes un douloureux éblouissement qui nous contraignit à fermer instinctivement les yeux. Jamais, jusqu'alors, nous ne nous étions trouvés au milieu d'un pareil scintillement de neige, d'une fulguration de glaces aussi intense. Partout où le regard pouvait plonger ou s'arrêter, il ne distinguait qu'une succession chaotique de pics, d'arêtes, de dômes, d'aiguilles, un moutonnement infini de montagnes recouvertes de neiges, enchevêtrées les unes dans les autres et se dirigeant en tous sens.
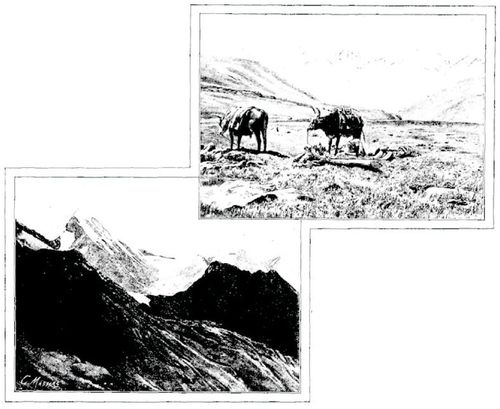
ENTRÉE DE LA VALLÉE DE KACHKATEUR.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
NOUS BAPTISÂMES KACHKATEUR-TAO, LA POINTE DE 4 250 MÈTRES QUE NOUS AVIONS ESCALADÉE.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
On a souvent comparé l'aspect d'une vaste étendue de montagnes aux vagues de la mer, qui se seraient subitement solidifiées par un coup de baguette magique. Sur les Alpes cette comparaison est exacte, car le déploiement des contreforts imite parfaitement, à peu de chose près, la formation des ondes de la mer. Mais ici le bouleversement était tel, l'asymétrie si frappante, que cette similitude nous semblait trop modeste. C'était plutôt un océan agité par un cataclysme, aux prises avec une tempête effrénée. Les roches mêmes qui crénelaient les crêtes de leurs étranges silhouettes, présentaient des reflets de poteries, des éclats de verre de Venise, avec des effets d'ombres qui faisaient qu'à grand'peine on les discernait de la neige qui les saupoudrait.
Le Khan Tengri dominait de sa haute pyramide de granit cette armée de colosses qui semblaient former comme une garde d'honneur et interdire l'approche aux profanes. Il se trouvait à une quarantaine de verstes au sud de nous, formant le centre, d'où rayonnaient et divergeaient de tous côtés les contreforts et les vallées.
D'après notre carte, le Khan Tengri aurait dû être à l'est du col de Kachkateur, à moins d'une vingtaine de verstes de l'endroit où nous étions. Nous n'eûmes pas de difficulté à constater que cette carte était tout à fait erronée sur ce point, et que si nous voulions aboutir à quelque résultat, nous devions nous en méfier. Nous faisions fausse route, car par la vallée du Saridjass, jamais nous n'aurions abordé le colosse. Il fallait tourner bride et nous en approcher par un autre côté. Après quelques observations sur le massif, nous baptisâmes Kachkateur-tao, la pointe que nous venions d'escalader. Elle mesurait 4 250 mètres d'altitude.
Une heure après nous étions sur le col, où le pauvre Kirghize qui gardait nos chevaux, à la merci d'un vent glacial, battait la semelle depuis longtemps, prenant force chiques de nass, pour combattre la faim, ne se doutant pas qu'il avait les vivres sur le dos!
En descendant rejoindre le camp, nous trouvâmes une paire d'énormes cornes de cerf, à 3 000 mètres, gisant là, qui sait depuis combien de temps, rougies par les intempéries, et calcinées par le soleil.
20 juillet.—Au delà du Saridjass-tao s'étend la vallée d'Inghiltchik, qui, selon toute probabilité, doit prendre naissance au pied du Khan Tengri. Mais le contrefort qui les divise est très élevé et encombré dans sa majeure partie par des neiges éternelles. Pour des alpinistes, ces entraves étaient moins que rien, car, avec un guide comme Zurbriggen, les difficultés s'aplanissent et deviennent des jeux d'enfants. Mais nous n'étions pas seuls et il fallait aussi transporter tous les bagages de la caravane, car arrivés de l'autre côté, nous n'aurions rien trouvé ni pour nous abriter ni pour nous sustenter. Nos chevaux ne craignaient guère le vertige, et leurs aptitudes de grimpeurs nous faisaient espérer que même dans un passage un peu laborieux ils se comporteraient bien. Seulement, il fallait trouver ce passage, ce qui n'était pas très facile avec l'ignorance des lieux et l'impatience qui nous agitait, et qui écartait toute velléité d'un long tâtonnement. Cependant le djighite nous fit comprendre que, peut-être, en interrogeant les gardiens des chevaux, il trouverait notre affaire. De l'endroit où nous étions il ne fallait pas compter pouvoir franchir la montagne. On devait dévaler jusqu'à la rencontre d'un vallon dont le col n'était pas trop dur pour nos montures.
En attendant, nous nous réveillons avec 20 centimètres de neige sur nos tentes. Et ce n'est que très tard que nous pouvons partir.
Le passage à gué du Saridjass-sou n'était pas sans offrir quelques dangers; néanmoins nous arrivâmes sains et saufs sur l'autre rive, après avoir éprouvé dans maintes baignades des émotions assez vives.
Sur l'autre versant, nous ne fûmes pas peu déconcertés de trouver, au lieu de la plaine que nous attendions, un terrain ondoyant de collines, creusé de réservoirs d'eau bourbeuse et sillonné de ruisseaux qui disparaissaient dans les déchirures du sol. Le terrain était morainique par excellence, par conséquent très poreux, et surtout d'une uniformité sans pareille. Il n'était pas prudent de s'éloigner trop de la caravane, car on aurait eu vite fait de s'égarer. Aussi, nous ne nous perdions jamais de vue et marchions en file indienne très serrée.
Le soir, on campa en face de la vallée d'Adeurteur, dont le glacier s'appelle de Mouchktoff, en l'honneur d'un officier russe du même nom, qui, le premier, entrevit le plateau du Saridjass.
Le lendemain matin, même surprise que la veille. Pendant la nuit, la neige était tombée drue sur nos tentes. À la première heure, des hennissements déchirants et un piétinement accéléré de sabots nous firent sursauter dans nos sacs. C'était une avalanche effrénée de chevaux, descendant des coteaux supérieurs chassés par une tourmente de neige.
À midi, nous nous acheminons, toujours sur le même versant, qui augmente peu à peu sa déclivité et s'approche de plus en plus de la ligne des vraies montagnes. Nous longeons plusieurs mares d'eau peuplées par des colonies de canards sauvages. Piotra, notre jeune colon russe, se met en devoir d'attraper quelques-uns de ces volatiles; dépouillé de vêtements, il se dissimule entièrement dans l'eau, et saisit par les pattes les pauvres bêtes qui, ne se doutant pas de sa présence, passaient à la portée de sa main. Entre temps, le djighite s'est informé auprès des bergers, et découvre finalement un passage pour franchir la montagne. C'est le col de Tuz. En hâtant un peu le pas, nous arrivons le soir, à l'embouchure de la vallée du même nom.
(À suivre.) Jules Brocherel.

LA VALLÉE DE TOMGHENT.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
Droits de traduction et de reproduction réservés.
TOME XI, NOUVELLE SÉRIE.—41e LIV. No 41.—14 Octobre 1905.

DES KIRGHIZES D'OUSTCHIAR ÉTAIENT VENUS À NOTRE RENCONTRE (page 489).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
VOYAGE DU PRINCE SCIPION BORGHÈSE AUX MONTS
CÉLESTES[2]
Par M. JULES BROCHEREL.
III. — Sur le col de Tuz. — Rencontre d'antilopes. — La vallée d'Inghiltchik. — Le «tchiou mouz». — Un chef kirghize. — Les gorges d'Attiaïlo. — L'aoul d'Oustchiar. — Arrêtés par les rochers.

KIRGHIZE JOUEUR DE FLÛTE.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
Le passage du col de Tuz est une étape importante dans l'excursion aux Monts Célestes; le vallon qui le précède ne s'aperçoit pas depuis le thalweg du Saridjass-sou; il reste masqué par une moraine s'avançant comme une sorte de digue entre les deux fleuves, qui, avant de se réunir, roulent longtemps presque parallèlement l'un à l'autre.
Le 22, en quittant notre camp, nous sommes assaillis par des nuées de moustiques qui s'abattent sur nous avec une voracité cruelle. Nous avons beau couper l'air de nos cravaches pour éloigner ces agaçants insectes, notre épiderme devient leur proie et nous en souffrons beaucoup.
Vers dix heures, nous rencontrons un groupe de trois arkars, espèce d'antilope du genre du chamois, qui paissaient tranquillement sur une pente gazonnée. Ils ne semblent guère surpris de notre présence, et au lieu de détaler à notre approche ils continuent à tondre les bouquets d'herbes, en s'arrêtant de temps à autre pour nous regarder. De la taille d'un petit chamois, ils sont très frêles, avec un pelage ras, d'un blond d'ocre, qui se confond facilement avec la teinte du terrain. Ils portent une paire de petites cornes droites, légèrement divergentes. C'est l'antilope argalis, commune dans la chaîne du Tien Chan.
Le vallon de Tuz se divise en trois combes. Nous prenons par celle de droite; les autres sont impraticables. Des traces de sentier nous conduisent rapidement aux premiers éboulis, au bas d'un énorme bastion de roches caverneuses. Il y a bien un semblant de chemin qui côtoie en rampant les escarpements bouleversés de la montagne, qu'on distingue de loin aux pierres remuées par les fréquentes traversées des caravanes, et qui se détache comme une longue bande claire sur la teinte ferrugineuse du sol. En réalité, c'est une parodie de sentier, car nous avançons avec beaucoup de peine, les cailloux qui jonchent le sol roulant avec une facilité extraordinaire.
Zurbriggen, qui nous a devancés, s'est placé en statue équestre sur le haut du bastion. Quand nous parvenons à lui, il secoue tristement sa barbe rousse, malmenant la pipe éteinte au coin de sa bouche. C'est un mauvais présage.

LE MASSIF DU KIZIL-TAO (page 486).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
«Par où passerons-nous?» nous dit-il en promenant son regard sur l'amphithéâtre de rochers et de glaces qui nous fait face à quelques centaines de mètres.
Nous appelons le djighite. Celui-ci nous indique une raie foncée qui traverse le glacier du milieu.
«Vot doroga!—Voilà le chemin—nous répond-il en russe. Djol djâman!—C'est très mauvais», ajoute-t-il dans son dialecte.
Près de nous, un petit lac recueille les eaux de trois glaciers, qui, bien que de petites dimensions, sont presque tous découverts, et d'une inclinaison assez alarmante. Mais «le chasseur», prenant par la bride deux chevaux, a déjà escaladé la moraine frontale. Nous le suivons sans savoir au juste ce que nous allons faire. Avec un courage un peu téméraire, nous hissons toutes les bêtes sur le sommet du pierrier, où elles ont bien de la peine à se tenir debout, tant la place est exiguë et le sol glissant, à cause du suintement du glacier.
Zurbriggen, tenant sa bête par les rênes, s'aventure audacieusement sur la pente glacée. D'abord il monte droit devant lui, puis un brusque renflement le contraint d'obliquer à droite, en prenant le glacier en écharpe.
Nous tentons d'en faire autant, en suivant les fissures où un petit relief permet de poser les pieds, et cherchons les endroits rugueux et granulés. Dépourvus de piolet, nous sommes forcés de nous servir des mains, afin de ne pas tomber. Mais quand il nous faut tourner à droite, pour traverser diagonalement le glacier, nous jugeons que le jeu est décidément trop dangereux. Les chevaux auraient toutes les chances de verser les charges, en même temps qu'ils dégringoleraient inévitablement jusqu'aux abrupts rochers d'en bas.
Le guide, parvenu miraculeusement en lieu sûr, nous crie de toutes ses forces de ne pas avancer, car il avait failli tomber, et son cheval en tremblait encore d'épouvante.
Tout à coup un cheval chargé roula comme une pierre contre la moraine, où stationnait le restant de la caravane. Abbas jeta un cri de douleur, se ramassant sur lui-même, sous les pieds du cheval. On le dégagea. Il avait une jambe blessée.

LES KIRGHIZES MÈNENT AU VILLAGE UNE VIE PEU OCCUPÉE.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
Continuer dans de pareilles conditions, c'était de la folie. Nous décidâmes donc de camper tout près du lac, afin de pouvoir chercher pendant le reste de la journée une route meilleure.
Abandonnant nos chevaux à leur sort, nous rejoignîmes le guide, et en quelques minutes nous parvînmes au sommet du col. Nous étions à 3 450 mètres d'altitude. À nos pieds s'étendait la vallée d'Inghiltchik sur une longueur de cent verstes, flanquée au sud par une paroi vertigineuse qui s'élevait à plus de 6 000 mètres.
Mais le temps pressait, et pour l'instant il convenait de découvrir un passage sûr, plutôt que de nous délecter du spectacle de la nature. À droite du col, au delà d'une arête de rocher, descendait un glacier avec une pente très douce et des moraines latérales peu escarpées. C'était par là que nous devions passer.
En arrivant au campement, nous trouvâmes deux malades, Abbas et Piotra. Celui-ci se roulait par terre en se tenant le ventre dans des contorsions atroces. L'autre se plaignait de souffrir de la jambe. On les frictionna avec un antiseptique, et on administra un purgatif au jeune Russe. La confiance aveugle que ces hommes simples avaient en notre toute-puissance, aidèrent à l'efficacité des remèdes. Nous eûmes plus tard occasion de nous servir de notre pharmacie auprès des Kirghizes. Bien qu'ils soient des hommes très endurcis, ce sont toujours des malades plus imaginaires que réels. Il suffit alors d'un rien pour les guérir incontinent. Ils professent à l'égard de la médecine des civilisés une confiance illimitée.
Le lendemain, au bout de trois heures, nous parvenons jusqu'au col de Tuz numéro deux. En réalité ce sont deux cols que fréquentent les nomades, selon que l'un des deux est plus ou moins praticable. Nous ne faisons donc que suivre l'exemple des Kirghizes.
Tandis que la caravane marchait vers la vallée d'Inghiltchik, je grimpai sur une petite éminence pour procéder à mes travaux. La vallée se développait en forme de croissant, à la périphérie duquel je me trouvais. De la sorte, mon regard pouvait plonger en amont et en aval dans presque toute la longueur de ce gigantesque sillon.
Au premier coup d'œil, on peut facilement distinguer dans ce massif, trois sections. La partie supérieure, longue de 50 verstes environ, est occupée entièrement par un glacier colossal, ayant la forme d'un tronc d'arbre dont les embranchements se perdent dans des gorges. La partie moyenne de la vallée, presque plate, est constituée par le thalweg même du fleuve, qui s'étend sur une largeur de 2 à 3 verstes. Après une vingtaine de verstes d'un amoncellement de pierres, et d'un fouillis de canaux, une écluse naturelle de rochers réunit tous les ruisseaux en un unique faisceau. C'est là que la vallée inférieure commence, revêtue de maigres pâturages.
Le versant qui tombe du faîte du Saridjass-tao, est recouvert jusqu'à mi-hauteur d'une forte couche de dépôts morainiques, marquant par une ligne nettement tracée le niveau de l'ancien glacier. Le terrain est brûlé par le soleil, et sa couleur jaunâtre ne fait que rehausser l'éblouissement des neiges supérieures.
Mais la paroi de roches qui fait vis-à-vis est tout ce qu'on peut imaginer de plus terrible, de plus convulsé, de plus disloqué dans la nature. Des aiguilles s'élancent avec une sveltesse étonnante, s'alignent en de multiples rangées au-dessus du contrefort qui est labouré par des fentes, et tourmenté en tout sens par une force diabolique.
Ce bloc incommensurable de granit et de gneiss est tailladé de gradins, fendu de fissures qui stupéfient parfois par leur tranchante netteté. Un talus de débris s'adosse à la base des rochers, dissimulant les anfractuosités. Des filets d'eau gazouillent en des fêlures ténébreuses, dont les parois tiennent en suspension d'énormes rochers, pris entre les bords de la crevasse.
Pour descendre le col de Tuz, il s'agit de faire un saut de 2 000 mètres. Ne croyez pas qu'un sentier facilite la besogne et qu'on n'ait qu'à se laisser glisser. Il faut s'ouvrir une route. Quand je parvins aux premiers gazons, mon cheval saignait de ses quatre pieds, et ne paraissait pas très enthousiasmé de ce divertissement.
Vers trois heures nous arrivons tous au bas du coteau, dont la bordure s'était écroulée par suite de l'érosion du torrent. Le paysage manque toujours de charme, bien qu'il s'égaye de quelques arbrisseaux blottis dans les anses de la berge. Des bouquets de crucifères, couleur safran, des chardons, des centaurées rouges et des anémones jaunes folâtrant en de longues traînées sur les buissons, se disputent une piètre existence dans le maigre terrain du talus. Quelquefois un ruisseau jaillit on ne sait comment de ce roc torréfié et arrose des parterres de graminées, formant de véritables oasis, dans le pierrier interrompu.
Sur une petite terrasse du rivage, quelque chose d'insolite attire notre attention. C'est un tombeau kirghize formé par des troncs d'arbres entrecroisés, au centre duquel s'élève une pyramide de cailloux.

NOTRE PETITE TROUPE S'AVENTURE AUDACIEUSEMENT SUR LA PENTE GLACÉE (page 482).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
Peu de temps après, nous atteignons un aël abandonné de nomades. C'est là qu'ils viennent s'établir pendant la mauvaise saison, car il paraît qu'alors, le versant que nous venons d'arpenter dans sa hauteur, exposé comme il est aux rayons du soleil, se débarrasse vite de la neige, et se recouvre d'herbes. Autour d'un gros bloc de granit, on voit distinctement les cercles tracés par les keregas, c'est-à-dire les treillis de bois qui forment la carcasse de la yourte. Au milieu, les trois pierres calcinées de l'âtre, sont encore debout. L'herbe a poussé, drue et haute, là où le stationnement prolongé des animaux a engraissé le sol.
Mais, au lieu de nous installer dans cet emplacement, nous préférons nous cacher à l'abri d'un mamelon, afin de protéger notre camp de l'haleine par trop réfrigérante du glacier qui, tout près de nous, vomit par mille bouches des torrents d'eau bourbeuse. En face, la masse écrasante du Kizil-tao, voilée de nuages, nous menace incessamment de tonnantes avalanches, dont la chute nous amuse plutôt qu'elle ne nous effraie, car nous sommes hors de leur portée. En amont, une mignonne cascade apparaît parmi les broussailles.

VALLÉE SUPÉRIEURE D'INGHILTCHIK.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
Les Kirghizes y réunissent habituellement leurs troupeaux de moutons, le site se trouvant clos naturellement.
24 juillet.—Nous allons faire une reconnaissance sur le glacier d'Inghiltchik, afin de chercher un endroit par où faire passer les chevaux. Si nous avons cette chance, nous nous transporterons le plus haut possible, de manière à pouvoir établir notre quartier général tout près de la base du Khan Tengri. Il doit être, certainement, au point terminus de cette gigantesque coulée de glace, que les nomades appellent le «tchiou mouz», le grand glacier.
La surface est très mouvementée: c'est tout un système de lacs et de torrents, de combes et de monticules, littéralement encombrés de pierres qui, suivant leur provenance et la plasticité du glacier, s'accumulent en stries longitudinales et transversales, de couleurs variées. Vu d'en haut, le glacier ressemble à la carapace d'un reptile.
Nous n'attendons pas longtemps pour nous apercevoir de l'impossibilité absolue d'y amener nos bêtes, à cause du manque de pâturages et de l'impraticabilité du terrain. Pour remonter le glacier d'Inghiltchik jusqu'à ses origines et y séjourner pendant quelques semaines, il eût fallu avoir sous la main une équipe de porteurs solides et chaussés ad hoc; ce qui n'était pas le cas des hommes dont nous disposions, ni de ceux que nous aurions pu trouver dans les vallées voisines. Ils sont d'abord mal habillés, et puis on ne peut leur faire porter quoi que ce soit sur les épaules. Nous nous résignâmes donc à chercher ailleurs le point d'attaque du Khan Tengri. Nous décidâmes de l'aborder depuis le col du Mouj-art, en passant sur le territoire chinois.
En levant le camp, nous ne fûmes pas peu surpris de voir le djighite nous amener un vieux Kirghize qui vint, sur-le-champ, se prosterner devant nous comme s'il implorait une grâce. Ce n'était rien moins que le chef, le chirtaï, de toute la vallée de Kaënde, venu exprès pour offrir ses bons offices. La veille, pendant que nous déambulions sur le glacier d'Inghiltchik, le djighite avait tout à coup disparu sans crier gare et, pour quérir son homme, il avait parcouru tout simplement 150 verstes et accompli le voyage en vingt-quatre heures.
Maître Abbas, abandonnant pour un moment ses casseroles, remplit gravement les fonctions de maître des cérémonies et d'interprète. D'une flegmatique imperturbabilité, il envisagea la chose avec son tact habituel, c'est-à-dire en traitant son hôte comme une vieille connaissance à lui. Il faut dire qu'il n'aimait guère les Kirghizes, il les considérait comme des quantités négligeables. En parlant d'eux et de leurs femmes, il avait coutume de dire que c'étaient des chiens.... capables de manger jusqu'à des charognes.
Ce chirtaï ne paraissait pas, à vrai dire, d'une très haute distinction. Sauf quelques paroles de convenance, qu'Abbas nous traduisait dans son français de Téhéran, il ne savait guère s'exprimer qu'à force de courbettes et de salamalecs, qu'il exécutait automatiquement à tout propos, en fermant les yeux et en pressant les mains sur la poitrine.
À peine étions-nous en route que deux nouveaux cavaliers vinrent à notre rencontre et se joignirent à nous. C'étaient deux sujets de notre autocrate en raccourci, mandés par lui pour venir en aide à notre caravane. Comme on le voit, si ce chef n'était pas très avenant, il connaissait au moins les règles élémentaires de l'hospitalité.
Ces hommes nous furent d'une grande utilité pour passer à gué le fleuve qui, en certains endroits, mesurait près de 200 mètres de largeur. Nous atterrîmes sur l'autre rive, à l'entrée du vallon d'Attiaïlo, le seul passage communiquant avec la vallée de Kaënde qui longe, au sud, celle d'Inghiltchik.
Le contrefort qui les sépare se présente, au point de vue géologique, comme le noyau central du groupe du Khan Tengri. C'est un système ayant des caractères propres, tant par son aspect extérieur que par la nature de ses roches. À son profil anguleux et à la disposition en éventail des couches granitiques, on reconnaît aisément l'origine plutonique de sa formation. Ce qui est surprenant dans la constitution de ce massif, c'est qu'à un moment donné il cesse inopinément, coupé en biais, du sud-ouest au nord-est, par l'entaille des gorges d'Attiaïlo. De loin, on ne s'attendrait pas à cette surprise, parce que la chaîne ne semble guère interrompue et paraît continuer sous la forme atténuée d'un contrefort servant d'appui gigantesque à la masse imposante du Kizil-tao. Mais, de près, comme nous le constatons en remontant le vallon d'Attiaïlo, on découvre que cet appendice montueux est d'une origine et d'une structure toutes différentes.

VALLÉE DE KAËNDE: L'EAU D'UN LAC S'ÉCOULAIT AU MILIEU D'UNE PRAIRIE ÉMAILLÉE DE FLEURS.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
Après deux ou trois verstes, le vallon se partage en deux: à gauche, une effroyable tranchée paraît contourner le bastion de granit, comme pour l'isoler. Nous prenons par celui de droite. Après quelques heures de rapide montée, la pluie nous surprend et nous oblige de nous arrêter au pied d'une paroi de rochers, coiffée de glaces. Il y a bien des pierres qui dégringolent de temps à autre et voltigent autour de notre camp, mais, habitués comme nous sommes à ces bagatelles, nous n'y faisons même plus attention.
C'est le chapeau rabattu, le col relevé et le plaid sur les épaules, que nous partons de notre bivouac de 3 000 mètres, sans savoir au juste où nous coucherons le soir. Lentement, fouettés par la pluie que le vent chasse contre nous, nous gravissons l'échelonnement des terrasses éventrées par les éboulements, contournant de temps à autre quelques moraines, dont les glaciers s'enfuient dans des gouffres enveloppés de brouillard, à notre gauche.
Au sommet du col, les nuages se déchirent un instant, et nous nous apercevons que nous frôlons un lac, dont l'eau s'écoule en serpentant au milieu d'une prairie émaillée de fleurs. Dans notre singulier état d'âme, voisin de l'indolence maussade, cette esquisse de paysage, aux lignes estompées et noyées dans un flottement de vapeurs, nous est comme un soulagement. La lourdeur apathique dans laquelle sommeillait notre esprit, disparaît tout à coup, et c'est presque avec enthousiasme que nous saluons ce lambeau de gazon ensoleillé, qui nous rappelle un petit coin des Alpes, un fragment de la patrie lointaine.
Mais cet attendrissement nostalgique n'est pas de longue durée. Après cette oasis alpestre, nous nous engageons, sans transition aucune, dans un affreux défilé, qui nous fait l'effet de quelque tunnel.

LES FEMMES KIRGHIZES D'OUSTCHIAR SE RANGÈRENT, AVEC LEURS ENFANTS, SUR NOTRE PASSAGE (page 489).—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.
Le temps s'obscurcit et la pluie recommence de plus belle. Le torrent s'est grossi démesurément. Il nous faut quand même le traverser et le longer à plusieurs reprises, avec la menace continuelle des pierres qui se détachent des pentes supérieures et dégringolent avec une rapidité extraordinaire. Pour éviter des accidents, nous sommes contraints à de périlleuses galopades sur le terrain trempé et glissant au plus haut degré.
Soudain, le djighite s'arrête tout court et nous fait signe d'en faire autant. Il nous dit alors, qu'un peu plus loin il y a un précipice très dangereux, et qu'il serait de la dernière imprudence de s'y aventurer. Nous nous regardons interloqués. Que faire? Pourquoi ne nous avait-il pas avertis plutôt? Devrons-nous camper en cet endroit? Nous nous trouvons sur une bande de gravois charriés par la rivière, dont l'eau tourbillonne à côté, entraînant, dans sa course, de gros blocs qui, en formant un barrage, auraient pu enlever notre camp et nous avec lui.
Mais à la seule pensée de retourner en arrière et de refaire la route de tout à l'heure, nous nous résignons à accepter notre triste sort. Ce soir-là, nous ne nous attardâmes pas à flâner, comme d'habitude, autour des tentes, pour faire la causette, et nous ne dînâmes pas non plus sur le tchiamkerr étendu à l'entrée de nos demeures. Après une courte inspection sur la solidité de celles-ci et une enquête sur leur imperméabilité, nous enfilâmes nos sacs-lits et nous attendîmes que le Dieu du sommeil mît un terme à notre surexcitation.
