Project Gutenberg's Physiologie du goût, by Jean Anthelme Brillat-Savarin
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Physiologie du goût
Author: Jean Anthelme Brillat-Savarin
Release Date: September 23, 2007 [EBook #22741]
Language: French
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PHYSIOLOGIE DU GOÛT ***
Produced by Mireille Harmelin, Rénald Lévesque and the
Online Distributed Proofreaders Europe at
http://dp.rastko.net. This file was produced from images
generously made available by the Bibliothèque nationale
de France (BnF/Gallica)


PHYSIOLOGIE
DU GOÛT
OU
MÉDITATIONS DE GASTRONOMIE TRANSCENDANTE.
OUVRAGE THÉORIQUE, HISTORIQUE ET À L'ORDRE DU JOUR
Dédié aux Gastronomes parisiens.

![]()
Il est une chose dont on ne se défie pas assez,--c'est la grosse morale, la morale des livres et des prédicateurs; cette morale qui met la vertu si haut qu'on se console facilement de n'y point atteindre, et en disant d'elle ce qu'un philosophe ancien disait du vice: Non licet omnibus adire Corinthum. Aussi la plupart se contentent d'une imitation de cette vertu trop ardue,--et cette morale rébarbative ne produit le plus souvent que des hypocrites.
Un homme qui vendrait des casques, des cuirasses et des épées à la taille des héros d'Homère, casques à peine remplis par une citrouille; cuirasses dont on ne toucherait pas les bords et qui seraient comme de petites chambres; épées qu'on ne pourrait soulever,--vendrait sans aucun doute fort peu de ces armes, fussent-elles fournies par Vulcain et ciselées sur les propres dessins de Minerve.
Le boulanger vous donnera pour quelques pièces de cuivre, ayant cours, le pain qu'il vous refusera pour des médailles d'or à l'effigie de Titus.--Il ne faut commander aux hommes qu'un labeur humain; il faut que la vraie morale admette les passions et les faiblesses;--elle doit les émonder, les diriger,--mais elle ne les arrachera qu'en détruisant l'arbre.
Puisque les ruisseaux existent, il ne faut pas fermer les égouts.
Certes, je n'ignore pas qu'on réserve toute son indulgence pour les passions qu'on a et qu'on n'en réserve pas pour les passions d'autrui;--je n'avais jamais parlé sans mépris de la gourmandise, jusqu'au moment où j'ai lu la Physiologie du Goût de Brillat Savarin; j'avais vu dans la gourmandise la plus brutale, la plus égoïste, la plus bête des passions; la lecture de Brillat Savarin m'a rendu honteux de ne pas être gourmand. En effet, quand on a vu tant d'esprit, de finesse, de gaîté, de philosophie chez un gourmand de profession, on regrette de ne pas avoir reçu de la nature les facultés nécessaires pour sentir et apprécier les plaisirs de la table;--on s'estime affligé d'une infirmité et de la privation d'un sens;--on se met au rang,--sinon des sourds et des aveugles, au moins de ceux qui ont l'oreille dure et la vue basse, et on envisage l'orgueil qu'on a manifesté de ne pas être gourmand, comme on envisage la sotte vanité des gens qui sont fiers d'avoir des lunettes d'or, et qui toisent avec dédain ceux qui n'ont pas de lunettes.
N'avons-nous pas tous nos gourmandises?--Est-ce que je n'ai pas la gourmandise des couleurs et celle des parfums;--est-ce que je ne m'enivre pas de chèvrefeuille;--est-ce que je ne m'exalte pas à la vue des splendeurs du soleil couchant;--est-ce que la musique me laisse toute la froideur de la raison;--est-ce que sous ces impressions enivrantes,--semblable aux ivrognes qui trouvent les rues trop étroites,--il ne m'arrive pas de trouver trop étroites les voies humaines, les routes du possible, les chemins de la réalité?
Je sais bien que la passion de la gourmandise a été parfois poussée un peu loin;--mais quelle passion n'a pas ses excès?--Certes, l'empereur qui engraissait ses poissons avec de la chair d'esclaves qu'on jetait coupés en morceaux dans ses viviers, semblera toujours avoir dépassé les bornes permises des plaisirs de la table; mais les gourmets romains qui reconnaissaient au goût les poissons pris à l'embouchure du Tibre de ceux pris entre deux ponts, et ne mangeaient pas les premiers. Ceux qui rejetaient le foie d'une oie nourrie de figues sèches et n'admettaient que le foie de l'oie nourrie de figues fraîches, n'avaient rien de dangereux ni de rebutant; leur goût exercé ressemblait à l'oreille d'Habeneck qui, dans un concert de deux cents instruments, rappelle à l'ordre une contre-basse qui appuie sur la corde avec l'index au lieu de se servir du pouce.
Et sans aller chercher dans les plaisirs des autres sens des analogies plus ou moins justes,--n'avons-nous pas tous nos jouissances gastronomiques à nous rappeler.--Puis-je, moi, me rappeler de sang-froid tous ces gigots à l'ail sur des haricots baignés dans le jus, que, pendant tant d'années, j'ai mangés une fois par semaine avec un ami que j'avais inventé et que je croyais avoir?--Est-ce que je puis, sans émotion, me souvenir de ces excellents dîners de navets crus pris dans les champs, avant d'aller le soir consacrer le prix d'un dîner plus luxueux au billet qui me permettait d'entrer dans un théâtre où je rencontrais de loin un regard qui a si longtemps fait ma force et ma vie.
Et qui donnera aux ananas, mangés dans des assiettes de Chine, la saveur qu'avaient les mûres des haies, quand j'avais dix-huit ans.
Est-ce que nos pauvres pêcheurs des côtes de Normandie ne se réjouissent pas à l'avance de manger un homard ou des crevettes cuits dans l'eau de la mer, quand ils peuvent éviter les regards de la douane;--car le fisc défend de puiser de l'eau à la mer, et l'Océan est gardé par toute une armée d'hommes vêtus de vert qui vous ferait rejeter à la mer une cruche d'eau que vous auriez subrepticement puisée:--cela épargnerait aux pauvres gens d'acheter du sel, et le sel est un impôt.
Le naturel dans les livres a un charme qui consiste en ceci qu'on croyait lire un livre et qu'on cause avec un homme.--Le livre de Brillat Savarin joint, au naturel le plus exquis, la verve la plus soutenue, l'esprit le plus franc, l'atticisme le plus pur.--C'est un modèle de style simple sans vulgarité.
La gourmandise n'est pas la goinfrerie.
Brillat Savarin fait entrer l'esprit, la bonne humeur et le bon goût dans les assaisonnements d'un bon dîner.
L'esprit qui n'est ou doit n'être que «la raison ornée et armée» est peu considéré en France,--parce qu'on prend pour de l'esprit certains exercices de mots pareils à ceux que font les jongleurs avec des boules.
De même les goinfres et les ivrognes se sont réclamée indûment d'Anacréon, d'Epicure; et se sont placés sous leur invocation sans les consulter. Anacréon, dans ses vers, recommande très souvent de mettre de l'eau dans le vin,--et Epicure voulait de là noblesse dans le plaisir, et mettait le plaisir dans la vertu.
Le vrai disciple d'Epicure compte, pour le meilleur plat de son dîner,--le pain qu'il a envoyé à son voisin pauvre.--Tel autre vous dira avec les Allemands,--en vous invitant à dîner: «Un seul plat et un visage ami.»
Brillat Savarin dit: «Ceux qui s'indigèrent ou qui s'enivrent ne savent ni boire ni manger.»
Je ne sais ce qu'il aurait dit des banquets politiques qui ne faisaient que poindre de son temps,--festins où chacun sert un plat de sa façon, au moyen de phrases sonores parce qu'elles sont creuses,--et où on s'occupe du gouvernement du pays à la fin du dîner,--c'est-à-dire dans une situation de corps et d'esprit où aucun de ces législateurs en goguette ne se permettrait de traiter la moins importante de ses petites affaires particulières.
Certes, ce n'est pas mourir que de laisser après soi sa pensée vivante au milieu des hommes, pensée qui a plus de force, et dont la puissance n'est plus contestée depuis qu'elle n'excite plus l'envie contre l'homme qui en était le dépositaire.
Tandis que les riches et les puissants se disputent quelques honneurs matériels et quelques avantages grossiers, ne sont-ce pas lès vrais maîtres du monde que ceux qui gouvernent encore par leurs livres les idées des peuples et là pensée humaine?
Entre ces illustres morts,--devenus des rois immortels,--le souvenir fait de singulières différences,--c'est la puissance de leur pensée qui assigne leur rang dans votre vénération; mais il en est quelques-uns dont on veut savoir la vie, sur lesquels on recherche précieusement et on recueille avec avidité les moindres détails,--pour les autres nous nous contentons de lire leurs écrits et de les admirer, tandis que les premiers sont nos amis.--On peut prendre pour type de ces deux impressions Voltaire et J.-J. Rousseau. On aime les fleurs qu'aimait Rousseau, et son souvenir donne une teinte toute particulière au paysage des lieux qu'il a habités.--Voltaire est tout dans ses livres et on ne le cherche pas ailleurs.
M. Brillat Savarin était un esprit charmant,--mais je ne pense pas qu'on tienne à savoir quelle était au juste la couleur de ses cheveux.--On ne se demande pas s'il a été amoureux.--Nous serons donc sobres de détails biographiques.--Anthelme Brillat Savarin--naquit à Belley, au pied des Alpes, le 1er avril 1755.--Il était avocat, lorsqu'en 1789 il fut député à l'Assemblée constituante.
Maire de Belley en 1793, il fut obligé de se réfugier en Suisse pour échapper à la tourmente révolutionnaire.
Proscrit pendant quatre ans, tant en Suisse qu'aux Etats-Unis,--professeur de langue française,--musicien à l'orchestre du théâtre de New-York.--s'il dut son existence matérielle à ses talents,--il dut la sérénité et le bonheur à sa douce philosophie.
Rentré en France en septembre 1796 il occupa diverses fonctions,--jusqu'à ce que le choix du sénat l'appelât à la cour de cassation où il a passé les vingt-cinq dernières années de sa vie, qui fut jusqu'à la fin douce et calme, entourée d'estime et d'unitées. Il était enrhumé lorsqu'il fut nommé membre de la députation chargée de représenter la cour de cassation à la cérémonie funèbre du 21 janvier dans l'église de Saint-Denis;--il y fut atteint d'une péripneumonie qui emporta en même temps que lui M. Robert de Saint-Vincent et l'avocat-général Marchangy.--Il mourut le 2 février 1826--à l'âge de 71 ans.
Alph. KARR.

APHORISMES
DU PROFESSEUR
POUR SERVIR DE PROLÉGOMÈNES A SON OUVRAGE ET DE
BASE ÉTERNELLE A LA SCIENCE;
I.
L'univers n'est rien que par la vie, et tout ce qui vit se nourrit.
II.
Lès animaux se repaissent; l'homme mange; l'homme d'esprit seul sait manger.
III.
La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent.
IV.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es.
V.
Le Créateur, en obligeant l'homme à manger pour vivre, l'y invite par l'appétit, et l'en récompense par le plaisir.
VI.
La gourmandise est un acte de notre jugement, par lequel nous accordons la préférence aux choses qui sont agréables au goût sur celles qui n'ont pas cette qualité.
VII.
Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours; il peut s'associer à tous les autres plaisirs, et reste le dernier pour nous consoler de leur perte.
VIII.
La table est le seul endroit où l'on ne s'ennuie jamais pendant la première heure.
IX.
La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile.
X.
Ceux qui s'indigèrent ou qui s'enivrent ne savent ni boire ni manger.
XI.
L'ordre des comestibles est des plus substantiels aux plus légers.
XII.
L'ordre des boissons est des plus tempérées aux plus fumeuses et aux plus parfumées.
XIII.
Prétendre qu'il ne faut pas changer de vins est une hérésie; la langue se sature; et après le troisième verre, le meilleur vin n'éveille plus qu'une sensation obtuse.
XIV.
Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un oeil.
XV.
On devient cuisinier, mais on naît rôtisseur.
XVI.
La qualité la plus indispensable du cuisinier est l'exactitude: elle doit être aussi celle du convié.
XVII.
Attendre trop longtemps un convive retardataire est un manque d'égards pour tous ceux qui sont présents.
XVIII.
Celui qui reçoit ses amis et ne donne aucun soin personnel au repas qui leur est préparé, n'est pas digne d'avoir des amis.
XIX.
La maîtresse de la maison doit toujours s'assurer que le café est excellent; et le maître, que les liqueurs sont de premier choix.
XX.
Convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit.
![]()
DIALOGUE
ENTRE
L'AUTEUR ET SON AMI.
(APRÈS LES PREMIERS COMPLIMENTS)
L'AMI.--Ce matin nous avons, en déjeunant, ma femme et moi, arrêté dans notre sagesse que vous feriez imprimer au plus tôt vos Méditations gastronomiques.
L'AUTEUR.--Ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà, en sept mots, toute la charte parisienne. Mais je ne suis pas de la paroisse; et un célibataire...
L'AMI.--Mon Dieu! les célibataires sont tout aussi soumis que les autres, et quelquefois à notre grand préjudice. Mais ici le célibat ne peut pas vous sauver; car ma femme prétend qu'elle a le droit d'ordonner, parce que c'est chez elle, à la campagne, que vous avez écrit vos premières pages.
L'AUTEUR.--Tu connais, cher docteur, ma déférence pour les dames; tu as loué plus d'une fois ma soumission à leurs ordres; tu étais aussi de ceux qui disaient que je ferais un excellent mari... Et cependant je ne ferai pas imprimer.
L'AMI.--Et pourquoi?
L'AUTEUR.--Parce que, voué par état à des études sérieuses, je crains que ceux qui ne connaîtront mon livre que par le titre ne croient que je ne m'occupe que de fariboles.
L'AMI.--Terreur panique! Trente-six ans de travaux publics et continus ne sont-ils pas là pour vous établir une réputation contraire? D'ailleurs, ma femme et moi nous croyons que tout le monde voudra vous lire.
L'AUTEUR.--Vraiment?
L'AMI.--Les savants vous liront pour deviner et apprendre ce que vous n'avez fait qu'indiquer.
L'AUTEUR.--Cela pourrait bien être.
L'AMI.--Les femmes vous liront, parce qu'elles verront bien que...
L'AUTEUR.--Cher ami, je suis vieux, je suis tombé dans la sagesse: Miserere mei.
L'AMI.--Les gourmands vous liront, parce que vous leur rendez justice et que vous leur assignez enfin le rang qui leur convient dans la société.
L'AUTEUR.--Pour cette fois, tu dis vrai: il est inconcevable qu'ils aient été si longtemps méconnus, ces chers gourmands! j'ai pour eux des entrailles de père; ils sont si gentils! ils ont les yeux si brillants!
L'AMI.--D'ailleurs, ne nous avez-vous pas dit souvent que votre ouvrage manquait à nos bibliothèques?
L'AUTEUR.--Je l'ai dit, le fait est vrai, et je me ferais étrangler plutôt que d'en démordre.
L'AMI.--Mais vous parlez en homme tout-à-fait persuadé, et vous allez venir avec moi chez...
L'AUTEUR.--Oh! que non! si le métier d'auteur a ses douceurs, il a aussi bien ses épines, et je lègue tout cela à mes héritiers.
L'AMI.--Mais vous déshéritez vos amis, vos connaissances, vos contemporains. En aurez-vous bien le courage?
L'AUTEUR.--Mes héritiers! mes héritiers! j'ai ouï dire que les ombres sont régulièrement flattées des louanges des vivants; et c'est une espèce de béatitude que je veux me réserver pour l'autre monde.
L'AMI.--Mais êtes-vous bien sûr que ces louanges iront à leur adresse? Êtes-vous également assuré de l'exactitude de vos héritiers?
L'AUTEUR.--Mais je n'ai aucune raison de croire qu'ils pourraient négliger un devoir en faveur duquel je les dispenserais de bien d'autres.
L'AMI.--Auront-ils, pourront-ils avoir pour votre production cet amour de père, cette attention d'auteur, sans lesquels un ouvrage se présente toujours au public avec un certain air gauche?
L'AUTEUR.--Mon manuscrit sera corrigé, mis au net, armé de toutes pièces; il n'y aura plus qu'à imprimer.
L'AMI--Et le chapitre des événements? Hélas! de pareilles circonstances ont occasionné la perte de bien des ouvrages précieux, et entre autres de celui du fameux Lecat, sur l'état de l'âme pendant le sommeil, travail de toute sa vie.
L'AUTEUR.--Ce fut sans doute une grande perte, et je suis bien loin d'aspirer à de pareils regrets.
L'AMI.--Croyez que des héritiers ont bien assez d'affaires pour compter avec l'église, avec la justice, avec la faculté, avec eux-mêmes, et qu'il leur manquera, sinon la volonté, du moins le temps de se livrer aux divers soins qui précèdent, accompagnent et suivent la publication d'un livre, quelque peu volumineux qu'il soit.
L'AUTEUR.--Mais le titre! mais le sujet! mais les mauvais plaisants!
L'AMI.--Le seul mot gastronomie fait dresser toujours les oreilles; le sujet est à la mode, et les mauvais plaisants sont aussi gourmands que les autres. Ainsi voilà de quoi vous tranquilliser: d'ailleurs, pouvez-vous ignorer que les graves personnages ont quelquefois fait des ouvrages légers? Le président de Montesquieu, par exemple 1.
Note 1:(retour) M. de Montucla, connu par une très bonne Histoire des Mathématiques, avait fait un Dictionnaire de géographie gourmande; il m'en a montré des fragments pendant mon séjour à Versailles. On assure que M. Berryat-Saint-Prix, qui professe avec distinction la science de la procédure, a fait un roman en plusieurs volumes.
L'AUTEUR, vivement.--C'est ma foi vrai! il a fait le Temple de Gnide, et on pourrait soutenir qu'il y a plus de véritable utilité à méditer sur ce qui est à la fois le besoin, le plaisir et l'occupation de tous les jours, qu'à nous apprendre ce que faisaient ou disaient, il y a plus de deux mille ans, une paire de morveux dont l'un poursuivait, dans les bosquets de la Grèce, l'autre qui n'avait guère envie de s'enfuir.
L'AMI.--Vous vous rendez donc enfin?
L'AUTEUR.--Moi! pas du tout; c'est seulement le bout d'oreille d'auteur qui a paru, et ceci rappelle à ma mémoire une scène de la haute comédie anglaise, qui m'a fort amusé; elle se trouve, je crois, dans la pièce intitulée The natural Daughter (la Fille naturelle). Tu vas en juger 2.
Note 2:(retour) Le lecteur a dû s'apercevoir que mon ami se laisse tutoyer sans réciprocité. C'est que mon âge est au sien comme d'un père à son fils, et que, quoique devenu un homme considérable à tous égards, il serait désolé si je changeais de nombre.
Il s'agit de quakers, et tu sais que ceux qui sont attachés à cette secte tutoient tout le monde, sont vêtus simplement, ne vont point à la guerre, ne font jamais de serment, agissent avec flegme, et surtout ne doivent jamais se mettre en colère.
Or, le héros de la pièce est un jeune et beau quaker, qui paraît sur la scène avec un habit brun, un grand chapeau rabattu et des cheveux plats; ce qui ne l'empêche pas d'être amoureux.
Un fat, qui se trouve son rival, enhardi par cet extérieur et par les dispositions qu'il lui suppose, le raille, le persifle et l'outrage; de manière que le jeune homme, s'échauffant peu à peu, devient furieux, et rosse de main de maître l'impertinent qui le provoque.
L'exécution faite, il reprend subitement son premier maintien, se recueille, et dit d'un ton affligé: «Hélas! je crois que la chair l'a emporté sur l'esprit.»
J'agis de même, et après un mouvement bien pardonnable, je reviens à mon premier avis.
L'AMI.--Cela n'est plus possible: vous avez, de votre aveu, montré le bout de l'oreille; il y a de la prise, et je vous mène chez le libraire. Je vous dirai même qu'il en est plus d'un qui ont éventé votre secret.
L'AUTEUR.--Ne t'y hasarde pas, car je parlerai de toi; et qui sait ce que j'en dirai?
L'AMI.--Que pourrez-vous en dire? Ne croyez pas m'intimider.
L'AUTEUR.--Je ne dirai pas que notre commune patrie 3 se glorifie de t'avoir donné la naissance; qu'à vingt-quatre ans tu avais déjà fait paraître un ouvrage élémentaire, qui depuis lors est demeuré classique; qu'une réputation méritée t'attire la confiance; que ton extérieur rassure les malades; que ta dextérité les étonne; que ta sensibilité les console: tout le monde sait cela. Mais je révélerai à tout Paris (me redressant), à toute la France (me rengorgeant), à l'univers entier, le seul défaut que je te connaisse.
L'AMI, d'un ton sérieux.--Et lequel, s'il vous plaît?
L'AUTEUR.--Un défaut habituel dont toutes mes exhortations n'ont pu te corriger.
L'AMI, effrayé.--Dites donc enfin; c'est trop me tenir à la torture.
L'AUTEUR.--Tu manges trop vite 4.
(Ici, l'ami prend son chapeau, et sort en souriant, se doutant bien qu'il a prêché un converti).
Note 3:(retour) Belley, capitale du Bugey, pays charmant où l'on trouve de hautes montagnes, des collines, des fleuves, des ruisseaux limpides, des cascades, des abîmes, vrai jardin anglais de cent lieues carrées, et où, avant la révolution, le tiers-état avait, par la constitution du pays, le veto sur les deux autres ordres.
Note 4:(retour) Historique.
![]()
BIOGRAPHIE
 E docteur que j'ai introduit dans le dialogue
qui précède n'est point un être fantastique comme les Chloris
d'autrefois, mais un docteur bel et bien vivant; et tous ceux qui
me connaissent auront bientôt deviné le docteur Richerand.
E docteur que j'ai introduit dans le dialogue
qui précède n'est point un être fantastique comme les Chloris
d'autrefois, mais un docteur bel et bien vivant; et tous ceux qui
me connaissent auront bientôt deviné le docteur Richerand.
En m'occupant de lui, j'ai remonté jusqu'à ceux qui l'ont précédé, et je me suis aperçu avec orgueil que l'arrondissement de Belley, au département de l'Ain, ma patrie, était depuis longtemps en possession de donner à la capitale du monde des médecins de haute distinction; et je n'ai pas résisté à la tentation de leur élever un modeste monument dans une courte notice.
Dans les jours de la Régence, les docteurs Genin et Civoct furent des praticiens de première classe, et firent refluer dans leur patrie une fortune honorablement acquise. Le premier était tout-à-fait hippocratique, et procédait en forme: le second, qui soignait beaucoup de belles dames, était plus doux; plus accommodant: Res novas molientem, eût dit Tacite.
Vers 1750, le docteur la Chapelle se distingua dans la carrière périlleuse de la médecine militaire. On a de lui quelques bons ouvrages, et on lui doit l'importation du traitement des fluxions de poitrine par le beurre frais, méthode qui guérit comme par enchantement, quand on s'en sert dans les premières trente-six heures de l'invasion.
Vers 1760, le docteur Dubois obtenait les plus grands succès dans le traitement des vapeurs, maladie pour lors à la mode, et tout aussi fréquenté que les maux de nerfs qui l'ont remplacée. La vogue qu'il obtint était d'autant plus remarquable, qu'il était loin d'être beau garçon.
Malheureusement il arriva trop tôt à une fortune indépendante, se laissa couler dans les bras de la paresse, et se contenta d'être convive aimable et conteur tout-à-fait amusant. Il était d'une constitution robuste, et a vécu plus de quatre-vingt-huit ans, malgré les dîners ou plutôt grâce aux dîners de l'ancien et du nouveau régime 5.
Note 5:(retour) Je souriais en écrivant cet article: il rappelait à mon souvenir un grand seigneur académicien, dont Fontenelle était chargé de faire l'éloge. Le défunt ne savait autre chose que bien jouer à tous les jeux; et là-dessus, le secrétaire perpétuel eut le talent d'asseoir un panégyrique très bien tourné et de longueur convenable. (Voyez au surplus la Méditation sur le plaisir de la table, où le docteur est en action.)
Sur la fin du règne de Louis XV, le docteur Coste, natif de Châtillon, vint à Paris; il était porteur d'une lettre de Voltaire pour M. le duc de Choiseul, dont il eut le bonheur de gagner la bienveillance dès les premières visites. Protégé par ce seigneur et par la duchesse de Grammont sa soeur, le jeune Coste perça vite, et, après peu d'années, Paris commença à le compter parmi les médecins de grande espérance.
La même protection qui l'avait produit l'arracha à cette carrière tranquille et fructueuse, pour le mettre à la tête du service de santé de l'armée que la France envoyait en Amérique au secours des États-Unis, qui combattaient pour leur indépendance.
Après avoir rempli sa mission, le docteur Coste revint en France, passa à peu près inaperçu le mauvais temps de 1793, et fut élu maire à Versailles, où l'on se souvient encore de son administration à la fois active, douce et paternelle.
Bientôt le Directoire le rappela à l'administration de la médecine militaire, Bonaparte le nomma l'un des trois inspecteurs généraux du service de la médecine des armées; et le docteur y fut constamment l'ami, le protecteur et le père des jeunes gens qui se destinaient à cette carrière. Enfin il fut nommé médecin de l'hôtel royal des Invalides, et en a rempli les fonctions jusqu'à sa mort.
D'aussi longs services ne pouvaient rester sans récompense sous le gouvernement des Bourbons, et Louis XVIII fit un acte de toute justice en accordant à M. Coste le cordon de Saint-Michel.
Le docteur Coste est mort il y a quelques années, en laissant une mémoire vénérée, une fortune tout-à-fait philosophique, et une fille unique, épouse de M. de Lalot, qui s'est distingué à la chambre des députés par une éloquence vive et profonde, et qui ne l'a pas empêché de sombrer sous voiles.
Un jour que nous avions dîné chez M. Favre, le curé de Saint-Laurent, notre compatriote, le docteur Coste me raconta la vive querelle qu'il avait eue, ce jour même, avec le comte de Cessac, alors le ministre directeur de l'administration de la guerre, au sujet d'une économie que celui-ci voulait proposer pour faire sa cour à Napoléon.
Cette économie consistait à retrancher aux soldats malades la moitié de leur portion d'eau panée, et à faire laver la charpie qu'on ôtait de dessus les plaies, pour la faire servir une seconde ou une troisième fois.
Le docteur s'était élevé avec violence contre des mesures qu'il qualifiait d'abominables, et il était encore si plein de son sujet, qu'il se remit en colère, comme si l'objet de son courroux eût encore été présent.
Je n'ai jamais pu savoir si le comte avait été réellement converti et avait laissé son économie en portefeuille; mais ce qu'il y a de certain, c'est que les soldats malades purent toujours boire à volonté, et qu'on continua à jeter toute charpie qui avait servi.
Vers 1780, le docteur Bordier, né dans les environs d'Amberieux, vint exercer la médecine à Paris. Sa pratique était douce, son système expectant et son diagnostic sûr.
Il fut nommé professeur en la Faculté de médecine; son style était simple, mais ses leçons étaient paternelles et fructueuses. Les honneurs vinrent le chercher quand il n'y pensait pas, et il fut nommé médecin de l'impératrice Marie-Louise. Mais il ne jouit pas longtemps de cette place: l'Empire s'écroula, et le docteur lui-même fut emporté par suite d'un mal de jambe contre lequel il avait lutté toute sa vie.
Le docteur Bordier était d'une humeur tranquille, d'un caractère bienfaisant et d'un commerce sûr.
Vers la fin du dix-huitième siècle parut le docteur Bichat... Bichat, dont tous les écrits portent l'empreinte du génie, qui usa sa vie dans des travaux faits pour avancer la science, qui réunissait l'élan de l'enthousiasme à la patience des esprits bornés, et qui, mort à trente ans, a mérité que des honneurs publics fussent décernés à sa mémoire.
Plus tard, le docteur Montègre porta dans la clinique un esprit philosophique. Il rédigea avec savoir la Gazette de santé, et mourut à quarante ans, dans nos îles, où il était allé afin de compléter les traités qu'il projetait sur la fièvre jaune et le vomito negro.
Dans le moment actuel, le docteur Richerand est placé sur les plus hauts degrés de la médecine opératoire, et ses Éléments de physiologie ont été traduits dans toutes les langues. Nommé de bonne heure professeur en la faculté de Paris, il est investi de la plus auguste confiance. On n'a pas la parole plus consolante, la main plus douce, ni l'acier plus rapide.
Le docteur Recamier 6, professeur en la même faculté, siége à côté de son compatriote...
Note 6:(retour) Filleul de l'auteur; c'est lui qui l'a soigné pendant sa dernière et courte maladie.
Le présent ainsi assuré, l'avenir se prépare; et sous les ailes de ces puissants professeurs s'élèvent des jeunes gens du même pays, qui promettent de suivre d'aussi honorables exemples.
Déjà les docteurs Janin et Manjot brûlent le pavé de Paris. Le docteur Manjot (rue du Bac, nº 39) s'adonne principalement aux maladies des enfants; ses inspirations sont heureuses, il doit bientôt en faire part au public.
J'espère que tout lecteur bien né pardonnera cette digression à un vieillard, à qui trente-cinq ans de séjour à Paris n'ont fait oublier ni son pays ni ses compatriotes. Il m'en coûte déjà assez de passer sous silence tant de médecins dont la mémoire subsiste vénérée dans le pays qui les vit naître, et qui, pour n'avoir pas eu l'avantage de briller sur le grand théâtre, n'ont eu ni moins de science ni moins de mérite.
![]()
PRÉFACE.
Pour offrir au public l'ouvrage que je livre à sa bienveillance, je ne me suis pas imposé un grand travail, je n'ai fait que mettre en ordre des matériaux rassemblés depuis longtemps; c'est une occupation amusante, que j'avais réservée pour ma vieillesse.
En considérant le plaisir de la table sous tous ses rapports, j'ai vu de bonne heure qu'il y avait là-dessus quelque chose de mieux à faire que des livres de cuisine, et qu'il y avait beaucoup à dire sur des fonctions si essentielles, si continues, et qui influent d'une manière si directe sur la santé, sur le bonheur, et même sur les affaires.
Cette idée-mère une fois arrêtée, tout le reste a coulé de source: j'ai regardé autour de moi, j'ai pris des notes, et souvent, au milieu des festins les plus somptueux, le plaisir d'observer m'a sauvé des ennuis du conviviat.
Ce n'est pas que, pour remplir la tâche que je me suis proposée, il n'ait fallu être physicien, chimiste, physiologue, et même un peu érudit. Mais, ces études, je les avais faites sans la moindre prétention à être auteur; j'étais poussé par une curiosité louable, par la crainte de rester en arrière de mon siècle, et par le désir de pouvoir causer, sans désavantage, avec les savants, avec qui j'ai toujours aimé à me trouver. 7
Note 7:(retour) «Venez dîner avec moi jeudi prochain, me dit un jour M. Greffuble, je vous ferai trouver avec des savants ou avec des gens de lettres, choisissez.--Mon choix est fait, répondis-je; nous dînerons deux fois.» Ce qui eut effectivement lieu, et le repas des gens de lettres était notablement plus délicat et plus soigné.(Voyez la Méditation X.)
Je suis surtout médecin-amateur; c'est chez moi presque une manie, et je compte parmi mes plus beaux jours celui où, entré par la porte des professeurs et avec eux à la thèse de concours du docteur Cloquet, j'eus le plaisir d'entendre un murmure de curiosité parcourir l'amphithéâtre, chaque élève demandant à son voisin quel pouvait être le puissant professeur étranger qui honorait l'assemblée par sa présence.
Il est cependant un autre jour dont le souvenir m'est, je crois, aussi cher: c'est celui où je présentai au conseil d'administration de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, mon irrorateur, instrument de mon invention, qui n'est autre chose que la fontaine de compression appropriée à parfumer les appartements.
J'avais apporté dans ma poche ma machine bien chargée; je tournai le robinet, et il s'en échappa, avec sifflement, une vapeur odorante qui, s'élevant jusqu'au plafond, retombait en gouttelettes sur les personnes et sur les papiers.
C'est alors que je vis avec un plaisir inexprimable les têtes les plus savantes de la capitale se courber sous mon irroration, et je me pâmais d'aise en remarquant que les plus mouillés étaient aussi les plus heureux.
En songeant quelquefois aux graves élucubrations auxquelles la latitude de mon sujet m'a entraîné, j'ai eu sincèrement la crainte d'avoir pu ennuyer; car, moi aussi, j'ai quelquefois bâillé sur les ouvrages d'autrui.
J'ai fait tout ce qui a été en mon pouvoir pour échapper à ce reproche; je n'ai fait qu'effleurer tous les sujets qui ont pu s'y prêter: j'ai semé mon ouvrage d'anecdotes, dont quelques-unes me sont personnelles; j'ai laissé à l'écart un grand nombre de faits extraordinaires et singuliers, qu'une saine critique doit faire rejeter; j'ai réveillé l'attention en rendant claires et populaires certaines connaissances que les savants semblaient s'être réservées. Si, malgré tant d'efforts, je n'ai pas présenté à mes lecteurs de la science facile à digérer, je n'en dormirai pas moins sur les deux oreilles, bien certain que la majorité m'absoudra sur l'intention.
On pourrait bien me reprocher encore que je laisse quelquefois trop courir ma plume, et que, quand je conte, je tombe un peu dans la garrulité. Est-ce ma faute à moi si je suis vieux? Est-ce ma faute si je suis comme Ulysse, qui avait vu les moeurs et les villes de beaucoup de peuples? Suis-je donc blâmable de faire un peu de ma biographie? Enfin il faut que le lecteur me tienne compte de ce que je lui fais grâce de mes Mémoires politiques, qu'il faudrait bien qu'il lût comme tant d'autres, puisque, depuis trente-six ans, je suis aux premières loges pour voir passer les hommes et les événements.
Surtout qu'on se garde bien de me ranger parmi les compilateurs: si j'en avais été réduit là, ma plume se serait reposée, et je n'en aurais pas vécu moins heureux.
J'ai dit, comme Juvénal:
Semper ego auditor tantum! nunquamne reponam!
et ceux qui s'y connaissent verront facilement qu'également accoutume au tumulte de la société et au silence du cabinet, j'ai bien fait de tirer partie de l'une et de l'autre de ces positions.
Enfin, j'ai fait beaucoup pour ma satisfaction particulière; j'ai nommé plusieurs de mes amis qui ne s'y attendaient guère, j'ai rappelé quelques souvenirs aimables, j'en ai fixé d'autres qui allaient m'échapper; et, comme on dit dans le style familier, j'ai pris mon café.
Peut-être bien qu'un seul lecteur, dans la catégorie des allongés, s'écriera: «J'avais bien besoin de savoir si... A quoi pense-t-il, en disant que... etc., etc.?» Mais je suis sûr que tous les autres lui imposeront silence, et qu'une majorité imposante accueillera avec bonté ces effusions d'un sentiment louable.
Il me reste quelque chose à dire sur mon style, car le style est tout l'homme, dit Buffon.
Et qu'on ne croie pas que je vienne demander une grâce qu'on n'accorde jamais à ceux qui en ont besoin: il ne s'agit que d'une simple explication.
Je devrais écrire à merveille, car Voltaire, Jean-Jacques, Fénélon, Buffon, et plus tard Cochin et d'Aguesseau, ont été mes auteurs favoris, je les sais par coeur.
Mais peut-être les dieux en ont-ils ordonné autrement; et s'il est ainsi, voici la cause de la volonté des dieux.
Je connais, plus ou moins bien, cinq langues vivantes, ce qui m'a fait un répertoire immense de mots de toutes livrées.
Quand j'ai besoin d'une expression, et que je ne la trouve pas dans la case française, je prends dans la case voisine, et de là, pour le lecteur, la nécessité de me traduire ou de me deviner: c'est son destin.
Je pourrais bien faire autrement, mais j'en suis empêché par un esprit de système auquel je tiens d'une manière invincible.
Je sais intimement persuadé que la langue française, dont je me sers, est comparativement pauvre. Que faire en cet état? Emprunter ou voler. Je fais l'un et l'autre, parce que ces emprunts ne sont pas sujets à restitution, et que le vol de mots n'est pas puni par le Code pénal.
On aura une idée de mon audace, quand on saura que j'appelle volante (de l'espagnol) tout homme que j'envoie faire une commission, et que j'étais déterminé à franciser le verbe anglais to sip, qui signifie boire à petites reprises, si je n'avais exhumé le mot français siroter, auquel on donnait à peu près la même signification.
Je m'attends bien que les sévères vont crier à Bossuet, à Fénélon, à Racine, à Boileau, à Pascal, et autres du siècle de Louis XIV; il me semble les entendre faire un vacarme épouvantable.
A quoi je réponds posément que je suis loin de disconvenir du mérite de ces auteurs, tant nommés que sous-entendus; mais que suit-il de là?... Rien, si ce n'est qu'ayant bien fait avec un instrument ingrat, ils auraient incomparablement mieux fait avec un instrument supérieur. C'est ainsi qu'on doit croire que Tartini aurait encore bien mieux joué du violon, si son archet avait été aussi long que celui de Baillot.
Je suis donc du parti des néologues, et même des romantiques; ces derniers découvrent les trésors cachés; les autres sont comme les navigateurs qui vont chercher au loin les provisions dont on a besoin.
Les peuples du Nord, et surtout les Anglais, ont sur nous, à cet égard, un immense avantage: le génie n'y est jamais gêné par l'expression; il crée ou emprunte. Aussi, dans tous les sujets qui admettent la profondeur et l'énergie, nos traducteurs ne font-ils que des copies pâles et décolorées 8.
Note 8:(retour) L'excellente traduction de lord Byron, par M. Benjamin Laroche, fait exception à cette règle, mais ne la détruit pas. C'est un tour de force qui ne sera pas recommencé.
J'ai autrefois entendu, à l'Institut, un discours fort gracieux sur le danger du néologisme et sur la nécessité de s'en tenir à notre langue telle qu'elle a été fixée par les auteurs du bon siècle.
Comme chimiste, je passai cette oeuvre à la cornue; il n'en resta que ceci: Nous avons si bien fait qu'il n'y a pas moyen de mieux faire, ni de faire autrement.
Or, j'ai vécu assez pour savoir que chaque génération en dit autant, et que la génération suivante ne manque jamais de s'en moquer.
D'ailleurs, comment les mots ne changeraient-ils pas, quand les moeurs et les idées éprouvent des modifications continuelles? Si nous faisons les mêmes choses que les anciens, nous ne les faisons pas de la même manière, et il est des pages entières, dans quelques livres français, qu'on ne pourrait traduire ni en latin ni en grec.
Toutes les langues ont eu leur naissance, leur apogée et leur déclin; et aucune de celles qui ont brillé depuis Sésostris jusqu'à Philippe-Auguste, n'existe plus que dans les monuments. La langue française aura le même sort, et en l'an 2825 on ne me lira qu'à l'aide d'un dictionnaire, si toutefois on me lit...
J'ai eu à ce sujet une discussion à coups de canon avec l'aimable M. Andrieux, de l'Académie française.
Je me présentai en bon ordre, je l'attaquai vigoureusement; et je l'aurais pris, s'il n'avait fait une prompte retraite, à laquelle je ne mis pas trop d'obstacle, m'étant souvenu, heureusement pour lui, qu'il était chargé d'une lettre dans le nouveau lexique.
Je finis par une observation importante; aussi l'ai-je gardé pour la dernière.
Quand j'écris et parle de moi au singulier, cela suppose une confabulation avec le lecteur; il peut examiner, discuter, douter et même rire. Mais quand je m'arme du redoutable nous, je professe; il faut se soumettre.
I am, Sir, oracle,
And, when I open my lips, let no dog bark.
(Shakespeare, Merchant of Venice, act. I, sc. 1.)



![]()
Les sens sont les organes par lesquels l'homme se met en rapport avec les objets extérieurs.
Nombre des Sens.
1.
 N doit en compter au moins six:
N doit en compter au moins six:
La vue, qui embrasse l'espace et nous instruit, par le moyen de la lumière, de l'existence et des couleurs des corps qui nous environnent;
L'ouïe, qui reçoit, par l'intermédiaire de l'air, l'ébranlement causé par les corps bruyants ou sonores;
L'odorat, au moyen duquel nous flairons les odeurs des corps qui en sont doués;
Le goût, par lequel nous apprécions tout ce qui est sapide ou esculent;
Le toucher, dont l'objet est la consistance et la surface des corps;
Enfin le génésique ou amour physique, qui entraîne les sexes l'un vers l'autre, et dont le but est la reproduction de l'espèce.
Il est étonnant que, presque jusqu'à Buffon, un sens si important ait été méconnu, et soit resté confondu ou plutôt annexé au toucher.
Cependant la sensation dont il est le siège n'a rien de commun avec celle du tact; il réside dans un appareil aussi complet que la bouche ou les yeux; et ce qu'il y a de singulier, c'est que chaque sexe ayant tout ce qu'il faut pour éprouver cette sensation, il est néanmoins nécessaire que les deux se réunissent pour atteindre au but que la nature s'est proposé. Et si le goût, qui a pour but la conservation de l'individu, est incontestablement un sens, à plus forte raison doit-on accorder ce titre aux organes destinés à la conservation de l'espèce.
Donnons donc au génésique la place sensuelle qu'on ne peut lui refuser, et reposons-nous sur nos neveux du soin de lui assigner son rang.
Mise en action des Sens.
 2.--S'il est permis de se porter, par
l'imagination, jusqu'aux premiers moments de l'existence du genre
humain, il est aussi permis de croire que les premières sensations
ont été purement directes, c'est-à-dire qu'on a vu sans précision,
ouï confusément, flairé sans choix, mangé sans savouré, et joui
avec brutalité.
2.--S'il est permis de se porter, par
l'imagination, jusqu'aux premiers moments de l'existence du genre
humain, il est aussi permis de croire que les premières sensations
ont été purement directes, c'est-à-dire qu'on a vu sans précision,
ouï confusément, flairé sans choix, mangé sans savouré, et joui
avec brutalité.
Mais toutes ces sensations ayant pour centre commun l'âme, attribut spécial de l'espèce humaine, et cause toujours active de perfectibilité, elles y ont été réfléchies, comparées, jugées; et bientôt tous les sens ont été amenés au secours les uns des autres, pour l'utilité et le bien-être du moi sensitif, ou, ce qui est la même chose, de l'individu.
Ainsi, le toucher a rectifié les erreurs de la vue; le son, au moyen de la parole articulée, est devenu l'interprète de tous les sentiments; le goût s'est aidé de la vue et de l'odorat; l'ouïe a comparé les sons, apprécié les distances; et le génésique a envahi les organes de tous les autres sens.
Le torrent des siècles, en roulant sur l'espèce humaine, a sans cesse amené de nouveaux perfectionnements, dont la cause, toujours active, quoique presque inaperçue, se trouve dans les réclamations de nos sens, qui, toujours et tour à tour, demandent à être agréablement occupés.
Ainsi, la vue a donné naissance à la peinture, à la sculpture et aux spectacles de toute espèce;
Le son, à la mélodie, à l'harmonie, à la danse et à la musique, avec toutes ses branches et ses moyens d'exécution;
L'odorat, à la recherche, à la culture et à l'emploi des parfums;
Le goût, à la production, au choix et à la préparation de tout ce qui peut servir d'aliment;
Le toucher, à tous les arts, à toutes les adresses, à toutes les industries;
Le génésique, à tout ce qui peut préparer ou embellir la réunion des sexes, et, depuis François Ier, à l'amour romanesque, à la coquetterie et à la mode; à la coquetterie surtout, qui est née en France, qui n'a de nom qu'en français, et dont l'élite des nations vient chaque jour prendre des leçons dans la capitale de l'univers.
Cette proposition, tout étrange qu'elle paraisse, est cependant facile à prouver; car on ne pourrait s'exprimer avec clarté, dans aucune langue ancienne, sur ces trois grands mobiles de la société actuelle.
J'avais fait sur ce sujet un dialogue qui n'aurait pas été sans attraits; mais je l'ai supprimé, pour laisser à mes lecteurs le plaisir de le faire chacun à sa manière: il y a de quoi déployer de l'esprit, et même de l'érudition, pendant toute une soirée.
Nous avons dit plus haut que le génésique avait envahi les organes de tous les autres sens; il n'a pas influé avec moins de puissance sur toutes les sciences; et en y regardant d'un peu plus près, on verra que tout ce qu'elles ont de plus délicat et de plus ingénieux est dû au désir, à l'espoir ou à la reconnaissance, qui se rapportent à la réunion des sexes.
Telle est donc, en bonne réalité, la généalogie des sciences, même les plus abstraites, qu'elles ne sont que le résultat immédiat des efforts continus que nous avons faits pour gratifier nos sens.
Perfectionnement des Sens.
3.
 ES sens, nos favoris, sont cependant loin
d'être parfaits, et je ne m'arrêterai pas à le prouver.
J'observerai seulement que la vue, ce sens si éthéré, et le
toucher, qui est à l'autre bout de l'échelle, ont acquis avec le
temps une puissance additionnelle très remarquable.
ES sens, nos favoris, sont cependant loin
d'être parfaits, et je ne m'arrêterai pas à le prouver.
J'observerai seulement que la vue, ce sens si éthéré, et le
toucher, qui est à l'autre bout de l'échelle, ont acquis avec le
temps une puissance additionnelle très remarquable.
Par le moyen des bésicles, l'oeil échappe, pour ainsi dire, à l'affaiblissement sénile qui opprime la plupart des autres organes.
Le télescope a découvert des astres jusqu'alors inconnus et inaccessibles à tous nos moyens de mensuration; il s'est enfoncé à des distances telles que des corps lumineux et nécessairement immenses ne se présentent à nous que comme des taches nébuleuses et presque imperceptibles.
Le microscope nous a initiés dans la connaissance de la configuration intérieure des corps; il nous a montré une végétation et des plantes dont nous ne soupçonnions pas même l'existence. Enfin, nous avons vu des animaux cent mille fois au-dessous du plus petit qu'on aperçoit à l'oeil nu; ces animalcules se meuvent cependant, se nourrissent et se reproduisent: ce qui suppose des organes d'une ténuité à laquelle l'imagination ne peut pas atteindre.
D'un autre côté, la mécanique a multiplié les forces; l'homme a exécuté tout ce qu'il a pu concevoir, et a remué des fardeaux que la nature avait créés inaccessibles à sa faiblesse.
A l'aide des armes et du levier, l'homme a subjugué toute la nature; il l'a soumise à ses plaisirs, à ses besoins, à ses caprices; il en a bouleversé la surface, et un faible bipède est devenu le roi de la création.
La vue et le toucher, ainsi agrandis dans leur puissance, pourraient appartenir à une espèce bien supérieure à l'homme; ou plutôt l'espèce humaine serait toute autre, si tous les sens avaient été ainsi améliorés.
Il faut remarquer cependant que, si le toucher a acquis uni grand développement comme puissance musculaire, la civilisation n'a presque rien fait pour lui comme organe sensitif; mais il ne faut désespérer de rien, et se ressouvenir que l'espèce humaine est encore bien jeune, et que ce n'est qu'après une longue série de siècles que les sens peuvent agrandir leur domaine.
Par exemple, ce n'est que depuis environ quatre siècles qu'on a découvert l'harmonie, science toute céleste, et qui est au son ce que la peinture est aux couleurs 9.
Note 9:(retour) Nous savons qu'on a soutenu le contraire; mais ce système est sans appui.Si les anciens avaient connu l'harmonie, leurs écrits auraient conservé quelques notions précises à cet égard, au lieu qu'on ne se prévaut que de quelques phrases obscures, qui se prêtent à toutes les inductions.
D'ailleurs, on ne peut suivre la naissance et les progrès de l'harmonie dans les monuments qui nous restent; c'est une obligation que nous avons aux Arabes, qui nous firent présent de l'orgue, qui, faisant entendre à la fois plusieurs sons continus, fit naître la première idée de l'harmonie.
Sans doute les anciens savaient chanter accompagnés d'instruments à l'unisson; mais là se bornaient leurs connaissances; ils ne savaient ni décomposer les sons ni en apprécier les rapports.
Ce n'est que depuis le quinzième siècle qu'on a fixé la tonalisation, réglé la marche des accords, et qu'on s'en est aidé pour soutenir la voix et renforcer l'expression des sentiments.
Cette découverte, si tardive et cependant si naturelle, a dédoublé l'ouïe, elle y a montré deux facultés en quelque sorte indépendantes, dont l'une reçoit les sons et l'autre en apprécie la résonance.
Les docteurs allemands disent que ceux qui sont sensibles à l'harmonie ont un sens de plus que les autres.
Quant à ceux pour qui la musique n'est qu'un amas de sons confus, il est bon de remarquer que presque tous chantent faux; et il faut croire, ou que chez eux l'appareil auditif est fait de manière à ne recevoir que des vibrations courtes et sans ondulations, ou plutôt que les deux oreilles n'étant pas au même diapason, la différence en longueur et en sensibilité de leurs parties constituantes fait qu'elles ne transmettent au cerveau qu'une sensation obscure et indéterminée, comme deux instruments qui ne joueraient ni dans le même ton ni dans la même mesure, et ne feraient entendre aucune mélodie suivie.
Les derniers siècles qui se sont écoulés ont aussi donné à la sphère du goût d'importantes extensions: la découverte du sucre et de ses diverses préparations, les liqueurs alcooliques, les glaces, la vanille, le thé, le café, nous ont transmis des saveurs d'une nature jusqu'alors inconnue.
Qui sait si le toucher n'aura pas son tour, et si quelque hasard heureux ne nous ouvrira pas, de ce côté là, quelque source de jouissances nouvelles? ce qui est d'autant plus probable que la sensibilité tactile existe par tout le corps, et conséquemment peut partout être excitée.
Puissance du Goût.
4.--On a vue que l'amour physique a envahi toutes les sciences: il agit en cela avec cette tyrannie qui le caractérise toujours.
 Le goût, cette faculté plus prudente, plus
mesurée, quoique non moins active; le goût, disons-nous, est
parvenu au même but avec une lenteur qui assure la durée de ses
succès.
Le goût, cette faculté plus prudente, plus
mesurée, quoique non moins active; le goût, disons-nous, est
parvenu au même but avec une lenteur qui assure la durée de ses
succès.
Nous nous occuperons ailleurs à en considérer la marche; mais déjà nous pourrons remarquer que celui qui a assisté à un repas somptueux, dans une salle ornée de glaces, de peintures, de sculptures, de fleurs, embaumée de parfums, enrichie de jolies femmes, remplie des sons d'une douce harmonie; celui-là, disons-nous, n'aura pas besoin d'un grand effort d'esprit pour se convaincre que toutes les sciences ont été mises à contribution pour rehausser et encadrer convenablement les jouissances du goût.
But de l'action des Sens.
5.--Jetons maintenant un coup d'oeil général sur le système de nos sens pris dans leur ensemble, et nous verrons que l'auteur de la création a eu deux buts, dont l'un est la conséquence de l'autre, savoir: la conservation de l'individu et la durée de l'espèce.
Telle est la destinée de l'homme, considéré comme être sensitif: c'est à cette double fin que se rapportent toutes ses actions.
L'oeil aperçoit les objets extérieurs, révèle les merveilles dont l'homme est environné, et lui apprend qu'il fait partie d'un grand tout.
L'ouïe perçoit les sons, non-seulement comme sensation agréable, mais encore comme avertissement du mouvement des corps qui peuvent occasionner quelque danger.
La sensibilité veille pour donner, par le moyen de la douleur, avis de toute lésion immédiate.
La main, ce serviteur fidèle, a non-seulement préparé sa retraite, assuré ses pas, mais encore saisi, de préférence, les objets que l'instinct lui fait croire propres à réparer les pertes causées par l'entretien de la vie.
L'odorat les explore; car les substances délétères sont presque toujours de mauvaise odeur.
Alors le goût se décide, les dents sont mises en action, la langue s'unit au palais pour savourer, et bientôt l'estomac commencera l'assimilation.
Dans cet état, une langueur inconnue se fait sentir, les objets se décolorent, le corps plie, les yeux se ferment; tout disparaît, et les sens sont dans un repos absolu.
A son réveil, l'homme voit que rien n'a changé autour de lui; cependant un feu secret fermente dans son sein, un organe nouveau s'est développé; il sent qu'il a besoin de partager son existence.
Ce sentiment actif, inquiet, impérieux, est commun aux deux sexes; il les rapproche, les unit et quand le germe d'une existence nouvelle est fécondé, les individus peuvent dormir en paix: ils viennent de remplir le plus saint de leurs devoirs en assurant la durée de l'espèce 10.
Tels sont les aperçus généraux et philosophiques que j'ai cru devoir offrir à mes lecteurs, pour les amener naturellement à l'examen plus spécial de l'organe du goût.
Note 10:(retour) M. de Buffon a peint, avec tous les charmes de la plus brillante éloquence, les premiers moments de l'existence d'Ève. Appelé à traiter un sujet presque semblable, nous n'avons prétendu donner qu'un dessin au simple trait; les lecteurs sauront bien y ajouter le coloris.


Définition du Goût.
6.
 E goût est celui de nos sens qui nous met en
relation avec les corps sapides, au moyen de la sensation qu'ils
exercent dans l'organe destiné à les apprécier.
E goût est celui de nos sens qui nous met en
relation avec les corps sapides, au moyen de la sensation qu'ils
exercent dans l'organe destiné à les apprécier.
Le goût, qui a pour excitateurs l'appétit, la faim et la soif, est la base de plusieurs opérations dont le résultat est que l'individu croît, se développe, se conserve et répare les pertes causées par les évaporations vitales.
Les corps organisés ne se nourrissent pas tous de la même manière; l'auteur de la création, également varié dans ses méthodes et sûr dans ses effets, leur a assigné divers modes de conservation.
Les végétaux, qui se trouvent au bas de l'échelle des être vivants, se nourrissent par des racines qui, implantées dans le sol natal, choisissent, par le jeu d'une mécanique particulière, les diverses substances qui ont la propriété de servir à leur croissance et à leur entretien.
En remontant un peu plus haut, on rencontre les corps doués de la vie animale, mais privés de locomotion; ils naissent dans un milieu qui favorise leur existence, et des organes spéciaux en extraient tout ce qui est nécessaire pour soutenir la portion de vie et de durée qui leur a été accordée; ils ne cherchent pas leur nourriture, la nourriture vient les chercher.
Un autre mode a été fixé pour la conservation des animaux qui parcourent l'univers, et dont l'homme est sans contredit le plus parfait. Un instinct particulier l'avertit qu'il a besoin de se repaître; il cherche, il saisit les objets dans lesquels il soupçonne la propriété d'apaiser ses besoins; il mange, se restaure, et parcourt ainsi, dans la vie, la carrière qui lui est assignée.
Le goût peut se considérer sous trois rapports:
Dans l'homme physique, c'est l'appareil au moyen duquel il apprécie les saveurs;
Considéré dans l'homme moral, c'est la sensation qu'excite, au centre commun, l'organe impressionné par un corps savoureux; enfin, considéré dans sa cause matérielle, le goût est la propriété qu'a un corps d'impressionner l'organe et de faire naître la sensation.
Le goût paraît avoir deux usages principaux:
1° Il nous invite, par le plaisir, à réparer les pertes continuelles que nous faisons par l'action de la vie;
2° Il nous aide à choisir, parmi les diverses substances que la nature nous présente, celles qui nous sont propres à nous servir d'aliments.
Dans ce choix, le goût est puissamment aidé par l'odorat, comme nous le verrons plus tard; car on peut établir, comme maxime générale, que les substances nutritives ne sont repoussantes ni au goût ni à l'odorat.
Mécanique du Goût.
7.--Il n'est pas facile de déterminer précisément en quoi consiste l'organe du goût. Il est plus compliqué qu'il ne paraît.
Certes, la langue joue un grand rôle dans le mécanisme de la dégustation; car, considérée comme douée d'une force musculaire assez franche, elle sert à gâcher, retourner, pressurer et avaler les aliments.
De plus, au moyen des papilles plus ou moins nombreuses dont elle est parsemée, elle s'imprègne des particules sapides et solubles des corps avec lesquels elle se trouve en contact; mais tout cela ne suffit pas, et plusieurs autres parties adjacentes concourent à compléter la sensation, savoir, les joues, le palais et surtout la fosse nasale, sur laquelle les physiologistes n'ont peut-être pas assez insisté.
Les joues fournissent la salive, également nécessaire à la mastication et à la formation du bol alimentaire; elles sont, ainsi que le palais, douées d'une portion de facultés appréciatives; je ne sais pas même si, dans certains cas, les gencives n'y participent pas un peu; et sans l'odoration qui s'opère dans l'arrière-bouche, la sensation du goût serait obtuse et tout à fait imparfaite.
Les personnes qui n'ont pas de langue, ou à qui elle a été coupée, ont encore assez bien la sensation de goût. Le premier cas se trouve dans tous les livres; le second m'a été assez bien expliqué par un pauvre diable auquel les Algériens avaient coupé la langue, pour le punir de ce qu'avec quelques-uns de ses camarades de captivité, il avait formé le projet de se sauver et de s'enfuir.
Cet homme, que je rencontrai à Amsterdam, où il gagnait sa vie à faire des commissions, avait eu quelque éducation, et on pouvait facilement s'entretenir avec lui par écrit.
Après avoir observé qu'on lui avait enlevé toute la partie antérieure de la langue jusqu'au filet, je lui demandai s'il trouvait encore quelque saveur à ce qu'il mangeait, et si la sensation du goût avait survécu à l'opération cruelle qu'il avait subie.
Il me répondit que ce qui le fatiguait le plus était d'avaler (ce qu'il ne faisait qu'avec quelque difficulté); qu'il avait assez bien conservé le goût; qu'il appréciait comme les autres ce qui était un peu sapide; mais que les choses fortement acides ou amères lui causaient d'intolérables douleurs.
Il m'apprit encore que l'abscision de la langue était commune dans les royaumes d'Afrique; qu'on l'appliquait spécialement à ceux qu'on croyait avoir été chefs de quelque complot, et qu'on avait des instruments qui y étaient appropriés. J'aurais voulu qu'il m'en fît la description; mais il me montra, à cet égard, une répugnance tellement douloureuse, que je n'insistai pas.
Je réfléchis sur ce qu'il me disait, et, remontant aux siècles d'ignorance, où l'on perçait et coupait la langue des blasphémateurs, --et à l'époque où ces lois avaient été faites, je me crus en droit de conclure qu'elles étaient d'origine africaine, et importés par le retour des croisés.

On a vu plus haut que la sensation du goût résidait principalement dans les papilles de la langue. Or, l'anatomie nous apprend que toutes les langues n'en sont pas également munies; de sorte qu'il en est telle où l'on en trouve trois fois plus que dans telle autre. Cette circonstance explique pourquoi, de deux convives assis au même banquet, l'un est délicieusement affecté, tandis que l'autre a l'air de ne manger que comme contraint: c'est que ce dernier a la langue faiblement outillée, et que l'empire de la saveur a aussi ses aveugles et ses sourds.
Sensation du Goût.
8.--On a ouvert cinq ou six avis sur la manière dont s'opère la sensation du goût; j'ai aussi le mien, et le voici:
La sensation du goût est une opération chimique qui se fait par voie humide, comme nous disions autrefois, c'est-à-dire qu'il faut que les molécules sapides soient dissoutes dans un fluide quelconque, pour pouvoir ensuite êtres absorbées par les houppes nerveuses, papilles ou suçoirs, qui tapissent l'intérieur de l'appareil dégustateur.
Ce système, neuf ou non, est appuyé de preuves physiques et presque palpables.
L'eau pure ne cause point la sensation du goût, parce qu'elle ne contient aucune particule sapide. Dissolvez-y un grain de sel, quelques gouttes de vinaigre, la sensation aura lieu.
Les autres boissons, au contraire, nous impressionnent parce qu'elles ne sont autre chose que des solutions plus ou moins chargées de particules appréciables.
Vainement la bouche se remplirait-elle de particules divisées d'un corps insoluble, la langue éprouverait la sensation du toucher, et nullement celle du goût.
Quant aux corps solides et savoureux, il faut que les dents les divisent, que la salive et les autres fluides gustuels les imbibent, et que la langue les presse contre le palais pour en exprimer un suc qui, pour lors suffisamment chargé de sapidité, est apprécié par les papilles dégustatrices, qui délivrent au corps ainsi trituré le passeport qui lui est nécessaire pour être admis dans l'estomac.
Ce système, qui recevra encore d'autres développements, répond sans effort aux principales questions qui peuvent se présenter.
Car, si on demande ce qu'on entend par corps sapides, on répond que c'est tout corps soluble et propre à être absorbé par l'organe du goût.
Et si on demande comment le corps sapide agit, on répond qu'il agit toutes les fois qu'il se trouve dans un état de dissolution tel qu'il puisse pénétrer dans les cavités chargées de recevoir et de transmettre la sensation.
En un mot, rien de sapide que ce qui est déjà dissous ou prochainement soluble.
Des saveurs.
9.
 E nombre des saveurs est infini, car tout corps
soluble a une saveur spéciale, qui ne ressemble entièrement à
aucune autre.
E nombre des saveurs est infini, car tout corps
soluble a une saveur spéciale, qui ne ressemble entièrement à
aucune autre.
Les saveurs se modifient en outre par leur agrégation simple, double, multiple; de sorte qu'il est impossible d'en faire le tableau, depuis la plus attrayante jusqu'à la plus insupportable, depuis la fraise jusqu'à la coloquinte. Aussi tous ceux qui l'ont essayé ont-ils à peu près échoué.
Ce résultat ne doit pas étonner; car étant donné qu'il existe des séries indéfinies de saveurs simples qui peuvent se modifier par leur adjonction réciproque en tout nombre et en toute quantité, il faudrait une langue nouvelle pour exprimer tous ces effets, et des montagnes d'in-folio pour les définir, et des caractères numériques inconnus pour les étiqueter.
Or, comme jusqu'ici il ne s'est encore présenté aucune circonstance où quelque saveur ait dû être appréciée avec une exactitude rigoureuse, on a été forcé de s'en tenir à un petit nombre d'expressions générales, telle que doux, sucré, acide, acerbe, et autres pareilles, qui s'expriment, en dernière analyse, par les deux suivantes: agréable ou désagréable au goût, et suffisent pour se faire entendre et pour indiquer à peu près la propriété gustuelle du corps sapide dont on s'occupe.
Ceux qui viendront après nous en sauront davantage, et il n'est déjà plus permis de douter que la chimie ne leur révèle les causes ou les éléments primitifs des saveurs.
Influence de l'odorat sur le goût.
10.--L'ordre que je me suis prescrit m'a insensiblement amené au moment de rendre à l'odorat les droits qui lui appartiennent, et de reconnaître les services importants qu'il nous rend dans l'appréciation des saveurs; car, parmi les auteurs qui me sont tombés sous la main, je n'en ai trouvé aucun qui me paraisse lui avoir fait pleine et entière justice.
Pour moi, je suis non seulement persuadé que, sans la participation de l'odorat, il n'y a pas de dégustation complète, mais encore je suis tenté de croire que l'odorat et le goût ne forment qu'un seul sens, dont la bouche est le laboratoire et le nez la cheminée, ou, pour parler plus exactement, dont l'un sert à la dégustation des corps tactiles, et l'autre à la dégustation des gaz.
Ce système peut être rigoureusement défendu; cependant, comme je n'ai point la prétention de faire secte, je ne le hasarde que pour donner à penser à mes lecteurs, et pour montrer que j'ai vu de près le sujet que je traite. Maintenant je continue ma démonstration au sujet de l'importance de l'odorat, sinon comme partie constituante du goût, du moins comme accessoire obligé.
Tout corps sapide est nécessairement odorant: ce qui le place dans l'empire de l'odorat comme dans l'empire du goût.
On ne mange rien sans le sentir avec plus ou moins de réflexion; et pour les aliments inconnus, le nez fait toujours fonction de sentinelle avancée, qui crie: Qui va là?
Quand on intercepte l'odorat, on paralyse le goût; c'est ce qui se prouve par trois expériences que tout le monde peut vérifier avec un égal succès.
Première expérience: Quand la membrane nasale est irritée par un violent coryza (rhume de cerveau), le goût est entièrement oblitéré; on ne trouve aucune saveur à ce qu'on avale, et cependant la langue reste dans son état naturel.
Seconde expérience: Si on mange en se serrant le nez, on est tout étonné de n'éprouver la sensation du goût que d'une manière obscure et imparfaite; par ce moyen les médicaments les plus repoussants passent presque inaperçus.
Troisième expérience: On observe le même effet, si, au moment où l'on avale, au lieu de laisser revenir la langue à sa place naturelle, on continue à la tenir attachée au palais; en ce cas, on intercepte la circulation de l'air, l'odorat n'est point frappé, et la gustation n'a pas lieu.
Ces divers effets dépendent de la même cause, le défaut de coopération de l'odorat: ce qui fait que le corps sapide n'est apprécié que pour son suc, et non pour le gaz odorant qui en émane.
Analyse de la sensation du Goût.
11.
 ES principes étant ainsi posés, je regarde
comme certain que le goût donne lieu à des sensations de trois
ordres différents, savoir: la sensation directe, la
sensation complète et la sensation réfléchie.
ES principes étant ainsi posés, je regarde
comme certain que le goût donne lieu à des sensations de trois
ordres différents, savoir: la sensation directe, la
sensation complète et la sensation réfléchie.
La sensation directe est ce premier aperçu qui naît du travail immédiat des organes de la bouche, pendant que le corps appréciable se trouve encore sur la langue antérieure.
La sensation complète est celle qui se compose de ce premier aperçu et de l'impression qui naît quand l'aliment abandonne cette première position, passe dans l'arrière-bouche, et frappe tout l'organe par son goût et par son parfum.
Enfin la sensation réfléchie est le jugement que porte l'âme sur les impressions qui lui sont transmises par l'organe.
Mettons ce système en action, en voyant ce qui se passe dans l'homme qui mange ou qui boit.
Celui qui mange une pêche, par exemple, est d'abord frappé agréablement par l'odeur qui en émane; il la met dans sa bouche, et éprouve une sensation de fraîcheur et d'acidité qui l'engage à continuer; mais ce n'est qu'au moment où il avale et que la bouchée passe sous la fosse nasale que le parfum lui est révélé, ce qui complète la sensation que doit causer une pêche. Enfin, ce n'est que lorsqu'il a avalé que, jugeant ce qu'il vient d'éprouver, il se dit à lui-même: «Voilà qui est délicieux!»
Pareillement, quand on boit: tant que le vin est dans la bouche, on est agréablement, mais non parfaitement impressionné; ce n'est qu'au moment où l'on cesse d'avaler qu'on peut véritablement goûter, apprécier, et découvrir le parfum particulier à chaque espèce; et il faut un petit intervalle de temps pour que le gourmet puisse dire: «Il est bon, passable ou mauvais. Peste! c'est du chambertin! O mon Dieu! c'est du surène!»
 On voit par là que c'est conséquemment aux
principes, et par suite d'une pratique bien entendue, que les vrais
amateurs sirotent leur vin (they sip it); car, à
chaque gorgée, quand ils s'arrêtent, ils ont la somme entière du
plaisir qu'ils auraient éprouvé s'ils avaient bu le verre d'un seul
trait.
On voit par là que c'est conséquemment aux
principes, et par suite d'une pratique bien entendue, que les vrais
amateurs sirotent leur vin (they sip it); car, à
chaque gorgée, quand ils s'arrêtent, ils ont la somme entière du
plaisir qu'ils auraient éprouvé s'ils avaient bu le verre d'un seul
trait.
La même chose se passe encore, mais avec bien plus d'énergie, quand le goût doit être désagréablement affecté.
Voyez ce malade que la Faculté contraint à s'ingérer un énorme verre d'une médecine noire, telle qu'on les buvait sous le règne de Louis XIV.
L'odorat, moniteur fidèle, l'avertit de la saveur repoussante de la liqueur traîtresse; ses yeux s'arrondissent comme à l'approche d'un danger; le dégoût est sur ses lèvres, et déjà son estomac se soulève. Cependant on l'exhorte, il s'arme de courage, se gargarise d'eau-de-vie, se serre le nez et boit...
Tant que le breuvage empesté remplit la bouche et tapisse l'organe, la sensation est confuse et l'état supportable; mais à la dernière gorgée, les arrière-goûts se développent, les odeurs nauséabondes agissent, et tous les traits du patient expriment une horreur et un goût que la peur de la mort peut seule faire affronter.
S'il est question, au contraire, d'une boisson insipide, comme, par exemple, un verre d'eau, on n'a ni goût ni arrière-goût; on n'éprouve rien, on ne pense à rien; on a bu, et voilà tout.
Ordre des diverses impressions du Goût.
12.--Le goût n'est pas si richement doté que l'ouïe; celle-ci peut entendre et comparer plusieurs sons à la fois: le goût, au contraire, est simple en activité, c'est-à-dire qu'il ne peut être impressionné par deux saveurs en même temps.
Mais il peut être double, et même multiple par succession, c'est-à-dire que, dans le même acte de gutturation, on peut éprouver successivement une seconde et même une troisième sensation, qui vont en s'affaiblissant graduellement, et qu'on désigne par les mots, arrière-goût, parfum ou fragrance; de la même manière que, lorsqu'un son principal est frappé, une oreille exercée y distingue une ou plusieurs séries de consonances, dont le nombre n'est pas encore parfaitement connu.
Ceux qui mangent vite et sans attention ne discernent pas les impressions du second degré; elles sont l'apanage exclusif du petit nombre d'élus; et c'est par leur moyen qu'ils peuvent classer, par ordre d'excellence, les diverses substances soumises à leur examen.
Ces nuances fugitives vibrent encore longtemps dans l'organe du goût; les professeurs prennent, sans s'en douter, une position appropriée, et c'est toujours le cou allongé et le nez à bâbord qu'ils rendent leurs arrêts.
Jouissances dont le Goût est l'occasion.
13.
 ETONS maintenant un coup d'oeil philosophique
sur le plaisir ou la peine dont le goût peut être l'occasion.
ETONS maintenant un coup d'oeil philosophique
sur le plaisir ou la peine dont le goût peut être l'occasion.
Nous trouvons d'abord l'application de cette vérité malheureusement trop générale, savoir: que l'homme est bien plus fortement organisé pour la douleur que pour le plaisir.
Effectivement, l'injection des substances acerbes, âcres ou amères au dernier degré, peut nous faire essuyer des sensations extrêmement pénibles ou douloureuses. On prétend même que l'acide hydrocianique ne tue si promptement que parce qu'il cause une douleur si vive que les forces vitales ne peuvent la supporter sans s'éteindre.
Les sensations agréables ne parcourent, au contraire, qu'une échelle peu étendue, et s'il y a une différence assez sensible entre ce qui est insipide et ce qui flatte le goût, l'intervalle n'est pas très grand entre ce qui est reconnu pour bon et ce qui est réputé excellent; ce qui est éclairci par l'exemple suivant: premier terme, un bouilli sec et dur; deuxième terme, un morceau de veau; troisième terme, un faisan cuit à point.
Cependant le goût, tel que la nature nous l'a accordé, est encore celui de nos sens qui, tout bien considéré, nous procure le plus de jouissances:
1° Parce que le plaisir de manger est le seul qui, pris avec modération, ne soit pas suivi de fatigue:
2° Parce qu'il est de tous les temps, de tous les âges et de toutes les conditions;
3° Parce qu'il revient nécessairement au moins une fois par jour, et qu'il peut être répété, sans inconvénient, deux ou trois fois dans cet espace de temps;
4° Parce qu'il peut se mêler à tous les autres et même nous consoler de leur absence;
5° Parce que les impressions qu'il reçoit sont à la fois plus durables et plus dépendantes de notre volonté.
6° Enfin, parce qu'en mangeant nous éprouvons un certain bien-être indéfinissable et particulier, qui vient de la conscience instinctive; que, par cela même que nous mangeons, nous réparons nos pertes et nous prolongeons notre existence.
C'est ce qui sera plus amplement développé au chapitre où nous traiterons spécialement du plaisir de la table, pris au point où la civilisation actuelle l'a amené.
Suprématie de l'homme.
14.
 OUS avons été élevés dans la douce croyance
que, de toutes les créatures qui marchent, nagent, rampent ou
volent, l'homme est celle dont le goût est le plus parfait.
OUS avons été élevés dans la douce croyance
que, de toutes les créatures qui marchent, nagent, rampent ou
volent, l'homme est celle dont le goût est le plus parfait.
Cette foi est menacée d'être ébranlée.
Le docteur Gall, fondé sur je ne sais quelles inspections, prétend qu'il est des animaux chez qui l'appareil gustuel est plus développé, et partant plus parfait que celui de l'homme.
Cette doctrine est malsonnante et sent l'hérésie.
L'homme, de droit divin, roi de toute la nature, et au profit duquel la terre a été couverte et peuplée, doit nécessairement être muni d'un organe qui puisse le mettre en rapport avec tout ce qu'il y a de sapide chez ses sujets.
La langue des animaux ne passe pas la portée de leur intelligence: dans les poissons, ce n'est qu'un os mobile; dans les oiseaux, généralement, un cartilage membraneux; dans les quadrupèdes, elle est souvent revêtue d'écailles ou d'aspérités, et d'ailleurs elle n'a point de mouvements circonflexes.
La langue de l'homme, au contraire, par la délicatesse de sa contexture et des diverses membranes dont elle est environnée et avoisinée, annonce assez la sublimité des opérations auxquelles elle est destinée.
J'y ai, en outre, découvert au moins trois mouvements inconnus aux animaux, et que je nomme mouvements de spication, de rotation et de verrition (à verro, lat., je balaye). Le premier a lieu quand la langue sort en forme d'épi d'entre les lèvres qui la compriment; le second, quand la langue se meut circulairement dans l'espace compris entre l'intérieur des joues et le palais; le troisième, quand la langue, se recourbant en dessus ou en dessous, ramasse les portions qui peuvent rester dans le canal demi-circulaire formé par les lèvres et les gencives.
Les animaux sont bornés dans leurs goûts: les uns ne vivent que de végétaux, d'autres ne mangent que de la chair; d'autres se nourrissent exclusivement de graines: aucun d'eux ne connaît les saveurs composées.
L'homme, au contraire, est omnivore; tout ce qui est mangeable est soumis à son vaste appétit; ce qui entraîne, pour conséquence immédiate, des pouvoirs dégustateurs proportionnés à l'usage général qu'il doit en faire. Effectivement, l'appareil du goût est d'une rare perfection chez l'homme, et pour bien nous en convaincre, voyons-le manoeuvrer.
Dès qu'un corps esculent est introduit dans la bouche, il est confisqué, gaz et sucs, sans retour.
Les lèvres s'opposent à ce qu'il rétrograde; les dents s'en emparent et le broient; la salive l'imbibe; la langue le gâche et le retourne; un mouvement aspiratoire le pousse vers le gosier; la langue se soulève pour le faire glisser; l'odorat le flaire en passant, et il est précipité dans l'estomac pour y subir des transformations ultérieures, sans que, dans toute cette opération, il se soit échappé une parcelle, une goutte ou un atome, qui n'ait pas été soumis au pouvoir appréciateur.
C'est aussi par suite de cette perfection que la gourmandise est l'apanage exclusif de l'homme.
Cette gourmandise est même contagieuse, et nous la transmettons assez promptement aux animaux que nous avons appropriés à notre usage, et qui font en quelque sorte société avec nous, tels que les éléphants, les chiens, les chats et même les perroquets.
Si quelques animaux ont la langue plus grosse, le palais plus développé, le gosier plus large, c'est que cette langue, agissant comme muscle, est destinée à remuer de grands poids, le palais à presser, le gosier à avaler de plus grosses portions; mais toute analogie bien entendue s'oppose à ce qu'on puisse en induire que le sens est plus parfait.
D'ailleurs, le goût ne devant s'estimer que par la nature de la sensation qu'il porte au centre commun, l'impression reçue par l'animal ne peut pas se comparer à celle qui a lieu dans l'homme; cette dernière, étant à la fois plus claire et plus précise, suppose nécessairement une qualité supérieure dans l'organe qui la transmet.
Enfin, que peut-on désirer dans une faculté susceptible d'un tel point de perfection, que les gourmands de Rome distinguaient, au goût, les poissons pris entre les ponts de celui qui avait été péché plus bas? N'en voyons-nous pas, de nos jours, qui ont découvert la saveur particulière de la cuisse sur laquelle la perdrix s'appuie en dormant? Et ne sommes-nous pas environnés de gourmets qui peuvent indiquer la latitude sous laquelle un vin a mûri, tout aussi sûrement qu'un élève de Biot ou d'Arago sait prédire une éclipse?
Que s'ensuit-il de là? qu'il faut rendre à César ce qui est à César, proclamer l'homme le grand gourmand de la nature, et ne pas s'étonner si le bon docteur fait quelquefois comme Homère: Auch zuweiler schlaffert der guter G***.
Méthode adoptée par l'auteur.
15.
 USQU'ICI nous n'avons examiné le goût que sous
le rapport de sa constitution physique; et à quelques détails
anatomiques près, que peu de personnes regretteront, nous nous
sommes tenus au niveau de la science. Mais là ne finit pas la tâche
que nous nous sommes imposée; car c'est surtout de son histoire
morale que ce sens réparateur tire son importance et sa gloire.
USQU'ICI nous n'avons examiné le goût que sous
le rapport de sa constitution physique; et à quelques détails
anatomiques près, que peu de personnes regretteront, nous nous
sommes tenus au niveau de la science. Mais là ne finit pas la tâche
que nous nous sommes imposée; car c'est surtout de son histoire
morale que ce sens réparateur tire son importance et sa gloire.
Nous avons donc rangé, suivant un ordre analytique, les théories et les faits qui composent l'ensemble de cette histoire, de manière qu'il puisse en résulter de l'instruction sans fatigue.
C'est ainsi que, dans les chapitres qui vont suivre, nous montrerons comment les sensations, à force de se répéter et de se réfléchir, ont perfectionné l'organe et étendu la sphère de ses pouvoirs; comment le besoin de manger, qui n'était d'abord qu'un instinct, est devenu une passion influente, qui a pris un ascendant bien marqué sur tout ce qui tient à la société.
Nous dirons aussi comment toutes les sciences qui s'occupent de la composition des corps se sont accordées pour classer et mettre à part ceux de ces corps qui sont appréciables par le goût, et comment les voyageurs ont marché vers le même but, en soumettant à nos essais les substances que la nature ne semblait pas avoir destinées à jamais se rencontrer.
Nous suivrons la chimie au moment où elle a pénétré dans nos laboratoires souterrains pour y éclairer nos préparateurs, poser des principes, créer des méthodes et dévoiler des causes qui jusque là étaient restées occultes.
Enfin nous verrons comment, par le pouvoir combiné du temps et de l'expérience, une science nouvelle nous est tout à coup apparue, qui nourrit, restaure, conserve, persuade, console, et, non contenté de jeter à pleine mains des fleurs sur la carrière de l'individu, contribue encore puissamment à la force et à la prospérité des empires.
Si, au milieu de ces graves élucubrations, une anecdote piquante, un souvenir aimable, quelque aventure d'une vie agitée, se présente au bout de la plume, nous la laisserons couler pour reposer un peu l'attention de nos lecteurs, dont le nombre ne nous effraie point, et avec lesquels au contraire nous nous plairons à confabuler; car si ce sont des hommes, nous sommes sûrs qu'ils sont aussi indulgents qu'instruits; et si ce sont des dames, elles sont nécessairement charmantes.

Ici le professeur, plein de son sujet, laissa tomber sa main, et s'éleva dans les hautes régions.
Il remonta le torrent des âges, et prit dans leur berceau les sciences qui ont pour but la gratification du goût: il en suivit les progrès à travers la nuit des temps; et voyant que, pour les jouissances qu'elles nous procurent, les premiers siècles ont toujours été moins avantagés que ceux qui les ont suivis, il saisit sa lyre, et chanta sur le mode dorien la Mélopée historique qu'on trouvera parmi les Variétés. (Voyez à la fin du volume.)


Origine des sciences.
16.--Les sciences ne sont pas comme Minerve, qui sortit tout armée du cerveau de Jupiter; elles sont filles du temps, et se forment insensiblement, d'abord par la collection des méthodes indiquées par l'expérience, et plus tard par la découverte des principes qui se déduisent de la combinaison de ces méthodes.
 Ainsi, les premiers vieillards que leur
prudence fit appeler auprès du lit des malades, ceux que la
compassion poussa à soigner les plaies, furent aussi les premiers
médecins.
Ainsi, les premiers vieillards que leur
prudence fit appeler auprès du lit des malades, ceux que la
compassion poussa à soigner les plaies, furent aussi les premiers
médecins.
Les bergers d'Égypte, qui observèrent que quelques astres, après une certaine période, venaient correspondre au même en droit du ciel, furent les premiers astronomes.
Celui qui, le premier, exprima par des caractères cette proposition si simple: deux plus deux égalent quatre, créa les mathématiques, cette science si puissante, et qui a véritablement élevé l'homme sur le trône de l'univers.
Dans le cours des soixante dernières années qui viennent de s'écouler, plusieurs sciences nouvelles sont venues prendre place dans le système de nos connaissances, et entre autres la stéréotomie, la géométrie descriptive et la chimie des gaz.
Toutes ces sciences, cultivées pendant un nombre infini de générations, feront des progrès d'autant plus sûrs que l'imprimerie les affranchit du danger de reculer. Eh! qui sait, par exemple, si la chimie des gaz ne viendra pas à bout de maîtriser ces éléments jusqu'à présent si rebelles, de les mêler, et d'obtenir par ce moyen des substances jusqu'ici non tentées, et d'obtenir par ce moyen des substances et des effets qui reculeraient de beaucoup les limites de nos pouvoirs!
Origine de la gastronomie.
17.
 A gastronomie s'est présentée à son tour, et
toutes ses soeurs se sont approchées pour lui faire place.
A gastronomie s'est présentée à son tour, et
toutes ses soeurs se sont approchées pour lui faire place.
Eh! que pouvait-on refuser à celle qui nous soutient de la naissance au tombeau, qui accroît les délices de l'amour et la confiance de l'amitié, qui désarme la haine, facilite les affaires, et nous offre, dans le court trajet de la vie, la seule jouissance qui, n'étant pas suivie de fatigue, nous délasse encore de toutes les autres!
Sans doute, tant que les préparations ont été exclusivement confiées à des serviteurs salariés, tant que les cuisiniers seuls se sont réservé cette matière et qu'on n'a écrit que des dispensaires, les résultats de ces travaux n'ont été que les produits d'un art.
Mais enfin, trop tard peut-être, les savants se sont approchées.
Ils ont examiné, analysé et classé les substances alimentaires, et les ont réduites à leurs plus simples éléments.
Ils ont sondé les mystères de l'assimilation, et, suivant la matière inerte dans ses métamorphoses, ils ont vu comment elle pouvait prendre vie.
Ils ont suivi la diète dans ses effets passagers ou permanents, sur quelques jours, sur quelques mois, ou sur toute la vie.
Ils ont apprécié son influence jusque sur la faculté de penser, soit que l'âme se trouve impressionnée par les sens, soit qu'elle sente sans le secours de ses organes; et de tous ces travaux ils ont déduit une haute théorie, qui embrasse tout l'homme et toute la partie de la création qui peut s'animaliser.
Tandis que toutes ces choses se passaient dans les cabinets des savants, on disait tout haut dans les salons que la science qui nourrit les hommes vaut bien au moins celle qui enseigne à les faire tuer; les poètes chantaient les plaisirs de la table, et les livres qui avaient la bonne chère pour objet présentaient des vues plus profondes et des maximes d'un intérêt plus général.
Telles sont les circonstances qui ont précédé l'avènement de la gastronomie.
Définition de la gastronomie.
18.--La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme, en tant qu'il se nourrit.
Son but est de veiller à la conservation des hommes, au moyen de la meilleure nourriture possible.
Elle y parvient en dirigeant, par des principes certains, tous ceux qui recherchent, fournissent ou préparent les choses qui peuvent se convertir en aliments.
Ainsi, c'est elle, à vrai dire, qui fait mouvoir les cultivateurs, les vignerons, les pêcheurs, les chasseurs et la nombreuse famille des cuisiniers, quel que soit le titre ou la qualification sous laquelle ils déguisent leur emploi à la préparation des aliments.
La gastronomie tient:
À l'histoire naturelle, par la classification qu'elle fait des substances alimentaires;
A la physique, par l'examen de leurs compositions et de leurs qualités;
A la chimie, par les diverses analyses et décompositions qu'elle leur fait subir;
A la cuisine, par l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût;
Au commerce, par la recherche des moyens d'acheter au meilleur marché possible ce qu'elle consomme, et de débiter le plus avantageusement ce qu'elle présente à vendre;
Enfin, à l'économie politique, par les ressources qu'elle présente à l'impôt, et par les moyens d'échange qu'elle établit entre les nations.

La gastronomie régit la vie tout entière; car les pleurs du nouveau-né appellent le sein de sa nourrice; et le mourant reçoit encore avec quelque plaisir la potion suprême qu'hélas! il ne doit plus digérer.
Elle s'occupe aussi de tous les états de la société; car si c'est elle qui dirige les banquets des rois rassemblés, c'est encore elle qui a calculé le nombre de minutes d'ébullition qui est nécessaire pour qu'un oeuf soit cuit à point.
Le sujet matériel de la gastronomie est tout ce qui peut être mangé; son but direct, la conservation des individus, et ses moyens d'exécution, la culture qui produit, le commerce qui échange, l'industrie qui prépare, et l'expérience qui invente les moyens de tout disposer pour le meilleur usage.
Objets divers dont s'occupe la gastronomie.
19.
 A gastronomie considère le goût dans ses
jouissances comme dans ses douleurs; elle a découvert les
excitations graduelles dont il est susceptible; elle en a
régularisé l'action, et a posé les limites que l'homme qui se
respecte ne doit jamais outrepasser.
A gastronomie considère le goût dans ses
jouissances comme dans ses douleurs; elle a découvert les
excitations graduelles dont il est susceptible; elle en a
régularisé l'action, et a posé les limites que l'homme qui se
respecte ne doit jamais outrepasser.
Elle considère aussi l'action des aliments sur le moral de l'homme, sur son imagination, son esprit, son jugement, son courage et ses perceptions, soit qu'il veille, soit qu'il dorme, soit qu'il agisse, soit qu'il repose.
C'est la gastronomie qui fixe le point d'esculence de chaque substance alimentaire; car toutes ne sont pas présentables dans les mêmes circonstances.
Les unes doivent être prises avant que d'être parvenues à leur entier développement, comme les câpres, les asperges, les cochons de lait, les pigeons à la cuiller, et autres animaux qu'on mange dans leur premier âge; d'autres, au moment où elles ont atteint toute la perfection qui leur est destinée, comme les melons, la plupart des fruits, le mouton, le boeuf, et tous les animaux adultes; d'autres, quand elles commencent à se décomposer, telles que le nèfles, la bécasse, et surtout le faisan; d'autres, enfin, après que les opérations de l'art leur ont ôté leurs qualités malfaisantes, telles que la pomme de terre, le manioc, et d'autres.
C'est encore la gastronomie qui classe ces substances d'après leurs qualités diverses, qui indique celles qui peuvent s'associer, et qui, mesurant leurs divers degrés d'alibilité, distingue celles qui doivent faire la base de nos repas d'avec celles qui n'en sont que les accessoires et d'avec celles encore qui, n'étant déjà plus nécessaires, sont cependant une distraction agréable, et deviennent l'accompagnement obligé de la confabulation conviviale.
Elle ne s'occupe pas avec moins d'intérêt des boissons qui nous sont destinées, suivant le temps, les lieux et les climats. Elle enseigne à les préparer, à les conserver, et surtout à les présenter dans un ordre tellement calculé que la jouissance qui en résulte aille toujours en augmentant, jusqu'au moment où le plaisir finit et où l'abus commence.
C'est la gastronomie qui inspecte les hommes et les choses, pour transporter d'un pays à l'autre tout ce qui mérite d'être connu, et qui fait qu'un festin savamment ordonné est comme un abrégé du monde, où chaque partie figure par ses représentants.
Utilité des connaissances gastronomiques.
20.--Les connaissances gastronomiques sont nécessaires à tous les hommes, puisqu'elles tendent à augmenter la somme du plaisir qui leur est destinée: cette utilité augmente en proportion de ce qu'elle est appliquée à des classes plus aisées de la société; enfin elles sont indispensables à ceux qui, jouissant d'un grand revenu, reçoivent beaucoup de monde, soit qu'en cela ils fassent acte d'une représentation nécessaire, soit qu'ils suivent leur inclination, soit enfin qu'ils obéissent à la mode.
Ils y trouvent cet avantage spécial, qu'il y a de leur part quelque chose de personnel dans la manière dont leur table est tenue; qu'ils peuvent surveiller jusqu'à un certain point les dépositaires forcés de leur confiance, et même les diriger en beaucoup d'occasions.
Le prince de Soubise avait un jour l'intention de donner une fête; elle devait se terminer par un souper, et il en avait demandé le menu.
Le maître d'hôtel se présente à son lever avec une belle pancarte à vignettes, et le premier article sur lequel le prince jeta les yeux fut celui-ci: cinquante jambons; «Eh quoi, Bertrand, dit-il, je crois que tu extravagues; cinquante jambons! veux-tu donc régaler tout mon régiment?--Non, mon prince; il n'en paraîtra qu'un sur la table; mais le surplus ne m'est pas moins nécessaire pour mon espagnole, mes blonds, mes garnitures, mes...--Bertrand, vous me volez, et cet article ne passera pas.--Ah! monseigneur, dit l'artiste, pouvant à peine retenir sa colère, vous ne connaissez pas nos ressources! Ordonnez, et ces cinquante jambons qui vous offusquent, je vais les faire entrer dans un flacon de cristal pas plus gros que le pouce.»
Que répondre à une assertion aussi positive? Le prince sourit, baissa la tête, et l'article passa.
Influence de la gastronomie dans les affaires.
21.
 N sait que chez les hommes encore voisins de
l'état de nature, aucune affaire de quelqu'importance ne se traite
qu'à table; c'est au milieu des festins que les sauvages décident
la guerre ou font la paix; et sans aller si loin, nous voyons que
les villageois font toutes leurs affaires au cabaret.
N sait que chez les hommes encore voisins de
l'état de nature, aucune affaire de quelqu'importance ne se traite
qu'à table; c'est au milieu des festins que les sauvages décident
la guerre ou font la paix; et sans aller si loin, nous voyons que
les villageois font toutes leurs affaires au cabaret.
Cette observation n'a pas échappé à ceux qui ont souvent à traiter les plus grands intérêts; ils ont vu que l'homme repu n'était pas le même que l'homme à jeun; que la table établissait une espèce de lien entre celui qui traite et celui qui est traité; qu'elle rendait les convives plus aptes à recevoir certaines impressions, à se soumettre à de certaines influences; de là est née la gastronomie politique. Les repas sont devenus un moyen de gouvernement, et le sort des peuples s'est décidé dans un banquet. Ceci n'est ni un paradoxe ni même une nouveauté, mais une simple observation de faits. Qu'on ouvre tous les historiens, depuis Hérodote jusqu'à nos jours, et on verra que, sans même en excepter les conspirations, il ne s'est jamais passé un grand événement qui n'ait été conçu, préparé et ordonné dans les festins.
Académie des gastronomes.
Tel est, au premier aperçu, le domaine de la gastronomie, domaine fertile en résultats de toute espèce, et qui ne peut que s'agrandir par les découvertes et les travaux des savants qui vont le cultiver; car il est impossible que, avant le laps de peu d'années, la gastronomie n'ait pas ses académiciens, ses cours, ses professeurs, et ses propositions de prix.
D'abord, un gastronome riche et zélé établira chez lui des assemblées périodiques, où les plus savants théoriciens se réuniront aux artistes, pour discuter et approfondir les diverses parties de la science alimentaire.
Bientôt (et telle est l'histoire de toutes les académies), le gouvernement interviendra, régularisera, protégera, instituera, et saisira l'occasion de donner au peuple une compensation pour tous les orphelins que le canon a faits, pour toutes les Arianes que la générale a fait pleurer.
Heureux le dépositaire du pouvoir qui attachera son nom à cette institution si nécessaire! Ce nom sera répété d'âge en âge avec ceux de Noé, de Bacchus, de Triptolème, et des autres bienfaiteurs de l'humanité; il sera, parmi les ministres, ce que Henri IV est parmi les rois, et son éloge sera dans toutes les bouches, sans qu'aucun règlement en fasse une nécessité.


G. de GONET Éditeur.
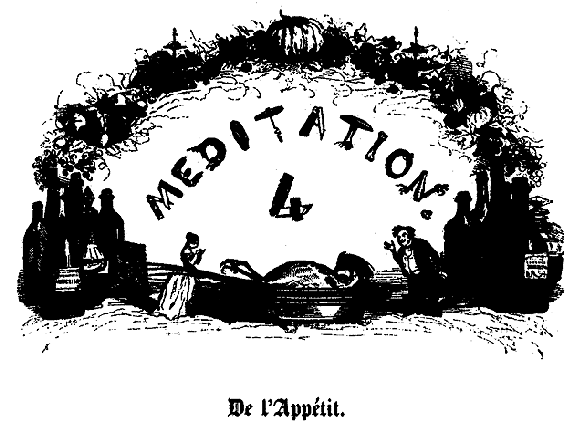
Définition de l'Appétit.
23.--Le mouvement et la vie occasionnent dans le corps vivant une déperdition continuelle de substance; et le corps humain, cette machine si compliquée, serait bientôt hors de service, si la Providence n'y avait placé un ressort qui l'avertit du moment où ses forces ne sont plus en équilibre avec ses besoins.
Ce moniteur est l'appétit. On entend par ce mot la première impression du besoin de manger.
L'appétit s'annonce par un peu de langueur dans l'estomac et une légère sensation de fatigue.
En même temps, l'âme s'occupe d'objets analogues à ses besoins, la mémoire se rappelle les choses qui ont flatté le goût; l'imagination croit les voir; il y a là quelque chose qui tient du rêve. Cet état n'est pas sans charmes; et nous avons entendu des milliers d'adeptes s'écrier dans la joie de leur coeur: «Quel plaisir d'avoir un bon appétit, quand on a la certitude de faire bientôt un excellent repas!»
Cependant l'appareil nutritif s'émeut tout entier: l'estomac devient sensible; les sucs gastriques s'exhalent; les gaz intérieurs se déplacent avec bruit; la bouche se remplit de sucs, et toutes les puissances digestives sont sous les armes, comme des soldats qui n'attendent plus que le commandement pour agir. Encore quelques moments, on aura des mouvements spasmodiques, on bâillera, on souffrira, on aura faim.
On peut observer toutes les nuances de ces divers états dans tout salon où le dîner se fait attendre.
Elles sont tellement dans la nature, que la politesse la plus exquise ne peut en déguiser les symptômes; d'où j'ai dégagé cet apophthegme: De toutes les qualités du cuisinier, la plus indispensable est l'exactitude.
Anecdote.
24.
 'APPUIE cette grave maxime par les détails
d'une observation faite dans une réunion dont je faisais
partie,
'APPUIE cette grave maxime par les détails
d'une observation faite dans une réunion dont je faisais
partie,
Quorum pars magna fui,
et où le plaisir d'observer me sauva des angoisses de la misère.
J'étais un jour invité à dîner chez un haut fonctionnaire public. Le billet d'invitation était pour cinq heures et demie, et au moment indiqué tout le monde était rendu; car on savait qu'il aimait qu'on fût exact, et grondait quelquefois les paresseux.
Je fus frappé, en arrivant, de l'air de consternation que je vis régner dans l'assemblée: on se parlait à l'oreille, on regardait dans la cour à travers les carreaux de la croisée; quelques visages annonçaient la stupeur. Il était certainement arrivé quelque chose d'extraordinaire.
Je m'approchai de celui des convives que je crus le plus en état de satisfaire ma curiosité, et lui demandai ce qu'il y avait de nouveau, «Hélas! me répondit-il avec l'accent de la plus profonde affliction, monseigneur vient d'être mandé au conseil d/État; il part en ce moment, et qui sait quand il reviendra?--N'est-ce que cela? répondis-je d'un air d'insouciance qui était bien loin de mon coeur. C'est tout au plus l'affaire d'un quart-d'heure; quelque renseignement dont on aura eu besoin; on sait qu'il y a ici aujourd'hui dîner officiel; on n'a aucune raison pour nous faire jeûner.» Je parlais ainsi; mais au fond de l'âme, je n'étais pas sans inquiétude, et j'aurais voulu être bien loin.
La première heure se passa bien, on s'assit auprès de ceux avec qui on était lié; on épuisa les sujets banaux de conversation, et on s'amusa à faire des conjectures sur la cause qui avait pu faire appeler aux Tuileries notre cher amphitryon.
À la seconde heure, on commença à apercevoir quelques symptômes d'impatience: on se regardait avec inquiétude, et les premiers qui murmurèrent furent trois ou quatre convives qui, n'ayant pas trouvé de place pour s'asseoir, n'étaient pas en position commode pour attendre.
À la troisième heure, le mécontentement fut général, et tout le monde se plaignait. «Quand reviendra-t-il? disait l'un.--A quoi pense-t-il? disait l'autre.--C'est à en mourir!» disait un troisième. Et on se faisait, sans jamais la résoudre, la question suivante: «S'en ira-t-on? ne s'en ira-t-on pas?»
À la quatrième heure, tous les symptômes s'aggravèrent: on étendait les bras, au hasard d'éborgner les voisins; on entendait de toutes parts des bâillements chantants; toutes les figures étaient empreintes des couleurs qui annoncent la concentration; et on ne m'écouta pas quand je me hasardai de dire que celui dont l'absence nous attristait tant était sans doute le plus malheureux de tous.
L'attention fut un instant distraite par une apparition. Un des convives, plus habitué que les autres, pénétra jusque dans les cuisines; il en revint tout essoufflé; sa figure annonçait la fin du monde, et il s'écria d'une voix à peine articulée et de ce ton sourd qui exprime à la fois la crainte de faire du bruit et l'envie d'être entendu: «Monseigneur est parti sans donner d'ordre, et, quelle que soit son absence, on ne servira pas qu'il ne revienne.» Il dit: et l'effroi que causa son allocution ne sera pas surpassé par l'effet de la trompette du jugement dernier.

Parmi tous ces martyrs, le plus malheureux était le bon d'Aigrefeuille, que tout Paris a connu; son corps n'était que souffrance, et la douleur de Laocoon était sur son visage. Pâle, égaré, ne voyant rien, il vint se hucher sur un fauteuil, croisa ses petites mains sur son gros ventre, et ferma les yeux, non pour dormir, mais pour attendre la mort.
Elle ne vint cependant pas. Vers les dix heures on entendit une voiture rouler dans la cour; tout le monde se leva d'un mouvement spontané. L'hilarité succéda à la tristesse, et après cinq minutes on était à table.
Mais l'heure de l'appétit était passée. On avait l'air étonné de commencer à dîner à une heure si indue; les mâchoires n'eurent point ce mouvement isochrone qui annonce un travail régulier; et j'ai su que plusieurs convives en avaient été incommodés.
La marche indiquée en pareil cas est de ne point manger immédiatement après que l'obstacle a cessé; mais d'avaler un verre d'eau sucrée, ou une tasse de bouillon, pour consoler l'estomac; d'attendre ensuite douze ou quinze minutes, sinon l'organe convulsé se trouve opprimé, par le poids des aliments dont on le surcharge.
Grands appétits.
25.
 UAND on voit, dans les livres primitifs, les
apprêts qui se faisaient pour recevoir deux ou trois personnes,
ainsi que les portions énormes que l'on servait à un seul hôte, il
est difficile de se refuser à croire que les hommes qui vivaient
plus près que nous du berceau du monde ne fussent ainsi doués d'un
bien plus grand appétit.
UAND on voit, dans les livres primitifs, les
apprêts qui se faisaient pour recevoir deux ou trois personnes,
ainsi que les portions énormes que l'on servait à un seul hôte, il
est difficile de se refuser à croire que les hommes qui vivaient
plus près que nous du berceau du monde ne fussent ainsi doués d'un
bien plus grand appétit.
Cet appétit était censé s'accroître en raison directe de la dignité du personnage; et celui à qui on ne servait pas moins que le dos entier d'un taureau de cinq ans était destiné à boire dans une coupe dont il avait peine à supporter le poids.
Quelques individus ont existé depuis, pour porter témoignage de ce qui a pu se passer autrefois, et les recueils sont pleins d'exemples d'une voracité à peine croyable, et qui s'étendait à tout, même aux objets les plus immondes.
Je ferai grâce à mes lecteurs de ces détails quelquefois assez dégoûtants, et je préfère leur conter deux faits particuliers, dont j'ai été témoin, et qui n'exigent pas de leur part une foi bien implicite.

J'allai, il y a environ quarante ans, faire une visite volante au curé de Bregnier, homme de grande taille, et dont l'appétit avait une réputation bailliagère.
Quoiqu'il fût à peine midi, je le trouvai déjà à table. On avait emporté la soupe et le bouilli, et à ces deux plats obligés avaient succédé un gigot de mouton à la royale, un assez beau chapon et une salade copieuse.
Dès qu'il me vit paraître, il demanda pour moi un couvert, que je refusai, et je fis bien; car, seul et sans aide, il se débarrassa très lestement de tout, savoir: du gigot jusqu'à l'ivoire, du chapon jusqu'aux os, et de la salade jusqu'au fond du plat.
On apporta bientôt un assez grand fromage blanc, dans lequel il fit une brèche angulaire de quatre-vingt-dix degrés; il arrosa le tout d'une bouteille de vin et d'une carafe d'eau, après quoi il se reposa.
Ce qui m'en fit plaisir, c'est que, pendant toute cette opération qui dura à peu près trois quarts d'heure, le vénérable pasteur n'eut point l'air affairé. Les gros morceaux qu'il jetait dans sa bouche profonde ne l'empêchaient ni de parler ni de rire; et il expédia tout ce qu'on avait servi devant lui sans y mettre plus d'appareil que s'il n'avait mangé que trois mauviettes.
C'est ainsi que le général Bisson, qui buvait chaque jour huit bouteilles de vin à son déjeuner, n'avait pas l'air d'y toucher; il avait un plus grand verre que les autres, et le vidait plus souvent; mais on eût dit qu'il n'y faisait pas attention, et, tout en humant ainsi seize livres de liquide, il n'était pas plus empêché de plaisanter et de donner ses ordres que s'il n'eût dû boire qu'un carafon.
Le second fait rappelle à ma mémoire le brave général P. Sibuet, mon compatriote, longtemps premier aide de camp du général Masséna, et mort au champ d'honneur en 1813, au passage de la Bober.
Prosper était âgé de dix-huit ans, et avait cet appétit heureux par lequel la nature annonce qu'elle s'occupe à achever un homme bien constitué, lorsqu'il entra un soir dans la cuisine de Genin, aubergiste chez lequel les anciens de Belley avaient coutume de s'assembler pour manger des marrons et boire du vin blanc nouveau qu'on appelle vin bourru.
On venait de tirer de la broche un magnifique dindon, beau, bien fait, doré, cuit à point, et dont le fumet aurait tenté un saint.
Les anciens, qui n'avaient plus faim, n'y firent pas beaucoup d'attention; mais les puissances digestives du jeune Prosper en furent ébranlées; l'eau lui vint à la bouche, et il s'écria: «Je ne fais que sortir de table, je n'en gage pas moins que je mangerai ce gros dindon à moi tout seul.--Sez vosu mesé, z'u payo, répondit Bouvier du Bouchet, gros fermier qui se trouvait présent; è sez vos caca en rotaz, i-zet vos ket pairé et may ket mezerai la restaz 11.»
L'exécution commença immédiatement. Le jeune athlète détacha proprement une aile, l'avala en deux bouchées, après quoi il se nettoya les dents en grugeant le cou de la volaille, et but un verre de vin pour servir d'entracte.
Bientôt il attaqua la cuisse, la mangea avec le même sang-froid, et dépêcha un second verre de vin, pour préparer les voies au passage du surplus.
Aussitôt la seconde aile suivit la même route: elle disparut, et l'officiant, toujours plus animé, saisissait déjà le dernier membre, quand le malheureux fermier s'écria d'une voix dolente: «Hai! ze vaie praou qu'izet fotu; m'ez, monche Chibouet, poez kaet zu daive paiet, lessé m'en a m'en mesiet on mocho 12.»
Note 11:(retour) «Si vous le mangez, je vous le paie; mais si vous restez en route; c'est vous qui paierez, et moi qui mangerai le reste.»
Note 12:(retour) «Hélas! je vois bien que c'en est fini; mais, monsieur Sibuet, puisque je dois le payer, laissez-m'en au moins manger un morceau.»Je cite avec plaisir cet échantillon du patois du Bugey, où l'on trouve le th des Grecs et des Anglais, et, dans le mot praou et autres semblables, une diphtongue qui n'existe en aucune langue, et dont on ne peut peindre le sou par aucun caractère connu. (Voyez le 3e volume des Mémoires de la Société royale des Antiquaires de France).
Prosper était aussi bon garçon qu'il fut depuis bon militaire; il consentit à la demande de son anti-partenaire, qui eut, pour sa part, la carcasse encore assez opime, de l'oiseau en consommation, et paya ensuite de fort bonne grâce et le principal et les accessoires obligés.
Le général Sibuet se plaisait beaucoup à raconter cette prouesse de son jeune âge; il disait que ce qu'il avait fait, en associant le fermier, était de pure courtoisie; il assurait que, sans cette assistance, il se sentait toute la puissance nécessaire pour gagner la gageure; et ce qui, à quarante ans, lui restait d'appétit, ne permettait pas de douter de son assertion.


SECTION PREMIÈRE.
Définitions.
26.
 U'ENTEND-ON par aliments?
U'ENTEND-ON par aliments?
Réponse populaire: L'aliment est tout ce qui nous nourrit.
Réponse scientifique: On entend par aliment les substances qui, soumises à l'estomac, peuvent s'animaliser par la digestion, et réparer les pertes que fait le corps humain par l'usage de la vie.
Ainsi, la qualité distinctive de l'aliment consiste dans la propriété de subir l'assimilation animale.
Travaux analytiques.
27.--Le règne animal et le règne végétal sont ceux qui, jusqu'à présent, ont fourni des aliments au genre humain. On n'a encore tiré des minéraux que des remèdes ou des poisons.
Depuis que la chimie analytique est devenue une science certaine, on a pénétré très avant dans la double nature des éléments dont notre corps est composé, et des substances que la nature semble avoir destinées à en réparer les pertes.
Ces études avaient entre elles une grande analogie, puisque l'homme est composé en grande partie des mêmes substances que les animaux dont il se nourrit, et qu'il a bien fallu chercher aussi dans les végétaux les affinités par suite desquelles ils deviennent eux-mêmes animalisables.
On a fait dans ces deux voies les travaux les plus louables et en même temps les plus minutieux, et on a suivi, soit le corps humain, soit les aliments par lesquels il se répare, d'abord dans leurs particules secondaires, et ensuite dans leurs éléments, au-delà desquels il ne nous a point encore été permis de pénétrer.
Ici j'avais l'intention de placer un petit traité de chimie alimentaire, et d'apprendre à mes lecteurs en combien de millièmes de carbone, d'hydrogène, etc., on pourrait réduire eux et les mets qui les nourrissent; mais j'ai été arrêté par le réflexion que je ne pouvais guère remplir cette tâche qu'en copiant les excellents traités de chimie qui sont entre les mains de tout le monde. J'ai craint encore de tomber dans des détails stériles, et me suis réduit à une nomenclature raisonnée, sauf à faire passer par-ci par-là quelques résultats chimiques, en termes moins hérissés et plus intelligibles.
Osmazôme.
28.
 E plus grand service rendu par la chimie à la
science alimentaire est la découverte ou plutôt la précision de
l'osmazôme.
E plus grand service rendu par la chimie à la
science alimentaire est la découverte ou plutôt la précision de
l'osmazôme.
L'osmazôme est cette partie éminemment sapide des viandes, qui est soluble à l'eau froide, et qui se distingue de la partie extractive en ce que cette dernière n'est soluble que dans l'eau bouillante.
C'est l'osmazôme qui fait le mérite des bons potages; c'est lui qui, en se caramélisant, forme le roux des viandes; c'est par lui que se forme le rissolé des rôtis, enfin c'est de lui que sort le fumet de la venaison et du gibier.
L'osmazôme se retire surtout des animaux adultes à chairs rouges, noires, et qu'on est convenu d'appeler chairs faites; on n'en trouve point ou presque point dans l'agneau, le cochon de lait, le poulet, et même dans le blanc des plus grosses volailles: c'est par cette raison que les vrais connaisseurs ont toujours préféré l'entre-cuisse; chez eux l'instinct du goût avait prévenu la science.

G. de CONET, Éditeur
C'est aussi la prescience de l'osmazôme qui a fait chasser tant de cuisiniers, convaincus de distraire le premier bouillon: c'est elle qui fit la réputation des soupes de primes, qui a fait adopter les croûtes au pot comme confortatives dans le bain, et qui fit inventer au chanoine Chevrier des marmites fermantes à clef; c'est le même à qui l'on ne servait jamais des épinards le vendredi qu'autant qu'ils avaient été cuits dès le dimanche, et remis chaque jour sur le feu avec une nouvelle addition de beurre frais.
Enfin c'est pour ménager cette substance, quoique encore inconnue, que s'est introduite la maxime que, pour faire de bon bouillon, la marmite ne devait que sourire, expression fort distinguée pour le pays d'où elle est venue.
L'osmazôme, découvert après avoir fait si longtemps les délices de nos pères, peut se comparer à l'alcool, qui a grisé bien des générations avant qu'on ait su qu'on pouvait le mettre à nu par la distillation.
À l'osmazôme succède, par le traitement à l'eau bouillante, ce qu'on entend plus spécialement par matière extractive: ce dernier produit, réuni à l'osmazôme, compose le jus de la viande.
Principe des aliments.
La fibre est ce qui compose le tissu de la chair et ce qui se présente à l'oeil après la cuisson. La fibre résiste à l'eau bouillante, et conserve sa forme, quoique dépouillée d'une partie de ses enveloppes. Pour bien dépecer les viandes, il faut avoir soin que la fibre fasse un angle droit, ou à peu près, avec la lame du couteau: la viande ainsi coupée a un aspect plus agréable, se goûte mieux, et se mâche plus facilement.
Les os sont principalement composés de gélatine et de phosphate de chaux.
La quantité de gélatine diminue à mesure qu'on avance en âge À soixante-dix ans, les os ne sont plus qu'un marbre imparfait; c'est ce qui les rend si cassants, et fait une loi de prudence aux vieillards d'éviter toute occasion de chute.
L'albumine se trouve également dans la chair et dans le sang; elle se coagule à une chaleur au dessous de 40 degrés: c'est elle qui forme l'écume du pot-au-feu.
La gélatine se rencontre également dans les os, les parties molles et cartilagineuses; sa qualité distinctive est de se coaguler à la température ordinaire de l'atmosphère; deux parties et demie sur cent d'eau chaude suffisent pour cela.
La gélatine est la base de toute les gelées grasses et maigres, blancs-mangers, et autres préparations analogues.
La graisse est une huile concrète qui se forme dans les interstices du tissu cellulaire, et s'agglomère quelquefois en masse dans les animaux que l'art ou la nature y prédispose, comme les cochons, les volailles, les ortolans et les becs-figues; dans quelques-uns de ces animaux, elle perd son insipidité, et prend un léger arôme qui la rend fort agréable.
Le sang se compose d'un sérum albumineux, de fibrine, d'un peu de gélatine et d'un peu d'osmazôme; il se coagule à l'eau chaude, et devient un aliment très nourrissant (v. g. le boudin).
Tous les principes que nous venons de passer en revue sont communs à l'homme et aux animaux dont il a coutume de se nourrir. Il n'est donc point étonnant que la diète animale soit éminemment restaurante et fortifiante; car les particules dont elle se compose, ayant avec les nôtres une grande similitude et ayant déjà été animalisées, peuvent facilement s'animaliser de nouveau lorsqu'elles sont soumises à l'action vitale de nos organes digesteurs.
Règne végétal.
29. Cependant le règne végétal ne présente à la nutrition ni moins de variétés ni moins de ressources.
La fécule nourrit parfaitement, et d'autant mieux qu'elle est moins mélangée de principes étrangers.
On entend par fécule la farine ou poussière qu'on peut obtenir des graines céréales, des légumineuses et de plusieurs espèces de racines, parmi lesquelles la pomme de terre tient jusqu'à présent le premier rang.
La fécule est la base du pain, des pâtisseries et des purées de toute espèce, et entre ainsi pour une très grande partie dans la nourriture de presque tous les peuples.
On a observé qu'une pareille nourriture amollit la fibre et même le courage. On en donne pour preuve les Indiens, qui vivent presque exclusivement de riz et qui se sont soumis à quiconque a voulu les asservir.
Presque tous les animaux domestiques mangent avec avidité la fécule, et ils sont, au contraire, singulièrement fortifiés, parce que c'est une nourriture plus substantielle que les végétaux secs ou verts qui sont leur pâture habituelle.
Le sucre n'est pas moins considérable, soit comme aliment, soit comme médicament.
Cette substance, autrefois reléguée aux Indes ou aux colonies, est devenue indigène au commencement de ce siècle. On l'a découverte et suivie dans le raisin, les navets, la châtaigne, et surtout dans la betterave; de sorte que, rigoureusement parlant, l'Europe pourrait, sous ce rapport, se suffire et se passer de l'Amérique ou de l'Inde. C'est un service éminent que la science a rendu à la société, et un exemple qui peut avoir dans la suite des résultats plus étendus. (Voyez ci-après, article sucre).
Le sucre, soit à l'état solide, soit dans les diverses plantes où la nature l'a placé, est extrêmement nourrissant; les animaux en sont friands, et les Anglais, qui en donnent beaucoup à leurs chevaux de luxe, ont remarqué qu'ils en soutiennent bien mieux les diverses épreuves auxquelles on les soumet.
Le sucre, qu'aux jours de Louis XIV on ne trouvait que chez les apothicaires, a donné naissance à diverses professions lucratives, telles que les pâtissiers du petit-four, les confiseurs, les liquoristes et autres marchands de friandises.
Les huiles douces proviennent ainsi du règne végétal; elles ne sont esculentes qu'autant qu'elles sont unies à d'autres substances, et doivent surtout être regardées comme un assaisonnement.
Le gluten, qu'on trouve particulièrement dans le froment, concourt puissamment à la fermentation du pain dont il fait partie; les chimistes ont été jusqu'à lui donner une nature animale.
On a fait à Paris, pour les enfants et les oiseaux, et pour les hommes dans quelques départements, des pâtisseries où le gluten domine, parce qu'une partie de la fécule a été soustraite au moyen de l'eau.
Le mucilage doit sa qualité nutritive aux diverses substances auxquelles il sert de véhicule.
La gomme peut devenir, au besoin, un aliment; ce qui ne doit pas étonner, puisqu'à très peu de chose près elle contient les mêmes éléments que le sucre.
La gélatine végétale qu'on extrait de plusieurs espèces de fruits, notamment des pommes, des groseilles, des coings, et de quelques autres, peut aussi servir d'aliment: elle en fait mieux la fonction, unie au sucre, mais toujours beaucoup moins que les gelées animales qu'on tire des os, des cornes, des pieds de veau et de la colle de poisson. Cette nourriture est en général légère, adoucissante et salutaire. Aussi la cuisine et l'office s'en emparent et se la disputent.
Différence du gras au maigre.
Au jus près, qui, comme nous l'avons dit, se compose d'osmazôme et d'extractif, on trouve dans les poissons la plupart des substances que nous avons signalées dans les animaux terrestres, telles que la fibrine, la gélatine, l'albumine: de sorte qu'on peut dire avec raison que c'est le jus qui sépare le régime gras du maigre.
Ce dernier est encore marqué par une autre particularité: c'est que le poisson contient en outre une quantité notable de phosphore et d'hydrogène, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus combustible dans la nature. D'où il suit que l'ichthyophagie est une diète échauffante: ce qui pourrait légitimer certaines louanges données jadis à quelques ordres religieux, dont le régime était directement contraire à celui de leurs voeux déjà réputé le plus fragile.
Observations particulières.
30.--Je n'en dirai pas davantage sur cette question de physiologie; mais je ne dois pas omettre un fait dont on peut facilement vérifier l'existence:
Il y a quelques années que j'allai voir une maison de campagne, dans un petit hameau des environs de Paris, situé sur le bord de la Seine, en avant de l'île de Saint-Denis, et consistant principalement en huit cabanes de pécheurs. Je fus frappé de la quantité d'enfants que je vis fourmiller sur la route.
J'en marquai mon étonnement au batelier avec lequel je traversai la rivière. «Monsieur, me dit-il, nous ne sommes ici que huit familles, et nous avons cinquante-trois enfants, parmi lesquels il se trouve quarante-neuf filles et seulement quatre garçons, et de ces quatre garçons, en voilà un qui m'appartient.» En disant ces mots, il se redressait d'un air de triomphe, et me montrait un petit marmot de cinq à six ans, couché sur le devant du bateau, où il s'amusait à gruger des écrevisses crues. Ce petit hameau s'appelle...

De cette observation qui remonte à plus de dix ans, et de quelques autres que je ne puis pas aussi facilement indiquer, j'ai été amené à penser que le mouvement génésique causé par la diète ichthyaque pourrait bien être plus irritant que pléthorique et substantiel; et j'y persiste d'autant plus volontiers que, tout récemment, le docteur Bailly a prouvé, par une suite de faits observés pendant près d'un siècle, que toutes les fois que, dans les naissances annuelles, le nombre des filles est notablement plus grand que celui des garçons, la surabondance des femelles est toujours due à des circonstances débilitantes; ce qui pourrait bien nous indiquer aussi l'origine des plaisanteries qu'on a faites de tout temps au mari dont la femme accouche d'une fille.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les aliments considérés dans leur ensemble, et sur les diverses modifications qu'ils peuvent subir par le mélange qu'on peut en faire; mais j'espère que ce qui précède suffira, et au-delà, pour le plus grand nombre de mes lecteurs. Je renvoie les autres au traité ex professo, et je finis par deux considérations qui ne sont pas sans quelque intérêt.
La première est que l'animalisation se fait à peu près de la même manière que la végétation, c'est-à-dire que le courant réparateur formé par la digestion est aspiré de diverses manières par les cribles ou suçoirs dont nos organes sont pourvus, et devient chair, ongle, os ou cheveu, comme la même terre arrosée de la même eau produit un radis, une laitue ou un pissenlit, selon les graines que le jardinier lui a confiées.
La seconde est qu'on n'obtient point, dans l'organisation vitale, les mêmes produits que dans la chimie absolue; car les organes destinés à produire la vie et le mouvement agissent puissamment sur les principes qui leur sont soumis.
Mais la nature, qui se plaît à s'envelopper de voiles et à nous arrêter au second ou au troisième pas, a caché le laboratoire où elle fait ses transformations; et il est véritablement difficile d'expliquer comment, étant convenu que le corps humain contient de la chaux, du phosphore, du fer et dix autres substances encore, tout cela peut cependant se soutenir et se renouveler pendant plusieurs années avec du pain et de l'eau.


SECTION II.
31.
Lorsque j'ai commencé d'écrire, ma table des matières était faite, et mon livre tout entier dans ma tête; cependant je n'ai avancé qu'avec lenteur, parce qu'une partie de mon temps est consacrée à des travaux plus sérieux.
Durant cet intervalle de temps, quelques parties de la matière que je croyais m'être réservée ont été effleurées; des livres élémentaires de chimie et de matière médicale ont été mis entre les mains de tout le monde; et des choses que je croyais enseigner pour la première fois sont devenues populaires: par exemple, j'avais employé à la chimie du pot-au-feu plusieurs pages dont la substance se trouve dans deux ou trois ouvrages récemment publiés.
En conséquence, j'ai dû revoir cette partie de mon travail, et l'ai tellement resserrée qu'elle se trouve réduite à quelques principes élémentaires, à des théories qui ne sauraient être trop propagées, et à quelques observations, fruit d'une longue expérience, et qui, je l'espère, seront nouvelles pour la grande partie de mes lecteurs.
§ Ier.--Pot-au-feu, Potage, etc.
32.
 N appelle pot-au-feu un morceau de boeuf
destiné à être traité à l'eau bouillante légèrement salée, pour en
extraire les parties solubles.
N appelle pot-au-feu un morceau de boeuf
destiné à être traité à l'eau bouillante légèrement salée, pour en
extraire les parties solubles.
Le bouillon est le liquide qui reste après l'opération consommée.
Enfin on appelle bouilli la chair dépouillée de sa partie soluble.
L'eau dissout d'abord une partie de l'osmazôme; puis l'albumine, qui, se coagulant avant le 50e degré de Réaumur, forme l'écume qu'on enlève ordinairement; puis, le surplus de l'osmazôme avec la partie extractive ou jus; enfin, quelques portions de l'enveloppe des fibres, qui sont détachées par la continuité de l'ébullition.
Pour avoir de bon bouillon, il faut que l'eau s'échauffe lentement, afin que l'albumine ne se coagule pas dans l'intérieur avant d'être extraite; et il faut que l'ébullition s'aperçoive à peine, afin que les diverses parties qui sont successivement dissoutes puissent s'unir intimement et sans trouble.
On joint au bouillon des légumes ou des racines pour en relever le goût, et du pain ou des pâtes pour le rendre plus nourrissant: c'est ce qu'on appelle un potage.
Le potage est une nourriture saine, légère, nourrissante, et qui convient à tout le monde; il réjouit l'estomac, et le dispose à recevoir et à digérer. Les personnes menacées d'obésité n'en doivent prendre que le bouillon.
On convient généralement qu'on ne mange nulle part d'aussi bon potage qu'en France, et j'ai trouvé dans mes voyages la confirmation de cette vérité. Ce résultat ne doit point étonner; car le potage est la base de la diète nationale française, et l'expérience des siècles a dû le porter à sa perfection.
§ II.--Du Bouilli.
33.
 E bouilli est une nourriture saine, qui apaise
promptement la faim, se digère assez bien, mais qui seul ne
restaure pas beaucoup, parce que la viande a perdu dans
l'ébullition une partie des sucs animalisables.
E bouilli est une nourriture saine, qui apaise
promptement la faim, se digère assez bien, mais qui seul ne
restaure pas beaucoup, parce que la viande a perdu dans
l'ébullition une partie des sucs animalisables.
On tient comme règle générale en administration que le boeuf bouilli a perdu la moitié de son poids.
Nous comprenons sous quatre catégories les personnes qui mangent le bouilli:
1° Les routiniers, qui en mangent parce que leurs parents en mangeaient, et qui, suivant cette pratique avec une soumission implicite, espèrent bien aussi être imités par leurs enfants;
2° Les impatients, qui, abhorrant l'inactivité à table, ont contracté l'habitude de se jeter immédiatement sur la première matière qui se présente (materiam subjectam);
3° Les inattentifs, qui, n'ayant pas reçu du ciel le feu sacré, regardent les repas comme les heures d'un travail obligé, mettent sur le même niveau tout ce qui peut les nourrir, et sont à table comme l'huître sur son banc;
4° Les dévorants, qui, doués d'un appétit dont ils cherchent à dissimuler l'étendue, se hâtent de jeter dans leur estomac une première victime pour apaiser le feu gastrique qui les dévore, et servir de base aux divers envois qu'ils se proposent d'acheminer pour la même destination.
Les professeurs ne mangent jamais de bouilli, par respect pour les principes et parce qu'ils ont fait entendre en chaire cette vérité incontestable: Le bouilli est de la chair moins son jus 13.
Note 13:(retour) Cette vérité commence à percer, et le bouilli a disparu dans les dîners véritablement soignés; on le remplace par un filet rôti, un turbot ou une matelote.
§ III.--Volailles.
34.
 E suis grand partisan des causes secondes, et
crois fermement que le genre entier des gallinacés a été créé
uniquement pour doter nos garde-mangers et enrichir nos
banquets.
E suis grand partisan des causes secondes, et
crois fermement que le genre entier des gallinacés a été créé
uniquement pour doter nos garde-mangers et enrichir nos
banquets.
Effectivement, depuis la caille jusqu'au coq-d'Inde, partout où on rencontre un individu de cette nombreuse famille, on est sûr de trouver un aliment léger, savoureux, et qui convient également au convalescent et à l'homme qui jouit de la plus robuste santé.
Car quel est celui d'entre nous qui, condamné par la Faculté à la chère des Pères du désert, n'a pas souri à l'aile de poulet proprement coupée, qui lui annonçait qu'enfin il allait être rendu à la vie sociale?

Nous ne nous sommes pas contentés des qualités que la nature avait données aux gallinacés; l'art s'en est emparé, et sous prétexte de les améliorer, il en a fait des martyrs. Non seulement on les prive des moyens de se reproduire, mais on les tient dans la solitude, on les jette dans l'obscurité, on les force à manger et on les amène ainsi à un embonpoint qui ne leur était pas destiné.
Il est vrai que cette graisse ultra-naturelle est aussi délicieuse, et que c'est au moyen de ces pratiques damnables qu'on leur donne cette finesse et cette succulence qui en font les délices de nos meilleures tables.
Ainsi améliorée, la volaille est pour la cuisine ce qu'est la toile pour les peintres, et pour les charlatans le chapeau de Fortunatus; on nous la sert bouillie, rôtie, frite, chaude ou froide, entière ou par parties, avec ou sans sauce, désossée, écorchée, farcie, et toujours avec un égal succès.
Trois pays de l'ancienne France se disputent l'honneur de fournir les meilleures volailles savoir: le pays de Caux, le Mans et la Bresse.
Relativement aux chapons, il y a du doute, et celui qu'on tient sous la fourchette doit paraître le meilleur; mais pour les poulardes, la préférence appartient à celles de Bresse, qu'on appelle poulardes fines, et qui sont rondes comme une pomme; c'est grand dommage qu'elles soient rares à Paris, où elles n'arrivent que dans des bourriches votives.
§ IV.--Du Coq-d'Inde.
35.
 E dindon est certainement un des plus beaux
cadeaux que le nouveau monde ait faits à l'ancien.
E dindon est certainement un des plus beaux
cadeaux que le nouveau monde ait faits à l'ancien.
Ceux qui veulent toujours en savoir plus que les autres ont dit que le dindon était connu aux Romains, qu'il en fut servi un aux noces de Charlemagne, et qu'ainsi c'est mal à propos qu'on attribue aux jésuites l'honneur de cette savoureuse importation.
À ces paradoxes on pourrait n'opposer que deux choses:
1° Le nom de l'oiseau, qui atteste son origine; car autrefois l'Amérique était désignée sous le nom d'Indes occidentales;
2° La figure du coq-d'Inde, qui est évidemment tout étrangère.
Un savant ne pourrait pas s'y tromper.
Mais, quoique déjà bien persuadé, j'ai fait à ce sujet des recherches assez étendues, dont je fait grâce au lecteur, et qui m'ont donné pour résultat:
1° Que le dindon a paru en Europe vers la fin du dix-septième siècle.
2° Qu'il a été importé par les jésuites, qui en élevaient une grande quantité, spécialement dans une ferme qu'ils possédaient aux environs de Bourges.
3° Que c'est de là qu'ils se sont répandus peu à peu sur la surface de la France: c'est ce qui fait qu'en beaucoup d'endroits, et dans le langage familier, on disait autrefois et on dit encore un jésuite, pour désigner un dindon;
4° Que l'Amérique est le seul endroit où on a trouvé le dindon sauvage et dans l'état de nature (il n'en existe pas en Afrique);
5° Que dans les fermes de l'Amérique septentrionale où il est fort commun, il provient, soit des oeufs qu'on a pris et fait couver, soit des jeunes dindonneaux qu'on a surpris dans les bois et apprivoisés: ce qui fait qu'ils sont plus près de l'état de nature, et conservent davantage leur plumage primitif.
Et vaincu par ces preuves, je conserve aux bons pères une double part de reconnaissance, car ils ont aussi importé le quinquina, qui se nommait en anglais Jésuit's bark (écorce des jésuites).
Les mêmes recherches m'ont appris que l'espèce du coq-d'Inde s'acclimate insensiblement en France avec le temps. Des observateurs éclairés m'ont appris que vers le milieu du siècle précédent, sur vingt dindons éclos, dix à peine venaient à bien; tandis que maintenant, toutes choses égales, sur vingt on en élève quinze. Les pluies d'orage leur sont surtout funestes. Les grosses gouttes de pluie, chassées par le vent, frappent sur leur tête tendre et mal abritée, elles font périr.
Des Dindoniphiles.
36.--Le dindon est le plus gros, et sinon le plus fin, du moins le plus savoureux de nos oiseaux domestiques.
Il jouit encore de l'avantage unique de réunir autour de soi toutes les classes de la société.
Quand les vignerons et les cultivateurs de nos campagnes veulent se régaler dans les longues soirées d'hiver, que voit-on rôtir au feu brillant de la cuisine où la table est mise? un dindon.
Quand le fabricant utile, quand l'artiste laborieux rassemble quelques amis pour jouir d'un relâche d'autant plus doux qu'il est plus rare, quelle est la pièce obligée du dîner qu'il leur offre? un dindon farci de saucisses ou de marrons de Lyon.
Et dans nos cercles les plus éminemment gastronomiques, dans ces réunions choisies, où la politique est forcée de céder le pas aux dissertations sur le goût, qu'attend-on? que désire-t-on? que voit-on au second service? une dinde truffée!... Et mes mémoires secrets contiennent la note que son suc restaurateur a plus d'une fois éclairci des faces éminemment diplomatiques.
Influence financière du dindon.
37.--L'importation des dindons est devenue la cause d'une addition importante à la fortune publique, et donne lieu à un commerce assez considérable.
Au moyen de l'éducation des dindons, les fermiers acquittent plus facilement le prix de leurs baux; les jeunes filles amassent souvent une dot suffisante, et les citadins qui veulent se régaler de cette chair étrangère sont obligés de céder leurs écus en compensation.
Dans cet article purement financier, les dindes truffées demandent une attention particulière.
J'ai quelque raison de croire que depuis le commencement de novembre jusqu'à la fin de février, il se consomme à Paris trois cents dindes truffées par jour: en tout trente-six mille dindes.
Le prix commun de chaque dinde, ainsi conditionnée, est au moins de 20 fr., en tout 720,000 fr.; ce qui fait un fort joli mouvement d'argent. À quoi il faut joindre une somme pareille pour les volailles, faisans, poulets et perdrix pareillement truffés, qu'on voit chaque jour étalés dans les magasins de comestibles, pour le supplice des contemplateurs qui se trouvent trop courts pour y atteindre.
Exploit du professeur.
38.
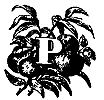 ENDANT mon séjour à Hartfort dans le
Connecticut, j'ai eu le bonheur de tuer une dinde sauvage. Cet
exploit mérite de passer à la postérité, et je le conterai avec
d'autant plus de complaisance que c'est moi qui en suis le
héros.
ENDANT mon séjour à Hartfort dans le
Connecticut, j'ai eu le bonheur de tuer une dinde sauvage. Cet
exploit mérite de passer à la postérité, et je le conterai avec
d'autant plus de complaisance que c'est moi qui en suis le
héros.
Un vénérable propriétaire américain (american farmer) m'avait invité à aller chasser chez lui; il demeurait sur les derrières de l'état (back grounds), me promettait des perdrix, des écureuils gris, des dindes sauvages (wild cocks), et me donnait la faculté d'y mener avec moi un ami ou deux à mon choix.

En conséquence, un beau jour d'octobre 1794, nous nous acheminâmes, M. King et moi, montés sur deux chevaux de louage, avec l'espoir d'arriver vers le soir à la ferme de M. Bulow, située à cinq mortelles lieues de Hartfort, dans le Connecticut.
M. King était un chasseur d'une espèce extraordinaire; il aimait passionnément cet exercice; mais quand il avait tué une pièce de gibier, il se regardait comme un meurtrier, et faisait sur le sort du défunt des réflexions morales et des élégies qui ne l'empêchaient pas de recommencer.
Quoique le chemin fût à peine tracé, nous arrivâmes sans accident, et nous fûmes reçus avec cette hospitalité cordiale et silencieuse qui s'exprime par des actes, c'est-à-dire qu'en peu d'instants tout fut examiné, caressé et hébergé, hommes, chevaux et chiens suivant les convenances respectives.
Deux heures environ furent employées à examiner la ferme et ses dépendances: je décrirais tout cela si je voulais, mais j'aime mieux montrer au lecteur quatre beaux brins de fille (buxum lasses) dont M. Bulow était père, et pour qui notre arrivée était un grand événement.
Leur âge était de seize à vingt ans; elles étaient rayonnantes de fraîcheur et de santé, et il y avait dans toute leur personne tant de simplicité, de souplesse et d'abandon, que l'action la plus commune suffisait pour leur prêter mille charmes.
Peu après notre retour de la promenade, nous nous assîmes autour d'une table abondamment servie. Un superbe morceau de corn'd beef (boeuf à mi-sel), une oie daubée (stew'd), et une magnifique jambe de mouton (gigot), puis des racines de toute espèce (plenty), et aux deux bouts de la table deux énormes pots d'un cidre excellent dont je ne pouvais pas me rassasier.
Quand nous eûmes montré à notre hôte que nous étions de vrais chasseurs, du moins par l'appétit, il s'occupa du but de notre voyage: il nous indiqua de son mieux les endroits où nous trouverions du gibier, les points de reconnaissance qui nous guideraient au retour, et surtout les fermes où nous pourrions trouver de quoi nous rafraîchir.
Pendant cette conversation, les dames avaient préparé d'excellent thé, dont nous avalâmes plusieurs tasses; après quoi on nous montra une chambre à deux lits, où l'exercice et la bonne chère nous procurèrent un sommeil délicieux.
Le lendemain, nous nous mîmes en chasse un peu tard; et parvenus au bout des défrichements faits par les ordres de M. Bulow, je me trouvai, pour la première fois, dans une forêt vierge, et où la cognée ne s'était jamais fait entendre.
Je m'y promenais avec délices, observant les bienfaits et les ravages du temps qui crée et détruit, et je m'amusais à suivre toutes les périodes de la vie d'un chêne, depuis le moment où il sort de la terre avec deux feuilles, jusqu'à celui où il ne reste plus de lui qu'une longue trace noire, qui est la poussière de son coeur.
M. King me reprocha mes distractions, et nous nous mîmes à chasser. Nous tuâmes d'abord quelques-unes de ces jolies petites perdrix grises qui sont si rondes et si tendres. Nous abattîmes ensuite six ou sept écureuils gris, dont on fait grand cas dans ce pays; enfin notre heureuse étoile nous amena au milieu d'une compagnie de coqs-d'Inde.
Ils partirent à peu d'intervalle les uns des autres, d'un vol bruyant, rapide, et en faisant de grands cris. M. Kang tira sur le premier, et courut après: les autres étaient hors de portée; enfin, le plus paresseux s'éleva à dix pas de moi; je le tirai dans une clairière, et il tomba raide mort.
Il faut être chasseur pour concevoir l'extrême joie que me causa un si beau coup de fusil. J'empoignai la superbe volatile, et je la retournais en tout sens depuis un quart d'heure, quand j'entendis M. King qui criait à l'aide; j'y courus, et je trouvai qu'il ne m'appelait que pour l'aider dans la recherche d'un dindon qu'il prétendait avoir tué, et qui n'en avait pas moins disparu.
Je mis mon chien sur la trace; mais il nous conduisit dans des halliers si épais et si épineux qu'un serpent n'y aurait pas pénétré; il fallut donc y renoncer; ce qui mit mon camarade dans un accès d'humeur qui dura jusqu'au retour.
Le surplus de notre chasse ne mérite pas les honneurs de l'impression. Au retour, nous nous égarâmes dans ces bois indéfinis, et nous courions grand risque d'y passer la nuit, sans les voix argentines des demoiselles Bulow et la pédale de leur papa, qui avait eu la bonté de venir au-devant de nous, et qui nous aidèrent à nous en tirer.
Les quatre soeurs s'étaient mises sous les armes: des robes très fraîches, des ceintures neuves, de jolis chapeaux et une chaussure soignée annoncèrent qu'on avait fait quelques frais pour nous; et j'eus, de mon côté, l'intention d'être aimable pour celle de ces demoiselles qui vint prendre mon bras, tout aussi propriétairement que si elle eût été ma femme.
En arrivant à la ferme, nous trouvâmes le souper servi; mais, avant que d'en profiter, nous nous assîmes un instant auprès d'un feu vif et brillant qu'on avait allumé pour nous, quoique le temps n'eût pas indiqué cette précaution. Nous nous en trouvâmes très bien, et fûmes délassés comme par enchantement.
Cette pratique venait sans doute des Indiens, qui ont toujours du feu dans leur case. Peut-être aussi est-ce une tradition de saint François de Sales, qui disait que le feu était bon douze mois de l'année. (Non liquet.)
Nous mangeâmes comme des affamés; un ample bowl de punch vint nous aider à finir la soirée, et une conversation où notre hôte mit bien plus d'abandon que la veille nous conduisit assez avant dans la nuit.
Nous parlâmes de la guerre de l'indépendance, où M. Bulow avait servi comme officier supérieur; de M. de La Fayette, qui grandit sans cesse dans le souvenir des Américains, qui ne le désignent que par sa qualité (the marquis); de l'agriculture, qui, en ce temps, enrichissait les États-Unis, et enfin de cette chère France, que j'aimais bien plus depuis que j'avais été forcé de la quitter.
Pour reposer la conversation, M. Bulow disait de temps à autre à sa fille aînée: «Mariah! give us a song.» Et elle nous chanta sans se faire prier, et avec un embarras charmant, la chanson nationale Yankee dudde, la complainte de la reine Marie et celle du major André, qui sont tout-à-fait populaires en ce pays. Maria avait pris quelques leçons, et, dans ces lieux élevés, passait pour une virtuose; mais son chant tirait surtout son mérite de la qualité de sa voix, qui était à la fois douce, fraîche et accentuée.
Le lendemain nous partîmes malgré les instances les plus amicales: car là aussi j'avais des devoirs à remplir. Pendant qu'on préparait les chevaux, M. Bulow, m'ayant pris à part, me dit ces paroles remarquables:
«Vous voyez en moi, mon cher monsieur, un homme heureux, s'il y en a un sous le ciel: tout ce qui vous entoure et ce que vous avez vu chez moi sort de mes propriétés. Ces bas, mes filles les ont tricotés; mes souliers et mes habits proviennent de mes troupeaux; ils contribuent aussi, avec mon jardin et ma basse-cour, à me fournir une nourriture simple et substantielle; et ce qui fait l'éloge de notre gouvernement, c'est qu'on compte dans le Connecticut des milliers de fermiers tout aussi contents que moi, et dont les portes, de même que les miennes, n'ont pas de serrures.
«Les impôts ici ne sont presque rien; et tant qu'ils sont payés nous pouvons dormir sur les deux oreilles. Le congrès favorise de tout son pouvoir notre industrie naissante; des facteurs se croisent en tout sens pour nous débarrasser de ce que nous avons à vendre; et j'ai de l'argent comptant pour longtemps, car je viens de vendre, au prix de vingt-quatre dollars le tonneau, la farine que je donne ordinairement pour huit.
«Tout nous vient de la liberté que nous avons conquise et fondée sur de bonnes lois. Je suis maître chez moi, et vous ne vous en étonnerez pas quand vous saurez qu'on n'y entend jamais le bruit du tambour, et que, hors le 4 juillet, anniversaire glorieux de notre indépendance, on n'y voit ni soldats, ni uniformes, ni baïonnettes.»
Pendant tout le temps que dura notre retour, j'eus l'air absorbé dans de profondes réflexions: on croira peut-être que je m'occupais de la dernière allocution de M. Bulow; mais j'avais bien d'autres sujets de méditation: je pensais à la manière dont je ferais cuire mon coq-d'Inde, et je n'étais pas sans embarras, parce que je craignais de ne pas trouver à Hartford tout ce que j'aurais désiré; car je voulais m'élever un trophée en étalant avec avantage mes dépouilles opimes.
Je fais un douloureux sacrifice en supprimant les détails du travail profond dont le but était de traiter d'une manière distinguée les convives américains que j'avais engagés. Il suffira de dire que les ailes de perdrix furent servies en papillote, et les écureuils gris courbouillonnés au vin de Madère.
Quant au dindon, qui faisait notre unique plat de rôti, il fut charmant à la vue, flatteur à l'odorat et délicieux au goût. Aussi, jusqu'à la consommation de la dernière de ses particules, on entendait tout autour de la table: «Very good! exceedingly good! oh! dear sir, what a glorious bit!» Très bon, extrêmement bon! ô mon cher monsieur, quel glorieux morceau 14!
Note 14:(retour) La chair de la dinde sauvage est plus colorée et plus parfumée que celle de la dinde domestique...J'ai appris avec plaisir que mon estimable collègue, M. Bosc, en avait tué dans la Caroline, qu'il les avait trouvées excellentes, et surtout bien meilleures que celles que nous élevons en Europe. Aussi conseille-t-il à ceux qui en élèvent de leur donner le plus de liberté possible, de les conduire aux champs, et même dans les bois, pour en rehausser le goût et les rapprocher d'autant de l'espèce primitive. (Annales d'Agriculture, cah. du 28 février 1821.)
§ V.--Du Gibier.
39.
 N entend par gibier les animaux bons à manger
qui vivent dans les bois et les campagnes, dans l'état de liberté
naturelle.
N entend par gibier les animaux bons à manger
qui vivent dans les bois et les campagnes, dans l'état de liberté
naturelle.
Nous disons bons à manger, parce que quelques-uns de ces animaux ne sont pas compris sous la dénomination de gibier. Tels sont les renards, blaireaux, corbeaux, pies, chats-huants et autres: on les appelle bêtes puantes.
Nous divisons le gibier en trois séries:
La première commence à la grive et contient, en descendant, tous les oiseaux de moindre volume, appelés petits oiseaux.
La seconde commence en remontant au râle de genêt, à la bécasse, à la perdrix, au faisan, au lapin et au lièvre; c'est le gibier proprement dit: gibier de terre et gibier de marais, gibier de poil, gibier de plume.
La troisième est plus connue sous le nom de venaison; elle se compose du sanglier, du chevreuil et de tous les autres animaux fissipèdes.
Le gibier fait les délices de nos tables; c'est une nourriture saine, chaude, savoureuse, de haut goût, et facile à digérer toutes les fois que l'individu est jeune.
Mais ces qualités n'y sont pas tellement inhérentes qu'elles ne dépendent beaucoup de l'habileté du préparateur qui s'en occupe. Jetez dans un pot du sel, de l'eau et un morceau de boeuf, vous en retirerez du bouilli et du potage. Au boeuf, substituez du sanglier ou du chevreuil, vous n'aurez rien de bon; tout l'avantage, sous ce rapport, appartient à la viande de boucherie.
Mais sous les ordres d'un chef instruit, le gibier subit un grand nombre de modifications et transformations savantes, et fournit la plupart des mets de haute saveur qui constituent la cuisine transcendante.
Le gibier tire aussi une grande partie de son prix de la nature du sol où il se nourrit; le goût d'une perdrix rouge du Périgord n'est pas le même que celui d'une perdrix rouge de Sologne; et quand le lièvre tué dans les plaines des environs de Paris ne paraît qu'un plat assez insignifiant, un levreau né sur les coteaux brûlés du Valromey ou du Haut-Dauphiné est peut-être le plus parfumé de tous les quadrupèdes.
Parmi les petits oiseaux, le premier, par ordre d'excellence, est sans contredit le becfigue.
Il s'engraisse au moins autant que le rouge-gorge ou l'ortolan, et la nature lui a donné en outre une amertume légère et un parfum unique si exquis, qu'ils engagent, remplissent et béatifient toutes les puissances dégustatrices. Si un becfigue était de la grosseur d'un faisan, on le paierait certainement à l'égal d'un arpent de terre.
C'est grand dommage que cet oiseau privilégié se voie si rarement à Paris: il en arrive à la vérité quelques-uns, mais il leur manque la graisse qui fait tout leur mérite, et on peut dire qu'ils ressemblent à peine à ceux qu'on voit dans les départements de l'est ou du midi de la France 15.
Note 15:(retour) J'ai entendu parler à Belley, dans ma jeunesse, du jésuite Fabi, né dans ce diocèse, et du goût particulier qu'il avait pour les becfigues.Dès qu'on en entendait crier, on disait: Voilà les becfigues, le père Fabi est en route. Effectivement, il ne manquait jamais d'arriver le 1er septembre avec un ami: ils venaient s'en régaler pendant tout le passage; chacun se faisait un plaisir de les inviter, et ils partaient vers le 25.
Tant qu'il fut en France, il ne manqua jamais de faire son voyage ornithophilique, et ne l'interrompit que quand il fut envoyé à Rome, où il mourut pénitencier en 1688.
Le père Fabi (Honoré) était un homme de grand savoir; il a fait divers ouvrages de théologie et de physique, dans l'un desquels il cherche à prouver qu'il avait découvert la circulation du sang avant ou du moins aussitôt qu'Harvey.
Peu de gens savent manger les petits oiseaux; en voici la méthode telle qu'elle m'a été confidentiellement transmise par le chanoine Charcot, gourmand par état et gastronome parfait, trente ans avant que le nom fût connu.
Prenez par le bec un petit oiseau bien gras, saupoudrez-le d'un peu de sel, ôtez-en le gésier, enfoncez-le adroitement dans votre bouche, mordez et tranchez tout près de vos doigts, et mâchez vivement: il en résulte un suc assez abondant pour envelopper tout l'organe, et vous goûterez un plaisir inconnu au vulgaire.
Odi profanum vulgus, et arceo. Horace.
La caille est, parmi le gibier proprement dit, ce qu'il y a de plus mignon et de plus aimable. Une caille bien grasse plaît également par son goût, sa forme et sa couleur. On fait acte d'ignorance toutes les fois qu'on la sert autrement que rôtie ou en papillotes, parce que son parfum est très fugace, et toutes les fois que l'animal est en contact avec un liquide, il se dissout, s'évapore et se perd.
La bécasse est encore un oiseau très distingué, mais peu de gens en connaissent tous les charmes. Une bécasse n'est dans toute sa gloire que quand elle a été rôtie sous les yeux d'un chasseur, surtout du chasseur qui l'a tuée; alors la rôtie est confectionnée suivant les règles voulues, et la bouche s'inonde de délices.
Au-dessus des précédents, et même de tous, devrait se placer le faisan; mais peu de mortels savent le présenter à point.
Un faisan mangé dans la première huitaine de sa mort ne vaut ni une perdrix ni un poulet, car son mérite consiste dans son arôme.
La science a considéré l'expansion de cet arôme, l'expérience l'a mise en action, et un faisan saisi pour son infocation est un morceau digne des gourmands les plus exaltés.
On trouvera dans les Variétés la manière de rôtir un faisan à la sainte alliance. Le moment est venu où cette méthode, jusqu'ici concentrée dans un petit cercle d'amis, doit s'épancher au dehors pour le bonheur de l'humanité. Un faisan aux truffes est moins bon qu'on ne pourrait le croire; l'oiseau est trop sec pour oindre le tubercule; et d'ailleurs le fumet de l'un et le parfum de l'autre se neutralisent en s'unissant, ou plutôt ne se conviennent pas.
§ VI.--Du Poisson.
40.
 UELQUES savants, d'ailleurs peu orthodoxes, ont
prétendu que l'Océan avait été le berceau commun de tout ce qui
existe; que l'espèce humaine elle-même était née dans la mer, et
qu'elle ne devait son état actuel qu'à l'influence de l'air et aux
habitudes qu'elle a été obligée de prendre pour séjourner dans ce
nouvel élément.
UELQUES savants, d'ailleurs peu orthodoxes, ont
prétendu que l'Océan avait été le berceau commun de tout ce qui
existe; que l'espèce humaine elle-même était née dans la mer, et
qu'elle ne devait son état actuel qu'à l'influence de l'air et aux
habitudes qu'elle a été obligée de prendre pour séjourner dans ce
nouvel élément.
Quoi qu'il en soit, il est au moins certain que l'empire des eaux contient une immense quantité d'êtres de toutes les formes et de toutes les dimensions, qui jouissent des propriétés vitales dans des proportions très différentes, et suivant un mode qui n'est point le même que celui des animaux à sang chaud..
Il n'est pas moins vrai qu'il présente, en tout temps et partout une masse énorme d'aliments, etc., et que, dans l'état actuel de la science, il introduit sur nos tables la plus agréable variété.
Le poisson, moins nourrissant que la chair, plus succulent que les végétaux, est un mezzo termine qui convient à presque tous les tempéraments, et qu'on peut permettre même aux convalescents.
Les Grecs et les Romains, quoique moins avancés que nous dans l'art d'assaisonner le poisson, n'en faisaient pas moins très grand cas, et poussaient la délicatesse jusqu'à pouvoir deviner au goût en quelles eaux ils avaient été pris.
Ils en conservaient dans des viviers; et l'on connaît la cruauté de Vadius Pollion, qui nourrissait des murènes avec les corps des esclaves qu'il faisait mourir: cruauté que l'empereur Domitien désapprouva hautement, mais qu'il aurait dû punir.
Un grand débat s'est élevé sur la question de savoir lequel doit l'emporter, du poisson de mer ou du poisson d'eau douce.
Le différend ne sera probablement jamais jugé, conformément au proverbe espagnol, sobre los gustos, no hai disputa. Chacun est affecté à sa manière: ces sensations fugitives ne peuvent s'exprimer par aucun caractère connu, et il n'y a pas d'échelle pour estimer si un cabillaud, une sole ou un turbot valent mieux qu'une truite saumonnée, un brochet de haut bord, ou même une tanche de six ou sept livres.
II est bien convenu que le poisson est beaucoup moins nourrissant que la viande, soit parce qu'il ne contient point d'osmazôme, soit parce qu'étant bien plus léger en poids, sous le même volume il contient moins de matière. Le coquillage et spécialement les huîtres fournissent peu de substance nutritive, c'est ce qui fait qu'on en peut manger beaucoup sans nuire au repas qui suit immédiatement.
On se souvient qu'autrefois un festin de quelque apparat commençait ordinairement par des huîtres, et qu'il se trouvait toujours un bon nombre de convives qui ne s'arrêtaient pas sans en avoir avalé une grosse (douze douzaines, cent quarante-quatre). J'ai voulu savoir quel était le poids de cette avant-garde, et j'ai vérifié qu'une douzaine d'huîtres (eau comprise) pesait quatre onces, poids marchand: ce qui donne pour la grosse trois livres. Or, je regarde comme certain que les mêmes personnes, qui n'en dînaient pas moins bien après les huîtres, eussent été complètement rassasiées si elles avaient mangé la même quantité de viande, quand même ç'aurait été de la chair de poulet.
Anecdote.
En 1798, j'étais à Versailles, en qualité de commissaire du Directoire, et j'avais des relations assez fréquentes avec le sieur Laperte, greffier du tribunal du département; il était grand amateur d'huîtres et se plaignait de n'en avoir jamais mangé à satiété, ou, comme il le disait: tout son soûl.
Je résolus de lui procurer cette satisfaction, et à cet effet je l'invitai à dîner avec moi le lendemain.
Il vint; je lui tins compagnie jusqu'à la troisième douzaine, après quoi je le laissai aller seul. Il alla ainsi jusqu'à la trente-deuxième, c'est-à-dire pendant plus d'une heure, car l'ouvreuse n'était pas bien habile.

Cependant j'étais dans l'inaction, et comme c'est à table qu'elle est vraiment pénible, j'arrêtai mon convive au moment où il était le plus en train: «Mon cher, lui dis-je, votre destin n'est pas de manger aujourd'hui votre soûl d'huîtres, dînons.» Nous dînâmes, et il se comporta avec la vigueur et la tenue d'un homme qui aurait été à jeun.
Muria.--Garum.
41.
Les anciens tiraient du poisson deux assaisonnements de très haut goût, le muria et le garum.
 E premier n'était que la saumure de thon, ou,
pour parler plus exactement, la substance liquide que le mélange de
sel faisait découler de ce poisson.
E premier n'était que la saumure de thon, ou,
pour parler plus exactement, la substance liquide que le mélange de
sel faisait découler de ce poisson.
Le garum, qui était plus cher, nous est beaucoup moins connu. On croit qu'on le tirait par expression des entrailles marinées du scombre ou maquereau; mais alors rien ne rendrait raison de ce haut prix. Il y a lieu de croire que c'était une sauce étrangère, et peut-être n'était-ce autre chose que le soy qui nous vient de l'Inde, et qu'on sait être le résultat de poissons fermentés avec des champignons.
Certains peuples, par leur position, sont réduits à vivre presque uniquement de poisson; ils en nourrissent pareillement leurs animaux de travail, que l'habitude finit par soumettre à ces aliments insolites; ils en fument même leurs terres, et cependant la mer qui les environne ne cesse pas de leur en fournir toujours la même quantité.
On a remarqué que ces peuples ont moins de courage que ceux qui se nourrissent de chair; ils sont pâles, ce qui n'est point étonnant, parce que, d'après les éléments dont le poisson est composé, il doit plus augmenter la lymphe que réparer le sang.
On a pareillement observé parmi les nations ichthyophages des exemples nombreux de longévité, soit parce qu'une nourriture peu substantielle et plus légère leur sauve les inconvénients de la pléthore, soit que les sucs qu'elle contient, n'étant destinés par la nature qu'à former au plus des arêtes et des cartilages qui n'ont jamais une grande durée, l'usage habituel qu'en font les hommes retarde chez eux de quelques années la solidification de toutes les parties du corps, qui devient enfin la cause nécessaire de la mort naturelle.
Quoi qu'il en soit, le poisson, entre les mains d'un préparateur habile, peut devenir une source inépuisable de jouissances gustuelles; on le sert entier, dépecé, tronçonné, à l'eau, à l'huile, au vin, froid, chaud, et toujours il est également bien reçu; mais il ne mérite jamais un accueil plus distingué que lorsqu'il parait sous la forme d'une matelotte.
Ce ragoût, quoiqu'imposé par la nécessité aux mariniers qui parcourent nos fleuves, et perfectionné seulement par les cabaretiers du bord de l'eau, ne leur est pas moins redevable d'une bonté que rien ne surpasse; et les ichthyophiles ne les voient jamais paraître sans exprimer leur ravissement, soit à cause de la franchise de son goût, soit parce qu'il réunit plusieurs qualités, soit enfin parce qu'on peut en manger presque indéfiniment sans craindre ni la satiété ni l'indigestion.
La gastronomie analytique a cherché à examiner quels sont, sur l'économie animale, les effets du régime ichthyaque, et des observations unanimes ont démontré qu'il agit fortement sur le génésique, et éveille chez les deux sexes l'instinct de la production.
L'effet une fois connu, on en trouva d'abord deux causes tellement immédiates qu'elles étaient à la portée de tout le monde, savoir: 1° diverses manières de préparer le poisson, dont les assaisonnements sont évidemment irritants, tel que le caviar, les harengs saurs, le thon mariné, la morue, le stock-fish, et autres pareils; 2° les sucs divers dont le poisson est imbibé, qui sont éminemment inflammables, et s'oxygènent et se rancissent par la digestion.
Une analyse plus profonde en a découvert une troisième encore plus active, savoir: la présence du phosphore qui se trouve tout formé dans les laites, et qui ne manque pas de se montrer en décomposition.
Ces vérités physiques étaient sans doute ignorées de ces législateurs ecclésiastiques qui imposèrent la diète quadragésimale à diverses communautés de moines, telles que les Chartreux, les Récollets, les Trappistes et les Carmes Déchaux réformés par sainte Thérèse; car on ne peut pas supposer qu'ils aient eu pour but de rendre encore plus difficile l'observance du but de chasteté, déjà si antisocial.
Sans doute, dans cet état de choses, des victoires éclatantes ont été remportées, des sens bien rebelles ont été soumis; mais aussi que de chutes! que de défaites! Il faut qu'elles aient été bien avérées, puisqu'elles finirent par donner à un ordre religieux une réputation semblable à celle d'Hercule chez les filles de Danaüs, ou du maréchal de Saxe auprès de mademoiselle Lecouvreur.
Au reste, ils auraient pu être éclairés par une anecdote déjà ancienne, puisqu'elle nous est venue par les croisades.
Le sultan Saladin, voulant éprouver jusqu'à quel point pouvait aller la continence des derviches, en prit deux dans son palais, et pendant un certain espace de temps les fit nourrir des viandes les plus succulentes.
Bientôt la trace des sévérités qu'ils avaient exercées sur eux-mêmes s'effaça, et leur embonpoint commença à reparaître.
Dans cet état, on leur donna pour compagnes deux odalisques d'une beauté toute puissante, mais elles échouèrent dans leurs attaques les mieux dirigées, et les deux saints sortirent d'une épreuve aussi délicate, purs comme le diamant de Visapour.
Le sultan les garda encore dans son palais, et pour célébrer leur triomphe, leur fit faire pendant plusieurs semaines une chère également soignée, mais exclusivement en poisson.
À peu de jours, on les soumit de nouveau au pouvoir réuni de la jeunesse et de la beauté; mais cette fois, la nature fut la plus forte, et les trop heureux cénobites succombèrent... étonnamment.
Dans l'état actuel de nos connaissances, il est probable que, si le cours des choses ramenait quelque ordre monacal; les supérieurs chargés de les diriger adopteraient un régime plus favorable à l'accomplissement de leurs devoirs.
Réflexion philosophique.
42.--Le poisson, pris dans la collection de ses espèces, est pour le philosophe un sujet inépuisable de méditation et d'étonnement.
Les formes variées de ces étranges animaux, les sens qui leur manquent, la restriction de ceux qui leur ont été accordés, leurs diverses manières d'exister, l'influence qu'a dû exercer sur tout cela la différence du milieu dans lequel ils sont destinés à vivre, respirer et se mouvoir, étendent la sphère de nos idées et des modifications indéfinies qui peuvent résulter de la matière, du mouvement et de la vie.
Quant à moi, j'ai pour eux un sentiment qui ressemble au respect, et qui naît de persuasion intime où je suis que ce sont des créatures évidemment antédiluviennes; car le grand cataclysme, qui noya nos grands-oncles vers le dix-huitième siècle de la création du monde, ne fut pour les poissons qu'un temps de joie, de conquête, de festivité.
§ VII.--Des Truffes.
43.
 UI dit truffe prononce un grand mot qui
réveille des souvenirs érotiques et gourmands chez le sexe portant
jupes, et des souvenirs gourmands et érotiques chez le sexe portant
barbe.
UI dit truffe prononce un grand mot qui
réveille des souvenirs érotiques et gourmands chez le sexe portant
jupes, et des souvenirs gourmands et érotiques chez le sexe portant
barbe.
Cette duplication honorable vient de ce que cet éminent tubercule passe non-seulement pour délicieux au goût; mais encore parce qu'on croit qu'il élève une puissance dont l'exercice est accompagné des plus doux plaisirs.
L'origine de la truffe est inconnue: on la trouve, mais on ne sait ni comment elle naît ni comment elle végète. Les hommes les plus habiles s'en sont occupés: on a cru en reconnaître les graines, on a promis qu'on en sèmerait à volonté. Efforts inutiles! promesses mensongères! jamais la plantation n'a été suivie de la récolte, et ce n'est peut-être pas un grand malheur; car, comme le prix des truffes tient un peu au caprice, peut-être les estimerait-on moins si on les avait en quantité et à bon marché.
«Réjouissez-vous, chère amie, disais-je un jour à madame de Ville-Plaine; on vient de présenter à la Société d'encouragement un métier au moyen duquel on fera de la dentelle superbe, et qui ne coûtera presque rien.--Eh! me répondit cette belle avec un regard de souveraine indifférence, si la dentelle était à bon marché, croyez-vous qu'on voudrait porter de semblables guenilles?»
De la Vertu érotique des Truffes.
44.
 ES Romains ont connu la truffe; mais il ne
paraît pas que l'espèce française soit parvenue jusqu'à eux. Celles
dont ils faisaient leurs délices leur venaient de Grèce, d'Afrique,
et principalement de Libye; la substance en était blanche et
rougeâtre, et les truffes de Libye étaient les plus recherchées,
comme à la fois plus délicates et plus parfumées.
ES Romains ont connu la truffe; mais il ne
paraît pas que l'espèce française soit parvenue jusqu'à eux. Celles
dont ils faisaient leurs délices leur venaient de Grèce, d'Afrique,
et principalement de Libye; la substance en était blanche et
rougeâtre, et les truffes de Libye étaient les plus recherchées,
comme à la fois plus délicates et plus parfumées.
Libidinis alimenta per omnia quærunt. Juvénal.
Des Romains jusqu'à nous il y a eu un long interrègne, et la résurrection des truffes est assez récente; car j'ai lu plusieurs anciens dispensaires où il n'en est pas mention: on peut même dire que la génération qui s'écoule au moment où j'écris en a été presque témoin.
Vers 1780, les truffes étaient rares à Paris; on n'en trouvait, et seulement en petite quantité, qu'à l'hôtel des Américains et à l'hôtel de Provence, et une dinde truffée était un objet de luxe qu'on ne voyait qu'à la table des plus grands seigneurs, ou chez les filles entretenues.
Nous devons leur multiplication aux marchands de comestibles, dont le nombre s'est fort accru, et qui, voyant que cette marchandise prenait faveur, en ont fait demander dans tout le royaume, et qui, les payant bien et les faisant arriver par les courriers de la malle et par la diligence, en ont rendu la recherche générale; car, puisqu'on ne peut pas les planter, ce n'est qu'en les recherchant avec soin qu'on peut en augmenter la consommation.
On peut dire qu'au moment où j'écris (1825) la gloire de la truffe est à son apogée. On n'ose pas dire qu'on s'est trouvé à un repas où il n'y aurait pas eu une pièce truffée. Quelque bonne en soi que puisse être une entrée, elle se présente mal si elle n'est pas enrichie de truffes. Qui n'a pas senti sa bouche se mouiller en entendant parler de truffes à la provençale?
Un sauté de truffes est un plat dont la maîtresse de la maison se réserve de faire les honneurs; bref, la truffe est le diamant de la cuisine.
J'ai cherché la raison de cette préférence; car il m'a semblé que plusieurs autres substances avaient un droit égal à cet honneur; et je l'ai trouvée dans la persuasion assez générale où l'on est que la truffe dispose aux plaisirs génésiques; et, qui plus est, je me suis assuré que la plus grande partie de nos perfections, de nos prédilections et de nos admirations proviennent de la même cause, tant est puissant et général le servage où nous tient ce sens tyrannique et capricieux!
Cette découverte m'a conduit à désirer de savoir si l'effet est réel et l'opinion fondée en réalité.
Une pareille recherche est sans doute scabreuse et pourrait prêter à rire aux malins; mais honni soit qui mal y pense! toute vérité est bonne à découvrir.
Je me suis d'abord adressé aux dames, parce qu'elles ont le coup d'oeil juste et le tact fin; mais je me suis bientôt aperçu que j'aurais dû commencer cette disquisition quarante ans plus tôt, et je n'ai reçu que des réponses ironiques ou évasives: une seule y a mis de la bonne foi, et je vais la laisser parler; c'est une femme spirituelle sans prétention, vertueuse sans bégueulerie, et pour qui l'amour n'est plus qu'un souvenir aimable.
«Monsieur, me dit-elle, dans le temps où l'on soupait encore, je soupai un jour chez moi en trio avec mon mari et un de ses amis. Verseuil (c'était le nom de cet ami) était beau garçon, ne manquait pas d'esprit, et venait souvent chez moi; mais il ne m'avait jamais rien dit qui pût le faire regarder comme mon amant; et s'il me faisait la cour, c'était d'une manière si enveloppée qu'il n'y a qu'une sotte qui eût pu s'en fâcher. Il paraissait, ce jour-là, destiné à me tenir compagnie pendant le reste de la soirée, car mon mari avait un rendez-vous d'affaires, et devait nous quitter bientôt. Notre souper, assez léger d'ailleurs, avait cependant pour base une superbe volaille truffée. Le subdélégué de Périgueux nous l'avait envoyée. En ce temps, c'était un cadeau; et d'après son origine, vous pensez bien que c'était une perfection. Les truffes surtout étaient délicieuses, et vous savez que je les aime beaucoup: cependant je me contins; je ne bus aussi qu'un seul verre de Champagne; j'avais je ne sais quel pressentiment de femme que la soirée ne se passerait pas sans quelqu'événement. Bientôt mon mari partit et me laissa seule avec Verseuil, qu'il regardait comme tout à fait sans conséquence. La conversation roula d'abord sur des sujets indifférents; mais elle ne tarda pas à prendre une tournure plus serrée et plus intéressante. Verseuil fut successivement flatteur, expansif, affectueux, caressant, et voyant que je ne faisais que plaisanter tant de belles choses, il devint si pressant que je ne pus plus me tromper sur ses prétentions. Alors je me réveillai comme d'un songe, et me défendis avec d'autant plus de franchise que mon coeur ne me disait rien pour lui. Il persistait avec une action qui pouvait devenir tout-à-fait offensante; j'eus beaucoup de peine à le ramener; et j'avoue à ma honte que je n'y parvins que parce que j'eus l'art de lui faire croire que toute espérance ne lui serait pas interdite. Enfin il me quitta, j'allai me coucher et dormir tout d'un somme. Mais le lendemain fut le jour du jugement: j'examinai ma conduite de la veille et je la trouvai répréhensible. J'aurais dû arrêter Verseuil dès les premières phrases et ne pas me prêter à une conversation qui ne présageait rien de bon. Ma fierté aurait dû se réveiller plus tôt, mes yeux s'armer de sévérité; j'aurais dû sonner, crier, me fâcher, faire enfin tout ce que je ne fis pas. Que vous dirai-je monsieur? je mis tout cela sur le compte des truffes; je suis réellement persuadée qu'elles m'avaient donné une prédisposition dangereuse; et si je n'y renonçai pas (ce qui eût été trop rigoureux), du moins je n'en mange jamais sans que le plaisir qu'elles me causent ne soit mêlé d'un peu de défiance.»

Un aveu, quelque franc qu'il soit, ne peut jamais faire doctrine. J'ai donc cherché des renseignements ultérieurs; j'ai rassemblé mes souvenirs, j'ai consulté les hommes qui, par état, sont investis de plus de confiance individuelle; je les ai réunis en comité, en tribunal, en sénat, en sanhédrin, en aréopage, et nous avons rendu la décision suivante pour être commentée par les littérateurs du vingt-cinquième siècle.
«La truffe n'est point un aphrodisiaque positif; mais elle peut, en certaines occasions, rendre les femmes plus tendres et les hommes plus aimables.»
On trouve en Piémont les truffes blanches, qui sont très estimés; elles ont un petit goût d'ail qui ne nuit point à leur perfection, parce qu'il ne donne lieu à aucun retour désagréable.
Les meilleures truffes de France viennent du Périgord et de la Haute-Provence; c'est vers le mois de janvier qu'elles ont tout leur parfum.
Il en vient aussi en Bugey, qui sont de très haute qualité; mais cette espèce a le défaut de ne pas se conserver. J'ai fait, pour les offrir aux flâneurs des bords de la Seine, quatre tentatives dont une seule a réussi; mais pour lors ils jouirent de la bonté de la chose et du mérite de la difficulté vaincue.
Les truffes de Bourgogne et du Dauphiné sont de qualité inférieure; elles sont dures et manquent d'avoine; ainsi; il y a truffes et truffes, comme il y a fagots et fagots.
On se sert le plus souvent, pour trouver les truffes, de chiens et de cochons qu'on dresse à cet effet; mais il est des hommes dont le coup d'oeil est si exercé, qu'à l'inspection d'un terrain ils peuvent dire, avec quelque certitude, si on y peut trouver des truffes, et quelle en est la grosseur et la qualité.
Les Truffes sont-elles indigestes?
 L ne nous reste plus qu'à l'examiner si la
truffe est indigeste.
L ne nous reste plus qu'à l'examiner si la
truffe est indigeste.
Nous répondrons négativement.
Cette décision officielle et en dernier ressort est fondée:
1° Sur la nature de l'objet même à examiner (la truffe est un aliment facile à mâcher, léger de poids, et qui n'a en soi rien de dur ni de coriace);
2° Sur nos observations pendant plus de cinquante ans qui se sont écoulés sans que nous ayons vu en indigestion aucun mangeur de truffes;
3° Sur l'attestation des plus célèbres praticiens de Paris, cité admirablement gourmande, et truffivore par excellence;
4° Enfin, sur la conduite journalière de ces docteurs de la loi qui, toutes choses égales, consomment plus de truffes qu'aucune autre classe de citoyens; témoin, entre autres, le docteur Malouet, qui en absorbait des quantités à indigérer un éléphant, et qui n'en a pas moins vécu jusqu'à quatre-vingt-six ans.
Ainsi on peut regarder comme certain que la truffe est un aliment aussi sain qu'agréable, et qui, pris avec modération, passe comme une lettre à la poste.
Ce n'est pas qu'on ne puisse être indisposé à la suite d'un grand repas où, entre autres choses, on aurait mangé des truffes; mais ces accidents n'arrivent qu'à ceux qui s'étant déjà, au premier service, bourrés comme des canons, se crèvent encore au second, pour ne pas laisser passer intactes les bonnes choses qui leur sont offertes.
Alors ce n'est point la fautes des truffes; et on peut assurer qu'ils seraient encore plus malades si, au lieu de truffes, ils avaient, en pareilles circonstances, avalé la même quantité de pommes de terre.
Finissons par un fait qui montre combien il est facile de se tromper quand on n'observe pas avec soin.
J'avais un jour invité à dîner M. Simonard, vieillard fort aimable, et gourmand au plus haut de l'échelle. Soit parce que je connaissais ses goûts, soit pour prouver à tous mes convives que j'avais leur jouissance à coeur, je n'avais pas épargné les truffes, et elles se présentaient sous l'égide d'un dindon vierge avantageusement farci.
M. S... en mangea avec énergie; et comme je savais que jusque-là il n'en était pas mort, je le laissai faire, en l'exhortant à ne pas se presser, parce que personne ne voulait attenter à la propriété qui lui était acquise.
Tout se passa très bien, et on se sépara assez tard; mais, arrivé chez lui, M. Simonard fut saisi de violentes coliques d'estomac, avec des envies de vomir, une toux convulsive et un malaise général.
Cet état dura quelque temps et donnait de l'inquiétude; on criait déjà à l'indigestion de truffes, quand la nature vint au secours du patient, M. Simonard ouvrit sa large bouche, et éructa violemment un seul fragment de truffes qui alla frapper la tapisserie, et rebondit avec force, non sans danger pour ceux qui lui donnaient des soins.
Au même instant tous les symptômes fâcheux cessèrent, la tranquillité reparut, la digestion reprit son cours, le malade s'endormit, et se réveilla le lendemain dispos et tout-à-fait sans rancune.
La cause du mal fut bientôt connue. M. Simonard mange depuis longtemps; ses dents n'ont pas pu soutenir le travail qu'il leur a imposé; plusieurs de ces précieux osselets ont émigré, et les autres ne conservent pas la coïncidence désirable.
Dans cet état de choses, une truffe avait échappé à la mastication, et s'était, presque entière, précipitée dans l'abîme; l'action de la digestion l'avait portée vers le pylore, où elle s'était momentanément engagée: c'est cet engagement mécanique qui avait causé le mal, comme l'expulsion en fut le remède.
Ainsi il n'y eut jamais indigestion, mais seulement supposition d'un corps étranger.
C'est ce qui fut décidé par le comité consultatif qui vit la pièce de conviction, et qui voulut bien m'agréer pour rapporteur.
M. Simonard n'en est pas, pour cela, resté moins fidèlement attaché à la truffe; il l'aborde toujours avec la même audace; mais il a soin de la mâcher avec plus de précision, de l'avaler avec plus de prudence; et il remercie Dieu, dans la joie de son coeur, de ce que cette précaution sanitaire lui procure une prolongation de jouissances.
§ VIII.--Du Sucre.
45.
 U terme où la science est parvenue aujourd'hui,
on entend par sucre une substance douce au goût,
cristallisable, et qui, par la fermentation, se résout en acide
carbonique et en alcool.
U terme où la science est parvenue aujourd'hui,
on entend par sucre une substance douce au goût,
cristallisable, et qui, par la fermentation, se résout en acide
carbonique et en alcool.
Autrefois on entendait par sucre le sucre épaissi et cristallisé de la canne (arundo saccharifera).
Ce roseau est originaire des Indes; cependant il est certain que les Romains ne connaissaient pas le sucre comme chose usuelle ni comme cristallisation.
Quelques pages des livres anciens peuvent bien faire croire qu'on avait remarqué, dans certains roseaux, une partie extractive et douce, Lucain a dit:
/# Quique bibunt tenera dulces ab arundine succos. #/
Mais d'une eau édulcorée par le sucre et la canne, au sucre tel que nous l'avons, il y a loin; et chez les Romains l'art n'était point encore assez avancé pour y parvenir.
C'est dans les colonies du Nouveau-Monde que le sucre a véritablement pris naissance; la canne y a été importée il y a environ deux siècles; elle y prospère. On a cherché à utiliser le doux jus qui en découle, de tâtonnements en tâtonnements on est parvenu à en extraire successivement du vesou, du sirop, du sucre terré, de la mélasse, et du sucre raffiné à différents degrés.
La culture de la canne à sucre est devenue un objet de la plus haute importance; car elle est une source de richesse, soit pour ceux qui la font cultiver, soit pour ceux qui commercent de son produit, soit pour ceux qui l'élaborent, soit enfin pour les gouvernements qui le soumettent aux impositions.
Du Sucre indigène.
 N a cru pendant longtemps qu'il ne fallait pas
moins que la chaleur des tropiques pour faire élaborer le sucre;
mais vers 1740, Margraff le découvrit dans quelques plantes des
zones tempérées, et entre autres dans la betterave; et cette vérité
fut poussée jusqu'à la démonstration, par les travaux que fit à
Berlin le professeur Achard.
N a cru pendant longtemps qu'il ne fallait pas
moins que la chaleur des tropiques pour faire élaborer le sucre;
mais vers 1740, Margraff le découvrit dans quelques plantes des
zones tempérées, et entre autres dans la betterave; et cette vérité
fut poussée jusqu'à la démonstration, par les travaux que fit à
Berlin le professeur Achard.
Au commencement du dix-neuvième siècle, les circonstances ayant rendu le sucre rare, et par conséquent cher en France, le gouvernement en fit l'objet de la recherche des savants.
Cet appel eut un plein succès: on s'assura que le sucre était assez abondamment répandu dans le règne végétal; on le découvrit dans le raisin, dans la châtaigne, dans la pomme de terre, et surtout dans la betterave.
Cette dernière plante devint l'objet d'une grande culture et d'une foule de tentatives qui prouvèrent que l'ancien monde pouvait, sous ce rapport, se passer du nouveau. La France se couvrit de manufactures qui travaillèrent avec divers succès, et la saccharication s'y naturalisa: art nouveau, et que les circonstances peuvent quelque jour rappeler.