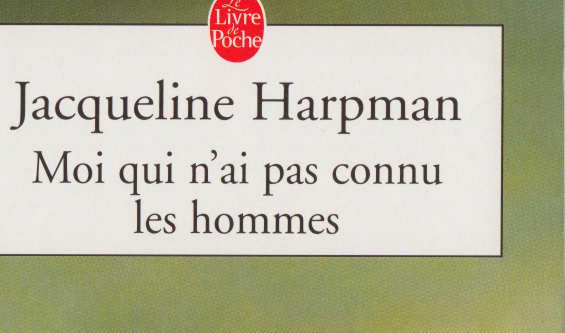


Jacqueline Harpman - Moi qui n’ai pas connu les hommes Roman paru chez Stock 1995
Jacqueline Harpman est belge. Membre de l'Association psychanalytique internationale, elle a déjà publié neuf romans dont cinq aux Éditions Stock, parmi lesquels La Fille démantelée et La Plage d'Ostende. Elle a reçu le Prix Médicis 1996 pour Orlanda (Grasset).
À Denise Geilfus pour l'amitié.
Depuis que je ne sors presque plus je passe beaucoup de temps dans un des fauteuils, à relire les livres. Je ne me suis intéressée que récemment aux préfaces. Les auteurs y parlent volontiers d'eux-mêmes, ils expliquent pour quelles raisons ils ont rédigé l'ouvrage qu'ils proposent. J'en suis surprise : n'était-il donc pas plus évident dans ce monde-là que dans celui où j'ai vécu de transmettre le savoir qu'on a pu acquérir? Ils semblent souvent sentir la nécessité
de préciser qu'il n'y a pas d'immodestie dans leur entreprise, qu'on leur a demandé d'écrire et qu'ils ont hésité avant d'y consentir. Comme c'est curieux !
Cela donne à penser que les gens n'étaient pas avides de s’instruire et qu'il fallait demander à être excusé de vouloir communiquer ses connaissances. Ou bien ils disent pourquoi ils ont estimé qu'il convenait de publier une nouvelle traduction de Shakespeare, les précédentes, si louables qu'elles soient, présentant telle ou 1
telle imperfection. Mais pourquoi traduire alors qu'il devait être si simple d'apprendre les différentes langues et de lire tous les ouvrages qu'on voulait sans passer par un intermédiaire? Ces choses-là me laissent toute perplexe. Il est certain que je suis fort ignorante : apparemment, j'en sais encore moins que je croyais. Ils parlent avec reconnaissance de ceux qui les ont formés, leur ont ouvert tel ou tel domaine du savoir et, comme je n'entends rien à ce dont il s'agit, je lis en général cela avec une certaine indifférence. Mais hier, brusquement, 1
mes yeux se sont remplis de larmes, j'ai pensé à Théa et une terrible vague de chagrin m'a traversée. Je la revoyais, assise sur le bord d'un matelas, les genoux 1
de côté, cousant patiemment avec son mauvais fil de cheveux tressés qui cassait tout le temps, s'arrêtant pour me regarder, étonnée, prompte à se rendre compte de mon ignorance et à m'enseigner ce qu'elle savait en se désolant que ce fût si peu, et j'ai senti une immense déchirure, je me suis mise à sangloter. Je n'avais jamais pleuré. J'avais aussi horriblement mal à l'âme que le cancer me fait mal au ventre et, moi qui ne parle plus jamais car il n'y a personne pour m'entendre, je me suis mise à l'appeler, je répétais Théa! Théa! j'étais incapable de tolérer qu'elle ne soit pas là, qu'elle ait laissé la mort s'emparer d'elle, l'arracher à mes bras maladroits, je me suis reproché de ne pas l'avoir retenue, d'avoir compris qu'elle n'en pouvait plus, je me suis dit que je l'avais abandonnée parce que j'étais toute roide, comme je l'ai été toute ma vie, comme je le serai en mourant, que je ne pouvais pas la serrer avec chaleur, que mon cœur était figé, stupide, et que je n'avais pas senti que j'étais désespérée.
Jamais encore je n'avais été aussi bouleversée et j'aurais bien juré que cela ne pouvait pas m’arriver. J'avais vu les femmes trembler, pleurer, crier, je restais étrangère à leur drame, témoin de mouvements qui me paraissaient inintelligibles, silencieuse, même quand je faisais ce qu'elles me demandaient pour les aider. Certes, nous étions toutes prises dans la même tragédie, si puissante, si totale que j'étais insensible à ce qui ne venait pas d'elle, mais j'avais fini par penser que j'étais différente. Et là, secouée par les sanglots, je me suis trouvée acculée, trop tard, bien trop tard, à me rendre compte que moi aussi j'avais aimé, que je pouvais souffrir et que, en somme, j'étais humaine.
Il me semblait que cette douleur ne se calmerait jamais, qu'elle avait pris possession de moi une fois pour toutes, qu'elle m'empêcherait définitivement de me consacrer à autre chose qu'elle-même, et j'y consentais. Je pense que c'est cela que l'on nomme être rongée par le remords. Je ne pourrais plus me lever, penser, ni même cuire ma nourriture, et je me laisserais dépérir lentement, je prenais une sorte de sombre plaisir à imaginer m'abandonner au désespoir, quand le mal physique est revenu, si brutal et aigu qu'il m'a distraite du mal moral. Et voilà que moi qui, forcément, ne m'amuse jamais, j'ai trouvé de la drôlerie à cette alternance et, toute pliée en deux que j'étais, je me suis mise à
rire.
Quand la douleur eut diminué, je me demandai si j'avais déjà ri. Les femmes riaient souvent, et il me sembla que je m'étais parfois jointe à elles, mais je n'en étais pas sûre. Là, je me rendis compte que je ne pensais jamais au passé, je vivais dans un perpétuel présent et j'étais en train d'oublier mon histoire. Je commençai par hausser les épaules, en me disant que ce ne serait pas une bien grande perte, puisqu'il ne m'était rien arrivé, mais bientôt cette pensée me choqua. Après tout, si j'étais un être humain, mon histoire était bien aussi importante que celle du roi Lear ou du prince Hamlet que ce William Shakespeare s'était donné la peine de relater dans le détail. La décision se prit en moi presque à mon insu : je ferais comme lui. Avec le temps, j'ai appris à lire couramment, écrire est beaucoup plus difficile, mais je n'ai jamais reculé devant une difficulté. J'ai du papier, des crayons, je n'ai peut-être pas beaucoup de temps, et depuis que je ne pars plus en expédition nulle occupation ne me requiert: je décidai de commencer tout de suite. J'allai dans la réserve, sortis la viande que je prendrais au repas et la mis à dégeler : ainsi quand la faim viendrait, ma nourriture serait vite prête. Puis je m'installai à la grande table et commençai à rédiger.
Au moment où j'écris ces lignes, mon récit est achevé. Tout est en ordre autour de moi et j'ai accompli la dernière tâche que je m'étais donnée. Cela ne m'a demandé qu'un mois, qui a peut-être été le plus heureux de ma vie. Je ne comprends pas cela : après tout, ce dont je me souvenais n'était que cette existence étrange qui ne m'a pas dispensé beaucoup de bonheur. Y a-t-il dans le travail de la mémoire une satisfaction qui se nourrit d'elle-même et ce dont on se souvient compte-t-il moins que l'activité de se souvenir? Voilà encore une question qui restera sans réponse : il me semble que je ne suis faite que de cela.
Au plus loin que je puisse retourner, je suis dans la cave. Est-ce bien cela que l'on nomme des souvenirs ? Les quelques fois où les femmes ont consenti à
me raconter des moments de leur histoire, ils contenaient des événements, des allées et venues, des hommes : moi, je suis réduite à nommer souvenir le sentiment d'exister dans un même lieu, avec les mêmes personnes, faisant les mêmes choses, qui étaient manger, excréter et dormir. Pendant très longtemps les journées se sont déroulées de façon exactement semblable, puis je me suis mise à penser et tout a changé. Avant, il ne se passait rien d'autre que cette répétition de gestes identiques et le temps me semblait immobile, même si je me rendais confusément compte que je grandissais et qu'il s'écoulait. Ma mémoire commence avec ma colère.
Je ne peux évidemment pas dire quel âge j'avais. Les autres étaient adultes depuis longtemps quand on put croire que j'allais faire ma puberté. Je n'en eus que les premiers signes : il me vint du poil aux aisselles et sur le pubis, mes seins gonflèrent faiblement, puis tout s'arrêta. Je n'eus jamais de règles. Les femmes me dirent que j'avais de la chance, je ne serais pas embarrassée par le sang et les précautions à prendre pour ne pas salir les matelas, j'échappais à la tâche fastidieuse de laver, tous les mois, les bouts de loques qu'il leur fallait faire tenir entre les cuisses comme elles pouvaient, c'est-à-dire en contractant les muscles puisqu'elles n'avaient rien pour les attacher, et je n'endurerais pas les maux de ventre si fréquents chez les jeunes filles. Mais je ne les croyais pas : elles avaient presque toutes des menstrues et comment concevoir comme avantage de n'avoir pas ce que les autres ont? J'eus le sentiment qu'elles me trompaient.
À cette époque-là, je ne m'interrogeais guère sur les choses, il ne me vint pas à l'esprit de me demander à quoi servaient les règles. Peut-être étais-je naturellement silencieuse, en tout cas l'accueil fait à mes rares questions ne m'encourageait pas. Le plus souvent, les femmes soupiraient, elles détournaient les yeux, et me disaient un « A quoi te servirait-il de savoir ? » qui donnait le sentiment de déranger ou d'attrister. Je n'en avais aucune idée et je n'insistais pas. Ce n'est que bien plus tard que Théa m'expliqua ce qu'étaient les règles. Elle me dit aussi qu'aucune des femmes n'avait beaucoup d'instruction, elles étaient ouvrières, dactylos ou vendeuses, tous mots qui, dans mon esprit, n'ont jamais acquis un sens précis, et qu'elles n'étaient pas beaucoup plus informées que moi.
Néanmoins, quand je sus, il me parut qu'elles avaient mis de la mauvaise volonté
à m'instruire. J'en fus outragée. Théa me dit que je ne me trompais pas tout à fait et tenta de m'expliquer leurs raisons : j'y reviendrai peut-être plus loin, si j'y pense, au moment dont je veux parler j'étais furieuse, je me sentais traitée avec mépris, comme si j'eusse été incapable de comprendre les réponses aux questions — peu nombreuses, pourtant — que je posais et je résolus de ne plus accorder aucun intérêt aux femmes.
J'étais tout le temps de mauvaise humeur, mais je ne le savais pas, car je ne connaissais pas les termes qui désignent les états d'âme. Les femmes allaient et venaient en se livrant aux rares occupations de la vie quotidienne et ne me demandaient jamais d'y participer. Je m'accroupissais et je regardais ce qu'il y avait à voir. Quand j'y pense : presque rien. Elles étaient assises et bavardaient, ou bien, deux fois par jour, elles préparaient le repas. Peu à peu, je tournai mon attention vers les gardes qui parcouraient perpétuellement les entours de la cage.
Ils allaient toujours par trois, à quelques pas l'un de l'autre, en nous observant, et l'usage était de paraître ignorer leur présence, mais je devenais curieuse. Je me rendis compte que l'un d'eux était différent : plus grand, plus mince et, je le compris après un moment, plus jeune. Cela m'intéressa beaucoup. Dans leurs périodes de bonne humeur, les femmes évoquaient les hommes, l'amour, elles avaient de petits fous rires et se moquaient de moi quand je leur demandais ce qui était drôle. Je recensai ce que je savais : les baisers, qui se donnent sur la bouche, les enlacements, faire de l'œil et du pied, que je ne comprenais pas du tout, puis venait le septième ciel — ma foi ! Comme je n'avais vu aucun ciel, ni le premier ni les autres, je ne m'attardais pas — et aussi des plaintes sur la brutalité, ça fait mal, ils ne se soucient pas des femmes, les mettent enceintes et s'en vont en disant « Comment puis-je savoir s'il est de moi? ». Elles déclaraient parfois qu'elles n'avaient rien perdu, et d'autres fois elles se mettaient à pleurer.
Moi, j'étais destinée à rester vierge. Un jour, j'avais rassemblé mon courage afin de surmonter ma colère, et j'avais questionné Dorothée, la moins rébarbative des deux vieilles.
- Ma pauvre petite !
Et, après quelques soupirs, elle n'avait pas manqué la réponse habituelle :
- À quoi te servirait de savoir, puisque ça ne peut pas t'arriver?
- A savoir, dis-je rageusement, et me fis ainsi découvrir le sens de mon acharnement.
Elle ne comprenait pas qu'on ait envie d'un savoir dont on n'aura aucun usage et je ne pus rien tirer d'elle. Il était sûr que je mourrais intouchée, au moins je voulais avoir l'esprit satisfait. Pourquoi s'acharnaient-elles toutes à ne rien dire? Je tentais de me consoler en me disant que leur secret n'était qu'un secret de polichinelle, puisque chacune le possédait. Était-ce pour lui redonner du lustre qu'elles me le refusaient, pour lui rendre l'éclat d'un trésor admirable qu'elles créaient, en se taisant, une fille qui ne savait pas et qui les regarderait comme les dépositaires d'une merveille, ne me maintenaient-elles dans l'ignorance que pour feindre de n'être pas tout à fait démunies? Elles prétendirent parfois que c'était par pudeur, mais je voyais bien qu'entre elles, elles n'avaient pas de pudeur, elles chuchotaient, elles pouffaient de rire, elles étaient indécentes. Moi, je ne ferais pas l'amour, elles ne le feraient plus : peut-
être étions-nous à égalité et qu'elles cherchaient à se consoler en me privant de ce dont elles pouvaient me priver.
Souvent le soir, avant de m'endormir, je pensais à celui des gardes qui était jeune. Je me servais du peu de chose que j'avais pu deviner: dans une autre vie, il serait venu s'asseoir à côté de moi, il m'aurait invitée à danser, il m'aurait dit son nom, j'en aurais eu un que je lui aurais dit, nous aurions parlé
et, si nous nous étions plu, nous nous serions promenés la main dans la main.
Peut-être ne l'aurais-je pas trouvé intéressant: il était le seul de nos six geôliers à ne pas être vieux et tout cassé, sans doute j'étais indulgente parce que je n'avais rencontré aucun autre jeune homme. Je tentais d'imaginer notre conversation, en ces temps que je n'ai pas connus : fera-t-il encore beau demain ?
Avez-vous vu les chatons qui sont nés chez la voisine ? Il paraît que votre tante va partir en voyage, mais je n'avais jamais vu de chatons et je ne me faisais pas idée de ce que peut être le beau temps, ce qui raccourcissait ma rêverie.
Alors, je pensais aux baisers, je me figurais avec autant de précision que possible la bouche du garde, qui était assez grande, avec des lèvres bien dessinées, à peine renflées - les bouches trop gonflées que je voyais chez certaines femmes ne me plaisaient pas. Je me représentais approcher mes lèvres des siennes : sans doute fallait-il en savoir plus car il ne se passait rien de particulier en moi.
Sauf un soir. Au lieu de m'endormir d'ennui à tenter de me figurer un baiser qui n'aurait jamais lieu, il me vint de me souvenir que les femmes avaient parlé
d'interrogatoires, pour s'étonner qu'il n'y en ait jamais eu. Je brodai sur le peu qu'elles avaient dit : j'imaginais qu'on venait chercher une femme, on l'emmenait hurlante et terrifiée. Parfois on ne la revoyait pas, d'autres fois on la jetait parmi nous le matin, couverte de brûlures, blessée, gémissante, et qui ne survivait pas toujours. Je pensais : - Ah ! S’il y avait des interrogatoires ! Il viendrait me chercher, je quitterais la salle où je vis depuis toujours, il m'entraînerait le long de couloirs inconnus, il se passerait quelque chose !
Mon esprit fut d'une rapidité incroyable : le garçon qui me poussait d'un air décidé semblait tout A sa tâche, mais, passé le coin, dès que nous fûmes hors de vue, voilà qu'il s'arrêtait, se tournait vers moi, me souriait et disait : Ne crains rien, puis me prenait dans ses bras. Là, je fus traversée par quelque chose d'immense, un soulèvement si vaste qu'il était plus grand que moi-même, une lumière inouïe explosa dans mon corps, je perdis le souffle et le retrouvai aussitôt car ce fut désespérément bref.
Après cela, mon âme changea. Je ne cherchai plus à obtenir que les femmes me disent leurs secrets, j'en possédais un. Le soulèvement se révéla difficile à
atteindre, je fus astreinte à me raconter des histoires de plus en plus longues et compliquées et, à mon extrême regret, je ne fus jamais soulevée deux fois de suite, alors que j'aurais voulu que cela durât des heures, j'aspirais à en être parcourue de façon ininterrompue, nuit et jour exquisément balancée, caressée comme l'herbe rare des plaines par le vent léger qui durait des jours entiers, ce que je ne vis que longtemps après.
Je me consacrai désormais tout entière au travail de produire le soulèvement. Il fallait inventer des circonstances extraordinaires où nous étions tamils, ou, au moins, isolés parmi les autres, face à face, et que, après bien des tourments, j'aie la surprise divine de sentir ses bras autour de moi. Mon imagination se développa.
J'étais obligée de l'entraîner avec beaucoup de discipline car je ne pouvais pas recourir deux fois au même récit, la surprise était indispensable, je m'en aperçus après avoir tenté plusieurs fois de me représenter le geste délicieux qui m'avait portée aux nues, sans être aucunement soulevée. La difficulté était très grande parce que j'étais à la fois l'inventeur du récit, le narrateur et l'auditeur à
qui il fallait donner le choc de l'étonnement. Je m'étonne aujourd'hui d'avoir pu surmonter tant d'obstacles ! Quelle vitesse devait aller mon esprit pour que je ne sois pas prévenue de l'idée qui arrivait, de sorte que l'imprévu me submerge
! La première fois, quand j'eus l'idée de l'interrogatoire, je ne m'étais encore jamais raconté d'histoires, je ne savais même pas que cela pût se faire, j'étais complètement prise au jeu, émerveillée à la fois par une activité si neuve et par le récit lui-même. Ensuite, je devins très vite une habituée, une technicienne du récit, je pus déceler s'il commençait mal, s'il courait à l'impasse, et même reprendre les événements pour infléchir plus adéquatement leur cours. J'allais jusqu'à construire des personnages qui revenaient régulièrement, qui se modifiaient d'apparition en apparition et qui me devenaient très familiers.
J'étais fort contente d'eux, ce n'est que ces temps-ci, en lisant les livres, que j'ai pu voir qu'ils étaient assez sommaires.
Il me fallait créer des histoires de plus en plus compliquées : je crois que quelque chose en moi savait ce que j'attendais d'elles et s'y opposait, je devais me prendre au dépourvu. J'eus parfois à raconter pendant plusieurs heures, égarant ainsi mon public intérieur qui oubliait de se méfier, se laissait capter par le plaisir d'écouter, s'amusait et baissait sa garde. Alors, venait l'instant admirable, le regard du garçon, sa main sur mon épaule et le transport de tout mon être. Après, je pouvais dormir. Peut-être en arrêtant l'histoire décevais-je un auditeur intérieur qui préférait le récit à l'émoi, d'où qu'il le reculait toujours et m'en aurait bien privée pour prolonger son propre plaisir. Il arrivait, racontant, que je tente de le raisonner: je suis fatiguée, je voudrais dormir, accorde-moi le soulèvement, je continuerai demain. Mais rien n'y faisait, il ne se laissait pas duper.
Les femmes remarquèrent que j'avais changé. Elles m'observèrent un moment, me virent toujours assise, les genoux repliés, le menton posé sur mes bras croisés, et je suppose que j'avais les yeux dans le vague. Je ne m'en aperçus pas car je ne m'occupais plus du tout d'elles, et je fus étonnée quand Annabelle vint me questionner.
- Que fais-tu ?
- Je pense, lui dis-je.
Ce qui la laissa perplexe. Elle resta encore un instant, attendant que j'en dise plus, puis alla porter ma réponse aux autres. Elles discutèrent un peu, et Annabelle revint.
- À quoi ?
Toute ma colère remonta.
- Quand je vous demandais ce qu'on fait dans l'amour, vous n'avez pas voulu me répondre, et je vous dirais ce que je fais dans ma tête ! Gardez vos secrets, si ça vous amuse, mais ne comptez pas que je vous dise les miens.
Elle fronça les sourcils et rejoignit les autres. Cette fois-ci, la discussion se prolongea. Je ne les avais encore jamais vues parler si longtemps avec sérieux, d'habitude après dix minutes elles pouffaient de rire. Il semblait que j'avais fait naître quelque chose de neuf dans leurs esprits. Ce fut une autre qui se leva et vint vers moi, la plus vieille et la plus respectée, Dorothée, que même moi je ne détestais pas. Elle s'assit et me regarda avec insistance. Elle me dérangeait beaucoup car elle interrompait à un moment très prometteur le récit qui durait depuis fort longtemps : on allait m'enfermer seule dans une cellule et j'avais entendu échanger quelques mots à propos de la relève, je pouvais espérer que le geôlier de nuit serait le jeune homme. Comment continuer devant cette vieille femme qui me regardait sans rien dire ? Tout au plus pouvais-je essayer de ne pas perdre la situation de vue : j'étais seule, haletante, effrayée, j'entendais des voix et des cliquetis d'armes dans le couloir, j'ignorais ce qui se passait, j'avais peur dans cette ambiance d'urgence et d'agitation. Je tentai de garder la scène en suspens dans mon esprit tout en examinant Dorothée qui m'examinait, je me disais que si le soulèvement ne se produisait pas bientôt, j'allais être obligée de pourvoir la situation d'un sens, et quoi diable pouvait provoquer de l'imprévu qui reflue jusqu'à
l'univers immobile où nous vivions, femmes enfermées depuis tellement d'années qu'elles avaient perdu le décompte du temps ?
- Il paraît que tu as des secrets, dit enfin Dorothée.
Je ne répondis pas, puisque ce n'était pas une vraie question. Je comprenais qu'elle voulait me troubler par son regard pesant et son silence. Sans doute, auparavant, quand je n'avais pas encore trouvé le monde intérieur où je me distrayais, quand j'étais encore curieuse et docile, j'aurais été intimidée, j'aurais cherché quelle faute j'avais commise qui me valût cet examen et j'aurais craint la punition. Mais je savais désormais que j'étais hors de leur portée : les punitions n'étaient jamais que la mise à l'écart, l'exclusion des conversations futiles et papillonnantes sur rien du tout, et je ne demandais que cela afin de poursuivre en paix ma quête secrète.
Comme je ne réagissais pas, elle fronça les sourcils.
- Je t'ai parlé. La politesse exige que tu me répondes.
Je n'ai rien à répondre. On vous a dit que j'avais des secrets. Vous me dites qu'on vous l'a dit. Fort bien. Et puis ?
- Je veux les connaître.
Je me mis à rire, ce dont je fus la première surprise. J'avais été habituée à
respecter la volonté des femmes, tout particulièrement celle des plus figées à
qui on accordait l'autorité, mais tout avait changé car je ne voyais plus sur quoi se fondait cette autorité. Je découvrais soudain qu'elles n'avaient aucun pouvoir. Nous étions toutes mêmement enfermées sans savoir pourquoi, gardées par des geôliers qui, soit par mépris, soit par ordre, n'adressaient la parole à aucune d'entre nous. Jamais ils ne pénétraient dans la cage. Ils allaient par trois, sauf au moment de la relève où on en voyait six d'un coup, et ne se parlaient pas entre eux. À l'heure des repas un des battants de la grande porte s'ouvrait, un homme poussait un chariot dans l'espace qui séparait la cage du mur et un autre déverrouillait une petite ouverture dans la grille, par où il faisait passer les victuailles. Ils ne répondaient à aucune question et depuis très longtemps on ne leur en posait plus. Les vieilles femmes étaient aussi impuissantes que les plus jeunes. Elles s'étaient emparées de je ne sais quel pouvoir imaginaire, un pouvoir sur rien, un accord tacite qui créait une hiérarchie sans signification car il n'y avait aucun privilège qu'elles pussent accorder ou refuser. Nous étions, en vérité, sur un pied d'égalité absolue.
J'étais restée immobile pendant quelques secondes, prenant connaissance claire de
ces
évidences
familières
qui
devenaient
soudain
des
révélations
stupéfiantes, regardant fixement Dorothée. Je me souvins de ce qu'elle avait dit.
- Vous voulez les connaître. Mais tout ce que vous pouvez faire à ce propos est m'informer de votre volonté.
J'observai avec intérêt sa façon de recevoir mes paroles : d'abord, quand elle vit que je commençais à répondre, elle eut l'air satisfait, elle dut croire qu'elle obtenait mon obéissance. Puis elle écouta, le sens de mes paroles lui apparut, mais c'était si surprenant qu'elle pensa qu'elle ne comprenait pas.
- Que veux-tu dire ?
- Pensez-y, lui dis-je. Exactement ce que j'ai dit.
- Tu n'as rien dit !
- J'ai dit que je ne dirai rien sur les secrets. Vous avez dit que vous les voulez, vous ne m'apprenez rien, je le savais déjà. Vous pensez qu'il suffit que vous me disiez que vous voulez les connaître pour que je vous les dise.
C'était bien sa position.
- C'est ainsi que les choses doivent se passer, affirma-t-elle.
- Pourquoi ?
Elle fut décontenancée. Je vis qu'elle ne réfléchissait pas à ma question, tant elle était étonnée qu'une telle question pût être posée. Elle était l'héritière d'une tradition dont je n'avais pas fait partie : quand l'aînée demande une réponse à la cadette, la cadette la donne. Jamais elle n'avait mis cela en doute, mais moi, grandie dans la cave, je n'avais pas de raison de m'y soumettre. Après un moment :
- Comment ça, pourquoi ?
- Pourquoi devrais-je vous répondre ? Pourquoi pensez-vous que cela va de soi
?
Son regard vacilla. Elle essayait de réfléchir, mais elle n'en avait pas l'habitude, elle sembla prise de vertige et s'accrocha à la première idée qui passait :
- Tu es insolente, dit-elle, soulagée comme si elle avait trouvé un sens aux paroles incompréhensibles que j'avais prononcées, sûre qu'il suffisait de retourner aux façons habituelles, aux conventions, aux lieux communs.
- Vous êtes une sotte, répondis-je, comme enivrée par mes nouvelles certitudes, et cette conversation est absurde. Vous pensez que vous avez du pouvoir et vous êtes comme nous toutes, réduite à recevoir votre part de nourriture des mains ennemies et hors d'état de me punir si je me rebelle contre vous. Ils interdisent toute autorité autre que la leur, vous ne pourriez ni me battre ni me priver. Pourquoi devrais-je vous obéir?
Cette fois-ci, il fut évident qu'elle n'entendait pas un mot. Je crois qu'elle aurait préféré devenir sourde. Elle grommela, s'agita un peu sur place, puis fit signe à
deux femmes plus jeunes qui vinrent l'aider à se lever, ce dont elle n'avait pas réellement besoin, et elle regagna sa place habituelle, à l'autre bout de la cage.
On la regarda intensément sans oser l'interroger. Elle ferma les yeux pour faire croire qu'elle réfléchissait et s'endormit.
- C'est parce qu'elle est vieille, dirent les plus jeunes, de telles épreuves ne conviennent pas à une femme de son âge.
Elles reprirent leur bavardage et moi mon histoire. J'y retrouvai la cellule sombre où on m'avait isolée. Je n'étais pas blessée, les gardiens usaient toujours de précision, pour soumettre sans frapper. J'étais blottie dans un coin, effrayée et ma posture humiliante me choqua : accroupie, tremblante, cela convenait-il à
quelqu'un qui venait d'affronter une des femmes les plus respectées de la cage, les yeux dans les yeux et en lui disant qu'elle était sotte? Elle n'avait pas pu répondre. J'eus un délicieux frisson, ce fut, je crois, mon premier plaisir intellectuel. Il fallait que, dans la cellule imaginaire, je me redresse, et ici que je sourie, que je les brave. Il m'était difficile de me concentrer sur l'histoire, le petit combat que je venais de mener m'avait plu et j'avais envie d'y penser, mais cela ne me procurerait pas le soulèvement puisque le jeune garde n'en était pas, et je fis appel à ma discipline intérieure pour retourner dans mon univers personnel.
Si les femmes avaient été prudentes, elles en seraient restées là. On pouvait encore feindre qu'il ne s'était rien passé et ne pas s'exposer à une bataille inégale. J'avais compris que j'étais aussi forte qu'elles et que ne pas livrer un secret, qui est à la portée de tout le monde tant qu'on ne torture pas, fait croire aussitôt que le secret est infiniment précieux. Leur savoir à propos de l'amour m'avait paru la chose la plus désirable qui se pût quand elles me le refusaient.
Désormais, je me moquais de leur mesquinerie, je me disais qu'en d'autres temps j'aurais acquis ce que je voulais du premier garçon venu, que, en le demandant aux femmes, je leur accordais une prérogative qu'elles n'avaient jamais possédée et que mon ignorance les parait indûment. Mais, maintenant que leur curiosité était excitée, elles connaissaient à leur tour l'exclusion et le dépit. J'avais trouvé le soulèvement pour me consoler: elles restèrent agitées, impuissantes, avec pour toute nourriture leur agacement à ronger. Elles se mirent à me surveiller.
Mais : surveiller ? Nous étions quarante à vivre dans cette grande salle souterraine où personne ne pouvait se dissimuler aux autres. De cinq en cinq mètres, des colonnes soutenaient la voûte, une grille séparait des murs la partie où nous séjournions, réservant sur les quatre côtés un large passage pour les perpétuelles allées et venues des gardes. Personne n'échappait jamais au regard et nous étions habituées à satisfaire nos besoins naturels les unes devant les autres. Au début - cela m'a été raconté, mes souvenirs n'allaient pas jusque-là -
les femmes en étaient extrêmement dérangées, elles imaginèrent de se former en rempart pour isoler celle qui excrétait, mais les gardes l'interdirent, aucune ne devait jamais être hors de vue.
Je trouvais tout naturel, quand j'allais uriner, de m'asseoir sur le siège des toilettes en continuant la conversation où j'étais engagée, les rares fois où je conversais. Les vieilles maugréaient furieusement, elles parlaient d'indignité et d'être ravalées au rang de la bête. Si tout ce qui nous différencie des bêtes est de se cacher pour déféquer, la condition humaine me paraît tenir à peu de chose pensais-je. Je ne discutais jamais avec les femmes, en fait je trouvais déjà qu'elles étaient stupides mais je ne m'étais pas souciée de me le dire si clairement.
Quand j'y pense aujourd'hui, quelle affreuse petite pécore je fus ! Je tirais gloire et fierté d'avoir Inventé un divertissement qui me semblait extraordinaire, et je me sentais en face d'une meute qui me pourchassait, alors que nous étions toutes des prisonnières mêmement impuissantes. Peut-être, isolée par mon âge et par les contraintes qui nous étaient imposées, avais-je, comme les autres, besoin de me créer une illusion où loger la détresse. Je n'en sais rien. Depuis que je ne marche plus, je réfléchis beaucoup, mais sans dialogue il me semble que ma réflexion tourne vite en rond. C'est pourquoi il est intéressant d'écrire mes pensées : lorsqu'elles viennent pour la deuxième Fois, je les reconnais, et je ne les répète pas.
Quand Dorothée se réveilla et trouva la force de relater notre conversation, elle ne révéla pas que Je lui avais dit qu'elle était sotte, mais, si attentive qu'elle fût à ne pas ternir son prestige, elle ne savait rien de mon secret et ne put le dissimuler.
- Un secret! Un secret! De quel droit garde-t-elle un secret dans la situation où nous sommes ?
Théa, qui était la plus intelligente, comprit tout de suite que ce n'était pas le contenu même du secret qui était le plus important, mais qu'on pût prétendre, et être crue, à
l'existence d'un secret en vivant sans cesse sous les yeux les unes des autres. Cela parut trop compliqué aux femmes, elles écartèrent Théa d'un geste agacé et exigèrent qu'on m'arrache le secret.
- Il faut la contraindre. L'obliger.
- Comment feras-tu ?
Colette, la plus sotte et la plus excitée, vint se planter en face de moi et ordonna d'un ton menaçant que je parle.
- Sinon, gare !
- Sinon, quoi ? dis-je en pouffant de rire.
Elle fit un geste violent, on voyait qu'elle pensait à des gifles. On le voyait si bien que les gardes qui ne nous quittaient jamais du regard le virent en même temps que moi, on entendit claquer le fouet. Nous savions qu'ils ne dirigeaient pas les coups vers nous et que les fouets ne claquaient que dans le vide de la galerie qui nous entourait, mais ce bruit nous faisait toujours peur et Colette sursauta. Aucune des femmes n'avait le souvenir précis d'avoir été frappée, mais, Théa m'en parla plus tard, cela devait avoir eu lieu dans la période obscure, au début de l'enfermement, pour qu'une crainte si profonde se soit inscrite en nous. Jamais personne ne désobéissait au fouet et les femmes décrivaient parfois les traînées sanglantes que les lanières faisaient sur la peau nue, la douleur brûlante qui durait des jours. Le fait est que plusieurs portaient de longues cicatrices blanches. Colette effrayée recula, je lui souris durement. J'étais prise entre l'envie de la narguer en silence, faisant des gardiens mes alliés, et celle de lui expliquer sa bêtise et son impuissance, quand Théa intervint. Elle s'approcha de Colette tremblante de colère et de peur, lui fit signe de s'écarter.
- Viens. Ça ne sert à rien, dit-elle d'une voix très douce.
Colette eut un frémissement de tout le corps, je crus qu'elle allait se jeter dans les bras de Théa, mais nous savions bien qu'il nous était interdit de nous toucher et elle baissa la tête.
- Viens, répéta Théa.
Elles s'en allèrent côte à côte. Je me réinstallai, la tête sur les genoux, contente qu'elles me laissent enfin en paix, et je me rendis compte que je ne pouvais pas me replonger dans l'histoire. Tout cela m'avait rendue nerveuse, je n'avais plus envie de rester assise, je ne retrouvais pas ma concentration. Je me levai, rejoignis les femmes qui préparaient les légumes pour la cuisson et m'offris à
les aider. Mais j'étais maladroite, je les agaçais.
- Oh! Va jouer! dit l'une d'elles.
- Avec qui ?
J'étais la plus jeune, la seule qui fût encore enfant quand nous avions été
enfermées. Les femmes ont toujours pensé que je devais n'être parmi elles que par erreur, que dans le grand tumulte qui avait régné, j'avais été envoyée du mauvais côté et que cela n'avait pas été corrigé. Sans doute, une fois les grilles fermées, ne devaient-elles jamais se rouvrir. Même, elles disaient parfois que les clefs devaient être perdues, et que, l'eût-on voulu, on n'aurait pas pu nous libérer. Je pense que c'était une plaisanterie, mais je ne m'en souviens que maintenant et il est trop tard pour m'en assurer.
Aline, la femme qui m'avait houspillée, sembla gênée. Elle me regarda tristement, peut-être avait-elle pitié de moi et réprouvait-elle l'acharnement de celles qui voulaient m'arracher mon secret.
- C'est vrai. Pauvre petite. Tu es toute seule. Elle avait l'air ému, ce qui calma un peu ma colère. Les femmes ne se montraient pas souvent gentilles avec moi. Je suppose qu'à cette époque elles m'en voulaient d'être là et d'être vivante, alors qu'elles ne savaient pas ce qu'il était advenu de leurs filles. Sans doute la terrible catastrophe où nous étions pouvait expliquer leur attitude : aucune ne se souciait jamais de moi, ne faisait un seul geste pour me rassurer. Mais peut-être n'était-il pas possible de rassurer? Ma propre mère n'était pas avec nous, nous ne savions rien de ce qui était arrivé aux autres, nous pensions qu'elles étaient toutes mortes. Ces temps-ci, j'ai fouillé dans mes souvenirs, il m'a semblé les voir qui se balançaient en gémissant, elles pleuraient, aucune ne tournait les yeux vers moi qui grelottais de terreur et je les détestais. Cela m'a semblé
injuste, et puis j'ai compris que, seule et terrifiée, la fureur était mon unique recours contre l'épouvante.
Je m'écartai d'Aline et allai me rasseoir, les genoux repliés, mais je ne parvins pas à reprendre ma rêverie. Je m'ennuyai. Faute de divertissement, je me mis à
les observer. Ce jour-là, nous avions reçu des poireaux et du mouton grossièrement équarri. Tout en nettoyant les légumes, elles discutaient avec ardeur de l'accommodement qu'elles choisiraient. Je ne portais jamais grande attention à ce que je mangeais, qui n'était à mon gré ni bon ni mauvais, sauf si j'avais encore faim quand mon assiette était vide, ce qui était rare car j'avais peu d'appétit, mais en les regardant parler, je fus frappée d'étonnement: à les entendre, on aurait imaginé qu'elles avaient le choix entre plusieurs recettes, des assaisonnements divers, alors qu'elles ne disposaient que de trois grandes marmites et d'eau, elles ne pourraient jamais que mettre les légumes à bouillir.
On les mangerait au déjeuner et l'eau de cuisson servirait de potage pour le soir.
Parfois, il venait un supplément de nourriture pendant l'après-midi, quelques kilos de pâtes, rarement des pommes de terre, rien qui pût prêter à beaucoup d'élaboration. Sans doute était-ce leur manière de se raconter des histoires, elles faisaient ce qu'elles pouvaient. Elles disaient et j'avais déjà entendu cela cent fois, mais sans y prêter attention - que le goût d'un bouillon n'est pas le même si on y met en premier lieu la viande ou les légumes, qu'on pouvait aussi cuire les ingrédients séparément, couper les poireaux en julienne ou en gros morceaux, laisser la cuisson réduire pour lui donner un goût plus vif, elles s'agitaient en jacassant. C'était la première fois que je les écoutais attentivement, je fus étonnée par l'abondance de leur parole, l'ardeur qu'elles mettaient à redire dix fois la même chose sous une autre forme pour ne pas s'apercevoir qu'elles n'avaient, en fin de compte, absolument rien à se dire depuis des éternités, mais il faut qu'un être humain parle, sinon il perd son humanité, je l'ai compris ces dernières années. Et peu à peu, elles me firent pitié, ces femmes acharnées à vivre, à feindre qu'elles agissaient, qu'elles prenaient des décisions dans la prison où elles étaient définitivement enfermées, dont elles ne sortiraient qu'en mourant - mais enlèverait-on les cadavres ? - et où elles ne pouvaient même pas se tuer.
Je me trouvai tout à coup en train de réfléchir à notre situation. Jusqu'alors, je l'avais endurée sans y penser, comme un état naturel, se demande-t-on pourquoi on a sommeil le soir et faim au réveil? Je savais, comme les autres, que parmi les choses interdites se trouvait le suicide. Au début, certaines, plus désespérées ou plus actives, avaient essayé le couteau ou la corde, et cela avait fait comprendre à quel point les gardiens nous surveillaient étroitement, car le fouet avait aussitôt claqué à leurs oreilles. Ils étaient d'excellents tireurs, touchant leur but de loin, coupant les ceintures dont elles comptaient faire des cordes, arrachant le couteau mal aiguisé aux mains qui le tenaient. Ils veillaient à nous garder en vie, ce qui fit croire aux femmes qu'ils voulaient les utiliser de l'une ou l'autre façon, qu'il y avait des projets. Elles imaginèrent toutes sortes de choses, il ne se passa rien. Nous étions nourries, sans excès grâce à quoi celles qui étaient trop grosses maigrirent, et sans manque réel. Nous devions préparer les repas dans les grandes marmites et, quand l'épluchage des légumes était fait, rendre les deux couteaux qui coupaient toujours mal. Nous recevions de temps à
autre quelques mètres de tissu qui permettaient de faire des vêtements, d'une coupe rudimentaire car nous n'avions pas de ciseaux, il fallait déchirer avec précision. J'écrivais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'événements, ce n'est pas tout à fait vrai : l'arrivée des pièces d'étoffe créait une grande excitation. Nous savions quelle robe était usée au-delà de toute réparation, quelle autre pouvait encore être sauvée et de grands calculs commençaient, qui visaient à exploiter au mieux le coton neuf. Il fallait tenir compte de la quantité de fil qui l'accompagnait, il arriva qu'il restât des bouts de tissu et que nous n'eussions plus rien pour les assembler. Un jour, Dorothée eut l'idée de coudre avec des cheveux, elle se souvenait que, dans un passé très lointain, on s'en était servi pour broder. Anna et Laurette avaient les plus longs cheveux, qui furent utilisés pour les premiers essais. Ils ne réussirent pas, le cheveu cassait, puis quelqu'un eut l'idée d'en tresser plusieurs et nous parvînmes à un certain résultat : les coutures ne tenaient pas longtemps, mais il y avait toujours de quoi les refaire.
Les gardes ne nous donnaient ni serviettes hygiéniques ni papier de toilette, ce dont les femmes se plaignaient beaucoup. Moi qui ne me souvenais pas d'en avoir disposé, je me débrouillais fort bien avec l'eau courante, qui ne manquait jamais, et, grâce à mon aménorrhée, je n'avais pas le souci de recueillir le sang.
Les moindres débris de tissu étaient soigneusement rassemblés, elles s'en servaient pour les règles, puis les lavaient longuement à l'eau claire car nous ne recevions que très peu de savon, noir et liquide, qui était réservé aux soins du corps.
Cette absence presque complète d'activité physique nous aurait privées de toute force, et nous nous astreignions à faire tous les jours un peu de gymnastique, ce qui était la chose la plus effroyablement ennuyeuse du monde, mais même moi je m'y soumettais car je comprenais que c'était nécessaire. Il arriva une ou deux fois qu'une femme fut malade : un thermomètre était joint aux provisions, le fouet faisait comprendre qu'elle devait prendre sa température, et il venait des médicaments si elle avait de la fièvre. Il semble que notre santé était particulièrement bonne. Mais, avec la nourriture, l'éclairage et le chauffage constant, nous devions coûter cher à quelqu'un ou à quelque chose, et nous ne savions pas pourquoi on se donnait toute cette peine. Dans la vie d'avant, les femmes travaillaient, portaient les enfants, on pouvait faire l'amour avec elles, dont je sais seulement que cela était fort prisé. À quoi servions-nous, ici ?
Je fus étonnée par mes réflexions. Tout à coup le secret qu'on me refusait et celui que je ne voulais pas donner me parurent de peu de valeur à côté de celui que détenaient les gardiens : que faisions-nous ici, pourquoi nous maintenait-on en vie ?
Je rejoignis Théa qui avait toujours été la moins rébarbative envers moi. Elle me sourit.
- Alors ? Tu viens me dire ton secret ?
Je hochai les épaules, agacée.
- Ne sois pas aussi stupide que les autres.
Regarde-les. Elles font semblant, elles se conduisent comme si elles dirigeaient encore quelque chose dans leur vie et prennent de grandes décisions sur l'ordre de cuisson des légumes. Que faisons-nous ici ?
Théa prit un air distant.
- Que veux-tu dire ?
- On ne peut pas parler de cela non plus ! Vous passez votre temps à vous faire croire que vous savez des choses, et vous vous servez de moi, qui en ignore une, pour vous convaincre de votre supériorité ! Personne n'a idée des raisons pour lesquelles on nous garde si attentivement et vous avez peur d'y penser.
- Ne nous mets pas toujours au pluriel.
- Alors singularise-toi ! Réponds avec ta propre pensée. Si tu en as une.
Nous ne pouvons pas nous gifler, mais si nous parlons calmement, sans que les expressions de nos visages trahissent la violence, nous pouvons échanger des paroles coupantes.
- À quoi sert-il d'en parler? Cela ne changera rien.
- Voilà encore bien votre stupidité ! Comme si parler ne devait servir qu'à
produire des événements. Parler, c'est exister. Regarde : elles le savent si bien qu'elles parlent pendant des heures pour ne rien dire.
- Mais est-ce que parler va nous apprendre quoi que ce soit sur ce que nous faisons ici ? Tu n'en sais pas plus que moi, ni qu'aucune d'entre nous.
- Non, mais je saurai ce que tu en penses, tu sauras ce que j en pense, peut-être cela fera-t-il naître une nouvelle idée, et puis nous aurons l'impression de nous comporter comme des êtres humains et pas des automates à répétition.
Elle déposa le bout de tissu qu'elle cousait avec des cheveux tressés et croisa les mains sur les genoux.
- Quand tu es assise, seule et les yeux fermés, c’est cela que tu fais, tu réfléchis sur nous ?
- Je fais ce qui me plaît, ne cherche pas à m'arracher des confidences, je ne suis pas une fille distraite qu'on prend par surprise.
Elle rit.
- Tu aurais été très brillante ! Tu aurais eu un beau et grand destin, toi ! Nous n'avons plus de destin. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous divertir à
converser. Tu te moques de la discussion sur les légumes, et pourtant ce que tu me proposes est la même répétition inutile.
Je me mis à rire. Il était fort plaisant d'avoir une Interlocutrice aussi intelligente que moi.
- Le sujet me plaît davantage. Sait-on pourquoi ils nous ont enfermées ?
- Non.
- Et où sont les autres ?
- Pour autant qu'il y en ait, on ne sait pas. Comme nous sommes ici, et qu'on nous garde en vie, nous pensons qu'il doit y en avoir d'autres qui vivent quelque part, mais rien ne le prouve et, s'il en est bien ainsi, nulle n'a idée du sens que cela peut avoir. Il n'y a pas le moindre indice. Ils ont rassemblé des adultes, tu n'es certainement ici que par erreur. Au début — enfin, pas vraiment au début, car il y a une période dont personne n'a un souvenir clair, mais après, à partir du moment où les choses s'organisent dans nos mémoires, nous savons que nous réfléchissions tout le temps. Ils auraient pu te tuer, mais ils ne tuent pas, ou te retirer, t'envoyer ailleurs, s'il y a d'autres prisons semblables à celle-ci, mais là
ton arrivée aurait constitué une information, et la seule chose dont nous soyons sûres est qu'ils veulent qu'on ne sache rien. Nous avons fini par supposer qu'ils t'ont laissée ici parce que toute décision peut être examinée, et que leur absence de décision marquait la seule chose qu'ils veulent qu'on sache, et qui est que nous ne devons rien savoir.
Jamais aucune des femmes ne m'avait parlé si longuement. Je sentais qu'elle me livrait tout ce qu'elle possédait, j'en eus un vertige léger qui n'était pas désagréable. Cela évoquait confusément le soulèvement et je me promis de voir ce que j'en pourrais faire dans mes histoires.
- Et rien de plus ?
- Rien.
Elle soupira, reprit son ouvrage, l'inspecta machinalement.
- Et nous n'en saurons jamais davantage. Nous mourrons l'une après l'autre, à
mesure que l'âge nous emportera. Dorothée sera sans doute la première, son cœur n'est pas bon. Elle a l'air d'avoir plus de soixante-dix ans. Moi, je ne dois pas en avoir atteint quarante : sans les saisons, nous ne pouvons pas tenir le décompte du temps. Tu seras la dernière.
Elle me regarda longuement sans rien dire. Comme j'avais beaucoup exercé
mon imagination ces temps-ci, je devinais ses pensées : un jour, je serais seule, dans la grande salle grise. Le matin, un garde me passerait de la nourriture, que je ferais cuire sur la plaque chauffante, je mangerais, je dormirais et je mourrais seule, sans avoir compris notre destin ni pourquoi il nous avait été infligé. Je fus glacée de terreur.
- Ne peut-on rien faire ?
- Il n'en est pas une d'entre nous qui n'ait songé à se tuer, mais ils sont trop prompts. Il ne faut pas essayer de se pendre : on n'aurait pas fini d'attacher un bout de tissu tordu en corde à la grille qu'ils seraient déjà là. Marie, qui est assise là-bas et qui parle avec Dorothée, a essayé de se laisser mourir de faim : ils l'ont poursuivie au fouet et harcelée jusqu'à ce qu'elle renonce. Tu connais les couteaux qu'ils nous donnent: ils ne coupent rien, lé peine si on peut gratter les carottes, et ils interdisent qu'on tente de les aiguiser. Une fois, il y a longtemps, Alice, une des femmes les plus désespérées, a obtenu d'une autre qu'elle l'étrangle. Ça s'est passé la nuit, quand ils baissent les lumières. Nous pensions que les gardes marchaient machinalement, en se fiant à notre immobilité : mais ils continuent à nous surveiller si attentivement, si constamment qu'ils ont compris, les fouets ont claqué.
- Ils ne nous touchent jamais.
- Jadis, ils l'ont fait, il y a eu des blessures, qui guérissaient très lentement. On ne sait pas pourquoi ils ont arrêté. Les révoltes sont inutiles. Il faut attendre de mourir.
Elle reprit sa couture. Elle assemblait les morceaux les moins usés d'une robe pour en faire je ne sais plus quoi. Quand j'y pense, je me dis que les pièces de tissu étaient quasiment de la générosité : il faisait chaud dans la cave et nous aurions pu vivre sans vêtements. Je revois les deux latrines, au milieu de la salle, où, comme nous étions quarante, il y avait presque tout le temps une femme assise qui faisait ses besoins, et j'ai de la difficulté à croire qu'ils aient voulu ménager notre pudeur en nous permettant de nous couvrir. J'observais Théa, il me vint à l'esprit que, puisque je devais être la dernière, il faudrait qu'un jour j'apprenne à coudre. À moins que, à mesure que les femmes mourraient, ils ne me laissent leur vêture et que, héritière de loques, j'aie de quoi m'habiller jusqu'au bout.
- J'étais triste. J'avais toujours détesté mes compagnes de prison à cause de leur indifférence à mon égard et je ne m'étais jamais préoccupée d'elles. À notre arrivée ici, elles étaient envahies par leur désespoir, leur peur, et j'étais restée isolée, petite fille terrifiée parmi des femmes qui pleuraient. En mourant, elles me laisseraient de nouveau toute seule. La colère monta en moi. Elles avaient donc réfléchi à notre situation, elles s'étaient longuement interrogées et m'avaient toujours laissée en dehors de leur questionnement. Théa était la première qui se donnât la peine de me parler. Cette conversation m'avait intéressée, je m'étais attachée à l'écouter, à réfléchir, comme si pendant des années elle ne m'avait pas tenue aussi écartée que faisaient les autres.
- Pourquoi, aujourd'hui, me parles-tu ? Elle sembla étonnée.
- Mais c'est toi qui es venue me parler, dit-elle. Tu restes constamment seule, comme si tu ne voulais pas te mêler à nous.
- J'allais lui dire qu'elles se taisaient toujours quand j'approchais, mais tout à
coup je me sentis terriblement fatiguée. Peut-être n'étais-je pas habituée à
converser si longuement. Elle me vit bâiller.
- Ils vont bientôt baisser les lumières. Préparons-nous à dormir. Nous causerons encore demain.
Naturellement, je ne trouvai pas le sommeil. Je voulais reprendre l'histoire qui avait été interrompue par Annabelle au moment où j'étais dans une cellule, le jeune garde allait bientôt apparaître, mais je ne pouvais pas me concentrer.
D'habitude, quand je me racontais une histoire je devenais insensible à ce qui se passait au-dehors, ce soir-là, les allées et venues des femmes qui disposaient les matelas, leurs chuchotements, l'arrivée progressive du silence, tout faisait irruption. Je pensais aux années, au chagrin, à ces époux perdus, aux enfants qu'elles n'avaient jamais revus, à ma mère, puisque, forcément, j'avais eu une mère. Je ne me souvenais pas d'elle, je savais seulement qu’il y devait y avoir eu quelqu'un à qui je disais maman, et qui n'était pas dans la prison. Etait-elle morte ? Je rassemblais le peu de chose que j'avais entendu dire sur la catastrophe, cela tenait en quelques mots : des cris, la bousculade, la nuit et une épouvante grandissante. Elles croyaient qu'elles avaient dû s'évanouir, peut-être plusieurs foin, et que tout s'était passé très vite, mais en y pensant je me dis que l'explication ne suffisait pas. Nous étions quarante qui n'avions aucun lien, alors que chacune, avant, était pourvue d'une famille, de parents, de frères, de sœurs, d'amis : seul un tri méticuleux pouvait n'avoir rassemblé que des étrangères.
C'est ce que Théa confirma le lendemain :
- Rends-toi compte du travail que cela représente : ils se sont arrangés pour qu'aucune de nous n'en connaisse une autre. Ils nous ont prises aux quatre coins du pays, et même de plusieurs pays, en vérifiant que le hasard ne réunirait pas deux cousines ou deux amies séparées par les circonstances.
- Pourquoi ? Que cherchent-ils ?
- Nous avons failli devenir folles à force de nous le demander. Toi, tu étais trop petite, tu ne pouvais rien y comprendre, et puis tu étais roulée en boule par terre, tu ne répondais pas quand on te parlait.
- Je ne me souviens pas de cela.
- Nous avons cru que tu ne te rétablirais pas. Comme il nous était interdit de nous toucher, aucune ne pouvait te prendre dans les bras, tenter de te rassurer, ni même te forcer à manger. Nous avons pensé que tu allais mourir, mais, très lentement, tu t'es remise à bouger. Tu t'es approchée de la nourriture au moment des repas, tu as accepté quelques bouchées. Alors, bien sûr, nous avons pris l'habitude de ne jamais évoquer nos maigres souvenirs devant toi, nous pensions que cela t'aurait fait du mal. Et peu à peu, nous nous sommes lassées d'en parler entre nous. Cela n'apportait rien. Les mêmes questions, posées pendant des années de la même manière, ça s'use tout seul.
- Et vous vivez comme ça, avec vos légumes, sans perspectives ?
- Si, la mort, dit-elle sèchement. Nous ne pouvons pas nous suicider, mais nous mourrons quand même. Il suffit d'attendre.
Je n'avais jamais pensé si clairement à notre situation. Dans mes histoires, il y avait toujours des événements : dans ma vie, il n'y en aurait jamais. Je compris qu'elle avait raison et que les secrets de l'amour ne me concernaient pas. Elles avaient peut-être joué à savoir quelque chose de plus que moi parce que, sur l'essentiel, elles ne savaient rien. Je me doutais que les hommes ne sont pas conformés comme les femmes : mais puisque je n'approcherais jamais un homme? Quelle importance cette différence avait-elle ? Ce sont les filles d'une autre histoire qui ont besoin d'être préparées aux noces, me dis-je.
Il me sembla que cette journée-là fut très courte, ce que j'attribuai à l'intensité
de ma réflexion. Quand la lumière baissait il fallait étaler les quarante matelas pour s'y coucher. Il y avait trop peu de place, ils étaient presque côte à côte, et tous les matins nous les disposions en pile de trois ou quatre afin de pouvoir circuler et de nous y asseoir. Je m'étendis et essayai de reprendre le récit, mais j'en étais incapable, j'avais la tête vide et une sorte de grande douleur dans la poitrine.
- Ferme les yeux, dit ma voisine, ne montre pas que tu ne dors pas.
- Pourquoi ?
C'était Francine, une des femmes les plus jeunes, une de celles qui ne s'étaient jamais moquées de moi.
- Tu n'observes donc rien? Tu vis parmi nous Comme si tu étais tombée de la lune. Ils ne permettent pas qu'on ne dorme pas, quand on n'a pas les yeux fermés, on est appelée à la grille et il faut prendre des pilules.
- Appeler? Mais ils ne nous parlent jamais !
- Oh ! ils parlent avec leurs fouets !
Je compris ce qu'elle voulait dire. Il arrivait très rarement qu'une femme désobéît : mais alors le fouet claquait à côté d'elle, jusqu'à ce qu'elle hume ce qui était ordonné. Ils étaient inlassables et d'une habileté parfaite, ils pouvaient le faire claquer vingt fois de suite à côté d'une oreille, si celle qui était visée résistait, il y en avait toujours une autre qui cédait. Quand Alice qu'ils avaient forcée à manger avait voulu s'étrangler avec sa robe roulée en corde, les nerfs de Clotilde avaient cédé et elle s'était jetée sur le nœud pour le défaire et arrêter l'effroyable menace de mort, toujours promise, jamais donnée. Je fermai les yeux.
- Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Demanda Francine.
- Comment arrives-tu à dormir ?
Elle ne dit rien. Je sentais de durs sanglots me serrer la gorge.
- Est-ce qu'on peut pleurer? Sans pilules?
- Non. Il vaut mieux te retenir. Alors, quelque chose d'étrange se passa en moi, j'eus envie de me blottir dans ses bras et cela fut si brusque, si inattendu, que j'en fus submergée. Je me jetai contre elle avant de me rendre compte de ce que je faisais.
- Arrête ! souffla-t-elle épouvantée.
Et le fouet claqua au-dessus de ma tête. Je reculai terrifiée, c'était la première fois que j'étais visée. J'en tremble encore. Je me rencognai, haletante comme si j'avais couru.
Courir? Je n'avais jamais couru!
Je savais pourtant bien que nous ne pouvions pas nous toucher et, comme je n'avais rien connu d'autre, je tenais cela pour évident. L'élan qui venait de m'emporter réveilla des choses confuses en moi : se donner la main, marcher en se tenant par la taille, se serrer dans les bras, ces mots étaient dans mon vocabulaire, ils désignaient des gestes que je n'avais jamais faits. Une promenade ? Je me souvenais peut-être de pelouses ou de saisons, puisque ces termes faisaient résonner quelque chose de très lointain, un écho léger qui s'éteignait vite. Je connaissais les murs gris qui s'écaillent, les barreaux de quinze en quinze centimètres, les gardes qui parcouraient régulièrement l'entour de la salle.
- Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? demandai-je de nouveau.
Elle haussa les épaules.
- On sait seulement ce qu'ils ne veulent pas.
Elle se détourna et il fut évident qu'elle ne continuerait pas la conversation.
Théa était la première qui eût consenti à parler longuement, peut-être serait-elle la seule ?
Je m'appliquai à garder les yeux fermés, espérant qu'à force de feindre le sommeil je m'endormirais. Pour la première fois, je comprenais que je vivais au sein même du désespoir. Je m'en étais tenue isolée : j'avais cru que c'était par rancune, il me sembla tout à coup que c'était par prudence et que toutes ces femmes qui vivaient sans savoir ce que leur vie signifiait étaient folles. Qu'elles en fussent responsables ou pas, elles étaient devenues folles par la force des choses, leur raison s'était égarée parce que plus rien n'avait de sens dans leur existence.
Je ne sais pas quel âge j'avais. Comme je n'étais pas réglée et que je n'avais quasiment pas de seins, Certaines croyaient que je n'étais pas aux quatorze ans, à peine treize, mais Théa qui raisonnait mieux que les autres pensait que je devais en avoir quinze nu seize.
- Nous ne savons pas depuis combien de temps nous sommes ici. Ta taille n'est plus celle d'une enfant, et certaines d'entre nous n'ont plus de règles depuis longtemps. Ce n'est pas à cause de l'âge. Anna est jeune, elle n'a pas de rides, moi non plus, me dit-on, ce n'est pas la ménopause qui nous a desséchées, c'est le désespoir.
- Alors, les hommes étaient très importants ? Elle hocha la tête.
- Les hommes, petite, c'était être en vie. Que Nommes-nous, sans avenir, sans descendance ? Les derniers maillons d'une chaîne cassée.
- La vie donnait donc tellement de plaisir?
- Tu as si peu idée de ce qu'était avoir un destin Glue tu ne peux pas comprendre ce qu'il en est d'être dépourvu au point où nous le sommes.
- Regarde notre façon de vivre : nous savons qu'il faut faire comme si c'était le matin car ils augmentent l'éclairage, puis ils nous passent la nourriture et à un moment donné les lumières baissent. Nous ne sommes même pas sûres qu'ils nous fassent vivre sur un rythme de vingt-quatre heures, comment mesurerions-nous le temps ? Ils nous ont réduites au dénuement absolu.
Son intonation était dure, elle regardait droit devant elle, je sentis que, de nouveau, j'avais envie de pleurer. Je me roulai en boule.
- Qu'as-tu?
Et sa voix était tout à coup si douce, si chantante que je frissonnai comme sous une caresse. Enfin, je suppose que cela peut se dire ainsi : quelque chose d'exquis se répandait en moi, si délicieux que cela me fit peur. Je me recroquevillai plus fort.
- Je ne veux plus parler, lui dis-je. J'étais mieux quand je n'avais rien compris, quand je vous détestais toutes parce que vous gardiez vos secrets. Vous n'en avez pas. Vous n'avez rien et il n'y a rien à avoir.
- Quels secrets croyais-tu que nous avions ? Mon ignorance ne m'humiliait plus, depuis que j'avais effleuré un savoir trop douloureux pour être supporté.
- Comment on fait l'amour, avec quoi, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Elles sont là à se raconter des histoires du passé, à faire des allusions en pouffant de rire et à se taire quand j'approche. Je croyais que c'était ça qui était important, et ça ne sert à rien.
- Pauvre petite, dit-elle, si tendrement et si tristement que mes larmes jaillirent.
Sans doute toléraient-ils que nous pleurions, du moment que ce fût calmement, sans éclat : le fouet ne claqua pas.
Il y eut un peu d'agitation, car il arrivait de la nourriture. Quand la faim nous prenait pour la deuxième fois depuis le matin, nous disions que c'était le soir.
Nous faisions cuire ce qu'il y avait, nous mangions, et peu après les lumières baissaient. Les femmes disaient que, avant la catastrophe, l'usage était de prendre trois repas par jour, le matin, à midi et le soir, mais notre appétit n'apparaissait que deux fois par période de veille et il n'était pas sûr qu'ils nous fissent vivre au même rythme qu'avant. C'était une de ces discussions qui recommençaient toujours mais qui ne se renouvelaient jamais, puisque rien ne changeait. Est-ce que, ne travaillant pas, nous avions moins de besoins et que deux repas nous suffisaient ? Nos corps auraient-ils perdu leurs habitudes au point que nous puissions dormir toutes les huit ou dix heures ? Cependant, savions-nous combien de temps nous dormions? Peut-être nous tenaient-ils éveillées huit heures et ne nous donnaient-ils que des nuits de quatre heures ?
Ou six ? Lès gardes étalent relevés à des intervalles qui ne correspondaient pas à ceux de notre vie, parfois au milieu du mir, parfois la nuit, ou deux fois pendant une journée. Je les regardais en rassemblant le peu que a savais quand je me rendis compte que le jeune garde qui avait les yeux bleus avait dû être absent: tout à coup, je le vis qui marchait le long de la grille et je me rendis compte que je n'avais plus pensé à lui et que je ne me racontais plus d'histoires depuis plusieurs jours. Il me sembla toujours aussi beau.
J'allai chercher mon assiettée de nourriture et m'assis à côté de Théa.
- Beau, lui demandai-je, belle : je suppose que ce sont des mots d'avant, de quand il se passait des choses ?
Elle me regarda longuement puis détourna les yeux.
- J'étais belle, dit-elle. Je ne sais pas si je le suis encore, il faudrait un miroir.
Mes cheveux sont devenus gris, mais cela ne signifie pas que je sois vieille, les femmes de ma famille blanchissaient tôt. Mes souvenirs sont confus, je crois que j'avais vingt-huit ans l'année de l'emprisonnement. Au début, je me souciais encore de me coiffer, j'étais Fort ennuyée d'avoir perdu mes brosses.
Elle parlait à mi-voix, comme pour elle-même, mais je savais bien qu'elle s'adressait à moi.
- Et puis ma robe s'est usée. C'était une jolie robe d'été, bien à la mode, avec des volants, dans ce genre de tissu délicat qui ne dure pas longtemps. J'ai été une des premières à porter ces espèces de tuniques que nous fabriquons.
Maintenant, il ne reste aucune robe d'avant, pas même des débris, qui ont été
utilisés jusqu'au dernier fil. Tu ne peux pas t'en faire une idée.
- Être belle, c'était pour les hommes ?
J'en étais à peu près sûre, mais j'entendais parfois des propos contradictoires.
- Oui. Il y en a qui disaient qu'on est belle pour soi. Que veux-tu qu'on ait à faire de sa propre beauté ? Moi, j'aurais pu m'aimer bossue ou bancale, pour être aimée des autres, il fallait de la beauté.
- Est-ce que j'en ai ?
Je la vis sourire, mais ce sourire était un crève-cœur.
- Oui, dit-elle. Oui. Tu aurais sans doute été parmi les plus jolies, car tu n'aurais pas eu cet air renfrogné et furieux, tu aurais ri, tu aurais provoqué les garçons.
- Parfois, je provoque le jeune garde, dis-je impulsivement.
Je venais de le comprendre.
Quand je me racontais des histoires, j'allais toujours m'asseoir à petite distance de la grille, du côté où il allait et venait. Il marchait à pas lents, surveillant attentivement ce qui se passait dans la cage, comme ils faisaient toujours. Moi, accroupie, tournée vers lui, je ne bougeais pas, je le suivais du regard, je l'observais, et comme il devait tout voir, il ne pouvait pas ne pas me voir le regarder. Juste une fille assise, vêtue de sa tunique informe. Mes cheveux étaient longs, je les nouais dans la nuque : hors de ça, je ne savais pas à quoi je ressemblais. Je ne connaissais même pas la couleur de mes yeux, que Théa me dit plus tard, et je n'avais aucune idée de ce que signifiait être parmi les plus jolies. Il ne me semblait pas qu'aucune des femmes fût belle : elles étaient propres, nous gardions le peu de savon que nous recevions pour nos corps et nos cheveux qui étaient toujours bien lavés. Nous avions presque toutes de longues chevelures, car nous n'avions rien pour les couper, ni pour couper nos ongles qui se cassaient n'importe comment quand ils avaient trop poussé; et nous avions l'air triste, sauf au moment des petits rires nerveux. Je ne sais pas quelle expression J'avais quand je regardais le garde : cela m'occupait complètement, je n'étais plus que regard. Il ne posait jamais les yeux sur moi : j'étais sûre qu'il avait que je le fixais constamment et qu'il en était embarrassé.
- Je voudrais lui faire perdre contenance.
- Mais pourquoi ? demanda Théa très étonnée. - Je ne sais pas. Pour avoir du pouvoir sur lui. Ils ont le fouet et ils nous font faire ce qu'ils veulent, qui est presque rien. Ils empêchent tout. Je voudrais qu'il soit perturbé, inquiet, effrayé, et qu'il ne puisse pas réagir. Il n'a jamais été interdit d'être assise et de regarder.
- Ils vont peut-être l'interdire. Ils interdisent à leur gré.
- Alors, ils reconnaîtraient que j'existe. Si tu fais une chose déjà interdite, c'est l'action qui est visée. Si tu fais une chose qui n'a pas été défendue et qu'on intervient, ce n'est pas l'activité qui attire l'attention, c'est toi-même.
Elle était la plus intelligente des femmes, mais j'avais compris une chose à quoi elle n'avait pas pensé, j'étais au moins aussi intelligente qu'elle ! Des remous délicieux me parcoururent, je lui souris.
- Ils nourrissent quarante femmes, ils les chauffent et leur distribuent de quoi se vêtir. Pour eux, nous n'avons pas de nom, ils nous traitent comme si rien ne nous différenciait les unes des autres. Moi, je suis moi. Je ne suis pas un quarantième de troupeau, une tête de bétail parmi les autres. Je vais le regarder jusqu'à ce qu'il soit gêné.
L'audace de ma pensée me suffoquait. Depuis des années, nous étions ici, réduites à une impuissance totale, déchues, démunies de tout même des outils pour se tuer, déféquant en pleine lumière sous les yeux de tout le monde, sous leurs yeux : moi, je voulais gêner un gardien et je pensais en avoir trouvé le moyen.
- Ne dis rien à personne. Je ne veux pas que les femmes sachent ce qui se passe.
Elles changeraient d'attitude, elles ne pourraient pas s'en empêcher et ce que je fais perdrait tout pouvoir.
- Et si nous nous mettions toutes à les regarder, ne seraient-ils pas encore plus gênés ?
- Ils ne le seraient plus du tout.
Les pensées me venaient comme des certitudes fulgurantes et je me sentais absolument sûre d'elles. D'où les tirais-je ? Je ne le sais toujours pas, seulement que je prenais un immense plaisir à ce qui se passait dans mon esprit.
- Une chose que tout le monde fait n'a pas de sens. C'est juste un usage, une coutume, on ne sait plus son origine, on la répète machinalement. Pour obtenir qu'il soit troublé, je dois être seule à le regarder.
Théa réfléchissait. Je ne suis pas sûre qu'elle me comprenait tout à fait, j'étais animée par une autorité irréfutable et rien ne m'arrêterait.
- Je ne sais pas à quoi tout cela peut nous conduire, lui dis-je, et c'est cela qui est prodigieux : dans notre vie absurde, j'ai inventé un imprévu. Elle hocha doucement la tête.
- Va, dit-elle, je vais continuer à y penser. Et je repris ma posture, assise en tailleur, le regard attaché au jeune gardien.
Etait-il vraiment beau ou ne le trouvais-je beau que parce qu'il était le seul des hommes à ne pas être vieux ? Moi qui savais si peu de chose et qui ne me souvenais pas du monde, je connaissais les signes de l'âge. J'avais vu les cheveux devenir gris puis blancs, les tavelures apparaître, les calvities menacer le sommet du crâne chez les plus vieilles femmes, les rides, le dessèchement, les plis, les tendons affaiblis, les dos voûtés. Le garde avait la peau nette, sa démarche était souple comme je sentais qu'était la mienne malgré le peu d'espace qu'elle avait pour se déployer, il était droit, jeune comme moi. Cela me sembla étrange : n'y avait-il plus assez de vieux? Peut-être étaient-ils tous morts
? Ou bien ne trouvait-on pas quoi faire des jeunes, on n'imaginait plus de tâches à leur donner et on les envoyait déambuler entre la grille et les murs? Avant, il n'y avait pas de jeune garde, me dis-je, et j'eus des battements de cœur. Depuis combien de temps était-il là? Il me sembla que je ne l'avais pas remarqué tout de suite, je n’avais pas compté les jours, j'ignorais quand j’avais commencé les histoires, je n'avais aucun père. Si je ne me trompais pas, si sa présence était récente, alors, pour la première fois depuis des années, quelque chose avait changé. Dehors, au-delà des murs, dans ce monde extérieur dont tout nous était dissimulé sauf la nourriture que nous mangions et les tissus qu'on nous donnait, des événements avaient eu lieu et leurs conséquences parvenaient jusqu'à nous.
Les gardiens avaient toujours été si vieux qu'on ne les voyait pas changer d'âge.
Moi, j'étais arrivée petite fille, j'étais femme, définitivement vierge, mais adulte malgré mes seins inachevés et ma puberté avortée : j'avais grandi, on avait pu mesurer sur mon corps le passage du temps. Les vieilles femmes ne changeaient pas plus que les vieux gardiens, les cheveux avaient blanchi, mais cela se passe si lentement qu'on n'en est pas frappé. J'avais été une horloge : en me regardant, les femmes regardaient leur propre temps s'écouler, était-ce pour cela qu'elles ne m'aimaient pas, peut-être les faisais-je pleurer rien qu'en existant? Le jeune garde n'était pas un enfant à son arrivée, il était grand, avec une chevelure bien drue, son visage n'avait pas de rides : les premières flétrissures de l'âge y paraîtraient et je tâterais ma peau pour savoir où j'en étais. Lui aussi serait une horloge, nous vieillirions à la même vitesse, je pourrais l'observer et juger, selon la souplesse de sa démarche, du temps qui me restait.
Il y avait donc eu un changement. Quelque part, une décision avait été prise, qui nous concernait, et dont nous pouvions constater les effets, un des vieux avait disparu, peut-être était-il mort et qu'on l'avait remplacé. Cela avait-il échappé à
l'attention de ceux qui régissaient nos vies, s'étaient-ils moqués de nous livrer une information ou leur vigilance s'était-elle relâchée ?
Je ne quittais pas les gardes des yeux. Ils étaient toujours trois, qui allaient et venaient dans la galerie. Ils ne se parlaient pas. Quand ils se croisaient, ils ne se regardaient pas, mais il me sembla qu'ils se surveillaient entre eux autant qu'ils nous surveillaient. On devait craindre qu'ils ne transgressent les consignes, qu'ils nous adressent la parole. J'eus de nouveau une intuition fulgurante, je comprenais pourquoi il fallait qu'ils fussent à trois : cela empêchait qu'il naquît de la complicité entre eux, on ne leur permettait pas de conversation privée dont le spectacle aurait pu nous dire quelque chose, ils devaient tout le temps maintenir leur position de geôliers soupçonneux. Les deux hommes qui circulaient avec le jeune garde étaient là depuis longtemps. Au cours des premières années, les femmes avaient tenté de parler aux gardiens, de revendiquer ou de les apitoyer, mais rien n'était venu à bout de leur blessante impassibilité. Alors, elles avaient renoncé et elles agissaient comme si elles ne les voyaient pas, comme si elles avaient rayé leur présence de leurs pensées —ou comme s'ils étaient eux-mêmes des barreaux dont on finit par connaître l'emplacement, on ne s'y heurte plus. Personne ne rêvait qu’ils en éprouvassent quelque mortification, mais l’orgueil des prisonnières se sentait préservé. Elles ne se plaignaient plus à eux et ne subissaient plus leur imperturbabilité comme une insulte. Le regard de cette fille, assise et qui ne bougeait pas, en prenait, sans aucun doute, plus de force.
Je ne me racontais plus d'histoires : en regardant le gardien, j'en créais une. Il fallait de la patience, je n'avais rien d'autre à dépenser. Je ne mais pas combien de périodes de veille s'écoulèrent ainsi. Je réfléchissais beaucoup, il m'apparut qu'il ne fallait plus penser en termes de jours et de nuits, mais de périodes de veille et' de sommeil. Ma certitude s'affermissait: nous ne vivions pas selon un cycle de vingt-quatre heures. Quand la lumière baissait, personne n'était fatigué
: les femmes disaient que c'était parce qu'elles n'avaient rien à faire. Elles avaient peut-être raison, moi je ne savais pas ce qu'il en était de travailler. C'est en observant constamment le jeune garde que je me convainquis. Les relèves n'avaient pas lieu au lever, aux repas ou au coucher, quand nous circulions dans tous les sens, mais à des périodes neutres et irrégulières. La grande porte s'entrouvrait, les trois hommes qui tournaient autour de la cage se rassemblaient, parfois ils quittaient tous la salle pendant que les suivants y entraient, parfois seul un ou deux étaient remplacés. Y avait-il un rapport entre leurs heures et les nôtres ? Comment pouvais-je évaluer le passage du temps ?
Je n'avais d'autres signes que les rythmes de mon corps.
Théa m'apprit que le cœur bat toujours à la même cadence, de soixante-dix à
soixante-quatorze fois par minutes chez une personne en bonne santé.
J'entrepris de compter.
On ne m'avait appris que très peu de chose. Trente, quarante, cinquante, certaines des femmes disaient septante, d'autres soixante-dix et il y avait aussi octante, il fallut que je me mette bien l'ordre des dizaines en tête, après quoi je m'aperçus que je ne connaissais pas les tables de multiplication et que je ne savais pratiquement pas diviser. Si, entre l'instant où la lumière augmentait et celui de la relève suivante, où le jeune garde arrivait, mon cœur avait battu sept mille deux cents fois, cela aurait donné cent minutes, il ne s'agissait que de multiplier par cent les soixante-douze de Théa, mais j'avais trois mille deux cent vingt ou cinq mille douze ! Je n'étais pas capable de faire les opérations nécessaires. Je pouvais me concentrer et compter, je n'arrivais pas à me servir des chiffres que j'obtenais.
- Peux-tu m'apprendre à calculer? demandai-je à Théa.
- Sans papier? Sans crayon?
Elle s'expliqua :
- Nous ne sommes pas aussi indifférentes que tu crois, et nous avons beaucoup discuté de ton éducation. T'apprendre à lire ? Avec quoi et pour lire quoi?
Compter, jusqu'à un certain point, cela a été possible, mais seulement pour le calcul mental et nous n'avons pas pu te montrer les opérations arithmétiques. Tu ne saurais pas lire un nombre. Hélène et Isabelle t'ont appris les tables de multiplication, tu as dû les oublier parce que tu ne t'en servais jamais. Et puis, quand tu as compris que ce n'était pas un jeu, tu t'es dérobée, cela t'a mise de mauvaise humeur. Nous ne pouvions pas te forcer et, à cause des gardes, nous ne pouvions pas t'infliger de punitions. Nous n'arrivions pas à te donner envie d'apprendre des choses dont tu ne voyais pas le sens et, en définitive, nous n'en voyions pas vraiment la nécessité. Huit fois huit, et puis quoi? Qu'est-ce qui va par soixante-quatre ici? Est-ce que t'apprendre quoi que ce fût avait un sens ?
Je savais ce qu'était lire, je n'avais jamais rien vu d'écrit. Tout au plus si j'avais compris l'idée des lettres, de leur assemblage, des mots. Elles avaient parlé des livres, des poètes.
- Si jamais nous sortons, je serai stupide.
- Sortir...
Elle me regardait fixement et je compris que des images passaient en elle, dont je ne pouvais rien me figurer. Certes, j'avais dû voir le soleil, les arbres, les jours et les nuits : je n'en avais aucun souvenir et si je me doutais de ce qui occupait le regard intérieur de Théa, je ne pouvais pas me le représenter.
- Hélas ! dit-elle enfin. Ma pauvre petite, tu ne cours pas ce risque, mais il est vrai que si cela arrivait, tu pourrais nous reprocher d'avoir été de bien mauvaises éducatrices et nous pleurerions de bonheur sous tes reproches.
Je regardai les femmes : elles venaient de recevoir les légumes et s'agitaient comme d'habitude, cherchant une nouvelle manière d'accommoder les choux et les carottes, alors qu'elles n'avaient à leur disposition que de l'eau et du sel.
Elles ne me parurent plus si sottes car je comprenais que, n'ayant rien dans leurs vies, elles prenaient le peu qui arrivait et s'en servaient au maximum, exploitant chaque bribe d'événement pour nourrir leurs esprits affamés.
- Hier, entre le moment où la lumière a augmenté et celui où le jeune garde est arrivé, c'est-à-dire où la relève a eu lieu, mon cœur a produit trois mille deux cent vingt battements, et aujourd'hui cinq mille douze. Combien de temps cela fait-il ?
Je vis qu'elle retenait son souffle.
- Quoi ! Tu as compté ça ?
- Cela peut servir à évaluer le temps.
Le jeune garde marchait lentement le long de la grille, les deux autres le suivaient à quelques pas d'intervalle. Jamais ils ne s'éloignaient les uns des autres, jamais ils n'allaient de front. Tout en parlant à Théa, je ne quittais pas ma proie du regard : jamais ses yeux ne se tournaient vers moi.
- Si tu as compté, c'est bien le moins que j'essaie de calculer, dit-elle. Je n'ai plus fait cela depuis si longtemps ! Mais sais-je à quelle vitesse ton cœur bat ?
- Tu m'as parlé d'un rythme normal.
- Oui, cependant il y a des variations individuelles, et comment puis-je savoir si ton cœur bat au rythme ordinaire ? Je ne peux même pas prendre ton pouls, nous ne pouvons pas nous toucher.
- Moi, je peux le prendre, je l'ai déjà fait. Je te dirai « toc » à chaque battement.
Compare à ton propre cœur, cela nous donnera une base de départ.
Mon rythme était plus lent que le sien.
- Tu es plus jeune. Tu dois être plus proche de la norme que moi, j'avais un rythme un peu rapide. Comment savoir?
- Qu'importe si l'unité n'est pas tout à fait exacte : le tout est d'avoir une unité.
Prends soixante-douze.
- Non. Puisque de toute façon nous ne pouvons pas être sûres, je vais diviser par soixante-dix. C'est plus facile, et même ainsi, je ne suis pas sûre de ne pas m'embrouiller.
Elle se tut, son regard devint fixe et elle se mit à marmonner. Je l'écoutais, sans quitter le garde des yeux.
Pour trois mille deux cent vingt, ça donne quarante-six. Enfin, je crois. Je suis étonnée que tombe juste. Je vais recommencer.
Un des vieux gardes m'examina attentivement pendant deux ou trois secondes.
- Oui. C'est bien quarante-six. J'essaie cinq mille douze.
Les gardes eurent le temps de faire un tour complet avant qu'elle eût fini.
- Soixante et onze ou soixante-douze, il y a des décimales.
- Ça fait soit quarante-six minutes après le lever, soit soixante et onze ou soixante-douze?
- Quarante-six minutes, ou une heure onze ou douze.
Elle était ravie.
- Comme c'est curieux! Quel rapport peut-il y avoir entre quarante-six minutes et une heure douze?
Je ne comprenais pas.
- On travaillait sept à huit heures par jour, Selon les emplois, expliqua-t-elle. On commençait tous les jours à la même heure, ou bien il y avait des horaires tournants pour assurer des permanences : mais on ne voyait jamais une variation de vingt-cinq ou vingt-six minutes d'un jour à l'autre. Est-ce que cela a un sens ?
Elle faisait allusion à une façon de vivre dont je ne connaissais rien et je ne pouvais que l'écouter réfléchir.
- Continue à compter. Compte les temps de demain.
- Demain? Mais est-ce demain au sens d'avant?
Ce premier succès me rendit ambitieuse. Je me dis qu'il y avait d'autres rythmes que les battements du cœur et je devins attentive à mon corps. Je savais que les menstrues se produisent tous les vingt-huit jours et je fus désolée que cet indice-là me manquât, mais j'observai les variations de mon appétit. Parfois, j'avais très faim au réveil et l'attente du repas me semblait longue. Nous nous étions installées dans l'idée qu'ils nous passaient la nourriture à des moments fixes : je vis que c'était faux. Entre les deux repas il s'écoulait parfois trois heures, parfois cinq. Quand j'eus compté une dizaine de fois, il apparut que le jeune garde arrivait à des moments tout à fait variables. Je n'énumérerai pas les chiffres que j'obtins, bien que je m'en souvienne parfaitement, ce sont les dates de naissance de ma pensée, Théa les trouva si étranges qu'elle se demanda si les intervalles n'étaient pas tout à fait aléatoires. Mais il ne restait presque jamais plus de six heures, si j'en croyais mon cœur. Quand il apparaissait, il avait l'air frais et reposé - à force de l'observer, je le connaissais bien - et à la fin de sa garde il donnait de petits signes de fatigue. Son pas gardait, certes, son élasticité, il tenait la tête droite : je ne pouvais définir avec précision ce qui suggérait la lassitude. Avait-il le teint plus pâle ? Un regard moins aigu ? Allait-il un rien plus lentement ?
La relève n'avait jamais lieu qu'à des moments indépendants de nos heures de repas et de sommeil. Cela me parut étrange.
- Là, ils donnent un indice, dis-je à Théa, leur temps n'est pas le même que le nôtre. Nous vivons, en somme, ensemble, eux et nous : ne serait-il pas naturel que nous suivions les mêmes rythmes ?
Je vis qu'elle ne comprenait pas.
Quand un des gardes n'apparaît pas pendant sept ou huit heures, on peut supposer qu'il va dormir. Mais ces moments-là ne sont jamais en concordance avec nos temps de sommeil. Il faudrait que je veille, pour faire, mentalement, le tableau de leurs absences.
Théa réfléchit, puis fronça les sourcils et hocha tète :
- Que peuvent signifier deux temps décalés?
- Tu as connu le monde réel. Moi, je ne peux rien tirer de cela.
Elle me dit qu'elle n'arrivait à rien, qu'elle ne avait pas relier ces choses entre elles et qu'il .était temps de mettre les autres femmes dans la confidence.
- Je n'arrive plus à penser. Il y a trop de données compliquées, je ne peux pas les rassembler. Il faut répartir ce que nous avons établi, avoir leurs points de vue.
Ce qui ne me plaisait évidemment pas, mais je me rendais compte que Théa était débordée et je lui donnai mon accord. Elle procéda par petits Conciliabules discrets : elle prenait une ou deux femmes à part, les avertissait qu'elle allait leur dire des choses extrêmement étonnantes et leur demandait de se composer une attitude qui n'alertât pas les gardes. L'idée d'être étonnée dans la vie que nous menions provoquait déjà de l'agitation et Théa devint vite experte dans l'art de calmer. Au cours des premières années elles avaient appris A se contrôler, puis, dans l'uniformité insensée des jours, elles n'avaient plus rien eu à contrôler. L'annonce d'une nouveauté affolait. Au début, la nouveauté ellemême choquait moins que son existence, elles disaient : - Ce n'est pas possible !
Et puis elles vacillaient. Théa inventa des techniques. Elle commençait par dire
: - Reste calme. Continue à faire ce que tu faisais - éplucher un légume, consolider une couture, tresser ses cheveux, il y avait si peu de chose à faire -
sans changer ton rythme, et pour cela prends conscience de ce rythme, de l'ampleur de ton geste. La femme qui entendait ce discours était forcément intriguée, mais modérément. Comme nous vivions sous surveillance, l'idée de se dissimuler derrière le fait de ne pas changer d'attitude était vite comprise et elles suivaient sans difficulté les injonctions de Théa. Le bruit se répandit qu'il se passait une chose extraordinaire et qu'il fallait surtout ne rien marquer. Il me semble que s'il y eut un petit frémissement d'excitation, il fut assez discret pour passer inaperçu des gardes. Les femmes avaient été bavardes à propos de tout quand il n'y avait rien à dire, on ne voyait pas la différence. Elles recensèrent ce qu'elles savaient sur le monde d'avant et se rendirent compte qu'elles avaient beaucoup oublié. La plupart avaient été des personnes peu instruites, qui vivaient tranquilles dans leur maison, avec les enfants, les courses, le ménage, je pense qu'elles n'avaient pas grand- chose à oublier. Elles se mirent à réfléchir
: elles avaient l'esprit rouillé, ce fut difficile.
Elles ne trouvèrent rien.
Moi, je poursuivais mon dénombrement. Peu à peu, j'en vins à pouvoir compter sans y penser, en bavardant, en mangeant, et bientôt en dormant. Je m'éveillais avec un chiffre en tête : au début, cela me sembla invraisemblable. Je fus méfiante, puis convaincue. Théa me dit que j'avais développé une aptitude qui n'était peut-être pas si extraordinaire que cela, simplement personne, avant moi, n'en avait eu besoin.
J'avais compté mes battements un par un : je me trouvai bientôt devant des nombres extravagants qui résistaient au calcul mental. À soixante-douze battements par minute, une heure faisait quatre mille deux cents, à la fin de la journée je dépassais les cinquante mille, ce n'était plus manipulable. Je changeai donc de technique : je comptais soixante-douze, je mettais un en réserve dans mon esprit, puis je reprenais et passais à deux, mais je craignis de m'embrouiller dans ces deux échelles différentes. Une femme vint alors me servir de boulier compteur : je lui disais un, elle le retenait, puis je disais deux. Elle me devint vite inutile, je ne me trompais pas, je vis que je maintenais correctement mon décompte. Peu à peu, je n'eus même pas à égrener les chiffres, quelque chose s'organisa dans mon esprit qui m'avertissait tous les soixante-dix battements. Je devins une horloge vivante.
Nos jours duraient de quinze à dix-huit heures, avec des alternances anarchiques. À partir du moment où la lumière baissait, que nous nommions début de la nuit, il s'écoulait plus ou moins six heures avant le réveil. Il fut donc établi que nous vivions selon un horaire artificiel. Il nous fallait des hypothèses.
Emma donna la plus folle :
- Nous ne sommes pas sur Terre. Nous sommes sur une planète qui tourne en seize heures et demie.
De quelle façon y aurions-nous été transportées ?
- Comment sommes-nous arrivées dans la cave ? Demandai-je.
Personne n'en savait rien, ce qui me stupéfia. J'avais attribué ma propre absence de souvenirs au fait que j'étais trop jeune, à cet état de choc dont Théa m'avait parlé, mais les autres n'en savaient pas plus que moi. Il semblait que la vie se déroulait comme à l'ordinaire et que, tout à coup, au milieu d'une nuit qui avait commencé comme toutes les autres, il y avait eu des cris, des flammes, la bousculade, des choses dont moi, qui avais toujours vécu dans le calme de la cave, n'avais aucune idée.
- Il y avait des drogues étranges, qui troublaient la mémoire, produisaient de faux souvenirs, dit Emma.
Théa n'était pas sûre que cela fût vrai. Il avait couru toutes sortes de bruits, que rien ne confirmait, des histoires de lavage de cerveau, de manipulations génétiques, de robots si parfaits qu'on les prenait pour des êtres humains.
- Le fait est qu'aucune de nous ne semble avoir de souvenirs cohérents qui permettent de reconstituer ce qui s'est passé. Nous ne savons même pas s'il y a eu une guerre, dit Dorothée. J'ai des images confuses, je vois des flammes, des gens qui courent dans tous les sens et il me semble que je suis ligotée, que j'ai peur. Cela dure très longtemps, j'ai toujours peur mais il n'y a même plus d'images.
- Moi, dit Annabelle, je n'en ai même pas autant à dire. Il y a ma vie ordinaire, les choses de tous les jours, et puis une sorte de panique à quoi j'ai toujours craint de repenser. Après, c'est ici, je suis couchée sur un matelas et je n'en suis pas étonnée.
- Les guerres ne se passent pas comme ça. Il y a des bombardements, des sirènes d'alerte.
- Il n'y avait pas de guerre. En tout cas, pas chez nous. Bien sûr, c'était une époque troublée, mais les gens instruits disaient que, depuis longtemps, on ne connaissait plus le calme.
- Nous avons été envahis par les Chinois. Ou par les Noirs.
- Ou les Martiens !
Elles étaient toujours aussi promptes à rire et je commençais à comprendre que ce n'était pas de la sottise ou de la futilité, mais un moyen de survivre.
- Mais pourquoi nous auraient-ils emmenées sur une autre planète ? À quoi pouvons-nous leur servir ?
- À rien, évidemment, dit une autre. Nous sommes toujours sur Terre. Il y a quinze ou vingt ans - non, moins, il suffit de regarder la petite -quand nous avons été enfermées, il y avait un but, on nous mettait en réserve pour quelque chose. Et puis un dossier a été perdu, les employés se sont arrangés pour que ça ne se sache pas, on continue à nous surveiller et à nous tenir en vie sans que personne en soit responsable. Nous sommes le produit d'une erreur administrative.
- Mais seize heures ! Cela n'explique pas seize heures !
- Et il est incompréhensible qu'on ne puisse trouver aucune régularité dans l'horaire des gardes. Mes souvenirs d'avant sont flous, mais je suis sûre qu'on travaillait selon des rythmes qui se répétaient. Il fallait même pointer.
- Une fois, une seule fois depuis que je compte, le jeune garde est resté près de onze heures d'affilée, debout, tournant autour de la cage. À la fin, il avait les traits tirés, il était pâle, mais il ne protestait pas. Je n'ai jamais vu qu'il ait l'air impatient, dis-je.
Nos conversations allaient ainsi, de redite en redite. Les tentatives de se rappeler les premières années de l'enfermement restèrent à peu près vaines. Il semblait que les femmes eussent lentement émergé d'un brouillard intérieur pour me retrouver habituées à la vie étrange qu'elles menaient. Rien n'évoquait une rébellion. Elles avaient eu des maris, des amants, des enfants : elles se rendirent compte qu'à force d'avoir peur d'y penser, à cause de la douleur, elles avaient presque tout oublié. Mes questions ravivaient les plaies. Cependant, elles ne tentèrent pas de me faire taire, car elles étaient effrayées d'avoir perdu leur propre histoire. Théa se convainquit peu à peu qu'elles avaient été
droguées.
- Regarde-nous, regarde comment nous vivons. Nous sommes démunies de tout ce qui avait fait de nous des êtres humains, mais nous nous sommes organisées, je suppose que c'est pour survivre, ou parce que, quand on est humain, on ne peut pas s'en empêcher. Nous avons recréé des règles avec ce qui nous restait, inventé un protocole. La plus vieille verse la soupe dans les gamelles, je régis les travaux de couture quand il y en a, Annabelle réconcilie celles qui se sont disputées, et nous ne savons pas de quelle façon cela s'est mis en place. Nous avons dû vivre en somnambules pendant une longue période et quand nous nous sommes réveillées, nous étions adaptées.
- Et le moment où Alice a voulu se tuer et où Clotilde l'en a empêchée ?
- C'est un souvenir plus net dans la confusion. Personne ne sait de quand cela date.
Je comptais depuis quatre mois. Nous avions décidé de ne plus nous soucier des alternances anarchiques qui nous étaient imposées, mon cœur nous servirait d'horloge. Un soir, au moment où les lumières baissaient, nous avions décidé
qu'il était onze heures, et qu'à partir de cet instant, je compterais les jours sur vingt-quatre heures, comme avant. Parfois, nous étions en train de déjeuner, mangeant sans plaisir les légumes bouillis, une femme me demandait l'heure et je répondais :
- Deux heures du matin.
Cela restaurait la révolte dans les esprits embrumés. Nous avions une heure à
nous, qui n'avait rien à voir avec le temps de ceux qui nous tenaient enfermées, nous retrouvions notre qualité d'êtres humains. Nous n'étions plus complices des gardiens. À l'intérieur de la grille, mon cœur puissant et régulier de fille furieuse nous avait restitué un domaine propre, nous avions fondé une zone de liberté. Il naquit de nouvelles plaisanteries. Quand la grille s'ouvrait pour la deuxième fois et que nous recevions quelques kilos de pâtes, s'il était huit heures du matin à mon cœur, il y en avait toujours une qui disait:
- Ah ! voilà le petit déjeuner !
Ou bien, à minuit :
- Le spectacle est fini, nous allons souper en ville.
Et nous avions des fous rires. Je riais aussi, je m'en souviens maintenant, car j'avais cessé de considérer les femmes comme des ennemies puis qu'elles recevaient de moi ce que je pouvais leur donner : l'heure. Je n'avais pas oublié
le jeune garde et, quand il était de service, je continuais à l’observer, assise près de la grille, espérant qu'un jour il se trahisse et donne un signe qu'il m'avait remarquée, mais cela ne se produisit pas. Je me demande encore si c'est par discipline ou s'il n'a vraiment jamais été frappé par le fait qu'une des femmes, toujours la même, ne le quittait pas un instant des yeux. Je ne me racontais plus d'histoires.
J'avais fait naître ce qu'il pouvait y avoir de neuf dans notre vie immobile.
Pendant que mon regard suivait le jeune garde on ne venait pas me parler, pour marquer la distinction et attirer l'attention sur moi. Cela me laissait beaucoup de temps pour la réflexion. Je me mis à craindre que l'habitude ne nous éteignît de nouveau. Il me semblait que certaines discussions ne soulevaient déjà plus un intérêt très vif, plusieurs des femmes bâillaient quand nous recommencions à
chercher un sens au décalage des temps. Elles grognaient que nous nous échinions inutilement, que nous ne trouverions rien, que tout était arbitraire.
Moi, je me disais que si l'excitation retombait j'allais de nouveau les détester et me sentir seule, alors que je m'étais amusée. Elles feraient de nouveau des plaisanteries qui m'excluraient et la colère me reprendrait. Mais Théa pensait que je me trompais et qu'elles étaient vraiment réveillées.
- C'est même dangereux, ajouta-t-elle. Je crains que les gardes s'en rendent compte et qu'ils nous droguent de nouveau. Nous retomberions dans l'inertie, nous serions à demi mortes et nous ne le saurions même pas, je ne peux rien imaginer de plus humiliant.
Inévitablement, le chagrin revint avec la mémoire. Assises face à face, elles osaient affronter leurs rares souvenirs, elles tentaient d'exhumer le passé dans de longues conversations qui allaient à tâtons à travers les obstacles, elles luttaient contre l'amnésie qui était peut-être un soulagement, et contre la peur.
Elles s'écoutaient attentivement les unes les autres, et quand une idée venait, elles coupaient la parole à celle qui parlait, se hâtaient de la dire avant de l'oublier. Elles gardaient pourtant une certaine raideur pour se protéger des larmes qui auraient alerté les gardiens. Je ne fus pas exclue, j'avais gagné ma place parmi elles, quoique je ne pusse qu'écouter.
Mais cela ne dura pas très longtemps, car l'événement se produisit.
Il est nécessaire que je le relate avec précision, ce qui me semble difficile à
cause du choc et de la stupeur. Il eut lieu au moment où les gardiens ouvraient la petite partie de la grille par où ils nous passaient la nourriture. Les gamelles et les casseroles restaient toujours à l'intérieur de la cage, nous les empilions à
côté des éviers, mais nous devions rendre les couverts, que nous glissions entre les barreaux après les repas. Les victuailles arrivaient sur les plateaux de grands chariots, il fallait les prendre avec les mains pour les déposer dans les récipients, ce qui était désagréable et difficile. Au fond de la salle, de l'autre côté de la grille, une grande porte métallique s'entrouvrait, et tout de suite la curiosité se déclenchait. Qu'aurions-nous aujourd'hui ? Que pourrions-nous en faire ? Deux des gardiens allaient vers la porte et tiraient à eux le chariot pendant que le troisième continuait à nous surveiller, le fouet prêt. Nous devions d'abord prendre la louche pour la soupe, les quarante cuillères et les mauvais couteaux qui serviraient à éplucher les légumes. Ce jour-là, il y avait des carottes et de la viande de bœuf coupée en gros cubes, les femmes se mirent aussitôt à discuter si elles feraient cuire toutes les carottes ou en garderaient une partie pour les croquer crues. Il y avait aussi des pommes de terre, ce qui enchanta tout le monde, nous en recevions rarement. Elles disaient que c'était étrange car les pommes de terre étaient, dans le monde d'avant, un aliment très peu coûteux et si riche en diverses choses que, d'après Théa, on pouvait garder une bonne santé en ne mangeant rien d'autre. Mais la quantité de nourriture nous parut très petite, même pour le médiocre appétit de femmes qui ne bougeaient pas et n'avaient à peu près rien à faire, de sorte que le contentement ne dura pas. Un des gardes introduisit une clef dans la serrure de la petite grille.
À ce moment exact, un bruit d'une violence terrible retentit.
Moi, je n'avais jamais rien entendu de semblable, mais les femmes se figèrent aussitôt car elles avaient reconnu la sirène d'alerte. C'était une clameur énorme qui montait interminablement en arrachant les oreilles. Je fus saisie de stupeur et je crois que, pour la première fois depuis que je l'avais acquis, je perdis le décompte du temps. Les femmes qui étaient assises se levèrent d'un bond, celles qui étaient à la grille pour prendre la nourriture reculèrent. Le gardien lâcha son trousseau en le laissant dans la serrure et se retourna vers les autres. Ils se regardèrent un instant puis, d'un même mouvement, prirent leur élan et coururent vers la grande porte, poussèrent les battants devant eux en les ouvrant tout à fait, ce qui n'avait jamais eu lieu, et sortirent.
Ils sortirent. Pour la première fois depuis l'enfermement, il n'y eut plus que les femmes dans la cave.
Pour moi, le premier choc passa vite. Je m'élançai, glissai le bras entre les barreaux, achevai de tourner la clef et la retirai avec tout le trousseau. Je poussai et la petite grille s'ouvrit. Je reculai, les mains crispées car j'y serrais la chose la plus précieuse du monde. Mon horloge intérieure avait repris son mouvement et je peux dire que nous restâmes ainsi plus d'une minute, immobiles devant la porte ouverte, encore incapables de réagir. L'émotion m'avait coupé le souffle et je haletais. Je me repris. Je m'accrochai aux barreaux, sautai et passai de l'autre côté pour ouvrir la grosse serrure. Il y avait plusieurs clefs dans le trousseau, je dus en essayer deux avant de tenir la bonne et comme je n'en avais jamais manipulé je fus maladroite, mais j'ouvris la grande grille. Les femmes pétrifiées d'étonnement me regardaient faire, elles avaient l'air de ne pas comprendre ce qui se passait.
- Venez, leur criai-je, sortez, venez !
Puis je courus vers l'autre porte. Je n'avais aucune idée de ce que j'y trouverais.
Il n'y avait que cinq ou six pas, qui me suffirent pour me demander si je ne tomberais pas sur les gardes, si je ne me précipitais pas vers le danger, mais je me dis que, s'il le fallait, elles viendraient à la rescousse et que quarante femmes en fureur tiendraient bien tête à quelques gardes, même armés. Je passai les battants ouverts, me trouvai dans un large couloir où il n'y avait personne. De chaque côté, plusieurs portes donnaient sur des salles dont je ne savais encore rien.
La première femme à me rejoindre fut Théa, et juste après elle Dorothée, celle qui m'avait interrogée. Elles avaient la même expression d'incrédulité. Elles parlaient, mais dans le hurlement continu de la sirène, je ne les comprenais pas.
Je me rendis compte que je parlais aussi, je disais qu'ils n'étaient plus là, qu'ils étaient partis, qu'ils s'étaient enfuis, je ne sais plus quoi, je répétais sans cesse la même chose, comme une vérité incroyable qu'il fallait dire et redire pour s'en convaincre. Nous persévérâmes quelques secondes dans cette conversation de sourdes, puis la sirène s'arrêta brusquement, comme étouffée par sa propre clameur.
- Ils sont partis, dis-je.
Dorothée hocha la tête. Théa répéta :
- Ils sont partis.
Nous étions si déconcertées que nous restâmes figées, les bras ballants. Les autres femmes apparurent, l'une après l'autre, timidement, puis, à mesure qu'elles se rassuraient les unes les autres, elles se bousculèrent, et ce fut la cohue dans ce couloir trop étroit pour nous contenir toutes. Je reculai, entrai dans une des salles, regardai autour de moi. Il y avait une grande table, quelques chaises, des armoires. Bien entendu, à cet instant-là, je ne savais pas encore le nom de toutes ces choses, je voyais des objets que je ne comprenais pas, entre lesquels je me faufilai rapidement car j'avais aperçu une autre porte au bout de la pièce. Celle-là aussi était ouverte, elle donnait sur l'escalier.
Je dis aujourd'hui escalier, comme si, à ce moment-là, je savais de quoi il s'agissait et ce que je cherchais. En fait, nous n'étions même pas sûres d'être sous terre, les femmes le pensaient parce qu'il n'y avait aucune fenêtre, et je ne m'étais jamais trouvée devant un escalier, mais j'en avais entendu parler et je compris immédiatement ce que je voyais. Je gravis très vite quelques marches puis me retournai pour appeler, inutilement car Théa et Dorothée m'avaient suivie. Elles avaient une démarche plus hésitante que la mienne, plus tard elles me dirent qu'elles craignaient encore de voir surgir les gardes et qu'avant de me suivre elles avaient crié aux femmes qu'il fallait être prêtes à se battre et qu'elles avaient répondu qu'elles se feraient tuer s'il le fallait, mais qu'elles ne retourneraient pas dans la cage. Moi, je ne pensais plus à eux. Je courais vers le haut, je ne réfléchissais pas, je montais dans une espèce de soulèvement de tout l'être, oui !, une ivresse proche de ce délice que je ne pouvais plus me procurer avec les histoires depuis que j'étais sortie de mon isolement et que je parlais avec les femmes, l'élan me portait si puissamment que, je le crois, si en cet instant-là un garde s'était montré, eût-il été deux fois plus grand que moi je l'aurais renversé et j'aurais marché sur lui, j'étais possédée par un bonheur sauvage qui ne tenait compte que de lui-même, je grimpais sans haleter, sans fatigue, moi qui n'avais jamais fait plus de vingt pas en ligne droite, je volais le long des marches comme dans ces rêves que je ne fis que plus tard, mais dont j'avais entendu les femmes parler, où l'on s'envole, on plane comme les oiseaux que j'allais bientôt regarder se laisser porter par les courants, dériver sans effort, danser longtemps dans le crépuscule comme je dansais au long des marches, aérienne, flottant interminablement, ascension soulante vers quelque chose d'inouï, en cet instant-là je ne savais pas quoi, le dehors, le monde qui n'était pas la cage, et je n'avais pas de pensées mais un ravissement profond qui m'emportait, et des images, peut-être, qui me traversaient l'esprit, ou seulement des mots qui gisaient en moi et se levaient pour recevoir les images imminentes, le ciel, la nuit, l'horizon, le soleil, le vent, d'autres encore, innombrables, accumulés depuis des années et qui se hâtaient, me poussaient en avant. Ah !
Cette première fois où j'ai monté l'escalier! Quand je l'évoque, j'ai les larmes aux yeux, je sens mon élan comme un déferlement de gloire, je crois que je consentirais à revivre douze années d'enfermement pour cette ascension prodigieuse, cette certitude admirable qui me rendait si légère que je gravis les cent marches d'un coup, sans reprendre mon souffle, et Je riais.
Je me trouvai tout à coup en haut. J'étais dans ce que nous avons, plus tard, nommé une guérite : trois murs et une porte, ouverte elle aussi, la plaine devant mes yeux. Je bondis, je regardai, c'était le monde.
Il faisait jour. Le ciel était gris, mais ce n'était pas le gris mort des murs, dans la cave : de grandes masses aux tons subtils glissaient doucement dans un vent léger, je reconnus les nuages, qui avaient des couleurs de nacre car le soleil les éclairait par-derrière. Une étrange émotion me serra la gorge, différente de l'exaltation qui m'avait portée le long de l'escalier, plus douce et exquise, j'aurais voulu m'y attarder, mais j'étais trop sollicitée. Il pleuvinait. Le hasard a voulu que nous soyons sorties un jour de pluie, par la suite nous nous aperçûmes qu'ils étaient rares en cette saison. Je m'avançai, je tendis les bras et le visage vers cette eau incroyable, dont j'avais entendu parler mais que je ne me figurais pas. Il y eut quelques gouttes sur mes mains et je les léchai, ravie.
Le vent, si faible qu'il fût, plaqua ma robe vite mouillée sur mes cuisses et cela me parut extraordinaire.
- Mais où sommes-nous ? dit une voix derrière moi.
C'était Dorothée essoufflée que Théa soutenait. Elles regardaient toutes les deux dans tous les sens et je les imitai : on ne voyait que la plaine à peine vallonnée qui s'étendait à perte de vue, d'un bout de l'horizon à l'autre.
- Nous sommes dehors, dis-je en riant, et il n'y a pas le moindre garde. Ils sont tous partis.
- Ceci est loin de toute ville, il n'y a même pas trace de faubourg. J'ai toujours pensé que nous devions être aux abords de quelque grand centre, dit Théa.
Dorothée fronçait les sourcils.
- Je n'ai jamais rien vu de semblable. Cette plaine est immense, rien ne l'interrompt. Nous ne sommes pas dans mon pays, il y avait toujours des montagnes.
Théa semblait si perplexe, si troublée, qu'elle me fit pitié.
- Qu'importe, lui dis-je, l'essentiel est que nous soyons dehors, libres, et qu'il n'y ait pas de gardes.
Les autres femmes commencèrent à arriver, hors d'haleine, un peu vacillantes, et nous nous écartâmes de la guérite pour leur faire de la place. Bientôt, elles furent toutes là, regardant étonnées autour d'elles, cherchant à se situer, répétant, l'une après l'autre, qu'elles n'avaient jamais rien vu de semblable, presque effrayées d'être dans un lieu si étrange. Je ne comprenais pas qu'elles ne se livrassent pas avec plus d'insouciance à la merveille d'être dehors, délivrées de la cage, de voir le ciel, de sentir la pluie et le vent. Elles avaient désiré
quelque chose toute leur vie, mais elles ne reconnaissaient pas, dans ce qui leur était donné, ce qu'elles avaient attendu. Peut-être, quand on a connu un quotidien compréhensible, ne se familiarise-t-on jamais avec l'étrangeté, c'est le genre de chose que moi, qui n'ai connu que l'insensé, je ne peux que supposer.
- J'ai peur, dit Annabelle.
Et elles se rapprochèrent les unes des autres, petit groupe effaré au milieu d'une terre inconnue, es quarante femmes se serrèrent, mal à l'aise, après la cage familière, devant l'immensité immobile d'où ne venait aucun signe.
- Et s'ils revenaient?
Je compris qu'elles cherchaient un sens à la peur qui les prenait. Elles regardèrent de tous les côtés, on ne voyait que la plaine caillouteuse où seule bougeait une herbe maigre faiblement agitée par le vent.
- Il ne faut pas rester ici, il faut partir, se cacher, continua Annabelle.
- Mais où aller ? murmura Francine. Il n'y a rien. Pas une construction, pas un abri, pas une route, juste...
- Elle regarda la petite bâtisse par où nous étions sorties : Juste cette espèce de guérite, au milieu de rien.
- Nous sommes perdues, dit une autre.
Il y eut toute une houle de petites phrases inachevées qui filaient de l'une à
l'autre, en s'entrechoquant et se bousculant. Je me mis brusquement en colère.
- Mais redescendez, alors ! Il y a toujours la cage, en bas, si le dehors vous fait peur !
- Oh ! toi et ton..., dit Annabelle exaspérée.
Elle s'interrompit. Je crois qu'elle pensait à de l'insolence, de la rébellion, mais aussi qu'elle se rendait compte que j'avais raison, que cet effroi ne leur ferait pas de bien. Je m'efforçai, moi aussi, de me dominer car je sentais que la dispute pouvait facilement naître, qui eût donné une direction à l'inquiétude en les dressant toutes contre moi. Théa, qui restait calme, me soutint.
- La petite a raison. Il faut réfléchir et s'organiser. Je ne comprends pas où sont les gardes, ni pourquoi ils ont disparu, et moi aussi cela me fait peur. Il n'y a pas tellement longtemps qu'ils sont sortis de la cave et on ne voit aucune trace d'eux.
- Onze minutes, dis-je, depuis que le bruit a commencé, et peut-être un peu plus car j'ai perdu le compte du temps pendant un moment. Nous avons mis onze minutes à ouvrir la grille, passer et monter.
- Onze minutes ? Avec un hélicoptère ou un petit avion, c'est bien assez pour qu'ils soient hors de vue, je suppose. Mais nous, nous ne pouvons pas disparaître ainsi. Pour arriver là-bas, à l'horizon, il faudrait bien deux ou trois heures de marche. S'ils ont le projet de revenir et de nous rattraper, nous serons reprises en un rien de temps.
- Moi pas, dit Annabelle. Je préfère mourir, je ne redescendrai pas. Ils pourraient me droguer autant qu'ils voudraient, je me sens capable de changer la drogue la mieux dosée en un poison mortel.
- Moi aussi, dit Germaine. J'arrêterais de respirer. Ce doit être une question de volonté, je suis sûre qu'on peut empêcher son cœur de battre.
Ces paroles les raffermirent, elles se mirent à dire moi aussi, moi aussi. La révolte s'éveillait, on voyait que, cette fois-ci, elles ne seraient pas prises au dépourvu, comme cela avait dû se passer jadis, qu'elles ne subiraient pas les événements en créatures terrifiées qu'on peut mener à n'importe quel abattoir car elles ne conçoivent pas l'abattoir. Elles se redressèrent. Elles regardèrent le pays étrange où nous étions, elles se carrèrent plus fermement sur le sol, il y eut des sourires.
- Il pleut, dit Francine.
Et elle fit comme j'avais fait, elle tendit les mains pour y recueillir des gouttes et les porta à ses lèvres. Puis elle toucha ses cheveux, ses joues :
- Je suis toute trempée. Je ne savais plus comment c'était. Il y a si longtemps...
- Plus de douze ans, dit Germaine. Il suffit de voir comme la petite a grandi.
Elles se tournèrent vers moi, leur horloge, me regardèrent longuement sans rien dire, puis elles se dispersèrent un peu. Elles se penchaient, touchaient le sol.
Plusieurs écartèrent les cailloux pour atteindre une terre grise et sèche car la pluie ne l'avait pas imprégnée. Annabelle humecta son doigt de salive et le leva pour prendre le vent.
- Les nuages sont légers. Ce doit être le milieu de la journée, on voit que le soleil est haut. S'il tourne dans le sens habituel, le vent souffle de l'ouest.
- C'est normal, puisqu'il pleut. C'est toujours par vent d'ouest qu'il pleut.
- Dans ton pays, peut-être, mais nous ne sommes pas dans ton pays.
- Oh non ! Il y aurait des collines et des forêts ! Cela les fit rire. Elles avaient besoin de détente.
- C'est curieux, on ne voit pas d'oiseaux. Est-ce que les oiseaux s'abritent quand il pleut? demanda Germaine qui n'avait jamais vécu qu'en ville.
- Mais où s'abriteraient-ils ? On ne voit pas un seul arbre. Il n'y a que quelques buissons.
- Et des cailloux, dit Dorothée. On ne pourrait rien faire pousser ici. Je n'ai jamais vu une terre aussi pauvre.
- D'ailleurs, nous n'avons rien à faire pousser.
Cette petite phrase resta un instant en l'air, comme si les esprits s'en emparaient, la tâtaient, puis la mettaient de côté pour plus tard. Mais elle laissa un sillage :
- Il faut préparer à manger, dit Germaine. C'était l'heure du repas, et j'ai faim.
C'est drôle, en bas, je ne sentais jamais la faim.
La nourriture était dans la cave, sur le chariot. Un frisson secoua les femmes à
l'idée que, si nous voulions manger, il fallait redescendre.
- Et la cuisson? Je ne vois pas comment nous pourrions cuire !
- Qu'importe, il faut manger, même si la viande est crue.
- Je n'irai pas en bas. Je préfère mourir de faim, dit Annabelle.
De nouveau, elles se rassemblèrent, épaule contre épaule, cherchant, je suppose, dans le contact à se rassurer. Il fallait que quelqu'un y aille et, naturellement, ce fut moi. Sans doute était-ce parce que je ne me souvenais pas d'un autre monde que celui de la cave, j'étais celle qui avait le moins peur. Quand elles se serraient les unes contre les autres, je ne les suivais pas et je restais donc à
l'écart, ce qui me désignait aux regards. Je compris et leur souris :
- Bien sûr, dis-je. J'irai.
Je n'attendis pas et me dirigeai tout de suite vers la guérite. Elles me suivirent à
quelques pas, comme pour me soutenir dans ce qui leur aurait fait si peur, et j'en fus contente car je sentais une répulsion devant l'escalier. Et s'ils revenaient?
Sauraient-elles se battre ? Une seconde la pensée me vint d'un horrible massacre, je me vis ne remontant que pour trouver un monceau de cadavres et les gardes ricanants qui m'attendaient l'arme à la main. Je me roidis car je ne voulais pas être lâche et entrepris la descente. Depuis, je suis redescendue des centaines de fois, voilà une des rares choses que je n'ai pas comptées, et cela n'a jamais cessé d'être déplaisant, comme si je pénétrais dans un piège qui pouvait toujours se refermer. Quand je fus seule, je pris l'habitude de fixer la porte de la guérite avec quelques pierres : c'était absurde, les serrures étaient rouillées et les pênes ne bougeaient plus, il n'y avait jamais de vent assez fort pour mouvoir le lourd battant de fer, mais je me sentais plus à l'aise.
Je dévalai les cent marches aussi rapidement que je pus, en étant très attentive à
mes mouvements car je n'avais pas encore descendu d'escalier et je craignais de tomber, puis je parcourus le corridor pour me trouver devant la difficulté de transporter les grandes casseroles, les carottes et les viandes, ainsi que l'eau. Je me rendis compte qu'il faudrait plusieurs voyages et que cela risquait de dépasser mes forces. Une demi-heure plus tôt, j'étais montée sans éprouver la moindre fatigue tant l'excitation était forte, maintenant le me sentais tout essoufflée, la tête me tournait et mes jambes tremblaient. Je me dis qu'il fallait, en tout cas, commencer un premier voyage et j'empilai les morceaux de viande dans une casserole. J'étais à mi-chemin quand je croisai Théa qui descendait.
- Je me suis dit que tu n'en viendrais pas à bout toute seule.
- C'est vrai, il y en a trop. Et puis, nous n'avions pensé qu'aux casseroles et aux légumes, mais il faut aussi de l'eau, pour boire et pour cuire, et les gamelles.
- De plus, il faudra faire du feu. En haut, elles rassemblent quelques pierres et des branchages, mais comment allumer?
Nous décidâmes que nous monterions ce que j'avais déjà rassemblé et qu'ensuite nous explorerions les salles.
Plus tard, nous avons beaucoup réfléchi sur ce que nous y avons trouvé, mais là
comme ailleurs nous n'arrivâmes jamais à rien de cohérent. Il n'y avait pas de chambre pour les gardes, ni de lit, ce qui étonna beaucoup Théa : ils ne dormaient donc pas ici ? Ils partaient tous les soirs et revenaient tous les matins
? Où allaient-ils ?
- Ils ont disparu en onze minutes, murmura Théa, et nous n'avons vu aucune trace d'eux. Je me demande si un hélicoptère ordinaire peut aller si vite.
Les tiroirs contenaient diverses sortes d'outils : marteaux, clous, tournevis, toutes choses dont j'eus à apprendre l'emploi, ainsi que des couteaux et des haches qui allaient nous devenir bien utiles. Quatre grands sacs à dos enchantèrent Théa qui m'expliqua leur usage, puis je lui montrai un tas de petites boîtes : c'étaient des allumettes qui réglaient bien opportunément la question du feu. Mais, surtout, nous découvrîmes de grandes réserves de vivres.
Ce furent d'abord des empilements de conserves qui arrachèrent des cris de joie à Théa, elle lisait les étiquettes et elle énumérait les noms des plats avec un enthousiasme qui me faisait rire : choucroute, cassoulet, pâté et légumes auxquels je n'avais jamais goûté. Puis nous ouvrîmes la porte d'une chambre froide remplie de viandes et de volailles congelées, ainsi que de sacs de carottes, de poireaux, de céleris et de navets. Nous n'aurions aucun problème de survie.
- Je suis incapable d'évaluer sérieusement tout cela, mais, même à quarante, il me semble qu'il doit y en avoir pour des années.
Elle nommait tout ce qu'elle voyait et j'eus bientôt l'esprit surchauffé par toutes ces nouvelles connaissances. Je crois qu'elle aurait encore exploré pendant des heures, mais je lui dis qu'il fallait rejoindre les autres, qui nous attendaient.
Nous remontâmes avec de la viande, des conserves, une grande quantité de pommes de terre et des allumettes. Les femmes mirent le feu aux branchages rassemblés entre de grosses pierres :
- Dorothée était sûre que vous trouveriez des allumettes, dit Germaine. Les hommes en ont toujours.
Nous redescendîmes prendre de l'eau. Cette fois-ci, deux des femmes les plus vigoureuses nous accompagnaient.
La pluie avait cessé et les nuages se dissipèrent pendant que la nourriture cuisait
: le soleil apparut, haut dans le ciel, ce qui signifiait, dirent-elles, que nous étions au milieu de la journée. Nous prîmes ce premier repas assises par petits groupes qui s'étaient disposés en rond autour du feu, alors que, dans la cave, chacune prenait sa gamelle et allait n'importe où. Il y avait beaucoup de nourriture et pour la première fois il en resta dans les casseroles, ce qui provoqua des plaisanteries :
- Nous allons grossir, dirent-elles.
- Un régime soutenu si vaillamment pendant tant d'années, et nous en perdrions les bénéfices !
On ne m'expliqua que bien plus tard pourquoi elles trouvaient cela tellement amusant. Etrangement, ces femmes qui riaient si souvent n'avaient pas plaisanté
depuis que nous étions sorties. Moi, j'étais toujours grave, cela ne me changeait pas. Je suppose qu'elles avaient été débordées par les chocs successifs.
- Quelle heure est-il ? me demanda Germaine.
Et je fus toute surprise de m'entendre dire qu'il était dix heures du soir. Il avait passé un peu plus de trois heures depuis que la sirène avait retenti, et, à ce moment-là, nous n'étions pas levées depuis longtemps. Il était donc bien vrai qu'on ne nous avait pas fait suivre le rythme ordinaire des jours et des nuits.
- Il faudra remettre ton horloge à l'heure, dit Théa en riant.
- Comment saurai-je où commencer?
- Nous observerons le coucher du soleil, ce soir : tu prendras cela comme temps zéro et tu nous diras combien de temps se sera écoulé jusqu'au coucher de demain. D'un coucher à l'autre, c'est un jour entier, n'est-ce pas ?
- Je ne sais pas, dit Dorothée. Est-ce que cela ne dépend pas des saisons ?
Elles se lancèrent dans une discussion confuse à quoi je ne compris rien. Les jours allongeaient en été, raccourcissaient en hiver, mais d'un coucher à l'autre cela faisait toujours, ou ne faisait pas forcément, vingt-quatre heures. Aucune d'elles n'avait de notion très claire à ce sujet, même Théa qui était pourtant la plus instruite. Je cessai bientôt de les écouter. De toute façon, à un moment donné, la nuit allait tomber : où la passerions-nous ?
Bien entendu, il n'était pas question d'aller dormir dans la cave et l'idée de rester aux abords de la guérite déplaisait. J'avais suivi du regard la progression du soleil, il me semblait qu'il restait plusieurs heures avant la nuit. Je suggérai d'aller prendre des couvertures et des vivres, puis de nous éloigner. Mais dans quelle direction ? Et si les gardes revenaient ? Comment imaginer d'où ils arriveraient, alors qu'il n'y avait pas de route visible ? D'ailleurs, comment étaient-ils partis ? Théa dit qu'il n'y avait pas de lits dans les salles. Les questions se remirent à fuser, mais Dorothée sentit le désordre et ramena les femmes à la préoccupation qui lui semblait essentielle : il fallait, si nous décidions de nous éloigner, choisir une direction, quel serait notre misère ?
Théa désigna le sud : on voyait, par là, un léger repli de terrain qui pourrait nous cacher.
Il y eut longtemps de l'inquiétude à propos du retour des gardes, mais ils ne revinrent jamais. La peur fut lente à quitter les femmes, et je ne comprenais pas bien pourquoi elles ne se rassuraient pas plus vite. Ils étaient partis d'un instant à l'autre, sans laisser aucune trace, comme volatilisés : apparus de nulle part, ils y étaient retournés et j'en étais moins étonnée que les autres, qui avaient vécu dans un monde où les choses avaient du sens. Moi, je n'avais connu que l'insensé, je pense que cela m'avait rendue profondément différente d'elles, comme je m'en rendis lentement compte. Nous étions libres.
En vérité, nous n'avions fait que changer de prison.
Théa et moi fîmes plusieurs allers et retours pour remonter les choses nécessaires. Les femmes nous attendaient aux abords de la guérite, nous déchargeaient de nos fardeaux et nous redescendions tout de suite. La troisième fois, elles nous retinrent, l'air excité et content.
- Venez voir ! Venez voir ! Nous avons fait quelque chose !
A quelques pas de l'endroit où nous nous étions assises pour manger, il y avait plusieurs buissons, peu denses mais assez hauts. Elles en avaient arraché le centre en s'y égratignant les mains et elles avaient jeté des couvertures sur les bords. Nous avions remonté deux pelles, dont elles s'étaient servies pour creuser un trou. Je ne comprenais pas.
- Ce sont les toilettes, dirent-elles, radieuses.
- Nous sommes de nouveau des êtres humains, déclara Dorothée. Nous pouvons faire nos besoins à l'écart, isolées, à l'abri des regards.
Moi qui étais habituée aux cabinets de la cave, je ne compris pas tout de suite l'émerveillement de Théa. Elle avait les larmes aux yeux. Elle s'approcha de l'espèce de construction, s'arrêta, sourit et demanda :
- Il y a quelqu'un ?
Elles rirent toutes.
- Non. C'est libre. Tu peux y aller.
Par ici, dit l'une des femmes en soulevant une couverture pour montrer l'entrée.
Théa avança, rabaissa la couverture derrière elle et s'isola un moment. Quand elle reparut, elle me dit que c'était mon tour.
Les plaintes sur l'obligation d'excréter en publia m'avaient abondamment informée, je finis pal mesurer l'importance de l'événement et je sentis qu'on m'invitait à participer à la vie d'avant, dans ce monde dont elles parlaient entre elles et dont, à présent, je savais qu'elles n'avaient pas le projet de m'exclure, même si je pressentais déjà que je ne pourrais jamais y entrer. J'allai donc vers le petit espace délimité par les couvertures. Elles me regardaient en retenant leur souffle, je voyais bien qu'elles me faisaient un présent de grande valeur, mon absence d'enthousiasme me gênait. J'écartai le gros tissu raide, passai, le laissai retomber derrière moi et fus aussitôt assaillie par une curieuse impression d'étrangeté. Le cœur me battait, j'avais un léger vertige. Je parcourus mes alentours du regard : je n'apercevais que les branchages couverts d'épines et les replis des couvertures brunâtres qui faisaient écran entre les autres et moi. Je frissonnai. Mais je compris vite : c'était la première fois que je me trouvais seule, qu'aucune femme ne me voyait et que je n'en voyais aucune. Cela me troublait profondément. Je restai debout, les bras ballants, à contempler ma situation. Je découvrais la solitude physique qui est si banale pour l'humanité
ordinaire et que je n'avais encore jamais connue. J'y pris goût tout de suite.
Heureusement.
J'usai du trou, mais je me sentais mal à l'aise car il fallait me tenir debout, les pieds écartés, le corps à demi ployé, dans une attitude inhabituelle qui me parut très inconfortable. Je fus contente de ne pas être vue en pareille posture, alors que je n'avais jamais été gênée de déféquer devant tout le monde en étant tranquillement assise sur la lunette des cabinets. Après, je pris la pelle pour couvrir mes déjections, comme on me l'avait prescrit, mais je fus dérangée par le manque d'eau quand je voulus me nettoyer. J'espérai ne pas m'être salie et m'en allai telle que j'étais. Par la suite, Théa m'enseigna comment me servir de quelques feuilles.
Germaine et Francine vainquirent leur répugnance à descendre et nous accompagnèrent plusieurs fois pendant que les femmes préparaient les ballots.
Chacune avait noué les quatre coins de sa couverture pour en faire une sorte de sac qui contînt des boîtes de conserve, de la viande et diverses choses que nous jugions utile d'emporter. Nous nous mîmes en route. Les trois grandes casseroles remplies d'eau étaient tenues chacune par deux femmes et nous avions décidé qu'elles seraient très souvent relayées pour ne pas risquer que la fatigue les fît trébucher et tout renverser. Il nous avait fallu plus d'une heure pour être prêtes.
Quand nous partîmes, le soleil semblait aux trois quarts de sa course, nous espérions avoir le temps d'atteindre l'autre côté du faible vallonnement avant la nuit.
Théa, les deux femmes qui nous avaient secondées et moi-même étions très fatiguées. Nous avions parcouru plus de dix fois les escaliers après des années où nous ne faisions pas dix mètres en ligne droite, et encore, à pas mesurés car les gardiens ne toléraient pas de nous voir courir. Les autres s'en rendirent compte et prirent une partie de notre charge. Quand Dorothée s'aperçut que je chancelais, elle demanda qu'on porte mon paquet. Après, cela ne m'arriva plus, je devins très vite la plus vigoureuse, sans doute parce que j'étais la plus jeune.
Je fus, de toute façon, celle qui s'adapta le mieux, c'est sans doute parce que je n'avais rien connu d'autre et que nul regret ne me taraudait.
Notre avance fut bientôt ralentie : nous n'étions chaussées que de sandales ouvertes et nous marchions sur des cailloux qui entraient par les interstices et faisaient mal. Nous boitillions, certaines essayèrent d'aller nu-pieds, mais virent qu'elles risquaient les écorchures. Ce fut Laurette qui eut l'idée de déchirer quelques bandes de tissu au bas de sa robe et de les enrouler autour de ses pieds.
Nous eûmes vite fait de l'imiter.
Au sommet de la colline nous nous arrêtâmes pour regarder en arrière. Rien ne bougeait dans ce grand paysage aride. Nous repartîmes en nous retournant souvent et dès que la guérite eut disparu nous pensâmes à faire halte, mais Germaine qui avait la vue particulièrement perçante dit qu'elle croyait qu'il y avait de l'eau, en bas, qu'il lui semblait voir des reflets jouer entre les buissons.
J'avais marché le nez au sol, veillant constamment à ne pas me blesser malgré
les espèces de chaussettes, je levai le regard, mais, même si je pus ensuite me rendre compte que ma vue était excellente, je n'avais aucune idée de ce à quoi pouvait bien ressembler un cours d'eau entre des arbustes. La perspective d'une rivière rendit des forces à tout le monde et nous décidâmes de poursuivre.
Germaine ne s'était pas trompée, une demi-heure plus tard nous déposions nos ballots, nous ôtions nos robes et nous courions vers une eau fraîche et peu profonde.
Ce premier bain me plut tellement que je crus ne jamais vouloir en sortir. Je restais étendue dans le lit du ruisseau, mes cheveux flottaient, je m'y serais bien endormie si, après un moment, je n'avais senti le froid.
Nous avions l'impression que nous étions trop fatiguées pour avoir faim, mais, une fois rafraîchies et reposées, nous fîmes quand même du feu. Le bois brûlait vite, bientôt il y eut de la braise et les femmes confectionnèrent une sorte de treillis avec du fil de fer pour y déposer la viande et la faire griller. Pour la première fois, je goûtais à quelque chose qui n'avait pas bouilli. Cela me parut délicieux, il me semblait que je ne pourrais jamais arrêter de manger. En vérité, je crois que je me suis endormie la bouche pleine !
Je m'éveillai au milieu de la nuit. Je fus saisie d'étonnement : il faisait noir ! Les yeux bien écarquillés, je distinguais à peine mes mains. Le ciel était une masse sombre, un peu effrayante, comme si elle pouvait s'effondrer, je mis tout un temps à comprendre qu'il faisait de nouveau très nuageux. Je me sentais oppressée et tentai de me rassurer en évoquant ce que les femmes m'avaient parfois dit sur les étoiles, qui sont si lointaines, les constellations et les galaxies.
Mais alors une autre inquiétude me vint, le sentiment d'un vide infini, le vertige et la crainte de tomber parmi cette étrange obscurité, tournoyant éternellement dans rien. Je me roulai en boule comme pour me protéger, et me rendis compte que j'étais couchée tout près d'une autre femme, que je la touchais. Cela me fit sursauter, j'eus le réflexe de m'écarter à cause du fouet, puis me souvins qu'il n'y avait plus de gardes. Néanmoins, le contact d'un autre corps ne m'était pas agréable et je reculai doucement. Je n'ai jamais retrouvé l'élan qui, une nuit, m'avait jetée contre Francine. On avait disposé une couverture sur moi, cela me sembla étrange et émouvant.
Je restai immobile parmi les femmes, mes compagnes de toujours qui dormaient autour de moi. Un vent léger faisait frémir les feuillages et j'écoutais ce bruit nouveau. J'avais changé de monde, tout était inconnu, depuis le matin j'apprenais sans cesse. Une vague de bonheur me traversa : quoi qu'il advînt, j'avais quitté la cave et, comme les autres, je savais que je mourrais plutôt que d'y retourner. Déjà, je ne comprenais plus comment j'avais pu supporter d'y vivre. Je me dis que, si elles n'en étaient pas toutes mortes, c'est que la douleur ne tue pas.
Je vis le jour se lever. Le ciel s'éclaircissait devant moi, les nuages se dissipèrent, la lumière vint, d'abord grise, puis de plus en plus dorée à mesure que le soleil montait. J'entendis chanter quelques oiseaux, et j'en vis qui volaient très haut. Peu à peu, les femmes s'éveillèrent, elles eurent l'air surpris, comme si la nuit leur avait fait oublier qu'elles étaient sorties, puis elles rirent et se hélèrent les unes les autres. Nous allâmes nous laver dans la rivière et, en flânant, nous trouvâmes, un peu plus loin, un endroit où elle était assez profonde pour qu'on y pût nager. Théa me tint sur l'eau, elle voulait m'enseigner la brasse, mais j'étais effrayée, je n'arrivais pas à suivre ses indications, je m'écorchais les genoux sur les cailloux. Néanmoins, je parvins à faire la planche et trouvai délicieux de me laisser dériver dans le faible courant. Puis nous mangeâmes le contenu de quelques boîtes de conserve. Les femmes firent du feu et s'arrangèrent pour accumuler beaucoup de cendre chaude, où elles mirent les pommes de terre à cuire. Nous passâmes le plus gros de cette première journée ainsi, à nous nourrir par gourmandise, retournant souvent nous baigner, lézardant dans un soleil sans violence. Cependant la crainte des gardes n'avait pas quitté les esprits et nous décidâmes que deux ou trois d'entre nous se tiendraient constamment en haut de la pente, pour surveiller la guérite. Quand ce fut mon tour, je dis qu'il n'était pas nécessaire de m'accompagner, je sentais qu'il me serait agréable d'être seule.
Le soir, les questions se remirent à rôder : où étions-nous ? Qu'allions-nous faire ?
Était-ce la Terre ?