
LA NEUVIÈME DÉCIMALE
Un milliardième de gramme … Comment déceler une parcelle de matière infime au point d’être invisible même au microscope le plus puissant ? Et pourtant, la chimie moderne utilise couramment des quantités de cet ordre.
Les chimistes savent non seulement peser un milliardième de gramme, mais aussi établir les propriétés de substances obtenues en traces aussi infimes. L’apparition des corps extra-purs a véritablement bouleversé de nombreux domaines scientifiques et techniques. Transistors, alliages aux propriétés étonnantes, énergie nucléaire — tout cela est directement lié à la nouvelle et passionnante branche de la science dont le lecteur trouvera dans ce livre un exposé clair et à la portée de tous.
L’auteur de « La neuvième décimale » Youri Fialkov qui est candidat ès sciences chimiques et chargé de cours à l’Institut Polytechnique de Kiev a consacré de nombreuses années à Tanalyse physico-chimique et à la radiochimie et publié plus de 70 articles traitant de ces domaines de la recherche. Depuis huit ans il s’est en outre donné pour tâche de vulgariser la science soviétique.
« Récits de chimie » et « La neuvième décimale » sont ses deux premiers ouvrages de vulgarisation scientifique. La présente traduction de « La neuvième décimale » est celle de la seconde édition russe.
Y. Fialкоv
La neuvième décimale
A la mémoire de mon frère
Il est des pics qu’on chercherait en vain sur les cartes. Leur conquête ne s’en poursuit pas moins de jour en jour, d’heure en heure. La lutte est opiniâtre, pleine de péripéties dramatiques et d’imprévu. Ces pics, ce sont ceux de la science.
Sans doute ceux qui entreprennent ces ascensions n’entendent-ils pas mugir les vents violents, ne sont-ils pas menacés par les avalanches, et cependant l’histoire des conquêtes de ces « pics de la science » est jalonnée d’exploits qui ne le cèdent en rien à l’ascension de l’Everest.
L’auteur se propose de relater la conquête de l’une des cimes de la chimie moderne, celle des quantités de matière infiniment petites. L’ascension en a été ardue et périlleuse. Les chimistes ont dû gravir les gradins escarpés des décimales, après les avoir taillés dans le dur granit de l’inconnu.
Un milliardième de gramme… Une parcelle de matière tellement infime que le plus puissant des microscopes ne saurait la déceler, peut-elle présenter une utilité quelconque ? Eh bien ! il apparaît que la chimie moderne fait un usage courant de quantités aussi réduites de diverses matières. Les savants ont appris non seulement à peser un milliardième de gramme mais encore à déterminer les propriétés de matières obtenues en quantités aussi insignifiantes. Les chercheurs ont eu à surmonter le handicap de théories périmées, tandis que le sommet à atteindre — la solution de l’énigme — se perdait dans d’épais nuages de contradictions.
Ce livre traite de phénomènes et d’événements les plus divers car l’histoire de la chasse aux parcelles de matière infinitésimales concerne quantité de problèmes et de branches scientifiques. C’est en effet aux « chasseurs » de l’infiniment petit et de l’invisible que sont dus les progrès réalisés dans des domaines de la chimie aussi éloignés l’un de l’autre que la synthèse des éléments artificiels, l’étude des matières extra-pures, la fabrication de semi-conducteurs, l’obtention et l’utilisation des métaux rares et ultra-rares, en un mot tout ce dont il sera question dans ce livre.
LES PREMIERS GRADINS
Victimes de la précision
Nous laissons au lecteur le soin de juger si cette histoire est tragique ou comique. Personnellement, j’incline à penser que cela importe peu, l’essentiel étant qu’elle soit authentique. Le lieu de l’action se situe en Allemagne, la date vers les années 1920.
Si quelqu’un était tenté de reconstituer cette histoire dans tous ses détails, l’auteur le prévient qu’il est inutile de compter sur les données de la presse. Les journaux réactionnaires allemands de l’époque, fidèles à leurs traditions, se gardèrent bien de parler de l’essentiel, tout en amplifiant démesurément les menus détails.
Tout débuta par un compte rendu consacré aux recherches effectuées sous la direction du professeur Litte, compte rendu que ce dernier lut à ses collègues d’institut un soir de juillet 1924. Le séminaire scientifique de l’institut se réunissait régulièrement une fois par quinzaine depuis déjà trente ans ; les honorables professeurs savaient bien que pendant toute cette période, il n’avait jamais été fait la moindre communication susceptible de troubler un tant soit peu la douce somnolence qui régnait habituellement dans la salle. D’ailleurs il faisait chaud, excessivement chaud. Ainsi que le président le fit observer, avec un humour plutôt douteux, à l’issue de la lecture du compte rendu, un verre d’eau gazeuse avec de la glace aurait été bien plus facile à avaler que la communication, sans nul doute intéressante, du Herr Professor. En la qualifiant d’« intéressante », le président se faisait manifestement violence, car durant toute la lecture il avait sommeillé à l’abri d’un journal. Quant au reste des membres, leur attention n’avait guère été plus vive.
Certes, bon nombre d’entre eux s’en repentirent cruellement par la suite, parce que ce soir-là, le professeur Litte leur donna la primeur de sa découverte de la transmutation du mercure en or.
Pendant un certain nombre d’années, Litte s’était servi d’une lampe de quartz à mercure. Or, ne voilà-t-il pas qu’un jour, il y avait de cela plusieurs mois, il s’était aperçu que le mercure de sa lampe contenait une quantité d’or relativement appréciable. Le mercure étant le voisin immédiat de l’or dans la classification périodique. Litte en avait déduit qu’il se trouvait en présence d’un cas de transmutation d’un métal vil en métal précieux sous l’effet des rayons électriques.
On ne saurait dire de quelle façon la presse eut vent de la communication du professeur Litte, mais le fait est que trois jours plus tard, la Patriotische Rundschau annonçait en manchette énorme : « Tout bon Allemand peut avoir son million ! » et, plus bas, en lettres à peine moins grandes : « Le secret de l’obtention de l’or est connu ! ».
Au cours des deux mois qui suivirent, le professeur Litte put se convaincre à ses dépens que l’expression « fardeau de la gloire » n’était pas une simple métaphore.
A vrai dire, les correspondants de presse et les reporters-photographes se conduisirent d’une façon relativement convenable. Ils se contentèrent de monter patiemment la garde à l’entrée de la villa du professeur, interrogeant tous ceux qui en sortaient. Mais les représentants des firmes industrielles grandes ou petites, eux, furent absolument odieux. Ils faisaient insolemment irruption dans le cabinet de travail du professeur, l’assaillaient de coups de téléphone en pleine nuit, pénétraient inopinément dans la salle à manger à l’heure du petit déjeuner, mettant sa patience à rude épreuve et lui coupant l’appétit. D’un ton qui se voulait persuasif ils promettaient monts et merveilles au professeur s’il consentait à céder le secret de la fabrication de l’or à leur firme et pas à une autre. Ils en profitaient d’ailleurs pour couvrir leurs concurrents présumés d’invectives souvent fort grossières.
L’enthousiasme des industriels fut porté à son comble par l’annonce que le chimiste japonais Nagoaka, ayant vérifié la communication de Litte, venait de confirmer sans réserve les conclusions du savant allemand. Nagoaka ajoutait que le Japon allait se livrer à des recherches sur la fabrication à l’échelle industrielle de l’or à partir du mercure.
Les bruits contradictoires et la tapageuse campagne de presse commençaient déjà à rendre la Bourse nerveuse. En un mot, l’affaire menaçait d’aller loin et le professeur Litte jugea alors utile de publier dans les colonnes d’une revue scientifique un exposé détaillé de l’essentiel de la question ainsi que ses propres hypothèses.
Les journalistes se jetèrent sur cet article avec avidité. Pour la première fois sans doute dans l’histoire de la science, un article paru dans une très sérieuse revue scientifique fut intégralement reproduit dans des journaux, symboles chimiques, lettres grecques et intégrales compris. L’auteur y déclarait catégoriquement qu’il serait prématuré de tirer la moindre conclusion, que l’or obtenu à partir du mercure n’excédait pas des quantités infimes, que les frais d’électricité nécessaires à cette transmutation dépassaient largement le prix de l’or obtenu, mais que néanmoins, à l’avenir… il serait possible… quand le phénomène aurait été étudié plus à fond… l’histoire de la science connaissait de nombreux exemples…
Le premier représentant des cercles d’affaires qui produisit sur Litte une impression favorable fut le directeur de la firme « Siemens ».
Monsieur Schkrubber déclara au Herr Professor qu’il n’était pas naïf au point de ne pas comprendre toute l’inanité, sur le plan industriel, du phénomène de transmutation du mercure en or qui venait d’être découvert. Mais ce n’était pas là ce qui l’intéressait en tant que directeur d’une grande firme. Son unique souci était de voir la science allemande s’enorgueillir d’une nouvelle réalisation de valeur. Lui-même se rappelait parfaitement, quoiqu’il ne fût pas bien vieux, les moqueries qui avaient accueilli la découverte du grand Rœntgen.
Etre comparé à Rœntgen flatta tellement l’amour-propre du professeur qu’il signa sur-le-champ le contrat que lui proposait Schkrubber, sans même prendre la peine de vérifier le nombre de zéros que contenait le chiffre de la somme allouée par la firme pour la poursuite des travaux. Le montant en était vraiment énorme. Que pouvait peser en comparaison de cette somme l’insignifiant alinéa qui stipulait que toutes découvertes faites par le professeur devenaient dorénavant propriété exclusive de la firme « Siemens » ?
Deux semaines plus tard, Litte était installé dans un cabinet parfaitement équipé et trouvait à peine le temps d’écouter et d’étudier les communications de ses multiples collaborateurs. En moins d’un mois, un procédé exceptionnellement sensible était mis au point permettant de déterminer la teneur en or du mercure, même si elle ne dépassait pas un cent-millième en pourcentage.
Le jour où l’on dressa le bilan des résultats des diverses expériences, le professeur Litte quitta son laboratoire à une heure fort tardive. Le lendemain il se pencha de nouveau sur le tableau des résultats en proie à la plus profonde perplexité. Il y avait de quoi s’étonner. Ces résultats refusaient obstinément de s’inscrire dans le cadre de lois quelconques. Dans un cas, le mercure « traité » dans une lampe pendant à peine quelques heures s’avérait bien plus riche en or que le mercure pris dans de vieilles lampes. Parfois, il suffisait de faire passer le courant dans une lampe pendant seulement trois minutes pour quintupler la teneur en or alors que dans d’autres cas, le passage du courant pendant deux semaines n’était suivi d’aucun changement de la teneur en or.
Mais il y avait aussi des succès. Le plus chanceux des assistants du professeur était Rudolf Krantz, garçon de haute taille et d’aspect gauche. Les spécimens qu’il analysait contenaient invariablement de quatre à cinq fois plus d’or que ceux des autres chercheurs. Ceci se reproduisait avec une telle régularité que le professeur fut même enclin à soupçonner son assistant de fraude. Aussi passa-t-il toute une journée à la table de travail de Krantz, l’observant avec attention et l’aidant même dans les opérations les plus simples.
Litte n’avait pas perdu son temps ! Ce jour-là, le spécimen de Krantz se trouva contenir exactement onze fois plus d’or que l’échantillon témoin obtenu lors des premières expériences du professeur.
Par la suite, le professeur Litte s’efforça plus d’une fois de se rappeler lequel de ses assistants lui avait suggéré l’idée de vérifier la présence éventuelle d’or dans le mercure d’origine, c’est-à-dire celui qui n’avait pas encore séjourné dans une lampe. Le professeur ne se souvient absolument pas qui cela pouvait bien être. Ce dont il est certain cependant, c’est qu’à cette suggestion il avait répondu d’un ton irrité que lui, le professeur Litte, n’avait pas fait l’acquisition de son mercure dans une charcuterie. Il l’avait obtenu de la firme « Kalbaum ». Quant au mercure fourni par une firme d’une réputation aussi irréprochable, il ne pouvait être question de mettre sa pureté en doute.
Par la suite, Litte se remémora cet accès d’humeur avec un profond malaise, car moins de deux heures plus tard, le mercure de la firme « Kalbaum » (« Les meilleurs produits du monde », « Pureté, 100% », « Garantie totale ») s’avérait contenir tout autant d’or que les spécimens des expériences moyennes. Mais, évidemment, la firme « Kalbaum » n’y était pour rien car ses chimistes ne disposaient pas de procédés de détection de l’or aussi précis que ceux du laboratoire Litte. Et quand bien même ils en eussent disposé, cela ne les aurait que fort peu avancés. En effet, ainsi qu’il fut démontré par la suite, il est presque impossible de séparer le mercure des infimes quantités d’or qu’il contient invariablement.
Peut-être le professeur serait-il allé sur-le-champ voir monsieur Schkrubber pour lui déclarer que toutes ses hypothèses scientifiques étaient fausses, qu’il avait été induit en erreur par le fait que le mercure d’origine contenait déjà de l’or. Et c’est bien là en effet ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si, vers la fin de cette journée néfaste et mémorable, n’était apparu Krantz. Le regardant de ses grands yeux bleus à travers ses lunettes, l’assistant du professeur venait lui soumettre le résultat de sa dernière analyse de la teneur en or du mercure de la lampe. Celle-ci contenait 25 (vingt-cinq) fois plus d’or que le mercure d’origine.
Litte donna l’accolade à Rudolf tout éberlué et déclara d’un ton ferme qu’il fallait continuer les expériences. Nul ne sait combien de temps aurait pu encore se prolonger cette affaire. Toujours est-il que trois jours plus tard, Krantz se présentait à nouveau, mais cette fois en proie au plus grand trouble : pour la première fois depuis le début des expériences, il n’était parvenu à aucun résultat. Les derniers spécimens ne contenaient pas la moindre parcelle d’or de plus que le mercure d’origine. Ce fut alors que Litte s’aperçut que pour lire ses résultats d’expérience, Krantz était obligé de se pencher de très près sur son registre.
— Vous devenez bien distrait, Krantz, observa Litte irrité, aujourd’hui vous avez même oublié vos lunettes. Mais peut-être êtes-vous totalement absorbé par la science ?
— P-p-pas tout à fait, répondit l’honnête Rudolf, seulement hier je suis allé à une petite soirée et je… je suis revenu à la maison sans lunettes.
— Sans lunettes… sans lunettes…, répétait machinalement Litte, le nez dans le registre de laboratoire, sans lunettes… sans lunettes… Sans lunettes !!! rugit-il soudain, elles étaient en or, Krantz ? Elles étaient en or ?
— Mais non, répondit le scrupuleux assistant complètement affolé, seule la monture était en or.
— Mein Gott, mein lieber Gott, gémit le professeur, vous êtes un idiot, et moi aussi : pas seulement un idiot, un triple idiot, voilà ce que je suis, Krantz ! C’est de votre monture que provenait l’or du mercure. L’or se dissout plus aisément dans le mercure que le sucre dans l’eau.
О mein Gott ! Qu’est-ce que je vais pouvoir dire à Herr Schkrubber !
Vaut-il la peine d’achever l’histoire ? Vaut-il la peine de décrire la houleuse séance du comité de direction de la firme « Siemens » à laquelle assistaient, en qualité d’experts, les plus grands chimistes d’Allemagne ? En tout cas il est tout à fait inutile de parler des manœuvres auxquelles dut recourir le président du comité de direction Schkrubber pour convaincre les membres dudit comité de passer les dépenses engagées au compte « profits et pertes ». Et ces dépenses étaient élevées, terriblement élevées !
Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c’est tout autre chose, à savoir les méthodes d’analyse qui permirent d’établir que tout mercure, quelle que soit son origine, contient une quantité d’or parfaitement décelable.
Or, cette quantité était exceptionnellement réduite en l’occurrence. Jugez plutôt : de combien peut-être la teneur en or du mercure s’il suffit de traces du métal précieux provenant d’une monture de lunettes ou de boutons de manchettes pour multiplier cette teneur par dix et même davantage ?
Pour en venir au fait, précisons que la teneur en or du mercure ne dépasse pas un gramme par 100 kilos. Ce qui n’a pas empêché les chimistes de déceler des traces d’or aussi infimes dans un tel « océan » de mercure. Il est bien évident que si Litte n’avait pas disposé d’un procédé de détection aussi perfectionné, il y aurait eu une histoire sensationnelle de moins et une réputation intacte de plus.
Faut-il en conclure que les analyses des chimistes pèchent par excès de précision ? Certes, non. Si Litte avait seulement pensé à vérifier la présence éventuelle d’or dans son mercure d’origine, tout serait resté dans la normale. Mais à l’époque, c’était impensable.
Une telle précision dans l’expérience est assez récente. 150 ans à peine avant cet incident les chimistes étaient incapables de déceler des impuretés même 100 fois, voire 1 000 fois supérieures.
La balance cree la chimie
Il y a à Léningrad, dans un des bâtiments dont les hautes et étroites fenêtres donnent sur la Néva, une grande salle circulaire dans laquelle règne un solennel silence de musée. Dans une niche on aperçoit un télescope dans le genre de ceux qui figurent sur le fond des portraits de savants des siècles passés. Un globe terrestre noirci par le temps, sur lequel se distinguent des continents aux contours insolites, jette des reflets ternes. Au plafond pend un appareil bizarre dont on ne saurait dire s’il s’agit d’un cerf-volant ou d’un instrument destiné à capter de l’électricité atmosphérique. Au centre de la salle se trouve une petite table sur laquelle est posée une balance sous une cloche de verre. Une balance tout à fait ordinaire. On peut en voir de bien plus intéressantes dans n’importe quel laboratoire d’école. Pourquoi donc fait-elle l’objet de tant de vénération ? Pourquoi lui fait-on un tel « honneur », honneur qu’on refuse à beaucoup de balances de laboratoire moderne, seuls les instruments de haute précision ayant droit à la protection d’une cloche de verre !
Eh bien ! il n’y a pas lieu de s’étonner. Tous ces instruments sont sacrés pour l’histoire de la science russe. Ils ont servi à Mikhaïl Lomonossov.
L’inscription qui conviendrait le mieux à cette balance serait : « Cet instrument a marqué le début de la chimie moderne. » Ayant découvert la loi de la conservation de la matière, qu’il démontra à l’aide de cette même balance, Lomonossov fit de la chimie une science exacte. A partir de ce moment, la balance devint le principal instrument de recherche du chimiste.
Jetons un coup d’œil sur les écrits chimiques datant non pas d’une période reculée du Moyen Age mais presque « de nos jours », tout au plus de 30 à 40 ans avant Lomonossov. On y rencontre constamment des descriptions dans le genre de celle-ci : « On a pris une quantité de bicarbonate de sodium (nous traduisons certains termes de l’époque en langage de chimie moderne) tenant dans le creux de la main et on y a ajouté de l’acide sulfurique à discrétion. Le mélange a bouilli pendant un certain temps et le poids du résidu ainsi obtenu dépassait de beaucoup celui du bicarbonate de sodium. » Allez donc comprendre ce que voulait dire l’auteur ! La grandeur d’une main varie énormément. Un tel ne saurait saisir plus de 50 g de bicarbonate de sodium dans le creux de sa main alors qu’un autre pourrait en amasser cinq fois plus. Et combien faut-il y ajouter d’acide ? A mon avis, un verre d’acide paraîtrait peut-être trop peu, alors que pour quelque lecteur même trois gouttes pourraient passer pour une quantité excessive.
Ayant démontré la loi selon laquelle au cours d’une réaction chimique rien ne se perd et rien ne se crée (« car si en un endroit il y a diminution, il y a addition en un autre »), Lomonossov posa les seuls fondements de la chimie rigoureusement justes et scientifiques.
Désormais, lorsqu’ils mélangeaient deux substances, les savants n’avaient plus besoin de deviner si le résultat de la réaction pèserait plus ou moins que les substances prises à l’origine, ils savaient d’une façon certaine que le poids des substances entrant en réaction devait être exactement égal au poids des produits de cette réaction.
A l’époque — il y a de cela deux siècles — la précision des recherches laissait à désirer. Seuls Lomonossov, Lavoisier et un certain nombre de savants se servaient d’instruments de précision. Quant à la plupart des autres, leurs balances étaient si peu exactes que, de nos jours, plus d’un vendeur refuserait de s’en servir pour peser des pommes de terre.
Mais cet état de choses ne dura pas. Dès le début du siècle dernier, tous les laboratoires de chimie furent dotés de balances extrêmement précises. Il faut en voir la raison dans le développement considérable de l’industrie chimique et, par suite, de l’analyse chimique.
Quelle que soit la tâche dont s’occupe le chimiste dans son laboratoire, qu’il s’agisse de l’obtention d’un nouvel élément, de la répétition d’expériences déjà effectuées, de l’étude de quelque réaction, son travail se termine toujours par une analyse chimique. Seule l’analyse permet de connaître la composition du produit obtenu, de vérifier si l’opération a été correctement menée et si le chercheur a atteint le résultat escompté.
L’analyse est chose délicate. Il n’est pas question de faire de l’à-peu-près. Les réactifs doivent être de la plus rigoureuse pureté, les récipients doivent reluire de propreté, et les calculs doivent être corrects. Quant à la balance, il va sans dire qu’elle doit être aussi précise que possible.
Le développement de la science et de la technique exigeait un perfectionnement assez rapide de l’analyse chimique. Aussi, un siècle après les travaux de Lomonossov, les savants disposaient-ils de balances permettant d’atteindre une précision d’un millième de gramme.
Quelque 40 à 50 ans plus tard, tout laboratoire pratiquant l’analyse chimique possédait une balance d’une sensibilité de deux dix-millièmes de gramme.
Deux dix-millièmes de gramme ? Il s’agit là d’une parcelle si infime qu’un microscope ordinaire ne saurait la déceler. Pourquoi les chimistes ont-ils eu besoin de pesées d’une telle précision ?
La raison en est simple. Pour que les résultats d’analyse soient indiscutables, il est indispensable de déterminer le pourcentage des éléments du composé à un centième de pour cent près, faute de quoi la composition exacte sera impossible à connaître. Si la quantité du composé prise pour l’analyse est de 1 g, il est clair que c’est précisément à des dix-millièmes de gramme que se chiffreront ces centièmes de pour cent nécessaires aux chimistes.
L’emploi de balances aussi sensibles exige une pratique et un soin exceptionnels. Si l’on oublie de refermer les battants du coffret en verre qui recouvre la balance, la pesée est faussée. Que deux ou trois grains de poussière invisibles à l’œil nu se déposent sur l’un des plateaux et l’aiguille indique immédiatement la présence d’une substance étrangère.
Dans ce cas, il faut enlever la poussière avec une peau de chamois en agissant avec une précaution infinie, pour ne pas abîmer le délicat mécanisme !
De nos jours, tout laboratoire de chimie est doté de balances de ce genre. Les étudiants, par exemple, commencent à se familiariser avec leur fonctionnement dès la première séance de travaux pratiques.
Mais les balances permettant des pesées à 0,0001 g près sont maintenant largement dépassées. Il y a quelques dizaines d’années sont apparus des instruments d’une précision d’un cent-millième de gramme. Le fait est que la quantité prise auparavant par les chimistes, c’est-à-dire 1 g, leur parut bientôt trop élevée. Les spécialistes de la chimie organique surtout ne furent pas satisfaits. En effet, il arrive souvent que la synthèse de quelque substance nécessite deux ou trois semaines sinon plus, le produit final ne pesant pas plus de 2 ou 3 g. En utiliser près de la moitié rien que pour l’analyse serait de la prodigalité, d’autant plus que toute récupération est exclue. Les chercheurs répugnaient donc à se séparer de plus d’un dixième de gramme pour l’analyse, d’où la nécessité de décupler la sensibilité de la balance.
C’est ainsi que la cinquième décimale fit son entrée dans la chimie…
Des balances d’une telle précision ne sont pas non plus rares dans les laboratoires de recherche, mais elles diffèrent notablement de leurs « compagnes à quatre décimales ». Tout d’abord, elles sont l’objet d’une attention toute particulière. On leur réserve habituellement une pièce à part, sur un support spécial fixé au mur. La température ambiante doit être maintenue à un niveau constant. Le déplacement de l’aiguille s’observe à l’aide d’un dispositif optique spécial. Que de tracas supplémentaires pour une seule décimale de plus.
Par la suite, les progrès dans le perfectionnement des balances se sont quelque peu ralentis. Non pas que la nécessité ne s’en fit pas sentir. La vie exigeait des savants une précision de plus en plus grande. Mais les divers dispositifs ingénieux mis au point en compliquaient singulièrement le fonctionnement et en augmentaient les dimensions. Il ne pouvait plus être question d’en généraliser l’emploi dans les laboratoires.
Les chimistes n’en sont pas pour autant restés les bras croisés. D’autres méthodes d’analyse sont venues à l’aide des pesées.
Une balance ? Non, mieux…
Vous avez tous dans votre boîte à pharmacie de petits cristaux foncés appelés permanganate. C’est un produit antiseptique dont on se sert, entre autres, comme gargarisme lors de certaines maladies. Le permanganate de potassium est un composé qui se sépare aisément de son oxygène, d’où son efficacité contre divers microbes pathogènes. Mais en l’occurrence, ce sont d’autres propriétés du permanganate de potassium qui nous intéressent.
Prenons un petit cristal de cette substance et jetons-le dans un verre d’eau. Au bout d’un certain temps, l’eau prend une coloration violet foncé. Ce fait est déjà intéressant en lui-même : le cristal est minuscule, mais la coloration est tellement intense que si on place le verre contre une lampe, il ne laisse pas passer la lumière.
Diluons le contenu deux fois, quatre fois et plus… La coloration s’atténuera graduellement mais persistera. Il nous faudra diluer l’eau pendant encore longtemps avant que la coloration finisse par disparaître.
Prenons une solution considérablement diluée mais dont la coloration est encore visible à l’œil nu. Combien une telle solution contient-elle de substance ou, comme disent les chimistes, quelle en est la concentration ? Eh bien ! La teneur en est établie avec une grande précision. Deux décilitres de la solution, c’est-à-dire le contenu d’un verre, ne contiennent qu’un dix-millième de gramme ou, exprimé en pourcentage, 0,0005%.
Il n’est pas difficile d’établir le rapport entre la quantité de substance colorante en solution et la coloration de cette dernière. Il sera ensuite très simple d’en déterminer la concentration : il est évident que plus la coloration de la solution est intense, plus elle contient de substance colorante.
Ce procédé d’analyse a reçu le nom de colorimétrie. Il est facile de comprendre que du point de vue de la sensibilité, les méthodes colorimétriques présentent des avantages indéniables sur les pesées.
Pour déterminer la concentration du permanganate de potassium, pour nous en tenir à cet exemple, il suffit de disposer d’un appareil très simple appelé colorimètre, d’un centilitre de solution et de trois minutes.
Voyons maintenant le nombre d’opérations nécessaires à l’analyse de la solution à l’aide de pesées. La concentration de cette solution est de 0,0005%. Ceci revient à dire qu’un millilitre contient tout juste 5 millionièmes de gramme de substance. L’évaporation complète des mêmes 10 millilitres de solution, qui nous suffiraient largement pour une analyse colorimétrique, ne mènerait strictement à rien, car une balance d’analyse ordinaire est incapable d’indiquer une quantité aussi faible.
Bref, pour déterminer la concentration de la solution, il nous faudrait en évaporer au moins 10 litres, et encore, le résultat ainsi obtenu serait-il cinq fois supérieur au chiffre réel, car 10 litres de solution contiennent au moins cinq fois plus d’impuretés que de permanganate de potassium.
Beaucoup d’entre vous savent ce que c’est que le « bleu de Prusse ». Cette agréable couleur s’obtient en traitant une solution de prussiate jaune par la solution d’un sel ferrique quelconque. Il apparaît que la couleur s’obtient même si la teneur du sel ferrique en solution ne dépasse pas trois centièmes de gramme par litre, ou trois cent-millièmes de gramme par millilitre. Pour une balance d’analyse ordinaire, 0,00003 g, c’est déjà une quantité impondérable. Voilà pourquoi certains ferrocyanures (ou prussiates) sont utilisés pour la détection de sels ferriques. Comme on le voit, ce sont des réactifs extrêmement sensibles.
La sensibilité du prussiate jaune n’est pourtant rien en comparaison avec un autre révélateur du fer, la substance organique phénanthroline, qui permet de déceler la présence de deux dix-millionièmes de gramme de fer par millilitre de solution : 0,0000002 ou 2 • 107 g.
Des réactifs organiques ont été mis au point pour tous les éléments. Chacun d’entre eux permet la détection, à partir de la coloration correspondante, de cent-millièmes à dix-millionièmes de gramme d’élément par millilitre de solution. Il est évident que nulle balance ne saurait rivaliser en sensibilité avec les réactions colorimétriques. Signalons à ce propos que la détermination de la teneur en or du mercure dans les expériences de Litte se faisait à l’aide d’un réactif au nom démesuré et sonore de paratétraméthyldiaminodiphénylméthane, permettant la détection de millionièmes de gramme d’or.
Si l’on tient compte du fait que le mercure ordinaire contient de l’or en quantité dix fois supérieure, on comprend comment Litte et ses collaborateurs n’avaient fait que découvrir ce que le mercure contenait dès le début (en y ajoutant d’ailleurs des quantités supplémentaires en provenance de lunettes, boutons de manchettes, anneaux et autres objets comportant de l’or).
En se servant de réactifs organiques on a appris non seulement à provoquer l’apparition de la coloration qui nous révèle la présence de tel ou tel élément en solution, mais encore à transformer ces éléments en composés insolubles dans l’eau. On peut citer l’exemple du réactif organique diméthylglyoxime dont la découverte est due au chimiste russe L.Tchougaïev au début de notre siècle. Le traitement à la diméthylglyoxime d’une solution contenant une quantité même infime de nickel provoque la formation immédiate d’un précipité. La pesée du précipité permet de déterminer la teneur du métal dans la solution étudiée. La diméthylglyoxime révèle la teneur du nickel en solution même si cette teneur ne dépasse pas un cent-millionième de gramme (10–8) par millilitre.
A partir des années 1930, l’emploi de méthodes d’analyse chimique dites physiques se répandit de plus en plus. Les savants cherchaient avec persévérance des moyens susceptibles de remplacer les organes des sens : des « yeux »
capables de mieux voir que ceux de l’homme, des « mains » plus sensibles que les nôtres, une « ouïe » qui permettrait d’entendre l’inaudible.
Ces méthodes font maintenant couramment partie de l’arsenal des recherches chimiques et rendent des services inappréciables aux savants.
Il convient de citer en premier lieu la spectroscopie qui, bien qu’étant l’une des plus récentes méthodes de recherche, est probablement la plus précieuse. Lorsqu’on se fut aperçu, il y a un siècle, que chaque élément colorait la flamme du bec Bunsen d’une teinte spécifique, cela ne provoqua d’abord aucune surprise particulière. Le milieu du siècle dernier, époque où la spectroscopie vit le jour, fut pour la chimie une période faste. C’étaient les premières années de l’hypothèse moléculaire, pas un seul mois ne s’écoulait sans qu’il y eût quelque découverte majeure dans le domaine de la chimie organique, de nouvelles méthodes d’analyse voyaient le jour.
Dès ses premiers pas, la spectroscopie enregistra un succès. Pour son « baptême du feu » cette méthode inscrivit à son actif la découverte de deux éléments nouveaux : le rubidium et le césium. La découverte d’un élément nouveau a toujours été considérée comme un événement important dans le domaine de la chimie. Aussi la spectroscopie éveilla-t-elle immédiatement l’attention.
La réputation de la méthode ne fit que croître après qu’elle eut permis la découverte en quelque dix ans du tallium, de l’indium, du germanium, du gallium, etc., et pour couronner le tout, de l’hélium.
En 1868, on observa dans les protubérances solaires [1] une ligne jaune et brillante qui ne correspondait à aucun des éléments connus sur la Terre. En conséquence, cet élément reçut le nom d’hélium (en grec, hêlios signifie Soleil). Plusieurs dizaines d’années furent encore nécessaires avant d’aboutir à la découverte de l’hélium sur notre planète, que l’on trouva d’abord en quantités infimes dans divers minéraux, puis dans l’atmosphère même.
Il est intéressant de noter que la spectroscopie a permis la découverte d’éléments dont les minéraux ne renferment que des quantités insignifiantes. Il est facile de s’en convaincre qu’il en est vraiment ainsi. A cet effet nous pouvons très bien nous passer des instruments d’optique compliqués dont on se sert actuellement dans les mesures spectroscopiques. Un réchaud à alcool ou, mieux, un bec Bunsen peuvent nous suffire. L’introduction dans la flamme d’un fil de platine ou d’acier bien trempé (une corde d’instrument de musique, par exemple), ne modifie pas sa couleur. Mais si, avant de l’introduire dans la flamme, on passe d’abord le fil de métal sur la paume de la main, on obtient une nette coloration jaune, caractéristique du sodium. D’où provient ce dernier ? Eh bien ! tout simplement du chlorure de sodium contenu dans la sueur que sécrètent constamment les pores de la peau. Or, si l’on pense à quel point est infime la quantité de chlorure de sodium sur la surface de la paume, on comprend aisément l’extrême sensibilité de la spectroscopie.
Des appareils très simples permettent de déceler des quantités de l’ordre de cent-millionièmes de gramme. La spectroscopie ne manquera donc pas de révéler la présence d’un élément recherché dans une matière première (roche ou minéral) même si sa teneur ne dépasse pas un gramme pour cent tonnes.
La spectroscopie et les réactifs organiques constituaient donc tout l’arsenal des moyens à la disposition des chimistes des années 30 pour l’étude des quantités infimes de matière.
La possession de moyens aussi modestes par rapport à ceux dont nous disposons à l’heure actuelle n’en rend que plus méritoires les remarquables réalisations des chimistes de l’époque. Mais avant de parler de celles-ci, je voudrais relater un procès qui se déroula en 1933 au tribunal des douanes allemandes. Si je mentionne cette histoire, ce n’est nullement par souci de distraire le lecteur à l’aide d’une digression policière, c’est que les événements qui eurent lieu entre les murs austères du tribunal du Reich furent intimement liés à certaines découvertes chimiques dont il est question dans ce livre.
Histoire policière
C’était un grand jour au tribunal des douanes du Reich. Le fait est qu’il ne s’agissait pas d’une banale histoire de contrebandiers coupables d’avoir dissimulé trois paires de bas dans un talon de soulier ou de quelque commerçant ayant négligé de régler à temps ses droits de douane sur un envoi de linge en provenance de Lyon. Au banc des prévenus se trouvaient ensemble huit grands bijoutiers de Berlin. L’affaire concernait du platine américain.
La police avait toujours fermé les yeux sur les opérations de ces messieurs les bijoutiers, bien que nombre d’entre elles eussent difficilement réussi à passer pour légales. Mais lorsque les dénonciations anonymes se mirent à pleuvoir à la direction de la police, force fut d’ouvrir une enquête. Une série de perquisitions révéla alors la présence, dans toutes les bijouteries, de gros stocks de platine. Interrogés séparément, messieurs les joailliers eurent recours à des subterfuges, mais gardèrent bouche cousue à propos de la véritable provenance du platine. Les registres de la douane ne portaient pas mention du passage de telles quantités de ce métal par la frontière. D’où la nécessité de ce procès, en raison duquel les plus grandes bijouteries de Berlin gardaient porte close depuis déjà trois mois.
Parmi le public de la salle, les noms des juges et du procureur volaient de bouche en bouche, mais bien peu se doutaient de l’influence décisive qu’allait exercer sur le cours du procès la déposition d’un expert d’aspect effacé dont le nom n’évoquait absolument rien ni aux juges ni au public attiré en ce lieu par un procès retentissant.
La question principale que le tribunal fut appelé à trancher était celle de la provenance du platine. Messieurs les bijoutiers affirmaient que le métal était d’origine allemande et provenait de la fonte de divers articles de platine. La police maintenait que le métal avait été introduit en fraude en provenance d’Amérique du Sud. Le platine se présentait sous la forme de petits lingots et était presque pur. Le procès semblait dans une impasse.
Le public était fatigué des interminables répliques entre les parties en présence, et lorsque le président annonça qu’il donnait la parole à l’expert, il n’atténua en aucune façon le brouhaha qui régnait dans la salle.
Les journaux du soir, rivalisant d’humour, annoncèrent que la durée de l’intervention du très estimable professeur était fonction de son hermétisme.
Le fait est qu’il n’était pas souvent donné d’entendre des termes de chimie et de physique dans la salle du tribunal du Reich. Voilà pourquoi le président avait les traits si contractés en écoutant le professeur, tentant péniblement de se rappeler les maigres notions de chimie qu’on lui avait inculquées jadis à l’école de droit.
L’expert crut devoir remonter à des faits n’ayant apparemment aucun rapport avec les douteuses opérations de messieurs les bijoutiers.
— La chimie analytique moderne, commença-t-il, dispose de moyens étonnants. Diverses méthodes nous permettent de déceler dans un seul gramme de matière des quantités d’impuretés tellement faibles qu’elles sont inaccessibles à notre imagination. Il est possible d’établir que la substance la plus pure contient invariablement des traces, que l’on peut déterminer exactement, de presque tous les éléments chimiques connus.
Prenons le nickel par exemple. Ce métal ne figure en quantité appréciable que dans les minerais, les quelques rares minéraux de nickel et les alliages. Et pourtant, on peut en détecter la présence dans tous les organismes végétaux et animaux. Le nickel est également présent dans l’étoffe dont sont faits nos vêtements et les boutons dont ils sont garnis.
On peut en dire tout autant d’éléments plus rares, l’or par exemple…
— L’or ? fit le président intéressé. Continuez, monsieur le professeur, continuez…
— L’or, tout comme les autres éléments, est omniprésent bien qu’invisible.
— Monsieur l’expert, interrompit d’un ton sarcastique l’avocat de l’un des bijoutiers, pourrait-il nous dire combien il y a d’or dans ma propre personne, par exemple ?
— Etant donné que la composition du corps de monsieur l’avocat ne diffère pas sensiblement de celle d’un rat, animal dont nous nous sommes servis pour nos expériences, l’or représente trois dix-millionièmes de votre estimable poids, répondit le professeur imperturbable. A ce propos, continua-t-il, il convient de faire observer que les divers éléments sont présents dans la même proportion dans les métaux d’origine commune. Et, inversement, les traces d’impuretés dans le fer provenant d’une certaine mine diffèrent en quantité et bien souvent aussi en qualité des traces de ces mêmes impuretés dans le fer extrait d’une autre mine.
Tout ceci nous a permis d’établir la provenance du platine soumis à l’expertise. Nous avons analysé une série d’objets en platine dont l’origine sud-américaine est certaine. Nous avons également soumis à l’analyse des articles en platine de l’Oural. En comparant les résultats de cette analyse avec ceux obtenus lors de l’étude de spécimens qui m’ont été présentés par le tribunal, j’en déduis que ce platine est sans aucun doute américain. En témoigne la présence d’une forte proportion de cuivre et d’une faible quantité d’arsenic.
La déposition de l’expert fut décisive. L’arrêt ne fut d’ailleurs pas particulièrement sévère. Les prévenus étaient des gens cossus et le jeune Reich préférait garder avec eux d’excellentes relations.
Un mois plus tard les réclames lumineuses brillaient de nouveau au fronton des larges vitrines des bijouteries qui s’ornaient de mannequins aux sourires figés, couverts de bijoux.
La classification périodique dans un… morceau de craie
Voici donc un aspect inattendu du problème des quantités infimes de matière qui, à l’époque, était à l’ordre du jour.
Il ne vaudrait guère la peine de rappeler l’existence d’une poignée de mercantis berlinois si ce n’était que cette histoire met assez bien en relief l’une des découvertes majeures de l’époque dans le domaine de la chimie, la théorie de l’omniprésence des éléments chimiques.
Quelques chiffres pour commencer. Y a-t-il une différence quelconque entre les nombres 100,0 et 100,000 ? Ne vous hâtez pas de dire non ! Réfléchissez à nouveau. Vous persistez à dire non ? Eh bien, du point de vue des mathématiques, vous avez peut-être raison. Mais moi, je suis chimiste et c’est pourquoi je déclare :
« Il y a une différence, et même considérable. »
— Quelle bêtise ! me rétorquera-t-on. Qu’importe en l’occurrence la différence entre un chimiste et un mathématicien ? Cent, c’est cent !
Voyons de plus près. Supposons que vous rouliez en voiture le long d’une route. Voyez-vous cet arbre là-bas ? A partir de celui-ci parcourez un kilomètre, en calculant la distance à l’aide de l’indicateur de vitesse. Halte ! Vous avez fait un kilomètre. Maintenant sortez de voiture et livrez-vous à quelques calculs.
Donc, vous avez parcouru un kilomètre. 1 kilomètre = 1 000 mètres. 1 000 mètres = 100 000 centimètres. Pouvez-vous dire que vous avez fait 100 000 centimètres ? Qui l’affirme se trompe bien. Pourquoi ? Etes-vous sûr que la voiture a parcouru exactement 100 000 centimètres à partir de l’arbre en question ? Ou bien 100 002 ou encore 99 998 centimètres ? C’est une différence assez grande. Vous pouvez tout au plus certifier que la voiture a roulé 1 000 mètres, et encore, vous ne savez pas trop si ce n’est pas plutôt 995 mètres ou 1 008 mètres. Comme on le voit, la quantité de chiffres dans un nombre n’est certainement pas sans importance quand il s’agit d’en révéler la teneur intime.
Si on dit qu’une voiture a parcouru 1 kilomètre, personne n’ira certifier qu’elle a roulé 1 mètre de moins ou 10 mètres de plus. Mais s’il est dit que la voiture a parcouru 1,00 kilomètre, cela signifie qu’on est sûr de ce qu’on avance, que la distance indiquée a été calculée à des centièmes de kilomètre près, autrement dit à des dizaines de mètres près.
On voit maintenant que la quantité 1,000 kilomètre signifie que la distance a été calculée à des dix-millièmes de kilomètre près, autrement dit à des décimètres près. Il apparaît donc que même les zéros peuvent être d’une signification considérable.
Il en est de même en chimie. Il n’est pas équivalent de dire qu’une substance a une pureté de 100% ou de 100,0%. Cette pureté peut s’exprimer également par un nombre qui, dans le premier cas, peut être par exemple 99,6 et, dans le second, 99,96. Comme on le voit, la différence est sensible.
Il fut un temps où les chimistes, eux non plus, n’accordaient pas grande importance à ces nuances, mais cette période « d’insouciance » est révolue depuis longtemps.
Il est une science que l’on nomme géochimie. Son domaine est l’étude de la composition chimique des divers minéraux, roches, eaux de mers et cours d’eau. L’analyse chimique d’un minéral est d’une pratique courante; on détermine la teneur du minéral en divers éléments et la chose est faite. En ajoutant les pourcentages de tous les éléments du minéral, combien doit-on obtenir ? 100%, c’est évident. Et, en effet, les chimistes ont effectué des milliers d’analyses et quand l’analyse est juste, le total se monte toujours à 100%.
Bien peu pourtant se sont préoccupés du « grade », si l’on peut dire, de ces 100%. Peut-on écrire 100,0% ou 100,000% ? En étudiant attentivement cette question, on découvre qu’écrire 100% n’est légitime que dans les cas les plus exceptionnels (mais, comme nous le savons maintenant, ceci peut correspondre à 99,91 ou 99,66, etc.). Dans la grande majorité des cas, il conviendrait d’écrire 99,9%.
Or, ce dixième de pour cent se révèle extrêmement curieux.
Il existe un minéral connu sous le nom de blende. Tous les manuels de chimie indiquent qu’il s’agit de sulfure de zinc (ZnS). En gros, c’est exact. Mais, à l’état pur, le sulfure de zinc doit contenir 67,09% de zinc alors que le minéral, ainsi que l’atteste une analyse rigoureuse, n’en contient que 63,55%. Il doit y avoir 32,91% de soufre, alors que le minéral n’en contient que 31,92%. En additionnant ces pourcentages, nous obtenons 95,47. Comme on le voit, nous sommes encore loin du compte. Le minéral contient donc encore autre chose. Certes, il n’y a là rien d’étonnant : un minéral naturel peut-il être aussi pur qu’un réactif chimique spécialement préparé en laboratoire ?
Et, en effet, une analyse complémentaire révèle dans notre spécimen des quantités assez appréciables de fer (1,57%), de silicium (0,34%), de manganèse (0,27%), d’oxygène (0,15%), de plomb (0,15%), d’arsenic (0,15%) et de cuivre (0,13%). Ce sont là les résultats d’une analyse qu’il n’y a pas tellement longtemps on pouvait qualifier de complète.
Mais l’est-elle bien, en réalité ? Additionnons tous ces résultats. Effectivement l’analyse est presque complète puisque nous obtenons 99,22%. Mais de quoi se composent les 0,78% qui restent ?
Ne continuons pas à fatiguer le lecteur avec de nouveaux chiffres. Disons seulement qu’une analyse assez poussée permettrait d’ajouter encore sept-dixièmes de pour cent. Ces 0,7% comprennent les éléments suivants : hydrogène, calcium, cadmium, aluminium, magnésium, sélénium, chlore, antimoine, carbone, phosphore, sodium, potassium, titane, bismuth.
Ainsi nous avons analysé la blende, qui doit se composer de zinc et de soufre, et nous avons déjà trouvé 23 éléments. Mais ce n’est pas tout. Il reste encore près de 0,1% et ce 0,1% se compose de 23 autres éléments. Inutile de les énumérer ; précisons seulement que parmi eux il y a du germanium, de l’indium, de l’or (dont la blende contient environ 0,0005%).
Mais le plus intéressant, c’est que même en ajoutant les pourcentages de ces 23 autres éléments, nous n’obtiendrons pas exactement 0,08%. Il y aura encore un reste d’environ un millième de pour cent et pour déterminer ce qu’il contient il a fallu avoir recours à toutes les subtiles méthodes d’analyse décrites précédemment qui ont permis d’établir avec une certitude absolue la présence de 30 autres éléments chimiques.
Cela fait 76 éléments en tout, soit le tableau de Mendéléev presque tout entier dans un morceau de blende.
Ce minéral n’est pas une exception. N’allez surtout pas croire que la blende a été choisie comme exemple parce qu’elle serait la seule à posséder cette remarquable particularité. Il n’en est absolument rien. Il a été prouvé expérimentalement que tous les minéraux renferment un nombre d’éléments chimiques tout aussi élevé que la blende.
Des minéraux on est passé à l’étude d’autres corps. On s’est alors aperçu que tout objet soumis à une analyse poussée, que ce soit un morceau de craie ou du lait de vache, un cendrier ou un marteau, un cahier ou une louche, recèle la presque totalité des éléments de la classification périodique. Comme dans le cas de la blende, la proportion des divers éléments varie de dizaines à des dixièmes de pour cent et moins. Pour certains éléments, la teneur qui ne dépasse pas un cent-millième de pour cent ou même moins doit être exprimée à l’aide de chiffres de 5 ou 6 décimales.
Un cent-millièmc de pour cent, ce n’est pas grand-chose. Si une roche donnée s’avérait contenir une proportion aussi infime d’un élément quelconque, il faudrait traiter dix mille kilogrammes pour en extraire 1 gramme de l’élément en question. Voilà pourquoi il serait absurde de vouloir extraire de l’or de la blende, bien que sa présence y soit indiscutable.
Il est clair qu’en l’absence de méthodes d’analyse aussi perfectionnées, nous ne serions pas en mesure de prouver l’omniprésence des éléments chimiques.
Il a certes fallu parvenir à une virtuosité peu commune pour arriver à déceler la présence d’un élément et à en déterminer la quantité alors que sa proportion ne dépasse pas quelques dix-millièmes ou cent-millièmes de pour cent. Cette virtuosité n’a pas été inutile car la faculté de manier les quantités de matière infinitésimales a valu à la science des découvertes telles que même dans des centaines d’années on les qualifiera encore d’étonnantes. Le lecteur le plus pointilleux ne m’accusera pas d’avoir employé ce qualificatif à la légère lorsqu’il aura fait connaissance avec les problèmes traités dans les chapitres qui suivent.
L’ALCHIMIE DU XXE SIÈCLE
Une histoire gasconne
Les véritables alchimistes ne passaient certainement pas leur temps dans de lugubres sous-sols : le plus souvent ils travaillaient en plein air. C’étaient des gens ordinaires et souvent gais. Et même, ils ne portaient pas tous la barbe, et bien peu d’entre eux avaient dans leur laboratoire un objet aussi macabre qu’un crâne humain. Non, les alchimistes ne ressemblaient pas le moins du monde aux portraits qu’en font les peintres contemporains !
Ils n’étaient pas non plus des aigrefins tels que les auteurs de certains livres et récits consacrés à la chimie du Moyen Age se plaisent à les représenter. Jamais l’esprit de lucre n’aurait pu faire progresser la science, d’autant plus au cours des siècles. Que l’alchimie ait été une science est indubitable. Certes, il y eut des alchi-mistes dont le but essentiel était l’obtention de l’or. Il y eut également de vulgaires escrocs abusant de la naïveté de grands personnages. Les vieux livres et revues contiennent des tas d’histoires sur ces filous. Il est intéressant de noter que pas un d’entre eux ne périt de sa mort naturelle. Les uns moururent sur la potence une fois démasqués ; d’autres, dès la première expérience « couronnée de succès », furent exécutés par les rois qui craignaient de voir le possesseur du « secret » s’enfuir chez le duc voisin pour lui proposer ses services ; d’autres encore furent lentement mis à mort, torturés par la Sainte Inquisition.
Quant aux alchimistes qui poursuivaient modestement leurs travaux dans leurs laboratoires privés, on n’en parle que fort peu. S’ils cherchaient la « pierre philosophale » ce n’était pas seulement pour sa capacité de transmuter les métaux vils en or. Cette pierre pour eux était avant tout un remède contre les maladies et un moyen de prolonger la vie. Ces obscurs alchimistes sont justement les auteurs de traités, ridicules à nos yeux mais pleins de sens pour l’époque, dans le genre de « De la vertu et de la composition de l’eau ». Mais oui, la vertu faisait partie, elle aussi, du domaine de l’alchimie !
Tandis que des aigrefins, s’affublant du nom d’alchimistes, recherchaient les meilleurs moyens de tromper les avides et peu intelligents personnages au pouvoir, les vrais alchimistes se penchaient inlassablement sur leurs cornues, dissolvant, distillant, cuisant, agitant des centaines de substances, et faisant ainsi progresser la chimie d’une façon considérable.
Mentionnons tout d’abord que les alchimistes ont presque décuplé par rapport aux anciens Grecs le nombre des composés connus de la science. Les alchimistes ont découvert les moyens les plus importants pour agir sur une substance ou sur un mélange de substances dans le but de provoquer une réaction chimique. Nous nous servons encore de nos jours de moyens presque identiques. Les alchimistes ont inventé des appareils très divers ; un grand nombre d’instruments que l’on voit aujourd’hui sur les tables des laboratoires de chimie nous viennent en droite ligne, presque inchangés, du laboratoire de l’alchimiste ; c’est le cas des matras, entonnoirs, cornues, appareils à distiller. Ce sont justement les alchimistes qui ont découvert les acides les plus importants, de nombreux composés organiques, le procédé de la distillation sèche du bois.
Pour le début de mon récit sur l’alchimie du XXe siècle, j’estime de mon devoir de donner au lecteur une image véridique de l’alchimie authentique, le convaincre que le mot « alchimiste » ne doit pas être pris dans un sens péjoratif. A ce propos, il m’a semblé que l’histoire du moine bénédictin Lorenzo Picca formerait la meilleure illustration de ce que j’avance.
Cette histoire, je l’ai trouvée par hasard en feuilletant un vieux livre publié en allemand en 1809 et contenant divers renseignements sur l’histoire des sciences naturelles. C’est dans ses pages épaisses et toutes craquelées par le temps que j’ai lu l’histoire du moine Lorenzo Picca. Bien sûr, elle y était exposée en termes secs et volontairement dénués de passion, termes considérés à l’époque comme les seuls convenant à un ouvrage scientifique. Mais il ne m’a pas été bien difficile de lire les détails, « entre les lignes », comme on dit. Voici cette histoire.
Le vent soulevait, des dunes du rivage, des jets de sable fin et piquant qui chantaient une chanson déchirante rappelant les gémissements des âmes pécheresses en enfer. Quand cette comparaison fut venue à l’esprit du prieur du monastère bénédictin de Saint-Nazaire, il ne put s’empêcher de sourire, malgré le tragique de la situation. Le monastère se dressait à quelques lieues de l’océan sur la rive droite de la Loire et se détachait nettement sous les rayons du soleil couchant. S’enfonçant dans le sable et respirant avec peine, les frères bénédictins, partis du monastère avec leur prieur, se traînaient péniblement à genoux stimulés par le chant monotone de deux enfants de chœur déjà passablement enroués.
En tête de file venait le frère Lorenzo Picca, lequel était justement la cause de cette procession insolite.
Une adresse privée du pape Clément V, rédigée d’une écriture trop ornée et alambiquée pour n’être qu’une simple note mais plutôt un commandement, enjoignait au monastère de Saint-Nazaire d’entreprendre « la recherche des substances merveilleuses qui transmuent les métaux vils en or, lequel nous est particulièrement nécessaire en cette période pénible où nos frères de religion se sont à ce point détournes de nous que les supérieurs de l’ordre des Templiers, haï de Dieu, bien que possédant le secret de la pierre philosophale, refusent de nous le communiquer ».
En lisant cette note, le prieur n’avait certes pas ri, il avait seulement souri avec déférence, ce qui, à vrai dire, constituait déjà une sédition caractérisée. C’était trop évident : la dépêche avait été écrite sous la dictée de l’un des hommes de Philippe IV qui hantaient alors la résidence papale. Philippe le Bel comme l’appelait avec dérision près de la moitié de la France, avait dépensé toutes ses maigres ressources à lutter contre le pape Boniface VIII, menant ce combat avec l’opiniâtreté et la férocité d’un putois. En revanche, le pape suivant — Clément — n’était en fait qu’une créature du roi.
Le prieur savait que le pape n’avait pas choisi son monastère au hasard. Il y avait déjà vingt ans que le monastère de Saint-Nazaire se distinguait par ses érudits. Le mérite en revenait surtout à Lorenzo Picca qui, en ce moment, soufflant plus que les autres, rampait péniblement sur le sable.
Les mœurs relâchées du monastère de Saint-Nazaire étaient pour ainsi dire consacrées par des traditions vieilles de plusieurs dizaines d’années. Même l’absence à la messe matinale n’y passait pas pour un péché bien grave. Voilà pourquoi Lorenzo Picca, entré au monastère en 1287, pouvait librement s’adonner à l’étude des sciences naturelles, domaine dans lequel il comptait déjà de nombreuses réussites. L’auteur du livre signale que Lorenzo Picca avait même inventé un télescope — ceci, 200 ans avant Galilée ! — dont il se servait pour observer la Lune. On trouve dans ses œuvres la description des merveilleuses propriétés d’une substance connue de nos jours sous le nom d’oxyde de mercure que l’on peut indéfiniment transformer en mercure brillant et inversement. Signalons que les Arabes avaient déjà fait cette découverte bien avant Lorenzo mais il est fort probable que ce dernier l’ignorait.
Ainsi coulait la douce existence de Lorenzo Picca au monastère de Saint-Nazaire, existence que ne troublaient d’aucune façon les frères bénédictins aux mœurs fort sereines et joyeuses. Du moins en fut-il ainsi jusqu’à la réception de la dépêche de Clément. Le délai pour trouver le secret de la préparation de l’or était très limité. Que ce secret existât, le pape n’en doutait pas. Les déclarations triomphales de l’ordre des Templiers qui se vantait de pouvoir se procurer de l’or en quantité, ne faisaient qu’aviver l’impatience de Clément. Sans doute certains cardinaux de l’entourage du pape bien informés avaient-ils plus d’une fois discrètement suggéré à sa Sainteté qu’il fallait chercher l’origine de l’or des Templiers dans le meurtre et le chantage plutôt que dans la possession de la « pierre philosopha-le ». Ce à quoi le pape, qui avait beaucoup lu, répliquait immédiatement en citant les écrits d’Arnold Villanovanus célèbre alors à travers tous les Etats de l’Europe occidentale. Villanovanus affirmait avoir découvert la « pierre philosophale » capable de transmuer le mercure en or.
A ce propos, il est intéressant de mentionner que, selon toute évidence, ledit Villanovanus était un habile filou. Il se disait possesseur non seulement de la « pierre philosophale » mais encore de « l’élixir de longue vie », lequel n’était autre qu’une méchante eau-de-vie de vin. Il était bien vrai que « l’élixir » possédait la faculté d’engendrer chez ceux qui en usaient la plus intense béatitude. Mais l’inventeur n’était pas sans savoir, lui, de quoi il régalait ses naïfs contemporains, puisqu’il préparait son « élixir » à partir de vin tout à fait ordinaire.
Bien entendu, la recherche de la « pierre philosophalc » fut confiée à Lorenzo Picca. Quand ce dernier tenta de se dérober en alléguant, sans grande conviction, que ses pensées étaient pleines de Dieu, le nonce du pape se mit violemment en colère. C’était bien la première fois, fit-il observer, qu’il était témoin d’une telle attitude envers un document aussi sacré qu’une dépêche pontificale. Ce disant, il jeta un regard tellement pénétrant sur le prieur que celui-ci, tendant les bras en direction de la statue de Saint-Nazaire, se hâta d’assurer le dignitaire du Saint-Siège qu’étant donné les facultés de Lorenzo, on pourrait bientôt sortir l’or du monastère à pleines charretées. Sur cette promesse, le nonce repartit non sans avoir donné l’ordre de mettre à la disposition de Lorenzo autant de moines qu’il le désirerait puisque, à sa connaissance, les expériences d’alchimie exigeaient de gros efforts et beaucoup de soin.
Voilà pourquoi dès le lendemain du départ du nonce, Lorenzo Picca procéda à l’initiation des frères bénédictins aux simples procédés de la pratique de l’alchimie. Le monastère connut alors des jours de fièvre. Les grappes de raisin perdaient leurs grains et pourrissaient faute de soins tandis que des étroites fenêtres du réfectoire, transformé en laboratoire, s’échappaient une âcre fumée et des paroles prouvant que la pratique de l’alchimie détournait l’âme et les pensées des bénédictins de la personne de Dieu.
Lorenzo Picca ne doutait pas, quant à lui, que toutes les recettes de « pierre philosophale » décrites dans divers ouvrages, et en particulier dans ceux de Villanovanus lui-même, n’étaient que du charlatanisme. La plupart de ces œuvres n’étaient qu’une suite de mots désordonnée, soit un texte chiffré, soit du pur galimatias.
Un mois et demi environ furent suffisants pour prouver, s’il en était encore besoin, que tous les secrets de la fabrication de l’or étaient une perte de temps. C’est alors que se produisit un événement imprévisible.
En ajoutant à une solution de mercure dans de l’acide azotique étendu d’eau à laquelle on avait apparemment mélangé des composés d’iode une solution d’argent dans de l’acide azotique, Lorenzo obtint un résidu jaune.
L’isolant de la solution, il se mit à le sécher quand, tout à coup, la poudre devint rouge vif. Picca retira vivement le récipient de la flamme et la poudre reprit lentement une couleur jaune. Quand on remit le récipient sur le feu, la poudre se mit à rougir à nouveau ; on éteignit le feu et la couleur redevint jaune.
Si quelque chimiste venait à observer un phénomène de ce genre de nos jours, il n’en serait nullement surpris et comprendrait immédiatement qu’il se trouve en présence d’une simple couleur thermosensible [2]. La substance obtenue par Lorenzo Picca, le sel d’argent d’acide tétraiodomercurique, est en effet une couleur thermosensible. Mais, il y a six cents ans, cette découverte produisit un effet saisissant. Se pressant autour de Lorenzo, les moines observaient la transformation miraculeuse en retenant leur souffle. Le prieur en personne, accouru au réfectoire, au lieu de remercier la Sainte Vierge pour ce miracle par une prière fervente, se tenait bouche bée, manifestant le même étonnement que les autres.
Les moines eurent alors pour la première fois la révélation que l’occupation à laquelle ils se livraient n’était pas un simple moyen d’atténuer le pesant ennui régnant au monastère. Mais ce même soir, Lorenzo confia aux bénédictins que la synthèse artificielle de l’or était impossible et que toute tentative dans ce sens était vouée à l’échec.
Quelques jours plus tard, les moines déclarèrent au nonce du pape revenu au monastère et attendant avec impatience le résultat des expériences, qu’ils renonçaient à chercher le secret de la fabrication de l’or, puisque, de toute façon, cela ne pouvait mener à rien.
On se représente sans peine la colère du haut dignitaire. On imagine aisément avec quelle précipitation, certainement indigne d’une fonction aussi élevée, il fit seller son cheval et quitta le monastère. Quelque temps après arriva une dépêche du pape enjoignant aux moines d’aller quémander le pardon de cette insubordination sans précédent auprès du pape lui-même à Avignon. Il était précisé que le trajet de Saint-Nazaire à Avignon devait être fait à genoux. Une exception n’avait été consentie qu’en faveur du prieur. Voilà pourquoi les dix-sept moines partis du monastère de Saint-Nazaire se dressant sur la rive droite de la Loire et se détachant nettement sous les rayons pourpres du soleil couchant, se traînaient à genoux parmi les dunes…
Quatre points d’interrogation
Le problème de la transmutation des éléments passionna plusieurs générations de savants. Mais la nature cachait jalousement le secret de ce qui constituait l’un de ses mystères les plus sacrés. La théorie atomique, qui fut adoptée en chimie vers la fin du siècle dernier, balaya comme fétus de paille toutes les idées mystiques sur la possibilité de transformer un élément en un autre à l’aide de quelque « force spirituelle ». Les adeptes de ces théories n’étaient pas tant des alchimistes (lesquels bien souvent ne savaient pas eux-mêmes ce qu’ils disaient) mais tout simplement des idéalistes. La théorie atomique produisit le même effet sur toutes ces élucubrations sans aucun rapport avec la science que le chant du coq sur l’esprit malin.
D’un autre côté, en proclamant l’atome un et indivisible, les savants tombèrent dans l’erreur opposée car cette affirmation ne fit que se renforcer et la transmutation d’éléments en vint donc à être considérée comme irréalisable.
Il fallut attendre jusqu’au début du XXe siècle pour que s’entrouvrît, en grinçant sur ses gonds, la porte derrière laquelle s’abritait le secret de la transmutation des éléments, laissant filtrer un mince rayon de lumière. Les premiers à l’apercevoir furent les célèbres savants Marie Curie-Sklodowska et Pierre Curie qui réussirent à atteindre la porte sacrée en escaladant les gradins taillés par Dmitri Mendéléev.
… Ranger dans un système ordonné la masse confuse de toutes les données sur les propriétés des éléments chimiques et de leurs composés constituait une tâche excessivement ardue. Car plus d’un tiers des éléments chimiques connus de nos jours n’avaient pas encore été découverts. Mendéléev fut le premier à indiquer combien il devait y avoir d’éléments en tout et à prédire les propriétés de nombreux éléments encore inconnus.
Mais retournons dans le passé.
Mendéléev déplace patiemment ses fiches. Pour le moment il n’y a pas encore de loi. Les gardiens de nuit et les concierges ont cessé de s’étonner de voir constamment de la lumière à l’une des fenêtres du bâtiment des professeurs de Г Institut Technologique.
Mais voyons comment se présentait la première classification périodique des éléments telle qu’elle fut publiée par Mendéléev au printemps 1869. Celui-ci mit des points d’interrogation aux endroits où, d’après ses hypothèses, devaient se trouver les éléments inconnus de la science. Mendéléev y décrivait les éléments encore à découvrir « ekabor », « ekaaluminium », « ekasilicium ». Quelques années plus tard, ces éléments furent trouvés et reçurent leurs noms actuels : scandium, gallium, germanium. La découverte d’éléments nouveaux ne fut plus fortuite mais résulta de recherches scientifiques systématiques. Aussi ne faut-il pas s’étonner qu’il n’ait fallu que quelque 50 ans après la création de la classification périodique des éléments pour ajouter encore 30 éléments aux 63 découverts lors des deux premiers siècles de l’existence de la chimie.
La façon dont les emplacements vides du tableau de Mendéléev furent remplis est une histoire très intéressante dont on ne saurait passer la fin sous silence.
Nous sommes en 1925… Un nouvel élément inconnu de la science mais prévu par Mendéléev, l’élément 75, ou rhénium, vient d’être découvert. Le tableau ne contient plus que quatre emplacements vides, les cases 43, 61, 85 et 87, dans lesquelles au lieu des symboles des éléments chimiques figurent encore des points d’interrogation. Les recherches les plus poussées afin de découvrir ces éléments dans divers minéraux et composés chimiques n’ont encore donné aucun résultat.
Tous les procédés de recherche possibles furent tour à tour essayés. Tous les gisements probables furent examinés, on eut recours aux moyens les plus fantastiques pour renrichissement éventuel des minerais en éléments inconnus. Mais les mystérieux éléments des cases 43, 61, 85 et 87 se dérobaient toujours.
Et le temps passait…
Années 1930. Les tableaux de la classification périodique de Mendéléev suspendus dans les salles de classe et dans les laboratoires des chimistes, publiés dans les revues scientifiques et les manuels, comportent toujours les quatre points d’interrogation. Et combien de points d’interrogation n’y a-t-il pas dans les carnets de travail des savants, les registres de laboratoire des expérimentateurs ?
Un rayon de lumiere
La capacité de certains éléments à se désintégrer avec émission de rayons spéciaux découverte par Henri Becquerel étonna ses contemporains. La radio-activité fut alors à la mode non seulement dans les milieux scientifiques mais encore dans de larges couches de la société. Les élégantes de Paris préféraient le modeste laboratoire des époux Curie aux expositions de tableaux de Monet ou aux spectacles auxquels participait une prima donna italienne. Toutes les conversations concernaient les merveilleux matras remplis de solution de sels de radium capables d’émettre des rayons lumineux dans l’obscurité. A Londres, on se pressait en foule aux conférences du célèbre chimiste Soddy consacrées aux étonnantes propriétés du radium. Bien des années plus tard, Marie Sklodowska écrivit dans ses mémoires à quel point elle fut lasse du tapage qui suivit la découverte du radium.
La presse boulevardière décrivait sur tous les tons les propriétés du radium bien qu’elle fût surtout frappée par le prix fabuleux de ce métal qui coûtait alors plusieurs centaines de milliers de dollars le gramme.
Quant aux savants, ce qui les passionnait c’était l’ampleur scientifique de la découverte des époux Curie. Le phénomène de la radioactivité prouvait clairement que l’atome n’était nullement quelque chose d’immuable, d’indivisible. La transmutation des éléments apparaissait désormais possible. Mais s’il en était ainsi, l’étude détaillée du phénomène de la radio-activité ne pourrait-elle pas nous permettre de comprendre la structure interne de l’atome ?
Les années qui suivirent comblèrent les espérances des savants. L’étude de la radio-activité s’avéra effectivement l’unique moyen permettant de percer les secrets de la structure de la matière.
Lorsque la radio-activité — c’est-à-dire la transformation naturelle des atomes d’éléments — eut été suffisamment étudiée, une question se présenta : puisque la transmutation spontanée d’un élément en un autre est possible, pourquoi ne pas tenter de provoquer ce processus artificiellement ?
La réponse ne se fit pas attendre. Le rythme du progrès de la science au XXe siècle n’était plus celui des siècles précédents. Vingt et quelques années s’étaient à peine écoulées depuis la découverte de la radio-activité que certains événements firent réapparaître dans les colonnes des revues scientifiques un mot démodé et déjà couvert de la poussière du temps, le mot « alchimie ».
A vrai dire, il serait difficile de trouver quelque chose d’alchimique à l’appareil construit en 1919 par le célèbre physicien anglais Rutherford. Cet appareil était muni d’un tube grossissant permettant l’étude des quelques éléments radioactifs connus à l’époque. Les émissions radioactives étaient détectées par l’apparition de lueurs fugitives sur un écran de sulfure de zinc. En effet, toute collision entre une particule en provenance d’un noyau d’élément radio-actif et des cristaux de sulfure de zinc provoque une faible lueur que l’on peut observer à l’aide d’un verre grossissant. Les préparations radio-actives étaient placées sur un support au centre même de l’appareil.
Ainsi donc, tout était assez simple et il n’y avait là rien d’étonnant pas plus que la découverte de Rutherford du fait que l’introduction d’une mince plaque de métal ou de mica empêchait les lueurs d’apparaître sur l’écran. Il était évident que les rayons radio-actifs étaient arrêtés par un tel obstacle.
Nul ne saurait dire ce qui incita un jour Rutherford à remplir son appareil d’hydrogène. En tout cas, il fut le témoin de phénomènes extraordinaires : malgré une plaque métallique placée entre la source d’émissions radio-actives et l’écran, les lueurs apparaissaient sur ce dernier exactement comme s’il n’y avait pas eu d’obstacle. Les lueurs disparaissaient dès qu’on évacuait l’hydrogène.
La cause du phénomène ne fut pas découverte immédiatement. Comme il arrive souvent, les idées les plus invraisemblables vinrent à l’esprit alors que, comme d’habitude, la solution était étonnamment simple et pourtant d’une importance considérable.
Les éléments radio-actifs naturels (en l’occurrence il s’agissait du polonium) émettent des rayons alpha, c’est-à-dire des noyaux atomiques d’hélium. Le poids atomique de l’hélium est 4, ses atomes étant 4 fois plus lourds que ceux de l’hydrogène de poids atomique 1. En heurtant les noyaux atomiques d’hydrogène (protons), les particules alpha leur transmettent leur énergie. La masse des protons étant faible par rapport à celle des particules alpha, les protons acquièrent une vitesse élevée qui leur permet de traverser l’obstacle.
Voilà pourquoi l’hydrogène rend la plaque métallique perméable aux rayons. N’est-ce pas simple ? Très simple ! Mais ce n’était pas encore là le plus intéressant. Quand on eut rempli l’appareil d’azote au lieu d’hydrogène, les lueurs continuèrent à apparaître sur l’écran exactement comme dans le cas précédent. Cette fois, on ne comprenait rien, les noyaux atomiques d’azote étant bien plus lourds que les particules alpha (de 3,5 fois plus) et la plaque étant imperméable à l’hélium, elle devait a fortiori l’être pour l’azote.
Dans ce cas, à quoi peut donc être due l’apparition des lueurs sur l’écran ? Comment les particules radio-actives peuvent-elles traverser un écran capable tout au plus de laisser passer les noyaux d’hydrogène ? De l’hydrogène était-il par hasard mélangé à l’azote ? On introduisit alors dans l’appareil de l’azote soigneusement débarrassé de toutes impuretés, notamment de l’hydrogène. Les lueurs n’en apparaissaient pas moins sur l’écran avec la même régularité.
Il restait une seule hypothèse : l’azote de l’appareil donnait naissance à de l’hydrogène sous l’effet de la radio-activité. Au début, elle parut invraisemblable, mais les expériences suivantes en prouvèrent le bien-fondé. La formation d’hydrogène dans l’appareil était indubitable.
Ainsi fut réalisée la première réaction nucléaire, qui, chez n’importe quel chimiste du siècle passé, aurait provoqué la plus profonde perplexité :
N + He = O + H.
La charge du noyau atomique d’azote est 7, celle de la particule alpha (noyau atomique d’hélium), 2. Leur somme est donc 9 et la somme des noyaux atomiques О et H est également 9 (8 noyaux d’oxygène + 1 noyau d’hydrogène).
Telle fut la première des centaines de réactions nucléaires dans laquelle un élément se transformait en un autre, ce qui, comme on le sait, relève précisément du domaine de l’alchimie la plus authentique. Voilà donc expliqué le titre du présent chapitre « un rayon de lumière ».
Examiner en détail tous les procédés dont dispose à présent la science pour transformer certains éléments en d’autres nous écarterait trop de notre sujet.
Bornons-nous à indiquer que tous ces procédés sont basés sur le « bombardement » des noyaux atomiques des éléments soumis à la transformation par des « projectiles » : particules nucléaires constituées par les protons, neutrons et particules alpha.
C’est précisément cette nouvelle branche scientifique, nommée chimie nucléaire, qui a permis d’obtenir artificiellement les éléments que les chimistes n’avaient pas réussi à trouver dans la nature.
Les chimistes éliminent les points d’interrogation
La loi périodique de Mendéléev permettait aux chimistes de déterminer les propriétés des éléments figurant sous les numéros 43, 61, 85 et 87, tout comme s’ils avaient été directement en présence de ces éléments et de leurs composés. Mais cela ne leur conférait pas le droit d’enlever les points d’interrogation de ces cases, droit réservé à celui qui obtiendrait ne serait-ce qu’un centième, un millième ou même un cent-millième de gramme de l’un de ces éléments. Or, personne ne réussit à en produire même d’aussi faibles quantités. Nous savons maintenant que toutes les tentatives pour extraire les mystérieux éléments des minéraux ou des roches étaient vouées à l’échec car aucun d’entre eux ne se trouve dans l’écorce terrestre en quantité tant soit peu appréciable.
Il semblait souvent que le succès fût proche, qu’un élément inconnu avait enfin été obtenu. Il arrivait qu’obtenant un composé inhabituel à ses yeux, un chercheur pensait être en présence d’un élément nouveau. Il prenait alors précipitamment la plume et rédigeait une lettre, priant l’éditeur de quelque revue de chimie de « publier sans tarder l’annonce de la découverte d’un nouvel élément ». Evidemment, l’éditeur ne manquait pas de le faire, car qui aurait voulu se priver de la gloire d’avoir été le premier à communiquer un résultat aussi remarquable ? C’est ainsi que des dizaines de « nouveaux » éléments furent présentés .dans les publications de l’époque. Mais les communications concernant tous ces « masurium », « illinium », « florencium » et autres « moldavium » étaient invariablement contredites par les chimistes qui entreprenaient la vérification des données concernant le « nouvel » élément.
Peu à peu, le problème des « quatre cases » cessa d’étonner par son côté mystérieux car tout ce qui est étrange finit par devenir habituel. De plus, les conversations sur ces emplacements vides commençaient à n’être plus de mise. Les digressions sur les éléments restant à découvrir semblèrent du même ordre que l’invention du « mouvement perpétuel ».
Et voici qu’au milieu de cette accalmie éclata comme un coup de tonnerre l’annonce de la chute de la « forteresse des quatre » ! A vrai dire, tout se passa d’une façon on ne peut plus discrète. En 1937, le « Bulletin de l’Académie des Sciences d’Italie » publia une sobre et laconique communication sur la préparation artificielle de l’élément 43 par les savants Segré et Perrier. Cette communication ne dépassait pas une centaine de mots dont un quart se composait d’adverbes à sens vague tels que « éventuellement », « probablement », « peut-être », etc. Cependant, la découverte du nouvel élément ne faisait pas de doute !
Quant aux journaux italiens, ils parlaient de choses fort différentes : du concours des quatre Tarzans, de la prochaine tournée du divin chanteur Gigli, de l’éruption probable du Vésuve, bref de tout sauf de la remarquable découverte de leurs compatriotes.
Le nouvel élément avait été obtenu en bombardant du molybdène — élément 42 — par des atomes d’hydrogène. L’hydrogène a le numéro atomique 1. La somme des numéros de la « cible » et du « projectile » est justement égale à 43, c’est-à-dire le numéro de l’élément technécium. Ce nom, le premier représentant du quatuor mystérieux ne le reçut pas au hasard. Il s’agissait d’en souligner la provenance, « technikos » en grec signifiant « artificiel ».
Est-il nécessaire d’indiquer que les propriétés prévues du technécium coïncidaient en tous points avec celles qui furent observées expérimentalement par la suite ? Il est vrai que l’élément fut d’abord obtenu en quantité tellement infime que nulle balance, même la plus sensible, n’était capable d’en indiquer le poids.
Après qu’une brèche eut été faite dans le prétendu « mystère des quatre », les recherches s’accélérèrent. Un an après l’obtention du technécium, les chimistes du monde entier éliminèrent encore un autre point d’interrogation de leur tableau de la classification périodique et y inscrivirent le symbole Pm représentant le prométhium, élément 61, obtenu de la même façon que le technécium.
Si vous jetez un coup d’œil sur la classification périodique de Mendéléev, il vous sera aisé de deviner comment on y parvint. Avec, bien sûr, l’élément 60 — le néodyme — qui fut bombardé à l’aide d’atomes d’hydrogène !
L’élément 61 fut nommé « prométhium » en hommage au dieu de la mythologie, Prométhée, qui s’empara du feu du ciel pour le transmettre aux hommes. Comme on le sait, Zeus l’en punit par un supplice atroce : il l’enchaîna au sommet du Caucase et un aigle lui rongeait le foie qui repoussait sans cesse. En donnant ce nom au nouvel élément, les savants qui le découvrirent voulaient souligner la voie dramatique et pénible qu’il leur avait fallu suivre du point d’interrogation au symbole de l’élément chimique.
Nous aurons encore l’occasion de parler des propriétés des métaux groupés dans l’étonnante catégorie des terres rares, dont fait partie le prométhium. Nous nous bornerons pour le moment à souligner qu’en plein accord avec sa position dans la classification périodique, le prométhium s’avéra semblable aux autres représentants de cette catégorie.
Ce fut ensuite le tour de l’élément 87. Le point d’interrogation de cette case intriguait tout particulièrement les chimistes qui se demandaient avec une extrême curiosité quelles seraient les propriétés chimiques de l’élément 87. Dans le tableau de Mendéléev la case 87 figure dans le premier groupe et le même rang vertical que le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium. L’ordre de cette énumération n’est pas arbitraire, l’activité chimique de ces éléments augmentant considérablement du lithium au césium. Ces métaux expulsent l’hydrogène de l’eau en formant des alcalis, d’où leur nom d’éléments alcalins.
Les métaux alcalins sont les plus actifs des métaux de la classification périodique, le césium étant le plus actif d’entre eux. Le lithium réagit faiblement avec l’eau mais si on jette du césium dans l’eau, la réaction ressemble à une véritable explosion.
L’élément inconnu 87, qui dans le tableau de Mendéléev se trouve placé au-dessous du césium, devait être encore plus actif que ce dernier. D’où l’intérêt des recherches afin d’obtenir cet élément : les suppositions allaient-elles se confirmer ?
L’élément en question fut découvert en 1939, d’une façon tout à fait inattendue, dans les produits de désintégration de l’élément radio-actif uranium. Quand on eut étudié les premières propriétés de cet élément appelé francium, on comprit pourquoi il s’était si longtemps dérobé aux recherches. Tout d’abord, comme tous les éléments d’un numéro supérieur à 83, le francium est radio-actif. Cependant, il diffère considérablement de ses « compagnons » par le fait qu’il se désintègre très rapidement. Sa période de demi-désintégration (c’est-à-dire le temps nécessaire à la désintégration de la moitié d’une quantité donnée de l’élément) n’est que de 22 minutes. Cela signifie que si nous prenons 1 gramme de francium, au bout de 22 minutes, il ne restera qu’un demi-gramme. Une heure plus tard, il n’y en aura plus qu’un huitième. A la fin de la quatrième heure, il ne restera plus de ce gramme de francium qu’une parcelle de deux dix-millièmes de gramme invisible à l’œil nu et une heure plus tard, il n’en subsistera plus qu’un « agréable souvenir » pour parler comme dans les romans anciens.
Cette faible durée de demi-désintégration ne constituait cependant pas la difficulté majeure pour isoler cet élément. Si les chercheurs avaient eu à leur disposition seulement un gramme de francium, ils auraient sans doute eu le temps, en deux heures, de se familiariser suffisamment avec ses propriétés. Mais pour se procurer ce gramme, il aurait été nécessaire de traiter — imaginez-vous ce chiffre ! — deux milliards et demi de tonnes d’uranium naturel.
— Halte ! dira le lecteur averti, cela ne veut-il pas dire que la teneur de l’uranium naturel en francium est de 4 • 10–16 gramme par gramme d’uranium ? Comment se fait-il alors qu’on ait réussi à déterminer une quantité de francium tellement faible qu’il est même difficile de l’exprimer ? Le nombre 10–16 n’a pas de nom spécial, 10–6 cela fait un millionième, 10–9, un milliardième, mais 10–16, on ne peut le désigner que par 10 puissances moins seize. Dans les chapitres précédents, il n’a pas été question de quantités aussi infimes. De quelles méthodes se sont servis les chimistes pour obtenir des quantités aussi impondérables, au plein sens du terme ?
La réponse sera fournie dans les chapitres suivants. Pour l’instant, pour en terminer avec le francium, nous dirons seulement que bien que personne ne l’ait encore jamais obtenu en quantité plus ou moins pondérable, nous en savons pas mal de choses. Cet élément est bien le métal le plus actif que l’on connaisse. C’est un conducteur d’électricité exceptionnel et, tout comme le mercure, il se présente à température ordinaire à l’état liquide.
Il serait prématuré de parler des applications pratiques de cet élément. On sait pourtant que si l’on injecte du sel de francium à un malade atteint de sarcome, le métal s’accumule tout entier dans la tumeur. Etant donné que le francium est radio-actif et que ses rayons exercent une action destructrice sur les tumeurs, on peut supposer que cette propriété trouvera son application en médecine.
Voilà à peu près tout ce que l’on peut dire du francium, le seul des quatre éléments mystérieux à avoir été découvert dans la nature et non pas obtenu artificiellement.
Le dernier à ôter son masque, de fort mauvaise grâce du reste, fut l’élément 85. En 1940, le point d’interrogation figurant dans cette case fut remplacé par le symbole At représentant l’astate. L’astate a également été obtenu « alchimiquement » par transformation artificielle d’éléments, en soumettant des atomes de bismuth au bombardement de noyaux d’hélium. Nous connaissons déjà l’aspect arithmétique du processus : le numéro d’ordre du bismuth est 83, celui de l’hélium, 2. D’où l’égalité a priori surprenante : bismuth + hélium = … astate.
L’astate est le dernier en date du groupe des halogènes. Les anciens membres de ce groupe — fluor, chlore, brome et iode — nous sont très familiers. Il n’en était que plus intéressant d’apprendre quelles seraient les propriétés du « nouveau-né ».
Comme on le sait, les halogènes sont les métalloïdes par excellence. Seul l’iode possède à un degré restreint des propriétés métalliques : l’éclat caractéristique du métal, la faculté de conduire le courant et d’engendrer des sels (azotates, chlorures, etc.).
L’astate est déjà un métal typique dont on connaît beaucoup de choses : ses degrés d’acidité en solution aqueuse, la composition de ses sels et même le fait qu’il se dissout facilement dans le chloroforme. Une seule chose reste inconnue, sa couleur, car personne n’est encore parvenu à obtenir de l’astate en quantité suffisante pour pouvoir juger de sa couleur. Mais, pour pouvoir observer la couleur d’une substance, il faut en avoir une quantité pondérable et ce n’est pas le cas.
Il est intéressant d’observer que pour les premières recherches sur les propriétés chimiques de l’astate, on se servit de solutions d’une molarité de 10–13, ce qui revient à dire qu’un litre de solution contenait deux cent-milliardièmes de gramme de cet élément.
Ainsi prit fin la « Grande Guerre » contre les points d’interrogation de la classification périodique des éléments. Ce fut une lutte pleine de péripéties dramatiques ce qui est le propre de toute investigation véritablement scientifique, lutte pour obtenir ce qui, auparavant, était considéré comme la manifestation de mystérieuses « forces de la nature », lutte qui permit au mot « alchimie » de devenir un terme scientifique moderne.
Après quoi, les mystères du système périodique étant, semblait-il, éclaircis, les chimistes devaient pouvoir pousser un soupir de soulagement. Mais la véritable science peut-elle se reposer sur ses lauriers ? S’il n’y avait plus de mystères à l’intérieur de la classification périodique, il pouvait y en avoir, ou plutôt il devait y en avoir hors d’elle. Aussi les recherches se poursuivirent-elles…
92 ? Et pourquoi pas davantage ?
Il existe dans la classification périodique des éléments curieux au plus haut degré. L’un se distingue par son aptitude à entrer en réaction ; tel autre, au contraire, peut se vanter qu’aucune force n’est capable de l’obliger à se combiner avec d’autres éléments ; un troisième est remarquable par son point de fusion très élevé et, donc, une liquéfaction très difficile : un quatrième possède la particularité d’être très malaisé à faire passer de l’état gazeux à l’état liquide. Bref, le tableau contient bon nombre d’éléments qui peuvent s’enorgueillir de telle ou telle propriété curieuse. Mais parmi eux il y en a un qui, sans contredit, les surpasse tous : l’uranium. Aucun élément sur terre n’a un poids atomique plus élevé. Voilà pourquoi pendant de nombreuses années, ce fut l’uranium qui, de droit, ferma la marche des éléments de la classification périodique.
Les chimistes s’étaient accoutumés au fait que l’uranium était le dernier élément. Leurs recherches portaient sur les éléments à découvrir qui se trouvaient au milieu du tableau : entre l’hydrogène et l’uranium. Quant à l’uranium, il était destiné à rester le dernier. Ainsi s’habitue-t-on au poêle dans sa chambre, ou à l’armoire, n’imaginant même pas qu’ils puissent être déplacés.
Mais, parmi les savants, il se trouva un « fauteur de troubles » qui clama : « Permettez, mais pourquoi la classification périodique doit-elle absolument se terminer par le numéro 92 ?
Pourquoi ne peut-il y avoir un 93e élément, un 94e et ainsi de suite ? »
« En effet ! — s’étonnèrent beaucoup d’autres. Pourquoi n’y aurait-il pas un 93e élément ? Pourquoi ne pas le rechercher ? »
Cette idée mûrit vers le début des années 30. C’est alors que commencèrent les recherches. Les fièvres de « l’or » et du « diamant » qui agitèrent le monde à diverses époques n’étaient rien en comparaison aux passions que déchaîna le problème des éléments transuraniens (éléments pouvant suivre l’uranium).
Cette passion fut peut-être due au fait que si personne n’avait de doute sur l’existence des éléments 43, 61, 85 et 87, la découverte ne serait-ce que d’un seul élément transuranien représentait par contre pour la science un intérêt de principe.
Peut-être aussi les chercheurs commençaient-ils à se trouver à l’étroit dans ces quatre cases de la classification périodique encore non « démasquées » à l’époque et éprouvaient-ils l’envie, timide d’abord puis de plus en plus forte, de s’évader de ce cadre.
Il en est apparemment toujours ainsi : tout ce qui se trouve au-delà de quelque limite, le pôle d’inaccessibilité, la Lune, ou les mystérieux éléments chimiques, est particulièrement attirant. Voilà pourquoi les éléments intermédiaires à découvrir étaient recherchés avec ténacité mais sans passion. On se trompait, on se corrigeait poliment l’un l’autre, on se tançait avec bonhomie, on louait avec complaisance, on se moquait sans acrimonie. Quant aux éléments situés au-delà de la limite — les éléments transuraniens — on les cherchait avec frénésie. On se disputait, on discutait, on hurlait — si tant est qu’on puisse hurler dans les colonnes d’une revue — on démentait, on portait aux nues, on critiquait.
Chaque année, le monde scientifique était secoué par une « grande » et une bonne demi-douzaine de « petites » découvertes du 93e élément, auxquelles on n’accordait pas grand crédit.
Il suffit de rappeler une seule de ces nouvelles sensationnelles. Le célèbre physicien italien Enrico Fermi émit un jour la supposition que le 93e élément s’était peut-être (peut-être !) formé au cours d’une de ses expériences.
Fermi ne prévoyait rien de bien précis, mais sa déclaration fut présentée d’une tout autre manière par la presse à sensations. Un journal, dépassant toutes les bornes, alla même jusqu’à inventer et décrire une réception au palais royal au cours de laquelle Fermi aurait lui-même présenté à la reine un petit flacon du 93e élément.
Il suffit de feuilleter n’importe quelle collection de revues de vulgarisation scientifique des années 30 pour y trouver l’annonce régulière, deux ou trois fois par an, de la découverte du nouvel élément 93, annonces qui étaient inévitablement démenties avec la même régularité.
Il devint bientôt évident que les éléments à numéro atomique supérieur à 92 ne pouvaient se trouver dans l’écorce terrestre. L’explication en était simple et, comme nous allons le voir, absolument correcte. Nous avons déjà noté que les éléments de la classification périodique à partir du polonium (84) sont tous radio-actifs. En d’autres termes, ils sont instables et se désintègrent au bout d’un certain temps, en se transformant en éléments à numéro d’ordre inférieur, lesquels à leur tour… et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on obtienne des éléments chimiques stables, le plomb par exemple. Les éléments devant suivre l’uranium avaient dû très vraisemblablement faire partie de l’écorce terrestre il y a des millions et des millions d’années, peut-être même des milliards. Mais, avec le temps, ces éléments s’étaient désintégrés, volatilisés. Et sur terre il n’y en avait plus.
Mais l’époque où les chimistes se contentaient de ce que la nature avait mis à leur disposition était révolue. Cependant, le vieil arsenal dont disposaient les savants n’était pas assez puissant pour investir la forteresse dans laquelle s’abritait la solution de ce problème.
L’énigme serait peut-être restée encore longtemps entière, si l’on n’avait pas eu recours à une nouvelle arme plus efficace : les neutrons. Comme les neutrons sont dépourvus de charge, ils conviennent parfaitement aux bombardements nucléaires. Les particules possédant une charge — noyaux atomiques d’hydrogène ou d’hélium — remplissent la même fonction avec beaucoup moins d’efficacité. En abordant un atome, une particule à charge positive éprouve une répulsion prononcée de la part d’un noyau à charge identique.
Les neutrons permirent d’obtenir artificiellement les noyaux de presque tous les éléments chimiques. Mais le 93e persistait à ne pas vouloir se rendre.
En bombardant l’uranium à l’aide de neutrons afin d’obtenir artificiellement l’occupant de la 93e case de la classification périodique, les savants remarquèrent d’abord que les noyaux atomiques d’uranium se désintégraient en « éclats ». Ces éclats formaient les noyaux atomiques des éléments situés au milieu du tableau de Mendéléev : baryum, lanthane et quelques autres dont la plupart possèdent une radio-activité artificielle. Les particularités de ces éléments radio-actifs artificiels ont été étudiées en détails : on connaît leurs poids atomiques ainsi que leur période de demi-désintégration.
Le nombre « d’éclats » découverts était très élevé de sorte que la découverte de nouveaux éléments artificiels par ce procédé finit par ne plus éveiller d’enthousiasme particulier chez les chercheurs. Or, lorsqu’en 1940 le physicien américain McMillan découvrit dans les produits de la fission de l’uranium un isotope radio-actif avec une période de demi-désintégration de deux à trois jours, il n’en fut pas autrement étonné. Une étude plus poussée révéla que les radiations provenaient d’un élément qui n’était semblable à aucun de ceux qui se formaient ordinairement lors de la fission de l’uranium. Une fois isolé, cet élément s’avéra être le… 93e. Le fait était tellement inattendu qu’il ne provoqua pas du tout l’effet qu’une telle découverte aurait dû susciter.
Du reste, les détails ne furent connus que bien plus tard, après les premières explosions de bombes atomiques, après que le sinistre champignon se fut élevé dans le ciel d’Hiroschima. Mais quel est le rapport ?
Le problème des éléments transuraniens apparut d’emblée intimement lié à celui du dégagement de l’énergie atomique. S’il n’en avait rien été, peut-être ne saurions-nous encore pas grand-chose des éléments au-delà du 92e.
Le 93e élément reçut le nom de neptunium : de même que dans le système solaire la planète Uranus est suivie de Neptune, dans le tableau périodique l’uranium devait être suivi du neptunium.
Des recherches plus poussées sur le processus de la formation du neptunium à partir de l’uranium révélèrent qu’il se déroulait de la façon suivante : lors de collisions entre neutrons et noyaux, une partie de ces derniers vole en éclats tandis qu’une autre, au contraire, capture les neutrons ; il se forme alors une autre variété ou, comme on dit, un isotope d’uranium, à poids atomique 239. Cet isotope est très instable et subit une rapide désintégration radio-active au cours de laquelle le noyau de chacun de ses atomes émet un électron.
L’électron possède une charge de –1, celle du noyau atomique d’uranium est 92.
Si de 92 on ôte –1, on obtient 93. C’est ainsi que se forme l’élément 93 ou neptunium.
Pendant que j’expliquais la façon dont se formait le neptunium à partir de l’uranium, le lecteur a déjà sans doute deviné le nom qu’on devait attribuer au 94e élément. Et il ne s’est pas trompé, c’est bien le plutonium ! Dans le système solaire, la planète Neptune n’est-elle pas suivie de la planète Pluton ?
Comme on le sait, Neptune fut découvert par des calculs mathématiques. Pluton fut d’ailleurs également trouvé au moyen de déductions purement théoriques basées sur une déviation de Neptune de l’orbite calculée.
Comme la planète d’où il tira son nom, le plutonium fut d’abord découvert théoriquement.
L’étude des propriétés du neptunium révéla qu’il émettait des rayons bêta, c’est-à-dire que chacun de ses atomes « expulsait » un électron. Nous savons déjà ce qui se passe lorsque le noyau d’un élément quelconque émet un électron : il se crée un noyau de l’élément situé dans la case suivante de la classification périodique. C’est pourquoi la découverte de l’émission de rayons bêta par le neptunium suggéra immédiatement que le 93e élément devait être suivi d’un 94e. A la suite d’expériences minutieuses, on finit effectivement par le découvrir en 1941.
Comme on le sait, la réaction en chaîne est une des conditions essentielles de la libération de l’énergie du noyau atomique lors de la fission d’éléments lourds. Les deux autres substances capables de réaction en chaîne, les isotopes d’uranium de poids atomiques 233 et 235, sont beaucoup plus difficiles à obtenir que le plutonium.
Actuellement le plutonium est produit en grandes quantités dans les réacteurs atomiques où la désintégration de l’uranium s’effectue simultanément à la formation du 94e élément. Après un certain temps, il se forme une quantité considérable de plutonium dans l’uranium dont est garni le réacteur. La séparation de ces deux éléments est relativement aisée.
L’obtention du neptunium et du plutonium fut un triomphe pour la physique et la chimie, une victoire de l’alchimie moderne pour ainsi dire. Et pourtant, comme le révéla un futur immédiat, ce n’était pas encore son apogée. Trois ans après la découverte du plutonium les chimistes durent ménager de nouvelles cases dans la classification périodique. Les « vedettes » furent les éléments 95 et 96 découverts en 1944.
Là encore, on eut recours à « l’artillerie », le polygone de tir étant un cyclotron (appareil pour l’accélération des particules élémentaires), l’uranium la cible et les particules alpha (noyaux d’hélium), les projectiles. Lorsqu’un noyau d’uranium était atteint par une particule alpha, il se formait un noyau de numéro atomique 94 (2 + 92, ce qui constituait une nouvelle méthode pour l’obtention du plutonium). Au bout d’un certain temps, le noyau de plutonium expulsait une particule bêta (électron) donnant ainsi naissance à l’élément 95. Ayant été découvert en Amérique, il reçut le nom d’américium.
L’élément 96 fut obtenu d’une façon similaire, en bombardant du plutonium par des particules alpha. Cet élément 96 résulta d’une expérience très complexe mais d’une opération arithmétique extrêmement simple (94 + 2 = 96). Il fut nommé curium, en l’honneur des célèbres chercheurs dans le domaine de la radio-activité Marie Curie-Sklodowska et Pierre Curie.
La comparaison de la science à un immense édifice n’est sans doute pas originale. Mais quand on relate la façon dont furent obtenus les éléments artificiels transuraniens, on ne peut s’empêcher d’utiliser cette image. C’est l’uranium qui servit de « fondement » à l’édifice ; le plutonium en fut le « rez-de-chaussée » et la base de « l’étage » suivant, c’est-à-dire de l’américium.
En somme, de même que chaque étage achevé permet de passer à la construction de l’étage suivant, chaque élément transuranien obtenu permettait de passer à l’élément nouveau suivant. C’est ainsi que l’américium fut utilisé pour la synthèse du 97e élément, étant soumis au bombardement de particules alpha dans un cyclotron. En vertu de la même opération que précédemment (95 + 2), on eut l’élément 97, que l’on appela berkélium, d’après Berkeley, ville où l’élément fut obtenu pour la première fois.
Pour la synthèse de l’élément 98, on se servit du curium que l’on soumit également à un bombardement de particules alpha pour isoler l’élément californium, nom qui fit son apparition dans la classification périodique en 1950. Ensuite, le rythme des découvertes se ralentit quelque peu…
Les nouveaux « locataires » de la classification périodique — les éléments 99 et 100 — ne virent pas le jour en laboratoire. Leur naissance ne fut pas précédée des discussions et digressions laborieuses qui devancent généralement toute découverte scientifique.
En 1952, les Américains effectuaient une expérience thermonucléaire comprenant la préparation et l’exécution d’une explosion secrète qui reçut le nom plutôt inoffensif et même quelque peu familier de « Mike ». Une demi-heure après l’explosion, des fusées automatiques lancées dans le nuage en forme de champignon s’élevant au-dessus de la zone d’essai y recueillaient des échantillons d’air, de poussières et d’autres particules solides. Les éléments 99 et 100 y furent découverts dans les filtres en papier sur lesquels s’étaient fixées les poussières issues de l’explosion.
Les résultats de cette expérience ne furent publiés que trois ans plus tard. C’est alors que deux éléments supplémentaires furent ajoutés à la classification périodique, nommés einsteinium et fermium en l’honneur des célèbres physiciens Albert Einstein et Enrico Fermi.
Dès 1955, on réussit à obtenir synthétiquement ces éléments en laboratoire.
En mai 1954, un groupe de chercheurs américains dirigé par Seeborg annonçait l’obtention de l’élément 101 et le nommait mendélévium « en hommage au rôle prépondérant du grand chimiste russe Dmitri Mendéléev qui fut le premier à utiliser la classification périodique afin de prédire les propriétés des éléments non encore découverts, principe qui servit de clé à la découverte des sept derniers éléments transuraniens ».
Le mendélévium ne clôt pas la série des éléments obtenus artificiellement. Actuellement les cases suivantes du tableau de Mendéléev sont également occupées, mais ici nous devons faire une courte pause dans notre récit sur l’histoire de l’obtention des éléments transuraniens, pour passer à l’étude d’autres questions non moins intéressantes.
Les manipulateurs de l’invisible
C’est à dessein que dans mon récit concernant la découverte de nouveaux éléments de la classification périodique je ne me suis pas servi une seule fois du mot « combien ». Cela pourrait faire supposer que les quantités de substances d’où furent extraits les éléments transuraniens ne jouaient aucun rôle. Mais, en réalité, ces quantités sont sans doute le plus important des nombreux facteurs dont dépendent la possibilité et la facilité (il serait plus juste de dire la difficulté) de l’obtention de tel ou tel élément.
Mais procédons par ordre. Regardez le dessin représentant la quantité globale d’américium disponible en 1944. A droite figure la pointe d’une aiguille, à gauche une échelle millimétrique ; il s’agit d’une photo prise par l’objectif d’un microscope. Combien peut-il y avoir d’américium ? demanderez-vous. La quantité exacte nous est connue : un cent-millième de gramme.
Cette fois-ci nous sommes en présence d’une quantité de beaucoup inférieure à celles dont il a été question dans les expériences de l’infortuné professeur Litte. Trente ans en chimie au XXe siècle, cela compte !
Prenons un des articles consacrés à l’un des éléments transuraniens, articles que les revues de chimie publient actuellement par douzaines. En apparence nous n’y trouvons rien d’étonnant. L’article contient les phrases et les termes de chimie traditionnels : « le composé a été obtenu par le mélange de deux solutions », « la composition a été déterminée par titrage », « le sel a été dissous dans l’eau distillée », etc., ce que l’on trouve habituellement dans n’importe quel ouvrage même n’ayant qu’un rapport lointain avec la chimie.
Mais en lisant plus attentivement, le lecteur non averti ne manquera pas d’être étonné. C’est qu’ici les burettes mesurent non pas des millilitres comme dans les laboratoires ordinaires, mais des cent-millièmes de millilitre. Les plus grands verres de laboratoire manipulés par les auteurs de l’article en question ne dépassaient pas 1 millimètre en diamètre. Les quantités de substances étaient de l’ordre d’un millième de gramme et les pesées se faisaient à un cent-millième de gramme près.

Au cas où certains lecteurs auraient quelques difficultés à imaginer ces nombres précédés d’une foule de zéros, nous allons les aider.
Un cent-millième de millilitre… En comparaison avec la capacité d’un verre ordinaire, cela équivaut à un mètre par rapport à la moitié de l’équateur. Ajoutons que ce volume est mesuré à un pour cent près ce qui signifie qu’on peut déceler des liquides d’un volume cent fois moindre. C’est comme si on mesurait l’équateur à deux millimètres près ! Si l’on vous disait par exemple « la distance d’Oboyani à San Francisco est de quatorze mille cent soixante-huit kilomètres neuf cent quarante quatre mètres quinze centimètres trois millimètres », vous ne manqueriez pas de prier l’auteur d’une telle affirmation de cesser cette plaisanterie. Mais si un chimiste écrit des choses analogues, elles nous étonnent, certes, mais nous paraissent tout de même possibles. Les voilà bien les miracles palpables du siècle de l’atome !
Maintenant représentons-nous la façon dont on opère avec de telles quantités de matière. Les éprouvettes et les verres sont tellement petits qu’on doit les prendre avec des pincettes spéciales et non avec les doigts. Les divers instruments, tels qu’entonnoirs pour filtrage, baguettes pour le mélange des solutions, etc., sont tellement minuscules que, par comparaison, les fers forgés pour une puce par le héros du récit de Leskov paraissent énormes. Les liquides contenus dans ces récipients sont transvasés avec un soin méticuleux pour ne pas en perdre une seule goutte. Mais au fait, comment peut-on parler de gouttes ? Le volume d’une goutte n’est-il pas mille fois supérieur à celui de toute la solution ?
Examinons maintenant les balances nécessaires. Le fléau de quartz pur n’est pas plus épais qu’un cheveu. En réalité, la plupart des pièces de ces balances sont tellement fines et impondérables qu’elles sont pratiquement invisibles à l’œil nu. On ne saurait installer une telle balance dans une pièce car, même si on la plaçait sur le support le plus solide et le plus stable, elle serait soumise à de fortes oscillations. Que quelqu’un vienne à passer dans la rue longeant l’édifice où se trouve le laboratoire, la pesée s’en trouvera faussée de plusieurs décimales ; et si c’est un camion, les plateaux de la balance danseront la gigue !
Les balances de ce genre sont installées dans de profonds locaux souterrains. On s’en approche avec des précautions de funambule. Il n’est pas question d’élever la voix ou de gesticuler.

Toutes ces précautions sont nécessaires pour effectuer des pesées à 0,000001 près. Voilà ce que c’est que la sixième décimale et ce qu’elle coûte d’efforts aux chimistes !
Les chercheurs des éléments transuraniens doivent opérer avec des quantités de matière infinitésimales car les éléments artificiels obtenus lors du bombardement à l’aide de particules élémentaires des cibles appropriées se présentent en quantités si infimes que seules des méthodes de ce genre permettent de les déceler.
Maintenant, lorsqu’il est question de la plupart des éléments transuraniens, on n’a affaire ni à des kilos ni à des grammes. Même le milligramme est une unité excessive.
Pour les éléments transuraniens il fallut inventer une nouvelle unité : le microgramme, millionième de gramme ou la millième partie d’un milligramme.
C’est ainsi que la quantité de neptunium obtenue lors de sa découverte était de dix microgrammes et celle de plutonium de vingt microgrammes. Quant à l’américium obtenu à l’origine, nous en connaissons déjà le poids indiqué sur le dessin. La quantité de curium isolé lors de sa découverte était du même ordre.
Pour les éléments berkélium et californium, même le microgramme est une unité trop grande. Leurs quantités obtenues à l’état isolé s’expriment en dixièmes, voire en centièmes de microgramme, c’est-à-dire des dix-millionièmes et cent-millionièmes de gramme !
Cependant tout ceci n’a nullement empêché l’étude détaillée des propriétés chimiques et physiques des éléments transuraniens. Bien plus, ces derniers ont soulevé un intérêt tel que leurs propriétés nous sont maintenant mieux connues que celles de certains éléments ordinaires.
J’ai en ce moment sous les yeux un livre rassemblant les résultats des recherches portant sur six éléments transuraniens (du neptunium au californium). C’est un gros in-folio de près de mille pages et ne pesant pas moins de deux kilos.
La branche de la chimie permettant l’étude des propriétés des corps disponibles en quantités infinitésimales a été nommée microchimie : en effet, pour observer les changements qui se déroulent dans les éprouvettes, le chimiste doit avoir recours au microscope.
Comme on le voit, l’une des difficultés principales de l’étude des éléments transuraniens — leurs quantités infinitésimales — a été surmontée avec succès.
Mais il n’est pas si simple d’être un alchimiste moderne ! Si la nécessité de recourir aux méthodes de la microchimie constituait l’unique difficulté de l’étude des éléments transuraniens, il n’y aurait encore que demi-mal ou même, pour être plus exact (et la chimie est une science exacte !), que quart de mal. Supposons que nous obtenions d’abord 10 microgrammes, puis une quantité égale une seconde fois, ensuite une troisième, une quatrième, une cinquième… Nous aurions ainsi rapidement un dix-millième de gramme, puis un dixième de gramme, quantité déjà fort appréciable !
La difficulté est ailleurs. Nous avons déjà signalé qu’à partir du polonium tous les éléments de la classification périodique sont radioactifs. Or, la radio-activité des éléments transuraniens est d’une intensité extrême.
Un microgramme de plutonium émet 140 000 particules alpha à la minute, ce qui est énorme. Un sel de plutonium, dissout dans l’eau, provoque la formation immédiate d’eau oxygénée : les particules alpha émises lors de la désintégration du plutonium déclenchent dans l’eau des processus chimiques complexes.
La radio-activité de l’américium est encore de plusieurs dizaines de fois supérieure. Un microgramme de cet élément émet 70 millions de particules alpha à la minute ce qui n’est pourtant rien en comparaison du voisin de l’américium, le curium, dont un microgramme émet dix milliards de particules alpha à la minute.
Cela signifie que si l’on dissout une quantité même infinitésimale d’un sel de curium dans l’eau, la température de la solution s’élève rapidement, atteignant bientôt la température d’ébullition. Le récipient contenant le sel en solution, placé sous une cloche de verre, dégage de la vapeur à profusion bien qu’il n’y ait aucune source de chaleur à proximité. La chaleur provient du curium lui-même ou, plutôt, des particules radio-actives qu’il émet. On ne réussira donc jamais à obtenir un morceau de curium métallique tant soit peu appréciable puisque son auto-échauffement provoque sa volatilisation immédiate.
La radio-activité intense des éléments transuraniens présente en outre l’inconvénient d’être extrêmement nocive. Plusieurs savants ayant manipulé des substances fortement radio-actives sans prendre les précautions indispensables ont succombé, victimes des graves maladies provoquées par les émissions radio-actives. De nos jours, la mort continue de frapper les habitants des villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki irradiés lors du bombardement atomique de 1945.
Aussi les chercheurs qui étudient les éléments transuraniens sont-ils obligés de prendre des précautions particulières.
En général, les préparations radio-actives d’éléments transuraniens sont placées derrière un écran en matière plastique protégeant des émissions radio-actives le visage et le corps du chercheur qui porte en outre des gants spéciaux.
Cependant de telles mesures ne sont efficaces que si la quantité de substance radio-active est infime ou si l’intensité des radiations de l’élément étudié est faible. Lorsqu’il s’agit de quantités plus grandes, on utilise des « manipulateurs », pinces ou tenailles aux formes diverses fixées à un long manche. De cette façon, le chercheur peut se tenir à distance respectable de la substance radio-active.
Mais lorsqu’il s’agit d’éléments aussi radioactifs que l’américium ou le curium, les pinces dirigées à la main sont inefficaces. Il est alors nécessaire d’utiliser des instruments télécommandés. Quoique ne possédant que deux doigts, les « mains » du manipulateur représenté sur le dessin, dont le plus adroit prestidigitateur envierait sans aucun doute la dextérité, sont capables d’exécuter les opérations les plus délicates.
Comme on le voit, les savants ont également réussi à surmonter la seconde difficulté. Mais un troisième obstacle, beaucoup plus sérieux, vient encore entraver l’étude des éléments transuraniens.
Auparavant la tâche essentielle dans l’étude des propriétés d’un élément nouveau consistait à extraire des quantités plus ou moins appréciables de composés de cet élément. Nous savons déjà de quelles doses infimes durent se contenter les chimistes en déterminant la valeur absolue de ces « quantités plus ou moins appréciables ».
Dans le cas des éléments transuraniens, le problème de l’extraction se trouve relégué au second plan. Avant d’extraire ces éléments, il faut d’abord les obtenir. L’obtention des premiers éléments transuraniens fut relativement aisée, mais ensuite les difficultés s’accrurent.
C’est ici qu’intervient une valeur appelée période de demi-désintégration. Nous avons déjà eu l’occasion de recourir à cette notion : il s’agit du temps que mettent à se désintégrer la moitié des atomes d’un élément radio-actif donné. Les premiers éléments transuraniens sont assez stables : la période de demi-désintégration du neptunium s’exprime en millions d’années et celle du curium en dizaines de milliers d’années. La variété de plutonium la plus stable a même une période de demi-désintégration de plusieurs dizaines de millions d’années. Mais pour les éléments suivants, cette durée diminue rapidement. Le berkélium ne met que sept mille ans à « mourir » à demi et le californium seulement 400. Ensuite la période de demi-désintégration est bien plus courte, environ 300 jours pour l’einsteinium, 20 heures pour le fermium et quelques minutes seulement pour le mendélévium.
Des jours, passe encore, mais des minutes… Les opérations nécessaires à l’obtention, puis l’extraction d’un élément demandent en effet un certain temps. Or, il était cette fois nécessaire, en moins d’une minute, d’isoler un élément, de le concentrer et d’en étudier les principales propriétés chimiques et physiques. Il ne pouvait certes en être question, quelle que fût la fiévreuse diligence déployée par l’expérimentateur.
« Mais quoi ! dira-t-on. Puisqu’il en est ainsi, il faut s’y résigner ! »
C’était justement l’attitude des chimistes auparavant. En présence d’un phénomène du genre de l’instabilité d’un composé, ils se contentaient d’étouffer un soupir de déception en s’en prenant à la Nature.
Mais quand il s’agit d’éléments transuraniens, les chimistes modernes peuvent-ils « s’en prendre à Dieu ? » Il y eut certes des soupirs de regret ! Mais, dans un tel cas le lyrisme n’entre pas en ligne de compte.
Lorsque parut la première communication concernant le mendélévium (élément 101), la plupart des chimistes avec lesquels j’eus alors l’occasion d’en discuter furent unanimes à penser qu’il devait s’y être glissé une coquille puisque l’article en question informait le lecteur que l’élément 101 avait été identifié comme possédant 17 atomes. Tout le monde était d’accord pour estimer qu’un typographe distrait avait dû oublier de mettre à la suite du chiffre 17 un dix à une puissance quelconque. Il aurait dû y avoir 17 • 108, à la rigueur, 17 • 106 atomes, bien que, cette dernière quantité parût en réalité invraisemblablement faible. Pourquoi ? Mais ne serait-ce que parce qu’un cm3 d’air contient trois milliards de fois plus d’atomes que 17 • 106. S’il était donc déjà bien difficile d’imaginer une quantité de matière ne contenant que 17 millions d’atomes, que dire alors d’une autre n’en possédant que dix-sept ! C’était tout simplement inconcevable. Et pourtant la communication ne contenait pas d’erreur et nous avions tort d’incriminer le typographe.
Ce furent les propriétés radio-actives du mendélévium qui permirent de déceler sa présence en quantité aussi infime dans la matière de la cible soumise à un bombardement afin d’obtenir le 101e élément. De même que la vitesse initiale d’un obus lancé par un canon à longue portée diffère de celle d’une balle tirée par un fusil de petit calibre, les particules alpha émises par les divers éléments radio-actifs ont des énergies diverses. En déterminant l’énergie des particules alpha, on peut identifier avec certitude l’élément radio-actif dont elles sont issues.
Quant à enregistrer la désintégration même d’un seul atome, la chose ne présente pas maintenant de difficultés. On possède actuellement des appareils très sensibles aux phénomènes de désintégration radio-active qui permettent d’identifier les particules radio-actives émises lors de la désintégration d’un atome et d’en déterminer l’énergie et la charge. C’est précisément avec de tels appareils qu’on a découvert que le bombardement d’einsteinium à l’aide de particules alpha donnait naissance à des atomes du 101e élément.
En essayant d’obtenir le 102e élément, les savants savaient déjà que sa période de demi-désintégration ne dépassait pas quelques minutes.
On décida d’abord de bombarder du curium par des noyaux de carbone (96 + 6). On produisit donc des quantités appréciables de curium aux Etats-Unis. La cible — une mince couche de curium sur une plaque d’aluminium — fut préparée en Angleterre et ensuite, avec d’infinies précautions, transportée en Suède à l’Institut Nobel où elle fut soumise à un bombardement de noyaux de carbone.
On ne tenta même pas d’isoler le 102e élément de la cible. On observa simplement qu’à la suite du bombardement la cible émit plusieurs particules alpha d’une énergie jusqu’alors inconnue et ce seul fait permit d’annoncer la création d’un nouvel élément qui fut appelé nobélium, du nom de l’institut où avait eu lieu l’expérience.
Reprise aux Etats-Unis, l’opération ne confirma pas les résultats obtenus par les expérimentateurs suédois. Après avoir failli le faire, on hésita à placer le symbole No dans la case 102, et, finalement, on y renonça, la question demeurant en suspens.
En 1957 des savants soviétiques tentèrent, à leur tour, d’obtenir le 102e élément. A l’issue d’expériences qui durèrent cinq ans on apprit que le laboratoire de Flérov à l’Institut Unifié des recherches nucléaires avait réussi à obtenir près de 1 000 atomes de cet élément, dont les caractéristiques chimiques correspondaient totalement à l’élément 102 de la classification périodique. Ces derniers temps les physiciens soviétiques ont obtenu par synthèse l’élément 104.
Puis la classification périodique accueillit un nouvel élément qui prit place dans la case 103 sous le nom de lawrencium.
Les savants de différents pays des divers continents partagent la même pensée et le même désir : faire reculer aussi loin que possible les limites de la classification périodique et élargir le domaine des connaissances humaines.
Tandis que vous lisez ces lignes, des chercheurs en blouse blanche se penchent sur de nombreux appareils en suivant avec attention leurs indications. L’un des chimistes adresse à voix basse quelques paroles à ses collègues, en secouant la tête d’un air désolé, inscrit quelques lignes dans un grand registre dont la couverture porte : 105e, puis, se tournant vers ses collaborateurs, leur dit : « Choisissons des conditions différentes… »
Ou peut-être, à cette minute même, la chance vient-t-elle de sourire à ces chercheurs et les aiguilles indiquant les résultats recherchés viennent-elles de révéler la découverte du 105e élément.
Peut-être ! Et si ce n’est à cette minute, ce sera demain, ou dans un mois.
Mais le 105e élément sera sans aucun doute obtenu.
Une nouvelle famille
Je suis prêt à parier qu’aucun de mes lecteurs ne pourra répondre correctement à la question que je vais poser, question qui semble pourtant bien simple : quel est l’élément le mieux connu actuellement ? Le fer ? Non. Le chlore ? Non ! L’oxygène ? Non !!! Le sodium ? Non plus !
Les propriétés chimiques les mieux connues sont celles du… plutonium.
La réponse est certes inattendue ! J’en ai moi-même été tout étonné. Il est en effet surprenant qu’un élément que nous connaissons depuis vingt ans seulement ait fait l’objet d’études plus poussées que le fer par exemple que l’humanité connaissait déjà à l’aube de son développement. Oui, le plutonium, dont je doute qu’on ait obtenu plus d’une tonne depuis sa découverte, est mieux connu également que le silicium dont les réserves dans l’écorce terrestre atteignent un chiffre astronomique.
A une certaine époque le problème de l’obtention du plutonium présenta tellement d’importance que des centaines de laboratoires dans divers pays s’évertuèrent à le résoudre. Les recherches s’effectuèrent avec une rapidité étonnante, furent menées avec fièvre. Pour pouvoir isoler le plutonium — et d’une façon aussi complète que possible — des produits de désintégration que contenaient les réacteurs atomiques, il fallait d’abord se livrer à une étude approfondie de ses propriétés et de celles de ses nombreux composés. Divers laboratoires s’y consacraient. A la suite de la publication des résultats d’une grande partie des recherches, on s’aperçut que de nombreux savants étaient parvenus à des conclusions identiques par des voies différentes par leur principe.
Ainsi, nul aspect chimique du plutonium n’échappa aux investigations des chercheurs.
Quoique l’obtention d’éléments artificiels fût déjà surprenante par elle-même, les résultats de l’étude des propriétés des premiers éléments transuraniens provoquèrent un étonnement extrême. On s’aperçut que tous ces éléments possédaient des propriétés chimiques semblables, pouvant notamment tous donner en solution aqueuse des sels avec des métaux trivalents.
D’autre part, de nombreux éléments transuraniens présentent une similitude extrême avec l’uranium : il serait trop long et bien fastidieux d’énumérer les faits qui l’attestent.
On peut se poser une autre question : en quoi cette similitude pouvait-elle étonner les chimistes ? Ils se ressemblent, soit, mais l’affirmer n’est pas encore répondre à la question.
Que le lecteur se donne la peine de masquer à l’aide d’une feuille de papier le groupe d’éléments désigné dans la classification périodique sous le nom d’actinides (la raison de cette appellation sera bientôt fournie). Le tableau de Mendéléev présente alors exactement l’aspect qu’il avait à la fin des années 40, à l’époque où l’on ne savait encore rien des éléments transuraniens artificiels. Représentons-nous la façon dont le chimiste se servait de ce tableau. Qu’aurait-il pu dire des propriétés de l’élément 93 qui n’existait pas encore ? Il aurait pu tenir à peu près le raisonnement suivant : « Si on découvre un jour l’élément 93 ou si on l’obtient artificiellement, il sera placé dans le septième groupe de la classification périodique, sous le rhénium. Le 93e élément doit donc posséder des propriétés semblables à celles du rhénium, tout comme celui-ci ressemble au technécium et au manganèse. »
Le même chimiste aurait pu prédire avec une égale assurance que le 94e élément serait proche de l’osmium, puisque sa case serait placée sous cet élément, dans le groupe 8.
Et pourtant rien de ceci ne s’avéra exact. Les éléments transuraniens ne sont nullement semblables à leurs analogues présumés. Par contre, ils se ressemblent entre eux sinon comme des jumeaux, du moins comme des frères. Or, ces éléments sont effectivement des frères, tant par leur naissance que par leur communauté d’esprit, si l’on peut dire, ou plutôt de propriétés chimiques.
Le lecteur a déjà remarqué sans doute que la case de l’élément 56 est suivie d’une autre contenant à elle seule les numéros allant de 57 à 71. Quinze éléments dans la même case!
Ou, pour être plus exact, 15 cases dans une seule. A quoi cela est-il dû ?
On sait que la couche externe des électrons de l’atome de tout élément de la classification périodique diffère de la couche correspondante de l’atome des éléments voisins. Ainsi la couche externe de l’atome de lithium possède un seul électron, le nombre d’électrons étant de deux dans le cas du béryllium et de trois dans celui du bore, etc.
C’est précisément de ce nombre d’électrons dans la couche externe que dépendent les propriétés chimiques d’un élément. Considérons par exemple le lanthane, premier membre de la famille des lanthanides comprenant les éléments qui lui sont similaires. La couche externe de l’atome de lanthane contient trois électrons, aussi est-il trivalent. Il semblerait que l’atome de l’élément suivant le lanthane, le cérium, contienne quatre électrons dans sa couche externe. Or, il n’en a que trois, comme le lanthane. Qu’est devenu ce quatrième électron ? Il se trouve dans l’une des couches internes. Il en est de même pour les lanthanides suivants. Tous, le praséodyme, le néodyme, le prométhium et jusqu’à l’élément 71 inclus, ont trois électrons dans la couche externe et ce sont les couches internes qui reçoivent les électrons supplémentaires. D’où la grande similitude des propriétés chimiques et physiques de ces 15 éléments.
Il en est de même pour les éléments qui suivent l’actinium. Dans le cas du thorium — voisin de l’actinium — c’est également non pas la couche externe mais l’une des couches internes qui reçoit les électrons supplémentaires. De même pour le protactinium, l’uranium et tous les éléments transuraniens obtenus à ce jour. Voilà pourquoi, suivant l’exemple des lanthanides, les éléments transuraniens forment la famille des actinides avec l’uranium, le protactinium et l’actinium. Ainsi, une seconde case multiple, comprenant les éléments 89 à 103 inclus, est apparue dans la classification périodique.
On peut déjà dire avec une certitude absolue que le dernier membre de la famille des actinides est le 103e élément, et que le 104e figure lans le IVe groupe du tableau périodique.
On peut même affirmer que la couche éléctronique de cet élément est similaire à celle du hafnium. Il n’est nullement besoin d’être prophète pour parvenir à une telle conclusion : il suffit de regarder la classification périodique.
Dans les laboratoires de la nature
Lorsque les propriétés des premiers éléments transuraniens furent connues, on comprit pourquoi on n’avait pas réussi à les trouver dans la nature. Les périodes de demi-désintégration, même des plus stables d’entre eux, sont tellement brèves par rapport à l’âge de notre planète qu’ils ont eu tout le temps de se désintégrer.
Si les savants acceptaient toutes les affirmations sans preuves, il est probable que nombre des remarquables découvertes dont notre époque est féconde n’auraient jamais eu lieu. Des questions se sont immédiatement présentées. D’abord, ne serait-il pas possible de découvrir les éléments transuraniens en dehors de notre planète, dans l’atmosphère des étoiles, puisque les particularités du spectre de ces éléments nous sont connues ? D’autre part, pourquoi certains des éléments transuraniens ne se formeraient-ils pas actuellement dans la nature, ne serait-ce qu’en quantités infimes ?
A propos de la première interrogation, rappelons une fois de plus l’extrême sensibilité des méthodes de recherche spectroscopiques qui permirent la découverte de l’hélium, d’abord sur le Soleil et ensuite sur la Terre. Or, la spectroscopie ne décela dans l’Univers aucune trace de plutonium ou d’autres éléments transuraniens. Les autres méthodes de recherche confirmèrent ce résultat négatif.
La réponse à cette première question nous vint de la source la plus inattendue. Ce furent les … historiens qui nous aidèrent à la trouver. La chimie, elle, a rendu bien des services aux historiens, aux archéologues surtout : tantôt pour déterminer la composition de quelque alliage très ancien, tantôt pour analyser une encre afin d’établir l’âge d’un manuscrit. Mais que les historiens aident les chimistes, cela ne s’était probablement encore jamais vu. La chose mérite d’être racontée en détail, d’autant plus qu’il faut remonter assez loin dans l’histoire.
Le 4 juillet 1054. Ce jour-là ou plutôt cette nuit-là, Ma Touan-lin, un astronome de l’observatoire du Grand Dragon à Pékin, avait pris place à son poste d’observation habituel sur la plate forme centrale. Il y passa un certain temps à observer soigneusement les étoiles et, s’assurant que leur position correspondait exactement à la normale, il se prépara à écrire dans un gros registre dans lequel il consignait ses calculs depuis de nombreuses années. Mais son pinceau ne parvint pas au flacon d’encre, sa main s’immobilisant à mi-chemin. Ma Touan-lin venait brusquement de remarquer, presque au zénith, une étoile assez brillante qui hier encore ne s’y trouvait pas. Il n’en était fait mention dans aucun des livres anciens dont le contenu était familier à Ma Touan-lin, car il était fort savant. Le jour suivant, l’étoile fit son apparition dans le ciel bien avant le coucher du soleil. Les rues étaient pleines de gens qui discutaient avec animation de cet événement sans précédent.
Dans ses notes, Ma Touan-lin nomma fort judicieusement cette étoile l’Invitée. De jour en jour la clarté de l’Invitée devenait plus intense. Deux mois plus tard elle brillait déjà d’un éclat plus vif que la Lune. Les enfants doués d’une vue perçante la distinguaient même en plein jour malgré les rayons du soleil. On peut maintenant aisément en déduire que si ces faits sont exacts (et il n’y a absolument aucune raison de mettre en doute la véracité des notes de Ma Touan-lin), la luminosité de la nouvelle étoile devait être de 600 millions de fois celle du soleil.
Toutefois, la nouvelle venue ne conserva son éclat que pendant deux mois environ, après quoi sa lueur pâlit rapidement. Six mois après elle ne se distinguait pas des autres étoiles et encore un an plus tard elle avait complètement disparu.
Lorsque les historiens découvrirent les notes du savant chinois, ceux qui manifestèrent le moins d’intérêt furent… les astronomes. Le phénomène décrit par Ma Touan-lin est en effet familier aux astronomes contemporains, les étoiles telles que celle qui fut jadis observée étant appelées supernovæ. La formation de nouvelles étoiles est relativement fréquente mais elles possèdent très rarement un éclat aussi intense que la supernova de 1054. Quand on dispose d’un télescope pour l’étude de la voûte céleste, la découverte d’une supernova est chose assez courante. Lorsqu’en 1948 un radiotélescope fut pointé vers l’endroit où apparut autrefois l’Invitée décrite par Ma Touan-lin, on s’aperçut qu’il s’en dégageait un flux intense d’ondes radio, fait particulièrement significatif…
Le lecteur impatient est sans doute sur le point de m’interrompre : « Pourquoi consacrez-vous une page entière à parler d’astronomes, d’historiens, de radio-astronomes sans mentionner le moindre chimiste ? » Que ce lecteur prenne patience ! Les chimistes vont bientôt faire leur apparition, il ne saurait en être autrement, car le puissant flux d’ondes radio venant de l’ancien emplacement de la supernova de 1054 les concerne tout particulièrement.
On sait que les ondes radio se dirigeant vers la Terre en provenance des espaces interplanétaires ont pour origine les brusques lueurs des novæ. On estime actuellement que ces lueurs sont dues à la formation et la désintégration d’éléments.
Le Soleil tire son énergie de la réaction de transformation de l’hydrogène en hélium. Mais c’est une étoile relativement jeune. Il existe dans les espaces cosmiques des étoiles plus anciennes dont une partie considérable de l’hydrogène a déjà « brûlé » et s’est transformée en hélium. Est-ce à dire qu’un tel astre soit en voie d’extinction ? Non ! Les noyaux des atomes d’hélium s’unissent pour former des atomes de carbone.
On a des raisons de croire que plus une étoile est âgée, plus les éléments qui la composent sont lourds. Mais il est évident que la transformation des éléments initiaux en éléments de plus en plus lourds ne saurait durer indéfiniment. A quel élément s’arrête donc ce processus ?
Les savants sont unanimes à penser que cet élément est… le californium. Les novæ possèdent en effet une particularité commune : la période de demi-extinction de leur éclat (à l’issue de laquelle l’intensité de cet éclat diminue de moitié) est d’environ 55 jours ce qui correspond presque exactement à la période de demi-désintégration du californium (de poids atomique 254).
Le processus du développement des éléments dans l’Univers se déroule ainsi : la continuelle augmentation du numéro d’ordre et du poids atomique des éléments dont une étoile est composée amène un accroissement de sa densité et une diminution de son éclat. Finalement, l’accumulation d’une grande quantité de californium dans la masse de l’étoile provoque une explosion atomique ; le californium et les autres éléments lourds se désintègrent en formant des éléments plus légers.
On peut donc considérer qu’il se forme au moins un élément transuranien dans les espaces cosmiques au cours des processus dont les étoiles sont le siège. Or, s’il y a formation de californium, il doit également y en avoir de curium et de plutonium, produits lors de la désintégration radio-active du californium.
Passons maintenant à la deuxième question : la formation dans la nature d’éléments transuraniens est-elle possible ?
A la suite de l’obtention des éléments transuraniens en laboratoire, on n’en continua pas moins de les rechercher dans les roches de l’écorce terrestre, et ce pour les raisons suivantes. Tout d’abord, les recherches n’étaient plus menées à l’aveuglette puisque les propriétés du neptunium par exemple, de même que celles du plutonium, étaient maintenant fort bien connues. D’autre part il s’agissait de savoir s’il pouvait se créer quelque part sur notre planète des conditions susceptibles de provoquer la formation de neptunium ou de plutonium à partir d’uranium.
Cette dernière supposition paraît absurde et pourtant ce fut elle qui se confirma la première. Plusieurs années avant la découverte du plutonium, on s’aperçut qu’au lieu de subir la désintégration radio-active générale (émission de particules alpha, bêta ou gamma) un certain nombre d’atomes d’uranium se scindaient littéralement en deux parties. Outre la formation d’éclats nucléaires, on observait alors également une émission de neutrons. Il est vrai que pour une désintégration de ce genre, il se produit plusieurs millions de désintégrations de type ordinaire.
Néanmoins, ce processus a toujours lieu. Ainsi donc, les neutrons indispensables à la transformation de l’uranium en neptunium, puis en plutonium proviennent de… l’uranium même.
D’autre part, il est possible que les rayons cosmiques détruisent les atomes de certains éléments en formant également des neutrons libres.
Toutes ces considérations servirent donc de base à la recherche du plutonium naturel dans les minerais d’uranium. Les premiers essais furent infructueux. Mais après avoir traité plusieurs kilos et même plusieurs tonnes de minerai d’uranium, on obtint enfin une réponse absolument nette : l’uranium naturel contenait bien du plutonium. Mais en quelle quantité ? A vrai dire on hésite à se servir du mot quantité en l’occurrence. En effet, le rapport entre le poids du plutonium et celui du minerai d’uranium est de 10–14. Pour mieux imaginer ce chiffre, indiquons que le rapport entre le nombre d’élèves dans une classe et celui de la population de notre planète est de l’ordre de 10–8, c’est-à-dire un million de fois plus élevé que le rapport plutonium-uranium dans le minerai de ce dernier.
En 1952 on analysa un échantillon de minerai d’uranium de poix en provenance du Congo pour déterminer s’il contenait du neptunium. Les opérations d’analyse furent tout aussi laborieuses que dans le cas précédent et le neptunium fut, évidemment, découvert. Nous disons « évidemment » car le maillon intermédiaire lors de la formation du plutonium à partir d’uranium est justement le neptunium. L’uranium s’avéra même contenir un peu plus de neptunium que de plutonium : une partie pour deux mille milliards de parties d’uranium.
Il est possible que les roches contiennent également d’autres éléments transuraniens en quantités infinitésimales. Ainsi, on suppose que le curium 247, dont la période de demi-désintégration est relativement longue — cent millions d’années environ — pourrait encore se trouver en quantités infimes dans l’écorce terrestre. Il s’y trouve alors très probablement en compagnie des lanthanides — éléments des terres rares — car les propriétés des actinides dont fait partie le curium, sont semblables à celles des éléments des terres rares. On a déjà calculé que si le curium accompagne les éléments des terres rares, il doit s’y trouver dans la proportion d’un atome pour 1015 atomes de lanthanides au minimum.
Bien entendu, la teneur des minerais d’uranium en plutonium et en neptunium est tellement faible qu’il ne saurait être question de les en extraire. Soulignons ce fait incontestable : les éléments transuraniens existent bien dans la nature.
Y a-t-il une limite au nombre des éléments ?
Je me proposais de commencer ce chapitre d’une tout autre façon. Je l’avais même déjà écrit. Appelez cela une coïncidence ou comme vous voudrez, mais trois jours plus tard, j’eus l’occasion de discuter pendant plusieurs heures de la question de savoir s’il existe une limite au nombre des éléments. J’avais été invité à participer à des débats consacrés à un nouveau roman de science-fiction, débats qui se déroulaient dans une bibliothèque pour la jeunesse où étaient rassemblés de nombreux enfants.
Le roman ressemblait à beaucoup d’autres. Il comprenait un professeur (à barbiche) qui appelait tout le monde « mon cher », un jeune savant licencié ès sciences (avec une mèche rebelle sur le front), disciple du professeur, et la jeune assistante de ce dernier. Evidemment, il y avait un peu d’amour, mais seulement pour la forme. Léonide était le personnage central, un jeune je-sais-tout déluré qui avait enfreint les injonctions de ses parents pour suivre le professeur et ses disciples dans une expédition géologique.
L’auteur obligeait l’expédition à traverser un incendie de forêt, lui faisait prendre un bon bain forcé dans un marais glacé, rencontrer un pangolin d’une espèce mystérieuse et, après des aventures plus ou moins heureuses, conduisait ses personnages à un lac étrange perdu dans des montagnes reculées. Ce lac paraissait tout à fait ordinaire mais à la place d’eau, il était plein d’un métal liquide inconnu. Et là commençait l’énigme. Ce métal était vingt fois plus lourd que le mercure (autrement dit sa densité devait être d’environ 260!); il ne formait de composés avec aucune matière connue. A chaud il s’opposait au passage du courant électrique, par contre à froid il devenait un conducteur parfait. Le jeune Léonide, qui avait eu la malencontreuse idée de se baigner dans le lac, était tombé gravement malade prouvant ainsi une fois de plus au lecteur à quel point il est répréhensible de désobéir aux grandes personnes.
Le vétilleux professeur qui, comme il sied aux professeurs de roman, savait tout, n’eut aucune peine à déterminer, sans l’aide du moindre appareil, que le métal inconnu était l’élément 150, mystérieusement conservé sur la Terre.
Le roman se terminait par un retour triomphal en avion, une noce, etc.
Je ne me rappelle plus ce que dirent les orateurs des mérites littéraires du livre, car il s’éleva très rapidement une discussion : l’auteur avait-il le droit de supposer l’existence sur notre Planète du 150e élément ? Lorsqu’on me posa la question, je répondis évasivement qu’un auteur de romans, surtout de science-fiction, était en droit de supposer tout ce qu’il voulait, mais que néanmoins il importait de faire une distinction entre l’imagination et la fiction pure et simple. On exigea de moi une réponse plus précise et on me demanda combien d’éléments nouveaux pouvaient encore être découverts. Je répondis à peu près ainsi :
D’après ce qu’on sait des éléments transuraniens déjà obtenus, il est évident que plus leur numéro d’ordre est élevé, plus leur période de demi-désintégration diminue rapidement. Rappelons que si la période de demi-désintégration du plutonium est de plusieurs dizaines de millions d’années, celle du 102e élément n’est que de quelques secondes.
D’autre part, il est important que chez les éléments transuraniens il se produise outre une désintégration radio-active — émission de particules alpha ou bêta —, une fission spontanée du noyau. Au cours de cette fission, au lieu d’émettre une particule alpha et bêta, le noyau se scinde en deux. Dans le cas d’éléments radioactifs naturels, la période de demi-désintégration de la fission spontanée est excessivement longue. Ainsi, pour le thorium, elle est de 1021 années (à titre de comparaison, indiquons que notre planète existe depuis environ 5 • 109 années). La période de demi-désintégration de la fission spontanée des éléments transuraniens est considérablement plus réduite. Pour le fermium, elle n’est que de 12 heures. On a cependant calculé que pour un certain nombre d’autres éléments suivant le 102e, la période de demi-désintégration de la fission spontanée devait être plus courte que la période de demi-désintégration ordinaire. Aussi existe-t-il une probabilité d’obtenir les éléments 103, 104 et peut-être 105.
Dans un avenir proche nous saurons s’il est possible d’obtenir les éléments à numéros d’ordre supérieurs.
Il faut néanmoins se garder d’en conclure que les recherches tendant à découvrir de nouveaux éléments artificiels touchent à leur fin. Au contraire, elles n’en sont qu’à leur début. Pourquoi ? Avant de répondre à cette question, il convient d’en poser une autre : quelle est la structure des atomes de tous les éléments du tableau de Mendéléev ?
« Curieuse question, penseront de nombreux lecteurs, chacun sait que tous les atomes comprennent un noyau à charge positive formé de protons et de neutrons autour duquel gravitent des électrons négatifs. »
Il en est certes effectivement ainsi. Mais cet arrangement est-il le seul possible ? Imaginons un atome dont le noyau, au lieu de contenir des protons à charge positive, serait formé d’antiprotons négatifs, et dont les électrons seraient remplacés par des particules positives de même masse. On sait d’ailleurs que des particules de ce genre existent. Considérons l’atome d’un antiélément. Quelles seront les propriétés d’un tel élément ? Qui osera les prédire ? ! Le fait est que, théoriquement, la création d’un tel élément est parfaitement possible.
Et que se passera-t-il si l’on remplace un ou plusieurs électrons des éléments « ordinaires » par des particules à charge négative plus lourdes que l’électron ? De telles particules sont également connues. Et quelles seront les propriétés d’un élément dans lequel une partie des protons du noyau aura été remplacée par d’autres particules à charge positive ?
Comme on le voit, nous avons déjà rassemblé une demi-page de questions, et non pas des questions oiseuses. Depuis plusieurs années elles sont cause de recherches théoriques et expérimentales. Cependant, pour l’instant, celles-ci n’ont pas eu grand résultat.
Ainsi, la science que nous appelions fort justement l’alchimie du XXe siècle n’en est encore qu’au début de sa glorieuse existence. Quant aux jeunes qui désireraient devenir alchimistes (sans guillemets), on peut leur garantir un travail plein de recherches passionnantes, comme dans toute activité véritablement scientifique.
DU GRAND DANS DU PETIT
Qu’y a-t-il de commun ?
Commençons par deux histoires.
Sur les cartes de visite d’Eugène O’Winstern, en lettres d’or, s’étalait le mot « négociant ». Les pilotes du port, parfaitement au courant de la véritable activité d’O’Winstern et peu habitués aux bonnes manières, l’appelaient « mercanti », terme quelque peu désobligeant mais certainement plus juste. Le même souci de justice nous conduit à ajouter qu’Eugène O’Winstern ne brillait pas par son intelligence. Il est vrai qu’il compensait cette lacune par son effronterie. C’était d’ailleurs la seule chose dont le « négociant » londonien disposât encore en 1937, car sa dernière opération, l’achat de blé canadien sur pied, lui avait coûté toute sa fortune.
Voilà pourquoi O’Winstern avait décidé de se rendre en Inde avec un chargement de machines-outils, comptant bien que leur vente lui permettrait de renflouer ses finances. Eugène ne comprenait pas grand-chose aux machines-outils mais il en savait encore moins sur l’Inde. A vrai dire, à part qu’on en importe des bananes et la malaria, le « négociant » ne connaissait rien de l’immense pays vers lequel il naviguait avec son chargement.
Il serait superflu de décrire les premières impressions d’Eugène O’Winstern en débarquant en Inde. Notre but en présentant ce personnage n’est certainement pas de familiariser le lecteur avec les bars et les bureaux de Bombay ; or, notre héros ne fréquentait aucun autre lieu. Aussi, allons-nous dire d’emblée ce qu’il vit dans la cour de la gare de marchandises de Delhi.
Le spectacle était désolant. Quand la petite équipe de débardeurs eut déchargé la première machine-outil d’un wagon, O’Winstern s’aperçut immédiatement que de toutes les fentes de la caisse s’échappait un liquide brun. Inquiet, le « négociant » donna immédiatement l’ordre d’ouvrir la caisse : seule l’épithète pitoyable peut qualifier ce qui s’offrit alors à sa vue.
Les machines-outils n’étaient plus qu’un amas de ferraille. La rouille formait sur les parties métalliques une couche tellement épaisse qu’on les aurait crues recouvertes de neige brune.
Eugène O’Winstern se précipita vers une des machines-outils, saisit une pièce mais celle-ci se détacha aussitôt et tomba à terre avec un bruit mat. Quand on eut déballé les vingt autres caisses, on put voir que l’état des autres machines n’était guère plus brillant.
Qui ou quoi blâmer ? L’ignorance crasse d’O’Winstern qui ne savait même pas que des objets métalliques destinés à un long transport devaient préalablement être enduits d’une épaisse couche de graisse ? Le chef du service des transports de marchandises par voie ferrée de l’Inde, par la faute duquel les machines-outils étaient restées deux mois à traîner dans le port de Bombay en attendant d’être expédiées sur Delhi ? L’air indien chaud et humide à en être gluant ?
Eh bien, non, l’infortuné « négociant » s’en prit plus directement à l’associé de son « négoce », c’est-à-dire à Dieu. Proférant à l’adresse du Seigneur des malédictions capables de frapper d’embolie le missionnaire le plus flegmatique, Eugène ne cessait de flâner à travers la ville en attendant que de la résidence du gouverneur lui parvienne la réponse dans lequel il sollicitait l’octroi d’une allocation de rapatriement.
Au cours d’une de ces promenades l’attention d’O’Winstern fut attirée par la célèbre colonne de Delhi. L’énorme obélisque, entouré de croyants, se dressait au centre d’une grande place. Pour passer le temps, Eugène se fraya un chemin parmi la foule des Hindous marmottant des prières sans fin et jeta un regard distrait sur la colonne. A force d’y appliquer leurs lèvres, les croyants avaient fini par en polir la base qui avait pris un ton mat, tandis que la partie supérieure était lisse comme une table d’apparat. O’Winstern posa son doigt sur la colonne… puis la frappa de la paume et… du poing. La colonne était en fer. Oui, il ne pouvait y avoir aucun doute là-dessus, elle était en fer ! Mais, comment diable le métal s’y conservait-il intact ?
Les Indiens avaient dû ajouter quelque chose à l’alliage ? Mais quoi ?
La réponse à cette dernière question, le « négociant » londonien tenta vainement de l’obtenir au cours de la semaine qui suivit. Mais quand il reçut sa modeste allocation et un billet pour un bateau en partance pour Londres quatre jours plus tard, Eugène se décida.
La nuit même, il se procura une scie à métaux et, tremblant de peur, scia un petit morceau de fer de la base de la colonne et le dissimula tout au fond de son sac de voyage. Il pensait qu’à Londres on ne manquerait pas de l’aider à découvrir en quoi était faite la colonne, quelle était la substance qu’on y avait ajoutée et qui empêchait le fer de rouiller !
Six semaines plus tard, O’Winstern expédiait le morceau de fer à un laboratoire londonien en vue d’analyse. L’échantillon était accompagné d’une lettre qu’Eugène rédigea en des termes dont l’astuce le surprit lui-même : il priait le laboratoire d’analyser un échantillon du fer qu’il se proposait d’utiliser pour son coffre-fort.
Lorsque, au lieu de l’analyse attendue, O’Winstern reçut une invitation à se présenter au laboratoire, il se tint sur ses gardes : évidemment on chercherait à savoir où il s’était procuré cet alliage remarquable ; mais on ne l’aurait pas, il garderait le silence.
Or, le chef du laboratoire, le professeur Hall, un homme chétif et portant lunettes, se confondit en excuses devant O’Winstern tout éberlué par cette amabilité inouïe et demanda à l’honorable gentleman où il s’était procuré un échantillon de fer d’une pureté aussi extraordinaire. Le professeur ajouta qu’il effectuait des analyses depuis déjà trente ans, mais que c’était la première fois qu’il avait affaire à un échantillon ne contenant pas la moindre impureté, le fer étant pur, ab-so-lu-ment pur.
Son espoir d’entreprendre la fabrication d’alliages capables de résister au climat humide de l’Inde ayant été réduit à néant, Eugène s’occupa d’achat et vente d’articles de contrebande, ce qui lui valut d’échouer rapidement en prison.
Quant au professeur Hall, il communiqua lors de l’une des séances du conseil de son institut les résultats de l’analyse d’un échantillon de fer d’origine inconnue dans lequel il n’avait pas réussi à trouver d’impuretés, ce fer étant pur, ab-so-lu-ment pur !
Dans les années vingt, au monastère de Kiévo-Pétchorskaïa Lavra, apparut un certain père Jonas. La renommée de ce moine au nom biblique et à la barbe vénérable s’étendit bientôt à tout Kiev et à de nombreuses lieues alentour. Ainsi que l’annonçaient en caractères ornés des avis affichés aux portes du monastère, le père Jonas soignait quotidiennement les fidèles atteints de « maux internes », à l’aide d’eau qu’il avait bénite de ses propres mains.
Les propriétés « médicinales » de cette eau attiraient des dizaines de malades et bientôt, aux heures de consultation du père Jonas, la cour du monastère vint à ressembler au célèbre marché bessarabien de Kiev aux heures d’affluence.
La publicité faite par les Saints pères attira au monastère même certains malades n’ayant encore jamais eu affaire à la religion.
Ce succès obligea la rédaction du journal komsomol à s’intéresser au nouveau guérisseur. C’est pourquoi, un jour d’avril, parmi les malades massés autour du monastère, se trouvait Nicolas Karlychev, un collaborateur du journal. Nicolas était venu là sans but défini. Il avait d’abord décidé d’observer simplement les malades et, par la même occasion, le faiseur de miracles. Mais quand le célèbre guérisseur eut fait son apparition parmi la foule, qu’il bénit d’un large geste de la main, Nicolas eut une idée : pourquoi ne se dirait-il pas malade lui aussi ? Ce qu’il fit sur-le-champ. Se courbant bien bas et gémissant exagérément, Karlychev prit place dans la longue file d’attente. En approchant du père Jonas, Nicolas, comme tout le monde, baisa, ou plutôt fit semblant de baiser, la main du faiseur de miracles, et après avoir reçu sa bénédiction et un petit flacon d’eau bénite, prit de nouveau place dans la colonne. Ce jour-là, Karlychev obtint trois flacons d’eau. Le lendemain il en obtint quatre et les jours suivants cinq encore. Il possédait donc maintenant 12 flacons d’« eau à propriétés curatives », soit un litre en tout.
Nicolas alla porter son butin au professeur Bobrychev, un célèbre spécialiste de Kiev des maladies internes. Le professeur examina l’eau « sacrée » à la lumière, la goûta et déclara catégoriquement qu’elle provenait du Dniepr et ne contenait rien d’autre de plus que la « grâce de Dieu ».
Tout ceci ne prit pas plus d’une demi-heure au professeur, mais Karlychev passa les trois heures suivantes à le convaincre d’essayer l’eau sur l’un de ses malades. Bobrychev refusait énergiquement, alléguant que l’absorption d’eau du Dniepr ne pouvait produire le moindre effet. Mais Nicolas insistait, désirant s’assurer le témoignage d’une aussi haute compétence que Bobrychev pour renforcer sa thèse sur l’entière inefficacité de l’eau sacrée. Après trois heures, Bobrychev, jetant un regard impatient sur sa montre, finit par donner son accord.
Trois semaines plus tard, Karlychev revint à la clinique de Bobrychev. Son article était déjà prêt. Les conclusions du professeur Bobrychev y tiendraient une place substantielle. Les Kiéviens ne manqueraient d’être impressionnés par le témoignage de Bobrychev. Quant aux conclusions du professeur, leur nature ne faisait aucun doute.
Le professeur reçut Nicolas dans son cabinet mais, à la différence de la fois précédente, au lieu de rester assis dans son fauteuil, il arpentait la pièce à pas rapides en fuyant le regard de Nicolas.
Il déclara au reporter d’une voix coupable qu’il avait fait l’essai de la « préparation », de « l’eau », corrigea-t-il, sur deux malades souffrant d’une vieille gastrite et sur un autre atteint d’une ulcère et dans les trois cas il avait constaté, non pas la guérison certes, mais une indéniable amélioration. Voilà. Après quoi le professeur eut un geste désabusé comme pour s’excuser, marmonna quelque chose sur les inexplicables mystères de la nature et laissa Nicolas seul, en proie à une extrême perplexité.
Une seconde analyse chimique effectuée cette fois avec un soin méticuleux confirma que l’eau était tout à fait identique à celle du Dniepr. Cependant l’analyse bactériologique révéla une absence de microbes presque absolue, mais cela pouvait être dû au fait qu’elle avait été bouillie.
Soudoyé, un servant du monastère se montra assez loquace. Il déclara qu’il apportait chaque jour neuf seaux d’eau dans la cellule du père Jonas. Celui-ci versait l’eau dans un grand baquet au fond duquel se trouvait « tout un tas » de pièces d’argent. Le servant n’en savait pas davantage.
L’article devant exposer la fraude du « saint guérisseur » ne put donc paraître à cette époque. Il ne fut publié que trois ans plus tard. Sa publication fut permise par certaines circonstances dont il sera question dans les chapitres suivants.
Voilà donc terminées les deux histoires que j’ai cru devoir présenter au lecteur. Je prévois deux questions tout à fait légitimes : pourquoi parle-t-on d’un trafiquant malchanceux et d’un saint imaginaire dans un livre consacré aux problèmes de la chimie moderne ; en supposant même que l’auteur les ait introduites simplement afin de distraire le lecteur, qu’y a-t-il de commun entre elles ?
Une substance pure . . . C’est difficile a obtenir
Le chapitre précédent concernait la chasse opiniâtre et inlassable dont les matières infinitésimales ont fait l’objet de la part des chimistes. Atome par atome, microgramme par microgramme, ceux-ci ont patiemment rassemblé des closes d’éléments chimiques excessivement réduites. Ces « chasseurs » savaient que les microgrammes de nouveaux éléments isolés par eux apporteraient à la chimie des « tonnes » de renseignements extrêmement précieux.
Dans ce qui suit nous aurons de nouveau affaire à des chimistes « chasseurs ». Et comme précédemment il sera question de chasse aux quantités de substance réduites et infiniment petites.
Mais dans le présent chapitre les « chasseurs » devront rechercher les quantités réduites de substances afin, non pas de les amasser, mais au contraire de les éliminer de la matière étudiée.
En procédant par ordre, il nous faut sans doute commencer par le chimiste Kohlrausch, célèbre savant allemand de la fin du siècle dernier. Il consacra plusieurs années de son activité scientifique à … la distillation incessante d’un vase à un autre de la même portion d’eau.
Au bout de quatre ans le directeur de l’institut où travaillait Kohlrausch hésitait à faire entrer ses invités dans le laboratoire du chercheur, sachant qu’il se trouverait toujours un plaisantin pour faire allusion à l’Académie des sciences de Laputa.
Mais les amateurs des Voyages de Gulliver avaient grand tort de faire assaut d’esprit. A la différence des savants de l’île volante de Laputa, Kohlrausch poursuivait des objectifs véritablement scientifiques : l’obtention d’une eau aussi pure que possible.
Mais la purification de l’eau est-elle chose si difficile qu’il soit nécessaire de lui consacrer plusieurs années ?
Prenons un exemple des plus ordinaires dans l’activité quotidienne du chercheur chimiste. Admettons que celui-ci ait besoin d’eau pure. Pas aussi pure sans doute que celle que cherchait à obtenir Kohlrausch et que finalement il obtint ! Simplement d’eau propre pour préparer une solution de quelque substance, de préférence libre d’impuretés.
Du robinet il fait couler dans une cornue de l’eau qui, à son point de vue de chimiste, est non seulement sale mais boueuse. Cette eau contient une grande quantité de divers sels de sodium, potassium, calcium et magnésium. Pendant son passage dans les tuyauteries, l’eau s’est également chargée d’une grande quantité de fer, imperceptible certes au palais de celui qui la boit mais largement suffisante pour que le chimiste puisse en détecter la présence à l’aide de sulfocyanate de potassium. La quantité de chlore ajoutée dans l’eau à la station de purification est suffisante pour que l’addition de quelques gouttes d’azotate d’argent lui donne un aspect laiteux révélant la précipitation de chlorure d’argent. En outre l’eau renferme une quantité considérable (toujours du point de vue du chimiste) de substances organiques : minuscules débris végétaux, bactéries, etc. L’eau du robinet contient en solution non pas une grande mais une énorme quantité d’air. On peut s’en assurer en observant un verre d’eau froide tirée du robinet : il se dépose sur les parois du verre un grand nombre de petites bulles d’air.
L’eau ne contient-elle pas également du gaz carbonique en solution ? Et du gaz sulfureux, que les eaux des rivières absorbent ne fût-ce qu’en quantité insignifiante en coulant à proximité de n’importe quelle usine utilisant le charbon comme combustible ? Et du phénol que le chef d’entreprise de quelque usine chimique a, par coupable négligence, fait déverser dans l’eau de la rivière quelque part en amont ? Bref, on peut dire que l’eau du robinet en question contient, outre de l’hydrogène et de l’oxygène, un bon tiers au moins des éléments de la classification périodique de Mendéléev. Quand bien même toutes ces impuretés seraient inoffensives pour l’homme buvant cette eau, elles gênent le chimiste. Aussi doit-il les éliminer.
Il commence par faire bouillir l’eau avec une solution alcaline de permanganate de potassium pour oxyder la plupart des substances organiques qu’elle contient. Puis il fait bouillir l’eau de nouveau avec une solution acide de permanganate, de façon à éliminer définitivement toutes les matières organiques. L’eau doit être ensuite distillée. On la débarrasse ainsi de la plupart de ses impuretés, c’est-à-dire des sels métalliques et d’une partie considérable de l’air. L’eau distillée ainsi obtenue est loin d’être pure : elle contient encore une quantité relativement importante d’air et presque tout son gaz carbonique. Comme toutes ces opérations s’effectuent dans des récipients de verre, l’eau renferme beaucoup de soude caustique et d’acide silicique en provenance du verre.
On fait à nouveau bouillir cette eau distillée pendant plusieurs heures pour éliminer au maximum les gaz qu’elle contient, y compris le chlore, puis on la verse dans un alambic. Cet appareil et le récipient destiné au distillât sont en platine, le réfrigérant où se condensent les vapeurs d’eau étant en étain. Ces métaux sont presque insolubles dans l’eau. Il convient de prendre des précautions pour éviter que l’eau n’entre en contact avec l’air, car elle absorberait alors à nouveau de l’oxygène, de l’azote et du gaz carbonique. L’eau ainsi obtenue est de l’eau dite bi-distillée. Assez ! Cette eau, le chimiste peut déjà s’en servir.
La lecture du processus de la purification de l’eau a sans doute pris plusieurs minutes au lecteur. On peut donc aisément se représenter le temps nécessaire à l’exécution de ces opérations.
Et cependant, l’eau obtenue par les procédés ci-dessus n’est pas tellement pure. Pour s’en assurer il suffit d’y plonger des électrodes reliées à une source de courant électrique. L’aiguille de l’appareil indiquera que le courant électrique passe, ce qui ne devait pas se produire puisque l’eau n’est pas un électrolyte. Donc, nous n’avons pas réussi à éliminer toutes les impuretés. Sans doute la conductance de notre eau n’est-elle pas très élevée, de l’ordre de 10–6 mhos. Kohlrausch, lui, qui avait effectué des opérations de purification beaucoup plus poussées, avait réussi à obtenir une conductance cent fois moindre : son eau était donc beaucoup plus pure. Mais il suffisait de la laisser pendant quelques minutes dans un récipient ouvert pour que sa conductance augmentât rapidement car il s’y dissolvait du gaz carbonique de l’air.
Ce que je viens de dire à propos de l’eau concerne également n’importe quelle autre substance, dans la plupart des cas les opérations de purification étant encore plus longues et plus minutieuses que pour l’eau.
Les substances absolument pures n’existent pas dans la nature. Tout composé quel qu’il soit contient toujours des quantités plus ou moins importantes de substances étrangères. En fonction du perfectionnement des méthodes d’analyse, les chimistes sont en mesure d’obtenir des renseignements de plus en plus détaillés sur la quantité des impuretés présentes dans la substance étudiée et sur leur nature. Mais les éliminer est chose plus difficile.
Il convient d’ajouter que cela est d’ailleurs souvent inutile. A quoi bon recourir à de subtiles opérations, dépenser beaucoup de temps et de coûteux réactifs chimiques pour la seule satisfaction de dire qu’on a obtenu un composé d’une pureté de 99,999 au lieu de 99,99. Une décimale de plus n’en vaut pas vraiment la peine en l’occurrence.
Aussi aucun chimiste n’a-t-il jusqu’à présent cherché à obtenir des substances absolument pures. A ce propos le moment est venu de raconter une histoire qui fit sensation parmi les chimistes.
C’est ainsi que surgissent les problèmes…
Après avoir écrit le mot « sensation », je me suis demandé si ce terme était bien exact pour qualifier la façon dont la découverte fut accueillie dans les publications parues à l’étranger dans les années 20. Apparemment, oui. De même que toute sensation, après avoir commencé par susciter une agitation d’ailleurs assez considérable dans les milieux scientifiques et pseudoscientifiques, cette découverte sombra dans l’oubli avec une inconcevable rapidité et vingt ans après on n’en trouvait pas la moindre mention même dans les manuels les plus complets. Pourquoi ? Peut-être parce que les faits décrits dans quelques courts articles parurent par trop invraisemblables aux chimistes des années 20. La réputation des sérieuses revues scientifiques publiant ces articles forçait le respect mais la pratique séculaire des physiciens et chimistes les contraignait à se demander s’il ne s’agissait pas d’une mystification. Tout bien considéré, d’éminents professeurs en venaient à la même conclusion évidente : c’était à n’y rien comprendre. Et comme il arrive souvent, plutôt que de chercher à élucider les causes de ces faits étonnants, on préféra les oublier.
S’il est bien difficile de purifier soigneusement une substance, la conserver dans cet état est encore plus malaisé. Des ennemis la guettent de tous côtés : il peut s’y mêler une goutte d’un composé étranger, de la cendre tombant de la pipe du chercheur, du vernis à ongle de son assistante, du pollen pénétrant par la fenêtre ouverte et de quantité d’autres substances de toutes sortes. Il est particulièrement difficile de préserver les substances pures du contact de l’air et de l’humidité atmosphérique. Car l’air pénètre partout, il n’y a pas moyen de lui échapper !
Voilà pourquoi les substances purifiées sont conservées dans des récipients hermétiquement clos.
C’est ce que fit le chimiste anglais Baker lorsqu’en 1908 il résolut de conserver, dans un tube de verre, de l’anhydride azotique, liquide qui bout à une température de +3°,5, en y ajoutant du pentoxyde de phosphore. En effet, lors de l’obtention de l’anhydride azotique l’expérimentateur y avait accidentellement mêlé une certaine quantité d’eau. Or, le pentoxyde de phosphore a pour l’eau une affinité exceptionnelle. Peu de composés sont aussi avides d’eau que cette poudre blanche.
Cinq années plus tard, Baker se rappela avoir rangé un tube hermétiquement clos contenant de l’anhydride azotique car il en avait alors justement besoin pour quelque expérience. Le procédé qu’utilisent habituellement les chimistes pour purifier un liquide est la distillation. Pour séparer l’anhydride azotique du pentoxyde de phosphore, Baker versa le liquide dans un alambic et se mit à le chauffer.
…Ce jour-là, les passants de Slough lane purent voir un homme d’un certain âge sortir de l’institut en discutant avec animation avec lui-même, le visage empreint de la plus profonde perplexité.
Baker avait certes toutes les raisons d’être étonné ! Pour commencer tout se déroula normalement : le matras contenant l’anhydride et le récipient destiné à recueillir le distillât furent placés dans de la glace. Puis Baker attendit que l’anhydride fût porté à ébullition sous l’action de la température ambiante. Dix minutes se passèrent, puis vingt, mais la distillation ne se produisait pas. Tout en parlant à son collaborateur, Baker jeta machinalement un coup d’œil sur le thermomètre immergé dans le liquide et s’arrêta au milieu d’une phrase. Le thermomètre indiquait 20°, c’est-à-dire exactement la température ambiante. D’après tous les ouvrages existants, l’anhydride azotique aurait dû bouillir depuis longtemps, or le liquide n’avait pas changé d’aspect. Haussant les épaules en réponse à la muette interrogation de son assistant, Baker commença à chauffer le matras avec précaution. Rien n’y fit : le liquide bleu ne bougeait toujours pas.
30°… 35°… 40°… La distillation ne commença qu’à 43°. En dépit de tous les manuels, l’anhydride azotique se mettait à bouillir à une température de 40° supérieure à la normale.
« Je me suis peut-être trompé de substance », pensa Baker. Il en fit donc l’analyse sur-le-champ et dut se rendre à l’évidence : c’était bien de l’anhydride azotique absolument pur, 100% pur ! On procéda de nouveau à la distillation : 43°. C’était invraisemblable !
A la table voisine, l’assistant, dont le regard revenait constamment au mystérieux matras, préparait fiévreusement de l’anhydride azotique à partir d’acide azotique. Par son aspect, le liquide bleu bientôt obtenu ne se distinguait en rien de celui que contenait le matras voisin. Quelle en serait la température d’ébullition ? Le thermomètre indiquait 3°,5. C’était exact. On effectua de nouveau la distillation du premier liquide : 43°.
Baker pria son assistant de fermer hermétiquement les récipients contenant les deux liquides, s’habilla et sortit. Il ne pouvait plus rester dans son laboratoire face à cette inquiétante énigme.
Pourquoi le chimiste anglais était-il aussi perplexe ? Ces quelques 40 degrés devaient-ils provoquer un trouble aussi profond ?
Certainement ! Car…
Les quantités constantes sont-elles constantes ?
… Car toute substance, ainsi que tout composé chimique, possède des propriétés physiques et chimiques bien définies.
Que l’on puise de l’eau dans l’Océan Indien, un marais boueux, la banquise ou une flaque d’eau, elle gèlera toujours à 0° et se mettra à bouillir à 100°, quelle que soit son origine.
Le benzène extrait de la houille par distillation ne se distingue en rien du benzène synthétique, obtenu à partir de l’acétylène par exemple.
Je ne sais si l’on peut même employer le terme d’axiome pour qualifier le fait suivant, tellement il est évident : un composé chimique donné possède une température d’ébullition constante, un point de fusion constant, une densité constante, etc. D’ailleurs cette règle sert de base aux procédés utilisés pour éliminer les impuretés des substances. Si l’on veut obtenir de l’acide acétique pur, par exemple, on en élimine les impuretés jusqu’à ce que la température de fusion atteigne 16°,6. Le chercheur peut alors être certain d’avoir de l’acide acétique pur. Si, en distillant une substance quelconque, le chimiste s’aperçoit qu’à pression atmosphérique normale elle bout à 110°,8 par exemple, il peut être sûr qu’il s’agit du toluène.
Or, voici que l’axiome devenait théorème. Le fait qu’à tout corps correspondent des propriétés bien définies restait encore à démontrer.
Il existe toute une série de substances dont les chimistes se servent presque quotidiennement en laboratoire. Leurs températures d’ébullition et de fusion ont été déterminées avec un soin tout particulier. Jetez un coup d’œil dans le manuel le plus succinct, vous y trouverez les données suivantes : le benzène bout à 80°, l’alcool à 78°,4, le brome à 59°, l’éther diéthylique à 35°.
Bref, les constantes physiques de ces corps sont fort bien connues. Aussi est-ce par eux que Baker décida de commencer la série d’expériences suivante.
Expérience sur quoi ? Le chercheur aurait-il réussi à comprendre la raison d’un aussi invraisemblable comportement de l’anhydride azotique ?
Non, pas encore, mais on se doutait de quelque chose et on suspectait l’eau d’être « coupable ».
Le lecteur sait maintenant ce qu’il en coûte au chimiste pour obtenir un corps pur. Il est évident que plus une substance est pure, plus elle est difficile à obtenir. On peut soigneusement éliminer les impuretés inorganiques d’un corps organique. Il est beaucoup plus malaisé mais cependant possible de faire de même pour toutes les impuretés organiques. Mais comment éliminer l’air et surtout la vapeur d’eau que ce corps contient ?
Lorsqu’il tenta de purifier du benzène, du brome, du bisulfure de carbone, de l’alcool et d’autres substances, Baker savait donc déjà qu’il ne parviendrait pas à en éliminer les infimes traces d’eau en provenance de l’air.
La raison majeure était que tous les composés chimiques décrits jusqu’alors, quelle que soit leur pureté, contenaient nécessairement une certaine quantité d’eau si infime fût-elle. Le but de l’expérience était d’obtenir plusieurs corps absolument purs. A cet effet, à des liquides soigneusement purifiés par les procédés habituels on ajouta du pentoxide de phosphore et le tout, versé dans des tubes de verre hermétiquement clos, fut mis de côté dans un placard du laboratoire.
La première inscription du registre de l’expérience date du 27 novembre 1913 et les suivantes de janvier… mars… juin… 1914. Puis elles furent interrompues.
La première guerre mondiale venait de commencer. En ces temps troublés, Baker ne pensait plus à ses tubes de verre. Les gouvernements impérialistes exigeaient des chimistes de nouvelles formules d’explosifs et de gaz de combat mortels. Voilà pourquoi Baker ne retrouva ses tubes que neuf ans après les avoir hermétiquement fermés et rangés.
Questions, questions…
Les tubes ne furent débouchés qu’en 1922. On prit des précautions exceptionnelles pour empêcher la moindre pénétration d’humidité : les récipients furent soigneusement séchés et les extrémités des tubes brisées dans du mercure.
Les résultats dépassèrent les espérances les plus optimistes.
On commença par distiller du benzène. Comme on le sait, le benzène « ordinaire » bout à 80°, mais celui obtenu par Baker ne bouillait qu’à 106°. Après cela on n’eut guère le loisir de s’étonner car Baker et ses collaborateurs ne cessèrent d’inscrire sur le registre du laboratoire de nouveaux faits surprenants : la température d’ébullition de l’éther atteignait 83° au lieu de 35°, celle du brome 118° au lieu de 59°, du mercure 459° au lieu de 357°, du bisulfure de carbone 80° au lieu de 46°, de l’alcool 138° au lieu de 78°,4.
Des résultats similaires furent obtenus avec d’autres liquides soumis à une déshydratation prolongée. Les recherches portèrent sur onze substances en tout.
Lorsque, plusieurs jours plus tard, ces faits nouveaux furent communiqués par Baker à ses collègues du monde scientifique, ils y furent accueillis de façons très diverses : certains s’esclaffèrent tant ces nouvelles leur parurent absurdes, d’autres prirent un air entendu, haussant les épaules dès que Baker s’éloignait d’eux, d’autres encore, les plus « perspicaces », dirent au savant :
— Vous me surprenez, mon cher collègue ! Ne voyez-vous pas que vous êtes en présence d’un phénomène de surchauffe tout à fait ordinaire au cours duquel une substance très pure peut se maintenir quelque temps à l’état liquide au-dessus de sa température d’ébullition ?
— Il ne peut être question de surchauffe, messieurs, rétorquait Baker. Primo, le fond du matras contenant la substance à distiller était garni de morceaux de porcelaine poreuse ce qui, comme on le sait, élimine toute possibilité de surchauffe. Secundo, quelle est la nature de l’ébullition dans un cas de surchauffe : le liquide ne change pas d’aspect tant que la température d’ébullition n’a pas été dépassée de plusieurs degrés puis il se met à bouillir d’un seul coup avec une intensité considérable, le contenu du matras tout entier formant une écume abondante. Dans mes expériences, mes chers collègues, l’ébullition a été tout à fait modérée, et la distillation également. En outre, n’oubliez pas que la surchauffe ne dépasse généralement pas trois ou quatre degrés, dix au maximum, alors qu’ici on a affaire à soixante-dix ou même quatre-vingt degrés ! Non, messieurs, il ne s’agit pas de surchauffe !
Ces « messieurs » voyaient d’eux-mêmes qu’il ne pouvait effectivement être question de surchauffe. Ceci mettait généralement fin aux discussions scientifiques et l’on passait à des thèmes de conversation plus ordinaires.
Ainsi donc, on se trouvait en présence d’une nouvelle et remarquable découverte scientifique et tout aurait été très bien, parfait même si… Baker avait lui-même compris la raison pour laquelle la déshydratation prolongée d’une substance avait des conséquences aussi surprenantes et incompatibles avec les notions scientifiques courantes.
Pour couronner le tout, de nouveaux faits furent découverts quelques jours plus tard. On s’aperçut que les substances soumises à une déshydratation prolongée changeaient également de température de fusion. Le souffre octaédrique fondait à 117°,5 au lieu de 112°,8, l’iode à 116e au lieu de 114°. Les températures de congélation des liquides s’élevaient et pour le brome et le benzène elles étaient respectivement de 2°,8 et 0°,6 supérieures à la « normale ».
Comme on le voit, il y avait là de quoi être troublé. D’une part, il y avait l’énorme masse de faits accumulés par de nombreuses générations de milliers de chimistes ; d’autre part, un fait absolument patent qui avait été observé et reproduit plus d’une fois en laboratoire. Que fallait-il donc croire ? Chaque corps possède-t-il effectivement des propriétés bien définies ? D’ailleurs, si une substance soumise à dessiccation contient une certaine humidité il ne s’agit plus d’une substance isolée. Mais pourquoi tous les chercheurs avaient-ils toujours obtenu lès mêmes valeurs pour les propriétés du benzène par exemple, et que seule une dessiccation d’une durée de plusieurs années entraînait un changement de propriétés ? Les questions ne manquaient pas…
Il convient de se pencher sur tous ces faits d’une façon systématique et de voir ce qu’il y a de clair.
Pas grand-chose à vrai dire. Il est indéniable que les phénomènes décrits plus haut sont dus à l’élimination d’humidité, puisqu’ils sont produits par le pentoxyde de phosphore ou d’autres substances du même genre possédant une grande avidité pour l’eau. Ceci est attesté par le fait suivant : si on laisse les substances déshydratées au contact de l’air, ne fût-ce que pour cinq minutes, leur température d’ébullition se met à décroître rapidement pour revenir à la normale (est-elle vraiment normale, peut-être la température la plus élevée est normale ?…). Cela est dû à l’absorption rapide par ces liquides de l’humidité de l’air, car si les liquides déshydratés sont placés dans une atmosphère privée d’eau, ils conservent leurs propriétés.
En outre, on voit maintenant la raison pour laquelle le phénomène appelé par Baker « effet de dessiccation » dépendait d’une déshydratation aussi prolongée (cinq, voire neuf ans !). D’après l’une des plus importantes lois de la chimie, la loi d’action de masse, la vitesse d’une réaction chimique est proportionnelle à la concentration des réactifs.
Quelle pouvait donc être la concentration initiale d’eau dans le benzène mélangé à du pentoxyde de phosphore ? C’est difficile à préciser, mais guère plus d’un millième pour cent. La dessiccation provoquait une diminution de cette quantité, rapide pour commencer, puis de plus en plus lente, le pourcentage tombant successivement à un millionième pour cent, un dix millionième, un cent millionième… Il s’ensuivait un ralentissement de la réaction entre le pentoxyde de phosphore et l’eau contenue dans le benzène. Un cent millionième pour cent… L’introduction d’une quantité aussi infime dans le produit déterminant la vitesse de la déshydratation donne un résultat évidemment très faible.
Voilà pourquoi des années sont nécessaires à la déshydratation complète du benzène et d’autres liquides.
Ainsi, certains aspects des phénomènes observés par Baker devenaient compréhensibles ou presque. Mais toutes les questions énumérées précédemment restaient sans réponses. Le plus grave était qu’on ne savait pas du tout de quel côté il convenait de les chercher.
C’est alors qu’on se mit à parler de « sensation ». Pour qu’il y ait sensation, il n’est pas indispensable que les journaux portent d’énormes manchettes et que les vendeurs s’égosillent à tous les coins de rues. La sensation peut prendre la forme de questions posées par les auditeurs d’un exposé scientifique étonnés, de chuchotements significatifs de la part des collègues, du ton particulièrement nerveux des articles consacrés à la découverte sensationnelle en question. A vrai dire, des circonstances même aussi exceptionnelles ne justifiaient pas tant d’émoi.
Dans les établissements où s’imprimaient les sévères revues scientifiques, celles qui ouvraient leurs colonnes à la polémique soulevée autour de la découverte de Baker appartenaient précisément à cette catégorie, le caractère typographique le moins employé était sans doute jusqu’ici le point d’exclamation car il n’est pas de bon ton de se laisser aller à l’émotion dans des écrits scientifiques. Le lecteur peut consulter n’importe quel tome des comptes rendus de la Société de chimie britannique, qui publia en son temps les principaux articles de Baker, la collection 1928 par exemple. Je suis absolument certain qu’il aura beau chercher, il ne trouvera pas un seul point d’exclamation dans cette volumineuse collection pesant dans les cinq kilos. Aussi peut-on aisément imaginer la consternation des ouvriers typographes chargés de la composition des articles consacrés à la discussion de « l’effet de dessiccation ». Les pages de certains d’entre eux fourmillaient littéralement de points d’exclamation. Les pauvres typographes ne savaient plus où se procurer en nombre suffisant ces caractères devenus soudain si précieux.
Un auteur particulièrement expansif crut devoir terminer son article par un mot signifiant « délire », ou quelque chose d’approchant, suivi de quatre points d’exclamation !
Personnellement, je n’ai pas eu l’occasion depuis de retrouver dans des revues scientifiques d’autres articles contenant des jugements et des épithètes aussi catégoriques et définitifs que « supergénial » et « superficiel », « génie » et « médiocre », « sagacité » et « spéculation », etc.
Il est bien compréhensible que les résultats des expériences de Baker aient provoqué un étonnement et une polémique aussi intenses parmi les savants des années 20. Même actuellement, plus de quarante ans après cette découverte, le lecteur se demande sans doute pourquoi la présence d’une insignifiante quantité d’eau exerce une influence aussi magique.
On comprend également pourquoi cette découverte causa une telle sensation et pourquoi elle fut si vite oubliée. En effet, peu de chimistes se hasardèrent à répéter ces expériences : il en faut de la patience pour mener à bien des recherches nécessitant neuf ans ! Mais les chimistes sont légion. Aussi se trouva-t-il tout de même des enthousiastes qui, tranquillement et sans fougue polémique, tentèrent de vérifier les données expérimentales du savant anglais.
Quelques années plus tard…
Quelques années plus tard, un certain nombre de travaux consacrés à « l’effet de dessiccation » firent leur apparition dans l’immense océan des écrits de chimie. Certains détails furent précisés ; or, dans la science il n’est rien d’aussi important que les détails !
Comme il aurait été plutôt ennuyeux d’attendre plusieurs années avant d’obtenir le mystérieux effet provoqué par une dessiccation complète, le chimiste d’Amsterdam Smits s’efforça de réduire ce délai. Il fallait que la substance initiale à déshydrater contienne déjà le moins d’eau possible. Smits établit que la majeure partie de l’eau se trouvant dans la substance à déshydrater provenait des microscopiques tubes capillaires dans le verre des récipients renfermant ces liquides. Les méthodes de déshydratation habituelles sont incapables d’éliminer l’eau de ces tubes capillaires, aussi Smits consacra-t-il un certain nombre d’articles à décrire un subtil procédé permettant d’éliminer les tubes capillaires du verre des récipients et de pomper l’air contenant l’eau d’évaporation. Les efforts des expérimentateurs furent couronnés de succès : ils réussirent à réduire sensiblement la quantité d’eau présente dans la substance à déshydrater. On ne sait pas exactement de combien : à l’époque les chimistes n’en étaient qu’à la sixième décimale et ne pouvaient donc mesurer des quantités d’eau aussi infimes. Mais l’important c’est qu’ils étaient parvenus à réduire la durée nécessaire à l’obtention de « l’effet de dessiccation » à un an et même, dans certains cas, à neuf mois.
Un autre chimiste, Meili, prouva que le temps nécessaire à la déshydratation pouvait être considérablement réduit si on conservait à une température élevée les récipients hermétiquement clos contenant les substances en contact avec du pentoxide de phosphore. L’idée était excellente puisque, comme on le sait, une élévation de température accélère les réactions chimiques.
Tels sont donc les deux petits courants de travaux consacrés aux substances extra-pures que j’ai réussi à découvrir dans le vaste océan des écrits de chimie de l’époque. Ces deux courants persistèrent pendant quelque temps puis disparurent. Il n’en subsista que trois ou quatre articles. Des expériences aussi longues avaient probablement fini par lasser même les plus enthousiastes.
Survint une pause d’une certaine durée. Puis en 1924 parut enfin un nouvel article consacré aux substances extra-pures ! Il était signé du même Smits. L’« effet de dessiccation » possède indéniablement la faculté de rendre les savants lyriques. En consultant cet article on a la sensation d’être en présence d’un journal intime. Oui, un journal intime dans un registre de travaux de chimie, avec des dates et même des heures. Un journal où l’auteur transcrit les émotions qu’il a ressenties à l’occasion de ses expériences, parle de ses déceptions et de ses joies.
L’article est consacré au problème suivant : la température d’ébullition des liquides soumis à la déshydratation s’élève-t-elle d’un seul coup, d’un bond, ou bien graduellement, à mesure qu’on élimine l’humidité ?
On prit du benzène soigneusement purifié. La description de sa déshydratation, même dans le langage sobre et précis des chimistes, occupe près de deux pages et nous la laisserons de côté. Au début de l’expérience la température d’ébullition du benzène, comme tous les benzènes du monde entier, était de 80°. Le 2 juin 1923 le liquide fut versé dans un appareil spécial qui fut ensuite hermétiquement clos et dans lequel la distillation s’effectuait d’un vase à un autre en l’absence d’air, le liquide étant constamment en contact avec du pentoxyde de phosphore.
Le 25 août la température d’ébullition du benzène atteignait déjà 81°,5 et le 23 février 1924 (près de neuf mois après le début de la déshydratation), 87°. Tout se déroulait on ne peut mieux. Mais ce jour-là il se produisit un événement fâcheux : l’expérimentateur laissa malencontreusement choir sa pipe sur le matras, et bien que ce ne fût pas l’une de ces énormes pipes de marin dont se servaient à l’occasion les matelots ivres pour se briser mutuellement le crâne dans les cabarets d’Amsterdam, mais une simple pipe de bruyère, le matras contenant le benzène n’en fut pas moins fêlé. La fêlure était à peine visible et elle fut d’ailleurs rapidement obstruée, mais ces quelques minutes suffirent pour qu’une infime quantité d’air humide pénétrât dans le matras. L’expérience subissait un contretemps : le thermomètre indiquait à nouveau 80°.
Cependant, les recherches se poursuivirent. Un mois après le jour néfaste, la température d’ébullition du benzène s’était déjà élevée d’un degré et demi. Un mois plus tard elle avait encore monte de trois degrés, pour finalement, un an après, atteindre l’intervalle 86°,6 et 87°,7. L’expérience fut alors interrompue bien que sa continuation eût permis de faire monter la température d’ébullition du benzène jusqu’à 106°, c’est-à-dire la température atteinte par Baker, et peut-être même davantage.
Nous ne devons pas oublier le problème qui tourmentait Baker et ses quelques continuateurs : pourquoi la présence d’une quantité d’eau infime au point de ne pouvoir être exprimée par un chiffre si petit soit-il exerçait-elle une influence aussi étonnante sur les propriétés des substances ?
Toutes les expériences dépendaient plus ou moins de la solution de ce problème. Mais les années passaient et les chercheurs n’en savaient pas plus sur ce point qu’en 1913, année de la découverte de « l’effet de dessiccation ». La seule différence était qu’à présent l’étonnement s’était un peu émoussé.
Cependant, après que les chercheurs eurent gravi quelques gradins de plus, lorsque plusieurs articles supplémentaires parurent, on commença à entrevoir la solution de l’énigme.
Encore quelques gradins
Dans l’un de ses aphorismes, Kozma Proutkov [3] affirme qu’il est utile d’observer les ondes concentriques qui se forment à la surface de l’eau lorsqu’on y jette une pierre. Je ne saurais dire exactement quelle utilité le spirituel personnage imaginaire y trouvait, mais je puis confirmer que, dans une situation similaire, un chercheur sut tirer des conclusions bien intéressantes. Sans doute observa-t-il non pas des ondes concentriques mais les bulles montant à la surface d’un liquide soumis à ébullition. Le fait important, en l’occurrence, c’est qu’il ne s’agissait pas d’un liquide ordinaire mais d’hexane (carbure saturé С6Н14) qui avait été soumis à une déshydratation de plusieurs années.
La température d’ébullition de cet hexane extra-sec et extra-pur était de 82°, celle de l’hexane « ordinaire » étant 69°. Cette différence de température ne causa aucune surprise car le fait était déjà bien connu. Ce fut le processus même de l’ébullition et de la distillation qui étonna.
L’ébullition et la distillation des liquides ordinaires se déroulent d’une façon très simple et parfaitement claire : la température de tout le volume du liquide s’élève d’abord lentement puis, à une certaine température (température d’ébullition), commence sa distillation qui se poursuit d’ailleurs exactement à cette température d’ébullition jusqu’à la disparition complète de la substance.
Pour les substances extra-pures, les choses se passaient bien différemment. L’hexane, par exemple : les premiers signes d’ébullition se manifestèrent à 79°, mais, bien que le liquide fût déjà en ébullition, sa température continua à monter lentement jusqu’à 82° et c’est à cette dernière que se distilla la plus grande partie de l’hexane.
Une ébullition de ce genre, dans un intervalle de températures plus ou moins large, s’observe lorsque l’on chauffe un mélange de liquides. Donc… l’hexane soumis à la distillation était également un mélange de liquides ? Mais il était absolument évident que le matras utilisé pour la distillation contenait de l’hexane excessivement pur, d’un degré de pureté jamais encore obtenu !
Or, tous les liquides extra-purs se comportaient de la même façon. Ils commençaient à bouillir non pas à une température bien précise mais dans un intervalle de températures plus ou moins large. Fallait-il en conclure que cet hexane extra-pur était en réalité un mélange d’hexanes ? C’était à nouveau l’impasse !
De plus, d’autres faits bien curieux furent découverts. On s’aperçut par exemple que les substances soumises à une déshydratation méticuleuse et prolongée subissaient d’autres changements que ceux de leurs températures d’ébullition et de fusion, changements qui affectaient la presque totalité de leurs propriétés physiques : indice de réfraction, tension superficielle, chaleur d’évaporation, etc.
Est-il nécessaire de dire que les nouveaux faits ajoutèrent beaucoup de points d’interrogation nouveaux à ceux que soulevait déjà ce problème ?
L’expérience suivante dans le domaine de « l’effet de dessiccation » permit aux chimistes de pousser un premier soupir de soulagement.
On détermina la densité de vapeur des substances soumises à une déshydratation prolongée. Or, connaissant cette densité, il ne faut pas plus de deux minutes à n’importe quel élève de seconde pour déterminer le poids moléculaire de la substance à l’état de vapeur. Ces calculs révélèrent que dans tous les cas les poids moléculaires des liquides extra-purs dépassaient les valeurs théoriques. C’est ainsi que pour le poids moléculaire de l’éther (С2Н5)2О on obtint 170. Or, la somme des poids atomiques de tous les atomes d’une molécule d’éther est 12 X 4 + + 10+ 16 = 74. Il s’ensuit donc que les molécules d’éther se rassemblent par groupes de deux ou trois molécules.
On observa des résultats similaires avec d’autres substances : le poids moléculaire obtenu pour l’alcool méthylique était presque le triple de la valeur théorique, ceux du brome, du benzène et du tétrachlorure de carbone d’une fois et demie supérieurs, celui de l’hexane de deux fois, du bisulfure de carbone de 2,7 fois, etc.
Ainsi donc, à l’état de vapeur toutes les substances déshydratées et extrêmement pures se présentent sous la forme de groupes de molécules ou, comme on dit, en association. Les dimensions de ces groupes à l’état liquide devaient évidemment être encore plus grandes.
On comprit alors pourquoi la température d’ébullition de ces liquides différait de celle des liquides ordinaires. Il était évident que l’énergie nécessaire au détachement d’une molécule à poids moléculaire élevé devait être plus forte que dans le cas de molécules à poids moléculaire réduit ce qui explique l’élévation de la température d’ébullition.
Ainsi tout paraissait être rentré dans l’ordre ; on tenait la clef de toutes les énigmes : les molécules des substances extrêmement pures s’assemblent par groupes et c’est la seule chose qui les distingue des substances simplement pures.
Mais en réalité c’était justement maintenant que les choses devenaient obscures. Le phénomène d’association est assez répandu. On connaît en chimie une énorme quantité de substances se présentant sous forme d’association à l’état liquide ou gazeux. Le poids moléculaire de la vapeur d’acide acétique, par exemple, est de 120, alors que le poids moléculaire théorique de ce corps (CH3COOH) est de 60. Donc, à l’état de vapeur, les molécules de l’acide acétique sont groupées par paires.
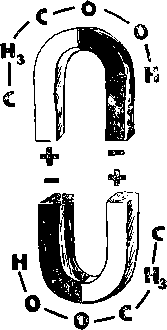
Toutes les substances pouvant ainsi s’associer possèdent la propriété suivante : la charge positive de leur molécule est concentrée dans une partie et la charge négative dans une autre. Il suffit de regarder le dessin pour comprendre pourquoi les molécules d’acide acétique tendent à s’unir entre elles. Le pôle positif d’une molécule attire le pôle négatif d’une autre. A l’état liquide, quand les distances entre les molécules sont plus réduites qu’à l’état gazeux, les groupes peuvent être plus grands et comprendre quatre ou six molécules, ou même davantage.
Du moment que l’association se produit lorsque des molécules possèdent une charge électrique double, un moment dipolaire [4] comme l’appellent les savants, il semble bien que l’absence de ce moment dipolaire doive exclure toute possibilité d’association.
Ainsi donc, le phénomène d’association n’a rien par lui-même d’étonnant et sa cause s’explique aisément. Retenons seulement que seules les molécules à charge électrique double, c’est-à-dire dipolaires, sont capables d’association.
Mais ce qui était clair pour les substances « ordinaires » ne l’était plus lorsqu’il s’agissait de liquides extra-purs, obscurcissant davantage les perspectives pourtant déjà assez sombres de la solution de l’énigme. Le fait est que la plupart des liquides utilisés pour l’étude de « l’effet de dessiccation » (il y en avait 11 en tout) avaient des molécules privées de moment dipolaire. Mais à l’état pur « ordinaire » la vapeur des composés même à molécules dipolaires, alcool et éther, possède une densité ordinaire correspondant au poids moléculaire normal.
Ainsi donc la réponse à une question en fait surgir au moins deux autres. Primo, pourquoi est-ce justement l’eau qui, en quantité infinitésimale, exerce une influence énorme sur les propriétés des substances ? Secundo, qu’est-ce qui pousse les molécules des substances même non dipolaires à s’associer en dépit de toutes les lois physiques et chimiques connues ?
Tel est le destin des savants. Ils ne pourront jamais dire : « C’est tout, dans ce domaine il n’y a plus rien à étudier. » Un problème résolu crée des dizaines de nouveaux problèmes qui exigent également une solution.
Pourquoi l’eau ?
Cette question, que posèrent les chercheurs lorsqu’ils abordèrent l’étude des propriétés des liquides extra-purs, les désolait. Ce qui leur faisait peur, c’était l’incertitude totale : de quel côté fallait-il s’intéresser à l’eau pour y répondre ?
Il était évident que par l’une de ses propriétés l’eau se distinguait nettement des autres liquides. Mais quelle était-elle ? Quand on n’a pas d’autre moyen à sa disposition pour résoudre tel ou tel problème scientifique, la supposition peut parfois servir de méthode de recherche.
Quelle était donc cette propriété ? Peut-être la viscosité, ou bien la densité ? Non, des centaines de substances possèdent ces caractéristiques au même degré, ou presque, que l’eau. La tension superficielle ? L’indice de réfraction ? La température d’ébullition ? La température de fusion ? Non, ces propriétés de l’eau sont semblables à celles des autres liquides. Peut-être la conductibilité ? Non. Le moment dipolaire ? Non. La chaleur latente de fusion ? Non plus ! La constante diélectrique ? Halte !
En effet, la constante diélectrique [5] de l’eau diffère considérablement de celle des autres liquides. Pour le benzène, par exemple, la constante diélectrique est de 2,3, pour l’hexane de 1,9, pour l’éther de 4,4 pour ne citer que quelques liquides. Quant à l’eau, elle est de 79. Peu de substances lui sont analogues sous ce rapport. Celle qui s’en rapproche le plus est l’acide formique mais sa constante diélectrique est aussi une fois et demie plus faible que celle de l’eau, substance « record ».
Mais indiquer que le phénomène observé est dû à la constante diélectrique n’est pas suffisant, il faut encore l’expliquer.
Supposons, raisonnèrent les chercheurs, que les molécules de toutes les substances, même celles dont les molécules ont un moment dipolaire nul, s’attirent mutuellement au moyen de quelques forces dont la nature nous est inconnue. D’ailleurs, quelles que soient ces forces, elles ne peuvent manquer d’être électriques et doivent par conséquent se plier aux lois de l’attraction électrostatique.
Dans le cas d’une substance pure, que contient l’espace qui sépare deux molécules quelconques ? Rien, le vide. En conséquence, dans le vide, les forces d’attraction électrique possèdent leur valeur maximale. Mais que se produira-t-il si une molécule d’une substance étrangère vient s’insérer entre ces deux molécules ? L’interaction entre les deux molécules de la substance principale sera fortement atténuée. Et si, en outre, la molécule étrangère est une molécule d’eau, possédant la constante diélectrique la plus élevée et donc affaiblissant au maximum les forces de l’interaction électrostatique, on comprend sans peine que dans ce cas toute attraction entre les molécules de la substance principale cessera totalement.
Cependant, les raisonnements même les plus complets restent vains s’ils ne sont pas confirmés par l’expérience. Et l’on passa donc, une fois de plus, à l’application pratique de déductions théoriques en laboratoire.
On versa du benzène pur déshydraté par les procédés de laboratoire ordinaires dans un récipient spécial où on le plaça entre deux électrodes de platine. On chauffa lentement jusqu’à ce que le benzène atteigne la température d’ébullition. Le thermomètre indiquait alors 80°. Le benzène se comportait donc comme du benzène « normal ». Une très haute tension fut alors appliquée aux électrodes. A priori, cela paraissait dénué de sens, puisque le benzène n’est pas conducteur de l’électricité. Or, dès qu’on eut branché le courant, l’ébullition du benzène cessa. Il fallut élever la température du liquide de 8° supplémentaires pour le faire bouillir à nouveau. Le benzène placé entre les électrodes se comportait exactement comme du benzène extra-pur soumis à une déshydratation de plusieurs années ! Dès que le courant fut débranché, la température d’ébullition redevint normale. En le faisant passer à nouveau la température d’ébullition remonta à 88°.
En quoi cette expérience confirme-t-elle l’influence de l’eau sur l’association des molécules de benzène ? Le benzène « ordinaire » contient une quantité d’eau relativement élevée : une de ses molécules sur 50 à 60 est entourée d’une pellicule d’eau excessivement mince (faite d’une seule molécule). Ces molécules d’eau ressemblent fort à de petits aimants.
Regardons le dessin : à l’une des extrémités de la molécule d’eau se trouvent les atomes d’hydrogène qui, de dimensions très réduites, possèdent un champ d’électricité positive intense ; à l’autre extrémité se situe l’atome d’hydrogène qui a deux charges négatives. Considérons maintenant la molécule de benzène. On comprend immédiatement pourquoi elle ne possède pas de moment dipolaire : ses six atomes de carbone et ses six atomes d’hydrogène sont disposés symétriquement, leurs charges s’équilibrant.

Mais, lors du passage d’un courant à haute tension, les « petits aimants » d’eau se détachent des molécules de benzène, la pellicule d’eau se désagrège et les molécules de benzène peuvent ainsi s’associer. D’où une élévation immédiate de la température d’ébullition.
Nous avons donc répondu à la question : « Pourquoi l’eau? ». Mais nous devons aussitôt ajouter, hélas, qu’en réalité elle était la plus facile.
Ce n’était pas bien difficile d’y répondre. Or, cette question en entraîne aussitôt plusieurs autres.
Ces questions sont les suivantes (le lecteur attentif les connaît probablement déjà). Primo, de quelle pellicule d’eau peut-il s’agir si du benzène « simplement » pur ne contient qu’une molécule d’eau pour 100 à 200 molécules ? D’autant plus que si l’on soumet le benzène à une déshydratation spéciale qui se prolonge durant plusieurs années, ce rapport se modifie considérablement et cette fois il n’y a plus qu’une molécule d’eau pour un million de molécules de benzène.
Nous n’avons donc pas réussi à trouver de réponse à la seconde question : qu’est-ce qui pousse donc les molécules non dipolaires des substances extra-pures à s’associer par groupes ?
Ce sont là des questions d’autant plus intéressantes qu’on ne sait comment y répondre. Même actuellement, la physique et la chimie ne sont pas encore en mesure de le faire. Voici donc un futur champ d’activité tout trouvé pour l’étudiant d’aujourd’hui.
Nous sommes encore loin d’avoir épuisé la série des questions qui m’ont incité à parler des plus remarquables propriétés des substances extra-pures. Quant aux événements qui ont obligé le monde scientifique à se rappeler l’histoire que je viens de raconter, leur tour viendra.
Une aiguille dans une meule de foin
Qui enviera celui qui doit trouver une aiguille dans une meule de foin par une sombre nuit sans lune ? Ne croyez-vous pas que dans un tel cas n’importe qui renoncerait en hochant la tête d’un air accablé ? Eh bien, vous vous trompez ! Je connais bon nombre de chimistes prêts à soutenir que cet individu de mon invention passe son temps à des futilités. En réponse à notre haussement d’épaules ils s’empresseraient de prouver leur affirmation dans le clair langage arithmétique.
Quel peut être le poids d’une meule de foin ? Environ 400 kg. Et celui d’une aiguille ? Un décigramme, soit 10–4 kg. En prenant ces 400 kg pour 100%, à quel pourcentage équivaudra 0,1 g ?

Donc, l’aiguille représente 25 millionièmes pour cent du poids de la meule. Le chimiste dirait que notre individu opère avec des chiffres à cinq décimales. Or, pour la chimie, la détermination de quantités d’impuretés s’exprimant par des chiffres à cinq décimales est une étape depuis longtemps révolue. C’est à partir de la sixième ou de la septième décimale que la tâche se complique. La cinquième est pour ainsi dire à la portée de tout le monde et n’exige que peu d’efforts.
Ah, si les recherches en chimie se limitaient seulement à la sixième ou la septième décimale !
Mais, a-t-on vraiment besoin de calculs plus précis ? Faut-il aller encore plus loin ?
Quand nous parlions de l’escalade par la chimie des gradins escarpés des décimales, nous pensions justement à la détermination analytique des impuretés. Vers 1955, la technique exigea des chimistes qu’ils soient capables non seulement de déterminer les quantités de ces impuretés mais aussi de les isoler. Pouvoir déterminer la quantité exacte de tel ou tel élément mélangé à une substance donnée et en débarrasser cette dernière tout en évitant d’introduire d’autres impuretés sont deux choses bien différentes, la seconde tâche étant bien plus complexe que la première.
Et pourtant si la technique et l’industrie l’exigent, la chimie ne peut faillir à son devoir.
Aussi se mit-on à ce travail…
Mais expliquons d’abord pourquoi la technique demanda des corps d’une pureté aussi extraordinaire.
La plupart des matières semi-conductrices ne manifestent leurs propriétés qu’à un degré de pureté extrêmement élevé. C’est notamment le cas du germanium, l’un des semi-conducteurs les plus utilisés. Très souvent la technique moderne des semi-conducteurs exige que le germanium possède une pureté de 99,999 999 999 9%, un atome d’impureté pour cent milliards d’atomes de germanium. Qu’il y ait deux atomes au lieu d’un et le semi-conducteur est inutilisable.
Ainsi donc les chimistes virent se dresser devant eux le pic de la dixième décimale. Cet Everest de la chimie moderne n’était pas destiné à être conquis par des savants isolés. Le sommet devait être atteint par l’immense collectif des chimistes travaillant dans le domaine de l’industrie des semi-conducteurs. Il ne s’agissait pas de se contenter d’obtenir quelques deux ou trois grammes de substance extra-pure, il fallait édifier des usines pouvant produire ces matières par quintaux, par tonnes même.
Le lecteur se rappelle quelles difficultés il fallut surmonter pour conquérir les sommets des sixième et septième décimales. Or, cette fois, on s’attaquait à la dixième. Et, de même qu’à haute altitude cent mètres de grimpée sont plus difficiles à franchir qu’un kilomètre en plaine, chaque décimale de plus dans la détermination de la pureté d’une préparation coûte aux chimistes des efforts de plus en plus pénibles.
Actuellement, l’obtention d’une substance d’une pureté de 99,99%, de « quatre neufs » comme on dit parfois, ne présente aucune difficulté même dans un laboratoire modestement équipé. Mais y a-t-il longtemps qu’il en est ainsi ?
J’ai sous les yeux trois articles parus dans diverses revues de chimie. Dans le premier on peut lire : « Nous sommes parvenus à obtenir un corps d’une pureté extrême, de 99,99%. » Dans le second : « Le contenu de la substance principale dans le produit obtenu atteint 99,999%. On peut donc considérer celui-ci comme relativement pur. » Dans la troisième communication : « L’échantillon était plutôt souillé : le contenu du métal principal ne se montait qu’à 99,999 9%. »
Les déclarations ci-dessus ne sont-elles pas entièrement contradictoires ? Non, il n’y a là en réalité aucune contradiction. Le premier article date en effet du début du siècle, le second des années 1920 et le troisième est récent. Le lecteur comprend à présent pourquoi une substance qui, il y a une soixantaine d’années, paraissait pure n’a pas gardé de nos jours son ancienne « réputation ».
Il est très intéressant de voir, ne serait-ce que brièvement, comment les chimistes procèdent actuellement pour obtenir des substances d’une telle pureté.
Disons tout de suite que l’obtention de corps extra-purs en grandes quantités n’a été rendue possible que grâce aux progrès sensationnels de la chimie analytique. Avant d’éliminer les impuretés d’une substance il convient tout d’abord de savoir de quelles impuretés il s’agit et ensuite quelles en sont les quantités présentes. C’est à la chimie analytique de fournir les réponses. Et plus le degré de purification est poussé, plus les procédés de cette science doivent être précis ; en effet, moins il reste d’impuretés, plus les analyses doivent être minutieuses.
Il n’est plus question maintenant d’employer les procédés extrêmement sensibles d’analyse chimique dont nous avons parlé au début de notre ouvrage. L’analyse des matières semi-conductrices a exigé des chimistes un renouvellement complet de leurs méthodes de recherche.
Il suffira de choisir deux des procédés dont dispose la chimie analytique pour illustrer la précision dont elle est capable.
L’une des plus récentes méthodes d’analyse est basée sur la radio-activité. Le métal à l’état pur est irradié à l’aide de neutrons qui rendent radio-actifs une partie de ses atomes, les atomes d’impuretés acquérant également une radio-activité artificielle. Or, la nature des radiations varie considérablement d’un élément radio-actif artificiel à un autre. En déterminant la quantité de chaque type de radiation, il est donc aisé de déduire la quantité et la nature des impuretés que contient le métal. Cette méthode permet de déceler des quantités d’impuretés de l’ordre de 10–12 g.
Pour les semi-conducteurs on peut employer une méthode d’analyse particulière basée sur le fait que la conductibilité des matières semi-conductrices dépend pour l’essentiel de la présence d’impuretés. Comme la conductibilité constitue une propriété particulièrement importante des semi-conducteurs, les matières servant à leur fabrication doivent être d’une pureté exceptionnelle.
On ne saurait citer tous les procédés qu’utilisent les chimistes pour obtenir des corps extrapurs de même qu’il est impossible, par exemple, d’étudier la géographie de notre planète entière en une leçon. Pour l’essentiel, toutes ces méthodes ressemblent de très près à celles dont nous avons parlé à propos de la purification de l’eau. Il est cependant indispensable d’examiner quelques-uns des procédés les plus intéressants dont on se sert pour obtenir des substances à « neuf » ou « dix neufs ».
Parlons d’abord des laboratoires dans lesquels s’effectuent ces opérations. Le personnel de ces établissements appartient à une catégorie bien particulière. Ils ont une peur bleue des courants d’air, non pas parce qu’ils craignent de s’enrhumer car ce sont, en général, des jeunes en excellente santé, mais parce qu’un courant d’air peut introduire dans le local des parcelles de matière susceptibles de souiller la substance à purifier. Le plus petit grain de poussière qui passerait inaperçu de la ménagère la plus méticuleuse les émeut. Dans ces laboratoires il ne sied pas de marcher vite ou de parler à haute voix : des mouvements brusques peuvent faire tomber des vêtements les restes de poussière que l’aspirateur placé à l’entrée du local n’a pas pu faire disparaître. Les murs et plafonds sont absolument lisses et luisants : aucun grain de poussière ne pourrait y adhérer. Toutes les manipulations se font à l’aide d’instruments spéciaux rappelant des pincettes à long manche, les mouvements devant être aisés et prudents… Une atmosphère de ce genre risque fort de rebuter les non-initiés.
Mais cette impression se dissipe dès que l’on fait plus amplement connaissance avec la façon dont ces gens à tablier de matière plastique effectuent l’ascension de l’un des pics les plus vertigineux de la science moderne, celui des « neuf décimales ». Voici l’un des plus récents appareils servant à l’obtention de matières extra-pures, dans lequel se déroule l’opération nommée fusion par zones.
Un four électrique disposé autour d’un tube de quartz se déplace lentement le long de ce tube qui contient un petit lingot de germanium de forme allongée placé sur un support spécial.
Extérieurement, l’installation n’a rien d’extraordinaire, On peut voir la zone de fusion se déplacer le long du lingot de germanium. A l’endroit où le four passe au-dessus du métal, celui-ci fond et se transforme en un liquide visqueux. Le four continuant à se déplacer, le métal se refroidit lentement.
Lors de la fusion du métal les impuretés contenues dans le germanium préfèrent rester dans la zone liquide. Pourquoi ? Parce que lorsque le métal fondu se solidifie à nouveau, ses atomes se combinant les uns aux autres expulsent les « étrangers » de leur réseau cristallin contraignant ces derniers à passer dans la zone liquide. En circulant le long du lingot de métal la zone liquide entraîne une partie considérable des impuretés. Quand elle atteint finalement l’extrémité du lingot et se solidifie, on la sectionne, le germanium possédant alors un degré de pureté beaucoup plus élevé qu’auparavant.
Cette méthode est la plus répandue, cependant elle n’est pas toujours utilisable. Elle ne convient pas par exemple à un autre semi-conducteur, le silicium, voisin du germanium dans la classification périodique, car il ne fond qu’à 1 400°, c’est-à-dire à une température beaucoup plus élevée que le germanium. A une température aussi importante les atomes de la quasi-totalité des corps étrangers proches tendent à entrer en réaction avec le silicium, notamment les atomes de l’air environnant et ceux du creuset contenant le lingot de silicium. L’air peut sans doute être éliminé par pompage, mais par quoi remplacer le creuset ?
Dans le cas de certains éléments, les métaux sensibles au champ magnétique, on a adopté une solution très ingénieuse : on se passe tout simplement de creuset : on place le morceau de métal à l’intérieur d’un électro-aimant cylindrique. Le courant étant branché, le morceau de métal reste suspendu en l’air ou plutôt dans le vide car l’air a été éliminé. C’est donc dans le vide que s’effectuent la fusion du métal et les autres opérations.
De cette façon, le métal passe par toutes les phases de purification sans subir le moindre contact avec les parois d’un récipient. Curieux procédé ! Mais comment l’employer avec le silicium qui est insensible au champ magnétique ?
C’est le silicium lui-même qui nous vient en aide. Il se trouve qu’à l’état liquide cet élément possède une tension superficielle extrêmement élevée, de telle sorte que dans un lingot de silicium fondu, la zone de fusion conserve la même forme qu’à l’état solide, la masse fondue étant retenue par une pellicule extérieure de liquide. En somme, le silicium est fondu dans un récipient fait de sa propre substance.
La purification de toute nouvelle matière semi-conductrice implique de nouvelles difficultés. Les exemples ci-dessus illustrent bien l’extrême complexité des problèmes posés par la préparation de substances extra-pures. Le fait est que le degré de pureté désormais réalisable industriellement dépasse tout ce que le savant à l’imagination la plus féconde eût pu voir en rêve il y a seulement dix ans.
Il semble que nous ayons tout dit : pourquoi on obtient des substances extra-pures, comment les chimistes parviennent à un tel degré de pureté, etc. Une seule chose reste obscure : pourquoi l’auteur a-t-il jugé nécessaire de raconter l’histoire de l’infortuné commerçant Eugène O’Winstern et du journaliste de Kiev Nicolas Karlychev ?
Un narrateur garde toujours le plus intéressant pour la fin. J’ai fait de même.
La nouvelle chimie
J’espère qu’on ne me tiendra pas grief de citer quelques phrases d’un manuel de chimie scolaire. Je prie cependant instamment le lecteur de ne pas sauter ces lignes qui ne paraissent arides et dénuées d’intérêt qu’à première vue : « Le zinc est un métal très malléable et plastique qui se dissout difficilement dans les acides, à une température très élevée. »
« Le titane, le manganèse et le chrome servent à la fabrication des articles les plus variés car ils se prêtent aisément au forgeage et au laminage. »
« Le fer est un métal exceptionnellement malléable possédant une résistance élevée à la corrosion. »
« Permettez, direz-vous, je ne sais ce qu’il en est du titane et du manganèse mais quant à l’action des acides sur le zinc c’est la première expérience à laquelle nous avons assisté dès notre premier cours de chimie à l’école et nous nous souvenons parfaitement que l’immersion de grenaille de zinc dans de l’acide — chlorhydrique ou sulfurique — provoquait un abondant dégagement d’hydrogène, l’attaque du zinc s’effectuant d’ailleurs à froid. »
On ne peut qu’être d’accord avec cette objection : le zinc réagit en effet intensément avec les acides. Et pourtant les affirmations ci-dessus sont parfaitement exactes. Seulement elles sont tirées d’un manuel de chimie… de l’avenir. Cette innocente falsification peut se justifier par le fait que cet avenir est tout proche.
Considérons à nouveau le zinc ; il est exact qu’il est attaqué par les acides mais ce comportement est celui du zinc à « trois neufs » : 99,9%. Le zinc à « quatre neufs » (99,99%) est également assez vulnérable aux acides. Mais il suffit de remplacer le quatuor par un quintette, par 99,999, pour que les propriétés du zinc subissent aussitôt un changement inattendu et surprenant, comme sous l’effet d’une baguette magique.
Les acides n’ont aucun effet sur le zinc à « cinq neufs » même à température élevée (le manuel de l’avenir ne s’est donc pas trompé !). A la différence de son confrère « impur » qui se fractionne à la moindre tentative de le soumettre à un façonnement quelconque, ce zinc peut être étiré en fils minces sans se rompre.
Les mêmes transformations merveilleuses s’observent pour tous les autres éléments qu’on a réussi à obtenir à l’état pur et extra-pur. On s’est aperçu que de nombreux métaux considérés auparavant comme cassants sont en réalité malléables. C’est ainsi qu’on a dû réviser les « fiches d’identité » du manganèse, du chrome et du titane. La malléabilité inattendue de ce dernier élément est particulièrement précieuse, car elle a permis de l’utiliser pour fabriquer diverses pièces. Auparavant le titane était considéré comme un métal cassant.
Il est une question qui mérite une attention particulière. Comment se fait-il que des échantillons d’éléments d’une pureté de 99,9, 99,99 et 99,999% se distinguent à peine l’un de l’autre alors qu’il suffit d’atteindre 99,9999 % — le contenu des impuretés se trouvant ainsi réduit de 1 000 fois moins qu’en passant de 99,0 à 99,9 — pour que se produise un brusque changement des propriétés de ces métaux ?
Revenons au zinc. Pour commencer, même lorsque sa pureté augmente, sa propriété de réagir avec les acides n’en est pas pour autant modifiée. Mais que le nombre de neufs vienne à être porté à cinq et il semble qu’il s’agisse aussitôt d’un tout autre élément aux propriétés physiques, chimiques et mécaniques totalement différentes, bref, ne rappelant absolument pas le zinc initial.
Ainsi, il existe plusieurs zincs, plusieurs titanes, plusieurs manganèses au même titre qu’il existe plusieurs benzènes, hexanes, éthers, selon le degré de pureté. C’est alors qu’on se souvient des expériences de Baker !
Nous assistons donc à la naissance d’une nouvelle chimie ; ce qui ne veut pas dire que les données sur les propriétés des cléments chimiques vont perdre leur signification et que nous devrons tous nous remettre à l’étude. Mais en parlant des propriétés d’un élément (ou d’un composé) quelconque, il faudra veiller à préciser son degré de pureté.
La « vieille » chimie est l’oeuvre de dizaines de générations de chimistes. La nouvelle chimie sera créée beaucoup plus vite et pour cette création, la prochaine génération de savants, les écoliers d’aujourd’hui, aura un rôle essentiel. Mais la conquête de ce nouveau sommet de la science moderne exigera une préparation sérieuse.
Dans les petits pots…
Il y a déjà longtemps que je parle des propriétés des éléments extra-purs et je n’ai pas ménagé les exemples. Cependant la raison pour laquelle la présence de quantités infinitésimales d’impuretés dans une substance exerce sur scs propriétés une influence aussi forte reste obscure.
On pourrait sans doute se livrer à ce sujet à bon nombre de réflexions et de conjectures. Mais ce phénomène demeure pour l’instant inexpliqué. Apparemment il y a encore des choses dans la chimie moderne dont même les spécialistes compétents dans ce domaine ne savent rien.
Cependant certaines considérations peuvent jeter quelque lueur sur les étroits sentiers conduisant à la solution de l’énigme qui se perd dans une épaisse forêt de questions. Selon toute vraisemblance, les propriétés chimiques et physiques des corps dépendent pour l’essentiel de l’homogénéité ou de l’hétérogénéité de leur composition chimique.
Lors du passage du courant à travers les métaux, les électrons ne se déplacent pas n’importe comment mais suivent les chaînes d’atomes dont est constitué le réseau cristallin des métaux. Ce fait n’explique pas encore pourquoi la présence d’une impureté, dans la proportion d’un atome pour des milliards, est capable de modifier les propriétés d’un métal, mais il permet de mieux le comprendre. En effet, la ligne téléphonique entre Moscou et Vladivostok a une longueur de quelque dix mille kilomètres. Or, il suffit de découper un millimètre de fil quelque partie long de ces dix mille kilomètres pour que la liaison soit immédiatement interrompue. Eh bien, les atomes des éléments étrangers peuvent jouer le rôle des coupures le long des lignes de transmissions.
Supposez qu’aux heures de pointe dans le métro un individu s’arrête brusquement parmi le flot des usagers et se mette à examiner la mosaïque du plafond ou à lire son journal. Le mouvement normal de la foule en sera immédiatement perturbé. Les injures ne tarderaient pas à pleuvoir sur le malheureux que le contrôleur de service obligerait bientôt à circuler. Mais les électrons ne parlent pas. Rencontrant sur leur passage des atomes étrangers qui refusent de les laisser passer, ils sont obligés de faire un détour. C’est alors que les chimistes assument la fonction de contrôleurs. En purifiant une substance, ils la débarrassent des atomes étrangers et facilitent ainsi le passage des électrons. Voilà pourquoi les métaux extra-purs conduisent le courant électrique bien mieux que leurs analogues « impurs ».
Ainsi donc, qu’elle soit utile ou néfaste, l’influence de quantités infimes d’impuretés sur les propriétés physiques des métaux peut être expliquée. Mais que peut-on dire des propriétés chimiques ?
Essayons de comprendre la façon dont les acides attaquent le zinc ordinaire pur à 99,9 ou 99,99%, provoquant un dégagement d’hydrogène.
Augmentons mentalement de plusieurs milliards de fois la surface du zinc attaqué par l’acide, rendant ainsi visibles les atomes qui composent le réseau du zinc. Parmi ces atomes on aperçoit des atomes d’impuretés relativement nombreux. Dans leur voisinage, le réseau cristallin est déformé, boursouflé. On remarque alors que les molécules d’acide arrachent les atomes de zinc précisément aux endroits où l’homogénéité du réseau cristallin est perturbée, au voisinage d’atomes d’impuretés. La présence d’impuretés crée donc des conditions particulièrement favorables au déroulement de la réaction.
Et si la substance est très pure et que sa composition peut être considérée comme homogène ?
Une comparaison s’impose. Ne perdons pas de vue cependant l’excellent proverbe allemand selon lequel : « Toute comparaison boite ».
Le lecteur connaît-il la fable de l’âne de Buridan ? Le docteur scolastique français Jean Buridan affirmait que si l’on plaçait un âne affamé à égale distance de deux bottes de foin absolument identiques, l’âne finirait par mourir de faim faute de savoir quelle botte il devait brouter en premier.
Je ne me serais pas donné la peine de rappeler ce piètre exemple du scolastique moyennâgeux si le phénomène s’observant lors de l’immersion de zinc extra-pur dans de l’acide ne rappelait quelque peu l’histoire de l’âne de Buridan. Se trouvant en présence d’une surface absolument homogène (du point de vue chimique), les molécules de l’acide « ne savent pas » par quel côté aborder la destruction du réseau cristallin du zinc. De même l’alpiniste qui cherche à escalader un pic absolument abrupt doit d’abord y trouver quelque crevasse ou saillie à laquelle il puisse s’accrocher. Des crevasses de ce genre, la surface des substances extra-pures n’en présente pas. C’est la raison pour laquelle elles sont extrêmement inertes du point de vue chimique.
D’une façon générale, les substances idéalement pures sont apparemment incapables de réagir les unes avec les autres. L’exemple suivant est bien connu. Le chlore et l’hydrogène réagissent activement l’un avec l’autre : leur mélange à la lumière provoque immédiatement une violente explosion. Dans l’obscurité la réaction est un peu plus lente. Mais si l’on déshydrate soigneusement les deux gaz (en leur faisant plusieurs fois traverser de l’anhydride phos-phorique) leur mélange ne donnera lieu à aucune réaction même en plein soleil !
L’équation de la réaction de l’hydrogène avec le chlore est :
H2 + Cl2 = 2HC1
Mais qu’est-ce que l’eau vient faire ici ? Elle n’apparaît pas dans l’équation et pourtant sans elle la réaction ne s’effectue pas. De toute évidence, la perturbation de l’homogénéité chimique joue également ici un rôle considérable.
Le monde des infiniment petits
Ce n’est pas par hasard que nous avons traité ici des propriétés des éléments extra-purs d’une manière fort détaillée. De jour en jour ce problème acquiert une importance accrue dans le domaine de la science et de la technique.
En outre, le problème des quantités infimes d’impuretés joue également un rôle immense dans de nombreuses autres sciences.
Le moment est venu de revenir aux histoires du début de ce chapitre qui, a priori, paraissaient n’avoir aucun rapport avec ce qui suivait.
Disons tout de suite que l’eau médicamenteuse n’était nullement une invention du moine Jonas qui se révéla d’ailleurs par la suite un fieffé coquin. Il y avait déjà longtemps que, sous couvert d’« eau sacrée », les monastères vendaient de l’eau dans laquelle avaient trempé des pièces ou d’autres objets en argent.
Au contact de l’argent, l’eau acquiert une trace infime de ce métal, de l’ordre d’un milliardième de gramme par litre d’eau. C’est peu, ex-cessivcment peu ! Il faudrait prendre un milliard de litres d’une telle solution pour en extraire un gramme d’argent. Un milliard de litres, un million de tonnes d’eau !
Une quantité d’argent aussi infime est cependant amplement suffisante pour détruire de nombreuses bactéries. Cette propriété de l’argent avait d’ailleurs été inconsciemment utilisée il y a déjà longtemps. C’est la raison pour laquelle la vaisselle d’argent était tant appréciée dans l’antiquité : les mets qu’on y cuisinait se distinguaient avantageusement des autres. Voilà pourquoi en préparant le médicament bien connu actuellement des pharmaciens sous le nom d’« eau d’argent » l’appui de la « sainte parole » était certes le cadet des soucis du moine Jonas, et s’il espérait quelque chose c’était seulement que ses crédules patients aient des poches bien garnies.
Je vous parle de milliardièmes et de dix-milliardièmes de gramme. Sachant par mon expérience personnelle à quel point il est difficile de se représenter « matériellement » des quantités aussi infimes je me permettrai d’avoir recours à une nouvelle comparaison.
Supposons que nous réussissions à partager un morceau de sucre de 10 grammes entre tous les habitants de notre planète. Quelle serait la part de chacun d’entre nous ? Quelques lecteurs hausseront les épaules et feront observer qu’elle se monterait peut-être à trois ou quatre molécules par personne ou même probablement encore moins. Chacun sait que la population mondiale est d’environ trois milliards d’habitants. Si l’on divise le poids d’un morceau de sucre par ce chiffre on obtient 4 • 10–9, quatre milliardièmes de gramme, c’est-à-dire quatre fois plus que la quantité d’argent contenue dans un litre d’eau d’argent.
Or, les chimistes ont trouvé le moyen de déceler des quantités d’argent aussi infimes. Le public d’une conférence fut un jour témoin de l’expérience suivante. Une cuiller d’argent fut agitée pendant quelques minutes dans un verre d’eau. Le versement de quelques gouttes d’un réactif organique spécial fit prendre alors à cette eau une nette coloration rouge. L’addition du même réactif à de l’eau n’ayant pas été en contact avec un objet d’argent ne provoqua aucune coloration.
Dans le domaine des quantités de substances infinitésimales, la biologie nous offre des exemples encore plus étonnants.
On a établi que la croissance de cellules végétales était fortement influencée par une substance appelée auxine. Si, à l’aide d’une seringue, on introduit de l’auxine dans la tige d’une plante, il se produit à l’endroit de la piqûre une croissance des cellules tellement rapide que la tige en subit même une déformation.
L’unité d’auxine est la quantité qui fait dévier une tige d’avoine de dix degrés. En grammes, cette unité équivaut à 2 • 10–11 ou deux cent-milliardièmes de gramme, quantité exceptionnellement infime… Il n’est du reste pas indispensable de prendre l’exemple de l’auxine. Notre propre odorat nous offre des exemples de détection de quantités infimes de substances.
Le gaz est essentiellement composé de méthane. Or, n’importe quel chimiste sait que le méthane est inodore. L’odeur que nous percevons lorsque nous ouvrons le robinet du gaz est celle d’un autre gaz, le mercaptan, qu’on mélange spécialement au méthane pour permettre de déceler les fuites de gaz éventuelles. Eh bien, l’odorat humain peut sentir la présence de mercaptan dans l’air même si sa proportion ne dépasse pas une partie pour cinq milliards de parties d’air. En d’autres termes, si quelqu’un s’avisait brusquement de libérer cent mètres cubes de mercaptan à Kiev, quelques heures plus tard, on verrait des gens perplexes lever le nez en l’air dans les rues de Moscou en se demandant d’où peut bien provenir cette fuite de gaz et pourquoi les services de réparation ne font rien.
En convertissant les chiffres ci-dessus en grammes on voit que l’odorat humain peut détecter la présence de 2 • 10–12 gramme de mercaptan, deux millièmes de milliardième de gramme ! C’est là une sensibilité qui dépasse de loin celle de n’importe quel réactif !
Ces exemples montrent clairement que le monde des infiniment petits exerce une énorme influence sur les propriétés de quantités considérables de substances. Nous avons cité de nombreux cas où le mélange de quelques atomes d’impuretés à des milliards d’atomes d’un corps en modifie complètement les propriétés. Lilliput l’emporte ainsi sur Gulliver !
Pour compléter notre exposé sur les substances extra-pures il nous faut encore parler de l’importance pratique de ce problème.
Les grands effets des petites impuretés
Le moment est venu de rappeler l’histoire du « négociant » Eugène O’Winstern.
Après tout ce que nous avons déjà expliqué, le lecteur doit comprendre à présent pourquoi la corrosion n’a pas eu le moindre effet sur la colonne de Delhi bien que depuis des millénaires celle-ci se trouve exposée à un climat chaud et humide. L’analyse du professeur Hall était parfaitement exacte : la colonne de Delhi est en fer absolument pur. Or, vous vous souvenez que dans cet état le fer résiste à la corrosion.
L’énigme est ailleurs : comment a-t-on pu obtenir une aussi grande quantité de fer extrapur il y a de cela des centaines d’années, alors que même de nos jours l’obtention d’un gramme de cette substance en laboratoire est considérée comme une entreprise extrêmement ardue ? Il y a donc tout lieu de croire que le fer de la colonne de Delhi provient d’un météorite constitué de fer absolument pur.
Mais c’est un tout autre aspect du problème qui nous intéresse ici.
Comme on le sait, la corrosion est un fléau redoutable. L’homme extrait du minerai de fer, en tire le métal, il le moule pour le façonner en divers objets. Or, une machine ou une machine-outil n’est pas plus tôt terminée, qu’elle se trouve immédiatement aux prises avec l’ennemi parfide et impitoyable qu’est la corrosion. A la moindre négligence, l’article de fer est attaqué et parfois même perdu ! Près de 30 millions de tonnes de fer se transforment annuellement en rouille, et cela malgré la lutte incessante et efficace que l’on mène contre la corrosion. Il est évident que cette perte est encore trop élevée.
On s’est aperçu que l’une des méthodes les plus efficaces pour lutter contre la corrosion était de fabriquer des pièces en métaux extra-purs. On se sert dès maintenant de récipients en fer pur pour y réaliser des réactions chimiques au cours desquelles se dégagent des substances extrêmement corrosives. On utilise déjà le zinc pour la fabrication de pièces d’automobiles.
Une autre utilisation importante des métaux extra-purs est la transmission de l’énergie électrique à grande distance. On sait que l’un des obstacles majeures qui s’opposent encore à la réalisation des projets de ce genre est la considérable perte d’énergie électrique en cours de transmission due à la résistance électrique des métaux dont sont faits les fils.
La résistance spécifique de l’argent n’est que de six pour cent inférieure à celle du cuivre et pourtant les gouvernements d’un certain nombre de pays n’ont pas hésité à l’utiliser pour la fabrication de lignes de transmission électrique lorsque celles-ci présentaient une importance particulière.
Les métaux extra-purs ont une résistance électrique considérablement inférieure à celle des métaux d’une pureté « ordinaire ». Il n’est pas rare que l’addition d’un neuf supplémentaire au chiffre exprimant la pureté d’un métal abaisse sa résistance électrique de dizaines de fois. Les métaux extra-purs sont donc appelés à devenir une source importante d’augmentation des ressources d’énergie électrique.
Mais à quoi bon tenter de deviner à l’avance les domaines d’application des métaux extrapurs ? Ne s’est-on pas aperçu récemment que les ampoules électriques comportant un filament en tungstène extra-pur duraient des dizaines de fois plus que les ampoules ordinaires ? Des communications concernant des découvertes de ce genre paraissent tous les mois, dans tout nouveau livre édité, tout récent numéro de revue scientifique.
… Telle est l’histoire de l’ascension de l’un des plus hauts sommets de la chimie moderne, celui des substances extra-pures. Certes, il comprend encore de nombreux coins inexplorés et des pics encore plus élevés et pour l’instant inviolés. Mais des équipes aguerries se préparent déjà à leur donner l’assaut. De nouvelles théories se créent, formant l’équipement scientifique du chimiste. On est en train d’explorer les abords de la voie qui conduira à la solution de tous les nombreux problèmes décrits dans le présent chapitre.
DANS LES VASTES ÉTENDUES DE L’ANTARCTIDE CHIMIQUE
La carte de la chimie
Parlons de romantisme, du romantisme de l’inconnu, du romantisme de la découverte.
Une expédition géographique est sur le point de partir… L’imagination se représente aussitôt des « taches blanches » sur la carte, des pics inconnus, de mystérieuses tribus indigènes, des fauves, des dangers et des aventures à profusion…
Des botanistes se mettent en route. Ils examinent avec un soin méticuleux leur équipement compliqué. Chaque brin d’herbe, chaque fleur devra faire l’objet d’un examen microscopique approfondi et d’une description aussi minutieuse qu’un acte notarié. Les botanistes vont découvrir de nouvelles plantes, des herbes médicinales, des espèces d’arbres inconnues à ce jour.
Quant aux géologues, qui ne se tiennent jamais en place, ils se préparent également au départ. Ce n’est certes pas une promenade de tout repos qui les attend ! Ils devront passer des jours et des jours, peut-être des mois, à suivre des routes inconnues, des sentiers touffus ou même à se frayer un chemin à travers des régions entièrement dépourvues de routes, à la recherche de gisements de minéraux. Comment ne pas les envier cependant ! La lecture du journal de route d’une expédition ne contenant pourtant que les informations les plus succinctes sur le déroulement des travaux est en effet souvent plus intéressante que celle d’un roman d’aventures.
Les océanographes sont également prêts à partir. Ils ont toutes les raisons d’être les plus concentrés et les plus soucieux. N’explorent-ils pas les profondeurs sous-marines, et chacun d’eux n’espère-t-il pas au fond du cœur y découvrir quelque monstre étonnant ? Or, les profondeurs sous-marines recèlent bien des surprises…
Certaines branches scientifiques contraignent le chercheur à affronter quotidiennement de grandes difficultés, à rassembler toute sa volonté, toutes ses aptitudes, à être capable de surmonter n’importe quel obstacle, pics inaccessibles, dense végétation de la jungle tropicale, etc.
Je me doute bien que si je m’avise de compter les chimistes au nombre de ces audacieux, il ne manquera pas de gens pour s’esclaffer en disant : « Drôles de romantiques ! Ils restent assis à longueur de journée dans leurs laboratoires, transvasant des liquides d’un récipient à un autre et quand ils rentrent chez eux le soir, ils s’emmitouflent dans un foulard de peur de s’enrhumer. »
Mais passons aux choses sérieuses, parlons du romantisme des recherches de chimie.
Comme chimiste je n’envie pas les géographes. Il est probable qu’il ne reste plus aucune tache blanche sur les cartes. Même les chaînes de montagnes de la lointaine Antarctide y ont déjà été indiquées par d’infatigables explorateurs. D’ailleurs, comment peut-il encore être question d’endroits inaccessibles sur notre planète alors que la région la plus reculée est à peine à 15 ou 20 heures de vol, mettons 24 heures au maximum ? Il y a certes des régions qui nécessitent une meilleure exploration, mais de régions inconnues il n’y en a plus !
Les botanistes ont sans nul doute un travail intéressant ! Mais peuvent-ils escompter faire encore de nombreuses découvertes ? Des centaines de milliers de plantes leur sont connues. De nos jours la découverte d’une plante nouvelle est un événement d’une importance exceptionnelle. Il existe des atlas volumineux de toutes les plantes connues. Là non plus il n’y a guère de lacunes.
Je pourrais presque en dire autant des géologues et même des océanographes (mais oui : n’a-t-on pas déjà découvert l’endroit le plus profond de l’Océan ?). Mais pourquoi médire de ces professions ? Elles méritent au contraire notre profonde estime. Constatons seulement dès maintenant que les chimistes peuvent parler d’égal à égal avec les géographes, botanistes, géologues et représentants d’autres professions considérées à fort juste titre comme « romantiques ». La carte de la chimie comporte bien plus de taches blanches que celles des sciences géographiques, botaniques, océanographiques, etc.
« Permettez, demandera le lecteur, de quelle carte peut-il être question en chimie ? » Cette carte c’est la classification périodique de Mendéléev et, en ce qui concerne le nombre de taches blanches, elle dépasse de loin la carte même la plus précise de notre planète.
Pour les géographes, le temps des voyages au hasard fondés sur le principe « qui sait si nous ne trouverons pas quelque chose d’intéressant » est révolu depuis près de quatre siècles. A cette époque, les voyageurs avaient déjà appris à s’orienter plus ou moins correctement et l’on connaissait la configuration des principaux continents et des mers. Il en était tout autrement en chimie ; dans ce domaine les savants « voyageaient » encore sans cartes il y a seulement une centaine d’années.
… Il suffit de lire la revue où Mendéléev fit paraître sa première communication concernant la classification périodique des éléments — l’une des plus grandes découvertes de l’histoire —, pages que le temps n’a pas encore réussi à jaunir, pour comprendre que cette découverte est en somme assez récente. En effet, quatre-vingt-dix ans constituent une période bien courte si l’on considère tout ce qu’elle a apporté à la chimie.
Pourtant la sensation de l’« ancienneté » de la loi de Mendéléev est probablement inhérente à tout chimiste. C’est bien naturel puisque la quasi-totalité des plus importantes généralisations scientifiques en chimie sont postérieures à la découverte de la loi périodique. Il ne pouvait d’ailleurs en être autrement car c’est justement grâce à cette loi que les chimistes obtinrent, comme les géographes, leur propre carte.
Jugez vous-même : le capitaine le plus intrépide pourrait-il se rendre sans carte de Mourmansk à San-Francisco, par exemple ? Or, avant la découverte de Mendéléev, les chimistes se trouvaient dans une situation encore plus difficile. Ils ne possédaient pas de carte, et de plus ils ne savaient même pas dans quelle direction « naviguer » et comment orienter leurs recherches pour obtenir des résultats.
Voyons en effet de quelle façon évoluaient les idées que se faisaient les chimistes de leur monde chimique.
Dans l’Antiquité, les composés dont se servaient pratiquement les chimistes comportaient seulement dix-neuf éléments. Mais ils s’en servaient pour ainsi dire inconsciemment. Supposons un instant que nous puissions demander à quelque savant de la Rome antique combien il connaît d’éléments au sens moderne du mot. Il aurait beau plisser le front et compter sur scs doigts, il est douteux qu’il soit en mesure d’en nommer plus de six ou sept, l’or, le cuivre, l’argent, le fer, l’étain, le plomb, le soufre, et c’est à peu près tout. Les autres éléments ne s’employaient qu’en combinaisons et notre interlocuteur romain imaginaire ne pouvait évidemment les connaître. Gomme on le voit, le monde chimique des anciens était tout aussi limité que leur monde géographique.
Malheureusement, l’augmentation par l’homme de son acquis chimique alla bien plus lentement que le développement de la géographie. Les douze premiers siècles de notre ère n’ajoutèrent que six éléments aux cinq déjà connus. Ainsi furent atteints les XIIe et XIIIe siècles. Or, encore très peu de temps auparavant, du VIIIe au IXe siècle, les alchimistes n’avaient-ils pas coutume de chanter le petit refrain suivant ?
…Le nombre des métaux est limité à sept
Pour ne pas dépasser le chiffre des planètes…
Vers la fin du Moyen Age, le rythme des découvertes de nouveaux éléments ne s’était guère accéléré. A l’aube du XIXe siècle, la science ne connaissait que 31 éléments chimiques. Au XIXe siècle, les choses allèrent un peu plus vite et, vers le milieu du siècle, n’importe quel savant assez érudit était capable d’énumérer les soixante éléments connus à l’époque.
Soixante, donc… mais combien y en avait-il en tout ? Cent ? Deux cents ? Ou bien étaient-ils déjà tous découverts ? Qui aurait pu le dire ?
Mendéléev fournit les réponses à ces questions. Il fut le premier à porter sur les taches blanches de la « carte de la chimie », la classification périodique, les éléments qui, à l’époque, n’avaient pas encore été découverts. Nous savons comment cette carte de la chimie permit ensuite de remplir toutes les cases vides du tableau de Mendéléev. Il semblait donc qu’il ne restât plus de taches blanches…
J’ai vu quelque part une carte montrant dans quelle mesure les diverses régions de notre planète avaient été étudiées. Les régions bien connues, comme celle de Moscou, étaient colorées en vert foncé, mais elles étaient peu nombreuses. Les régions moins bien étudiées étaient en vert pâle, la couleur dominante. Les régions peu étudiées, indiquées en jaune, étaient limitées à l’Himalaya, au Groenland et aux régions tropicales du Brésil. Seule l’Antarctide était en blanc, excepté une mince bande jaune le long de la côte. Mais maintenant, depuis que les savants de nombreux pays se sont mis à l’étude de ce continent dans le cadre de l’Année Géophysique Internationale, l’Antarctide a indéniablement « conquis » le droit à la couleur jaune.
Essayons donc de colorier de la même façon le tableau de Mendéléev ! Cette fois-ci le résultat est tout autre. La couleur vert foncé n’y figure absolument pas. Il n’y a pas non plus beaucoup de vert pâle, cette couleur étant limitée aux éléments suivants : oxygène, soufre, chlore, fer, silicium, potassium, sodium et plutonium. Quant aux cases jaunes il y en a tant que de loin le tableau rappelle le plumage d’un canari. Le fait est que la plupart des éléments de la classification périodique sont assez mal connus. Nous pouvons en outre y remarquer bon nombre de cases dont, comme l’Antarctide sur la carte de géographie, seuls les contours sont en jaune : les éléments très peu connus.
A ce propos rappelons qu’il existe un volumineux ouvrage de référence en plusieurs tomes appelé catalogue de Gmelin, et qui contient des renseignements sur tous les éléments chimiques et leurs composés inorganiques. Il ne s’agit évidemment pas d’un catalogue au sens ordinaire du terme. On ne le mettrait pas dans sa poche et il n’entrerait même pas dans un porte-documents, ce qui n’est pas surprenant car il comprend près de cent tomes, un tome par élément. En jetant un coup d’œil sur chaque tome, on peut se faire une idée précise de ce qu’on connaît sur tel ou tel élément. Certains tomes sont tellement épais qu’on a beaucoup de peine à les soulever tandis que d’autres ressemblent davantage à un mince cahier d’écolier.
Comme on le voit, il y a bien plus d’« Antarctides » sur la carte de la chimie que sur celle de la Terre.
La maison de la classification périodique
Ainsi donc, les éléments que nous connaissons sont loin d’avoir été étudiés dans une égale mesure. Pourquoi des ouvrages de plusieurs tomes sont-ils consacrés à certains éléments tandis que les renseignements concernant d’autres éléments tiendraient dans dix ou quinze lignes ?
Je suis certain que de nombreux lecteurs ont déjà une réponse toute prête. Ecoutons-les :
« Parce que les éléments chimiques ont été découverts à des époques différentes. Il est évident que le fer, élément connu de l’homme depuis des temps immémoriaux doit être mieux connu que l’hafnium, par exemple, découvert il y a seulement quelques dizaines d’années. »
Cette réponse n’est exacte que dans une certaine mesure. Si on regarde le tableau des dates des découvertes des divers éléments chimiques, l’inconsistance de cette explication saute aux yeux.
En effet, l’yttrium, par exemple, était déjà connu au XVIIIe siècle ; or, il est moins bien connu que le magnésium ou le sodium, découverts au XIXe siècle. Le tantale fut découvert en 1800, onze ans avant l’iode qui pourtant est infiniment mieux connu : alors que les propriétés de l’iode et de ses composés ont fait l’objet de plusieurs livres, tout ce que nous connaissons sur le tantale tiendrait tout au plus dans une mince brochure.
Lors d’une conférence de chimie organisée il y a quelques années, mon attention fut attirée au cours d’une pause par une conversation animée. Plusieurs savants d’âge mûr, fort respectables, discutaient en se coupant mutuellement la parole et en inscrivant rapidement quelque chose au verso de leur programme. Ce n’étaient pas des problèmes scientifiques qui les passionnaient, il s’agissait seulement de savoir de combien d’éléments chacun d’entre eux avait rencontré les composés au cours de sa vie. La palme de cette compétition peu ordinaire revint à un professeur qui, au cours de sa carrière, avait eu l’occasion de manipuler les composés de soixante éléments. Le programme du professeur était couvert de symboles d’éléments qu’il y avait inscrits, et à l’expression des visages de ses interlocuteurs il était évident qu’ils en considéraient le nombre plus qu’imposant.
Soixante éléments… à peine un peu plus de la moitié des « briques » du monde matériel ! Peut-il se faire qu’un homme dont toute la vie a été consacrée à la chimie n’ait pas eu l’occasion de voir les composés de tous les éléments ?
Nous arrivons ainsi à la véritable raison pour laquelle les divers éléments chimiques ont fait l’objet d’études aussi inégales.
Apparemment, ce qui importe c’est la quantité de chaque élément contenue dans l’écorce terrestre (la lithosphère : continents, l’hydrosphère : océans, mers et cours d’eau, et l’atmosphère : couche de fluide gazeux de notre planète) .
Imaginons une maison à plusieurs étages habitée par les éléments chimiques, chacun occupant une surface correspondant à son contenu dans l’écorce terrestre.
L’oxygène occuperait près de la moitié de la maison, 47,2% pour être précis, ce qui correspond à sa proportion dans le poids de l’écorce terrestre. Plus du quart de notre demeure imaginaire serait occupé par le silicium dont la proportion est de 27,6%. Ainsi donc les trois quarts de l’espace habitable seraient occupés par deux grands propriétaires : le silicium et l’oxygène. Les 89 autres éléments chimiques naturels devraient se partager le quart restant !
Mais ce quart serait également divisé d’une façon « injuste ». Le fer représente 8,8% du poids de l’écorce terrestre, le calcium 3,6%, et il existe en tout huit éléments dont la proportion dans l’écorce terrestre s’exprime par des nombres supérieurs à un.
81 éléments doivent donc se partager 0,4% de la surface habitable de cette maison qui symbolise ainsi en quelque sorte l’« injustice » de la nature. En fait, la plupart des éléments de la classification périodique s’entassent dans un étroit réduit de la maison dont la plus grande partie est occupée par huit éléments géants.
La raison pour laquelle nos connaissances diffèrent d’un élément chimique à un autre est donc claire : ils se trouvent en proportions inégales dans l’écorce terrestre. Plus les éléments sont abondants, mieux ils sont connus, voilà tout !
La conclusion est certes correcte, mais… ne dit-on pas que la science tout entière consiste essentiellement en « mais » ? Bien qu’il s’agisse d’une boutade, il y a également un « mais » dans notre cas.
Regardons plus attentivement le tableau de la composition de l’écorce terrestre en éléments. Considérons par exemple le scandium, élément fort rare. Peu de chimistes peuvent se vanter d’avoir vu des composés de scandium. L’écorce terrestre en contient effectivement très peu : à peine six dix-millièmes pour cent. Le voisin du scandium est l’argent, métal également assez rare mais pas autant que le scandium. C’est évident pour tout le monde. Nous serons tous d’accord pour admettre que l’argent est un métal qu’on rencontre assez fréquemment dans la vie courante. Il n’y a sans doute pas un foyer qui ne possède une petite cuiller ou quelque objet en argent. En tout cas chacun de nous possède des photographies et la surface de n’importe quel papier photographique est recouverte de composés d’argent.
Or, l’écorce terrestre ne contient qu’un centmillième pour cent d’argent, soixante fois moins que de scandium !
Le gallium figure maintenant encore au nombre des éléments les plus rares. Il y a seulement quelques années que certains laboratoires de chimie (encore très peu nombreux) ont à leur disposition des composés de gallium. Mais le tableau des éléments atteste d’une façon irréfutable que l’écorce terrestre contient deux cents fois plus de gallium que de mercure, métal pourtant courant et bien connu de tous.
Le nom de l’élément semi-conducteur germanium est actuellement sur toutes les lèvres. On parle partout de sa rareté. Or, le germanium est vingt fois plus abondant dans la nature que l’iode, élément tout à fait ordinaire et bon marché.
Ces exemples suffisent. Il est déjà évident que la « rareté » d’un élément et sa proportion dans l’écorce terrestre sont des notions qui sont loin d’être identiques. La possibilité d’obtenir un élément joue également un grand rôle.
Certains éléments de l’écorce terrestre se trouvent à l’état concentré, soit dans des minerais, soit mélangé en proportions constantes à certains minéraux. D’autres éléments se trouvent pour ainsi dire à l’état « dilué ». L’écorce terrestre contient à peu près autant d’étain que d’yttrium. Or, les gisements d’étain se présentent sous la forme du minéral cassitérite, mais l’yttrium, lui, ne fait partie d’aucun minerai particulier et se rencontre mélangé dans des proportions infimes aux minerais les plus divers. C’est la véritable raison pour laquelle l’yttrium est beacoup moins connu que l’étain.
Il est maintenant clair que l’écrasante majorité des éléments chimiques ne se trouvent qu’en quantités infimes dans l’écorce terrestre. Pour isoler les composés de bon nombre d’entre eux, on est obligé de recourir à des manipulations qui rappellent celles que nous avons décrites au cours des chapitres précédents. Voici donc à nouveau des décimales, à nouveau des quantités infinitésimales, à nouveau la recherche du grand dans du petit…
Des excavations dans une cour
Je voudrais relater un incident malencontreux qui se produisit un jour dans un institut de recherches mais qui se termina, fort heureusement, le mieux possible.
Tout établissement scientifique possède plusieurs coffres-forts dans lesquels sont enfermés les appareils en argent et en platine, les sels d’or et d’autres métaux précieux. Il y avait des coffres-forts de ce genre dans l’institut qui nous intéresse. L’un d’eux attirait les regards respectueux des collaborateurs de l’établissement, car il contenait un quart de gramme de radium, quantité énorme si l’on considère la rareté de ce métal.
A tous ceux que la question intéressait, on précisait volontiers que le radium s’y trouvait non pas à l’état métallique mais en solution aqueuse d’azotate contenue dans un épais récipient en plomb, métal arrêtant les rayons émis par le radium. Le radium était tellement nécessaire aux diverses recherches que les collaborateurs de l’institut devaient s’inscrire sur une liste auprès du chef de laboratoire en attendant avec impatience le jour où ils pourraient enfin se livrer à leurs expériences.
L’incident se produisit au moment où l’institut déménageait dans un nouvel édifice. Tous les collaborateurs étaient en proie à l’agitation coutumière aux déménagements : ils emballaient hâtivement l’appareillage scientifique dans des caisses mal ajustées, se donnaient des coups de marteau sur les doigts, redressaient des clous tordus, bref « aidaient » l’équipe de déménageurs. Ils avaient tous hâte de se remettre au travail dans le nouvel édifice.
Le chaos qui régnait alors peut seul expliquer (mais non excuser !) le fait que le chef de laboratoire, parti en quête de clous, sortit sans prendre la précaution de fermer le coffre-fort. Il ne partait « que pour une petite minute » ! Mais au lieu d’une minute, son absence en dura dix, laps de temps largement suffisant pour ce qui se produisit…
L’un dos déménageurs entra dans la pièce. Il n’y restait plus que deux grosses caisses trop lourdes pour lui seul. Afin de ne pas perdre de temps, il décida de descendre un cylindre métallique qu’il remarqua dans le coffre-fort largement ouvert. Le cylindre était assez pesant et il y remuait quelque chose. Le déménageur dévissa le couvercle et s’aperçut que le cylindre contenait un liquide. « Probablement de l’alcool », pensa-t-il. Mais ce liquide n’avait aucune odeur et selon toute vraisemblance, ainsi que l’œil exercé du déménageur eut tôt fait de s’assurer, c’était de l’eau.
Lorsque le chef de laboratoire se représenta par la suite ce qui se produisit dans les minutes qui suivirent, il fit la grimace et secoua la tête comme si on lui avait versé de l’eau glacée dans le cou. Car le déménageur, prenant une brusque décision, s’approcha de la fenêtre et versa le liquide dans la cour de l’institut. Il revissa ensuite le couvercle et descendit tranquillement le cylindre dans un camion.
Une demi-heure après, le déménageur jurait ses grands dieux qu’il n’avait jamais entendu parler de radium et qu’il était bien certain d’avoir versé de l’eau.
Deux jours plus tard des excavatrices firent leur apparition dans la cour de l’institut. Toute la terre fut chargée dans des camions et expédiée dans une usine de traitement de minerais de radium. Les responsables de ces travaux « de sauvetage » peu communs tenaient à chaque parcelle de la terre argileuse qui recouvrait auparavant la cour de l’institut.
Le radium fut extrait du sol sans difficultés et expédié à l’institut. Est-il besoin d’ajouter que cette fois-ci la garde du métal précieux fut confiée non pas au chef de laboratoire distrait mais à un autre chercheur ?
Cette histoire permettra peut-être au lecteur à se représenter dans une certaine mesure les difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs et le personnel industriel travaillant à l’obtention des éléments rares.
Le radium est un métal des plus rares. Tellement rare que la terre d’une vaste cour imprégnée d’une solution d’un quart de gramme de sel de radium paraît en contenir des quantités considérables car d’ordinaire on doit se contenter de minerais bien plus pauvres.
D’autres éléments suivent d’assez près le record de rareté du radium ; le rhénium, par exemple. Nous aurons à reparler en détail de cet élément qui prend de jour en jour une place accrue dans la technique moderne. L’extraction d’un kilo de rhénium des minerais les plus riches exige un chargement de six cents wagons de chemin de fer !
Actuellement, à l’écholle industrielle, le gallium est extrait de la cendre de certains types de houille. Si une telle cendre en contient plus de deux millièmes pour cent — vingt grammes par tonne ! — elle est considérée comme excellente pour l’extraction du gallium.
On peut en dire autant de tous les autres éléments auxquels la nature n’a réservé qu’un étroit et peu confortable réduit dans la maison des éléments chimiques constituée par l’écorce terrestre.
En lisant ces lignes certains diront peut-être :
« Mais quoi, on aurait bien tort d’incriminer la nature. Si les éléments rares font tellement défaut, tant pis, laissons-les. Nous pouvons sans doute nous contenter des éléments que la nature a placés à notre disposition en quantités suffisantes. »
Cette conclusion est incorrecte surtout parce que les éléments chimiques rares et partant peu étudiés recèlent des propriétés si inattendues qu’elles rempliraient d’étonnement les auteurs, à l’imagination pourtant féconde, des œuvres de science-fiction.
Au cours de ce chapitre nous dirons ce qu’a apporté à la science et à la technique l’étude détaillée des propriétés de certains éléments auparavant peu connus. Ceux-ci serviront d’exemples permettant de se faire une idée de ce que réservent à la science et à la technique les expéditions dans les espaces peu explorés de l’« Antarctide chimique ».
Il est sans doute inutile de raconter chaque fois comment on isole les composés de tel ou tel élément rare. Toutes les méthodes auxquelles on a recours sont semblables à celles que nous avons décrites aux chapitres précédents. Ce qui est bien plus important, ce sont les propriétés de ces éléments et l’utilisation qu’on en fait actuellement ou qu’on en fera dans un avenir proche.
Le plus léger
Si j’avais à tourner un dessin animé de vulgarisation scientifique sur les éléments chimiques, je présenterai une compétition sportive entre les éléments, ce qui serait à la fois amusant et instructif. Nous y verrions une course entre le fluor à l’activité exceptionnelle et les autres éléments. Paresseux et maladroits les gaz inertes nous feraient souvent bien rire. L’agile petit hydrogène se déplacerait à une vitesse vertigineuse. Le mercure, pleurnicheur, verserait de grosses larmes. L’uranium, massif, s’avancerait d’un pas pesant.
Il est presque certain que la palme du nombre de records battus irait au lithium. Cet clément possède le poids atomique le plus faible de tous les métaux connus, seuls l’hydrogène et l’hélium ayant des poids atomiques inférieurs. La densité du lithium, de 15 fois inférieure à celle du fer et la moitié de celle du bois, lui vaudrait un second record. Les navires en lithium posséderaient un port exceptionnel… si ce métal n’avait line telle affinité pour l’eau. Deux adolescents n’auraient aucune peine à soulever une voiture en lithium si celui-ci n’avait une affinité extrême pour l’oxygène et l’azote de l’air.
La troisième « performance » du lithium est l’énorme différence existant entre ses températures de fusion et d’ébullition, atteignant presque 1 200° (100° seulement pour l’eau). Le lithium possède également une aptitude phénoménale à se combiner avec de nombreux éléments, y compris l’azote pourtant si « fier ». Les propriétés ci-dessus suffisent déjà pour valoir au lithium une place de choix parmi les autres éléments de la classification périodique.
Le rôle restreint que le lithium et ses composés ont joué jusqu’à tout récemment dans l’industrie n’en paraît que plus modeste. Il faut en voir la raison dans le fait que les propriétés de ce métal rare étaient encore insuffisamment connues. Le lithium peut maintenant se considérer comme largement récompensé.
Personne n’a jamais tenté de vérifier quel est le composé chimique dont on parle le plus souvent dans les revues scientifiques. D’ailleurs quelle serait l’utilité d’un travail aussi pénible et fastidieux ? Si pourtant ce travail se faisait, je ne doute pas que la palme irait à l’acide lithydrique.
On savait déjà depuis longtemps que le lithium pouvait s’unir à l’hydrogène pour former un hydracide [6]. L’intérêt réside dans le fait qu’un kilo de ce composé ne contient pas moins de mille cinq cents litres d’hydrogène se dégageant aisément quand on introduit l’hydracide dans l’eau.
Mais qui, il y a seulement quelques années, aurait pu supposer que l’acide lithydrique deviendrait le plus puissant des explosifs connus ? Personne n’aurait certes pu prédire que ce simple composé chimique permettrait aux savants de reproduire sur la Terre des processus dont seul le Soleil était jusqu’alors le théâtre.
A vrai dire il ne s’agit pas de l’hydracide mais du deutéride de lithium, composé de lithium et de deutérium (isotope lourd de l’hydrogène).
Au point de vue chimique il n’y a aucune différence entre ces deux dernières substances. Le deutéride de lithium forme la base de la charge de la bombe à hydrogène. Un dispositif de mise à feu à uranium ou à plutonium produit une forte élévation de température qui amorce la réaction nucléaire. Le lithium et le deutérium se combinent alors en se transformant en hélium, libérant ainsi une quantité d’énergie colossale.
Une réaction de ce genre, transformation d’hydrogène en hélium, est la source énergétique du Soleil où, chaque seconde, 570 millions de tonnes d’hydrogène se transforment en 566 millions de tonnes d’hélium. Les réserves d’hydrogène du Soleil sont tellement colossales que le poêle à hydrogène constitué par l’astre du jour est assuré de fonctionner au « régime » actuel pendant de nombreux milliards d’années.
Mais le lithium possède aussi maintenant un certain nombre d’applications pratiques « terrestres », notamment métallurgiques.
L’addition de dix pour cent de lithium à du magnésium forme un alliage plus solide et surtout plus léger que le magnésium qui possède un poids spécifique beaucoup plus faible que la plupart des métaux. L’addition de quantités insignifiantes de lithium à différents alliages modifie souvent leurs propriétés au point de rendre ces alliages méconnaissables.
C’est ainsi que le « scléron », alliage à base d’aluminium, contient 0,1% de lithium. Mais privé de ce 0,1% il perd aussitôt sa solidité et sa dureté, qualités qui lui valent une réputation méritée.
Grâce à leur faible poids spécifique et à leur résistance aux températures élevées, les alliages de lithium et d’aluminium peuvent être utilisés dans la construction d’appareils volant à des vitesses considérablement supérieures à celles du son.
On a récemment effectué des recherches intéressantes sur l’utilisation du lithium comme combustible. La combustion de lithium pulvérisé dans un courant d’air ou d’oxygène dégage une énorme quantité de chaleur.
On a calculé que l’utilisation du lithium comme combustible permettrait d’obtenir d’un kilo de ce métal une chaleur égale à la combustion de quatre mille tonnes de houille.
On s’est aperçu que les sels de lithium des acides stéarique et palmitique constituent d’excellents lubrifiants conservant leurs propriétés entre –50° С et +150° C.
On pourrait encore citer de nombreuses branches techniques et industrielles dans lesquelles le lithium trouve une application pratique.
Mais le nombre de secteurs qui attendent l’utilisation de ce métal remarquable est encore plus élevé. Aussi est-on pleinement en droit d’appeler le lithium métal de l’avenir.
A ce propos, tous les métaux dont nous allons parler sont plus ou moins des métaux d’avenir ainsi que nous le verrons d’après l’exemple du « héros » de la section suivante.
Le métal des matières précieuses
Personne ne saurait affirmer quels motifs poussèrent le savant français Vauquelin à se consacrer à la chimie au cours de la période agitée que traversa la France à la fin du XVIIIe siècle, motifs d’ordre pécuniaire probablement. Non pas que le respectable monsieur Vauquelin ait eu l’intention de se procurer de l’argent d’une manière illicite. Il n’enviait nullement les lauriers du comte de Saint-Germain, le célèbre faussaire en diamants dont les aventures défrayèrent si souvent la chronique de la cour de Louis XVI. Mais tant qu’à s’occuper de chimie, pourquoi ne pas étudier les propriétés et la composition de cette merveilleuse pierre précieuse : l’émeraude, ce duc sinon ce roi des joyaux ?
Malheureusement, il lui fallut bientôt arrêter ses expériences sur les émeraudes : soit qu’elles n’eussent pas abouti, soit que madame Vauquelin eût sévèrement désapprouvé les dépenses ruineuses qu’entraînaient les recherches de son mari dans ce domaine. Certains résultats avaient pourtant été obtenus. De l’émeraude; Vauquelin isola, en 1798, une matière grisâtre qu’à cause de sa saveur doucereuse il nomma « terre sucrée » ou glucine (du grec glukus, doux). Le terme de « terre » servait alors à désigner la plupart des oxydes.
Exactement vingt ans après, on tira de la glucine un métal gris brillant auquel on donna le nom de glucinium ou glycinium. Par la suite, on appela ce métal béryllium, nom qui lui est resté. Un nouveau nom fit ainsi son apparition dans la liste des éléments chimiques.
Mais quarante ans plus tard les propriétés du béryllium étaient si peu connues que Mendé-léev hésita longtemps avant de décider dans quelle case il devait placer cet élément. Sans l’intuition géniale du grand chimiste, le béryllium aurait longtemps circulé sur la table des éléments avant de prendre possession de la case 4.
La « biographie » du béryllium est fort intéressante. Sa « fiche d’état civil » n’est pas moins originale : elle porte 1798 comme année de naissance et 1932 comme début de l’activité laborieuse. C’est effectivement en 1932 qu’on fit pour la première fois usage dans l’industrie de certains alliages de béryllium. Mais comme le preux des anciens chants russes Ilia Mourometz qui resta trente-trois ans oisif avant de passer à l’action de toute sa force herculéenne, des que le béryllium passa au service de l’homme il se mit à faire des merveilles.
L’écorce terrestre contient à peine quelques dix-millièmes pour cent de béryllium, mais ils valent bien la peine qu’on les recherche.
Le poids spécifique du béryllium est un peu plus élevé que celui du lithium, son voisin dans la classification périodique, tout en étant cependant considérablement inférieur à celui de bon nombre d’autres métaux. Le béryllium est le plus résistant des métaux à l’action de l’air à l’état libre. Bien que le béryllium soit moins résistant que l’acier, la différence de densité entre eux est telle qu’à poids égal, une construction en béryllium serait bien plus solide qu’en acier.
On sait que le problème n° 1 des constructeurs aéronautiques est d’abaisser au maximum le poids des pièces. Ils passent parfois des mois à rechercher les moyens de réduire le poids d’un appareil de quelques kilos, étant obligés de s’y attaquer littéralement gramme par gramme : ici ils suppriment une vis, là ils modifient un assemblage ou ils remplacent le métal de certaines pièces par de la matière plastique.
L’utilisation du béryllium débarrassera très prochainement les constructeurs de ces recherches fastidieuses. Les travaux sur les alliages du béryllium avec le magnésium et l’aluminium sont déjà fort avancés et l’on peut affirmer que ces alliages produiront la même révolution dans l’aéronautique que l’emploi de l’aluminium. Il n’a pas été difficile de calculer qu’en remplaçant l’aluminium par des alliages de béryllium on augmenterait le rayon d’action des appareils.
Cette simple application du béryllium montre déjà clairement l’intérêt qu’il y a à soumettre les éléments rares à une étude plus intense car ils sont appelés à jouer un rôle fantastique. Le fait qu’ils soient peu abondants par rapport aux éléments « géants » ne présente pas d’inconvénient majeur. La chimie n’est-elle pas là pour y remédier ?
Les chimistes ont d’ailleurs justifié les espoirs placés en eux. Ils ont déjà mis au point plusieurs procédés destinés à obtenir du béryllium bon marché à partir des matières premières les plus pauvres en cet élément.
Les recherches tendant à trouver d’autres procédés d’extraction du béryllium et de nouvelles sources de matières premières se poursuivent d’ailleurs à un rythme accéléré. L’usage de ce métal se répand en effet de plus en plus dans la technique et l’industrie.
Un nouveau terme qui n’existait pas encore dans le vocabulaire chimique et technique il y a une dizaine d’années, a fait son apparition : la béryllisation. Ce terme est en passe de devenir aussi courant que ceux de « laminage », « trempe » et autres mots du même genre. La béryllisation consiste à placer une pièce d’acier chauffée à blanc dans de la poudre de béryllium. L’infime quantité de béryllium qui pénètre alors dans la couche superficielle de l’acier le recouvre ainsi d’une sorte de cuirasse d’alliage de béryllium. C’est à dessein que j’ai choisi le mot de cuirasse, car la pièce traitée de la sorte acquiert une résistance et une dureté nettement plus élevées.
Les pièces béryllisées s’usent plusieurs fois moins vite que les pièces en acier. Le plus intéressant est que ce traitement ne requiert qu’une quantité infime de béryllium. Lorsque le procédé est utilisé correctement, un kilo de béryllium permet de traiter des centaines, voire des milliers de pièces diverses.
Il ne se passe pas de mois sans que nous apprenions de nouveaux détails sur les remarquables propriétés des alliages de béryllium. On s’est aperçu qu’il suffisait d’ajouter deux pour cent de béryllium à du cuivre pour obtenir un alliage plus dur que l’acier inoxydable. L’addition de béryllium confère d’ailleurs aux alliages une propriété supplémentaire : la résistance à la « fatigue ». On a en effet constaté que les objets métalliques sont également sujets à la fatigue. Les meilleurs ressorts d’acier, par exemple, sont incapables de résister à plus d’un million de compressions, alors que les ressorts en bronze de béryllium, alliage de béryllium et de cuivre, sont capables d’en supporter 25 fois plus.
On sait que le cuivre est un excellent conducteur de l’électricité. Or, l’addition à du cuivre d’une faible quantité de béryllium en améliore encore considérablement la conductibilité. Il est superflu d’insister sur l’avantage que représente cette propriété du béryllium dans l’industrie, puisque les déperditions de courant sont d’autant plus réduites que la conductibilité est plus élevée.
Le béryllium est devenu irremplaçable dans la fabrication des ampoules de Rœntgen utilisées en radioscopie. Il est aux rayons X ce que le verre le plus transparent est à la lumière. Alors que la presque totalité des métaux s’opposent au passage des rayons X, le béryllium, lui, est « transparent » à ces rayons.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur le béryllium, métal qui est en quelque sorte en train de renaître pour une vie d’actions glorieuses.
Quinze jumeaux
Un récit détaillé de la façon dont furent découverts les quinze éléments contenus dans une seule case du tableau de Mendéléev serait non moins passionnant et dramatique que l’Odyssée, par exemple, et, en tout cas, plus long. Les aventures du vaillant et ingénieux Ulysse ne sont rien en comparaison de celles que vécurent les chimistes avant de réussir à mettre un ordre relatif entre les cases 57 et 71 de la classification périodique.
Il s’agit de l’intervalle occupé par les éléments du groupe dit des terres rares. Leur dénomination témoigne déjà de leur grande rareté. Il y a seulement une dizaine d’années, les composés de métaux des terres rares n’apparaissaient guère qu’à l’occasion d’expériences de chimie inorganique pratiquées en salle de cours. Alors, le professeur qui sortait de sa poche de gilet une éprouvette hermétiquement bouchée contenant une poudre d’aspect ordinaire, quelque sel de néodyme ou d’ytterbium, se gardait bien de la faire circuler dans les rangées de peur qu’elle ne soit brisée, mais ne manquait jamais, en revanche, de se lancer dans de longues digressions sur la façon dont il avait réussi à se procurer cet échantillon.
Un récit même très succinct de l’histoire de la découverte des éléments des terres rares constituerait un traité scientifique d’une centaine de pages. Dès 1800 des dizaines de savants de divers pays se penchèrent sur le problème des éléments contenus dans les terres rares. De nombreuses années furent nécessaires même à un esprit aussi puissant que Mendéléev pour décider la place qu’il convenait d’attribuer à ces métaux dans la classification périodique. Des monceaux de papier furent couverts d’écrits et plus d’une théorie fut rejetée avant qu’on ne décide de placer ces quinze éléments dans une seule case.
En effet, les éléments des terres rares se ressemblent plus entre eux que bien des jumeaux. Ils sont inséparables, tant dans la classification périodique que dans la nature. On ne peut jamais les voir l’un sans l’autre. Mais les « maîtres » de ces éléments jumeaux, les chimistes, ne se laissèrent pas attendrir par cette touchante amitié. Elle leur valut, au contraire, bien des moments pénibles. C’est que l’étonnante similitude entre les propriétés chimiques des éléments des terres rares complique singulièrement les opérations nécessaires à leur séparation. Jusqu’à ce qu’on trouve le moyen de déterminer expérimentalement le numéro d’ordre de tel ou tel élément, les chimistes n’étaient jamais certains qu’un élément donné appartenant au groupe des terres rares ne fût pas en réalité un mélange de plusieurs éléments.
Si on regarde le schéma représentant l’ordre dans lequel furent découverts les éléments du groupe des terres rares, on se trouve en présence d’une situation semblable à celle de la reproduction de bactéries. Au début on ne connaissait que deux de ces éléments : l’yttrium et le cérium. Puis on s’aperçut que le cérium contenait un second élément, appelé lanthane. Le lanthane ne resta pas longtemps seul. Des recherches méticuleuses révélèrent que l’élément considéré auparavant comme du lanthane pur était en réalité un mélange de lanthane et de didyme. Mais c’est en vain qu’on chercherait cet élément dans la classification périodique. On s’aperçut en effet quelques années plus tard que le didyme consistait à son tour en deux éléments : le didyme proprement dit et le samarium. Or, ce didyme se révéla lui aussi être un mélange de deux éléments qu’on appela praséodyme et néodyme. Quant au samarium il ne voulut pas demeurer en reste lui non plus et il « essaima » les éléments gadolinium et europium.
Le même phénomène se produisit pour l’yttrium qui « engendra » successivement les éléments erbium, terbium, holmium, thulium, dysprosium et lutécium.
Maintenant nous connaissons parfaitement la raison de l’étonnante ressemblance entre les éléments de numéros d’ordre de 57 à 71. Comme pour les éléments artificiels de la famille des actinides dont nous avons déjà parlé, la couche électronique externe possède une structure identique chez tous les éléments des terres rares.
Etant donné que la séparation des lanthanides les uns des autres est fort difficile, les propriétés de chacun d’entre eux étaient encore très mal connues jusqu’à ces tout derniers temps. La chimie de ces éléments représentait une région de terres vierges en quelque sorte. Mais quand on eut tracé les premiers sillons des recherches scientifiques, des pousses fort drues ne tardèrent pas à apparaître.
Commençons par dire que d’année en année l’appellation même de « terres rares » devient de plus en plus inexacte. On a en effet découvert que l’écorce terrestre en contient beaucoup plus qu’on ne le croyait jusqu’alors. Bien que la proportion des lanthanides soit très faible, seize millièmes pour cent en tout, elle dépasse cependant celle de nombreux autres éléments. Pour les chimistes, la manipulation de quantités s’exprimant à l’aide de six ou sept décimales est chose tout aussi courante que de prendre l’autobus et ils n’éprouvent pas de difficultés particulières à isoler et purifier les composés des éléments jumeaux. Il est cependant évident que dans la majorité des cas on ne peut se passer des méthodes microchimiques. La chimie des éléments des terres rares illustre une fois de plus, et d’une manière très nette, comment la recherche des substances qui s’abritent parmi les décimales éloignées de la virgule a donné de nouvelles matières remarquables à la technique. Certes, même actuellement, quelques lanthanides font encore cruellement défaut. Le lutécium et le thulium, par exemple, sont respectivement 200 et 350 fois plus chers que l’or, non à cause de leur rareté mais de la difficulté à les séparer.
Depuis qu’on a appris à se contenter de quantités infimes pour l’étude des propriétés des éléments d’obtention difficile, les propriétés chimiques des métaux des terres rares nous sont devenues beaucoup plus familières.
Il y a vingt ans, la relation même la plus complète de tout ce qui était connu sur les propriétés chimiques des lanthanides aurait sans doute tenu dans une modeste brochure de moins de cent pages, de nos jours par contre elle nécessiterait une dizaine de tomes volumineux bourrés de chiffres, de formules, de schémas, etc.
Des changements de même ampleur ont eu lieu dans le domaine de l’utilisation pratique des éléments des terres dites rares.
Pendant près de 75 ans l’application des lanthanides fut limitée à la fabrication d’un alliage pour pierres à briquet. Mais nul parmi ceux qui allumaient alors leur cigarette à un briquet invariablement capricieux, pas même le chimiste, ne se doutait que chacun des métaux de cet alliage à étincelles deviendrait un jour important en métallurgie et dans l’industrie chimique.
Examinons au hasard un certain nombre de ces métaux, le thulium par exemple. Il y a une dizaine d’années, les plus volumineux manuels ne contenaient pas plus de quelques lignes sur cet élément, et encore en petits caractères, maintenant on pourrait aisément lui consacrer un livre entier, de grosseur fort respectable.
L’isotope artificiel radio-actif du thulium, à poids atomique 170, émet des rayons gamma de même nature que les rayons X. Cette dernière phrase, qui paraît empruntée à un ouvrage spécialisé, révèle en réalité une révolution dans un vaste domaine de la technique et de la médecine — celui de la radioscopie.
Chacun d’entre nous a eu l’occasion ne serait-ce qu’une fois dans sa vie de passer au cabinet de radiologie, qui est sans doute le plus mystérieux des cabinets de toute polyclinique. Le radiologue est dissimulé dans des ténèbres impénétrables. Seule une petite lampe rouge jette une faible lueur dans le fond du cabinet. L’écran émet une bizarre lumière verte. L’apparition sur cet écran du squelette de la personne qui vous précède vous remplit aussitôt d’un respect légitime pour la technique radiologique, respect qui ne ferait qu’augmenter si vous aviez l’occasion de vous familiariser avec la fabrication des appareils de radiographie. Il est vrai que les non-initiés auraient bien du mal à donner un sens à tout ce savant enchevêtrement de fils et à toutes ces ampoules de dimensions impressionnantes.
Actuellement les rayons X ont de nombreuses applications pratiques qui dépassent d’ailleurs le domaine médical. Il paraît superflu d’insister sur l’utilité des rayons X dans celui-ci ! Seule la radiologie permet de diagnostiquer un grand nombre de maladies. Les rayons X ne sont pas moins utiles en technique radiométallographique, servant à l’examen des objets métalliques. Ils permettent de déceler à coup sûr les pièces défectueuses dans lesquelles se dissimulent des fêlures ou des espaces vides invisibles de l’extérieur. Cependant, la masse considérable de l’appareillage restreint l’utilisation des rayons X. Le médecin qui va examiner un malade emporte une trousse garnie des appareils et instruments de médecine les plus divers : stéthoscopes, seringues, appareils à mesurer la tension artérielle ou à vérifier l’activité cardiaque, mais il ne lui est pas possible d’emporter un appareil de radioscopie, accessoire dont il aurait pourtant grand besoin.
Heureusement, cette difficulté sera bientôt du domaine du passé, et cela grâce à l’élément des terres rares thulium. Les appareils de radiologie à base de thulium seront ridiculement simples : une ampoule contenant une quantité quasi impondérable de thulium ou d’un de ses sels, un petit manchon pour protéger des radiations et un écran de dimensions réduites pour y projeter l’image. Je ne sais si un appareil de ce genre pourra entrer dans un sac à main mais il tiendra à coup sûr dans une serviette. Un appareil de radiologie à thulium voisinera donc très prochainement avec les stéthoscopes dans la trousse du médecin.
Est-il nécessaire d’ajouter que les appareils à base de thulium radio-actif deviendront également les auxiliaires irremplaçables des spécialistes chargés de contrôler la qualité des pièces métalliques ?
Le prométhium, cet élément qu’on n’a pas encore réussi à trouver dans la nature et que pour l’instant on obtient artificiellement, est également promis à un avenir brillant. Et ici les écrivains de récits fantastiques pourraient s’en donner à cœur joie ! Il est d’ailleurs possible que je me trompe, car il n’y a, en réalité, rien de fantastique dans ce que je me propose de dire sur le prométhium ; il n’y a que des comptes rendus d’expériences sévères et précis, des appareils déjà au point, la fantaisie peu ordinaire des savants, mais pas de fantastique.
On s’est aperçu que les émissions radio-actives du prométhium (des électrons, ou rayons bêta) pouvaient être utilisées comme source d’énergie. Une trace de prométhium absolument infime suffit à fabriquer une pile miniature capable de fournir une quantité d’énergie assez impressionnante vu ses dimensions réduites. C’est ainsi qu’une pile à prométhium guère plus grande qu’une tête d’épingle est capable d’actionner le mécanisme d’une montre-bracelet pendant cinq ans. Il existe déjà des appareils acoustiques utilisant des piles à prométhium (on sait que l’inconvénient majeur des appareils acoustiques ordinaires était la nécessité de porter sur soi des piles électriques qu’il fallait recharger fréquemment).
Le calcul de ce que peut donner une pile à prométhium de la grosseur d’un œuf est sans doute simple affaire d’arithmétique. Le lecteur peut ici donner libre cours à son imagination : il risque peu dé se tromper. Mais pourquoi l’auteur n’en ferait-il pas autant (sans dépasser la mesure bien entendu) ? Du reste, s’agit-il bien là d’imagination. J’ai eu l’occasion de faire une conférence sur certaines réalisations de la chimie contemporaine devant un auditoire de jeunes. Je mentionnai, entre autres choses, les merveilleuses propriétés du prométhium. Le conférencier qui m’avait précédé, célèbre médecin soviétique spécialiste de la chirurgie du coeur, avait parlé des remarquables succès de la médecine soviétique. A la fin de la soirée il m’invita à passer chez lui et me posa des questions détaillées sur le prométhium et en particulier sur les piles. La raison de cet intérêt subi pour la nouvelle source d’énergie devint bientôt évidente. Il y a des années que les médecins de divers pays envisagent la création d’un cœur artificiel. Non pas de l’un de ces volumineux appareils à l’aide desquels on effectue des opérations sur le cœur, mais d’un organe artificiel que le malade pourrait porter sur lui en permanence. Un tel « malade » serait d’ailleurs en meilleure santé que la plupart des gens bien portants possédant un cœur ordinaire, car son cœur à lui ne connaîtrait aucune fatigue.
Cependant les divers projets de cœur artificiel portatif appartiennent encore au domaine de la semi-fantaisie. La difficulté majeure réside dans la source d’énergie. Notre cœur doit fournir un travail tellement intense que même une pile pesant un kilo ne suffirait à un cœur artificiel que pour un peu plus d’une heure.
A cet égard le prométhium peut jouer un rôle d’une portée exceptionnelle. Il est vrai que pour l’instant tout le prométhium dont disposent les laboratoires du monde entier ne suffirait probablement même pas pour un seul « moteur cardiaque ».
L’histoire de la science connaît cependant bon nombre d’exemples de métaux initialement rares dont le prix de revient baissa par la suite en quelques années vertigineusement. Lors de son séjour à Londres en 1889, Mendéléev reçut en cadeau une balance dont l’un des plateaux était en or et l’autre en un métal incomparablement plus précieux à l’époque, c’est-à-dire en… aluminium. Or, à peine cinquante ans plus tard, l’aluminium était devenu un matériau tout aussi ordinaire que le bois.
Après tout cela, je crains fort que le récit de l’usage « prosaïque » des autres éléments du groupe des terres rares ne paraisse ennuyeux. Je prie pourtant le lecteur de croire que l’importance colossale qu’acquièrent d’année en année les éléments des terres rares dans l’économie n’en sera pas pour autant diminuée.
L’addition de lanthanides à la fonte exerce un effet véritablement magique sur cet alliage habituellement cassant. Les éléments des terres rares atténuent considérablement la fragilité de la fonte tout en augmentant sa résistance dans la même proportion. On sait que la fonte ordinaire se prête difficilement au façonnage, mais si on y incorpore des métaux des terres rares, on peut même l’usiner sur un tour. La quantité de métal nécessaire est d’ailleurs infime et varie de trois cents grammes à deux kilos par tonne de fonte. L’essentiel est que pour cette opération les métaux des terres rares n’ont pas besoin d’être séparés les uns des autres : ils produisent tout l’effet désiré même ajoutés ensemble.
On a découvert ces dernières années que les éléments des terres rares pouvaient servir à la fabrication de verre de qualité convenant à la confection de lentilles de télescopes, de hublots de bathysphères et de récipients destinés à contenir des substances particulièrement pures.
L’intérêt des chercheurs pour les éléments jumeaux est tellement considérable que pas un mois ne s’écoule sans que ne viennent de nouvelles découvertes fondamentales dans ce domaine. On a récemment fait connaissance avec les propriétés peu communes du gadolinium. On s’est aperçu qu’il pouvait être utilisé pour l’obtention de températures excessivement basses : on place du sulfate ou du chlorure de gadolinium dans un gaz inerte et on le soumet à l’action d’un champ magnétique ; la température du sel s’élève et sa chaleur se communique au gaz ; ce dernier est ensuite évacué et l’effet du champ magnétique interrompu ; le gadolinium subit un abaissement de température considérable par rapport à sa température initiale.
En répétant plusieurs fois l’opération, les chercheurs sont parvenus à atteindre une température ne dépassant le zéro absolu que de deux dix-millièmes de degré.
Il y a cent ans on connaissait ou plutôt on devinait l’existence de bon nombre de lanthanides mais on ne savait pas en isoler les composés à l’état pur. A l’Exposition Universelle de Paris de 1900, on choisit d’illustrer les énormes réalisations de la chimie à l’aide d’échantillons d’éléments des terres rares à l’état pur. Il y a une quinzaine d’années la séparation de ces éléments était considérée comme une opération extrêmement difficile mais maintenant on peut obtenir des échantillons de lanthanides à l’état pur dans le laboratoire le plus ordinaire. N’importe quel assistant en est capable. Il trouvera toutes les instructions nécessaires dans les travaux bien connus publiés dans ce domaine et reproduits dans les manuels destinés aux élèves des établissements d’enseignement supérieur.
Ainsi, pour la première fois dans l’histoire géologique de notre planète, l’homme a troublé la touchante union des éléments des terres rares et brisé l’harmonie de la famille des métaux jumeaux.
Une vieille revue humoristique présenta un jour un dessin montrant la scène suivante : une dizaine de personnages barbus d’une ressemblance évidente avec d’éminents savants russes de l’époque traînaient vers une voie de chemin de fer un escargot qu’ils avaient attrapé au lasso et sur lequel était écrit le mot « science ». Ce dessin signifiait sans doute que le rythme du développement de la science s’accélérait. Je ne sais si un dessin analogue paraîtrait amusant de nos jours, mais ce dont je suis certain, c’est qu’il conviendrait de remplacer la locomotive par une fusée cosmique. L’histoire des éléments jumeaux que nous venons de raconter en est la meilleure confirmation.
La milliardième partie de l’écorce terrestre
Nous ne réussirons évidemment pas à parler de toutes les régions de l’« Antarctide chimique ». Le nombre des éléments qui, récemment encore, étaient hors de portée des chercheurs et de l’industrie est trop élevé. Mais il est certaines « taches blanches » qu’on ne saurait passer sous silence. Il est même impossible de n’en parler que brièvement.
C’est à une région de ce genre qu’appartient la 75e case de la classification périodique, celle du rhénium, le « benjamin » des éléments d’après la date de sa découverte. De tous les éléments que contient l’écorce terrestre, le rhénium a été le dernier à se dévoiler. Le symbole Re n’a pris la place du point d’interrogation de la 75e case qu’en 1925. Toutes les additions ultérieures dans la classification périodique sont dues à l’obtention d’éléments artificiels.
La découverte tardive du rhénium s’explique par sa rareté exceptionnelle : il ne représente que la milliardième partie du poids de l’écorce terrestre, cinq fois moins que l’or ou le platine.
Voilà pourquoi aucun autre élément n’a réussi aussi longtemps à tromper les chimistes que ce métal à l’aspect d’argent terni ne présentant, à première vue, aucune particularité spéciale si ce n’est son poids spécifique élevé.
Le nombre des expéditions chargées, auparavant, de mettre la main sur « l’homme des neiges » n’est rien à côté du nombre des chercheurs qui s’étaient consacrés à la recherche du rhénium.
Dans une de ses études littéraires intitulée A la poursuite des plantes l’écrivain Paoustovski écrit : « On sait que les savants sont doués d’une persévérance monstrueuse, capable de faire perdre patience à l’homme le plus calme ». Eh bien, en l’occurrence, le contraire se produisit. Le mystère du 75e élément contraignit plus d’un chercheur à renoncer à son but et bon nombre de ceux qui persévérèrent finirent tôt ou tard par pester contre l’occupant inconnu peu conciliant de l’appartement 75.
Ce 75e élément paraissait avoir été découvert en 1869 par Guiar qui lui donna le nom d’« uralium », mais, par la suite, il renonça à ses conclusions, évitant ainsi le triste sort du chimiste Rose dont la communication enthousiaste sur la découverte en 1846 de l’élément pélopium fut alors démentie par plusieurs chercheurs à la fois. Le même sort attendait l’élément nipponium décrit en 1906 par Ogawa, ainsi que le lucium dont Barrière annonça la découverte en 1896, et beaucoup d’autres encore.
Mais il semble bien qu’il n’y ait pas eu d’erreur dans la communication que le chimiste russe S. Kern fit paraître le 27 juin 1877 et dans laquelle il indiquait avoir découvert dans les résidus résultant du traitement des minerais de platine un nouvel élément, qu’il proposa d’appeler davium en l’honneur du célèbre chimiste anglais Davy. La détermination du poids atomique et des propriétés chimiques du davium montrèrent qu’il devait occuper dans la classification périodique la place prévue par Mendéléev pour l’élément appelé par lui dvi-manganèse. Une vingtaine d’années plus tard le chimiste américain Mallet effectua de nouveau les travaux de Kern mais sans réussir à obtenir dans les résidus de minerai de platine l’élément isolé par le chercheur russe. Soit que le minerai de platine fût d’une autre provenance que celui dont s’était servi Kern, soit que Mallet fut un chimiste inexpérimenté, toujours est-il que la découverte du davium ne se confirma pas. La communication de Mallet ne provoqua aucune réponse de la part de Kern qui devait être mort depuis lors, mais comme on a toujours tendance à suivre plutôt les critiques, un point d’interrogation fit à nouveau son apparition dans la case 75.
Ce fut seulement lorsque la preuve indéniable de l’existence du 75e élément, le rhénium, fut établie par Noddak, Tack et Berg que les chimistes s’aperçurent de l’identité entre les réactions décrites en son temps par Kern pour le davium et celles du rhénium.
Ainsi une critique inexacte retarda de près de cinquante ans la date de la découverte remarquable d’un nouvel élément.
Seuls cinq éléments chimiques naturels peuvent se vanter de posséder dans le chiffre exprimant leur contenu dans l’écorce terrestre un nombre de zéros supérieur à celui du rhénium. Ce sont le polonium, le radon, le radium, l’actinium et le protactinium. Le rhénium possède sur eux l’indéniable avantage qu’actuellement on le produit à l’échelle industrielle. L’élément qu’il y a un peu plus de vingt ans on aurait vainement cherché dans la collection la plus complète est actuellement produit dans des usines spéciales !
Les propriétés du rhénium sont en effet apparues tellement intéressantes et prometteuses pour la technique moderne que la chimie a estimé de son devoir de mettre au point des procédés permettant d’obtenir cet élément en grandes quantités.
Le rhénium est l’un des métaux les plus réfractaires. De nos jours, alors qu’on est en présence de températures élevées dans de nombreux domaines de la science et de la technique, surtout dans la construction d’avions à réaction, cette propriété du rhénium apparaît comme exceptionnelle. Un seul métal fond à une température plus élevée que le rhénium, c’est le tungstène. 3 200°, température de fusion du rhénium, est déjà cependant un chiffre assez impressionnant.
La deuxième propriété rendant le rhénium si précieux est son inertie chimique. Il ne se combine pas à l’oxygène de l’air même à une température de 1 500° C. Il ne subit aucune modification aux températures ordinaires. Une plaque brillante de rhénium ne se ternit pratiquement pas. On se représente aisément les applications que ce métal peut trouver dans les industries automobile et aéronautique.
La plupart des acides n’exercent aucun effet sur le rhénium. Il reste absolument « impassible » même si on l’arrose d’acide fluorhydrique chaud, pourtant fort caustique. Aussi l’addition d’une dose insignifiante de rhénium rend-elle de nombreux alliages inattaquables aux acides. Les appareils de chimie en alliage de rhénium résistent plusieurs dizaines de fois mieux à l’usure que les instruments en alliage ordinaire.
Il n’est nullement besoin d’être prophète pour prédire que dans un avenir très proche le rhénium remplacera le tungstène dans grand nombre de domaines techniques. Ceci s’explique principalement par le fait qu’à températures élevées, le rhénium est plus résistant que le tungstène, raison pour laquelle la surface des pièces soumises au frottement dans les machines particulièrement importantes sont dès maintenant recouvertes de rhénium si ce frottement provoque une forte élévation de température. Ajoutons que le rhénium se prête en outre aisément à l’obtention de couches électrolytiques de bonne qualité, propriété particulièrement précieuse.
Ainsi donc, l’un des domaines de l’application du rhénium repose sur l’utilisation de ses remarquables qualités mécaniques et de son inertie. Mais autant le rhénium est stable envers de nombreuses substances autant il se distingue par son aptitude à provoquer des réactions chimiques sans subir lui-même de modification. En d’autres termes on s’est aperçu que le rhénium constituait un excellent catalyseur pour un grand nombre d’importantes réactions chimiques. Il s’agit là du second domaine d’applications étendues de ce métal de l’avenir.
Quelques années à peine après la découverte du rhénium, il apparut qu’il catalysait la réaction entre le gaz carbonique et l’hydrogène, produisant du méthane. On ne saurait surestimer l’importance de cette réaction, le méthane étant un excellent combustible, facilement transportable, brûlant à une température élevée sans suie ni fumée. Mais le plus important est que le méthane est le produit de base d’une foule de produits chimiques. Quant au gaz carbonique et à l’hydrogène, ce sont les sous-produits d’un grand nombre d’industries. La combustion de la houille et du pétrole libère chaque jour des centaines de milliers de tonnes de gaz carbonique. L’hydrogène se forme également lors de l’obtention par électrolyse d’oxygène et de nombreux métaux, sa présence étant alors indésirable.
Le rhénium permet de transformer ces résidus en une matière première fort utile pour l’économie. Les oxydes de rhénium constituent d’excellents catalyseurs dans un processus aussi important pour la technologie chimique que l’oxydation par l’oxygène de l’air du gaz sulfureux, réaction servant de base à la préparation industrielle de l’acide sulfurique.
Ainsi c’est évident : l’avenir appartient au rhénium. Mais il reste à résoudre un problème majeur avant que ce métal ne devienne d’un usage courant dans l’industrie : la mise au point d’un procédé d’extraction rapide et bon marché du rhénium à partir de ses minerais. C’est là une tâche ardue mais sa solution ouvrira de telles perspectives à l’économie que les chimistes qui s’y consacrent pourront en tirer une fierté légitime.
La base du siecle de l’atome
On réunira peut-être un jour tous les écrivains d’œuvres de vulgarisation scientifique concernant la chimie et on leur proposera de consacrer un livre à l’un des éléments. L’un choisira l’iode, un autre le fer, un autre encore le sodium. Ce seront là des livres très intéressants, car il y a énormément de choses instructives à dire sur n’importe lequel des éléments. En ce qui me concerne, je choisirai évidemment l’uranium.
Ecrire un livre sur cet élément serait une tâche fort intéressante, car l’histoire de l’uranium est autrement plus passionnante que les aventures du valeureux d’Artagnan et en tout cas bien plus instructive.
Il serait assez tentant de comparer l’uranium au vilain petit canard qui finit par se transformer en un cygne magnifique mais cette comparaison serait inexacte car le vilain petit canard du conte d’Andersen est infiniment plus proche du cygne que l’uranium du XIXe siècle ne l’est de l’uranium du XXe. On pourrait sans doute dire qu’au cours des quelque 150 ans qui se sont écoulés depuis sa découverte, l’uranium a fait une carrière éblouissante puisque jadis élément aux propriétés connues seulement d’un cercle étroit de spécialistes il est devenu un élément auquel tout le monde s’intéresse. Mais même cette comparaison, ainsi qu’on le verra par la suite, donne une idée très imparfaite de la situation.
3 • 10–4. Trois dix-millièmes pour cent. Trois grammes par tonne. Telle est la proportion de l’uranium dans l’écorce terrestre. Deux fois moins que le samarium, trois fois moins que le gadolinium, dix fois moins que l’étain. C’est peu, fort peu.
On peut considérer la découverte de cet élément par Klaproth en 1789 comme très importante, mais sa naissance fut sans aucun doute prématurée. Le XIXe siècle commença, puis s’écoula en grande partie sans que les savants sachent encore ce qu’il convenait de faire de l’uranium et à quoi il pourrait bien servir. On pouvait il est vrai rencontrer des composés de cet élément dans les laboratoires des photographes particulièrement méticuleux. Les vieux ouvrages signalent qu’à un moment donné l’uranium fut utilisé dans l’industrie de la céramique et dans la production de la peinture dite « jaune d’uranium » mais ces faits n’y figurent sans doute que faute de pouvoir citer d’autres applications pratiques de cet élément. Il est possible qu’on n’ait jamais fabriqué plus d’une ou deux dizaines de tonnes de la peinture en question.
Même après la découverte de la radio-activité de l’uranium, l’intérêt pour ce métal garda un caractère purement académique. Comment pouvait-on en effet sérieusement penser à l’application pratique d’un élément dont l’écorce terrestre contenait une quantité aussi infime ?
L’intérêt pour l’uranium augmenta quelque peu au XXe siècle à cause de son compagnon habituel, le radium. On se mit à extraire des minerais d’uranium afin d’en isoler le radium, élément auquel les savants portaient en son temps un intérêt tout particulier. Cependant rien ne permettait de prévoir que le moment était proche où ruranium deviendrait l’élément essentiel de l’économie d’une série de pays. Ce fait date des années 40, lorsqu’on s’aperçut que l’isotope d’uranium à poids atomique 235 et le plutonium, obtenu à partir de l’uranium, étaient à la base de la production de l’arme nucléaire. Elément chimique négligé, l’uranium se transforma en une matière première minérale stratégique de tout premier ordre.
D’habitude les éléments radio-actifs ne se rencontrent dans l’écorce terrestre qu’à l’état « délaye ». Mais avec l’uranium l’humanité eut de la chance car il a ses propres minerais qui ne sont pas tellement rares. A vrai dire, on ne saurait qualifier ces minerais de riches. Le traitement nécessaire à l’obtention de composés d’uranium plus ou moins purs comporte près d’une vingtaine d’opérations minutieuses. Mais du moment qu’il s’agit d’uranium, aucun effort ne saurait paraître excessif.
Il existe au Canada un grand lac de l’Ours. Un jour on découvrit des gisements d’uranium sur ses rives. Il est probable qu’aucun journal ne consacra alors le moindre entrefilet à cet événement. Mais dès qu’on eut pris conscience de l’importance de l’uranium pour la production de la bombe atomique, les monopoles américains se ruèrent vers le Canada en jouant des coudes. Les concurrents ourdissaient des intrigues les uns contre les autres. Les compagnies faisaient faillite les unes après les autres. Il s’en créait aussitôt de nouvelles, tout aussi fictives que les précédentes. Les sociétés pour l’achat de « blé » canadien naissaient par dizaines, mais pas un seul grain de blé ne quittait le territoire du Canada. Une seule chose intéressait toutes ces compagnies : l’uranium. Cette lutte bien caractéristique des mœurs capitalistes se serait sans doute poursuivie encore longtemps si l’Etat canadien, conscient de l’importance du problème atomique, n’avait lui-même mis la main sur les gisements d’uranium.
Mais la fièvre de l’uranium ne tomba nullement. Gonflant démesurément l’histoire d’un Irlandais qui avait découvert un petit gisement d’uranium grâce à un radiomètre de sa fabrication, des compagnies firent des bénéfices fabuleux grâce à la vente d’appareils similaires. Des milliers de prospecteurs explorèrent les montagnes et les régions désertiques dans l’espoir d’y trouver de l’uranium. Cette fièvre n’est pas encore tombée même actuellement. Le « virus » de l’uranium s’est introduit jusque dans les colonnes des revues scientifiques sérieuses.
L’exemple de l’uranium montre à quel point sont justifiés les efforts des chimistes qui se consacrent à l’étude détaillée des propriétés des éléments peu connus. Chacun des éléments aussi négligés actuellement que l’était l’uranium dans un passé récent est en effet susceptible de servir un jour de base à des découvertes capitales et de partager ainsi la fortune de l’uranium, élément qui était destiné à influer sur le développement de l’humanité.
Le lithium, le béryllium, les éléments des terres rares, le rhénium, l’uranium… Voilà tout ce que nous avons eu le temps d’examiner dans ce chapitre. Certains éléments ont été laissés de côté faute de place, d’autres ont été passés sous silence parce que, pour l’instant, on n’en sait pas grand-chose.
Mais les exemples cités prouvent suffisamment qu’il n’y a pas d’éléments inutiles. Tous les éléments de la classification périodique sans exception doivent être mis au service de l’homme. Quant au fait que certains d’entre eux ne se trouvent dans l’écorce terrestre qu’en quantité infime nous avons pu voir tout au long de ce livre qu’il ne présentait pas d’inconvénient majeur pour les chimistes. Ceux-ci obtiennent avec tout autant de succès les éléments géants et ceux qui sont dissimulés dans la nature loin de la virgule des décimales.
Nous nous sommes bornes à un seul problème de la chimie contemporaine, celui des substances extra-pures et des quantités de matière infinitésimales. Un seul problème… Or, il y en a des centaines, chacun d’entre eux étant pour le moins aussi intéressant et important que celui auquel le présent volume a été consacré.
Ю. ФИАЛКОВ
Девятый знак
На французском языке
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» МОСКВА
Y. Fialкоv
La neuvième décimale
ÉDITIONS MIR
Moscou • 1966
UDC 533.9 (0,23)-40
Traduit du russe par I. Sоkolov
Copyright by les Editions Mir. U.R.S.S. 1966
A NOS LECTEURS
Les Editions Mir vous seraient très reconnaissantes de bien vouloir leur communiquer votre opinion sur le contenu de ce livre, sa traduction et sa présentation, ainsi que toute autre suggestion.
Notre adresse: Editions Mir,
1er Rijski péréoulok,
Moscou, U.R.S.S.
Imprimé en Union Soviétique