
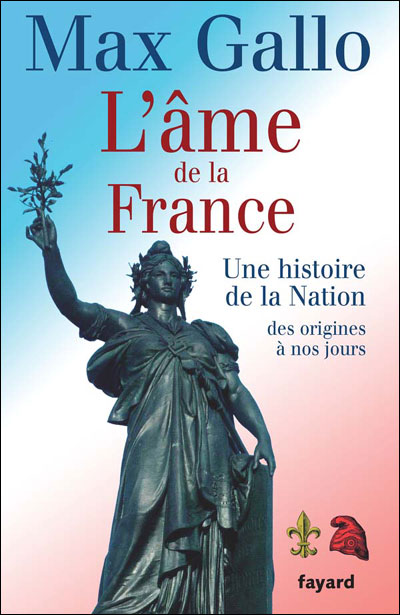

Table des Matières
Page de Titre
Table des Matières
Page de Copyright
Epigraphe
Dédicace
avant-propos
LIVRE I - LES SEMEURS D'IDENTITÉ
1 - LES RACINES ET LES PREMIERS LABOURS
2 - LA SÈVE ET LA TAILLE
3 - LE ROYAUME DÉVASTÉ ET RENAISSANT
LIVRE II - GUERRES CIVILES,
GLOIRE DU ROI,
PUISSANCE DE L'ÉTAT
1 - LA GUERRE AU NOM DE DIEU
2 - LA MESSE DU ROI ET DES CARDINAUX
3 - LE GRAND SOLEIL FRANÇAIS
LIVRE III - L'ÉCLAT DES LUMIÈRES – L'IMPOSSIBLE RÉFORME
ET LA RÉVOLUTION ARMÉE
1 - LOUIS XV
2 - L'IMPUISSANCE DU ROI
3 - LA LOI DES ARMES
LIVRE IV - LA RÉPUBLIQUE IMPÉRIALE
1 - LA COURSE DU MÉTÉORE
2 - L'ÉCHO DE LA RÉVOLUTION
3 - RENOUVEAU ET EXTINCTION DU BONAPARTISME
4 - LES VÉRITÉS DE MARIANNE
5 - L'UNION SACRÉE
LIVRE V - L'ÉTRANGE DÉFAITE
ET LA FRANCE INCERTAINE
1 - LA CRISE NATIONALE
2 - L'ÉTRANGE DÉFAITE
3 - L'IMPUISSANCE RÉPUBLICAINE
4 - L'EFFORT ET L'ESPOIR GAULLIENS
5 - LA FRANCE INCERTAINE
DU MÊME AUTEUR
© Librairie Arthème Fayard, 2007.
978-2-213-63981-9
« Tous les siècles d'une nation sont les feuillets d'un même livre.
« Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé. »
Ernest Renan, La Réforme intellectuelle et morale.
« Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France : ceux qui refusent de vibrer au souvenir de Reims ; ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération.
« Peu importe l'orientation présente de leurs préférences. Leur imperméabilité aux plus beaux jaillissements de l'enthousiasme collectif suffit à les condamner. »
Marc Bloch, L'Étrange Défaite.
« Le peuple français est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. »
Jacques Bainville, Histoire de France.
Les ouvrages du même auteur figurent en fin de volume.
Pour David.
avant-propos
L'âme de la France et le pain des Français
C'était il y a un quart de siècle, en 1981.
Je me souviens de ceux qui clamaient d'une voix vibrante que l'élection de leur candidat à la présidence de la République – c'était aussi le mien – allait faire passer la France « de la nuit à la lumière ».
Vingt-cinq années se sont écoulées. On sait ce qu'il en fut. Mais les bonimenteurs sont remontés sur l'estrade et font à nouveau commerce d'espoir.
Ils ont chanté dans les années 30 du xxe siècle : « Il va vers le soleil levant, notre pays... » Trois ans après l'« embellie » du Front populaire, les nazis entraient dans Paris.
Ils ont, dans les années 80 du même siècle, promis qu'on allait « changer la vie ». Et le chômage a enseveli le pays dans la précarité, l'incertitude et l'angoisse.
Ils disent « Nous allons gravir la montagne. » Pour un « ordre juste contre tous les désordres injustes ».
C'est la même chanson.
Et je crains que cette ascension collective promise ne se réduise – nous avons vécu cela – au pèlerinage des courtisans gravissant derrière le Roi – la Reine – le petit rocher de leurs ambitions satisfaites, cependant que le peuple oublié continue de patauger, en bas, dans les marécages.
Pessimisme ?
Inquiétude, plutôt. Le réveil des peuples auxquels depuis des décennies tous les candidats au pouvoir présidentiel promettent sans tenir parole s'appelle révolte et même révolution. Et donc grand saccage.
Car on ne peut susciter l'espérance créatrice d'une nation qu'en lui disant la vérité de son histoire et de sa situation, et non en lui offrant des mirages trompeurs.
Or, pour la France, le xxie siècle tel qu'il commence, sera un temps des troubles. La nation est ankylosée par une crise profonde. Elle doute de son identité, et donc de son avenir.
Elle ne peut qu'être ébranlée par les contrecoups d'une situation internationale qui est un véritable avant-guerre.
Qu'on songe aux problèmes posés par la prolifération nucléaire, le Moyent-Orient, la question du pétrole, les conséquences d'une mondialisation non régulée, les migrations inéluctables et les bouleversements climatiques. Sans oublier la révolution scientifique et ses répercussions techniques, sociales et éthiques. Dès lors, le pays sera de plus en plus confronté à des tensions difficiles à apaiser.
Il faudra prendre des décisions rudes, peut-être cruelles. On ne pourra plus se contenter de diriger la France en flattant l'opinion.
Les candidates et les candidats aux élections prochaines en ont-ils conscience ? Y sont-ils préparés ? Ils le prétendent. Mais mesurent-ils tous la profondeur de la crise et des changements qui s'imposent ?
On peut légitimement en douter.
Pourtant, depuis le début de ce siècle dangereux, le sol de la nation s'est déjà fissuré, laissant apparaître les entrailles de notre société en crise.
L'extrême droite a été présente au second tour de l'élection présidentielle de 2002 alors que, depuis deux décennies, elle était reléguée au banc d'infamie.
Les partis de gouvernement n'ont rassemblé qu'à peine 36 % des voix.
Le président sortant n'a pas atteint 20 % des suffrages.
Les socialistes qui, souvent, font la mode, ont été éliminés par les électeurs pour la première fois depuis 1969, en dépit de l'attention qu'on leur prête, des louanges qu'on leur tresse, de l'autosatisfaction qu'ils affichent.
Ce tremblement de terre politique a été suivi d'une brutale coulée de lave du volcan social.
En novembre-décembre 2005, dans 274 communes, 233 bâtiments publics et 74 bâtiments privés ont été endommagés ou incendiés, et 10 000 voitures ont été brûlées.
Ce qui porte le total des véhicules détruits dans l'année 2005 à 45 000 !
Des engins incendiaires ont été lancés dans trois mosquées, deux synagogues ont été visées, une église a été partiellement incendiée.
Quatre personnes ont trouvé la mort durant cette période.
Mais tout va très bien, madame la marquise !
Quelques mois plus tard, le 23 mars 2006, sur l'esplanade des Invalides, dans le cœur symbolique de Paris, au terme d'une manifestation calme et autorisée, des jeunes gens encapuchonnés ont agressé et dépouillé ceux qui défilaient paisiblement.
Événements marginaux, accompagnant inévitablement la démocratie de la rue qui impose sa loi à la démocratie représentative, ou bien actes révélant les nouvelles ruptures de la société française ?
« J'ai vu, témoigne un photographe, des jeunes se faire lyncher avec une violence inouïe. Je n'avais jamais encore été confronté à de telles scènes à Paris, à des jeunes capables de faire preuve gratuitement d'une incroyable violence. »
En octobre-novembre 2006, des autobus ont été incendiés en Ile-de-France, dans le Nord et l'Est, à Marseille. Des policiers ont été attaqués.
Pour maîtriser et calmer de telles tensions, les mots et les sourires charmeurs ne suffiront pas.
L'élu(e) de la nation à la présidence de la République au printemps 2007 devra passer aux actes.
Or les Français ont beaucoup appris depuis trente ans.
Ils éliront « elle » ou « lui », mais ils ne se contenteront pas de postures avantageuses, d'habiletés, de générosités affichées.
Ils ont fait l'expérience et l'inventaire du style mitterrandien et des gesticulations chiraquiennes.
L'un était un président roué se complaisant dans les liaisons dangereuses, séducteur tout en arabesques et en hypocrites indignations de façade.
L'autre, un bateleur dressant son étalage sur les grands boulevards, retenant un instant les badauds par son insolente esbroufe.
Avec de tels acteurs, les Français ont beaucoup appris sur le théâtre politique, ses jeux de rôle et ses simulacres.
Seuls quelques compères et les croyants applaudissent aux promesses des nouveaux candidats.
Le vrai public partagé entre le scepticisme et l'espoir observe et attend.
Certes, une femme élue présidente peut renouveler le répertoire, mais on exigera d'elle plus que de la compassion ou de la séduction : des résultats !
Or les promesses seront d'autant plus difficiles à tenir que, pour être élus, les candidates et les candidats à la présidence de la République ou aux élections législatives auront d'abord divisé les Français, accusant leurs rivaux d'être responsables des maux qui frappent le pays.
Le coupable, ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est la droite – ou c'est la gauche !
Mais de grand guignol en farces, d'alternances en cohabitations, les Français savent que l'un vaut l'autre.
Et en 2005, au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen, quand les acteurs cessent d'interpréter la pièce Gauche-Droite, renoncent aux mimiques de leurs oppositions pour inviter les Français à voter oui, ceux-ci saccagent le théâtre en scandant non !
Les Français ne se contentent donc plus des tours de passe-passe des prestidigitateurs. Ils n'attendent plus qu'on sorte du chapeau un lapin blanc.
Leur vie est difficile. Les conflits et la violence, le fanatisme, sont une réalité. L'horizon est obscurci par des risques majeurs.
Que faire ?
Il faudrait aux dirigeants le courage de dire et surtout d'agir. Car la « moraline » ne suffit pas.
Ils devraient savoir où conduit le « lâche soulagement », comme disait Léon Blum au lendemain de Munich, en 1938.
Fin, honnête, le leader du Front populaire voulait la paix, refusait l'« excitation du patriotisme » (septembre 1936), critiquait ceux qui croyaient la guerre inéluctable.
Esthète sensible, il détournait la tête pour ne pas voir les dangers.
C'est laid et brutal, la guerre.
Mais l'illusion s'est fracassée contre le réel.
Blum a été déporté par les nazis.
Des centaines de milliers de Français qui avaient défilé en clamant qu'ils voulaient le pain, la paix, la liberté, ont moisi quatre années dans les camps de prisonniers en Allemagne, victimes de dirigeants qui avaient préféré leur dire ce qu'ils voulaient entendre, que le temps était aux congés payés – mérités –, et non à la mobilisation et à la préparation à la guerre.
Elle eut lieu.
Et les parlementaires élus en 1936 dans l'« embellie » du Front populaire votèrent le 10 juillet 1940, à Vichy, la mort de la République. Seuls 80 d'entre eux s'y refusèrent.
Cette étrange défaite, le « plus atroce effondrement de notre histoire » (Marc Bloch), peut se reproduire.
Point n'est besoin d'une invasion étrangère.
Il suffit que, face à une crise intérieure avivée par une tension internationale, la lâcheté, le désir de rassurer, l'emportent sur le courage et la volonté.
Or la nation ne peut plus se permettre de dépendre des stratégies de carrière de dirigeants soucieux de rassembler leurs camps politiques, oubliant que la France les transcende.
« Je suis pour la France, disait de Gaulle en 1965 quand on l'accusait d'être le candidat de la droite. La France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français. Ce n'est pas la gauche, la France ! Ce n'est pas la droite, la France ! Prétendre représenter la France au nom d'une fraction, c'est une erreur nationale impardonnable ! »
Pour ne pas la commettre, il faut vouloir que la France se prolonge en tant que nation une et indivisible, et non en un conglomérat de communautés, d'ethnies, de régions, de partis politiques.
Mais les élites de ce pays ont-elles ce désir d'unité nationale alors que, de concessions aux communautés en confessions et en repentances, elles déconstruisent l'histoire de ce pays ?
Certes, il faut en finir avec la légende qui fait de l'histoire française une suite d'actions héroïques dictées par le souci du bien de l'humanité !
Pour autant, la France n'est pas une ogresse dévorant les peuples – et d'abord le sien !
En fait, on ne peut bâtir l'avenir de la nation sans assumer toute son histoire.
Elle s'est élaborée touche après touche, au long des millénaires, comme ces paysages que l'homme « humanise » terroir après terroir, village après village, labour après labour, modelant l'espace en une sorte de vaste jardin organisé « à la française ».
Et c'est ainsi, d'événement en événement, de périodes sombres en moments éclatants, que s'est constituée l'âme de la France.
On peut l'appeler, avec Braudel, « la problématique centrale » de notre histoire. « Elle est, écrit-il, un résidu, un amalgame, des additions, des mélanges, un processus, un combat contre soi-même destiné à se perpétuer. S'il s'interrompait, tout s'écroulerait. »
C'est la question qui est posée en ce début du xxie siècle à la nation : « Voulons-nous nous perpétuer ? »
Nos élites le veulent-elles, partagent-elles encore la réflexion de Renan selon laquelle « tous les siècles d'une même nation sont les feuillets d'un même livre. Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé » ?
Mais qui s'exprime ainsi aujourd'hui ?
Le mot de nation, même s'il est à nouveau employé, est encore suspect. On évoque le pays, les régions, les provinces, l'Europe ou le monde. Rarement la patrie, mot tombé en désuétude.
Et quand quelqu'un ose parler de patriotisme, de patriotes, on ricane ou bien on le soupçonne d'être un extrémiste de droite.
La notion d'identité de la France fait même question, alors que Braudel en avait fait l'une de ses références.
« Une nation, écrivait-il, ne peut être qu'au prix de se chercher elle-même sans fin, de se transformer dans le sens de son évolution logique, de s'opposer à autrui sans défaillance, de s'identifier au meilleur, à l'essentiel de soi, conséquemment de se reconnaître au vu d'images de marque, de mots de passe connus des initiés (que ceux-ci soient une élite ou la masse entière du pays, ce qui n'est pas toujours le cas). Se connaître à mille tests, croyances, discours, alibis, vaste inconscient sans rivages, obscures confluences, idéologies, mythes, fantasmes... »
Ainsi s'est constituée, s'est maintenue, s'est déployée au cours de notre histoire l'âme de la France.
Mais les présidents qui se sont succédé depuis trente ans, au lieu de se soucier d'elle, ont préféré parler des Français, leurs électeurs...
Adieu la France, ont-ils tous lancé avec plus ou moins de nostalgie.
Le premier jugeait que la France, ne représentant plus que 1% de la population mondiale, devait se fondre dans la communauté européenne.
Le deuxième concédait qu'elle était encore notre patrie, mais que son avenir s'appelait l'Europe.
Le troisième l'invitait à la repentance perpétuelle.
L'alibi de nos trois présidents – et de nos élites – était que les Français se moquaient de la France, cette vieillerie !
Les citoyens, prétendait-on, se souciaient du régime de leur retraite, de leur emploi. Ils voulaient qu'on les protège, que les hommes politiques les débarrassent du carcan « centralisé » de l'État et choisissent la proximité, la région, non les grandes ambitions nationales.
On a donc remisé dans les caves et les greniers Jeanne d'Arc, la Sainte Pucelle, et le drapeau tricolore, nationaliste, Napoléon l'esclavagiste et La Marseillaise, la sanglante guerrière !
C'est là, aux oubliettes, que l'extrême droite a trouvé ces reliques abandonnées, elle les a brandies et on lui a laissé prétendre – cela arrangeait ceux que l'histoire de France gênait – qu'elle était le « Front national ».
Ainsi les élites ont-elles donné le sentiment qu'elles n'avaient plus la volonté de perpétuer la nation.
Qu'il s'agissait là à la fois d'une tâche archaïque, néfaste et impossible, voire compromettante et ridicule.
Mais, depuis qu'on ne se soucie plus de l'âme de la France, les problèmes quotidiens des Français se sont aggravés.
On leur a dit depuis trois décennies :
Oublions les rêves de grandeur !
Cessons d'être une patrie, devenons un ensemble de régions européennes !
Finissons-en avec l'exception française !
Effaçons notre histoire glorieuse de nos mémoires ! Elle est criminelle.
N'évoquons plus Versailles, Valmy ou Austerlitz, mais le Code noir, la rafle du Vel' d'Hiv', Diên Biên Phu et la torture !
Soyons d'une province, basque ou corse, poitevine, savoyarde, vendéenne ou antillaise, et non d'une nation !
Restons enracinés dans nos communautés et nos traditions d'origine. Soyons de là-bas, même si nous avons nos papiers d'ici !
Négligeons le français, conjuguons nos langues avec l'anglais bruxellois !
Ainsi nous vivrons mieux !
Nous aurons plus de pain, plus de paix, plus de liberté !
Un temps les Français l'ont cru.
Mais les mots deviennent peu à peu poussière face à l'expérience vécue.
Ils ne sont plus que des mensonges.
Le pain est rare et cher pour le chômeur.
L'insécurité, la violence et le fanatisme menacent la paix et la liberté.
Et, en 2005 comme en 2002, les Français ont sifflé les bonimenteurs.
Ils recommenceront demain si les promesses ne deviennent pas des actes.
Ils ont appris que leurs problèmes individuels, dans un monde cruellement conflictuel, ne peuvent être résolus que si, à rebours du discours des élites, le destin de la France, de son identité, de ses intérêts nationaux, est la préoccupation première de ceux qui les gouvernent.
Et qu'une nation ce n'est pas seulement une somme de régions souveraines, un « agrégat inconstitué de peuples désunis ».
Il n'y a, il n'y aura de pain, de paix, de liberté pour les Français que si on défend et perpétue l'âme de la France telle que notre histoire l'a façonnée.
LIVRE I
LES SEMEURS D'IDENTITÉ
Des origines à 1515
1
LES RACINES ET LES PREMIERS LABOURS
de la préhistoire à 400 après Jésus-Christ
1.
Au commencement de l'âme française il y a la terre.
Ce n'est qu'un coin d'espace encerclé par les glaciers qui s'amoncellent sur les bordures du territoire mais qui jamais ne recouvriront cet hexagone balayé par les tempêtes de poussière de lœss. Celle-ci se dépose, s'accumule, formant des terrasses dont le vent violent modifie les contours. Les glaciers avancent, reculent ; la faune, la flore changent, le climat s'adoucit, se tempère, puis le froid redouble.
Et cela durant des centaines de milliers d'années.
Qui peut concevoir ce que signifie l'épaisseur immense du temps ?
Les formes de ce territoire au long de ces trois millions d'années sont encore imprécises, le dessin est inachevé.
Mais sur cette surface d'étendue moyenne, les blocs granitiques – plateaux, monts, chaînes arasées par l'érosion – côtoient les plus récentes montagnes, les pics déchiquetés, les sommets que les glaciers ensevelissent encore.
Les roches d'âges différents – des centaines de milliers d'années des unes aux autres – sont voisines, séparées parfois par un étroit sillon où des fleuves s'installent.
L'Europe se rassemble, s'entremêle dans cet hexagone qui sera la France.
Ce pays est comme un résumé de ce qui, ailleurs, s'étale dans une monotonie semblant ne jamais devoir s'interrompre, alors qu'ici on passe d'un paysage, d'un relief à l'autre.
Et ce commencement de l'âme de la France dit ainsi la diversité, une marqueterie de différences, un lieu où l'on se rencontre et se mêle.
Ce n'est qu'une terre, mais c'est l'empreinte première.
Cependant, rien encore n'est définitif. Les assauts glaciaires se succèdent.
Autour de huit mille ans avant notre ère, la mer fait irruption, séparant ce qu'on nommera les îles Britanniques du continent, isolant le bassin fluvial de la Tamise de celui du Rhin, donnant ses limites à l'hexagone. Par ses origines, par la mémoire de la terre, il était donc lié à cette partie que la mer éloigne, qui devient îles. Ce sont désormais comme des frères siamois tranchés par l'encastrement, entre eux, de la mer du Nord. Et chacun vivra différent malgré leur souche commune.
Les formes et les limites sont ainsi en place.
La terre hexagonale enseigne la diversité des horizons, des sols et des roches aux premiers hommes qui surgissent, venant de l'est par la grande voie danubienne, et du sud par la voie méditerranéenne.
Que sait-on de ces hommes d'il y a plus d'un million d'années ?
Peut-on imaginer qu'en eux, au fond de leur regard, il y a de temps à autre – et, entre chacun de ces moments, peut-être faut-il compter cent mille années ? – une étincelle qui, un jour, après un nouveau déluge de temps – 800 000 ans ? – donnera une flammèche ?
Elle annonce qu'ici, sur ce sol, surgira – il y faudra une autre coulée gigantesque d'années – l'âme de la France.
Les premiers de ces hommes-là sont des prédateurs que leur nomadisme pousse d'un paysage à l'autre, que le froid et le vent font reculer, se réfugier dans des grottes, mais auxquels le réchauffement du climat donne l'audace de repartir.
Ils chassent. Ils pêchent. Ils cueillent. Ils taillent dans la pierre des armes et des outils rudimentaires. Ils tendent des pièges et, selon les époques – entre elles s'étendent des millénaires –, ils tuent l'hippopotame, le rhinocéros ou l'ours brun, le cerf, le sanglier ou le lapin, le bison ou le cheval sauvage, le taureau ou le bouquetin.
Ils façonnent des grattoirs, des perçoirs, et bientôt polissent la pierre, le bois de ces arbres qui, en fonction du climat, s'enracinent dans le nord ou le sud de l'hexagone : bouleaux, pins, noisetiers, chênes, ormes, tilleuls...
Et, le temps s'étant encore écoulé, voici qu'en frottant des bouts de bois l'un contre l'autre ils font jaillir des étincelles, maîtrisant ce feu que parfois déjà la foudre leur offrait.
Ils s'accroupissent autour du foyer, ces hommes qu'on nomme de Neandertal – du nom d'un site proche de Düsseldorf.
Ils ont la voûte crânienne surbaissée, des arcades sourcilières renflées, énormes, un front fuyant, leur face sans menton est un museau. Ils sont pourtant Homo sapiens. Après eux viendront les Homo sapiens sapiens, l'homme de Cro-Magnon – vieux de 35 000 ans, trouvé aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil, dans la Dordogne –, dont la boîte crânienne s'est allongée.
Mais, pour passer de l'un à l'autre, de la pierre taillée (paléolithique) à la pierre polie (néolithique), il a fallu plusieurs milliers d'années, peut-être plus de cent mille.
Ils brisent la pierre à coups de burin. Ils la grattent. Ils la lustrent. Ils sont encore nomades, mais déjà, dans un climat plus tempéré, ils demeurent longuement sur les lieux qu'ils jugent favorables à leurs chasses.
Ils sont là, entre Loire et Garonne, et leurs générations se succèdent sans aucune interruption, faisant de cette région l'une des seules de France où l'occupation humaine ait été permanente.
Le peuplement est dense dans les vallées de la Dordogne et de la Vézère, dans le Périgord, la Corrèze.
Lesquels de ces hommes-là, qui se rassemblent autour des feux et soufflent sur les braises pour que les flammes bleutées dansent devant leurs yeux fixes, ont, quand la mort frappait l'un des leurs, décidé de l'enfouir dans une tombe afin qu'il vive une autre vie et que son corps abandonné ne soit pas livré aux rapaces, aux fauves ?
Dans la Corrèze, à La Chapelle-aux-Saints, ils ont préparé cette sépulture.
Est-ce le premier indice d'une âme qui, en eux, commence son travail de genèse de l'homme ? Pour qu'ainsi la terre de l'hexagone devienne un grand reposoir où, génération après génération, durant des millénaires, les corps fécondent le territoire, millions de morts qui sont comme l'humus de l'âme de la France ?
Cette tombe de La Chapelle-aux-Saints, les hommes l'ont conçue et creusée quarante mille ans avant notre ère. Et c'est le signe qu'ils s'interrogent à tâtons, entre effroi et rêve, sur ce qu'est cette vie qui un jour les abandonne, sur ces animaux, biches, bouquetins, chevaux, taureaux, qu'ils tuent et dont ils se repaissent, et parce qu'ils veulent les « saisir » ils les emprisonnent dans leur regard, les représentent sur les parois des grottes à Lascaux, à Rouffignac (Dordogne).
Un renne apparaît sur ces parois, seul témoin d'un temps glaciaire qui a disparu, puis viennent taureaux, bisons, cerfs, chevaux peints en noir, en jaune, en rouge, animaux d'un climat tempéré installé dans l'hexagone autour de ces années 17 000-15 000 avant notre ère.
Et c'est ainsi que sur cette terre hexagonale surgit la première civilisation connue de l'humanité, brille l'étincelle de l'art, ce phénomène majeur du paléolithique. Dans la profondeur abyssale du temps, l'âme germe là où l'homme jette un regard interrogateur sur lui-même et sur le monde.
Là, il creuse une tombe, et quelques millénaires plus tard, alors que les temps glaciaires s'achèvent, il prend soin de ses morts. Il dresse des pierres en de longs alignements, et ces menhirs, encore debout, rappellent que le temps le plus reculé, le plus obscur, est toujours le nôtre, que l'âme de la France d'aujourd'hui n'en finit pas de communier avec ses origines.
Ailleurs, l'homme d'après le paléolithique construit des dolmens, lourdes tables de granit, tombes individuelles ou collectives. Ces rites funéraires, ces monuments dressés aux disparus, ces manifestations de l'âme, révèlent que l'homme vivant veut que ses morts demeurent à ses côtés.
Il ne lui suffit plus de se livrer à des repas rituels où il mange le cœur et le cerveau, la moelle des os des disparus, manière de conserver leurs forces en lui. Il veut les honorer, les garder près de lui en ces lieux où désormais il s'installe en sédentaire, où il commence – quatre mille ans avant notre ère ? – à gratter le sol pour creuser un trou, tracer un sillon, enfouir une semence, devenant ainsi agriculteur et non plus seulement chasseur.
Les terroirs se dessinent entre les tombes.
Et ils composent aujourd'hui une cartographie de la préhistoire française.
Qui marque encore notre sol, notre présent.
Chaque année, durant le dernier quart du xxe siècle de notre ère, moins d'une dizaine de milliers d'années après la construction des menhirs et des dolmens, et moins de vingt mille ans après que les hommes eurent peint les fresques rupestres de la grotte de Lascaux, un président de la République gravissait la roche de Solutré, en Saône-et-Loire, accompagné d'une petite foule de courtisans et de journalistes.
Autour de ce rocher surplombant la plaine se trouvait un amoncellement de carcasses de plus de dix mille chevaux. Poussés vers le vide par les chasseurs préhistoriques qui, les poursuivant, les acculaient à la mort, ou bien victimes d'un cataclysme ? Le mystère demeure.
Mais ce « pèlerinage présidentiel », ce rituel, cette manière de tenir le fil noué avec les hommes des premiers temps, leurs lieux sacrés, de mettre ses pas dans l'humus humain de notre hexagone, montrait que l'âme de la France restait liée aux temps préhistoriques et qu'elle se reconnaissait comme leur fille lointaine. Mais peut-on employer ce mot pour dire vingt mille ans, après avoir parcouru des centaines de milliers d'années ?
2.
Ce n'était plus les temps glaciaires, et l'âme des hommes de cette terre hexagonale qui s'appellerait la France fixait ses premiers repères dans un climat tempéré.
De la grotte de Lascaux à la roche de Solutré et aux milliers de menhirs dressés à Carnac, les représentations picturales ou les tumulus funéraires collectifs et les tombes individuelles faisaient de la terre un espace sacré, d'autant plus qu'on apprenait à la labourer, à la ensemencer, et qu'ainsi sanctifiée par l'humus humain elle devenait la Grande Mère qui conservait les corps pour leur donner une autre vie, mais aussi la Nourricière qui compensait les aléas de la chasse et de la cueillette.
Et on voulait désormais s'enraciner, se tenir serrés les uns contre les autres pour cultiver, tisser, modeler ces poteries que l'on décorait en griffant le vase encore malléable avec des coquillages (le cardium). Et l'art naissait ainsi, sur les rives de la Méditerranée, pour remonter la vallée du Rhône vers le nord.
C'est là, non loin du fleuve, entre le massif hercynien et la montagne alpine, que l'on retrouve, à mi-chemin entre Avignon et Orange, les traces du premier village d'agriculteurs de la future France : Courthezon.
On y polit la pierre – c'est l'époque néolithique –, mais on y utilise bientôt les métaux, le cuivre – l'âge chalcolithique – puis le bronze, et, à la fin du néolithique, le fer.
En moins de cinq mille ans – Courthezon a été créé vers 4650 avant notre ère – il se produit ainsi plus de transformations dans notre hexagone qu'il ne s'en était accompli en plus de cinquante mille ans !
On incinère les morts, on enfouit leurs cendres dans des urnes que l'on regroupe en vastes champs ainsi peuplés de l'âme des défunts. On crée des tombes individuelles, on édifie des tumulus de bronze. Et la terre n'est plus seulement une étendue, mais un berceau de l'âme. On crée des paysages, on ouvre des clairières, on trace des chemins, des routes.
On construit des maisons sur des pieux au lac de Chalin, dans le Jura. Un village est identifié à Chassey, près de Chagny, en Saône-et-Loire. Entre les groupes de sédentaires, les échanges se multiplient, les routes forment un réseau qui peu à peu dessine la trame de l'hexagone.
Ces hommes qui façonnent des poteries, qui abattent les arbres pour aménager chemins et clairières, qui se préoccupent du destin de leurs morts, sont les premiers occupants de l'hexagone.
Ils ont le crâne court. Ils sont râblés. Mais, au cours du dernier millénaire d'avant notre ère, ils voient prendre pied sur la terre hexagonale d'autres hommes.
Les uns viennent de l'Est, du bassin du Danube, et peut-être de plus loin encore. Les Grecs les appellent Keltai, Celtes, ce qui signifie « les hommes supérieurs, sublimes ».
Les autres viennent du Sud. Ce sont des Grecs de Phocée, et, en 620 avant notre ère, ils créent Marseille, la première cité grecque de l'hexagone. Elle essaimera, donnant naissance à Nikaia-Nice, Antipolis-Antibes, Agathé-Agde, Theline-Arles.
Ces cités-là restent nos repères. Elles sont quelques-uns des premiers points d'appui de l'âme de la France qui, peu à peu, investit l'hexagone, cette terre qui est la première des régions d'Occident à entrer en contact direct avec les grandes civilisations du bassin oriental de la Méditerranée.
Ainsi, durant le premier millénaire avant notre ère, alors que commence l'âge du fer, l'hexagone s'ouvre aux Celtes et aux Grecs qui vont, à leur manière, féconder la terre de la future France et commencer à modeler son âme.
3.
C'est désormais le vent de l'histoire qui souffle sur l'hexagone. Le temps ne se compte plus en centaines ou en dizaines de milliers d'années, mais en siècles.
L'esprit qui errait dans les temps préhistoriques peut désormais concevoir ces durées qui lui sont plus familières.
De même, il voit entrer dans l'hexagone et dans l'histoire des peuples identifiés qui font partie de sa mémoire et de ses légendes.
Celtes – Gaulois –, Grecs, Romains et Germains peuplant nos mythologies sont autant d'éléments de notre âme contemporaine. Les noms de cités, les vestiges, les monuments, la symbolique qui en est issue, sont au cœur de notre présent.
Nous imaginons que nous sommes leurs descendants directs. On peut, dans un cortège d'aujourd'hui, voir un manifestant, vêtu en Gaulois de légende, porté sur un bouclier, incarner la « résistance » à une loi que l'opinion condamne !
Ainsi, à tout instant, le passé légendaire investit le présent, oriente le futur, garde vivante une âme qui se structure dans les derniers siècles d'avant notre ère.
Les Grecs sont installés le long de la côte méditerranéenne. Les Celtes demeurent au nord, au centre et de part et d'autre du Rhin. Des tribus nouvelles – les Belges – arrivent et les refoulent. Puis surviennent les Germains, qui menacent les Celtes, les repoussent vers le sud, les font entrer en contact avec les Romains.
Ces peuples se côtoient et s'interpénètrent dans ce résumé d'Europe qu'est l'hexagone.
Il n'y a pas une seule « race », un seul « peuple », maîtres du territoire.
Ainsi, dès sa genèse, parce que l'hexagone est comme un impluvium qui recueille toutes les « averses » de peuples, l'âme de ce qui sera la France est ouverte. Les peuples venus d'ailleurs l'irriguent.
C'est leur présence sur le sol hexagonal, et non leur sang, qui détermine leur appartenance et bientôt leur identité, quelle qu'ait été celle de leurs origines.
Dès ces premiers siècles historiques, ce qui concerne l'hexagone touche le reste de l'Europe et toute la Méditerranée. Le bassin danubien et, au-delà, la Grèce et ses colonies d'Asie sont aux sources de ce peuplement hexagonal.
Et les Celtes ne se contentent pas de se répandre dans l'hexagone ; ils envahissent le nord de la péninsule Italique.
Ils ont le coq pour emblème et deviennent, pour les Romains, Galli, Gaulois, du nom de ce coq, gallus.
En 385 avant Jésus-Christ, ces Gaulois sont sous les murs de Rome et menacent le Capitole.
Quand ils se replient, battus par les Romains, ils s'installent dans la plaine du Pô, où l'un de leurs peuples, les Boii, fonde Bononia, Bologne.
Et cette région padane qu'ils marquent de manière indélébile – n'y a-t-il pas une Ligue du Nord dans l'Italie d'aujourd'hui, et les dialectes de l'Émilie ne recèlent-ils pas des mots « gaulois » ? – devient, pour les Romains, la Gaule Cisalpine, la première Gaule, antérieure à l'hexagonale, la « nôtre », qui ne surgira que peu à peu, trouvant son identité gauloise dans la perception de sa différence d'avec les Grecs, les Romains, les Germains.
Les Gaulois de cette Gaule Transalpine – ainsi nommée par les Romains – s'hellénisent au contact des Grecs des cités de la côte méditerranéenne. Le commerce unit ce Sud au Nord. Des amphores remplies de vin sont transportées sur le Rhône, la Saône, la Seine, le Rhin. D'autres marchandises – armes, tissus, poteries – franchissent les cols des Alpes.
Ainsi, en même temps que surgissent l'identité gauloise et l'âme de la Gaule, se constitue l'Occident.
Cette période de l'âge du fer est donc décisive.
La première séquence – la période dite de Hallstatt, du nom d'un village proche de Salzbourg –, jusqu'aux années 400 avant Jésus-Christ –, puis la seconde, la période de la Tène – du nom d'un village proche de Neuchâtel –, jusqu'aux années 150 avant Jésus-Christ, voient se mettre en mouvement cette dialectique de l'unité et de la division de l'Europe qui sera à l'œuvre tout au long de l'histoire de ce continent.
Les peuples et les régions se séparent et s'unissent. Le réseau des routes commerciales les rapproche, unifie peu à peu leurs mœurs.
À Vix, dans la Côte-d'Or, au pied du mont Lassois qui commande et verrouille la vallée de la Seine, la tombe d'une princesse, morte autour de sa trentième année vers l'an 500 avant Jésus-Christ, contient un immense cratère grec (1,65 mètre de haut, plus de 200 kilos). Les bijoux de cette jeune femme permettent de mesurer l'éclat de cette civilisation celtique – on dira bientôt gauloise – ouverte aux influences grecques, qui marque une étape de plus dans la construction de l'âme de la France.
Plus au sud, dans la Drôme, le village du Pègue révèle lui aussi l'influence grecque : un champ d'urnes, un ensemble de fortifications.
La civilisation celtique s'enracine ainsi en maints lieux de l'hexagone.
À Entremont, non loin d'Aix-en-Provence, on identifie un ensemble fortifié construit vers 450 avant Jésus-Christ.
Des villes : Bibracte, près d'Autun, sur le mont Beuvray, Gergovie, proche de Clermont, Alésia, dans la Côte-d'Or, témoignent du déploiement de cette âme « gauloise ».
Un président de la République, à la fin du xxe siècle, a même songé, un temps, à se faire inhumer sur le mont Beuvray. Il avait même acquis à cette fin une parcelle de terre, voulant par là s'insérer au plus profond de notre histoire, peut-être se l'approprier.
Vitalité toujours renouvelée de nos origines légendaires...
En tous ces lieux on découvre la créativité gauloise. Ils inventent le tonneau et le savon. Ils sont charrons, forgerons, charpentiers. Ils construisent des chars à deux ou quatre roues. Ils les placent parfois auprès de leurs chefs décédés, dans les tombes princières qu'ils bâtissent pour les honorer.
Ce sont des guerriers valeureux, aux armes puissantes : glaive court, hache. Ils sont bons cavaliers et chargent, casqués. Impitoyables, ils pendent à leur ceinture les têtes de leurs adversaires vaincus.
Les Romains se méfient de ce peuple gaulois qu'ils contrôlent en Gaule Cisalpine, mais qui reste tumultueux en Gaule Transalpine.
Ils veulent l'isoler de cette mer Méditerranée où se croisent et s'articulent les relations entre toutes les provinces de leur république : cette Mare Nostrum qui ne saurait être menacée par les Gaulois.
Alors ils font la conquête du littoral méditerranéen, y créent des villes, dont Narbonne. La province qu'ils y instituent, qui portera le nom de Narbonnaise, tient les Gaulois éloignés de la mer.
Ainsi s'ébauche à partir de cette province la surveillance – qui conduit à la domination – par les Romains de la Gaule Transalpine. Ils y interviennent, nouant des alliances avec tel ou tel des peuples gaulois, Éduens, Arvernes, Séquanes, Rèmes, Lingons. Ils jouent habilement des rivalités entre eux tous.
Dès l'origine, ce peuple gaulois qui s'unifie porte donc en lui, par sa diversité même, des ferments de division. L'âme de la France peut toujours se fissurer, une partie d'elle-même, être attirée par la rupture, la séparation, l'alliance avec l'étranger.
Et les Romains, adossés à la Narbonnaise, de définir ainsi trois Gaules : l'Aquitaine, la Celtique, la Belgique.
Ils creusent de cette manière, sur le territoire de la Gaule, des sillons, presque des frontières, qui ne s'effaceront plus.
Dans chacune de ces Gaules, les cités sont autant de lueurs qui continuent de briller depuis ces débuts de l'histoire.
Avaricum (Bourges), Cenabum (Orléans), Autricum (Chartres), Vesontio (Besançon), Lutetia (Paris), Adenatunum (Langres), Burdigala (Bordeaux), Segodunum (Rodez), Mediolanum (Saintes), Lemonum (Poitiers), Samarobriva (Amiens), Rotomagus (Rouen), Arras, Beauvais, Reims (créées respectivement par les peuples des Arelates, des Bellovaci, des Rèmes) : nommer ces cités, c'est parcourir toute l'histoire de France jusqu'à l'avènement du xxie siècle.
C'est découvrir, au cœur des villes d'aujourd'hui, des vestiges qui sont les racines de notre présent.
Ces cités et ces lieux constituent une sorte d'archipel dont la plupart des « îles » – ces villes – se perpétuent au milieu d'un grand remuement de peuples.
Les Parisii et les Séquanes quittent alors le bassin de la Seine sous la poussée des Belges, et gagnent les uns le Yorkshire, les autres la Franche-Comté.
Les Romains s'emploient à refouler les Germains, dont ils craignent l'alliance avec les Gaulois. Et en 102-101 avant Jésus-Christ, le consul Marius bat les Teutons à Aix-en-Provence, et les Cimbres à Verceil, en Gaule Cisalpine.
Ainsi se créent des séparations, des oppositions, qui vont perdurer.
La Gaule qui a rassemblé et amalgamé les peuples est aussi le lieu de leur émiettement, une source qui se déverse dans les régions voisines.
Elle est, comme sa géographie la détermine, un condensé d'Europe, le territoire où toute l'histoire du continent se noue.
Et sur ce grand berceau hexagonal où vagissent les âmes des futures nations rivales et proches s'étend l'ombre de l'aigle romaine.
4.
Quand les légions de Jules César avancent en Gaule, précédées de leurs aigles aux ailes déployées, l'histoire se mêle à la légende.
Et c'est en s'appuyant sur les Commentaires de César vainqueur qu'on peut se représenter comment se construit alors l'âme de la France.
On voit – on imagine – Vercingétorix, le jeune chef des Arvernes, peuple d'Auvergne, diriger et incarner durant dix mois la résistance à la plus grande armée du monde. Avant d'être battu à Alésia et de mourir étranglé dans une prison souterraine de Rome – le Tullianum – après le triomphe de César, le Gaulois aura réussi à rassembler autour de lui la plupart des peuples de la Gaule, une armée de cent mille hommes, et à infliger au général romain une défaite sous les murs de Gergovie.
Les lieux de ces affrontements entre les légions de César et les guerriers gaulois se sont inscrits dans la longue histoire française.
C'est ainsi qu'une âme nationale palpite au souvenir qu'à Cenabum (Orléans) débuta la première rébellion gauloise contre Rome, qu'elle subit une défaite à Avaricum (Bourges), puis l'emporta à Gergovie (près de Clermont), avant d'être terrassée à Alésia/Alise-Sainte-Reine, sur le mont Auxois.
Cette résistance, magnifiée par les historiens, les romantiques du xixe siècle, devient ainsi l'un des ressorts de l'âme de la France. Et le combattant gaulois apparaît comme l'ancêtre du citoyen républicain. Vercingétorix et ses guerriers préfigurent les soldats de l'an II, les francs-tireurs de 1870 et ceux de 1944. Ils les inspirent. Un peuple résiste à l'envahisseur. Vaincu, il jette ses armes aux pieds du conquérant dans un dernier geste de défi.
Vingt siècles plus tard, Astérix vengera Vercingétorix...
La légende est une potion magique.
Mais, ses vertus évanouies, il reste la réalité, l'histoire. Celle-ci contribue à faire comprendre comment se constituent une âme collective, une nation, dès le temps de César, dans les années 60-50 d'avant notre ère.
Au début, avant que les légions de César n'entrent en Gaule, cette terre est divisée en cent peuples souvent rivaux.
Mais entre eux existe la communauté d'une civilisation celtique avec sa langue, ses dieux, ses prêtres – les druides –, ses rites souvent cruels.
On sacrifie aux dieux – Ésus, Teutatès, Taranis, Lug – des hommes (on retrouvera les vertèbres brisées révélant des meurtres rituels).
Les druides et une « aristocratie » dominent ces peuples.
Le sanglier plus que le coq pourrait leur tenir lieu d'emblème.
Mais cette civilisation commune ne peut effacer les divisions. Les Éduens (établis entre la Loire et la Saône, autour de Bibracte), les Lingons (région de Langres), les Rèmes (région de Reims), sont les alliés de Rome.
Cette division des Gaulois est le levier dont se sert Jules César pour intervenir en Gaule, empêcher les tentatives d'unité entre les Éduens, les Séquanes (Seine), les Helvètes.
Alors que s'ébauche la préhistoire de ce qui deviendra la France, on mesure que l'incapacité à s'unir est comme une maladie génétique de ce territoire, lieu d'accueil de peuples différents, tentés de jouer chacun leur partie.
César exploite cette pathologie.
Il soutient ses alliés. Il protège les Éduens contre les Suèves (des Germains). Il refoule et massacre les Helvètes. Il écrase la révolte des Belges en 57. Il sépare ces peuples et fait du Rhin la frontière entre Gaulois et Germains, entre la Gaule et la Germanie.
César trace là une ligne de fracture décisive qui rejouera tout au long de l'histoire, estompée à certaines périodes, puis à nouveau creusée, un fossé de part et d'autre duquel les peuples devenus ennemis s'observent avant de s'entretuer.
Et tandis qu'il se contente de cantonner les Germains dans les forêts de la rive droite du Rhin, il opprime les peuples gaulois.
Les violences, les atrocités que leur infligent les légions romaines suscitent la rébellion.
Les peuples divisés se rassemblent autour de Vercingétorix. Après plus de cinq ans d'un impitoyable protectorat romain, la résistance s'enflamme et les dix mois de lutte qui suivent forgent la nation gauloise.
C'est dans la lutte et la résistance qu'un peuple se donne une âme.
La légende s'empare alors du dernier carré de combattants gaulois : ceux d'Uxellodunum (dans le Quercy), qui résistent jusqu'en 51 aux légions de César, et qui, afin que tous les peuples de Gaule sachent à quel point les Romains sont implacables, auront les mains tranchées ou les yeux crevés – leur mutilation paraissant à leurs vainqueurs plus exemplaire qu'une mise à mort, plus effrayante qu'un simple égorgement.
Mais le sang répandu, les violences subies, les martyres endurés, ne sont jamais oubliés.
Ils irriguent la longue mémoire d'un lieu, d'un territoire. Et les peuples qui, des siècles plus tard, y demeurent, redécouvrent ces origines englouties, rivières souterraines qui disparaissent durant de longs parcours, puis soudain refont surface.
Et l'âme s'y abreuve, découvrant ces dix mois de résistance, ce chef gaulois, Vercingétorix, qui devient un héros emblématique.
L'âme prend aussi conscience que c'est en Gaule que s'est joué le sort de l'histoire de l'Occident – l'histoire mondiale d'alors.
César, vainqueur de cette guerre des Gaules qu'il a voulue, provoquée, pour rentrer dans Rome en triomphateur, a transformé la République. L'Empire romain va naître comme ultime conséquence de son initiative.
Mais c'est en Gaule qu'il aura trouvé la force de franchir – en 49 – le Rubicon, cet acte qui va changer la face du monde connu.
Comment mieux dire l'importance décisive de ce coin de terre entre les mers, où l'Europe se rassemble ?
5.
Morte était la Gaule celtique, étranglée par la poigne romaine comme l'avait été Vercingétorix dans le Tullianum, à Rome, après six années de captivité au fond de cette prison en forme de fosse.
Mais les peuples renaissent quand ils disposent d'un territoire tel que la Gaule, carrefour entre le Nord et le Sud, lieu de passage et de rencontre.
Celui qui s'installe dans l'hexagone dispose de ce trésor – la situation géographique – qui peut ne pas être utilisé, mais qui, dès lors qu'on le découvre, donne à qui en dispose un atout maître.
Et sur le corps vaincu et blessé de la Gaule celtique surgit ainsi une Gaule latine, pièce maîtresse de l'Empire romain.
César le veut, lui qui a fixé les limites de ce qui constitue son point d'appui pour régner à Rome.
Et ses successeurs, dont certains naîtront dans ce pays gallo-romain – Claude, à Lyon, qui régnera sur l'Empire de 41 à 54 ; Antonin, à Nîmes, qui sera empereur de 138 à 161 –, veilleront sur ces trois Gaules, l'Aquitaine, la Celtique, la Belgique, les défendant contre les incursions barbares, germaniques, élevant un limes sur le Rhin.
Quand, à partir du iiie siècle de notre ère, les Alamans et les Francs, des Germains, s'avanceront, les empereurs tenteront de les repousser, divisant la Gaule en deux circonscriptions administratives, l'une (au nord de la Loire et du cours supérieur du Rhône) ayant Trèves pour capitale, et l'autre, au sud, avec Vienne.
Pour trois siècles la Gaule romaine échappera aux invasions germaniques et restera unifiée.
C'est le latin, devenu la langue de ce nouveau pays, qui y structure l'âme des peuples.
On découvre ainsi que l'hexagone est un creuset assimilateur. La civilisation romaine envahit tout l'espace, conserve les lieux de culte des dieux gaulois pour y célébrer les siens propres.
Ceux qui refusent la collaboration et l'assimilation quittent la Gaule pour les îles Britanniques ou bien pour les forêts de Germanie.
Ceux des Gaulois qui ne sont pas réduits en esclavage, qui n'ont pas été mutilés, qui n'ont pas eu les yeux crevés, les mains tranchées par leurs vainqueurs, acceptent cette nouvelle civilisation, accueillante dès lors qu'on collabore avec elle, qu'on reconnaît ses dieux, son empereur, qu'on sert dans son armée – c'est ce que fait l'aristocratie gauloise.
Les Gaulois deviennent citoyens de Rome ; ils se mêlent aux vétérans romains qui fondent des colonies d'abord en Narbonnaise, puis, plus au nord, le long de la vallée du Rhône.
La paix romaine s'appuie sur ces villes nouvelles : Béziers, Valence, Vienne, Nîmes, Orange, Arles, Fréjus, Glanum – près de Saint-Rémy-de-Provence –, Cemelanum – près de Nice. On élève des trophées à La Turbie, à Saint-Bertrand-de-Comminges, pour célébrer la pacification, la victoire sur des résistances locales.
On écrase des révoltes – celle de Vindex en 68 –, des mutineries dans l'armée du Rhin en 70 de notre ère.
Mais plus jamais la Gaule tout entière ne s'embrase. Elle est désormais romaine.
Les repères que retient notre mémoire, qui balisent l'âme de la France, sont désormais des constructions romaines.
Les voies pavées se ramifient, l'une conduisant du sud (Arelate, Arles) au nord-est (Augusta Treveronum, Trèves), et l'autre d'est en ouest, les deux se croisant à Lugdunum (Lyon).
C'est la ville de l'empereur Claude, la capitale des Gaules. Un môle dans l'histoire nationale.
Ici les trois Gaules – Aquitaine, Celtique, Belgique – envoient chaque année les délégués de leurs soixante peuples pour débattre au sein d'une assemblée fédérale qui se réunit le 1er août. Là, au confluent du Rhône et de la Saône, on célèbre le culte de Rome et de l'empereur, on affirme l'unité de la Gaule romaine et sa fidélité à l'Empire.
Lugdunum devient l'un de ces lieux emblématiques qui renaissent à chaque période de l'histoire. Elle doit son nom au dieu gaulois Lug, voit s'élever un autel pour célébrer l'empereur, et c'est dans l'amphithéâtre de la ville que sont torturés les martyrs chrétiens – sainte Blandine –, en 177, sous le règne de l'empereur philosophe Marc Aurèle.
Et c'est Lugdunum qui deviendra ultérieurement le siège du primat des Gaules, capitale du christianisme comme elle avait été capitale de la Gaule romaine.
Mais Lugdunum n'est que le centre d'une constellation de villes, d'un maillage urbain qui sert de trame à l'histoire de la nation et d'armature à son âme.
Pas une de ces villes romaines (presque toutes nos villes d'aujourd'hui se sont élevées sur un premier noyau romain qui lui-même a souvent germé sur une cité gauloise) qui n'ait laissé une trace monumentale : vestiges de thermes ou d'amphithéâtres, d'aqueducs, de demeures – Maison carrée de Nîmes, pont du Gard, théâtres d'Arles, de Nîmes, d'Orange, arènes de Lutèce, thermes de Vaison-la-Romaine...
Toute une civilisation romaine s'épanouit et les campagnes se peuplent de villae, les clairières s'étendent, l'agriculture et l'arboriculture se répandent. Le vignoble progresse jusqu'au Rhin.
Qui se rappelle que tel temple de Janus, près d'Autun, a été construit sur un lieu de culte des dieux gaulois ? Et que l'oppidum de Bibracte – sur le mont Beuvray –, d'origine gauloise, est lui aussi devenu lieu de culte romain ?
Mais ce passé s'estompe, s'enfouit, même si on en retrouvera un jour la trace et s'il rejaillira.
Après Alésia et la reddition de Vercingétorix, la Gaule est devenue romaine sans réticence ni remords. Son âme se construit autour des valeurs et des mœurs romaines. La bière a cédé la place au vin.
Quand on s'insurge – à partir de la fin du iiie siècle –, c'est contre telle ou telle mesure jugée trop rigoureuse ou trop coûteuse (les impôts). Mais ces paysans révoltés, les bagaudes, ne visent pas à construire une autre unité politique.
Rome est l'horizon de tous.
Seuls les chrétiens refusent, malgré les tortures, le martyre – ainsi ceux qui ont pour théâtre Lugdunum –, de célébrer le culte de l'empereur et de Rome.
Mais les peuples barbares qui se pressent contre le limes rhénan rêvent, eux, de submerger la civilisation romaine. Et c'est le creuset gaulois qui, au début du ve siècle, paraît, autant que l'Italie, le représenter.
Ils vont déferler, couvrir l'hexagone de leurs peuples, et, au contact d'une terre déjà imprégnée d'« âme », s'y transformer.
2
LA SÈVE ET LA TAILLE
des invasions barbares à 1328
6.
C'est le temps des barbares, et rien ne peut arrêter leur déferlement.
Ils franchissent le Rhin et les Alpes. Ils débarquent sur les côtes. Ils viennent du fin fond de l'Europe. D'autres barbares derrière eux les poussent en avant. C'est une grande migration de peuples qui s'enfoncent dans la Gaule, la traversent ou bien s'y installent, la défendent contre ceux qui arrivent après eux.
Cette terre hexagonale fécondée depuis des millénaires par les peuples divers qui, tous, y ont laissé leurs traces, leurs morts, donne ainsi naissance à une autre civilisation.
Avec ses cent cités, ses dix-sept provinces, ses deux diocèses, la Gaule gallo-romaine s'efface. Elle est démantelée comme ses monuments qui deviennent des carrières, dont on arrache les blocs de pierre pour bâtir demeures, murs d'enceinte, bientôt châteaux forts et églises.
Et ainsi, tout au long de cinq siècles obscurs – de l'an 400 à l'an mil –, les vestiges de Rome nourrissent et inspirent ce qui naît sur ce territoire qui n'est plus la Gaule, mais la France. Elle porte désormais le nom d'un peuple germanique, installé sur le Rhin inférieur et qui, depuis des décennies, est déjà en contact avec les Gallo-Romains.
Ces Francs sont devenus soldats. Ils commandent des légions. Peu à peu, ils cessent d'être des mercenaires pour devenir les maîtres de ces régions situées au-delà de l'Escaut et du Rhin.
D'autres peuples pénètrent à leur tour cette Gaule dont les villes, le sol fertile – ces grands champs de céréales –, le climat tempéré, les voies romaines, les villae campées au centre de vastes exploitations agricoles, les attirent. Tout est butin dans ce pays où il fait bon vivre.
Les tribus germaniques – Vandales, Suèves, Burgondes, Alamans, Goths, Wisigoths, Alains – se ruent année après année sur l'hexagone, y taillent leur territoire, sont refoulées par d'autres.
Les Wisigoths venus des Balkans sont installés dans le Sud-Ouest ; ils y fondent les royaumes de Toulouse et de Bordeaux, puis sont repoussés dans le nord de l'Espagne.
Les Burgondes dominent la région comprise entre Lyon et Genève.
Les Alamans prennent possession des régions situées de part et d'autre du Rhin supérieur.
Ainsi se dessinent des divisions nouvelles : un nord et un sud de l'hexagone, où une langue « romane » peu à peu se répand, et un Est – sur le Rhin inférieur – où s'enracine un parler germanique : frontières géographiques et linguistiques, sillons creusés profond et que le temps n'effacera pas.
Dans le même temps s'affirme la puissance d'assimilation de ce territoire. L'humus humain y est si épais et si riche, les paysages et le climat y sont si accueillants, qu'il suffit d'être sur ce sol pour y prendre racine, vouloir le défendre contre d'autres peuples venus de Pannonie (Hongrie) ou de plus loin encore.
Ce sont les Huns. Ils chevauchent, pillent. Contre eux s'allient, sous le commandement d'un dernier chef de l'armée romaine (Aetius), Francs, Burgondes, Wisigoths, pour résister aux hordes d'Attila. Celles-ci seront vaincues sur la Marne (entre Châlons et Troyes, sans doute) en 451, à la bataille des champs Catalauniques.
Victoire symbolique en une région qui sera, tout au long de l'histoire, une zone de confrontation.
Victoire lourde de sens : les barbares ligués pour combattre les Huns, les repousser, cessent, par ce simple fait, d'être des barbares. Ils ont choisi de se fixer sur ce sol, de s'allier pour le défendre.
Plus significatif encore : Burgondes et Wisigoths sont chrétiens, même s'ils sont hérétiques, adeptes de l'arianisme, qui récuse la divinité du Christ.
À Paris, cette ville vers laquelle se dirigeait Attila, c'est Geneviève, une aristocrate gallo-romaine, catholique, qui a rassuré la population, prédit la défaite des Huns, incarné cette civilisation nouvelle issue de l'Empire romain, voué au Christ depuis l'empereur Constantin (330).
Restent les Francs qui sont encore païens mais qui, en combattant les Huns, en créant leur royaume entre Rhin et Seine, sont pris par cette terre qui les conquiert autant qu'ils croient la posséder.
Car peu à peu, en deux siècles – des années 300 aux années 500 –, la Gaule romaine s'est, comme l'Empire, mais plus que la plupart des autres provinces, christianisée. Un tournant majeur de l'histoire s'est ainsi accompli. L'empreinte la plus profonde a été creusée dans l'âme des peuples qui vivent et vivront sur ce sol.
Vers l'an 500 – le 25 décembre 496 ? –, le chef franc Clovis reçoit le baptême à Reims. Le païen devient chrétien. Il renonce, comme le lui demande l'évêque Remi, à ses amulettes, il courbe la tête. Et, avec lui, ses guerriers, son peuple, s'agenouillent et reconnaissent la foi dans le Christ. Clovis devient ainsi le premier souverain issu d'un peuple barbare à choisir le catholicisme, à ne pas être l'un de ces chrétiens hérétiques comme sont les Wisigoths et les Burgondes.
Il y gagne l'appui de l'Église.
Or celle-ci détient la mémoire de Rome, la langue et les fastes de l'Empire. Les évêques sont issus depuis deux siècles de l'aristocratie romaine, et quand le dernier empereur, Romulus Augustule, disparaît, en 476, et que sombre ainsi l'empire d'Occident, la Gaule résiste encore dix années. L'Église et ses évêques maintiennent parmi les barbares la foi nouvelle et le souvenir de l'Empire.
Clovis et les Francs s'enracinent ainsi sur une terre où, dès 314, un concile a réuni en Arles douze évêques venus de toutes les cités de Gaule.
Où, à la fin du ive siècle, un ancien soldat romain né en Pannonie, Martin, a créé un premier diocèse et commencé à évangéliser les paysans. Premier évêque élu par les fidèles, « barbare » et non issu de l'aristocratie gallo-romaine, il incarne une foi charitable – il a partagé son manteau avec un pauvre –, simple et populaire.
Les pèlerins accourent pour le rencontrer. Sulpice Sévère, un aristocrate et lettré gallo-romain, écrit sa biographie, dresse la liste de ses miracles. Ce livre se répand dans tout l'Occident, jusqu'en Égypte et en Grèce. La basilique de Tours, où repose Martin, devient le cœur de ce catholicisme qui gagne toute l'ancienne Gaule, laquelle fait figure de foyer chrétien de l'Europe. Des monastères sont fondés : ceux de l'île de Lérins (dans la baie de Cannes) et de Saint-Victor (à Marseille). Arles et Lyon – la ville qui connut les premiers martyrs chrétiens en 177 – sont des villes d'où la foi rayonne.
En se convertissant et en entraînant son peuple dans sa foi, Clovis s'appuie sur cette chrétienté déjà présente, et la renforce.
Lui qui a vaincu les Alamans – à Tolbiac, en 496, et sa conversion constitue peut-être une manière de remerciement à Dieu pour cette victoire – s'ouvre, à la bataille de Vouillé, près de Poitiers, la route de Bordeaux et de Toulouse. Il bat les Wisigoths hérétiques. Il annexe les pays situés entre la Loire et les Pyrénées. Il assemble ainsi – même s'il ne contrôle pas la côte méditerranéenne – un « royaume » dont les contours annoncent ceux de la France. Et il n'est pas jusqu'à la frontière de l'Est, tenue par les Alamans parlant le germanique, qui ne préfigure les limites françaises.
Mais Clovis ne fixe pas de frontières, celles-ci ayant été déjà esquissées par César.
Abandonnant Soissons, il choisit le futur centre national du pouvoir lorsqu'il fait de Paris – ville romaine d'importance moyenne, comparée à Lyon, Arles, Vienne, Trèves – sa capitale.
Déjà, en 502, il a choisi l'emplacement d'un mausolée sur l'une des collines de la rive gauche de la Seine, en face des îles.
Le palais du roi est situé dans la ville que domine ce sanctuaire.
Les choix sont donc clairs et dessinent un trait majeur de l'âme française : les liens tissés entre le roi et l'Église, entre monarchie et catholicisme.
Mais l'évêque Remi l'a rappelé au jeune catéchumène qu'était Clovis : les deux pouvoirs, celui de l'Église et celui du roi, restent séparés.
Si la France devient la « fille aînée de l'Église », le roi, pourtant baptisé et sacré, n'est pas confondu avec un homme d'Église.
Le roi prie. Les prêtres prient pour le roi. Mais celui-ci n'est pas l'égal d'un dieu.
Détentrice de l'héritage de Rome, l'Église ne confond pas pour autant pouvoir politique et pouvoir religieux. Elle refuse d'idolâtrer le roi comme l'était l'empereur.
Cependant, en juillet 511, c'est le souverain Clovis qui convoque à Orléans les évêques de son royaume.
Dans cette ville qui fut la première à se rebeller contre César et dont le nom va résonner tout au long de l'histoire nationale, Clovis définit les relations entre le roi et les évêques, les églises et les monastères.
Le roi des Francs veut que « son » Église échappe à l'influence de Rome et que « ses évêques » lui obéissent.
Ainsi s'annonce la singularité des rapports entre la France et Rome. Clovis est déjà un « gallican ».
La Gaule romaine et chrétienne a donc assimilé les barbares francs. Dans toute l'Europe occidentale, à ce titre, ce royaume franc catholique constitue une exception en ce début du vie siècle.
Près d'un millénaire et demi plus tard – en 1965 –, de Gaulle, devenu président de la République, confiait : « Pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis, choisi comme roi de France par la tribu des Francs qui donnèrent leur nom à la France... Mon pays est un pays chrétien, et je commence à compter l'histoire de France à partir d'un roi chrétien qui porte le nom de Franc. »
Écho lointain de la conversion d'un chef barbare qui lança sa hache à deux tranchants pour déterminer le lieu où s'élèveraient, sur la colline parisienne, son mausolée et celui de sainte Geneviève.
7.
En ce début du vie siècle, dans le royaume franc dont Paris est la capitale, le peuple prie.
Il s'agenouille devant les reliques de sainte Geneviève et le tombeau de Clovis.
Il communie à Tours devant le mausolée de saint Martin. Il participe à la messe dans ces églises qui s'élèvent ici et là, en des lieux où depuis toujours on célébrait le culte des dieux païens, qu'un seul Seigneur désormais remplace.
Parmi ce peuple des croyants, cette cohue de pèlerins qui donnent à leurs fils le nom de Martin, on ne sait plus distinguer ceux qui sont d'origine germanique de ceux issus de ces villes et de ces villages gallo-romains.
L'Église est un immense baptistère qui rassemble et unit, préside à la naissance de cet enfant encore vagissant et fragile : le peuple français.
Il est présenté sur les fonts baptismaux par la tradition romaine dont le catholicisme est l'héritier et dont l'Église conserve la richesse. C'est en latin qu'on prie.
Mais il a aussi un parrain germanique, homme libre portant les armes, se plaçant au service d'une aristocratie franque qui fusionne elle aussi avec l'aristocratie gallo-romaine. Et c'est la religion, la foi, le baptême, qui rendent possible et sanctifient cette union.
Il y a d'un côté la loi germanique – la loi salique – qui fixe les amendes à payer pour chaque délit commis et précise les conditions des successions, dont la femme peut-être exclue. De l'autre, il y a les commandements catholiques qui imposent eux aussi le respect de règles, de principes.
Le royaume franc fait ainsi le lien – incarne la rencontre et l'union – entre le monde germanique et l'héritage antique. Et la conversion de Clovis, l'église vouée à sainte Geneviève, le mausolée au cœur de Paris, affirment ce rôle décisif de la terre « française » entre les deux versants majeurs de la civilisation européenne telle qu'elle commence à apparaître.
Mais les reliques d'une sainte et le tombeau d'un roi, les prières d'un peuple, ne suffisent pas à maintenir l'unité du royaume franc.
À la mort de Clovis, le partage entre ses fils crée quatre royaumes avec à leur tête un Rex Francorum. Ils ont chacun une ville emblème pour capitale : Paris avec Childebert, Reims avec Thierry, Orléans avec Clodomir, Soissons avec Clotaire.
Une logique d'affrontement, exprimant le désir de réunir ce qui vient d'être partagé, se met inéluctablement en branle. En 561, après un demi-siècle de luttes, Clotaire aura reconstitué l'unité du royaume.
Mais, autour du royaume franc, au sud et au nord, d'autres royaumes se sont constitués : la Septimanie (la région de Montpellier) wisigothe, la Provence des Ostrogoths, le royaume burgonde.
En même temps, l'aller et retour entre fragmentation et réunification se prolonge, trace de nouvelles frontières, et surgissent de nouveaux chefs : Mérovée, Dagobert. L'Austrasie (entre Rhin, Meuse, Escaut : la Lorraine, la Champagne, l'Alsace avec Metz) côtoie la Neustrie (Paris et Soissons). Et, s'associant à l'un ou à l'autre au fil des rivalités et des guerres qui les opposent, subsistent le royaume de Bourgogne et celui d'Aquitaine.
En 632, le roi Dagobert fait à son profit l'unité des différentes royautés.
Ces conflits, ces retrouvailles, ces séparations, révèlent la tendance forte et contradictoire à l'émiettement de la terre hexagonale, qu'elle soit celtique, gauloise, romaine ou franque.
Durant ces siècles, c'est un incessant va-et-vient entre éclatement et cohésion, les forces qui séparent et celles qui soudent.
Mais, face à cet avenir à chaque fois incertain, le pouvoir royal, malgré l'appui que lui porte l'Église, s'affaiblit. L'aristocratie, les comtes, les maires du palais, s'en emparent.
Dès le viie siècle, la famille de Pépin de Landen, maire du palais d'Austrasie au temps de Dagobert (qui règne de 629 à 639), s'impose.
Au début du viiie siècle, l'un de ses descendants, Pépin de Herstal (il meurt en 714), devient le chef de fait de toute la monarchie franque.
C'en est fini des descendants de l'aïeul de Clovis, Mérovée, les Mérovingiens.
8.
Pour que le royaume franc recouvre l'unité et donc la force qu'il avait acquise en sa prime jeunesse, au temps de Clovis, à l'orée du vie siècle, il ne suffit pas qu'une dynastie succède à une autre et que les descendants de Pépin de Herstal écartent définitivement les Mérovingiens.
Il faut que chacun des nouveaux maîtres du pouvoir fasse la preuve de sa capacité à maintenir la cohésion de son royaume et à le défendre. S'il y réussit, alors il bénéficiera de l'appui de l'Église et du peuple des croyants.
On enfouira le souvenir des Mérovingiens dans le mépris et la réprobation, et l'âme du peuple se convaincra qu'il y a pour ce royaume – peut-être parce que les hommes et les femmes qui l'habitent, qui en labourent et en sèment le sol, sont chrétiens – une attention particulière de la Providence qui l'arrache aux abîmes pour le faire renaître.
C'est ce sentiment que les croyants éprouvent et que l'Église et ses évêques confortent quand Charles Martel – fils bâtard de Pépin de Herstal – repousse, le 17 octobre 732, sur la voie romaine reliant Poitiers à Tours – la ville de saint Martin –, les Arabes et les Berbères musulmans qui, depuis près d'une décennie, avaient commencé, à partir de l'Espagne, à lancer des razzias sur les villes de Septimanie et d'Aquitaine, s'emparant et pillant Nîmes et Carcassonne, mettant le siège devant Toulouse, saccageant Autun et Sens, Lyon, Mâcon, Beaune, toute la Bourgogne, lançant des raids dans le Rouergue, l'Aveyron, menaçant Avignon.
La victoire de Charles Martel en 732 est donc loin d'être un épisode secondaire.
Le royaume franc ne sera pas conquis, islamisé par ces guerriers qui, rassemblés à Pampelune, ont répondu à l'appel à la guerre sainte lancé par le gouverneur d'Al-Andalus, nom donné à l'Espagne occupée.
Mais, pour être un coup d'arrêt, cette victoire ne met pas fin à la menace.
La poussée musulmane conduit le duc de Provence – Mauronte – à traiter avec l'adversaire afin de partager avec les Sarrasins la domination de la vallée du Rhône. Le duc de Provence ouvre aux musulmans les portes de Saint-Remy, d'Arles et surtout d'Avignon.
On mesure là cette tentation de la séparation, de la trahison, du choix de l'« étranger », fût-il un infidèle, pour échapper à la tutelle du pouvoir central.
Périsse le royaume pourvu que je règne en maître sur ma province ! Tous les moyens sont alors bons pour y parvenir.
Mais, en 734, à la tête de l'armée franque, Charles Martel vient mettre le siège sous les murs d'Avignon, bientôt conquise, et les Arabes sont passés au fil de l'épée avec leurs alliés. La ville est pillée et incendiée.
Bientôt, après quarante années de lutte, la présence musulmane, à l'exception de quelques lieux sur la côte méditerranéenne, est chassée de la terre franque.
Et Charles Martel est inhumé en 741, à Saint-Denis, parmi les rois.
Il reste dans le légendaire français comme celui qui a préservé la terre chrétienne – et « nationale ».
Il est le vrai fondateur de la dynastie carolingienne.
Après le règne de son fils Pépin le Bref (751 à 768), c'est le fils aîné de ce dernier, Charlemagne, qui va régner, de 768 à 814.
Une autre histoire alors commence.
D'abord se confirme le rôle majeur que joue cette terre franque dans la civilisation chrétienne.
Les armées de Charles Martel ont refoulé les infidèles. Charlemagne et son frère Carloman ont été sacrés à Saint-Denis par le pape Étienne II.
Le premier est empereur en 800.
Ainsi, la tradition romaine donne sa forme à la nouvelle « race » royale issue du monde germanique. Le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, sera lui aussi sacré. La royauté est désormais de droit divin.
L'empereur est entouré de conseillers issus de l'Église : Alcuin et Éginhard.
Ce sont eux, les lettrés, qui renouent avec la tradition antique des études et assurent ainsi la perpétuation du savoir. Les évêques sont les relais du pouvoir impérial.
Le royaume franc est certes étendu vers l'est, et Aix-la-Chapelle en devient la capitale au lieu de Paris, mais c'est tout l'ancien territoire hexagonal, la Gaule gallo-romaine, qui bénéficie de cet ordre impérial et de l'action des missi dominici.
Une « administration » se met en place. Les hommes doivent prêter serment de fidélité à la personne de l'empereur.
Avec Charlemagne s'incarne ce lien particulier qui unira l'ouest et l'est de la civilisation franque.
Il y a un peuple français et un peuple germanique, mais, au-delà de leurs parlers, de leurs antagonismes, s'exprime cette lointaine origine commune, cette union carolingienne. Charlemagne est inhumé en 814 dans la chapelle palatine, à Aix.
Cet empire de traditions romaine et franque est fort. Il peut surmonter les défaites face aux Basques alliés des musulmans – à Roncevaux en 778 –, consolider la frontière sud en Aquitaine contre les incursions musulmanes, envoyer aussi une ambassade au calife de Bagdad, Haroun al-Rachid (802), recevoir l'ambassadeur du calife en 807, obtenir pour les Francs le droit de garder les Lieux saints.
À ce moment se noue pour des siècles le lien singulier et contradictoire qui unit le monde musulman et ce peuple franc. Il résiste, refoule l'avancée musulmane, mais, dans le même temps, il obtient du calife cette reconnaissance symbolique qu'est la concession de la garde des Lieux saints.
C'est aussi cette présence en Palestine qui vaudra à la royauté « franque » son rôle majeur dans les croisades.
Bien des aspects fondamentaux de l'âme française, du légendaire dans lequel elle puise, naissent ainsi au cours de cette période carolingienne qui peu à peu se dégrade.
Dès le viiie siècle, il lui faut faire face aux incursions normandes sur toutes les côtes de l'ancienne Gaule.
À la mort de Louis le Pieux, en 840, l'empire se divise. Du serment de Strasbourg et du traité de Verdun (842-843) – en langues romane et germanique – naissent trois États dont les frontières vont rejouer sans fin durant plus de onze siècles !
L'un des fils, Louis, obtient tout ce qui se trouve au-delà du Rhin et en outre, sur la rive occidentale du fleuve, Mayence, Worms et Spire. Le royaume de Lothaire – le deuxième fils – comprend le territoire situé entre Rhin et Escaut jusqu'à la Meuse, et sa frontière occidentale longe le cours de la Saône et du Rhône jusqu'à la mer. Tout le reste revient à Charles le Chauve.
Empire partagé, royaumes affaiblis.
Comment résister à ces envahisseurs normands qui remontent la Seine jusqu'à Paris, massacrent les évêques de Chartres, de Bourges, de Beauvais, de Noyon, longent les côtes jusqu'au delta du Rhône, pillent Arles, Nîmes, Valence ?
Les paysans s'arment ou fuient, échappant ainsi souvent à la condition d'esclaves, et c'est en hommes libres qu'ils s'établissement sur d'autres terres.
Pendant que ces incursions normandes atteignent le cœur des royaumes francs, leurs rois s'entre-déchirent dans l'espoir de reconstituer à leur profit l'unité impériale perdue.
Quête vaine, épuisement d'une dynastie dans des guerres fratricides, qui tente en vain de réunir ce qu'on peut commencer d'appeler la France et l'Allemagne.
C'est l'Église qui va choisir de soutenir une nouvelle dynastie.
L'Église est d'autant plus puissante que les ordres monastiques se sont développés – l'abbaye bénédictine de Cluny est fondée en 920.
L'Église réussit au xe siècle à imposer le respect d'une « trêve » puis d'une « paix de Dieu ». Elle entend rétablir l'ordre public en protégeant les églises, les clercs désarmés, les marchands et le bétail, sous peine d'excommunication par les évêques. Des « assemblées de paix » se tiennent à l'initiative et sous l'autorité de ceux-ci. Le poids de l'Église devient ainsi déterminant.
Quand l'archevêque de Reims, Adalbéron, choisit de soutenir Hugues Capet – héritier de Hugues le Grand –, duc des Francs, contre le dernier des Carolingiens, la balance penche en faveur de ce nouveau souverain.
Hugues Capet renonce à la Lotharingie, qui restera sous l'influence allemande. Il choisit de régner sur la partie occidentale de l'ancien empire de Charlemagne, cette Francia qui devient alors la France.
Ainsi commence, avec le règne d'Hugues Capet (987-996), la dynastie capétienne.
Elle est déjà l'héritière d'une longue histoire qui a façonné un territoire et son âme.
9.
C'est le temps des rois de France, et c'est aussi l'an mil.
Le sacre confère aux souverains capétiens le pouvoir de faire des miracles.
Rois thaumaturges, ils sont les représentants du Christ sur la terre, les vicaires de Dieu en notre monde.
Rois-prêtres, ils ont accès au surnaturel.
Le sacre a fait d'eux des « oints du Seigneur ». Ils font sacrer leur héritier, l'aîné de leurs fils. Attenter à leur pouvoir, les menacer, les agresser, est naturellement un acte sacrilège qui se paie de la vie.
Ils sont rois de droit divin, participent à la liturgie et deviennent ainsi des hommes au-dessus des autres hommes.
Ils protègent les hommes d'Église, tous les lieux de culte : les premières cathédrales qui surgissent à Orléans, Chartres, Nevers, Auxerre, ainsi que les monastères. Et ils condamnent au bûcher les hérétiques.
Ce roi qui, le jour de son sacre, guérit en touchant les écrouelles, qui accomplit des miracles, répète les gestes de Jésus.
Il lave les pieds des pauvres assemblés autour de lui durant la semaine sainte. Il distribue du pain, des légumes, un denier. Et il peut même, tel le Christ, rendre la vue à un aveugle.
Ainsi, l'âme française s'imprègne du respect qu'elle doit à ces monarques au pouvoir surnaturel.
Elle est d'autant plus marquée par ce caractère de représentant du Christ que la peur est au cœur de ce xie siècle durant lequel se succèdent Robert II le Pieux (996-1031), Henri Ier (1031-1060) et Philippe Ier (1060-1108).
Les chroniqueurs, les prédicateurs, les devins, annoncent la fin des temps.
Car qui pourrait réfuter, en cette millième année depuis la Passion du Seigneur, la prophétie de l'Apocalypse : « Mille ans écoulés, Satan sera relâché de sa prison et s'en viendra séduire les nations des quatre coins de la terre. »
Cette certitude fait de chaque événement un signe.
L'éclipse donne au soleil la couleur du saphir. Les hommes, se regardant les uns les autres, se voient pâles comme des morts. Les choses semblent toutes baignées d'une vapeur couleur safran. Une stupeur et une épouvante jamais vues s'emparent alors du cœur des hommes.
Comment ne se tourneraient-ils pas vers ce roi de la Francia, comment ne s'agenouilleraient-ils pas devant lui ? Ne tient-il pas son pouvoir de Dieu, et ne représente-t-il pas le Christ ici-bas ?
Ainsi s'amorce le mouvement qui pousse vers le souverain les habitants du royaume que tenaillent la peur, la misère, la famine, l'insécurité, la terreur devant l'apocalypse.
On saisit à l'origine ce lien particulier – religieux – qui va, siècle après siècle, unir les sujets du royaume de France à l'« oint du Seigneur ».
Le roi n'a de comptes à rendre qu'à Dieu, mais sa mission est de protéger ceux qui sont rassemblés autour de lui. S'il rompt ce lien avec Dieu – et avec l'Église, qui, elle aussi, représente Dieu en ce bas monde –, alors les régicides se lèvent pour le punir d'avoir failli à sa fonction.
Mais le meurtre du roi blesse le peuple. Il faut qu'un autre souverain renoue le lien avec le « surnaturel ».
« Le roi est mort, vive le roi ! »
Et quand la monarchie est rejetée par les représentants de toute la nation (ainsi, en 1793, avec le verdict condamnant à mort Louis XVI), un vide se crée, qu'il faut combler : Empire et Restauration d'abord, puis exaltation de la République protectrice.
L'État hérite de la divinité du roi.
Mais la force du roi de France est d'abord religieuse, intimement liée à sa personne. Et si fort est son caractère surnaturel, si personnel le lien entre lui et Dieu, entre lui et le peuple, que l'excommunication – dont Robert et Philippe sont un temps frappés pour avoir rompu des liens conjugaux – ne parvient pas à effacer l'aura surhumaine que le sacre leur a attribuée.
En outre, le royaume de France est devenu, après le temps des incertitudes, un territoire aux frontières plus précises, au centre bien identifié. C'est bien au cœur de la France que le roi réside.
Quand ses chevauchées ne le conduisent pas d'un bout à l'autre du royaume – il doit se montrer à son peuple, à ses vassaux –, il demeure à Orléans, à Étampes, à Chartres, dans cette Beauce couverte de blés, à Paris. Les grands fleuves – la Loire, la Seine, la Marne, l'Oise, la Meuse – sont les nervures de ce territoire dont Paris devient la ville la plus active.
Le roi est ainsi à même de protéger les reliques de saint Martin à Tours, celles de sainte Geneviève, le tombeau de Clovis à Paris et celui de Dagobert à Saint-Denis.
Il est sacré à Reims, où, avant d'être le pape de l'an mil, l'évêque Gerbert d'Aurillac crée des écoles. Non loin se trouvent Troyes et ses foires, où les marchands venus d'Italie et du Nord se rencontrent. Là, le rabbin Rashi (Salomon Ben Isaac, 1040-1105) rédige ses commentaires sur la Bible et le Talmud, que les moines savants consultent, méditent et contestent.
La France trouve ainsi son assise. Elle est le grand royaume de l'Ouest, et c'est la Meuse qui lui sert de frontière avec l'Empire teutonique.
Les deux souverains – le roi Robert II le Pieux et l'empereur Henri – se rencontrent au bord de ce fleuve en 1023, à Ivois.
L'empereur est reçu sur la rive « française », le roi, sur la rive « germanique ». On s'embrasse. On célèbre la messe. On échange des cadeaux.
« Ils resserrent ainsi les liens de leur fraternité, et chacun regagne ses terres. »
Les deux identités se renforcent mutuellement.
À la périphérie du royaume de France s'affirment des entités régionales : duché de Bourgogne, duché d'Aquitaine, marquisats de Toulouse, de Provence, duché de Lorraine, duché de Normandie d'où le duc Guillaume appareillera avec une flotte et 7 000 combattants pour se lancer à la conquête de l'Angleterre (1066, bataille d'Hastings).
Dès ce xie siècle, le royaume de France apparaît donc bien comme la clé de voûte d'une civilisation européenne qui, désormais, ne connaît plus ces grandes ruées « barbares » qui l'ont transformée au fil des siècles. Les peuples se sont enracinés.
Il y a certes encore des incursions scandinaves, ou, au sud, des razzias musulmanes (Narbonne est attaquée par les Sarrasins en 1020), mais l'heure est à l'éclosion d'une société féodale qui va structurer l'âme française.
Le roi de France est le suzerain de vassaux qui disposent à leur tour d'hommes liges.
Des châteaux, le plus souvent en bois, surgissent. « Un blanc manteau d'églises neuves » couvre le royaume. Des divisions sociales nouvelles se font jour : « Les uns prient, les autres combattent, les autres travaillent », écrit en 1030 Adalbéron, évêque de Laon.
Dans le royaume où l'espace inoccupé apparaît immense, les « pauvres » – paysans, manants – sont unis par la misère et le travail, la famine et l'absence de droits.
L'égalité entre eux s'établit, la distinction ancienne qui séparait l'esclave de l'homme libre disparaît peu à peu : c'est le « peuple ».
Au-dessus, le deuxième ordre est celui des hommes de guerre, les chevaliers, dont la monture et les armes constituent les biens les plus précieux.
Ils servent le seigneur féodal, qui les adoube.
Enfin il y a le premier ordre, celui des hommes d'Église. Certains d'entre eux choisissent de vivre retirés dans les monastères (La Chartreuse est créé en 1084) et suivent des règles strictes.
La prière et l'étude sont leur quotidien. Apparaît ainsi une génération intellectuelle séparée du peuple et des hommes de guerre, mais inculquant à ces deux ordres le sens de leur vie et régnant par là sur les âmes.
Ce sont les « hommes d'Église » qui veulent établir la « paix de Dieu », empêcher que les hommes de guerre ne se combattent. Ce sont eux qui organisent les grands pèlerinages : à Rome pour prier sur le tombeau de saint Pierre, à Compostelle pour rendre grâce à saint Jacques, à Jérusalem pour retrouver les pas du Christ.
Mais, en 1009, le Saint-Sépulcre aurait été profané par les hommes du calife du Caire. Et c'est une souffrance pour la chrétienté, en ce millième anniversaire de la Passion du Seigneur. Une preuve décisive de la présence et de l'action de Satan. Pour le combattre et le vaincre, il faut que les chrétiens cessent de s'entretuer, « car c'est répandre sans aucun doute le sang du Christ ».
On peut expulser les juifs, brûler les hérétiques, mais la trêve et la paix de Dieu doivent s'imposer aux chevaliers chrétiens ainsi qu'aux pauvres enfants de Dieu. Il ne doit y avoir de guerre que sainte.
Ainsi, peu à peu, l'âme française se constitue, acquiert une identité forte.
Il faut, dans le royaume, autour du roi et de ses vassaux, que règne la paix. Que la violence soit dirigée exclusivement contre les ennemis de Dieu.
En 1095, à Clermont, le moine clunisien Eudes de Châtillon, devenu le pape Urbain II, préside un concile de paix pour toute la chrétienté.
Les hommes de guerre, les princes et les chevaliers doivent veiller à la faire respecter. Et à protéger les chrétiens qui désirent se rendre à Jérusalem, au Saint-Sépulcre profané par les infidèles.
Il faut « délivrer » Jérusalem.
Le légat du pape, Adhémar de Monteil, évêque du Puy, va diriger cette « croisade » dont le projet s'impose peu à peu. Ainsi va se déverser sur la terre du Christ le trop-plein de chevaliers et d'hommes de guerre qui commencent à troubler la paix de Dieu en terre chrétienne.
Un religieux, Pierre l'Ermite, va prêcher les pauvres, les laïques qui ne sont pas gens de guerre, pour qu'ils se joignent au comte de Flandre, au duc de Normandie, au duc de Basse-Lotharingie, Godefroi de Bouillon, qui partent avec leurs chevaliers.
La croisade est l'affaire de toute la chrétienté. Ainsi, parmi les princes, chevauche Hugues de Vermandois, frère de Philippe Ier, roi de France.
L'âme française et son royaume sont inséparables, dès le xie siècle, des destinées de l'ensemble de la chrétienté.
10.
L'an mil et les inquiétudes du xie siècle s'éloignent. Quand ce siècle s'achève, qui se souvient encore des prophéties de l'Apocalypse ?
Durant les règnes de Louis VI (1108-1137) et de son fils Louis VII (1137-1180), le royaume de France s'épanouit.
Le xiie siècle est, pour la France, comme une adolescence vigoureuse, quand s'affermissent les traits du visage et ceux du caractère, annonçant la personnalité et l'âme de l'âge adulte.
L'essor de Paris, qui devient capitale de fait, symbolise ce développement d'un royaume dont le nombre des habitants s'accroît.
Ils défrichent. Les clairières, les cultures, s'étendent au détriment des forêts.
Ils se déplacent le long des routes des grands pèlerinages. La moitié des chevaliers du royaume partent en croisade en Terre sainte (Jérusalem a été conquise en 1099) ou en Espagne. Les marchands vont d'une foire à l'autre. Celles de Champagne (Troyes, Bar-sur-Aube) et de Brie sont fréquentées par des Italiens, des Flamands, des Catalans.
Même si ces centres d'échanges et ces voies commerciales sont situés aux marges orientales du royaume de France, celui-ci ne reste pas à l'écart, car Paris est devenue la ville unique qui attire marchands, visiteurs, « étudiants » de tout le royaume et du reste de l'Europe.
« Elle est assise au sein d'un vallon délicieux, au centre d'une couronne de côteaux qu'enrichissent à l'envi Cérès et Bacchus, écrit Gui de Bazoches. La Seine, ce fleuve superbe qui vient de l'Orient, y coule à pleins bords et entoure de ses deux bras une île qui est la tête, le cœur, la moelle de la ville entière. Deux faubourgs s'étendent à droite et à gauche, dont le moins grand ferait encore l'envie de bien des cités. Chacun de ces faubourgs communique avec l'île par deux ponts de pierre. Le Grand Pont, tourné au nord [...], est le théâtre d'une activité bouillonnante, d'innombrables bateaux l'entourent, remplis de marchandises et de richesses. Le Petit Pont appartient aux dialecticiens qui s'y promènent en discutant. Dans l'île, à côté du palais des Rois qui domine toute la ville, on voit le palais de la Philosophie où l'étude règne seule en souveraine, citadelle de lumière et d'immortalité. »
Entouré de forêts giboyeuses – pour le plaisir des rois et des chevaliers –, Paris acquiert ainsi une prépondérance absolue sur tout le royaume.
La ville de sainte Geneviève et de Clovis, voisine de l'abbaye de Saint-Denis, où l'abbé Suger fait construire une basilique imposante, verra bientôt se dresser le chœur de la cathédrale Notre-Dame (1163), puis sa nef (1180). Les « écoles » s'y multiplient.
Le maître Pierre Abélard s'installe sur la rive gauche, sur la montagne Sainte-Geneviève, donnant ainsi naissance à un « Quartier latin » qui est l'un des visages de la ville. Il est le premier « professeur », celui qui veut concilier foi et raison : « N'emploie jamais la contrainte pour amener ton prochain à la croyance qui est la tienne, dit-il. C'est par ses lumières seules que l'esprit humain doit se déterminer. En vain essaieras-tu d'obtenir violemment une adhésion mensongère ; la foi ne vient pas de la force mais de la raison. »
Un débat s'engage : contre Paris, contre la raison, pour la « Sainte Ignorance », la mystique, la prière, la contemplation.
Bernard de Clairvaux – saint Bernard, fondateur de l'abbaye de Clairvaux, âme de l'ordre cistercien qui sème dans tout le royaume et en Europe les « filles » de l'abbaye mère, et qui « fait » les papes –, exhorte professeurs et étudiants : « Fuyez du milieu de Babylone, fuyez et sauvez vos âmes ! » Il faut s'enfermer dans la solitude des monastères : « Vivre dans la grâce pour le présent, et attendre avec confiance l'avenir. » « Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres. Les bois et les pierres t'apprendront plus que n'importe quel maître. »
Cette « dispute » – c'est saint Bernard qui l'emportera ; Abélard, condamné, sera contraint de se retirer dans une dépendance de l'abbaye de Cluny – fait de Paris le centre intellectuel non seulement du royaume de France, mais de l'ensemble de l'Europe chrétienne. Dès ce xiie siècle, Paris est bien cette cité de lumière et d'immortalité qu'elle demeurera au fil du temps.
Mais, en fait, c'est tout le royaume de France qui devient le lieu où s'élaborent les idées, les controverses, les tendances, les formes qui vont ensuite se répandre d'un bout à l'autre de l'Europe chrétienne.
La France est un creuset. Elle concentre, elle transmute, elle invente, elle diffuse, elle rayonne.
Les abbayes cisterciennes essaiment à partir de Cîteaux et de Clairvaux dans toute l'Europe.
« Regardez les arbres de la forêt, dit saint Bernard. Notre ordre cistercien est comme le plus puissant d'entre eux. Il y a le tronc, c'est notre abbaye de Cîteaux, et quatre branches maîtresses, les premières filles : Morimond, La Ferté, Pontigny, Clairvaux. Chacune d'elles, dont Clairvaux la plus puissante, a donné à son tour naissance à d'autres. L'ordre est comme un arbre qui se ramifie ; de chaque branche surgit un nouveau rameau et toutes montent, verticales, vers le ciel. »
C'est saint Bernard qui, au concile de Troyes, en 1129, rédige les règles des Templiers, ces chevaliers chargés de la défense des pèlerins en Terre sainte.
Ils sont des moines-soldats qui ne craignent ni de pécher en tuant des ennemis, ni de se trouver en danger d'être tués eux-mêmes. C'est pour le Christ, en effet, qu'ils donnent la mort ou qu'ils la reçoivent ; ils ne commettent ainsi aucun crime et méritent une gloire surabondante. S'ils tuent, c'est pour le Christ ; s'ils meurent, le Christ est en eux.
C'est saint Bernard encore qui, en Aquitaine, tente d'empêcher que se développe l'hérésie cathare qui voit des chrétiens rechercher la « perfection », entrer en contact direct – sans l'intermédiaire de l'Église – avec le Christ. Ils conçoivent la vie comme une lutte implacable entre le Bien et le Mal. Eux veulent être des « Parfaits ».
Ainsi, c'est sur la terre du royaume de France que naissent aussi bien les orientations majeures de l'Église que les hérésies.
Et c'est encore saint Bernard qui prêche la croisade à Vézelay en 1146 : « « Dieu le veut, et son souverain pontife sur cette terre nous le commande : emparons-nous pour toujours du Saint-Sépulcre ! »
Le pape Eugène III a été moine cistercien, et le roi Louis VII rejoint les croisés, laissant la régence du royaume à l'abbé de Saint-Denis, Suger.
Le royaume de France est bien le lieu d'où partent, en ce xiie siècle, les impulsions qui orientent le destin de la chrétienté.
Le royaume a été le berceau de l'art cistercien aux fortes colonnes, aux voûtes puissantes, à l'austérité de la pierre nue, et chaque abbaye en Europe se modèle sur celles de Sénanque ou du Thoronet.
Et, de même, c'est en Ile-de-France, à Sens (1140), à Chartres (1145-1155), à Senlis (1155), à Noyon (1151), à Laon (1155-1160), à Paris (1163-1180), que les cathédrales « gothiques », avec leur croisées d'ogives, leurs vitraux, leurs nefs inondées de lumière, lancent leurs flèches verticales vers le ciel.
Le xiie siècle voit ainsi l'âme française être l'une des sources prééminentes de l'Europe.
C'est l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, qui réunit autour de lui des chrétiens espagnols qui ont vécu sous la domination musulmane. En ces temps de croisade, il veut entreprendre la traduction du Coran.
« Qu'on donne, écrit-il, à l'erreur mahométane le nom honteux d'hérésie ou celui, infâme, de paganisme. Il faut agir contre elle, c'est-à-dire écrire. »
Il ajoute : « Pour que la fidélité de la traduction soit entière et qu'aucune erreur ne vienne fausser la plénitude de notre compréhension, aux traducteurs chrétiens j'en ai adjoint un, sarrasin. »
Le royaume de France est ainsi à l'avant-garde : c'est sur son sol que la raison et la connaissance sont au travail et que l'âme française se nourrit de cette ouverture aux autres, afin de comprendre ce « qui a permis à ce poison mortel d'infester plus de la moitié du globe ».
Au xiie siècle, le royaume de France est celui du mouvement, du débat intellectuel, du changement. Ce climat modifie les habitudes, les comportements.
La femme, oubliée du monde féodal du xie siècle, est redécouverte en même temps que se répand le culte de Notre Dame, de sainte Madeleine.
C'est dans le sud de la France, en Guyenne, en Gascogne, qu'on commence à la chanter, à dresser pour elle les autels de l'amour courtois qu'exaltent les troubadours.
La reine Aliénor d'Aquitaine, un temps épouse de Louis VII (de 1137 à 1152), encourage cette évolution, en même temps que son remariage avec Henri Plantagenêt – qui est à la tête d'un domaine angevin et roi d'Angleterre – représente une menace pour le royaume de France.
Sur ses flancs ouest et sud, la présence « anglaise » obscurcit l'avenir.
Mais Louis VII, tout en proclamant la « paix du roi » pour dix ans dans tout le royaume (1155), ne cède rien aux Plantagenêts.
C'est que s'est lentement affirmé un « amour de la France » comme germe du patriotisme, comme l'un des traits majeurs de l'âme du royaume.
À la fin du xie siècle, un clerc d'Avranches a composé la première chanson de geste, 4 002 vers dans une langue qui se dégage du latin à la façon dont se brise la coquille d'un œuf.
En vers de dix pieds, le clerc raconte l'histoire du neveu de Charlemagne qui commandait l'arrière-garde de l'empereur et qui tombe, le 15 août 778, dans une embuscade tendue par les Basques – alliés des Sarrasins – à Roncevaux.
Cette Chanson de Roland évoque le chevalier blessé qui se soucie de ne pas laisser son glaive entre des mains ennemies.
Puisse jamais ne t'avoir un homme capable de couardise
Dieu, ne permettez pas que la France ait cette honte !
Et le poète d'ajouter :
Il vaut mieux mourir
À honneur qu'à honte vivre...
..................................................
Que jamais de France ne sorte
La gloire qui s'y est arrêtée.
Et le « comte Roland, étendu sous un pin, la face tournée vers l'Espagne, sent que la mort l'envahit : de la tête elle gagne le cœur... Il se met à se resouvenir de bien des choses, de toutes les terres qu'il a conquises, de la douce France »...
Le royaume de France n'est plus seulement le domaine personnel des Capétiens.
Il est la « douce France », qui appartient à tous ceux, chevaliers, clercs, poètes, manants, qui la peuplent et qui l'aiment.
Tous font vivre et se partagent l'âme de cette « douce France ».
11.
Le roi Philippe Auguste, qui hérite à la mort de son père Louis VII de la « douce France », et qui va régner d'un siècle à l'autre (1180-1223), quarante-trois ans, ne veut plus se nommer « roi des Francs », comme c'était encore l'usage pour les premiers Capétiens.
Il est le « roi de France ».
Et ce changement de titulature dit son ambition, la conscience qu'il a de n'être plus seulement le suzerain de grands vassaux, le maître d'un domaine royal, mais celui de tout un peuple qui commence à faire « nation ».
Le chanoine de Saint-Martin de Tours qui brosse son portrait écrit : « Beau et bien bâti, chauve, d'un visage respirant la joie de vivre, le teint rubicond, il aimait le vin et la bonne chère, et il était porté sur les femmes. Généreux envers ses amis, il convoitait les biens des adversaires et il était très expert dans l'art de l'intrigue... Il réprimait la malignité des Grands du royaume et provoquait leurs discordes, mais il ne mit jamais à mort nul qui fût en prison. Recourant au conseil des humbles, il n'éprouvait de haine pour personne, sinon un court moment, et il se montra le dompteur des superbes, le défenseur de l'Église et le nourrisseur des pauvres. »
Sur le socle construit par ses prédécesseurs, il bâtit un État. Et tout au long de son règne prolongé par celui de son fils Louis VIII (1223-1226), avec l'aide de ses baillis, de ses prévôts, de ses sénéchaux, il agglomère autour du domaine royal de nouveaux territoires. Il domine les grands vassaux de la Flandre, de la Champagne, de la Bourgogne. Au mitan du xiiie siècle, le royaume aura atteint la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée.
C'est la France, et le pape Innocent III reconnaît qu'aucune autre autorité temporelle en ce monde n'est supérieure à celle de son roi.
Ainsi, en ces cinquante années qui terminent le xiie siècle et commencent le xiiie, la France s'est-elle imposée comme la grande puissance continentale.
Elle est riche d'hommes, chevaliers, marchands, paysans. Elle a les fleuves et les routes pour le transport des marchandises qui vont et viennent du sud au nord. Le roi lève les impôts, et, quand il le juge bon, il pressure, menace, expulse, rouvre ses portes aux juifs, manieurs et prêteurs d'argent. C'est le commandeur de l'ordre du Temple, Aimard, qui gère la trésorerie du roi. Les Templiers, présents en Terre sainte et dans toute l'Europe, assurent les transferts de fonds. On tient des comptes précis. On dispose d'archives. Une administration se met ainsi en place à Paris.
C'est la plus grande ville d'Occident (50 000 habitants). Philippe Auguste la protège par une enceinte fortifiée. Deux grandes voies pavées – Saint-Martin et Saint-Denis – la parcourent sur la rive droite de la Seine. La rue Saint-Jacques, reprenant le tracé de la voie romaine, gravit sur la rive gauche la montage Sainte-Geneviève. La ville s'étend. Les vignes reculent. L'Université conquiert des privilèges (1215), un statut qui, entre le pape et le roi, lui assurent son indépendance.
Paris révèle la puissance du roi. Dans la tour du Louvre, on enferme les trésors et les prisonniers. Dans le donjon du Temple, on entasse les coffres emplis d'argent. Qui douterait que le souverain qui dispose d'une telle capitale ne soit le plus grand ? Il peut acheter des alliés, corrompre des adversaires, garder sur pied une armée de deux à trois mille hommes, noyau autour duquel s'agrègent, en cas de besoin, des mercenaires, des routiers, des soudards, des « cotteraux » qui ne sont plus des chevaliers, mais des hommes d'armes aguerris, sergents et arbalétriers montés, fantassins.
Ainsi se constitue un pouvoir d'État disposant d'une administration, avec ses hommes et ses rouages, d'une « diplomatie », d'une force militaire capable de briser les résistances que peut rencontrer le roi de France dans ses désirs de conquête.
Le pape lui-même est contraint de composer avec ce souverain.
Quand il prononce en 1198 l'interdit du royaume pour punir Philippe Auguste d'avoir voulu répudier son épouse, cette sanction, qui prive tout un peuple des sacrements, est de peu d'effet. Le pape doit négocier, lever l'interdit (1200).
La puissance capétienne peut ainsi se déployer, et le royaume de France, se dilater jusqu'aux rives des mers qui bordent l'Hexagone.
C'est une longue entreprise où les alliances, les guerres, les trêves, les mariages, s'entremêlent.
L'avancée capétienne se fait en direction de la Flandre, au nord.
Elle vise le Languedoc et le comté de Toulouse au sud, là où, malgré les prêches des Cisterciens et des Dominicains – ordre créé en 1215 –, l'hérésie cathare s'est enracinée.
À l'ouest (de la Normandie à la Guyenne, de la Seine à la Loire et à la Garonne), le roi de France se heurte au roi d'Angleterre Henri II Plantagenêt et à ses fils Richard et Jean.
À l'est, il lui faut se mesurer à l'empire germanique d'Otton IV.
C'est encore et toujours la situation géopolitique de la France qui suscite les convoitises de l'Angleterre et de l'Allemagne, parce qu'elle est un môle qui peut empêcher la domination ou de l'Anglais ou du Germain.
L'âme de la France se forge dans ces confrontations qui, pacifiques ou guerrières, naissent de la situation géographique et des intérêts contradictoires qu'elle génère. Dans ces quatre directions – nord, ouest, est, sud –, en un demi-siècle, le roi de France l'emporte.
L'Artois, le Valois, le Vermandois, l'Amiénois, sont acquis par le mariage avec Isabelle de Hainaut, qui descend en ligne directe des Carolingiens.
Et le Capétien peut ainsi se présenter en héritier de l'empereur Charlemagne.
À l'ouest, il faut briser la puissance anglo-angevine et aquitaine, lutter contre Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre. La mort de Richard en 1199 facilite la tâche. Mais la guerre – avec des intervalles de paix – dure près de vingt ans. Combats difficiles, impitoyables. Ce ne sont plus seulement des chevaliers qui s'affrontent dans une guerre « réglée », mais des « routiers », des « soudards », des « cottereaux », des mercenaires qui égorgent les prisonniers. Les forts construits par les Anglo-Aquitains sont conquis (ainsi, en 1204, Château-Gaillard, censé protéger Rouen).
Jean sans Terre et ses troupes sont mis en fuite à La Roche-aux-Moines, le 2 juillet 1214.
La Normandie, l'Anjou et la Touraine passent aux mains du roi de France.
Année et mois de victoire ! Au nord, vingt-cinq jours plus tard, le dimanche 27 juillet 1214, à Bouvines, les troupes de Philippe Auguste écrasent celles d'une coalition regroupant l'empereur Otton IV, Jean sans Terre et de grands féodaux.
Ce dimanche de Bouvines est le jour de l'irruption éclatante de la nation. Les chroniqueurs exaltent les « fils de France » « à la bouillante valeur » qui « n'hésitent jamais à braver toute sorte de dangers ».
En face d'eux, il y a « ces fils d'Angleterre que les plaisirs de la débauche et les dons de Bacchus attachent avec plus de charmes que les présents de Mars ». Il y a surtout les « Teutons ».
D'un côté, des combattants « issus de parents français » (« Vous, enfants de la Gaule, vous combattez toujours à cheval ! »), de l'autre, les Germains sont des fantassins redoutables mais sans noblesse de cœur !
L'âme française se trempe à Bouvines en s'opposant, en construisant un mythe, en célébrant une victoire qui n'est plus seulement celle du roi, mais celle de tout un peuple : « Dans tout le royaume, on n'entend partout qu'un applaudissement ; toute condition, toute fortune, toute profession, tout sexe, tout âge chantent les mêmes rythmes d'allégresse... Les innombrables danses des gens du peuple, les chants suaves des clercs, les sanctuaires parés au-dedans comme au-dehors, les rues, les maisons, les routes, dans tous les villages et dans toutes les villes, tendues de courtines et d'étoles de soie, tapissées de fleurs, d'herbe et de feuillage vert... Ceci se passa sur la route jusqu'à ce qu'on fût arrivé à Paris. Les bourgeois parisiens et par-dessus tout la multitude des étudiants, le clergé et le peuple allaient au-devant du roi, chantant des hymnes et des cantiques... Durant toute la nuit, les cierges ne cessent de briller dans les mains de tout le monde, chassant les ténèbres, de telle sorte que la nuit, se trouvant subitement transformée en jour et resplendissant de tant d'éclats et de lumières, dit aux étoiles et à la lune : Je ne vous dois rien ! Tant le seul amour du roi portait les peuples à se livrer aux transports de leur joie dans tous les villages... »
L'âme de la France naît de cette représentation d'un peuple uni autour de son souverain, de cette fusion de tous et de cette ville capitale, Paris, qui l'exprime.
Ce mouvement magnifié – rêvé pour une bonne part – renforce le pouvoir royal.
Le roi soutient les seigneurs et les moines cisterciens qui ont conduit la croisade contre les terres et les villes opulentes du Languedoc, ces populations converties à l'hérésie cathare.
Simon de Montfort et l'abbé de Cîteaux, Amalric, organisent la conquête, massacrent et pillent (sac de Béziers en 1209).
Le roi d'Aragon, venu au secours de Raymond VI de Toulouse, son vassal, est battu à Muret (1213). Louis, le fils de Philippe Auguste, cueille ces territoires et massacre à son tour (Marmande, 1218).
Roi en 1223, il apportera au royaume de France le Poitou et la Saintonge, La Rochelle et Avignon.
Le royaume de France atteint désormais la Méditerranée.
Le Nord a conquis les peuples du Sud.
En 1244, l'hérésie cathare brûle avec Montségur.
L'âme de la France se nourrit aussi de la cruelle violence de l'État.
Le peuple de France – et d'abord celui du Sud – ne l'oubliera pas.
12.
L'enfant de douze ans qui, en 1226, devient le roi Louis IX, sait que son royaume de France est, avec ses 13 millions d'habitants, le plus peuplé, le plus puissant, le plus riche, le plus influent de la chrétienté.
Il a vu son grand-père Philippe Auguste et son père Louis VIII gouverner, repousser et vaincre les Anglais et les Impériaux.
Il est entouré de leurs conseillers, de leurs évêques, de leurs chapelains, et sa mère Blanche de Castille exerce la régence avec autorité.
L'État, avec ses agents, sa monnaie, ses prévôts – le plus important est celui de Paris, qui siège au Châtelet –, a déjà sa vie propre, même quand le roi est un enfant ou bien quand, plus tard, en 1249, Louis IX partira en croisade, sera fait prisonnier et restera hors de France pendant près de cinq années.
Louis dira à ses proches, conseillers, laïques et clercs : « Gardez-vous de croire que le salut de l'Église et de l'État réside en ma personne. Vous êtes vous-mêmes l'État et l'Église ! »
Humilité d'un souverain qui veut être l'incarnation du roi chrétien idéal et qui, promulguant une Grande Ordonnance (1254), déclare :
« Du devoir de la royale puissance nous voulons moult de cœur la paix et le repos de nos sujets... et avons grande indignation encontre ceux qui injures leur font et qui ont envie de leur paix et leur tranquillité. »
Au fur et à mesure que son règne se déroule – il durera quarante-quatre ans, de 1226 à 1270, faisant de ce xiiie siècle le siècle de Saint Louis, puisque Louis IX est canonisé en 1297 par le pape Boniface VIII –, sa grande et maigre silhouette semble s'affiner encore dans une austérité mystique, comme s'il voulait mieux exprimer l'essence de la monarchie française, chrétienne en son principe fondateur.
« Le Roi, dit Joinville, son conseiller et biographe, se maintint si dévotement que jamais plus il ne porta ni vair ni petit-gris, ni écarlate, ni étriers ou éperons dorés. Ses vêtements étaient de camelin ou de drap bleu-noir. Les fourrures de ses couvertures et de ses robes étaient de peaux de daims ou de pattes de lièvres. Il était si sobre qu'il ne choisissait jamais sa nourriture. »
Ainsi, dans l'âme française, le souverain, déjà placé au-dessus des hommes par le sacre, devient-il aussi l'homme qui doit – au-delà de la politique qu'il mène – incarner la piété, le souci de la justice et de la paix pour ses sujets.
Il n'est pas seulement respecté, vénéré ou craint. Il est aimé pour ses vertus. Il est « saint » avant même d'être canonisé.
Et quand, en 1228, le jeune roi de quatorze ans, pour éviter d'être enlevé par des grands qui veulent ainsi prendre barre sur lui, se réfugie, rentrant d'Orléans, derrière l'enceinte fortifiée de Montlhéry, les milices communales de Paris et d'Ile-de-France, les chevaliers du domaine royal, le délivrent, et le peuple en cortège lui souhaite longue vie en le reconduisant dans sa capitale, Paris.
La vie exemplaire de Louis IX, l'amour de son peuple, le rayonnement de Paris, la puissance de l'État, tout concourt alors à faire du royaume de France et de son roi les acteurs majeurs de la chrétienté.
C'est dans cette source rayonnante du xiiie siècle que s'épanouit l'âme de la France en sa singularité.
Il y a en effet une exception française qui s'affirme au xiiie siècle.
La vigueur et l'attrait de l'université parisienne – qui compte 5 000 étudiants, et Thomas d'Aquin est l'un d'eux –, de celles de Montpellier, de Toulouse, d'Orléans, d'Angers, font de la France le centre intellectuel de la chrétienté. Chaque « nation » d'Europe fonde son collège sur la montagne Sainte-Geneviève. En 1257, le chapelain de Louis IX, Robert de Sorbon, crée un collège destiné aux clercs séculiers, boursiers. Ces étudiants veulent voir confirmer leur autonomie universitaire. Ils cessent de suivre leurs cours (1299) et obtiennent qu'un droit de grève leur soit reconnu. Le pape garantit ces droits.
Dans le royaume de France, joyau de la chrétienté, le nombre de cardinaux passe de deux à huit. Mesure de l'influence de la France, le pape Urbain IV, élu en 1261, est un Champenois, et en 1265 c'est un Provençal, conseiller de Louis IX, qui devient pape sous le nom de Clément IV.
Cependant, le souverain de France – le roi aux fleurs de lis, emblème peut-être lié au culte marial – ne s'interdit pas de résister aux pressions de la papauté.
Une fusion intime s'opère néanmoins entre l'Église et la monarchie française.
L'abbaye du Mont-Saint-Michel, le monastère de Royaumont, l'abbaye de Maubuisson et la Sainte-Chapelle – qui contient les reliques de la Passion, un morceau de la vraie croix et la couronne du Christ – témoignent de la volonté du roi – il suscite les initiatives, finance les travaux – d'élever des chefs-d'œuvre à la gloire du Christ.
Les dernières flèches des cathédrales se dressent, et le sourire de Reims, et le Bon Dieu d'Amiens, expriment dans la pierre la foi de toute une société que magnifie la piété du roi.
Celui-ci part pour la Terre sainte. Son long emprisonnement en Orient (de 1249 à 1254) exalte sa foi. Après sa libération, lors de son débarquement à Hyères, il s'entretient avec un moine cordelier qui lui dit : « Or prenne garde le roi, puisqu'il va en France, à faire si bien justice à son peuple qu'il en conserve l'amour de Dieu et que Dieu ne lui ôte pas, pour la vie, le royaume de France. »
On saisit le lien – au xiiie siècle, c'est une spécificité française – entre la foi exigeante et les mesures que le monarque met en œuvre. Il se veut Rex Pacificus, signant des traités avec le roi d'Aragon Jean Ier ou le roi d'Angleterre Henri III. Il n'utilise pas la puissance du royaume pour imposer par la guerre ses solutions.
De même, ses Grandes Ordonnances veillent à ce que les pouvoirs s'exercent avec équité. Le chêne de Vincennes, au pied duquel le roi rend la justice, en est le symbole.
Il vise à une politique « vertueuse ».
Il dit dans l'ordonnance de 1254 : « Que tous nos baillis, vicomtes, prévôts, maires et tous autres, en quelque affaire que ce soit, fassent serment qu'ils feront droit à chacun sans exception de personne, aussi bien aux pauvres qu'aux riches et à l'étranger qu'à l'homme du pays ; et ils garderont les us et coutumes qui sont bons et éprouvés, [sinon] qu'ils en soient punis en leurs biens et en leurs personnes si le méfait le requiert. »
Oui, exception française, au xiiie siècle, que cette moralisation de l'action politique !
Cette volonté est fondée sur la foi, sur le refus du péché et sur la crainte du blasphème qui habitent Louis IX.
« Vous devez savoir qu'il n'y a pas de lèpre aussi laide que d'être en péché mortel, dit-il. Je vous prie de préférer que toutes les infortunes arrivent à votre corps, lèpre ou toute autre maladie, plutôt que le péché mortel advienne à votre âme. »
Mais alors, il faut poursuivre ceux qui sont en état de péché.
D'abord les hérétiques (massacre des cathares à Montségur), et le royaume de France sera terre d'Inquisition.
On enterre vivant. On brûle (en mai 1239, dix-huit hérétiques sont voués aux flammes au Mont-Aimé, en Champagne). En 1242, dans un grand autodafé, on brûle vingt charretées de livres talmudiques.
Il faut que « tous les juifs vivent du labeur de leurs mains ou des autres besognes qui ne comportent pas d'usure ». En 1269, on exige qu'ils portent sur leurs vêtements un signe permettant de les reconnaître. On les dénonce parce qu'ils « font circuler sous le nom de Talmud des livres emplis de blasphèmes et d'injures contre le Christ, la Vierge, les chrétiens et Dieu même ».
Certes, Lombards, Cahorsins, chrétiens qui se livrent à l'usure, sont condamnés eux-mêmes au bannissement. Mais l'antijudaïsme chrétien de Louis IX est un fait. Et il pénètre l'âme française avec d'autant plus de virulence que le roi et son royaume sont l'expression la plus achevée – et les modèles – de la chrétienté.
Louis IX est déjà le Roi Très-Chrétien quand, en 1270, il embarque une seconde fois à Aigues-Mortes – port qu'il a fait construire – pour la Terre sainte.
Il s'arrêtera à Tunis et y mourra le 25 août 1270 après avoir vu s'éteindre son fils cadet. Et c'est son aîné, Philippe III le Hardi, qui lui succédera.
Cette mort en croisé fait de lui une figure sacrée de la chrétienté, l'image pieuse de ce royaume qui a vu aussi l'épanouissement de l'art gothique, la gloire de l'université de Paris, le prestige de la langue française illustrée par un Jean de Meung – deuxième partie du Roman de la Rose – et les œuvres de Rutebeuf – Renart le Bestourné.
Quelques années avant de se croiser (en 1267), Louis IX avait voulu procéder à la réorganisation de la basilique de Saint-Denis afin qu'on pût lire dans l'agencement des tombeaux l'histoire de la dynastie du royaume de France.
Ce nouvel ordonnancement, cette réécriture de l'histoire, plaçant dans la partie sud de la nef les Mérovingiens et les Carolingiens, au nord les Capétiens, et, entre ces deux rangées, Philippe Auguste et Louis VIII, qui appartenaient aux deux lignées – ils descendaient à la fois, affirmaient les généalogistes, de Charlemagne et d'Hugues Capet –, étaient une manière d'incarner la glorieuse continuité de la royauté française.
Ces gisants conduisent à Louis IX, dont la sainteté exprime l'essence de ce royaume.
L'âme de la France en reçoit la grâce.
Louis est saint.
« Mais, dit son chroniqueur Joinville, on n'en fit pas assez quand on ne le mit pas au nombre des martyrs pour les grandes peines qu'il souffrit au pèlerinage de la Croix, et aussi parce qu'il suivit Notre Seigneur dans le haut fait de la Croix. Car si Dieu mourut sur la Croix, il fit de même, car il était croisé quand il mourut à Tunis. »
Le roi de France n'est pas seulement saint, mais martyr.
Comment certains n'imagineraient-ils pas, après un tel apogée, que la France est promise à un destin exceptionnel, qu'elle est une nation sainte ?
« J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires », écrira de Gaulle.
13.
Saint Louis, le roi martyr, le Roi Christ, aura régné quarante-quatre années. À eux tous, ses cinq successeurs – les derniers Capétiens en ligne directe – n'auront, de 1270 à 1328, gouverné le royaume de France que durant cinquante-huit ans.
Mais c'est comme si peu importaient désormais la durée de chaque règne, et même la personnalité de chacun des souverains. Il y a pourtant bien des différences entre le fils de Saint Louis, Philippe III le Hardi – qui règne quinze ans : 1270-1285 –, son petit-fils Philippe IV le Bel (1285-1314 : vingt-neuf ans de règne), et les fils de ce dernier, Louis X le Hutin (1314-1316), Philippe V le Long (1316-1322) et Charles IV le Bel (1322-1328), auquel succédera Philippe de Valois.
Ce que Saint Louis a légué, c'est l'idée que la royauté française est au-dessus de tout.
« Dans toute la chrétienté, le roi de France n'a jamais d'égal », dit un chroniqueur italien.
La couronne royale transcende toutes les circonstances, toutes les personnalités. La canonisation de Louis IX a exalté le sacre qui déjà plaçait le souverain au-dessus des simples mortels.
Les rois de France sont de la lignée d'un saint.
« Grand déshonneur à ceux de son lignage qui voudront mal faire, dit Joinville, car on les montrera du doigt et on dira que le Saint Roi dont ils sont issus eût répugné à faire une telle méchanceté. »
En fait, le grand manteau bleu à fleurs de lis d'or de Saint Louis les protège.
Ils font de son corps, qu'ils fractionnent, des reliques.
En présence de Philippe le Bel, les ossements de Saint Louis sont placés en 1298 dans une châsse d'or derrière l'autel de l'abbaye de Saint-Denis. En 1306, Philippe le Bel obtiendra que la tête du Saint Roi soit transférée à la Sainte-Chapelle. Mais on laissera le menton, la mâchoire et les dents aux moines de Saint-Denis.
Puis on fragmentera le squelette pour offrir des reliques à tel ou tel souverain, à tel ou tel homme d'Église.
Une phalange du doigt de Saint Louis sera ainsi envoyée à un roi de Norvège...
Le roi de France bénéficie de l'immunité que lui confère son ascendance sainte. Mais il tire aussi son pouvoir de lui-même :
« Que veut le roi si veut la loi », disent les conseillers, les légistes qui forment autour de lui un groupe de plus en plus nombreux.
Ils sont membres des Chambres – la plus importante est la Chambre des comptes (1320) –, des Conseils.
Ils sont rassemblés dans le palais de l'île de la Cité, que Philippe le Bel agrandit et fortifie d'épais et hauts remparts.
Il fait édifier une immense salle à deux nefs enrichies par les statues des rois de France et qui est destinée aux avocats et à leurs clients.
Les services de juridiction criminelle sont installés dans les grosses tours. L'ensemble du « personnel » royal, de leurs familles et de leur domesticité représente près de 5 000 personnes, l'équivalent de la population d'une ville du royaume.
Personne – ni grands féodaux, ni étudiants ou professeurs, ni marchands ou moine prêcheurs – ne peut échapper à l'attraction de Paris, qui est la plus grande ville de la chrétienté avec – peut-être ? – 61 098 feux ou foyers fiscaux, soit plus de 200 000 personnes.
L'État centralisé, organisé, apprend à compter.
En 1328, une enquête sur l'état des feux les évalue pour tout le royaume à 2 469 987 répartis entre 23 671 paroisses, soit plus de 13 millions d'habitants.
Ainsi s'affirme l'un des traits constitutifs de l'histoire nationale : le pouvoir est centralisé à Paris.
Il enserre tout le territoire dans une « administration » dirigée de la capitale, du palais royal, où sont concentrés tous les rouages.
Le centre est le roi.
« Le roi est empereur en son royaume. » « Le roi ne tient son royaume que de son épée et de lui. » « Le roi ne tient de personne, sauf de Dieu et de lui. » Telle est la thèse des « conseillers », qui sont souvent des « gradués en droit » issus des universités de Toulouse, de Montpellier, d'Orléans et naturellement de celle de Paris.
Ces légistes sont avocats ou procureurs de la Couronne. Quelques-uns d'entre eux accéderont au Conseil du roi ou à la Chambre des comptes.
Ils annoncent une « haute administration ».
Les légistes les plus proches du roi (pour Philippe le Bel, Pierre Flotte, Guillaume de Nogaret, Enguerrand de Marigny) concentrent sur eux les accusations, les haines et le mépris dont on ne peut pas même concevoir d'accabler le roi.
Trahi êtes chacun le pense
Par vos chevaliers de cuisine...
écrit-on au souverain.
Et les barons, les féodaux qui subissent l'autorité royale s'indignent de la place tenue par ces
Petites gens parvenus
Qui sont à la cour maîtres devenus
Qui cousent, règnent et taillent
Toutes les bonnes coutumes défaillent
Justice désormais
À la cour on ne nous rend jamais
Serfs vilains avocassiers
Sont devenus empereurs.
Ces légistes, « boucs émissaires » jalousés, paient de leur vie leur pouvoir qu'une succession royale remet en cause.
En 1278, le chambellan de Saint Louis, Pierre de la Brice, est accusé et pendu au gibet de Montfaucon comme un détrousseur ou un crocheteur. Enguerrand de Marigny connaîtra le même sort en 1315.
Car l'État royal qui concentre, centralise le pouvoir, et dont le souverain n'a pas la même exigeante vertu, la même humilité que Saint Louis, peut se montrer une machine impitoyable.
Les cinq derniers rois capétiens ont d'abord poursuivi la politique d'élargissement de leur royaume.
Agenais, Poitou, Languedoc, Guyenne, Bourgogne – et la ville de Lyon – entrent dans le domaine royal.
Mais le Comtat Venaissin, avec Avignon, est « donné » au pape en vertu d'une promesse de Saint Louis.
Et au nord-est, en Flandre, le roi de France et ses chevaliers aux « éperons dorés » sont battus à Courtrai en 1302 par les fantassins des milices des villes drapières. La Flandre industrieuse, « bourgeoise » et « marchande », résiste ainsi à l'attraction capétienne.
La France trouve là une résistance qui ne cédera pas au cours du temps. C'est un autre « monde ».
Et pourtant la « machine royale » est puissante.
Elle fait reculer le pape Boniface VIII qui voulait que tous les chrétiens, y compris le roi de France, relèvent de sa justice (1296).
En convoquant à Notre-Dame en 1302 une assemblée de plus de mille délégués – clercs et laïques –, Philippe le Bel en appelle à la fidélité monarchique qui commence à prendre les couleurs du sentiment national. Et il ne craint pas d'envoyer Guillaume de Nogaret, son légiste, tenter de s'emparer, à Agnani, de Boniface VIII, qui mourra des suites de cet « attentat » (1303).
Pour défendre ou accroître leur pouvoir, faire respecter leur souveraineté, briser les résistances, obtenir les moyens qui leur sont nécessaires, l'État, le roi, ses légistes, sont prêts à toutes les violences.
On voit s'affirmer-là une raison d'État qui marque l'âme de la France et la structure.
Capable de faire plier la papauté, elle n'hésite pas à réprimer les émeutes, les insurrections populaires (à Provins, en 1280, lorsqu'on veut prolonger la durée du travail d'une heure sans augmentation), voire à manipuler la monnaie (1295) ou à créer de nouveaux impôts (la maltôte en 1290).
On confisque les biens des juifs (1306). Pour les condamner au bûcher et les spolier, on profite des rumeurs qui les accusent d'empoisonner les puits et de se liguer avec les lépreux, à l'instigation des musulmans, aux fins d'assassiner des chrétiens.
L'État étend son empire, se ramifie. Il a besoin de ressources. Il diminue la teneur en métal fin des monnaies, lève de nouveaux impôts. Et si on dresse en 1328 un état des feux, preuve de l'efficacité administrative de l'État, c'est d'abord pour des raisons fiscales.
L'argent et le pouvoir vont de concert.
De même, quand, à partir de 1307, Philippe le Bel s'attaque à l'ordre du Temple, c'est à la fois parce que cette organisation internationale échappe à son pouvoir, et peut même s'imposer à lui, et parce qu'elle est une puissance financière.
L'ordre est supprimé en 1312.
Par la torture et au cours d'un procès, il faut obtenir les aveux des maîtres de l'ordre. Mais Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, devant la foule rassemblée face à Notre-Dame, proclament leur innocence et la sainteté de l'ordre. Ils seront cependant livrés aux flammes le 18 mars 1314.
Procès politique organisé par un État pour qui la justice n'est qu'un instrument parmi d'autres servant à contrôler la « totalité » des activités du royaume.
La famille royale elle-même n'est pas préservée de cette violence. D'autant que – une punition, une malédiction, murmurent certains – aucun des trois fils de Philippe le Bel n'a d'héritier mâle.
Il faut donc se montrer impitoyable avec tous ceux qui, par leur comportement, peuvent mettre en cause la légitimité de la lignée royale.
Les accusées – donc les coupables – vont être les belles-filles de Philippe le Bel : elles ont commis le péché d'adultère ou en ont été témoins. Elles sont enfermées à Château-Gaillard. Leurs amants – deux jeunes chevaliers – sont châtrés et torturés à mort (1314).
Exemplarité archaïque du châtiment, violence de cet État qui mêle modernité et barbarie, religiosité et cynisme.
Le roi vénère les reliques de Saint Louis et n'a de comptes à rendre qu'à Dieu.
Vicaire du Christ, il est à l'abri de toute critique.
Son « absolutisme » croît parce que l'État qui se construit est plus efficace, donc plus redoutable.
Au moment où, en 1328, un Valois succède aux Capétiens, l'âme de la France, la tradition nationale, conjuguent dès ces xiiie et xive siècles la cruauté et la sainteté, tendances contradictoires et complémentaires.
3
LE ROYAUME DÉVASTÉ ET RENAISSANT
1328-1515
14.
Le ciel s'obscurcit vite au-dessus du royaume de France lorsque meurt en 1314 Philippe IV le Bel.
Pourtant, la France est l'État le plus peuplé, le plus riche, le plus puissant de la chrétienté.
Aucune autorité temporelle, pas plus un autre roi que l'empereur germanique, ne peut imposer sa loi au roi de France, souverain de la fille aînée de l'Église.
Le pape lui-même n'y parvient pas.
Un Capétien est maître comme Dieu en son royaume.
Et il n'est pas une seule ville qui puisse rivaliser avec sa capitale.
Paris est la ville des étudiants et des clercs, des bourgeois, des marchands, des maîtres de métier et des théologiens.
Tous ceux qui pensent et écrivent en Europe – donc tous ceux qui prient – rêvent de séjourner quelques années à l'ombre de Notre-Dame et sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève, dans ce Quartier latin où l'on étudie et ripaille.
Et cependant l'orage approche, dont on entend les grondements. Aucun des trois fils de Philippe IV le Bel n'a eu de descendant mâle. Seule la fille du roi, Isabelle, a donné naissance à un fils ; mais il a été couronné roi d'Angleterre.
Cet Édouard III possède les terres immenses de Guyenne. Il est le descendant lointain de Henri Plantagenêt, l'Angevin, duc de Normandie, qui, en 1154, avait épousé Aliénor d'Aquitaine, devenant ainsi le grand vassal du roi de France, et roi d'Angleterre pouvant prétendre à la couronne à Paris.
Mais les légistes français argumentent. Ils sont déjà imprégnés de ce sentiment national qu'on a vu sourdre au xiiie siècle. Les barons, les princes, ne veulent pas, eux non plus, être soumis à l'Anglais.
Certes, dans les vignobles, sur les quais du port de Bordeaux, là où l'on charge dans les navires les barriques à destination de l'Angleterre, on soutient la prétention d'Édouard à être aussi roi de France, puisqu'il est le fils de la fille de Philippe IV le Bel.
Les légistes contestent la valeur de cette ascendance : « Mais, écrivent-ils, si le fils d'Isabelle avait quelque droit à alléguer, il tenait ce droit de sa mère ; or, à cause de son sexe, sa mère n'avait aucun droit. Il en allait donc de même du fils. »
Le moine chroniqueur ajoute : « Les Français n'admettaient pas sans émotion l'idée d'être assujettis à l'Angleterre. »
On va donc sacrer à Reims, le 29 mai 1328, le comte de Valois, fils d'un des frères de Philippe IV le Bel. Et à sa mort, en 1350, lui succédera son fils, Jean le Bon.
La chaîne dynastique des Valois va se dérouler durant deux siècles et demi.
Mais qui peut croire qu'Édouard III acceptera, lui, roi d'Angleterre, d'être le vassal du roi de France alors qu'il se sent par le sang plus proche de Philippe le Bel que ce Valois sacré à Reims, célébré dans sa Cour, la plus brillante de la chrétienté ?
Qui peut croire qu'il ne trouvera pas d'alliés parmi ces barons et ces princes, français, certes, mais demeurés des féodaux que le poids d'une administration royale commence à irriter ? Ils se veulent vassaux, mais non sujets.
L'un d'eux, Charles de Navarre – Charles le Mauvais –, fils d'une petite-fille de Philippe le Bel, descend directement du roi capétien. Il faudra bien compter avec lui, qui possède Normandie, Picardie, Flandre, Champagne, Lorraine !
Et puisque s'exacerbent au sommet du royaume de telles rivalités, comment ces bourgeois de Paris, ces riches marchands que le fisc royal s'évertue à pressurer, ne joueraient-ils pas leur partie, se servant de l'un ou l'autre prétendant et des querelles entre rois pour acquérir puissance et influence ?
Ainsi s'annonce le temps des conflits, d'une guerre qui peut durer cent ans.
Il suffit de quelques années pour que le beau, le grand, le saint royaume de France soit dévasté.
Nul ne saurait l'envisager quand, après le sacre de Reims, Philippe VI de Valois préside, après avoir touché les écrouelles, les réjouissances. On y dévore 82 bœufs, 85 veaux, 289 moutons, 78 porcs, 13 chevaux ; on y met en perce des centaines de tonneaux de vin.
Trois mois plus tard, en août 1328, Philippe VI rétablit l'ordre dans les Flandres, terre de l'un de ses vassaux, et au mont Cassel, guidés par le roi, les chevaliers français, à coups d'estoc et de taille, massacrent les milices piétonnes des villes flamandes toujours rétives.
Point de quartier pour ces gens du commun, ces ouvriers tisserands !
Les barons et jusqu'à Édouard III sont enchantés de ce souverain de France, chevalier courageux, fidèle à l'ordre aristocratique.
En fait, cette victoire sur les « ongles bleus » flamands, cette tuerie de gueux qui, un temps, semble recréer l'unité de la chevalerie contre les marchands, les artisans, les ouvriers, les villes, ne peut effacer les contradictions.
Les rivalités entre grands, entre monarques, sont trop fortes, et, derrière elles, se profile le conflit entre deux nations qui s'affirment : la France et l'Angleterre.
Il suffit d'une dizaine d'années (1337-1347) pour que la guerre devienne la gangrène de ce xive siècle. Elle le sera pour « cent ans ».
Philippe VI a voulu s'emparer de la Guyenne. Édouard évoque avec mépris un « soi-disant roi de France ». La flotte anglaise détruit la française, censée transporter les troupes pour l'invasion de l'Angleterre (bataille de L'Écluse, 24 juin 1340). À Crécy (26 août 1346), les archers anglais déciment la chevalerie française. Et le 4 août 1347, les bourgeois de Calais livrent les clés de leur ville à l'Anglais, qui s'en empare pour deux siècles.
Ainsi, un conflit aux origines dynastiques et féodales se transforme en guerre entre nations, chacune d'elles gardant la cicatrice de ces premiers affrontements qu'a suscités une naissance commune.
Le Français est le cousin de l'Anglais, et l'un et l'autre sont les plus anciens ennemis.
L'Anglais affirme sa supériorité militaire. Il détruit la flotte d'invasion – naissance d'une tradition ! Il tue méthodiquement les chevaliers français qui combattent comme autrefois et que le « soldat » anglais perce de ses flèches ou égorge au coutelas.
Face à l'Anglais, l'âme française éprouve un sentiment d'admiration et d'impuissance. Les Anglais l'emportent toujours. Après la mort de Philippe VI, en 1350, c'est son fils Jean le Bon qui, avec ses chevaliers, est battu à Poitiers en 1356, fait prisonnier, gardé à Londres, délivré contre forte rançon. Par le traité de Brétigny-Calais en 1360, il sera contraint d'abandonner à l'Anglais plus du tiers de son royaume avant d'aller mourir à Londres, où – noble chevalier – il est allé remplacer l'un de ses fils prisonnier, qui s'était enfui.
En dépit de la prise de possession par Philippe VI du Dauphiné (1343), de Montpellier (1349), puis de l'affirmation de la suzeraineté royale sur la Bourgogne, ce milieu du xive est, pour le royaume de France, un abîme où il s'enfonce.
Pour la toute jeune nation, c'est l'un de ces « malheurs exemplaires » qui blessent son âme et vont se répéter tout au long de son histoire.
Car le sol du royaume de France n'est pas seulement jonché des corps des chevaliers percés de flèches ou égorgés par les archers et les « routiers » anglais à Crécy puis à Poitiers. Les dix ans – 1346-1356 – qui séparent les deux défaites françaises voient s'amonceler les cadavres.
La peste noire a commencé de faucher en 1347-1348. Qu'elle soit bubonique ou pulmonaire, elle tue souvent un habitant sur deux, et la totalité de ceux de certains villages sont enfouis dans des fosses communes ou entassés sur des bûchers.
Au début du xive siècle, la population du royaume était devenue si abondante que la disette – parfois la famine –, après des décennies de récoltes suffisantes, étaient réapparue.
La peste noire vide les campagnes sans faire disparaître la famine. Et les survivants tuent ceux qu'ils jugent responsables de l'épidémie.
On dit que les juifs empoisonnent les puits et les sources. On les traque et on les brûle. Ceux qui le peuvent se réfugient à Avignon, où le pape Clément VI les protège, excommuniant ceux qui les persécutent. Mais des milliers périssent, comme si l'épidémie de peste noire réveillait une autre maladie endémique, l'antijudaïsme, comme si celui-ci était caché au plus profond d'un repli de l'âme de la France et se tenait prêt à l'infester si les circonstances s'y prêtaient, s'il fallait désigner un bouc émissaire responsable des malheurs du temps.
Dans le désarroi et la terreur provoqués par la peste noire, des milliers de chrétiens se flagellent, « batteurs » fouettant leurs corps jusqu'au sang, zébrant leurs torses et leurs cuisses en hurlant, longues processions ensanglantées parcourant des campagnes appauvries.
D'autres paysans – ces « jacques » – affamés se rebellent. Quand la jacquerie devient menaçante, on la taille en pièces – ce que fait Charles le Mauvais en 1358, massacrant plus de vingt mille jacques après avoir, par traîtrise, capturé puis décapité le chef (Guillaume Carle, en Beauvaisis) que ces paysans se sont donné.
Sur fond de peste noire – et donc de « grande peur », comme on dira en 1789 –, de disette, de jacqueries – donc de violences – se met en place une « mécanique » sociale et politique qui caractérisera souvent l'histoire nationale.
Le pouvoir royal est affaibli : le Dauphin Charles, fils de Jean le Bon, réunit les états généraux (1357).
On voit surgir des « réformateurs » parmi lesquels s'imposent le prévôt des marchands de Paris, Étienne Marcel, l'évêque de Laon, Robert le Coq, du parti de Charles de Navarre.
Cet engrenage – querelles dynastiques, jacqueries, états généraux, volonté de réforme, rôle des « bourgeois » de Paris – « invente » un assemblage qui se recomposera à maintes reprises au cours de l'histoire de France.
À Paris, une foule en armes massacre les « mauvais conseillers » du roi (22 février 1358).
Étienne Marcel pénètre dans les appartements du Dauphin et ordonne la mise à mort des « maréchaux » de Champagne et de Normandie, qui incarnent la chevalerie incapable de remporter des victoires militaires contre les Anglais et opposée aux réformes.
Le Dauphin Charles assiste au massacre de ses proches, qu'il est contraint d'approuver. Étienne Marcel le prend alors sous sa protection, le coiffant d'un chaperon rouge et bleu, couleurs de la bourgeoisie parisienne !
On pense ici à Louis XVI qui, le 20 juin 1792, face aux sans-culottes qui ont envahi le palais des Tuileries, est contraint de « boire à la santé de la nation » et de coiffer le bonnet rouge. C'est comme si les émeutiers rejouaient, quatre siècles plus tard, la scène de février 1358 !
Les peuples ont une longue et fidèle mémoire. Les souvenirs jaillissent, ressuscitent des gestes inscrits dans l'inconscient collectif comme si, au cours des temps, s'était élaboré une génétique de la nation.
Ces mécanismes politiques et psychologiques vont s'inscrire dans l'âme de la France, où s'affirme le sentiment national.
Les partisans d'Étienne Marcel se retournent contre lui – en juillet 1358 – quand le prévôt des marchands, devenu l'allié de Charles le Mauvais, sera rendu responsable de l'entrée dans Paris de troupes anglaises.
Il est assassiné à la porte Saint-Antoine après que Jean Maillart, qui a été l'un de ses soutiens, a refusé de lui remettre la clé de la porte, et a fait au contraire appel au Dauphin, qui va pouvoir rentrer dans Paris.
On mesure ici combien la question « nationale » est intriquée avec les questions de politique « intérieure ».
Charles le Mauvais, rival du Dauphin, et Étienne Marcel, le réformateur, ont recours aux Anglais. Car ceux-ci sont certes des étrangers, mais aussi issus de la même origine « française ». Dès lors, rechercher leur appui, est-ce prendre le parti de l'étranger ? On peut d'autant plus se poser la question que le système féodal – vassalité – enserre encore le royaume.
Cependant, choisir l'Anglais pour allié, c'est déjà être, aux yeux de Français de plus en plus nombreux, du « parti de la trahison ».
Et c'est cette coalition des féodaux avec l'étranger, de Charles le Mauvais avec les Anglais, qui est défaite à Cocherel, le 16 mai 1364, par le capitaine breton Bertrand Du Guesclin.
Le Dauphin Charles, dont le père Jean le Bon vient de mourir prisonnier à Londres, peut sortir de Paris et se rendre à Reims pour s'y faire sacrer avec son épouse Jeanne de Bourbon, le 19 mai 1364.
L'abîme ne s'est pas refermé sur le royaume de France et ses souverains.
15.
En 1364, après l'avènement et le sacre de Charles V, le peuple espère que les souffrances, la disette, la peste noire, mais aussi ces compagnies de routiers, de soudards, de pillards, d'Anglais qui, entre deux batailles, écument le pays, vont s'éloigner.
Charles V n'est-il pas de « sainte lignée » ? Ne dit-il pas qu'il veut placer sa couronne sous la protection du « bienheureux Louis, fleur, honneur, bannière et miroir, non seulement de notre race royale, mais de tous les Français » ?
Il déclare que le roi « doit seigneurier au commun profit du peuple ». Il incarne la figure du souverain français tel qu'on le rêve, soucieux du sort de son peuple. Et donc ne le pressurant pas fiscalement, supprimant même certaines impositions – ce qui attire à lui les seigneurs gascons auxquels l'Anglais réclame des taxes. Un roi qui s'entoure d'hommes sages, légistes, professeurs, théologiens, lecteurs d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin – Nicolas Oresme et Philippe de Mézières –, qui accumule dans une tour du Louvre plus de mille manuscrits, autant qu'en possède le pape. Et ses propagandistes écrivent, et on recopie leur Traité du Sacre, le Songe du Vergier, dans lesquels ils exaltent les caractères du monarque, mystique et divin, de la royauté française, tout en affirmant son indépendance vis-à-vis de la papauté.
Ce souverain-là ne veut conduire qu'une guerre victorieuse. Assez de Crécy et de Poitiers ! Ses chefs de guerre, Bertrand Du Guesclin et Olivier de Clisson, sont de prudents hommes d'armes, non des chevaliers téméraires et écervelés, cibles des archers anglais. Du Guesclin et Clisson conseillent de ne combattre les Anglais que s'ils sont en mauvaise posture : c'est ainsi seulement qu'on doit « prendre un ennemi ».
Et prudemment, de manière retorse, Charles V se réapproprie le Poitou, la Saintonge et l'Angoumois.
En 1380, à sa mort, l'Anglais ne possède plus qu'une bande de terre entre Bordeaux et Bayonne, et les villes de Calais, Brest et Cherbourg.
Le royaume reprend son souffle après des temps où la peste, la disette et la guerre l'étouffaient.
On peut semer et moissonner. On peut vendre son grain en échange d'une monnaie – un franc d'or – que de trop rapides changements de teneur en métal précieux ne dévaluent pas d'une saison à l'autre. Et à Paris on peut s'imaginer que l'ordre et la sécurité vont régner.
Charles V entreprend de renforcer les défenses de la ville. Une nouvelle enceinte est construite, englobant les nouveaux quartiers.
Il protège ainsi sa résidence de l'hôtel Saint-Paul, immense bâtiment qui possède sept jardins, une ménagerie, une volière, un aquarium. Il poursuit la construction du donjon de Vincennes et commence à ériger, à la porte Saint-Antoine, une Bastille qui comportera huit donjons reliés par un mur de vingt-quatre mètres de hauteur.
Aucune ville chrétienne ne recèle une telle forteresse. Mais Paris n'est-elle pas la plus grande ville de la chrétienté ?
Ainsi, tout au long du règne de Charles V (1364-1380), se dessine et se précise dans l'âme française le modèle du « bon souverain », lettré (on dira de Charles V qu'il est « le Sage »), entouré de conseillers dévoués – savants eux-mêmes –, prudent mais courageux défenseur du royaume, soucieux du bien commun, et, comme l'écrit sa biographe Christine de Pisan, fille d'un médecin conseiller du roi, « désireux de garder et maintenir, et donner exemple à ses successeurs à venir que par solennel ordre doit se tenir et mener le très digne degré de la haute couronne de France ».
Roi administrateur veillant à la bonne gestion du royaume, il promulgue de Grandes Ordonnances afin d'organiser sa succession – son fils Charles n'a que douze ans en 1380 – en créant un conseil de régence, mais est tout aussi préoccupé de veiller au sort de la forêt française, cette richesse du royaume dont une ordonnance, à compter de 1376, fixe les règles d'exploitation.
Ce souverain-là sait écouter son peuple.
Quand des émeutes urbaines – à Montpellier, notamment – et des jacqueries – celles des tuchins qui se mettent sur la touche (1379) – soulèvent le peuple contre le fisc, il réprime mais diminue les impôts. Et, peu avant sa mort, il annonce la suppression des impôts directs, les fouages (calculés par « feux »).
C'est le roi juste et sage, celui que recherchent tout au long de leur histoire les Français, et qui, parce qu'il y a eu Saint Louis et Charles V – puis d'autres, plus tard, de cette « sainte lignée » –, ne surgit ni d'un rêve ni d'une utopie. C'est celui qu'on attend dans les temps sombres, et qu'on regrette après sa mort.
« Au temps du trépassement du feu roi Charles V, l'an 1380, les choses en ce royaume étaient en bonne disposition et avaient fait plusieurs notables conquêtes. Paix et justice régnaient. N'y avait fait obstacle, sinon l'ancienne haine des Anglais... »
Il n'y a pas que l'Anglais.
Le chroniqueur Jean Juvénal des Ursins oublie que l'étranger, dans un royaume comme la France, ne peut rien s'il ne bénéficie de la complicité, de l'alliance d'une partie des grands.
Or l'œuvre de rétablissement accomplie par Charles V est minée par les privilèges, les apanages qu'il a accordés à ses trois frères : Jean de Berry, Louis d'Anjou et Philippe de Bourgogne. Ce sont eux qui vont composer le conseil de régence, puisque, à la mort de Charles V, son fils Charles VI n'a que douze ans.
Et lorsque Charles VI trépasse à son tour, en 1422, le royaume de France est plongé au plus profond des abîmes de son histoire.
Charles VI a déshérité son fils, l'a banni, l'accusant d'« horribles crimes et délits ». Il a marié sa fille Catherine au roi d'Angleterre, Henri V de Lancastre, qu'il a légitimé comme « son vrai fils et héritier ». Et le traité de Troyes conclu en 1420 a stipulé que la couronne de France est échue à Henri V et pour toujours à ses héritiers.
Il n'y a donc plus qu'une double monarchie : le roi d'Angleterre est roi de France.
Aussi, quand en 1422 Charles VI et Henri V décèdent et que le fils de l'Anglais ne peut régner, puisqu'il n'a que dix mois, c'est le duc de Bedford qui devient régent d'une France occupée par les Anglais ; quant au fils de Charles VI, qui l'a déshérité, il peut bien prendre le titre de Charles VII il est celui que, par dérision, on surnomme « le roi de Bourges » !
C'est le duc de Bedford qui a présidé à Saint-Denis aux obsèques de Charles VI, et le héraut s'est écrié : « Vive le roi Henri de France et d'Angleterre ! »
Était-ce le royaume de France que l'on portait en terre ?
« Chacun vit mourir là rien que plus qu'il aimât », écrit un témoin.
Ainsi, en l'espace de quarante-deux années, le royaume est-il retombé au fond d'un abîme bien plus profond que celui d'où Charles V le Sage avait réussi à l'arracher.
En 1422, dans ce pays occupé, le seul espoir gît dans cette blessure intime de chaque Français qui souffre de la présence anglaise, de la perte de souveraineté du royaume, gouverné au nom de Henri VI par le duc de Bedford.
Or cela fait quatre décennies que le peuple subit le malheur.
Peste, disette, famine, violences des Grandes Compagnies, pillage par les Anglais, châtiment à la moindre rébellion.
Les oncles de Charles VI, maîtres du conseil de régence, massacrent les jacques, ou les bourgeois quand ils protestent contre la levée d'impôts trop lourds, ou bien quand ils ont la disgrâce de figurer dans le camp de l'un des princes et que celui des autres est vainqueur.
Car les oncles du roi sont divisés.
Le plus puissant est Philippe de Bourgogne, opposé à ses deux frères, Louis d'Anjou et Jean de Berry.
Et l'Anglais, entre ces rivaux, peut jouer l'un ou l'autre. Il est d'autant plus fort que le royaume est appauvri, que sa population n'a jamais été aussi réduite – à peine une douzaine de millions d'habitants.
Marchands, artisans, jacques, manouvriers, bourgeois de Rouen, de Paris ou d'Orléans ont le sentiment que les oncles du roi dilapident les biens du royaume et remplissent les coffres avec des impôts de plus en plus lourds.
Dans les villes et les campagnes, on s'insurge. On massacre les percepteurs, on pourchasse les juifs (ils seront expulsés du royaume en 1394), on ouvre les portes des prisons.
À Paris, les émeutiers s'emparent, à l'Hôtel de Ville, des deux mille maillets de plomb que le prévôt avait fait entreposer là pour servir en cas d'attaque des Anglais.
Ces mouvements populaires échappent aux riches bourgeois qui voudraient les utiliser pour faire pression sur les oncles du roi.
Ceux-ci répriment. Les têtes roulent, les corps se balancent aux gibets. Mais le calme ne revient dans le royaume qu'au moment où le roi, en 1388, met fin au gouvernement des princes, et, avec l'aide des « sages » conseillers de son père Charles V, règne effectivement.
Court moment d'apaisement. C'est le temps des fêtes. Charles VI a vingt-deux ans, son épouse Isabeau en a dix-neuf, son frère Louis d'Orléans, dix-huit. Danses, jeux, déguisements. Louis d'Orléans guide le roi son frère et la reine Isabeau dans les labyrinthes du plaisir. La tragédie n'est jamais bien loin. Des travestis vêtus en sauvages, la peau enduite de poix et couverte de poils, meurent brûlés vifs à un bal donné à l'hôtel Saint-Paul.
Ce bal des Ardents est le symbole de cette période : Paris brille des milliers de feux d'une fête qui attire artistes et artisans. Louis d'Orléans « ne gouverne aucunement à son plaisir et fait jeunesses étranges ».
Le pouvoir entre les mains des oncles du roi était divisé ; il est maintenant débauché sans que cessent les rivalités. Et le peuple continue de souffrir.
Seule la présence du roi légitime empêche la désagrégation du royaume.
Mais, le 5 août 1392, dans la forêt du Mans, il suffit de la rencontre d'un mendiant, mauvais présage, et du choc bruyant d'une lance sur un casque pour que Charles VI bascule dans la démence.
Ce roi fou, Charles VI, qui dans ses périodes de lucidité sombre dans la dépression ou est influencé – manœuvré – par son entourage, va « régner » ainsi entre démence et prostration trente ans durant.
Le royaume de France s'enfonce dans l'abîme parce que son roi a sombré dans la folie et que les grands s'entre-déchirent, peu soucieux du sort du royaume.
Ce pays commence à découvrir un trait majeur de son histoire : qu'il pourrit toujours par la tête. C'est le cas avec la guerre civile entre le frère du roi, Louis d'Orléans, et son fils, Charles d'Orléans, marié à la fille du comte d'Armagnac, d'une part, et, de l'autre, Philippe de Bourgogne et son fils Jean sans Peur.
Ces deux factions – Armagnacs et Bourguignons – sont les deux fauteurs de guerre civile. Assassinats et massacres, utilisation des éléments les plus violents du peuple, sont de règle.
Jean sans Peur, le Bourguignon, fait assassiner en 1407 Louis d'Orléans, frère du roi, l'Armagnac. Dès lors, les Bourguignons traquent dans Paris tous les Armagnacs.
« On n'avait pas plus de pitié à tuer ces gens-là que des chiens : c'est un Armagnac. »
Les Bourguignons contrôlent le roi fou, s'appuient sur de « méchantes gens, tripiers, bouchers et écorcheurs, pelletiers, couturiers et autres pauvres gens de très bas état faisant de très inhumaines, détestables et très déshonnêtes besognes ».
L'un d'eux est Simon Caboche (1413), qui, avec les siens – les cabochiens –, fait régner la terreur dans Paris. Le monarque est terré dans sa folie. On impose une « ordonnance cabochienne », mais l'anarchie qui s'installe, les meurtres qui se multiplient, isolent les Bourguignons et poussent les marchands, la bourgeoisie parisienne, à changer de camp. Jean sans Peur quitte Paris, qui devient Armagnac avec Charles d'Orléans.
Que fait le camp perdant dans une guerre civile ? Il devient le parti de l'étranger. Le prince bourguignon s'allie alors avec l'Anglais.
Une pratique française se confirme : la division au sommet de l'État provoque la crise du royaume et la guerre civile dont l'étranger tire profit.
Le nouveau roi d'Angleterre, Henri V, est un souverain remarquable, grand chef de guerre, fin politique et homme pieux. Il entend se réapproprier l'héritage des Plantagenêts.
Son armée débarque en Normandie, gagne les pays de la Somme.
Les chevaliers français sont entassés sur le plateau d'Azincourt. Le sol est boueux, ce 25 octobre 1415. L'armure pèse au moins vingt kilos. Si l'on tombe à terre, on ne peut se relever. Alors on charge les archers anglais sans attendre qu'arrive la piétaille des gens d'armes. Les chevaux se heurtent, renversent leurs cavaliers, qu'il ne reste plus aux Anglais qu'à égorger, car Henri V a ordonné qu'on ne fasse prisonniers que les grands et qu'on tue tous les autres.
Ils seront trois mille chevaliers, barons, baillis, grands officiers de l'administration du royaume à être ainsi massacrés.
Charles d'Orléans, prisonnier, est transféré en Angleterre, où, de prison en prison, il passera vingt-cinq années à se morfondre et à rimer :
En regardant vers le pays de France
Un jour advint à Douvres sur la mer
Qu'il me souvint du doux plaisir
Qu'en ce pays je trouvais
Et mon cœur commença à soupirer
Mais à mon cœur amer
Voir la France faisait grand bien.
Cette nostalgie charnelle du royaume perdu, cette souffrance et cette humiliation, il n'est pas besoin d'être prisonnier en Angleterre pour les ressentir.
On souffre de la guerre civile : les Bourguignons massacrent encore les Armagnacs à Paris en 1418 ; Jean sans Peur le Bourguignon est assassiné à Montereau le 10 avril 1419 – est ainsi vengé Louis d'Orléans, qu'il avait fait tuer le 23 novembre 1407.
On souffre de l'avancée des troupes anglaises, armée d'occupation qui prend possession sans ménagements du royaume de son roi, imposant à Rouen un siège impitoyable, remontant la Seine : « Les Anglais font autant de mal que les Sarrasins. » Mais on en veut aussi au Dauphin Charles, devenu lieutenant général du royaume en 1417.
On désire la paix.
On approuve donc le traité de Troyes (20 mai 1420). Henri V de Lancastre épouse la fille de Charles VI et devient, de fait, fils et héritier du roi de France.
Charles le Dauphin n'est plus qu'un banni.
Le 1er décembre 1420, Henri V, Charles VI, le pauvre roi fou, son épouse Isabeau et Philippe le Bon, le nouveau prince bourguignon, entrent dans Paris.
« Jamais princes ne furent reçus à plus grande joie qu'ils furent. »
La capitale du royaume de France est aux mains des Anglais, mais la foule assoiffée de paix applaudit.
Après la mort de Henri V et celle de Charles VI, en 1422, le duc de Bedford est régent du royaume au nom de Henri VI de Lancastre.
Malheureux Charles VII, roi de Bourges !
Un pouvoir divisé, une guerre civile, un parti de l'étranger, un peuple exsangue et désorienté, la souffrance d'une âme française humiliée, bafouée, niée : tel est l'abîme où a chuté le royaume de France.
Quelle providence ou quelles circonstances, quels héros pourront-ils lui permettre de resurgir au grand jour de l'unité et de la souveraineté nationales ?
16.
Où s'est réfugiée l'âme de la France, puisque le territoire du royaume est partagé et que celui qui se proclame roi de France, ce pauvre Charles VII, n'a pas même été sacré à Reims, qu'il tient sa Cour à Bourges et qu'Orléans est assiégée par l'Anglais ?
Car le roi anglais, Henri VI de Lancastre, est roi de France, lui aussi, fort de la légitimité que lui confère le traité de Troyes. Et à Paris, qu'il contrôle, les bourgeois, les maîtres de l'Université, les marchands, les évêques, « collaborent » avec le régent anglais, le duc de Bedford.
D'autant plus que l'Anglais a pour allié Philippe le Bon, le Bourguignon, le plus fastueux des princes de la chrétienté, qui possède trois capitales : Lille, Bruges et surtout Dijon. Riche, il l'est par les vignobles de Beaune – on construira dans cette ville, en 1443, un magnifique hôpital –, par les voies commerciales qu'il contrôle, par les Flandres ou cliquètent les métiers mécaniques à tisser.
Il attire peintres, artistes, sculpteurs.
Le duc de Bretagne, à l'autre extrémité du territoire, est lui aussi l'allié de l'Anglais.
Ainsi, cette « France anglaise » dispose de presque tout le pays au nord et à l'est de la Loire, et il faut encore y ajouter la Guyenne.
Telle est ainsi brisée l'ancienne unité française liée à la « sainte lignée » des rois de France.
Et lorsque les chevaliers du roi de Bourges tentent une fois encore de bousculer les archers anglais, ceux-ci, comme à Crécy, Poitiers, Azincourt, les massacrent de leurs flèches et de leurs coutelas, le 17 août 1424, à Verneuil-sur-Avre.
Charles VII doute aussi de lui, de ses droits. Hésitant, il songe parfois à se retirer en Dauphiné, à renoncer à la reconquête du royaume, qui lui paraît si difficile qu'elle en devient improbable.
Cependant, les provinces qu'il contrôle sont riches – les pays de Loire, notamment –, elles ont été peu touchées par les ravages de la guerre. Il a autour de lui non seulement les membres du vieux parti Armagnac, mais ceux qui sont restés fidèles à la dynastie capétienne.
Sans doute certains membres de sa Cour sont-ils tentés par des rapprochements avec les Bourguignons, et lui-même, miné par l'incertitude, n'est-il pas capable de prendre la tête de la résistance à l'Anglais, de se faire le héraut du royaume de France.
Élites collaborant avec l'occupant, pouvoir royal impuissant, armée défaite : l'âme de la France réside encore et résiste dans son peuple humilié et exploité par l'Anglais.
« Toujours le régent Bedford enrichissait son pays de quelque chose, et quand il en revenait il n'en rapportait rien qu'une nouvelle taille », écrit un témoin.
En Normandie, où l'Anglais, de Rouen à Caen, s'est fortement implanté, on se rebelle contre les impôts nouveaux. Et l'occupant réprime, sévit, pend, décapite.
Un patriotisme populaire naît de cette résistance. Il s'exprime partout, l'Anglais agissant partout selon son intérêt.
On murmure même à l'université de Paris, quand les professeurs y apprennent que Bedford veut créer une université à Caen afin d'y former des « administrateurs » au service des Anglais.
On mesure l'âpreté et la rapacité anglaises. Dans les années qui suivent le traité de Troyes, un témoin écrit : « Les Anglais ont détruit et gâté tout le royaume, et tant de dommages y ont fait au temps passé et de présent que si tout le pays d'Angleterre était rendu et mis à deniers, on n'en pourrait pas recouvrer la centième partie des dommages qu'ils ont faits audit royaume de France. »
L'âme de la France se forge ainsi dans la défaite et l'occupation étrangère. Un « parti français » s'affirme au sein du peuple.
Jeanne la Pucelle, fille de « labours aisés » et fille du peuple – analphabète, donc –, est l'une de ces Françaises qui, au nom de Dieu, protecteur du royaume de France, répondent à l'appel de ces voix – celle du Seigneur, celles du peuple – qui les incitent à se lever pour sauver le royaume.
Jeanne, qui est née entre la Champagne et le Barrois, est l'incarnation de ce mouvement surgi des profondeurs nationales.
Mais il y avait aussi Péronne, de Bretagne, et Catherine, de La Rochelle. Et combien de femmes et d'hommes agenouillés prient pour que soit sauvé le royaume et sacré le roi français ? La foi chrétienne enflamme le sentiment national. Jeanne est portée par cette croyance qui l'« oblige » à agir, lui insuffle la force de conviction bousculant les hésitations.
Le représentant du Dauphin, Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, bien que sa terre relève du duc de Bourgogne, va l'aider, lui permettre de rejoindre Chinon. Elle y reconnaîtra le Dauphin et s'imposera aux chefs de guerre après avoir été reconnue pucelle.
C'est une vierge qu'on attendait, puisqu'une débauchée, la reine Isabeau, avait corrompu le roi Charles VI et perdu le royaume.
Jeanne convainc les théologiens chargés de l'interroger : « Au nom de Dieu, les gens d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. »
De Blois elle prévient le roi d'Angleterre : « Je suis venue ici de par Dieu le Roi du Ciel pour vous bouter hors de France. »
En trois mois, Jeanne va changer la donne de cette guerre de cent ans en révélant la force du patriotisme populaire.
De la Bourgogne à la Normandie, de la Bretagne à l'Aquitaine, et à Paris même, on va rapidement savoir qu'une pucelle, menant au combat Dunois le Bâtard, demi-frère de Charles d'Orléans, La Hire, le duc Jean d'Alençon, et ses capitaines de compagnie, a, le 8 mai, fait lever le siège d'Orléans, et, le 18 juin, remporté la victoire de Patay.
Le Dauphin peut enfin, l'étreinte anglaise desserrée, se rendre à Reims et s'y faire sacrer le 7 juillet 1429.
Il est désormais le roi de France légitime.
« Gentil roi, dit la Pucelle, ores est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que levasse le siège d'Orléans et que vous emmenasse en cette cité de Reims recevoir votre Saint Sacre, en montrant que vous êtes vrai Roi de France et celui auquel le royaume de France doit appartenir. »
Victoire miraculeuse, née du peuple patriote et de la foi en Dieu.
Victoire décisive et pourtant gaspillée.
Charles VII et sa Cour n'agissent pas, veulent d'abord se réconcilier avec le duc de Bourgogne. Le roi laisse Jeanne, sans appui, tenter de prendre Paris (elle y est blessée), La Charité-sur-Loire. Elle entre dans Compiègne qu'assiège une armée bourguignonne. Mais elle ne connaît pas la fortune des armes comme à Orléans. Elle est faite prisonnière le 24 mai 1430 et vendue pour 10 000 écus aux Anglais.
Elle est jugée hérétique et schismatique à Rouen suivant une procédure inquisitoriale. Les clercs sont français (l'évêque de Beauvais, Pierre Cauchon) ; les soldats, anglais. Condamnée, elle est brûlée vive le 30 mai 1431, place du Marché, à Rouen : « Elle fut arse cestui jour. »
Rien n'avait été tenté par Charles VII pour arracher celle que les Anglais et les juges ecclésiastiques à leur service tenaient pour une sorcière, et qui avait tiré le royaume de France de l'abîme.
Mais Jeanne la Pucelle n'allait pas être oubliée, devenant dans l'âme de la France, le symbole du patriotisme, et, pour les chrétiens, la preuve que la Providence veille sur le royaume.
Son procès en réhabilitation aura lieu en 1456. Mais la Pucelle continue de chevaucher tout au long de l'histoire nationale : patriote revendiquée par la IIIe République, béatifiée en 1900, elle est canonisée en 1920 par Benoît XV. Et le 8 mai fut proclamé fête nationale.
« Lance au poing et dans son étui de fer aussi claire que le soleil d'avril à sept heures,
« Voici Jeanne sur son grand cheval rouge qui se met en marche contre les usurpateurs [...]
« Et maintenant écoutez, Messieurs les hommes d'État, et vous tous, Messieurs les diplomates, et vous tous, Messieurs les militaires...
« Jeanne d'Arc est là pour vous dire qu'il y a toujours quelque chose de mieux à faire que de ne rien faire...
« Cette Pucelle et cette patronne et cette conductrice au plus profond de la France arrachée par l'aspiration du Saint-Esprit... »
On peut refuser cette vision mystique de « sainte Jeanne » et de la France qu'exprime Paul Claudel, mais, après son « passage » – « Cette flamme déracinée du bûcher ! elle monte ! » –, tout change. Comme si le patriotisme populaire et la foi qu'il exprime obligeaient les « élites » à constituer ce « parti français » qui fait de l'Anglais l'ennemi dans tout le royaume, et Charles VII, sacré à Reims, le seul roi de France.
Une paix est conclue entre Bourguignons et Armagnacs (Arras, 1435). Charles VII entre le 12 novembre 1437 dans un Paris ruiné où errent les loups, mais c'est sa capitale. Elle est à l'image d'un royaume dévasté, parcouru par les Grandes Compagnies. Les campagnes sont vides d'habitants ; de rares paysans affamés y sont guettés par les « écorcheurs », les routiers en maraude, ou frappés par les retours de la peste noire (ainsi en 1438).
De tout le royaume monte vers le roi le désir de le voir agir.
« Il faut que vous vous éveilliez, car nous n'en pouvons plus », lui lance Jean Juvénal des Ursins.
Charles VII acquiert de la détermination. Il se montre combatif et volontaire. Il affiche ses maîtresses – Agnès Sorel –, et le Dauphin Louis supporte mal cette autorité nouvelle. Le futur Louis XI s'éloignera de ce père devenu, pour les vingt dernières années de son règne, un vrai roi de France.
Charles VII réforme. Par les ordonnances de mai 1445, à partir de ces routiers, de ces écorcheurs, de ces soldats désœuvrés entre deux batailles, il crée une armée soldée par le Trésor royal et donc permanente. Ces « Compagnies de l'Ordonnance du Roi » sont logées en forteresse ou chez l'habitant, et complétées par des « francs archers » à raison d'un par cinquante feux. Le franc archer, dispensé d'impôts, doit s'entraîner au tir à l'arc ou à l'arbalète.
Le roi tire enfin la leçon des défaites de la chevalerie française en créant cette « infanterie à l'anglaise ».
Pontoise (1441), Le Mans (1448), Rouen, Caen, Cherbourg (1449) sont reconquises. Et, avec ces villes, le prestige royal.
L'entrée de Charles VII à Rouen est solennelle. Ce 10 novembre 1449, il est accueilli par l'archevêque Raoul Roussel, par les évêques qui furent les acteurs du procès de Jeanne d'Arc et par les témoins de son supplice.
Mais, après avoir été les alliés intimes des Anglais, les dignitaires s'inclinent désormais devant Charles VII, qui avance sous un dais, précédé par un cheval portant le sceau aux trois lis.
La fonction royale est séparée du corps du roi.
La victoire de Castillon, en Guyenne – le 17 juillet 1453 –, clôt la guerre de Cent Ans.
Trois cents bouches à feu ont écrasé la chevalerie et l'infanterie anglaises dans cette Aquitaine liée à l'Angleterre depuis trois siècles.
Tant de batailles perdues sont ainsi vengées.
Le pouvoir a toujours besoin de gloire. Dans l'histoire nationale, depuis les origines, ce sont les glaives et les armées qui l'ont apportée.
Le chevalier, le soldat – et le clerc – sont en France, plus que les marchands, faiseurs de prestige. L'argent, le commerce, plient devant le pouvoir. Et Charles VII fait emprisonner Jacques Cœur (1451), grand argentier et grand marchand. L'argent n'est jamais une fin, pour un roi de France, au contraire de la gloire.
Ce n'est qu'un indispensable moyen.
Quand, le 22 juillet 1461, Charles VII s'éteint, le royaume de France a recouvré une part de sa puissance, de sa gloire et de sa richesse.
Est-ce par une attention de la Providence ?
Celui qui n'avait jamais été qu'un « gentil Dauphin », Charles VII, est devenu, grâce à Jeanne la Pucelle, grâce à tous les Français, attachés à leur nation, et aux conseillers qui l'ont à sa Cour assisté, Charles VII le Bien servi.
17.
« Je suis France », dit Louis XI.
Il vient enfin, à trente-huit ans, de succéder à son père, Charles le Bien servi.
Voilà près de vingt ans qu'il attend, plein d'impatience et même de rage. Il a quitté le royaume de France pour se réfugier chez le Bourguignon, Philippe le Bon. Il a conspiré contre son père, organisé complots et même prises d'armes.
Enfin Charles VII est mort.
Le 13 août 1461, Louis entre dans la cathédrale de Reims : cérémonie fastueuse dont les détails et la magnificence ont été voulus par le duc de Bourgogne ; c'est d'ailleurs lui qui a posé la couronne sur la tête de Louis XI.
C'est à ses côtés qu'il entrera dans Paris, le 31 août.
« Je suis France », dit alors Louis.
Manière d'affirmer qu'il sera souverainement roi de France, donc prêt à secouer toutes les tutelles qu'on voudrait lui imposer. Et d'abord celle de l'héritage de Charles VII. Il renvoie les conseillers de son père : vingt-cinq baillis et sénéchaux. Et il suffit de quelques semaines pour que l'on comprenne que ce souverain au visage de fouine, d'une piété superstitieuse, remuant entre ses doigts des médailles saintes comme s'il s'agissait d'amulettes, est un monarque déterminé et autoritaire.
Il se méfie des grands, donc en tout premier lieu du duc de Bourgogne, le plus puissant. Il préfère s'entourer d'hommes simples mais dévoués corps et âme – Tristan L'Hermite, Olivier Le Daim, l'évêque Balue, bientôt disgracié et emprisonné sans procès –, le chroniqueur Commynes, corrompu, et Francesco Sforza, venu de l'Italie de Machiavel et des Médicis.
Ainsi, pour la première fois dans l'histoire nationale, un souverain esquisse un pouvoir « absolutiste » en s'appuyant non plus sur ses vassaux, les grands, mais sur des hommes liés à lui par un lien de « service », serviteurs du roi et donc de l'État.
Gouvernement impitoyable : le roi réprime avec sauvagerie – pendaisons, mutilations, bannissements – la « tircotterie » d'Angers et la « mutemaque » de Reims, des émeutes antifiscales.
Car ce pouvoir qui se ramifie a besoin d'argent. Il multiplie par quatre la taille. Il resserre les rouages de l'État, contrôle les villes, le clergé. Il renforce l'armée des compagnies d'ordonnances. Il favorise les cités marchandes. Il crée une quatrième foire à Lyon, ce qui fait de cette ville un centre d'attraction pour les banquiers et marchands italiens. De nombreuses routes sont pavées et les « chevaucheurs » du roi, qui transportent les plis officiels, trouvent aux relais des montures fraîches.
Et à sa manière autoritaire, en renforçant l'État, le roi exprime les souhaits du peuple, de ce « parti français » né dans la guerre contre le « parti de l'étranger », et qui, même s'il en craint la violence, approuve un souverain affirmant : « Je suis France. »
Avec Louis XI surgit ainsi un nouveau type de souverain français, de pouvoir national, peu respectueux des « règles » et de la morale – les conseillers de Louis XI sont des hommes de police, et même, à l'occasion, des bourreaux –, comme si le service du royaume autorisait – au nom de Dieu aussi, car le roi est pieux, il invoque saint Michel – l'emploi de toutes les habiletés et de toutes les violences.
Parce que la ville d'Arras a résisté en 1479, tous les habitants en sont chassés, remplacés par d'autres, et la ville, débaptisée, devient un temps « Franchise ».
Mais ce pouvoir est national. Louis XI se rend en pèlerinage à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, il crée l'ordre de Saint-Michel parce que, dix ans durant – 1424-1434 –, la place a résisté au siège des Anglais, parce que Jeanne d'Arc a invoqué saint Michel qui allait l'aider à terrasser l'Anglais comme il avait terrassé le dragon.
Et les premières imprimeries qui se créent à Paris à partir de 1470 – il y en aura neuf, contre quarante en Italie – diffusent à des centaines d'exemplaires, peut-être même à un ou deux milliers, ces invocations à saint Michel et ces apologies du roi de France. Les grands qui ont montré contre les Anglais leur impuissance, leur désir de collaborer avec l'occupant et de constituer un parti de l'étranger, et les chevaliers qui ont donné la preuve de leur incapacité à vaincre les archers anglais voient ainsi leur pouvoir réduit au bénéfice de celui du roi et de l'État.
Au contraire, comme jamais, les marchands, les bourgeois, les manouvriers, considèrent que le pouvoir royal est le garant de leur prospérité :
Et quand Anglais furent dehors
Chacun se met en ses efforts
De bâtir et de marchander
Et en biens superabonder.
Ce « parti français », ce peuple « patriote », n'est évidemment pas conscient de la politique que conduit Louis XI, mais, lorsqu'il est averti de ce qui se trame, il soutient l'« universelle aragne » qui tisse sa toile pour réduire les ducs et les princes à l'impuissance et les dépouiller de leurs possessions au profit du royaume.
Tel est l'axe de cette politique française de Louis XI, qui parfois trébuche sur les propres pièges qu'elle tend à ses adversaires.
Les grands ont jaugé la menace. Ils mènent dès 1465 une guerre ouverte contre Louis XI. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon et son fils Charles le Téméraire, le duc de Bretagne, ont formé ce qu'ils appellent la ligne du Bien Public et ont enrôlé dans leurs rangs le propre frère du roi.
Après la bataille incertaine de Montlhéry (16 juillet 1465), les ligueurs menacent Paris. Louis XI négocie (traité de Conflans, 1465), mais sa détermination ne faiblit pas. Il incite les Flandres à se soulever contre Charles le Téméraire, et prend le risque de se rendre à Péronne, défier le duc de Bourgogne et négocier avec lui en dépit de l'insurrection des Liégeois, que, l'accord une fois intervenu, on réprimera (1468).
Ce souverain bavard, retors et superstitieux, auteur de plus de sept volumes de lettres, a une vision claire des dangers qui menacent le royaume. Il doit briser le duché de Bourgogne, empêcher que Charles le Téméraire ne conquière l'Alsace et la Lorraine, réunissant ainsi territorialement la Flandre et la Bourgogne. Et il doit plus encore empêcher que se renoue l'alliance anglo-bourguignonne.
Or Édouard IV débarque en 1475 une armée de 25 000 hommes à Calais. Pour le faire renoncer, il faut lui verser 75 000 écus plus 50 000 écus de rente annuelle.
Le peuple approuve cette politique. Les villes ont résisté aux Bourguignons (ainsi Jeanne Hachette à Beauvais). Il se félicite de l'accord intervenu entre Louis XI et Édouard IV d'Angleterre (à Picquigny, 1475) :
J'ai vu le Roi d'Angleterre
Amener son grand ost
pour la Française terre
Conquérir bref et tost
Le Roi voyant l'affaire
Si bon vin leur donna
Que l'autre sans rien faire
Content s'en retourna.
Ce roi réussit. Charles le Téméraire, qui a repris la guerre, meurt devant Nancy (1477), et en jouant des successions, en mêlant habile diplomatie et menaces, Louis XI agrandit le royaume de France du Roussillon, de la plus grande partie de la Bourgogne (duché), de la Picardie, de l'Anjou, du Maine et de la Provence.
Avec Marseille, le royaume s'ouvre ainsi sur la Méditerranée et recouvre les limites de la Gaule romaine.
Certes, il a fallu accepter que Marie de Bourgogne – fille de Charles le Téméraire – épouse l'empereur Maximilien d'Autriche. Les Habsbourg sont aux portes du royaume de France. Mais Louis XI a obtenu que la fille de Marie de Bourgogne épouse le Dauphin Charles, et elle apporte dans sa dot la Franche-Comté, l'Auxerrois, le Mâconnais et l'Artois.
Au sud, Isabelle de Castille a épousé Ferdinand d'Aragon, et ces Rois Catholiques vont reconquérir toute l'Espagne, en chasser les musulmans.
Ces modifications portent en germe une nouvelle géopolitique de l'Europe occidentale. Le royaume de France ne peut qu'y être directement impliqué.
Le 30 août 1483, quand meurt Louis XI à Plessis-lès-Tours, le royaume de France n'est plus l'État exsangue de la première moitié du xve siècle.
L'âme du pays a été trempée par la guerre. Elle se sait et surtout se veut française.
Au lent processus d'agrandissement et d'unification du royaume, Louis XI, en vingt-deux ans de règne, a apporté une contribution majeure.
Dans le fonctionnement du pouvoir, il a tout subordonné au succès de la politique qui sert la gloire et les intérêts du royaume tels que le roi les conçoit.
Ceux qui ne partagent pas cette vision doivent être brisés. Le royaume de France ne doit compter que des sujets soumis au pouvoir royal.
L'âme de la France se souviendra de l'« universelle aragne ».
18.
La mort a saisi Louis XI et c'est un enfant de treize ans qui est sacré roi de France. Point de conseil de régence pour Charles VIII : le défunt roi a choisi deux tuteurs, sa fille Anne et son époux, Pierre de Beaujeu, un Bourbon dont il sait qu'ils continueront sa politique avec ténacité et prudence. « Anne, disait-il, est la femme la moins folle du monde. »
Et, précisément, elle doit faire face avec Pierre de Beaujeu à la « Guerre folle » que mènent contre ces deux tuteurs les princes qui veulent dominer le roi, retrouver leur influence. Parmi eux, il y a le cousin du souverain, Louis d'Orléans, fils du poète Charles d'Orléans, retenu si longtemps prisonnier en Angleterre. Vaincu par les troupes royales, Louis d'Orléans passera trois années en prison (1488-1491) avant de devenir, à la mort de Charles VIII (1498), Louis XII, roi de France.
Et, revêtant les habits du souverain, il combat à son tour les princes. Il peuple son Conseil de roturiers, comme l'avaient fait Louis XI et Charles VIII. Il écoute les avis de cet « humaniste » – un des hérauts de la révolution culturelle qui, portée par l'imprimerie, bouleverse des valeurs réputées immuables – nommé Guillaume Budé (1467-1540), dont Charles VIII avait fait son secrétaire.
Fini le temps des chroniqueurs à la Commynes. Charles VIII les a renvoyés.
Avec le roturier progresse l'esprit profane.
La Sorbonne admet les studia humanitatis – études profanes. Un Robert Gaguin publie pour Charles VIII les Commentaires de César, et une Histoire française qui se donne Tite-Live pour modèle.
Les imprimeries se multiplient à Paris et à Lyon. En 1514, Louis XII dispensera les livres de taxe à l'exportation. Les librairies disposent en réserve de plusieurs dizaines de milliers de volumes à eux tous.
On imprime, on réimprime François Villon, sa Ballade des dames du temps jadis :
Où est la très sage Héloïse
Pour qui châtré fut et puis moine
Pierre Abélard à Saint-Denis [...]
Et Jeanne la bonne Lorraine
Qu'Anglais brûlèrent à Rouen [...]
Mais où sont les neiges d'antan ?
La nation naît de cette langue qui s'affine, se crée en forgeant des mots neufs, en exprimant une sensibilité nouvelle et en donnant à des milliers de lecteurs la conscience forte d'appartenir à une communauté nationale. Le chant profane, les livres, la poésie, tous ces textes qui commencent à circuler constituent une mémoire collective, une légende et une mythologie partagées.
La France commence à vivre en chaque Français grâce au pouvoir des mots :
Frères humains qui après nous vivez
N'ayez les cœurs contre nous endurcis [...]
Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre !
Heureusement, entre le moment où Villon écrit cette Ballade des pendus – vers 1461 – et la fin du siècle (Charles VIII : 1483-1498 ; Louis XII : 1498-1515), la mort recule.
Les grappes de pendus au gibet de Montfaucon sont moins serrées.
La peste noire et la disette frappent encore au début du règne de Charles VIII, mais le pays se repeuple ; les étrangers sont admis sans avoir à payer le droit d'aubaine pour obtenir la « naturalité ».
Castillans et Italiens arrivent nombreux dans les villes, dont la population augmente (Paris : 250 000 ; Lyon, Nantes, Rouen, Toulouse : entre 25 000 et 50 000).
Les défrichements reprennent, les villages abandonnés retrouvent vie.
À Lyon, à Troyes, à Paris, du tissage à la fabrication de papier pour l'imprimerie, les ateliers se multiplient, en même temps que des modes nouvelles, venues d'Italie, répandent le goût du luxe, des tissus en soie, de la joaillerie.
En deux décennies, la France a retrouvé sa richesse. Elle est la plus vaste des nations – 450 000 kilomètres carrés –, la plus peuplée – 20 millions d'habitants –, celle dont l'organisation étatique, la plus élaborée, permet de recouvrer les impôts avec le plus d'efficacité.
Ainsi s'inscrit dans la mémoire nationale l'expérience à la fois du malheur exemplaire et du redressement miraculeux qui remet la France à sa place : au premier rang.
Le passage de la dévastation provoquée par la guerre – civile et étrangère – à ce renouveau, cet éloignement des temps de malheur, sont des éléments déterminants dans l'élaboration de l'âme de la France.
Hier, c'était la peur qui étreignait les campagnes menacées par les routiers des Grandes Compagnies.
À la fin du xve siècle, Claude de Seyssel publie Louange au Roi Louis XII, et il décrit une France paisible, gouvernée par un « Père » :
« Tous, dit-il, labourent et travaillent, ainsi avec les gens croissent les biens, les revenus et les richesses. »
La croyance s'enracine qu'il existe un miracle français, que la Providence veille sur le royaume.
Mais, rassurés, satisfaits, les souverains et leur entourage – et, naturellement, les grands, soucieux de recouvrer leur influence – ne réalisent pas que la France ne regarde pas vers l'Atlantique, où Portugais, Espagnols et Italiens s'aventurent (1492 : Christophe Colomb aborde les terres américaines), et qu'ainsi le royaume de France ne participera pas à ce partage du monde – et de l'or ! Les souverains français préfèrent chevaucher en Italie, qui, émiettée, sans État, est cependant le grand pôle économique et financier de l'Europe avec les Flandres.
S'il ne peut être question de conquérir ces dernières, l'Italie, elle, semble facile à saisir.
C'est le mirage de la monarchie française. Pour le matérialiser, on veut avoir les mains libres.
On rend le Roussillon à Ferdinand d'Aragon, l'Artois et la Franche-Comté aux Habsbourg. Une « politique étrangère » française se dessine, où l'illusion, le souci de la gloire, l'emportent sur la raison. Et dans laquelle on sacrifie le gain sûr, réalisé, au rêve.
Charles VIII entre dans Naples en février 1495, vêtu du manteau impérial et de la couronne de Naples, de France, de Jérusalem et de Constantinople.
Car le roi de France entend aussi libérer ces deux dernières villes (Constantinople a été conquise en 1453 par les musulmans). Mais il lui faudra rebrousser chemin devant la coalition italienne qui se forme, et quitter l'Italie malgré la furia francese victorieuse à Fornoue (5 juillet 1495).
Mêmes difficultés pour Louis XII, qui se heurte à une Sainte Ligue animée par le pape Jules II, peu soucieux de voir le grand royaume de France dominer l'Italie.
De cette aventure italienne resteront le renforcement d'un courant d'hommes et d'idées, et l'influence dominante de la création artistique italienne dans le royaume de France.
D'un côté, les hommes d'armes (Charles VIII est entré en Italie à la tête de près de trente mille hommes) ; de l'autre, les peintres, les musiciens, les architectes, les théologiens, les philosophes, de Savonarole à Machiavel.
D'un côté le roi, de l'autre le pape.
Un lien ambigu est ainsi noué entre l'âme de la France et celle de l'Italie, qui, quelles que soient les circonstances – incompréhensions, rivalités, conflits –, ne sera jamais tranché.
C'est que les libres décisions des hommes sont orientées par des logiques enserrées dans des structures qui posent les termes d'une équation que, par leurs choix, les acteurs auront à résoudre ou à compliquer.
Le royaume de France n'a, en matière de politique extérieure, le choix qu'entre une expansion vers le nord-est (la Flandre, les Pays-Bas), l'est (au-delà du Rhin), le sud-est (l'Italie) et le sud (l'Espagne).
L'Italie est le seul territoire qui, par son morcellement et sa richesse, attire les convoitises. Et il en sera ainsi jusqu'à ce qu'il soit unifié.
À l'intérieur du royaume, le pouvoir royal est aussi confronté à des problèmes qui ne sont jamais définitivement résolus, puisqu'ils font partie de la nature même de la société française.
Que faire des grands ?
Les tuteurs de Charles VIII ont brisé leur « Guerre folle ». Et, comme Louis XI avant lui, comme Louis XII après lui, Charles VIII s'appuie sur des « roturiers », des « bourgeois » qui deviennent ses conseillers.
De même, comme Charles VII – qui avait, dans la Pragmatique sanction de Bourges, affirmé en 1438 la nécessaire obéissance du clergé français au roi de France et non au pape, sauf en matière théologique –, Charles VIII favorise l'indépendance du clergé français.
Reste le troisième ordre (après l'aristocratie et le clergé), représenté au sein des états généraux, qui reflètent l'ensemble de la nation.
Charles VIII réunit les états en 1484 et leur annonce... une réduction des impôts (de la taille).
Quant à Louis XII, il les assemble à Tours en 1506 pour leur faire rejeter le projet de mariage entre l'héritière du duché de Bretagne – sa fille Claude de France – et le petit-fils de Maximilien d'Autriche, Charles de Habsbourg... futur Charles Quint !
Quel roi de France et quels représentants des Français eussent accepté de voir le royaume pris en tenailles par les Habsbourg, écrasant l'Ile-de-France entre leurs possessions de l'Est et de l'Ouest ?
C'eût été retrouver, en pis, la situation qui avait donné naissance à la guerre de Cent Ans.
En 1514, Claude de France épouse François de Valois et apporte en dot le duché de Bretagne.
Lorsque, le 1er janvier 1515, Louis XII, « Père du Peuple », meurt sans héritier mâle, c'est son cousin, François de Valois, qui monte sur le trône sous le nom de François Ier.
Des temps nouveaux commencent, dont on pressent qu'ils sont porteurs de bouleversements majeurs dans l'ordre des valeurs – mais l'âme de la France est déjà si forte, si structurée, qu'on ne pourra la nier.
CHRONOLOGIE I
Vingt dates clés (des origines à 1515)
35 000 avant J.-C. : L'homme de Cro-Magnon, aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil (Dordogne)
15 500 avant J.-C. : Grotte de Lascaux
620 avant J.-C. : Fondation de Marseille
500 avant J.-C. : Début des invasions celtes
58-52 avant J.-C. : Jules César en Gaule
177 : Martyrs chrétiens de Lyon
498 : Baptême de Clovis
800 : Charlemagne empereur
843 : Partage de Verdun
910 : Fondation de Cluny
987-996 : Hugues Capet
1096-1099 : Première croisade
1180-1223 : Philippe Auguste
1244 : Prise de Montségur, citadelle cathare
1285-1314 : Philippe le Bel
1348 : Épidémie de peste noire
1429 : Jeanne d'Arc délivre Orléans (8 mai), est suppliciée à Rouen le 30 mai 1431
1461-1483 : Louis XI
1495 : Entrée de Charles VIII (1483-1498) à Naples
1511 : Sainte Ligue (pape, Angleterre, Espagne, Venise, Suisse) contre la France de Louis XII (1498-1515)
LIVRE II
GUERRES CIVILES,
GLOIRE DU ROI,
PUISSANCE DE L'ÉTAT
1515-1715
1
LA GUERRE AU NOM DE DIEU
1515-1589
19.
Que devient le royaume de France après que Luther a affiché, en 1517, sur les portes de la chapelle du château de Wittenberg, 95 propositions pour réformer l'Église catholique, et que dans toute l'Europe, et d'abord dans l'Empire germanique, se déchaîne la guerre des religions entre huguenots et papistes, réformés et catholiques ?
Quelles blessures seront infligées à l'âme de la France dans cet affrontement des croyants qui devient vite une guerre civile et une guerre sociale ?
Comment un royaume dont le roi est le représentant de Dieu sur terre, qui accomplit en son nom des miracles, qui détient de fait un pouvoir quasi sacerdotal, pourrait-il traverser cette épreuve sans que les passions le bouleversent et le déchirent ?
Cependant, durant quarante-cinq ans, de 1515 à 1560, la tourmente qui ravage l'Allemagne – la révolte des paysans, une vraie guerre aux arrière-plans religieux, y commence en 1524 – semble épargner la France. On y poursuit les hérétiques, on y brûle les imprimeurs, on y conspire déjà, mais le royaume ne s'embrase pas.
Le vent souffle fort, la mer se creuse dès 1520, mais le royaume continue de voguer. Ce n'est qu'en 1559-1560 que la tempête se lève et que s'approche l'heure des massacres.
Les deux premiers souverains Valois, François Ier (1515-1547) et Henri II, son fils (1547-1559), ont affirmé avec force leur foi catholique et ont condamné les huguenots.
La guerre civile, la persécution généralisée, n'éclatent pas pour autant.
Mais voici que, le 30 juin 1559, au cours d'un tournoi – vestige et rituel médiévaux –, Henri II a l'œil et le crâne transpercés par un morceau de la lance de son adversaire, Gabriel de Montgomery. Longue agonie, symbole de la souffrance nationale à venir.
Son frêle fils aîné (quinze ans), François II, lui succède, mais régnera à peine un an et demi.
Va commencer alors le temps de la guerre civile. Mais l'on se souviendra des quarante-cinq premières années du xvie siècle comme d'une époque encore paisible.
Et pourtant, entre le 25 janvier 1515, sacre du duc de Valois, devenu François Ier, et la mort tragique de Henri II en 1559, que de transformations dans la vie du royaume, qui déterminent son avenir et marquent pour des siècles l'âme de la France !
D'abord le roi.
Il est, avec François Ier, glorieux vainqueur des Suisses à Marignan (13 et 14 septembre 1515) après avoir franchi les Alpes au col de l'Arche, 3 000 sapeurs ouvrant la route à 40 000 hommes et à 300 canons.
La tradition militaire nationale s'enracine. Sur le champ de bataille, le roi se fait sacrer chevalier par Bayard. Ce geste n'est pas la vaine tentative de faire revivre un rituel anachronique, mais l'expression d'une volonté de nouer le présent au passé. François Ier et Bayard sont des chevaliers. Il n'y a pas rupture entre les époques. L'institution monarchique est éternelle. Ainsi se créent et se renforcent les mythes nationaux.
François Ier annonce les campagnes de Bonaparte en Italie – les cols d'où l'on tombe par surprise sur l'ennemi, l'emploi de l'artillerie pour arracher la victoire. Et les avantages qu'on glane : concordat avec le pape en 1516 – le roi nomme aux charges de l'Église de France et bénéficie ainsi de sa richesse, qui devient un instrument politique pour s'attacher les candidats aux fonctions ecclésiastiques.
Il signe un traité de paix perpétuelle avec les cantons suisses : coûteux, parce qu'il faut les acheter, mais le royaume dispose ainsi d'une frontière sûre et de mercenaires courageux, dévoués, aguerris.
François Ier se sent si fort qu'il brigue en 1519 la dignité impériale. Mais l'argent des banquiers augsbourgeois – les Fugger – permet à Charles d'Espagne d'acheter les électeurs et de devenir Charles Quint.
Toute la géopolitique française s'en trouve changée : l'ennemi n'est plus l'Anglais. En 1520, François Ier accueille Henri VIII au camp du Drap d'or, mais le Habsbourg, Charles Quint, prend le royaume de France en tenailles entre le Rhin et les Pyrénées, et revendique l'héritage bourguignon.
L'Italie n'est plus seulement la terre des richesses, des arts, des créateurs qu'il faut attirer en France (Léonard de Vinci et sa Joconde, le Primatice, le Rosso, Cellini), mais le champ clos de l'affrontement entre le roi de France et l'empereur Charles Quint et son fils Philippe II. Entre le Français et les Habsbourg, dix-huit ans de guerre.
À la victoire de Marignan – jamais oubliée, magnifiée – succèdent les défaites, et d'abord la plus grave, le 24 février 1525 : le « désastre » de Pavie.
François Ier est fait prisonnier : « De toutes choses ne m'est demeurée que l'honneur et la vie sauve », dit-il. Transféré à Madrid, il n'est libéré qu'en signant sous la contrainte un traité léonin et en donnant ses fils en gage contre sa libération.
Humiliation.
Nécessité de trouver contre le Habsbourg des alliances nouvelles : celles des hérétiques allemands ! Et celle, encore plus scandaleuse, de Soliman le Magnifique.
Avec la complicité française, la flotte turque viendra bombarder en Nice 1543, et, pour que les équipages et les navires de Soliman puissent hiverner, François Ier les accueillera à Toulon après avoir vidé la ville de ses habitants.
L'intérêt dynastique et le « patriotisme monarchique » sont plus forts que la foi catholique !
La France inaugure ainsi une diplomatie « nationale » et « laïque » qui ne répugne pas à chercher l'appui de l'infidèle contre l'empereur chrétien, qu'il soit Charles Quint ou Philippe II d'Espagne.
Stratégie fructueuse qui permet de compenser la puissance des Habsbourg (deux après l'abdication et la mort de Charles Quint – 1556, 1558 : l'empereur Ferdinand et le roi d'Espagne Philippe II) et de consolider la présence française en Orient.
Les « capitulations » de 1536 accordent des avantages aux vaisseaux et aux marchands français au Levant, et confirment que la France est la protectrice des Lieux saints.
Au terme des affrontements (victoire française à Cérisoles en 1544, résistance de Metz en 1554, puis défaite française à Saint-Quentin en 1557), le traité du Cateau-Cambrésis (1559) marque l'épuisement des deux adversaires.
Henri II conserve les trois évêchés (Metz, Toul et Verdun), rend ses États au duc de Savoie, et les Anglais rétrocèdent Calais.
Mais ces aléas de la guerre – et même la captivité de François Ier – n'ont en rien atteint le prestige du roi.
François Ier est le « César triomphant », l'égal de Cyrus et de Constantin.
Il est pour la première fois « Sa Majesté ».
Les états généraux ne sont plus convoqués (de 1484 à 1560). « Car tel est notre bon plaisir. » « Car ainsi nous plaît-il être fait. »
Le roi gouverne en réunissant des conseils : Conseil secret, Conseil étroit, Conseil des affaires.
La centralisation renforce l'absolutisme.
L'ordonnance de Villers-Cotterêts, le 10 août 1539, manifeste cette volonté royale de réglementer, de contrôler, de tenir d'une main ferme tout le royaume.
Pièce maîtresse dans cette unification, c'est, au bénéfice du roi et de toutes les juridictions du royaume, un acte juridique et politique majeur qui marque profondément l'âme de la France.
Il vise, en 192 articles, à créer une nation « homogène » :
« Le langage maternel français » est obligatoire dans les actes publics.
La langue est l'instrument de la politique : le français est la langue de l'État.
La justice devient une arme étatique : les juridictions ecclésiastiques ne peuvent juger que les affaires concernant l'Église.
Dans la procédure pénale, l'accusé se voit privé de moyens de défense au bénéfice de l'accusation. Le pouvoir royal a tiré la leçon des émeutes qui se sont produites à Lyon en 1529, et la nouvelle législation permettra de réprimer avec encore plus de sévérité la révolte de 1543-1548 qui dresse la Guyenne contre les hausses d'impôts. De même, parce qu'il a fallu faire face en 1539 à une grève des imprimeurs lyonnais, l'ordonnance de Villers-Cotterêts interdit les confréries de métier.
Une monarchie absolue se met en place au moment où l'humanisme de la Renaissance imprègne les élites tout en les séparant du reste du peuple.
Le pouvoir se ramifie. Il construit ou réaménage les châteaux de Chambord, Fontainebleau, Amboise, Anet, ainsi que le Louvre. Il augmente sa puissance militaire : il paie les mercenaires suisses, « solde » les compagnies, les dote d'armes nouvelles (arquebuses, bombardes, couleuvrines, pistolets). Il se veut resplendissant – la Cour autour du roi compte plusieurs milliers de courtisans –, rayonnant : Bibliothèque royale, Typographie royale, Collège des lecteurs royaux, « noble et trilingue Académie » – latin, grec, hébreu –, futur Collège de France.
Et il a dès lors de plus en plus besoin d'argent.
Il faut, pour lever l'impôt, connaître le nombre des habitants.
Les curés sont chargés de tenir des registres des naissances et des baptêmes.
En 1523 est créé un Trésor de l'épargne. On emprunte aux villes. On multiplie les créations d'« offices » qui sont vendus afin d'augmenter les recettes.
On applique avec rigueur le concordat de 1516 :
« Le Roi nomme, dit l'ambassadeur de Venise, à 10 archevêchés, 82 évêchés, 527 abbayes, à une infinité de prieurés et canonicats. Ce droit de nomination lui procure une grandissime servitude et obéissance des prélats et laïques par le désir qu'ils ont des bénéfices. Et de cette façon il satisfait ses sujets, mais encore il se concilie une foule d'étrangers. »
Les sujets paient et reçoivent, mais le pouvoir absolu exige obéissance.
« En quelque chose que le Roi commande, il est obéi aussitôt comme l'homme l'est des bêtes ! » dit Maximilien d'Autriche.
Et ceux qui ne plient pas, ou ceux qui, dans le domaine financier, essentiel pour la monarchie absolue, fraudent, sont châtiés.
Le roi ne peut pardonner les malversations, même s'il en bénéficie un temps. À la fin, il condamne et s'approprie.
Ainsi le surintendant Jacques Beaume de Semblançay est-il pendu le 9 août 1527 au gibet de Montfaucon :
Frères humains qui après nous vivez
N'ayez les cœurs contre nous endurcis...
Mais l'« humaniste » François Ier ne transige pas à propos de son pouvoir.
« Il n'y a qu'un roi de France, dit-il, et garderais bien qu'il n'y aurait en France un Sénat comme à Venise... »
Pas de Parlement outrepassant ses fonctions judiciaires :
« Le roi vous défend que vous ne vous entremettiez en quelque façon que ce soit du fait de l'État ni d'autre chose que de la justice. »
Ainsi, dans cette première moitié du xvie siècle, on ne peut se contenter de regarder les tableaux inspirés de l'école italienne ou les châteaux. Il ne faut pas s'en tenir à cette Renaissance qui change le décor, les costumes et les mœurs.
On assiste en fait à l'affirmation d'une monarchie nouvelle, centralisatrice, unificatrice, autoritaire.
L'absolutisme encadre la nation, dicte ses ordonnances. En imposant la langue de l'État, le français, la monarchie entend régir l'âme de la France. Elle renforce la nation, même si sa rigidité tout comme le mécanisme de vente des offices nécessaire à son financement portent en eux, à long terme, des éléments de faiblesse.
Mais, vers 1550, c'est la force de la royauté française qui frappe.
Pour Machiavel, elle est un modèle. Nation la plus peuplée d'Europe, elle est efficacement gouvernée.
« Nul pays n'est aussi uni, aussi facile à manier que la France, écrit un ambassadeur vénitien en 1546. Voilà sa force, à mon sens : unité et obéissance. Les Français, qui se sentent peu faits pour se gouverner eux-mêmes, ont entièrement remis leur liberté et leur volonté aux mains de leur roi. Il lui suffit de dire : “Je veux telle ou telle somme, j'ordonne, je consens”, et l'exécution est aussi prompte que si c'était la nation entière qui eût décidé de son propre mouvement. »
Cette relation particulière entre un peuple et son souverain est la traduction politique d'un sentiment partagé entre celui-ci et les Français : le patriotisme.
Et les poètes, les écrivains – ils forment une Pléiade incomparable, de Clément Marot à Ronsard, de Rabelais à Du Bellay, de Montaigne à Desportes –, les juristes, l'expriment, chantent la patrie :
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux
Que des palais romains le front audacieux
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine
Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin
Plus mon petit Liré que le mont Palatin
Et plus que l'air marin la douceur angevine,
dit Du Bellay, évoquant son village natal et rêvant de « vivre entre ses parents le reste de son âge ».
Il ajoute en 1559 :
Laisse-moi donques là ces Latins et Grégeois
Qui ne servent de rien au poète françois
Et soit la seule cour ton Virgile et Homère
Puisqu'elle est, comme on dit, des bons esprits la mère.
Les auteurs anonymes de chansons populaires riment autour des mêmes thèmes.
Ils exaltent « le noble roi François », vainqueur à Marignan, et pleurent lors de sa détention à Madrid après le désastre de Pavie.
Mais, durant toute sa captivité – un an –, la fidélité au souverain n'est jamais remise en cause.
Alors que la régente – Louise de Savoie, mère du roi – est à Lyon, les Parisiens, craignant l'invasion, créent une assemblée représentative qui s'arroge certes des pouvoirs, mais qui s'affirme décidée à combattre l'ennemi « impérial ». Et il en est ainsi dans tout le royaume.
Ce « patriotisme » est une des spécificités françaises, et les femmes en sont souvent les porte-parole, comme si elles reprenaient le glaive de Jeanne d'Arc.
D'ailleurs, autour de François Ier et de Henri II, les femmes jouent un rôle décisif.
Louise de Savoie mène les négociations pour la libération de son fils. Sa sœur Marguerite, sa maîtresse Anne, duchesse d'Étampes, sont des actrices de la vie culturelle et favorisent la diffusion de l'humanisme.
Diane de Poitiers, maîtresse de Henri II, et naturellement son épouse Catherine de Médicis, fille de Laurent de Médicis, nièce de deux papes, mère de François II, puis de Charles IX (1560-1574) et de Henri III (1574-1589), d'une reine d'Espagne et d'une reine de Navarre, ont elles aussi un grand poids politique.
Ce rôle des femmes au sommet de l'État, dans le cœur du pouvoir absolutiste, que Jeanne d'Arc avait incarné au siècle précédent, se trouve ainsi confirmé au xvie siècle et devient l'un des traits majeurs de l'« âme de la France ».
Ce sentiment national, ce patriotisme, cet absolutisme, se renforcent mutuellement et accroissent le pouvoir du roi.
Ils vont être confrontés à la Réforme, c'est-à-dire à la possibilité, pour l'un des sujets du royaume, d'opter pour une autre religion que celle de son souverain.
Et, de surcroît, une foi souvent étrangère, hérétique (Luther a été excommunié par la diète de Worms en 1521).
Le risque d'une résurgence d'un « parti de l'étranger » est, au fur et à mesure que le siècle s'avance, de mieux en mieux perçu par ceux qui, « politiques », souhaitent préserver l'unité du royaume et donc organiser la « tolérance » pour les adeptes de la « religion prétendument réformée ».
Durant toute la première moitié du xvie siècle – jusqu'en 1560, date de la mort de François II –, la situation oscille.
Marguerite, sœur de François Ier, humaniste, influence le roi, favorable à ceux (Lefèvre d'Étaples, un érudit ; Briçonnet, évêque de Meaux), qui veulent, en bons lecteurs de la Bible – dont les exemplaires imprimés se répandent –, purifier l'Église.
Le 5 février 1517, François Ier a même chargé Guillaume Budé d'inviter Érasme à venir à Paris : « Je vous avertis que si vous voulez venir, vous serez le bienvenu », lui écrit le monarque.
La création du Collège trilingue (latin, grec, hébreu) des lecteurs royaux participe de cette ouverture humaniste tolérée et même souhaitée dès lors qu'elle ne touche que le monde intellectuel et ne met pas en cause le pouvoir politique.
Mais l'excommunication de Luther, la publication en français de L'Institution chrétienne de Calvin, le choix de l'« hérésie » par près de la moitié de la noblesse (les Condés, les Montmorencys, les Bourbons), inquiètent les souverains.
C'est leur pouvoir absolu que leur « tolérance » remet en cause.
Et l'Église catholique, dont ils sont en fait les maîtres politiques, est un rouage trop important de leur système absolutiste pour qu'ils acceptent de la voir attaquée ou simplement concurrencée.
Pour un roi de France – même prince de la Renaissance, même humaniste comme François Ier –, le fait que certains de ses sujets rompent avec le pape, refusent les sacrements, quittent donc l'Église catholique, la religion dont il est le « représentant » et qui le sacre, est inacceptable.
Dès lors, durant cette première moitié du xvie siècle, la persécution des huguenots va s'accentuer, sans provoquer encore de guerre civile.
Dès 1523, des hérétiques sont brûlés à Paris, place Maubert.
Il suffit qu'une statue de la Vierge ait été mutilée pour que d'autres soient torturés, condamnés au bûcher.
En 1529, un gentilhomme, Berquin, est ainsi exécuté.
En 1534, le roi s'indigne et s'inquiète qu'on ait osé placarder sur la porte de sa chambre, à Amboise, mais aussi au Louvre, des textes hostiles à la messe.
Cette « affaire des placards » le persuade que les huguenots sont des ennemis du pouvoir royal.
La persécution s'intensifie. On torture. On brûle. L'imprimeur Étienne Dolet est ainsi exécuté (1546), et le roi laisse le parlement d'Aix exterminer dans le Luberon 3 000 hérétiques « vaudois » dont les villages sont détruits.
La machine à massacrer est en marche.
Une « Chambre ardente » est créée dès 1551 auprès du parlement de Paris, et un inquisiteur dominicain y siège. Elle rendra en trois ans plus de 500 arrêts contre l'hérésie.
Un édit d'Écouen autorise en 1559 à abattre tout huguenot révolté ou en fuite. Et le conseiller Anne Du Bourg, qui s'oppose à cet édit, est étranglé et brûlé.
Mais cette persécution n'empêche pas, en 1555, Calvin, réfugié à Genève, d'organiser les églises réformées de France. En 1560, on en compte plus de 150, représentant deux millions de fidèles. Un synode national se réunit même à Paris.
Sur son lit de mort, Henri II a beau murmurer : « Que mon peuple persiste et demeure ferme en la foi en laquelle je meurs », des protestants chantent des psaumes sur l'autre rive de la Seine, en face du Louvre.
Ce défi à l'autorité royale, à l'absolutisme, à la règle fondatrice – « religion du roi, religion du royaume » –, constitue une lourde menace.
D'autant plus politique que des conjurés huguenots cherchent à s'emparer du roi en résidence à Amboise. Cette conjuration ourdie par des gentilshommes va échouer, et les nobles « catholiques » conduits par François de Guise exécuteront plus d'une centaine de conjurés, dont certains sont pendus aux balcons du château.
Est-ce le temps des massacres qui commence ?
La mort de François II permet à sa mère Catherine de Médicis de faire promulguer deux édits qui tentent d'éviter la guerre civile.
Le premier amnistie les conjurés d'Amboise.
Le second, distinguant l'hérésie de la rébellion, entrouvre ainsi la porte à la tolérance religieuse dès lors qu'elle ne se mue pas en force politique hostile au pouvoir royal.
Est-ce possible ?
Un imprimeur est encore brûlé vif pour écrits séditieux ; des huguenots sont massacrés à Lyon.
Comment établir une frontière nette entre critique de l'Église et opposition au roi qui en est le protecteur ?
D'ailleurs, les protestants recommencent à conspirer. Ils tentent de s'emparer de Lyon (septembre 1560). Alors la répression s'abat sur eux.
Devant les états généraux réunis à Orléans peu après la mort du roi François II – le 5 décembre 1560 –, le chancelier Michel de L'Hospital lance un appel à la tolérance qui est aussi l'expression d'un désir d'unité française, de sagesse politique et de tolérance.
On ne peut, dit-il, convaincre les huguenots qu'avec les « armes de la charité, les prières, persuasions, paroles de Dieu qui sont propres à tel combat. Le couteau vaut peu contre l'esprit. Ôtons ces mots diaboliques, luthériens, huguenots, papistes : ne changeons pas le nom de chrétien ! »
Cette voix est aussi celle d'une autre spécificité française.
Elle affirme qu'entre les camps opposés, entre les violences qui s'exacerbent l'une l'autre, il existe un choix « médian » récusant l'extermination d'un camp par l'autre, parce que la première victime en serait le royaume, la nation elle-même.
20.
La France de 1560 peut-elle entendre la voix de la sagesse et de la tolérance ?
Les passions religieuses qui se déchaînent nourrissent les ambitions, les haines, les ressentiments, les convictions, les croyances que la monarchie centralisatrice, autoritaire, marchant vers l'absolutisme, a jusque-là réussi à contenir, à refouler, à étouffer.
Et toutes les vieilles blessures se rouvrent au moment où le pouvoir se trouve affaibli.
En 1560, un enfant de dix ans est devenu Charles IX, roi de France. Il est maladif, dépressif, velléitaire.
Et c'est sa mère, Catherine de Médicis, « par la grâce de Dieu, reine de France, mère du Roy », qui exerce la régence, avec l'habileté, le sens de l'intrigue, l'absence de scrupules, le cynisme d'une fille des Médicis de Florence, élèves de Machiavel.
Elle n'a qu'un seul but : ne rien céder du pouvoir royal, celui de Charles IX, c'est-à-dire le pouvoir qu'elle détient, et peut-être demain celui de son fils préféré, Henri – sans compter qu'après lui reste encore un frère cadet, François.
Quant à sa fille Marguerite, elle la mariera le moment venu à l'un des grands, duc ou prince, et pourquoi pas au roi de Navarre, Henri de Bourbon ?
Elle se méfie de tout et de tous.
De ces Guises – François, le général ; Charles, l'archevêque de Reims – qui prétendent descendre en ligne directe de Charlemagne et qui incarnent un catholicisme intransigeant. Ils sont pénétrés de l'esprit du concile qui, réuni à Trente, après 1545, ne cède rien aux « réformés », mais élabore au contraire une Contre-Réforme, qui recrée l'Inquisition sous le nom de Congrégation de la Suprême Inquisition, qui s'appuie sur la Compagnie de Jésus – l'armée noire du pape – pour diriger les consciences des hommes et des femmes d'influence, et établit les listes des livres « diaboliques » à proscrire.
De ces autres grands, les Bourbon-Condé, qui soutiennent les huguenots.
Des Bourbon-Navarre, eux aussi tentés par la religion prétendument réformée.
Catherine de Médicis s'inquiète de voir ces protestants se doter d'une organisation militaire, exprimant, sous le couvert de la foi nouvelle, les volontés d'autonomie des grands seigneurs et des villes brisées par le pouvoir royal.
Cette situation religieuse, politique, sociale – la disette reparaît, les prix des denrées montent, la misère, qui semblait contenue, se répand à nouveau avec, ici et là, des poussées de peste noire –, est d'autant plus lourde de menaces que chaque camp regarde vers l'étranger.
Les catholiques vers l'Espagne, les huguenots, vers ces « Gueux » des Pays-Bas qui combattent l'Espagnol Philippe II et affirment leur religion et leur désir d'indépendance.
L'Allemagne s'émiette.
La religion du prince est celle de son peuple.
Il en ira ainsi en Angleterre, quand Élisabeth, après le schisme de Henri VIII, choisira en 1563 de créer l'Église anglicane, antipapiste, mais hiérarchisée à l'instar de l'Église catholique.
Dans cette nouvelle configuration des forces en Europe, la France hésite encore.
Étrange moment, révélateur du caractère complexe de l'histoire nationale et de l'âme de la France.
Autour d'elle, les peuples s'alignent. Les uns entrent au temple, les autres, dans l'Église romaine ou dans l'Église anglicane.
Les peuples obéissent à leur souverain : Cujus regio, ejus religio.
Mais la France, fille aînée de l'Église, hésite et débat.
Le patriotisme, le sentiment familial, sont déjà si forts que, durant deux années encore (1560-1562), Catherine de Médicis et ses conseillers tentent d'éviter la guerre civile.
Ronsard, « papiste », s'adresse au souverain :
Sire, ce n'est pas tout que d'être Roi de France
Il faut que la vertu honore votre enfance...
Et dans cette Institution pour l'adolescence du roi Charles IX (1561), il convoque l'histoire devenue référence, légende :
Du temps victorieux vous faisant immortel
Comme Charles le Grand ou bien Charles Martel...
L'invincible, l'indomptable Charles Martel...
La régente organise à Poissy, en septembre 1561, un colloque où des représentants de la religion catholique et de la religion réformée débattent, échangent avec vigueur des arguments en faveur de leur foi.
Dialogue de la dernière chance – mais significatif de la singularité française – où les plus radicaux des intervenants – Théodore de Bèze pour les huguenots, le général des jésuites Lainez – empêchent que la tolérance l'emporte.
Cependant, un édit – de Saint-Germain, le 17 janvier 1562 – reconnaît dans certaines conditions le droit pour les pasteurs de prêcher à l'extérieur des villes, qui leur demeureront closes.
C'est un pas vers l'apaisement, vers la reconnaissance de l'autre.
Mais les passions débordent, entraînent le peuple.
Des protestants saccagent des églises. Des catholiques, des temples. Les uns et les autres prennent les armes, s'affrontent déjà.
Et premier massacre à Vassy, non prémédité.
Il a suffi, le 1er mars 1562, à François de Guise et à ses hommes d'entendre chanter des psaumes dans la ville – en contradiction avec l'édit de Saint-Germain – pour qu'ils tuent des dizaines de huguenots. On massacre des « religionnaires » dans plusieurs villes. En guise de riposte, les protestants s'emparent d'autres cités.
La porte de la cruauté et de la guerre civile vient de s'ouvrir, et elle ne se refermera – jamais totalement – que trente-six années plus tard, en 1598, avec l'édit de Nantes, pacification précaire.
Cependant, comme si dès 1562 les Français pressentaient que le pire pour le royaume était encore à venir, s'exprime alors le désarroi, la souffrance devant ce malheur qu'est la guerre entre Français.
Réfugié à Bâle, un huguenot (Castellion) écrit dans son Traité des hérétiques : « Supportons-nous l'un l'autre et ne condamnons incontinent la foi de personne. »
Quant à Ronsard, dans la Continuation du Discours sur la misère de ce temps, il décrit :
L'extrême malheur dont notre France est pleine
...............................................................................
Comme une pauvre femme atteinte de la mort
Son sceptre qui pendait et sa robe semée
De fleurs de lis était en cent lieux entamée
Son poil était hideux, son œil hâve et profond
Et nulle majesté ne lui haussait le front.
Castellion, dans son Conseil à la France désolée, insiste sur le malheur absolu qu'est la guerre civile : « Ce ne sont pas les étrangers qui te guerroient comme bien autrefois a été fait lorsque par dehors tu étais affligée, pour le moins tu avais par dedans l'amour et accord de tes enfants quelque soulagement. Aujourd'hui, ce sont tes propres enfants qui te désolent et affligent. Tes villes et villages, voire les chemins et les champs, sont couverts de corps morts, tes rivières en rougissent et l'air en est puant et infect. Bref, en toi il n'y a ni paix ni repos, ni jour ni nuit, et on n'entend que plaintes, et hélas de toutes parts sans y pouvoir trouver lieu qui soit sûr et sans frayeur et meurtre, crainte et épouvantement. »
La France se déchire et les Français s'entretuent. L'âme de la France souffre.
Le patriotisme et la conscience nationale éplorés ne peuvent pourtant empêcher les affrontements de se succéder – quatre « guerres » de 1562 à 1574 –, ni les camps en présence de faire appel à leurs « coreligionnaires » des pays voisins.
Ainsi, en même temps que resurgissent, derrière les engagements religieux, les ambitions des grands féodaux, les colères sociales, on voit renaître le « parti de l'étranger ».
Les huguenots livrent Le Havre aux Anglais, en appellent aux reîtres et aux lansquenets allemands, cependant que les catholiques se tournent vers l'Espagne de Philippe II.
De même se profile le risque d'éclatement du royaume.
Des « républiques théocratiques », des places de sûreté « huguenotes », se constituent.
Les villes de La Rochelle, de Nantes, de Nîmes, de Bourges, de Montpellier, de Montauban, échappent à l'autorité royale, alors que Paris – et son parlement, dont la juridiction s'étend à une grande partie de la France, hors le sud du pays – est farouchement, fanatiquement catholique.
On voit ainsi s'organiser une sorte de république des Provinces-Unies du Midi dont les capitales sont Nîmes et Montauban et qui dispose d'un port, La Rochelle.
Mais l'attachement à l'unité nationale perdure.
Des édits (celui d'Amboise en 1563), qui sont autant le résultat du rapport des forces que la manifestation de l'espérance dans le retour à la paix civile, suscitent des trêves précaires.
Et le roi continue d'incarner la nation.
Profitant d'une longue suspension des combats, Catherine de Médicis tente de rassembler les adversaires autour de Charles IX.
Elle parcourt la France à ses côtés dans un long périple de vingt-sept mois (1564-1566). Les populations divisées, les villes huguenotes, l'accueillent, se retrouvent autour de lui, attestant qu'il est la clé de voûte du pays, que sa force symbolique est grande et que ses sujets veulent croire en la fin de leurs affrontements fratricides.
À dire vrai, chaque camp voudrait avoir à sa tête ce roi-emblème. Les huguenots essaient même de l'enlever, à Meaux, en 1567 ! Ils échouent.
Catherine de Médicis ne renonce pas.
Elle veut réaliser le projet de mariage entre sa fille Marguerite et Henri de Bourbon, roi de Navarre, union d'une catholique de sang royal et d'un hérétique. Ce faisant, la réconciliation est-elle possible ? L'unité du royaume va-t-elle se reconstituer ?
Charles IX a vingt ans en 1570. L'amiral de Coligny, la plus forte personnalité huguenote, est admis au Conseil du roi.
Lui aussi a le projet de reconstituer l'unité du royaume en concevant une grande politique étrangère « nationale ». La France prendrait la tête d'une large coalition protestante en s'alliant avec les « Gueux » des Pays-Bas et en menant à leurs côtés la guerre contre Philippe II, le Habsbourg, le roi de cette Espagne ennemie de la France.
On saisit ici combien, quand il s'agit de la France – de la grande puissance européenne –, sont toujours intriquées la politique intérieure et la politique extérieure.
La « géopolitique » commande cette liaison. C'est là une caractéristique permanente de l'histoire nationale.
Le mariage de Marguerite et de Henri de Navarre doit se célébrer en août 1572.
C'est un moment charnière. L'apparence est à l'unité retrouvée.
Les nobles huguenots entrent dans Paris pour participer aux fêtes nuptiales. Coligny est devenu le conseiller influent du roi.
Mais aucun camp n'a désarmé.
Catherine de Médicis a organisé le piège en même temps qu'elle œuvrait à la réconciliation. Les Guises n'ont pas renoncé. Une tentative d'assassinat de Coligny échoue. L'ordre est donné de massacrer les protestants pour noyer l'attentat contre Coligny dans un flot de sang.
C'est la Saint-Barthélemy, le dimanche 24 août 1572.
On poignarde. On noie. On égorge. On dépèce. On brûle. On pille.
Le peuple – femmes et enfants – arrache les membres des victimes, jette les nouveau-nés dans la Seine. On trouve des morceaux de chair dans toutes les rues de Paris. Crimes barbares et rituels.
Le peuple échappe à ses chefs.
Le massacre, à Paris, par la foule enivrée de passion, s'inscrit dans l'âme de la France, annonce d'autres massacres.
La Saint-Barthélemy devient un repère, une référence. En août-septembre 1792, on craindra – deux cent vingt ans plus tard, donc ! – une « Saint-Barthélemy des patriotes », et les massacres de Septembre rappelleront, par leur violence rituelle, leur barbarie, ceux d'août 1572.
Tout au long de notre histoire, dans nos « guerres de religion » – qui se nommeront alors guerres de classes –, on massacrera (1834, 1848, 1871, 1934, 1944).
Paris n'est pas une ville paisible, mais une capitale ensanglantée, l'épicentre des passions françaises.
Le massacre se propage et fait trembler toute la France.
On tue dans de nombreuses villes : à Meaux, Orléans, Bourges, Troyes, Rouen, Bordeaux, etc.
Les huguenots se vengent, une furie iconoclaste se répand. D'autres protestants quittent le pays.
Tuer ou être tué, combattre et se protéger dans les places de sûreté, se terrer, fuir : telles apparaissent à beaucoup les seules issues.
Le pouvoir royal ordonne les massacres ou ne les empêche pas. Dès lors, comment faire encore confiance à ce roi, hésitant, il est vrai, placé devant le fait accompli, mais finalement l'acceptant, le couvrant, le légitimant – qui a laissé égorger jusque dans les chambres du Louvre ?
Quant à Henri de Navarre, il n'a dû son salut qu'au fait qu'il a – comme Henri de Condé – promis d'abjurer (il le fera le 3 septembre 1572).
Ces massacres se poursuivent d'août à octobre 1572 et font entre 15 000 et 30 000 victimes.
Une procession royale, le 4 septembre, rend grâce pour la victoire de la Juste Foi. À Rome, le pape Grégoire XIII célèbre un Te Deum.
Le parti huguenot est décapité.
Le roi peut donc, dans une ordonnance, exiger que l'on arrête de tuer, d'attenter à la vie et aux biens de « ceux de la religion nouvelle ».
Mais comment le croire ?
Un protestant, Duplessis-Mornay, écrira : « L'État s'est crevassé et ébranlé depuis la journée de la Saint-Barthélemy, depuis que la foi du Prince envers le sujet et du sujet envers le Prince, qui est le seul ciment qui entretient les États en un, s'est si outrageusement démentie. »
Dans l'âme de la France plane désormais le soupçon que le pouvoir peut mentir, trahir, qu'il faut se méfier de lui.
Certes, cela n'efface pas le sentiment enraciné que le roi est, comme dit Duplessis-Mornay, « le seul ciment » de la nation.
Mais il faut, en face de lui, rester sur ses gardes, et donc le contrôler.
Et pourquoi ne pas élire le roi, affirmer la supériorité des états généraux sur le monarque, exiger de pouvoir le désavouer, le renvoyer et même le condamner ? Car le tyrannique ne peut devenir légitime.
Entre le roi et certains de ses sujets – les huguenots, en l'occurrence –, c'est l'ère du soupçon qui commence.
La Saint-Barthélemy fait naître de nouveaux adversaires de l'absolutisme, des ennemis des rois (les « monarchomaques », tels Théodore de Bèze et François Hotman).
Faut-il s'étonner que les protestants soient, trois siècles plus tard – les nations ont une longue mémoire –, parmi les plus ardents défenseurs du libéralisme politique, et qu'ils jouent un rôle majeur dans le mouvement et le gouvernement républicains ?
Ainsi, la Saint-Barthélemy, si elle a arrêté la progression de la religion prétendument réformée, a aggravé les tensions. Les blessures sont profondes.
Les « malcontents » sont nombreux même chez les catholiques, que les massacres ont effrayés.
Quand Charles IX meurt à Vincennes, le 30 mai 1574, à vingt-quatre ans, Catherine de Médicis exerce la régence, puisque son avant-dernier fils, Henri, a été élu roi de Pologne.
Henri III va succéder à Charles IX à la tête d'un royaume divisé vers lequel, quittant Cracovie, il se dirige à petite allure.
21.
Ce roi qui traverse l'Europe, qu'on fête à Vienne et qui s'attarde à Venise parce qu'il aime les plaisirs, a vingt-trois ans. C'est un Valois, fils de la Renaissance, beau, séducteur, brillant et lettré.
Il raffole du luxe, des parfums, des tissus.
Il est sensible aux charmes des jeunes femmes, et, assure-t-on, des jeunes gens qui l'entourent, ces mignons qu'il dote et qui forment une Cour joyeuse.
Pourtant, il n'ignore rien de la cruauté des temps.
Catholique, il peut – mais joue-t-il ? – manifester une piété exaltée, baroque.
Il n'a pas hésité à participer au massacre de la Saint-Barthélemy. La Contre-Réforme lui convient, même si, dans sa vie privée, rien ne le freine.
Il est le roi, c'est-à-dire qu'il n'a de comptes à rendre qu'à lui-même et à Dieu.
Il a le sens de ses devoirs politiques. Il doit gouverner ce royaume déchiré où le sang n'en finit pas de couler. Et où, il le sait, son pouvoir royal et sa personne sont mis en cause.
Il veut renforcer l'État. Et il est lui aussi pénétré de l'idée que l'autorité du roi est la condition de l'unité et de la paix.
Il est ainsi un continuateur de Louis XI et de François Ier, cherchant à accroître l'efficacité du gouvernement, transformant le Conseil du roi en un Conseil d'État qui se divise en Conseil des parties et en Conseil des finances.
Il gouverne avec l'aide de ces « gens de robe », nobliaux aux origines modestes mais que l'ambition et la volonté de s'enrichir transforment en grands serviteurs de l'État.
Ainsi – c'est là un trait français, une tendance longue et puissante de notre histoire –, le désir du renforcement de l'État ne disparaît pas, alors que les obstacles qu'il rencontre se multiplient, que les « monarchomaques » se nourrissent des haines religieuses pour justifier leur théorie d'un pouvoir royal contrôlé, limité.
Les ennemis du roi recrutent certes parmi les huguenots, soucieux de défendre leur « sûreté », mais aussi parmi les grands seigneurs, héritiers et nostalgiques des pouvoirs féodaux.
Les Guises sont des catholiques intransigeants – ultras et même fanatiques –, comme le roi, mais ils contestent son pouvoir. Les Bourbons sont huguenots, mais sont aussi des « féodaux », tel Condé, et l'un d'eux, Henri, est même roi de Navarre.
Celui-ci, qui peut croire à la sincérité de son abjuration, obtenue alors qu'on pressait la pointe d'une épée sur sa gorge durant la Saint-Barthélemy ?
Henri III doit aussi compter avec ce tiers parti des « malcontents », des « politiques », qui trouve en François de Valois, frère cadet du roi, un soutien considérable.
Ces oppositions suscitent contre le monarque et ses « mignons » – le duc de Joyeuse, le duc d'Épernon – des libelles, des pamphlets, une floraison de rumeurs et de reproches visant les mœurs dissolues, la prodigalité, les fêtes fastueuses du souverain.
Le pouvoir royal est devenu une cible.
On le vise de toutes parts pour des raisons différentes : religieuses, féodales, morales, vindicatives ou même sociales – la disette serre souvent le peuple à la gorge et l'épidémie relaie la faim.
Situation d'autant plus difficile pour le roi qu'il a besoin d'argent, qu'il demande aux états généraux de lui voter des subsides alors même qu'on le critique et le conteste.
Il suffit d'un événement – l'évasion de Paris, en 1575, de François, frère du roi, et de Henri de Navarre, tous deux retenus prisonniers – pour que la tension se mue en nouvelle guerre.
Relaps, hérétique à nouveau, Henri, roi de Navarre, va devenir le chef et le protecteur des Églises réformées de France.
Ainsi s'aggrave une crise politique et nationale complexe où se conjuguent des déterminants divers et contradictoires. Ce sera là un des traits permanents de notre histoire : le pouvoir central est toujours contraint de tenir compte de forces qui souvent s'équilibrent, s'opposent entre elles. L'unité nationale, qui est pourtant un désir permanent, demeure précaire. L'autorité de l'État – dont la puissance pourtant se renforce d'autant plus que les tendances à l'éclatement sont puissantes – ne cesse d'être remise en cause.
Quand le pouvoir ne peut être le fédérateur de toutes les forces, il doit s'allier à certaines d'entre elles, au risque de voir toutes les autres se liguer contre lui.
Henri III choisit ainsi en 1576 – après des batailles perdues – de négocier avec les huguenots et de leur concéder des avantages considérables (édit de Beaulieu, 7 mai 1576).
Quatre ans seulement après le massacre de la Saint-Barthélemy, le culte de la nouvelle religion peut être célébré partout sauf à Paris.
Les huguenots non seulement peuvent conserver huit places de sûreté, mais ils seront représentés à égalité avec les catholiques dans les parlements.
Et, décision lourde de symbole, les victimes de la Saint-Barthélemy sont réhabilitées.
On mesure, à cet édit, combien les préoccupations politiques l'emportent, chez le roi, sur les engagements religieux. C'est son pouvoir et l'unité du royaume autour de sa personne qui comptent au premier chef.
Mais, par l'étendue des concessions consenties aux huguenots, il affaiblit sa position face aux catholiques.
Des ligues se constituent, fédérées par Henri de Guise. Et lorsque les états généraux se réunissent à Blois (1576), une majorité de parlementaires obligent Henri III à renoncer à l'édit de Beaulieu et lui refusent les subsides qu'il réclame.
Pis : la tentation est grande, chez nombre d'entre eux, de contester son pouvoir, même si la majorité craint l'éclatement du royaume.
En France, la conscience nationale est déjà persuadée qu'il n'est pire malheur que la rupture de l'unité du royaume.
C'est ce qu'exprime, dans ses Six livres de la République, Jean Bodin, quand il développe l'idée de la nécessité d'un pouvoir fort, au-dessus des factions, assurant l'unité nationale, et, en politique extérieure, l'indépendance.
Le pouvoir central – royal – était alors seul capable d'assurer ces deux conditions de la paix civile. Et la tolérance entre religions antagonistes sera possible à condition précisément que le pouvoir soit fort.
L'idée d'un pouvoir arbitre – et, à terme, laïque – commence ainsi à sourdre.
Et, contradictoirement, les partisans d'un pouvoir limité sont aussi les adversaires de la tolérance.
Voilà encore une spécificité française qui s'esquisse.
La logique de l'affrontement est encore la plus forte. Même si, durant quelques années, la guerre cède la place à des trêves, à des paix provisoires, à des édits de conciliation qui permettent, en 1578-1579, à Catherine de Médicis de visiter, en compagnie de Henri de Navarre, les provinces huguenotes dans l'espoir d'en obtenir des subsides – l'argent, ressort indispensable du pouvoir –, la situation est par trop dégradée pour qu'une paix véritable soit possible.
Disettes, tremblements de terre, inondations, épidémies et poussées de peste noire ravagent le royaume : on dénombrerait 50 000 victimes de l'épidémie rien qu'à Paris ! Et, dans les territoires qu'ils contrôlent, les Guises et Henri de Navarre se préparent à une nouvelle guerre.
Quand on apprend que le frère du roi, François, est mort, le 10 juin 1584, et que, Henri III n'ayant point de fils, c'est Henri de Navarre, chef des Églises réformées, qui est le seul héritier légitime de la couronne, les hostilités paraissent inéluctables. Les catholiques ne peuvent accepter d'avoir pour souverain un hérétique et un relaps.
C'est un nouvel abîme qui s'ouvre, où le royaume risque fort de basculer et d'être enseveli.
Une fois de plus s'opère la conjonction entre situation intérieure et politique extérieure.
Les Guises concluent un accord avec l'Espagne. C'est un grand projet politique contraire à celui qu'avait tenté de mettre sur pied Coligny en 1572. Il s'agit, avec l'appui de Philippe II (qui verse des subsides), d'extirper l'hérésie, de s'allier avec le Habsbourg pour faire la guerre aux « Gueux » des Pays-Bas et y assurer ainsi la domination de l'Espagne.
Naturellement, ce « parti de l'étranger » espère s'emparer en France du pouvoir royal.
Les Guises prétendent descendre de Charlemagne : ne valent-ils pas mieux qu'un roi de Navarre hérétique ? Ils peuvent compter sur la Sainte Ligue, qui a pris le contrôle de Paris.
On voit se développer en effet dans la capitale (à partir de 1576, et surtout de 1585) un vrai parti politique qui associe un catholicisme intransigeant à des aspirations et à des structures démocratiques.
Les « militants » – plusieurs milliers – sont encadrés par des « moines » ligueurs ; ils élisent des responsables de quartier. Un conseil des Seize les représente.
Cette conjonction d'une idéologie radicale et de la volonté populaire d'exercer directement le pouvoir annonce elle aussi une des lignes de force de l'histoire nationale.
La « propagande » condamne le « tyran » et ses mœurs. Elle appelle au tyrannicide.
Il n'a servi de rien à Henri III de se rallier aux positions des catholiques intransigeants (au traité de Nemours, en 1585), de ne laisser aux huguenots que le choix entre l'abjuration et l'exil, et d'interdire partout le culte protestant. On le soupçonne : n'est-il pas celui qui a, neuf ans auparavant, accordé aux mêmes hérétiques, par l'édit de Beaulieu, la possibilité pour leurs pasteurs de prêcher partout en France sauf à Paris ?
Or c'est Paris qui est le foyer le plus vif de l'intransigeance catholique. Là règne la Sainte Ligue, véritable mouvement populaire qui échappe en partie au contrôle des Guises, même si le peuple de la cité les suit.
Avantage considérable dans l'affrontement entre catholiques et huguenots, car chaque camp comprend que celui qui tient Paris peut l'emporter dans le reste du royaume. Condition nécessaire, en tout cas, même si elle n'est pas suffisante.
C'est également une donnée majeure de l'histoire nationale, et elle surgit avec force, en cette fin de xvie siècle, pour ne plus jamais s'effacer.
Mais Paris est d'autant plus difficile à maîtriser par le pouvoir que, peu à peu, la population parisienne, consciente de la symbolique de la ville (qu'on se souvienne de Clovis et de sainte Geneviève, de Philippe Auguste et d'Étienne Marcel), est toujours prête à manifester son indépendance. Elle est nombreuse, et le pouvoir s'en méfie. Le roi n'aime plus résider à Paris : Henri III lui préfère Blois.
Quand il envoie des troupes dans la capitale, même s'il affiche désormais un catholicisme aussi radical que celui de la Ligue, la ville se couvre de barricades (12 mai 1588).
Le peuple de Paris, ligueur, craint une Saint-Barthélemy des catholiques, et vient d'inventer ainsi son mode spécifique de protestation. Celui-ci se transmettra d'un siècle à l'autre, comme si les barricades devenaient un symbole et le mode d'expression de Paris, donc aussi de la France.
Quel choix politique peut faire Henri III ?
Les Guises ont ouvert la porte à l'Espagnol. Ils visent non seulement à affaiblir le pouvoir royal, mais à s'emparer du trône. Ce serait la fin de l'unité du royaume, de sa souveraineté – Philippe II subventionne les ligueurs et leur envoie des troupes –, de son indépendance. Le roi se rebelle. Le pouvoir monarchique, le sens de l'État, sont plus forts que l'appartenance religieuse.
Le 25 décembre 1588, Henri III organise à Blois l'assassinat des Guises – « À présent, je suis roi ! » s'écriera-t-il – et confirme que Henri de Navarre, l'hérétique, sera son héritier.
Pour les ligueurs, le souverain n'est plus qu'un « tyran Sardanapale » contre qui le tyrannicide est légitime.
Le 1er août 1589, le moine Jacques Clément éventrera d'un coup de poignard Henri III, qui, dans son agonie, confirmera son choix dynastique.
Henri de Navarre deviendra donc Henri IV, mais le monarque mourant lui demande de se convertir.
La France n'en a pas fini avec la guerre. Henri IV va devoir conquérir et son royaume et Paris.
Et le poète Agrippa d'Aubigné, qui, enfant de huit ans en 1560, fut témoin, à Amboise, des premiers massacres de huguenots, qui a combattu, a été blessé dans les rangs protestants, qui est devenu en 1573 l'écuyer de Henri de Navarre et est en 1589 encore à ses côtés, décrit l'état du royaume avec la compassion et la révolte désespérée d'un « patriote » :
Je veux peindre la France une mère affligée
Qui est, entre ses bras, de deux enfants chargée.
Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts
Des tétins nourriciers ; puis, à force de coups
D'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage
Dont Nature donnait à son besson l'usage.
.........................................................................
Elle dit : « Vous avez, félons, ensanglanté
Le sein qui vous nourrit et qui vous a portés,
Or vivez de venin, sanglante géniture,
Je n'ai plus que du sang pour votre nourriture !
Cette souffrance française devant la tragédie nationale fait la force de ceux qui veulent rétablir l'unité, la souveraineté et la paix dans le royaume.
Le « parti de l'étranger » et de la division devrait, pour l'emporter, guérir l'âme blessée de la France, or il exacerbe sa douleur.
2
LA MESSE DU ROI ET DES CARDINAUX
1589-1661
22.
Comment Henri IV, hérétique et relaps, qu'un souverain a choisi pour lui succéder après avoir été frappé par le poignard d'un moine fanatique, peut-il rassembler autour de lui son royaume déchiré par les haines religieuses ?
À peine un sixième de la France l'a reconnu.
La capitale est entre les mains de la Sainte Union des ligueurs, soumise aux Guises. Les Parisiens suivent les processions des prêtres, des moines, qui, brandissant crucifix et portraits de la Vierge, exaltent le tyrannicide et la vraie foi. Le pape les soutient. L'Espagne de Philippe II finance les Guises, envoie ses soldats pour renforcer les rangs des ligueurs, et rêve de voir monter sur le trône de France Isabelle, l'infante, la petite-fille de Henri II, et de soumettre ainsi la France aux Habsbourg.
Et c'est cependant Henri IV qui va l'emporter.
Il lui faut d'abord conquérir son royaume comme s'il s'agissait d'une terre étrangère, et, pour cela, faire appel à l'aide des soldats d'Élisabeth Ire, ces anglicans, adversaires des papistes.
Il a besoin d'argent.
Il se dirige donc vers la Normandie, la grasse province qui verse le plus d'impôts et dont les ports nombreux peuvent accueillir les navires anglais.
Le 21 septembre 1589, il remporte la victoire à Arques – près de Dieppe – contre les troupes de Guise, du duc de Mayenne, et il est à nouveau vainqueur des ligueurs et des Espagnols à Ivry (le 14 mars 1590).
Il a lancé : « Ralliez-vous à mon panache blanc ! »
Cela vaut certes pour une bataille, mais le royaume ne se soulève pas en sa faveur, même si les provinces et les parlements de Rennes et de Bordeaux se rallient à lui.
Cela ne représente encore jamais que la moitié du royaume. Et s'il réussit à s'emparer de Chartres, il a échoué devant Rouen, et n'a pu longtemps faire le siège de Paris.
La France est divisée. Les moines casqués, les ligueurs, les milices, tiennent la capitale. Et ce roi qui aspire à gouverner la France commence par faire mourir de faim les Parisiens en les enfermant dans un blocus impitoyable : on fabrique du pain en broyant les os des squelettes arrachés au cimetière des Innocents ! On dénombrera près de cinquante mille victimes de la disette, de la maladie et des combats.
Ce sont les troupes espagnoles d'Alexandre Farnèse qui viennent desserrer le siège et prennent garnison dans Paris.
Telle est la France : quand elle n'est pas unie, elle s'entre-dévore, elle en appelle à l'étranger.
Les passions s'y exacerbent, mais, en même temps, dans chacun des camps, des « politiques », des « réalistes », commencent à penser qu'il faut trouver des solutions de compromis.
Et ces « raisonnables » se séparent peu à peu d'avec les plus « zélés » de leurs compagnons. La France apparaît aux « politiques » si divisée que, sous peine de la voir éclater, disparaître, il leur faut trouver des solutions qui ne satisfont pas les « zélés », mais expriment l'équilibre des forces.
Les passions françaises conduisent ainsi paradoxalement à l'« arrangement » qui permet la reconstitution de l'unité nationale. Mais cette « sagesse » ne l'emporte qu'après que l'on a éprouvé l'impossibilité et souffert des cruautés des solutions extrêmes.
C'est à Paris que tout se joue et que se confirme le rôle décisif, central, de la capitale, et qu'ainsi s'accuse un trait majeur de l'histoire française.
Là s'esquisse parmi les ligueurs des revendications politiques extrêmes. Les « catholiques zélés » veulent un roi contrôlé par les états généraux. Le conseil des Seize de la Ligue et un comité secret des Dix dressent des listes de proscription de personnalités à « épurer ».
On perquisitionne. On menace.
Le « papier rouge » énumère les noms de ceux qui doivent être « pendus, dagués, chassés ». Les lettres P, D, C, indiquent le châtiment prévu.
Et trois magistrats, dont le président Brisson, soupçonnés d'être des « politiques », c'est-à-dire des « modérés » indulgents envers l'hérésie, donc des traîtres, sont pendus et leurs cadavres exposés en place de Grève.
Un climat de terreur s'installe ainsi dans Paris.
Les « zélés » développent dans un même mouvement une conviction religieuse radicale – contre les huguenots – et une idéologie égalitaire.
Ils contestent la transmission héréditaire des titres nobiliaires.
Ils s'en prennent à ceux qui, en pleine disette – due au blocus de Paris par les armées de Henri IV –, ont leurs plats « pleins de grasse soupe ».
Ces revendications inquiètent les gentilshommes, le duc de Mayenne et les bourgeois aisés.
Des divisions se font jour parmi les ligueurs. Le roi, redécouvre-t-on, est le garant de l'ordre, et les « zélés » répandent au contraire des ferments de désordre, voire de révolution.
On aspire à la paix, à l'unité du royaume autour du souverain. Et le patriotisme vient s'ajouter à ces motivations sociales. On se veut « vrai Français ». On rejette et on craint la présence et la politique des Espagnols.
On craint l'éclatement du pays. On s'inquiète de ces villes « qui veulent un conseil à part, comme si chacune d'elles eût voulu se former sur le modèle et le plan d'une république ». La France ne risque-t-elle pas de devenir « une Italie, et les villes changées en Sienne, Lucques et Florence, ne ressentant plus rien de leur ancien gouvernement et du bel ordre de l'illustre monarchie » ?
Ainsi le « bloc » catholique se fissure-t-il.
La passion religieuse et les revendications républicaines et égalitaires qu'elle charrie, la « terreur » qu'elle commence à répandre, rencontrent les réticences, l'opposition des « politiques », des « nobles », des « bourgeois », des patriotes attachés au modèle monarchique français.
Et le duc de Mayenne, les Guises, les chefs traditionnels de la Ligue, préfèrent en définitive choisir l'ordre.
Les plus zélés des ligueurs sont arrêtés.
Les responsables des exécutions du président Brisson et des deux autres magistrats sont pendus.
En décembre 1589, le duc de Mayenne vide de ses pouvoirs le conseil des Seize et les concentre dans ses mains.
Le « dérapage » de la Sainte Union vers des solutions extrêmes est arrêté.
En France, les poussées « révolutionnaires » sont rapidement enrayées par l'attachement à l'unité du royaume – à celle de la nation – et à l'ordre social.
Le « moment » de l'extrémisme laisse des cicatrices, développe des conséquences politiques, mais, à la fin, c'est le compromis qui s'impose.
La violence est présente dans l'histoire nationale, mais cette tempête est de brève durée et un équilibre national finit par se reconstituer, recimentant la nation et restaurant la cohésion du corps social.
L'intelligence de Henri IV est de l'avoir compris.
Il mesure qu'il ne peut conquérir son royaume par le seul usage de la force.
Il n'a pas pu entrer dans Paris. Les ligueurs ne sont pas vaincus. Il doit, s'il veut régner et être reconnu comme souverain, incarner l'unité du royaume, faire une concession majeure, abjurer sa foi huguenote afin d'exprimer, par ce choix, qu'il s'inscrit dans la tradition nationale, et donc sacrifier sur l'autel de l'unité sa foi protestante.
Le 25 juillet 1593, en la basilique de Saint-Denis, il abjure, entend la messe et communie.
Le 27 février 1594, il est sacré à Chartres, puisque Reims est encore aux mains des ligueurs.
À Pâques, il touchera les écrouelles. Il entrera dans Paris le 22 mars 1594, entendra un Te Deum à Notre-Dame avant de faire son entrée solennelle dans la capitale le 15 septembre.
Les politiques, les patriotes, tous ceux qui sont soucieux d'ordre social et qui veulent « recoudre » le tissu national, sont satisfaits.
Les villes se rallient à Henri IV.
Les garnisons espagnoles quittent le pays.
Les états généraux, qui voulaient contrôler le roi, sont discrédités.
Les Jésuites, accusés de prôner le tyrannicide, sont expulsés en 1594, et le pape, dans une cérémonie d'expiation à Rome, reconnaît l'abjuration de Henri IV et son retour au sein de la Sainte Église catholique.
Les Français, écrivent les partisans du roi dans des textes de propagande, ont refusé d'avaler le « catholicon d'Espagne », cette drogue étrangère qu'on voulait leur faire boire.
« Notre roi est maintenant catholique, il va à la messe, il faut le reconnaître et il ne faut plus que l'on nous trompe. »
Mais la souveraineté de Henri IV ne sera définitivement établie qu'après qu'il aura brisé les résistances armées des Guises en Bretagne (le duc de Mercœur) et en Bourgogne (le duc de Mayenne).
En fait, ces victoires militaires ne sont que de façade. Henri IV achète les ralliements. Le Trésor royal déboursera à cette fin 32 millions de livres.
L'unité du royaume se paie cher. C'est dire que si la raison l'emporte, si les « politiques » ont triomphé, en fait les divisions demeurent. On choisit l'équilibre, non l'adhésion enthousiaste.
Et il faut encore, pour empêcher les cicatrices de se rouvrir, en finir avec l'action de l'étranger.
Henri IV déclare la guerre à l'Espagne en sorte que l'unité nationale s'affirme aussi dans le combat contre les Habsbourg. Il est victorieux des Espagnols à Fontaine-Française, sur les bords de la Saône.
Mais les Espagnols assiègent Amiens, et la paix ne sera conclue que le 2 mai 1598, à Vervins.
Henri IV a pu signer à Nantes un traité avec les huguenots (30 avril 1598).
Moment important dans la construction de l'âme de la France. En refusant d'envoyer des renforts alors que les Espagnols assiégeaient Amiens, les huguenots ont montré leur détermination, leur amertume, leurs réticences face à ce roi qui a abjuré leur foi, même si de nombreux pasteurs ont fait le même choix que lui. L'édit de Nantes – ville ligueuse ! – leur accorde la liberté de conscience, l'égalité des droits, la liberté de culte, et des articles secrets leur assurent d'une part le versement par le roi de 45 000 écus par an – les pasteurs en exercice seront payés –, d'autre part le contrôle de 150 villes qui seront des « refuges de sûreté » possédant une garnison dont le souverain sera le gouverneur et dont il paiera l'entretien.
Les huguenots constituent ainsi un État dans l'État.
C'est dire que l'édit de Nantes n'est qu'un traité de compromis, de paix civile. Il marque cependant la difficile naissance, à l'avenir incertain, d'une exception française : l'acceptation de la coexistence, en un seul royaume, de deux religions ; et donc, en germe, la séparation de la religion et de l'État.
Quelles que soient les arrière-pensées des uns et des autres, les soupçons, les regrets des catholiques devant l'hérésie qui, loin d'être « extirpée », est ainsi reconnue, et les amertumes inquiètes des protestants face à ce monarque qui les a reniés, un sillon commence à être tracé.
Il n'est pas encore profond.
On pense toujours qu'un royaume n'est réellement uni que si tous les sujets du roi partagent avec lui la même foi, qui ne saurait être que catholique.
Mais l'amorce de ce sillon existe, et une graine fragile y a été semée.
23.
À peine douze années séparent la signature de l'édit de Nantes, le 30 avril 1598, et ce 14 mai 1610, quand, à Paris, dans l'étroite rue de la Ferronnerie, vers six heures de l'après-midi, François Ravaillac – « la barbe rousse et les cheveux tant soit peu dorés » – profite d'un arrêt du carrosse royal pour tuer de deux coups de poignard Henri IV, que les poètes de la Cour avaient comparé à Mars, à Hercule, à Charlemagne, et qu'ils avaient surnommé Henri le Grand.
Même si Ravaillac n'a été le bras armé d'aucune conspiration, cet acte criminel révèle le rapport complexe que les Français entretiennent désormais avec leur roi.
Depuis le début des guerres de Religion, des moines, des prédicateurs – curés ou pasteurs –, ont légitimé le tyrannicide. Il faut châtier l'hérétique ou le huguenot qui a abjuré, et Henri III a succombé aux poignards. La personne du roi est certes « sacrée ». Y attenter est donc « sacrilège ». Mais, en même temps, elle peut être « sacrifiée » afin d'expier ses fautes. Et le régicide est célébré comme un martyr : le moine Jacques Clément, assassin de Henri III, a été sanctifié par les moines ligueurs.
Il y a ainsi un double mouvement contradictoire autour de la personne du roi.
Celui-ci renforce ses pouvoirs, et jamais souverain n'a été plus encensé que ne l'est Henri IV, mais l'idée s'est peu à peu répandue qu'on pouvait le punir de mort – ce qui est fait. Ou le désigner, le renvoyer, cela qui a été réclamé par les états généraux, même si cette éventualité n'est jamais devenue réalité. Cependant, l'hypothèse demeure dans les grimoires et les mémoires.
Et personne ne l'oublie.
Ainsi, lorsque Henri IV s'emploie à affirmer et élargir son autorité, les parlements résistent et il doit faire plier chacun d'eux afin qu'il enregistre l'édit de Nantes.
C'est dire que les parlementaires – comme la majorité de la population – n'admettent pas que des sujets du roi pratiquent une religion différente de celle de leur souverain, et que cette communauté ait obtenu des garanties – juridiques et même militaires – particulières à ce sujet.
Ces réticences révèlent que les guerres de Religion marquent le début d'une ère du soupçon entre le monarque et son peuple.
Certes, Henri IV s'impose avec habileté et détermination.
Il dit aux parlementaires : « Je couperai la racine à toute faction et à toute prédication séditieuses. »
Il sait bien que les universités et les assemblées du clergé condamnent l'édit de Nantes. Lorsqu'elles invoquent la papauté, il les admoneste :
« Être bien avec le pape ? J'y suis mieux que vous ; je vous ferai tous déclarer hérétiques pour ne me pas obéir ! »
Et, habilement, il accepte le retour des Jésuites dans le royaume, et choisit pour confesseur le père Coton, membre de la Compagnie.
Cette concession ne le conduit pas pour autant à admettre l'application des décrets du concile de Trente. La France « gallicane » ne s'ouvrira que difficilement à la Contre-Réforme, et s'affirme ainsi une particularité française : le royaume est catholique, mais proclame son indépendance à l'égard de la théologie – et de la politique – vaticanes.
Henri IV répète qu'« un roi n'est responsable qu'à Dieu et à sa conscience ».
Il faut que les décisions et les actes du monarque confirment cette souveraineté qui ne se reconnaît que des limites divines et personnelles.
Dès lors, la glorification de la personne du souverain et de sa politique est essentielle.
Les poètes officiels – François de Malherbe –, les sculpteurs, les architectes, les peintres, s'emploient à exprimer, à illustrer, à construire la « représentation » du roi :
La rigueur de ses lois, après tant de licence,
Redonnera le cœur à la faible innocence,
écrit Malherbe dans sa Prière pour le Roi Henri le Grand.
La terreur de son nom rendra nos villes fortes,
.........................................................................
Et le peuple qui tremble aux frayeurs de la guerre,
Si ce n'est pour danser n'orra plus de tambours.
.........................................................................
Tu nous rendras alors nos douces destinées :
Nous ne reverrons plus ces fâcheuses années
Qui pour les plus heureux n'ont produit que des pleurs :
Toute sorte de biens comblera nos familles,
La moisson de nos champs lassera les faucilles
Et les fruits passeront la promesse des fleurs.
Cette mise en scène des actions du roi – la « poule au pot » ! – constitue, par son ampleur, une novation, et souligne cette exaltation du pouvoir royal qui caractérisera la monarchie française. Celle-ci est « sacrée ». Elle œuvre pour le bien du royaume.
Manière de contenir le « soupçon » qui la menace, et de justifier la répression qui frappe ceux qui se rebellent : les grands et leurs clientèles.
Le maréchal de Biron, qui a conspiré avec le duc de Savoie, sera décapité en 1602.
Les duels sont interdits, la haute aristocratie est surveillée, et certains de ses membres sont emprisonnés ou contraints à la fuite (Condé et sa jeune femme, poursuivie par les assiduités du monarque, se réfugieront dans les Pays-Bas espagnols).
Le gouvernement est resserré, quelques dynasties ministérielles – les Pomponne, les Jeannin, les Villeroy – s'affirment, tandis qu'une politique cohérente, centralisée, interventionniste dans l'économie et la finance, se met en place. Des hommes comme Sully et Barthélemy de Laffemas élaborent un « modèle français ».
Un Olivier de Serres publie le Théâtre d'agriculture et ménage des champs. De grands travaux – routes, drainage des marais poitevins, canal de Briare, construction d'arsenaux et de galères – sont lancés.
Les châteaux – Chambord, Fontainebleau, Saint-Germain –, l'aménagement de Paris – le Louvre, le Pont-Neuf, les places Royale et Dauphine – matérialisent cette politique.
Paris, un temps délaissée par les Valois, qui lui avaient préféré les bords de Loire, redevient le centre d'un royaume repris en main : une capitale, « miracle du monde ».
Ce « modèle français » est soutenu par une démographie vigoureuse. En l'espace de ces quelques années, le royaume de France redevient le plus puissant, le plus peuplé, le plus riche des royaumes de la chrétienté.
C'est une « seconde Renaissance » qui se déploie malgré la hausse des prix, la ruine de nombreux petits propriétaires paysans étranglés par le renchérissement des fermages, le poids de l'usure.
Sully et Barthélemy de Laffemas réussissent à stabiliser le cours de la monnaie, à reconstituer un trésor royal, et l'activité économique dans les manufactures (tapisseries, soieries, métallurgie, constructions navales) anime un « mercantilisme » : il faut « exporter » et non importer.
Mais – c'est un autre trait de l'âme de la France – l'État centralisé joue là le rôle majeur. C'est lui qui crée, incite, oriente, contrôle.
C'est autour de lui que tout s'organise. Dès lors, la question de ses finances est capitale.
Il faut trouver de l'argent.
On a abaissé la taille, mais on augmente la gabelle. Et la misère paysanne perdure. Le besoin d'argent comme l'attrait qu'exerce le pouvoir expliquent la création de l'« impôt » de la paulette (du nom du financier Paulet), qui va orienter l'évolution de la société française et peser sur l'avenir de la monarchie.
Il s'agit de faire payer chaque année une taxe aux titulaires d'offices, qui leur assurera l'hérédité des charges qu'ils ont acquises.
La vénalité des offices – moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses – est ainsi associée à l'hérédité de ces offices. Est ainsi créée une bourgeoisie d'officiers, une noblesse de robe liée au pouvoir monarchique et donc le soutenant, mais devenant une « caste » proliférante, un véritable « quart état » constitué d'officiers héréditaires.
Ils renforcent l'absolutisme et le pouvoir de la monarchie. Ils en dépendent. Ils en sont donc solidaires, mais, d'une certaine manière, ils l'emprisonnent. Ils ossifient le pouvoir et la société. Et, au lieu d'investir dans les activités économiques, dans la production ou le commerce, ils gèrent leur bien prestigieux : leur charge héréditaire.
Le pouvoir royal mesure à la fois l'intérêt de cette « noblesse de robe » qui l'alimente, et la difficulté qu'il éprouve à se servir d'elle.
L'État multiplie alors les « commissaires », les « intendants », qui sont ses agents zélés et obéissants.
Ainsi se dessine au début du xviie siècle le pouvoir français : un centre lié à cette noblesse de robe et agissant par l'intermédiaire d'agents à son service, exécutants efficaces et dévoués.
Cette armature, si elle maintient le pays rassemblé autour du pouvoir central, si elle fait du royaume de France, dès les années 1600, le plus structuré des États d'Europe, si elle favorise le rôle de l'État, risque de faire perdre à la société sa souplesse, sa capacité d'initiative.
Elle peut conduire de ce fait, en cas de conflit, à une remise en cause du pouvoir central, à qui chacun est lié et dont tout dépend.
On le mesure au printemps de 1610 quand Henri IV décide d'entrer en guerre contre l'Espagne, manière d'affaiblir l'empereur du Saint Empire romain germanique, qui, par le jeu de la succession ouverte en deux duchés – Clèves et Juliers –, peut se retrouver sur les bords du Rhin. Or le Habsbourg allié de l'Espagne est l'ennemi.
Henri a rassemblé une armée de 100 000 hommes. Il est d'autant plus impatient d'intervenir aux Pays-Bas espagnols que Condé et son épouse s'y sont réfugiés. Et que Henri IV, le « Vert-Galant », entend bien conquérir la jeune femme.
Mais ce n'est là qu'un aspect anecdotique, significatif du rôle des femmes et des passions qu'elles suscitent dans le fonctionnement de la monarchie française. Elle ne doit pas masquer le grand projet de politique extérieure du roi : s'allier aux princes luthériens, aux Hollandais calvinistes, pour mieux s'opposer aux Espagnols catholiques.
Henri IV a veillé à faire couronner, le 13 mai 1610, la reine Marie de Médicis, qui assurera ainsi, tandis qu'il sera en campagne, la présidence du conseil de régence.
Mais cette entreprise ambitieuse, qui vise à faire de la France l'arbitre de l'Europe en réduisant l'influence des Espagnols et des Habsbourg d'Empire, a des conséquences dans le royaume même : elle ravive les soupçons envers ce roi qui fut huguenot, relaps avant d'abjurer.
Tout ceux qui ont condamné l'édit de Nantes s'inquiètent de voir ce souverain faire peut-être le jeu des hérétiques.
Et François Ravaillac, posant le pied sur l'un des rayons de la roue du carrosse royal, rue de la Ferronnerie, poignarde le souverain, le 14 mai vers six heures de l'après-midi.
Ravaillac sera soumis à la question. Les jambes brisées, le corps tailladé, il sera écartelé en place de Grève et le peuple brûlera ses restes.
Le cœur de Henri IV, enchâssé dans un reliquaire, est déposé au collège jésuite de La Flèche, son corps embaumé repose à Saint-Denis.
Le roi est mort, vive le roi !
C'est Louis XIII, un enfant de neuf ans.
Marie de Médicis assurera la régence du royaume.
24.
Qui tue le roi blesse le royaume.
Et ce d'autant plus qu'au souverain assassiné succède un enfant, symbole de la faiblesse, incapable de tenir les rênes.
Or la nation française est couturée de cicatrices mal refermées, d'ambitions refoulées, de haines, d'amertumes et de regrets.
Il y a les grands – le prince de Condé, le duc de Longueville, les ducs de Guise et de Bouillon – et, derrière eux, leurs clientèles, toute cette noblesse d'épée que Henri IV a humiliée, vaincue, et qui rêve à nouveau, comme aux pires moments des guerres civiles, de se partager le royaume, de dominer le sommet de l'État.
La scène centrale n'est occupée que par une régente, la reine Marie de Médicis, entourée de ce couple que l'on présente comme des aigrefins, des pilleurs de trésors : Concino Concini et sa « sorcière » de compagne, Leonora Galigaï.
Les libelles contre eux se multiplient. Les grands s'impatientent, rejoints par la noblesse de robe, parlementaires, officiers propriétaires de leurs charges qu'ils peuvent désormais léguer.
Marie de Médicis, croyant renforcer son pouvoir, s'est présentée devant le parlement de Paris pour se faire confirmer par l'assemblée qu'elle était bien la régente « des affaires du royaume pendant le bas âge dudit seigneur son fils ».
Elle semble ainsi avouer sa faiblesse, ce besoin de reconnaissance, alors que Henri IV avait veillé à ce qu'elle fût sacrée régente.
Or, quand en France la clé de voûte du pouvoir s'affaiblit, ne peut tenir toute sa place, c'est l'édifice entier qui se fissure.
Les factions animées par les grands se reconstituent. Les protestants, autour du duc de Rohan, créent des assemblées permanentes afin d'être prêts à réagir à toute remise en cause de l'édit de Nantes. Ils renforcent leur organisation militaire et politique. Ils craignent qu'un changement d'orientation du pouvoir ne s'opère à leur détriment.
C'est que les signes ne manquent pas, montrant une nouvelle fois qu'en France la politique intérieure et les choix de politique étrangère sont toujours intimement liés.
Par sa situation géopolitique, la France est l'épicentre de l'Europe, et s'il se met à trembler – si le roi ou l'État sont contestés –, c'est tout le système des relations internationales européennes qui se recompose.
Henri IV avait déclaré la guerre à l'Espagne en s'appuyant sur les puissances protestantes, contestant ainsi la suprématie des Habsbourg d'Allemagne et d'Espagne.
Le nouveau pouvoir signe la paix avec l'Espagne, à la grande satisfaction du « parti dévot », mais en suscitant l'inquiétude des « politiques », de ces « bons Français » qui placent les considérations religieuses au second plan, cherchant d'abord à conforter la puissance du royaume face aux Habsbourg.
Dès 1612, Marie de Médicis, dévote, prépare des « mariages espagnols » : Louis XIII épousera l'infante Anne d'Autriche, et Élisabeth, sœur de Louis XIII, se mariera avec le futur Philippe IV d'Espagne.
C'est bien une réorientation majeure de la politique étrangère du royaume qui se précise. Elle place la France dans une situation de dépendance à l'égard de l'Espagne ou des Habsbourg d'Allemagne au moment même où commence le grand affrontement de la guerre de Trente Ans (1618-1648), dans laquelle la France laisse les Impériaux envahir le Palatinat ou briser la révolte tchèque, ou encore Philippe IV d'Espagne faire la guerre aux Provinces-Unies.
La politique du parti dévot l'emporte. Elle est aux antipodes des choix d'un François Ier s'alliant avec Soliman le Magnifique pour s'opposer à Charles Quint, ou encore de ceux de Henri IV s'appuyant sur les princes luthériens et les Provinces-Unies.
Ce choix d'un traité d'alliance avec l'Espagne (1612), qui conduit à la conclusion des « mariages espagnols », ne s'explique pas seulement par des raisons religieuses.
Les décrets du concile de Trente sont désormais appliqués en France. Un renouveau religieux se manifeste avec la création d'ordres mendiants, de collèges jésuites, et l'émergence de fortes personnalités comme saint François de Sales, saint Vincent de Paul, Bérulle.
En fait, le royaume est trop divisé, trop déchiré en factions rivales pour appliquer un projet de politique extérieure qui consisterait – comme l'avait esquissé Henri IV – à faire de la France l'arbitre de l'Europe en assurant ainsi la prépondérance française et en supplantant par là les Habsbourg, qu'ils soient d'Allemagne ou d'Espagne.
Il faudrait, pour y parvenir, rassembler le royaume. Or les grands conduisent des guerres civiles contre la régente et le roi mineur (1614-1616 ; 1616-1617). Les protestants du Béarn prennent à leur tour les armes.
Les états généraux réunis à Paris en octobre 1614 montrent l'impossibilité de formuler des propositions – fiscales, par exemple – rassemblant les trois ordres (clergé, noblesse, tiers état).
On voit la vieille noblesse s'opposer à la nouvelle, définie par ses fonctions.
Incapable de rassembler, le pouvoir est cependant servi par ces divisions qui réduisent les états généraux à une impuissance comparable à la sienne.
Les « officiers » proclament orgueilleusement qu'ils sont, de par leurs fonctions, liés au monarque : « Nous représentons Votre Majesté en nos charges, dit le prévôt des marchands de Paris, Miron. Qui nous outrage, viole Votre autorité, voire commet en certains cas le crime de lèse-majesté. »
En France, la carence ou le trouble au sommet de l'État provoquent inéluctablement l'éclatement de la nation en groupes rivaux.
Dans ces conditions, le pouvoir n'échappe pas à la critique. Chaque clan formule ses « remontrances ».
Le parlement de Paris présente les siennes en mai 1615, et élabore un véritable programme, demandant le retour à la politique extérieure de Henri IV, critiquant les conseillers de la reine, ces « étrangers » prévaricateurs.
Quelques semaines plus tard, Condé publie un manifeste exigeant que la Cour suive les cahiers des états généraux. C'est dire que le « soupçon » à l'égard de la monarchie est devenu acte d'accusation.
Les mesures prises par Concini pour tenter de faire face à ces oppositions – il fait entrer au Conseil Armand Jean Du Plessis, futur cardinal de Richelieu, chargé des Affaires étrangères –, l'emprisonnement de Condé à la Bastille, puis l'envoi de troupes en Champagne et dans le Nivernais pour réduire une rébellion du duc de Nevers, si elles recréent un semblant d'ordre, ne peuvent rétablir l'unité et l'autorité du pouvoir.
Car dans la monarchie française, qui est déjà absolutiste, c'est le roi qui les incarne. Il est le cœur du royaume et de la construction politique. S'il est absent ou empêché, le royaume entre en crise.
L'âme de la France ne peut vivre sans un « centre », une clé de voûte.
Ainsi le coup d'État organisé par Charles d'Albert de Luynes avec l'assentiment du roi est-il un premier pas nécessaire vers le retour à l'ordre.
Le 24 avril 1617, Concini est assassiné. Son corps, déterré par la foule, est dépecé, brûlé, ses cendres répandues, et Leonora Galigaï exécutée à son tour comme sorcière. Marie de Médicis chassée, Louis XIII, âgé de seize ans, confie le pouvoir réel à Luynes.
Mais le roi doit s'imposer par les armes : contre Marie de Médicis – la guerre de la mère et du fils –, contre les grands en Guyenne et en Normandie, contre les protestants en Béarn.
Luynes tout comme le dévot Louis XIII continuent la « politique » qui privilégie les mobiles religieux et ne se dresse donc pas contre le Habsbourg.
Les Espagnols prennent pied dans la Valteline, et la France se retrouve ainsi menacée d'encerclement, les armées espagnoles étant désormais toutes proches de celles de l'empereur de Vienne.
La mort de Luynes, en 1621, permet le raccommodement du roi et de sa mère.
Or celle-ci a eu pour conseiller le cardinal de Richelieu, longtemps partisan de l'alliance avec l'Espagne, mais qui, devant les initiatives de Madrid et de Vienne, a pris conscience de l'effacement et de la subordination qu'elles impliquent pour la France.
Avec son entrée au Conseil, le 29 avril 1624, les conditions d'un changement de politique, si le roi l'entérine, sont réunies.
Quinze années viennent d'être perdues, le royaume étant paralysé par des luttes vaines.
Elles ont cependant confirmé que la France, à tout moment de son histoire, peut s'enfoncer dans le marécage de ses divisions, connaître l'impuissance, les haines fratricides, les violences, les assassinats, les exécutions les plus barbares, puis recouvrer l'unité un temps perdue et donc sa force.
25.
La France était entravée.
Or il faut moins de vingt ans à Richelieu et à Louis XIII pour en faire l'un des acteurs majeurs de la politique européenne, et donc aussi pour remodeler le gouvernement, la société et l'âme du royaume.
En 1624, lorsque Richelieu est appelé au Conseil du roi, la France hésitait à choisir une politique.
Le 4 décembre 1642, quand meurt le Cardinal, suivi le 14 mai 1643 par le roi, le royaume est engagé sur une trajectoire qui détermine son avenir.
En fait, tout s'est joué en quelques semaines, même s'il a fallu plusieurs années pour déployer les conséquences du diagnostic que, dès le mois de novembre 1624 – il est entré au Conseil le 29 avril –, formule Richelieu :
« Les affaires d'Allemagne sont dans un tel état, écrit-il à Louis XIII, que si le roi les abandonne, la Maison d'Autriche se rendra maîtresse de toute l'Allemagne, et ainsi assiégera la France de tous côtés. »
Le souverain partage cette analyse.
Il a renouvelé en juin 1624, malgré les « dévots », son alliance avec les Provinces-Unies protestantes. Or elles sont en guerre avec l'Espagne catholique.
Mais Louis XIII n'a pas encore tranché définitivement. Il demeure fidèle au rapprochement avec l'Espagne, dont le roi est son beau-père. Louis reste un dévot.
Le Cardinal, lui, a choisi. L'ambassadeur de Venise note : « En toutes choses, Richelieu se fait connaître plus homme d'État que d'Église. »
C'est là une orientation décisive.
Elle place la politique au cœur de toutes les décisions. Elle est laïque dans son essence. Elle ne vise pas des objectifs « religieux », mais est portée par l'« idée que la place du royaume de France parmi les nations » doit être la première.
Encore, pour y parvenir, faut-il tout subordonner à cette ambition nationale et dynastique.
Cela suppose une direction ferme et unifiée de l'État. Une société soumise où les corps intermédiaires (parlements, états provinciaux) ne jouent qu'un rôle mineur, où l'on ne tolère aucune indépendance des grands, ces princes toujours tentés de se partager le royaume ; et où l'on ne peut non plus accepter que les huguenots constituent un « État dans l'État » avec des places fortes, des villes de sûreté, une organisation politico-militaire.
Quant au peuple de va-nu-pieds, de manants et de croquants, il faut réprimer sans pitié toutes ses protestations, ses rébellions, d'autant plus nombreuses que les impôts sont multipliés par trois entre 1635 et 1638, et que la disette menace toujours les pauvres.
Or la grande politique étrangère exige d'immenses ressources. Il faut armer 150 000 hommes, les doter d'une artillerie, les « solder », construire des navires, payer les Suédois ou les Hollandais, ces alliés qui mènent seuls la guerre contre l'Espagne, puisque Louis XIII ne l'a pas déclarée et que la France conduit donc contre les Habsbourg une « guerre couverte », « douce » mais fort coûteuse.
Il faut par conséquent abandonner « toute pensée de repos, d'épargne et de règlement du dedans du royaume », diagnostique Richelieu.
C'est bien le choix d'une politique étrangère destinée à assurer la grandeur du royaume qui détermine le programme de Richelieu.
Ceux qui s'opposent à lui invoquent les souffrances, les sacrifices qui vont être demandés au peuple si la guerre s'engage.
Ils sont hostiles à l'idée d'une politique antiespagnole, donc anticatholique.
Ils refusent, en fait, le caractère absolutiste de la monarchie.
Ils soutiennent les complots que les grands ourdissent contre Richelieu, envisageant de le faire assassiner. On voit se liguer des dévots, comme le garde des Sceaux Marillac, des grands, comme le comte de Chalais.
On conspire avec l'accord du frère du roi, Gaston d'Orléans, de la reine mère Marie de Médicis, ou même de la reine Anne d'Autriche, fille du roi d'Espagne.
On conteste l'interdiction des duels.
De leur côté, les protestants – les ducs de Rohan et de Soubise – entendent défendre leurs places fortes, donc le port de La Rochelle, qui peut leur permettre de recevoir l'aide anglaise.
Le programme que Richelieu élabore est d'une force et d'une limpidité implacables.
Il faut, dit-il, « ruiner le parti huguenot », « rabaisser l'orgueil des grands », « réduire tous les sujets à leurs devoirs, et relever le nom du roi dans les nations étrangères au point qu'il doit être ».
Les têtes des grands – pour un duel, un complot, une trahison – roulent : Marillac, le duc de Montmorency-Bouteville, Cinq-Mars, le comte de Chalais, sont décapités.
Les huguenots de La Rochelle sont assiégés : ils capituleront en 1628, la population de la ville étant alors passée de 25 000 à 6 000 habitants.
La détermination de Richelieu est impitoyable.
Il brise les résistances des protestants dans les Cévennes. Et même si, par l'édit de grâce d'Alès (1629), il leur accorde la liberté de conscience et de religion, ils perdent toutes les garanties « militaires et politiques » que Henri IV leur avait accordées.
Ils sont dans la poigne du roi, sans autre défense que son bon vouloir.
« Les sources de l'hérésie et de la rébellion sont maintenant éteintes », constate Richelieu.
L'essentiel n'est cependant pas dans la victoire de l'Église contre les adeptes de la religion prétendument réformée, mais bien dans ce que l'on peut faire de ce royaume qu'on maîtrise désormais.
Or le but est clair : la grandeur du royaume, la gloire du roi, qui ne sauraient s'obtenir que par la domination sur les autres nations.
Or il faut que la France soit la première des nations. Richelieu ne veut pas d'une Europe impériale, mais de nations alliées, subordonnées à la nation française.
Ce choix de la « grandeur nationale » passe par l'intervention dans les affaires européennes.
Richelieu est ainsi le premier des hommes d'État français à formuler clairement l'ambition qui va devenir l'un des traits distinctifs de l'âme de la France.
« Maintenant que La Rochelle est prise, écrit le Cardinal à Louis XIII, si le roi veut se rendre le plus puissant du monde, il faut avoir un dessein perpétuel d'arrêter le cours des progrès d'Espagne, et au lieu que cette nation a pour but d'augmenter sa domination et étendre ses limites, la France ne doit penser qu'à se fortifier en elle-même et s'ouvrir des portes pour entrer dans tous les États de ses voisins et les garantir des oppressions d'Espagne. »
Richelieu oppose ainsi une Europe des nations, dont la France serait la protectrice, à une Europe « impériale ».
Pour mettre en œuvre cette politique, encore faut-il que le roi la soutienne. Or Louis XIII est soumis à la pression de son entourage : Anne d'Autriche, l'épouse espagnole, Marie de Médicis, la mère dévote, et tous ceux du « parti dévot » que révulse l'idée de faire la guerre à l'Espagne ou qui prévoient le coût d'hostilités prolongées et les souffrances qu'elles provoqueront.
Le 16 novembre 1630, Marie de Médicis croit avoir obtenu d'un Louis XIII malade le renvoi de Richelieu, mais le roi va finalement conforter le Cardinal, chasser le garde des Sceaux, Marillac, et la reine mère, Marie de Médicis. Le tournant décisif est pris.
La guerre « ouverte » ne sera néanmoins déclarée à l'Espagne qu'en 1635.
C'est qu'il faut de l'argent pour la conduire. Les impôts sont augmentés, affermés à des « financiers », des « traitants », des « partisans » qui avancent à l'État les sommes qu'ils empruntent aux grandes familles de la noblesse d'épée et de robe, auxquelles est versé un intérêt. Quelles que soient leurs positions politiques, elles sont ainsi tenues par la dépendance financière qui les lie au roi.
Si l'on ajoute que Richelieu a dû renoncer à mettre fin à la vénalité des offices, à l'impôt de la paulette qui les rend héréditaires, on mesure combien la monarchie absolutiste est en même temps comme un Gulliver pris dans la toile d'araignée de ses besoins d'argent. Elle est dans la main des prêteurs, eux-mêmes attachés à cette monarchie qui les prive du pouvoir politique mais qu'ils financent et qui leur paie des « rentes », qui crée des offices de plus en plus nombreux pour les leur faire acheter puis transmettre.
Ainsi se ramifie la structure d'une société où le propriétaire d'un office préfère le prestige de sa fonction, de son titre, de la rente, aux aventures du commerce et aux risques de l'investissement dans les grandes compagnies.
Ankylose française au moment où Hollandais et Anglais courent les mers du monde.
Cependant, le royaume est riche, il demeure le plus puissant et le plus peuplé d'Europe. Il met sur pied six armées. Et même si, en 1636, Corbie est assiégée, les cavaliers espagnols parvenant à Pontoise, la nation ne cède pas. Le patriotisme conduit plus de trente mille volontaires à se rassembler pour défendre Paris. Au bout de sept années, cette guerre commencée en 1635 permet aux troupes royales de conquérir Arras, Bapaume, le Roussillon, Perpignan.
La Gazette (créée en 1631 par Théophraste Renaudot), l'Académie française, conçue par Richelieu dès 1635, exaltent ces victoires. Car c'est le rôle des écrivains, des « gazettes », de chanter la gloire du souverain et la grandeur du royaume.
Le régime absolutiste est un tout : la littérature – Le Cid est joué en 1636, année de Corbie – et la peinture doivent concourir à la célébration de la France et de son monarque.
L'Académie française est l'illustration de cette volonté politique de rassembler les sujets autour du pouvoir royal et de conforter le patriotisme.
On ignore les libertins (au sens d'incroyants), et le baroque cède peu à peu la place au classicisme.
Certes, il ne se passe pas d'année, entre 1624 et 1643, sans qu'il y ait une jacquerie, une émeute paysanne, une révolte dans les villes, ainsi à Dijon, Aix-en-Provence, Lyon, Rouen.
Que ce soit en Quercy, en Saintonge, en Angoumois, en Poitou – en 1636, année de Corbie –, que les rebelles se nomment « croquants » en Périgord ou « va-nu-pieds » en Normandie, il s'agit toujours de protester contre les hausses d'impôts, l'augmentation des taxes, et, souvent, des « privilégiés » soutiennent ces mouvements parce que eux-mêmes perdent peu à peu de leur pouvoir au bénéfice des « intendants de police, de justice et de finance ».
Mais on ne s'attarde pas sur la misère des humbles ni sur les malheurs de la guerre.
Ce ne sont pas les gravures de Callot montrant les grappes de pendus aux arbres, sur les champs de bataille, qu'on retient, mais les écrits d'académiciens français « célébrant les victoires des armées du roi ».
On s'inquiète pourtant, à la mort de Louis XIII, le 14 mai 1643. Son fils, né en 1638, n'est âgé que de quatre ans et huit mois.
Le temps des troubles va-t-il revenir ?
Depuis le 5 décembre 1642, sur la recommandation de Richelieu, Louis XIII a fait du cardinal Jules Mazarin son principal ministre et le parrain de son fils, le futur Louis XIV.
26.
Quand le pouvoir s'affaiblit, il redevient une proie que tous cherchent à dépecer.
Dans la monarchie française déjà absolutiste au milieu du xviie siècle, c'est la force du roi qui fait la force de l'État.
Or voici que l'histoire semble se répéter, offrir l'occasion d'une revanche aux grands, aux parlementaires, à tous ceux qui avaient dû ployer l'échine devant Louis XIII régnant de concert avec Richelieu.
Le Cardinal avait cherché et réussi à « rabaisser l'orgueil des grands ». Ils le revendiquent et se redressent.
Le roi n'est-il pas qu'un enfant ?
Et pourquoi respecter cette Anne d'Autriche, espagnole, reine mère comme l'avait été Marie de Médicis, l'Italienne gouvernant avec Concini, déjà un Italien comme l'est ce principal ministre légué par Richelieu à Louis XIII et à Anne d'Autriche, ce cardinal tonsuré mais non ordonné prêtre, Giulio Mazarini ?
Le pouvoir semble d'autant plus chancelant qu'Anne d'Autriche, pour obtenir la plénitude de la régence, fait casser par le parlement de Paris, dans un lit de justice, le testament de Louis XIII en même temps qu'elle confirme Mazarin dans ses fonctions.
Il suffit de quelques mois pour qu'une « Cabale des Importants », animée par le duc de Beaufort (petit-fils de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées), envisage d'assassiner Mazarin.
Louis XIII n'avait-il pas laissé tuer Concini et supplicier Leonora Galigaï ? La « Cabale des Importants » est démasquée, Beaufort, emprisonné, mais le ton est donné.
Mazarin sera la cible, puisque, entre une reine mère étrangère et un Louis XIV encore enfant, il est le seul capable, et pour plusieurs années, de diriger l'État et de faire face.
Pour l'abattre, puisqu'on n'a pu l'assassiner, on va le larder de toutes les calomnies, de toutes les accusations.
Plus de quatre mille pamphlets – des mazarinades – seront publiés contre lui.
Il est, dit-on, le suborneur d'Anne d'Autriche. Il est porteur du « mal de Naples » – la syphilis –, et adepte du « vice italien », l'homosexualité.
Il pille à son profit les caisses du royaume – ce qui est vrai. Sa fortune est si grande qu'il achète des œuvres d'art par centaines – elles rempliront le musée du Louvre.
Par une politique matrimoniale minutieusement calculée, il place ses trois neveux et ses six nièces, les filles de sa sœur Mancini. Et, avec cela, habile, séducteur, grand manœuvrier, continuant la politique de Richelieu avec une égale obstination dissimulée sous des manières douces.
Mazarin illustre ainsi cette particularité française : admettre que des « étrangers » puissent servir le pouvoir au plus haut niveau de l'État.
Ces hommes qui parfois – comme Mazarin – parlent maladroitement le français deviennent des « patriotes » attachés aux intérêts du roi, soucieux de contribuer à la grandeur de la nation.
Remarquable capacité du pays – de l'État monarchique et plus tard républicain – de s'ouvrir. Car il ne s'agit pas là de la conséquence d'une pratique « féodale » pour laquelle les nationalités ne seraient pas encore définies, mais bel et bien d'un trait spécifique de la nation française.
D'ailleurs, ce n'est pas d'abord l'« étranger » qu'on attaque, mais le principal ministre, celui qui incarne la politique absolutiste, la guerre qui se poursuit contre l'Espagne catholique. Car si les protestants ont été réduits au silence par Richelieu, le parti dévot est toujours aussi puissant, toujours aussi hostile à la politique étrangère qui dresse la France contre les Habsbourg de Madrid et de Vienne.
Les parlementaires sont les plus déterminés. Ils ne sont pas sensibles à la victoire de Condé à Rocroi (le 19 mai 1643), puis aux succès du même Grand Condé et de Turenne sur la Moselle et le Rhin (Fribourg, Nördlingen), ou dans le Nord (prises de Furnes et de Dunkerque).
Ils sont dressés contre la monarchie absolutiste, contre les impôts, les taxes que le pouvoir veut prélever, la guerre dévorant l'argent.
Un des traits majeurs de l'histoire nationale réside en effet dans cette question financière.
Les caisses de l'État, qui mène une grande politique, sont toujours vides. Il épuise les recettes fiscales des années à venir. Endetté, il pressure les plus pauvres.
Mal endémique, révoltes dans toutes les provinces, misère accablante à laquelle s'ajoutent les malheurs de la guerre et les poussées de la peste.
Les grands et les parlementaires conduisent leurs « frondes » contre le pouvoir, mais ce sont les humbles qui pâtissent des récoltes saccagées, des pillages perpétrés par la soldatesque.
En Champagne, « toutes les églises et les plus saints mystères sont profanés, les ornements pillés, les fonts baptismaux rompus, les prêtres ou tués ou maltraités ou mis en fuite, toutes les maisons démolies, toute la moisson emportée, les terres sans labour et sans semence, la famine et la mortalité presque universelles, les corps sans sépulture et exposés la plupart à servir de curée aux loups. Les pauvres qui restent de ce débris sont presque tous malades, cachés dans des cabanes découvertes ou dans des trous que l'on ne saurait presque aborder, couchés la plupart à plate terre ou sur la paille pourrie, sans linge ni habits que de méchants lambeaux. Leurs visages sont noirs et défigurés, ressemblant plutôt à des fantômes qu'à des hommes. »
Ce n'est pas cette situation cruelle qui pousse les parlementaires, en 1644, en 1648, en 1650, ou les grands, de 1650 à 1653, et les assemblées du clergé et de la noblesse, en 1650 et 1651, à conduire contre le pouvoir royal qu'incarne Mazarin la Fronde parlementaire ou la Fronde des princes.
Il s'agit, pour ces « élites » qui détiennent la richesse, les offices, le prestige, d'arracher à la monarchie absolutiste la réalité du pouvoir et de sauvegarder, de reprendre ou de multiplier leurs privilèges.
Cette opposition entre le pouvoir royal et les privilégiés est profonde et renaissante.
Mais la position des grands et des parlementaires est difficile à tenir, car d'autres forces entrent dans le jeu : pauvres des villes, artisans, ouvriers, apprentis, domestiques, appartenant à des couches sociales qui n'ont pas de biens à défendre ou à arrondir, mais qui veulent obtenir de quoi survivre.
Et les parlementaires comme les grands craignent par-dessus tout ces « sans-culottes », et à la fin les liens d'intérêt et la solidarité qui unissent les privilégiés au roi, en dépit de leurs divergences, l'emportent.
Ce jeu complexe des forces politiques et sociales structure notre histoire nationale.
On l'a déjà vu à l'œuvre plusieurs fois. Qu'on se souvienne d'Étienne Marcel (1358), ou des guerres de Religion, notamment à Paris.
Il ne peut que se reproduire.
Les besoins financiers d'un l'État absolutiste s'accroissant, il multiplie les créations d'offices, renforce les « corps intermédiaires » qu'il dépouille de tout pouvoir, mais dont il dépend. Dans le même temps, il s'endette, augmente les impôts, ce qui unit un temps contre lui toutes les couches de la société. La réunion des états généraux devient alors une revendication commune. Les derniers se sont tenus en 1614. On les réclamera à nouveau en 1651, mais ils ne se réuniront que quelque cent quarante ans plus tard, à la fin du xviiie siècle. Ce sera en 1789.
Ce qui est chaque fois en question, c'est la nature même du pouvoir, et donc le visage de la nation.
Ainsi, quand, le 13 mai 1648, le parlement de Paris invite les autres cours souveraines à se réunir à lui, les propositions élaborées visent à en finir avec l'absolutisme, à placer la monarchie sous la tutelle des parlementaires, c'est-à-dire à garantir aux membres des cours le pouvoir – et les privilèges – dont le souverain entend conserver ou s'arroger le monopole.
C'est déjà là une « réaction » nobiliaire et parlementaire. Les parlementaires veulent révoquer les intendants et les commissaires que les cours souveraines n'auront pas légitimés.
Le roi ne saurait de même, sans leur autorisation, créer des taxes et des impôts nouveaux.
Les sujets du royaume ne pourraient être détenus plus de vingt-quatre heures sans être déférés devant leurs juges.
En outre, le pouvoir ne pourrait plus fixer les conditions de la transmission des offices ou de leur création.
Les prérogatives de l'État absolutiste seraient transférées à ces parlementaires, propriétaires de leurs charges, privilégiés par excellence.
Or ces corps intermédiaires, qui détiendraient le pouvoir réel, ne sont évidemment pas représentatifs de la société. Les croquants du Rouergue, les rebelles de Bordeaux, les miséreux de Champagne, victimes des mauvaises récoltes ou de la soldatesque, ne sont pas concernés par ces revendications.
Cependant, quand Mazarin, qui se croit renforcé par la victoire de Condé à Lens, le 20 août 1648, ordonne l'arrestation, le 26, de parlementaires – dont le populaire conseiller Broussel –, la population parisienne dresse plus de 1 500 barricades (28 août). Et le pouvoir recule, libérant les parlementaires incarcérés et fuyant Paris pour Saint-Germain dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649.
La capitale échappe une fois de plus au pouvoir royal, mais laisse, face aux parlementaires et aux grands qui les ont rejoints, ce « peuple » que les « élites » sociales craignent tant.
Et d'autant plus que l'exemple anglais – avec Cromwell et la décapitation de Charles Ier, marié à une sœur de Louis XIII, Henriette, réfugiée en France – montre le danger qu'il y a à laisser se déchaîner contre le pouvoir royal la colère populaire. Les parlementaires signent donc avec le roi la paix de Rueil – 11 mars 1649 –, et, en août, la Cour peut rentrer à Paris.
La partie n'est pas terminée pour autant.
La Fronde des grands (Condé, Gondi de Retz) se déchaîne à son tour de 1650 à 1653. Les assemblées du clergé et de la noblesse réclament la convocation des états généraux.
Les parlementaires rentrant en scène, la tête de Mazarin est mise à prix (150 000 livres), car il est un « perturbateur du repos public ». La haine contre lui est attisée par les milliers de mazarinades : « Adieu, cause de nos ruines ! Adieu, l'abbé à vingt chapitres ! Adieu, seigneur à mille titres ! Allez sans jamais revenir ! » Et on lui promet le sort de Concini, puisqu'il est présenté comme le responsable de tous les maux du royaume, et d'abord de la création des nouvelles taxes contre lesquelles les Parisiens se sont révoltés en dressant leurs barricades.
Mais cette révolte populaire affaiblit les frondes plus qu'elle ne les renforce, car elle fait craindre des désordres sociaux, des revendications extrêmes mettant en cause les biens des « élites » mutinées.
Celles-ci s'étaient déployées parce que le pouvoir royal était affaibli.
Or il a remporté des succès.
Le traité de Westphalie a mis fin le 24 octobre 1648 à la guerre avec les Impériaux. Le royaume y gagne l'Alsace, moins Strasbourg.
Surtout, le 7 septembre 1651, Louis XIV est proclamé majeur, et ce simple fait relégitime le pouvoir. Le roi en est la clé de voûte. Par sa seule accession à la majorité, qui marque la fin de la régence, il rassemble autour de sa personne.
La France est attachée à la symbolique du pouvoir royal. Une procession manifeste cette adhésion populaire.
Mais les princes et les parlementaires les plus déterminés persistent encore dans leur opposition. C'est l'ultime partie.
Condé rejoint la Guyenne, se range aux côtés des révoltés qui se sont emparés de Bordeaux. Puis il regagne Paris, et ses partisans s'opposent, porte Saint-Antoine (juillet 1652), aux troupes royales qui veulent entrer dans la capitale.
Un pouvoir insurrectionnel est créé, des centaines d'exécutions ont lieu, la terreur s'installe. Par une manœuvre habile, le roi fait mine d'exiler Mazarin.
Ce dernier épisode – une sorte de simulacre – montre cependant la vigueur et l'enracinement des contradictions entre la monarchie absolue et les corps intermédiaires associés aux princes.
La victoire de Louis XIV, qui peut enfin rentrer à Paris en octobre 1652, puis le retour de Mazarin, acclamé par la population de la capitale le 30 janvier 1653, ne doivent pas dissimuler le fait que les problèmes demeurent.
Les « élites » françaises sont divisées. Les uns se rangent derrière la monarchie absolutiste et sont favorables au renforcement de l'État. Les autres rêvent d'un gouvernement de l'aristocratie et des parlementaires, d'une monarchie bridée par les corps intermédiaires.
Le désir de paix des populations appauvries et le patriotisme ont pesé de façon déterminante sur la fin de ces frondes.
Condé, par un véritable acte de trahison, s'est mis au service des Espagnols. Mais il est battu par les troupes de Turenne (en 1658, aux Dunes).
L'opposition parlementaire est matée.
Les dévots, engagés dans une guerre théologique contre les jansénistes (Pascal publie les Provinciales en 1657), ne protestent guère contre la conclusion d'un traité entre Mazarin et... Cromwell (1654) ! Et toute la nation est satisfaite de la fin de la guerre avec l'Espagne, conclue par le traité des Pyrénées le 7 novembre 1659.
Le royaume s'agrandit de l'Artois, de la Cerdagne et du Roussillon. Condé est pardonné. Surtout, le mariage de l'infante Marie-Thérèse d'Espagne et de Louis XIV est annoncé. L'infante doit remettre une dot de 500 000 écus d'or en échange du renoncement des époux au trône d'Espagne.
Ce « mariage espagnol », le traité des Pyrénées signé après celui de Westphalie, renversent la situation de la France en Europe.
Malgré les Habsbourg et contre eux, elle a établi sa prépondérance.
Les deux traités ont d'ailleurs été rédigés en français, non en latin.
Le 26 août 1660, Louis XIV et Marie-Thérèse font leur entrée solennelle dans Paris au milieu des acclamations.
Le 9 mars 1661, Mazarin meurt.
Cet Italien honni, calomnié, a poursuivi l'œuvre de Richelieu. Il n'a certes jamais oublié son clan familial. Stratège habile, il a fait de Louis XIV le légataire universel de son immense fortune, sachant que le roi va refuser la succession de son parrain. Et c'est Colbert, le financier de Mazarin, qui la règle.
Mais le jeune monarque et l'État sont les bénéficiaires de l'héritage politique que Mazarin a accumulé pour le service de la France.
Louis XIV peut régner.
3
LE GRAND SOLEIL FRANÇAIS
1661-1715
27.
« La face du théâtre change », dit Louis XIV à ses ministres et secrétaires d'État, le 10 mars 1661, lendemain de la mort de Mazarin.
Ce roi de vingt-trois ans, qui s'adresse aux membres de son Conseil, debout, le chapeau sur la tête, est impatient de régner.
Il ajoute :
« Je vous défends de rien signer, pas une sauvegarde, pas un passeport sans mon ordre, de me rendre compte chaque jour à moi-même et de ne favoriser personne. »
Ce roi veut tout voir, tout contrôler, tout décider.
« C'est par le travail que l'on règne, ajoute-t-il. C'est pour cela que l'on règne. »
Chaque jour, et durant les cinquante-quatre années de son gouvernement personnel, jusqu'à la veille de sa mort – le 1er septembre 1715 –, il accomplit avec ponctualité et gravité son « métier de roi ».
Dans chacune de ses paroles, de ses écrits, de ses décisions, de ses postures, il est l'incarnation de l'absolutisme.
Ce qui était en germe dès les origines de la monarchie française, que les hésitations des monarques, la vigueur des résistances des grands, des féodaux, des parlements, des cours souveraines, avaient empêché de l'emporter, atteint avec Louis XIV sa pleine maturité.
Dans tous les aspects de la vie nationale, cet absolutisme s'impose. Richelieu et Mazarin ont renversé les derniers obstacles au terme de guerres et de frondes qui ont marqué l'enfance et l'adolescence de Louis XIV.
Sa volonté d'exercer un pouvoir absolu est aussi le fruit d'une expérience douloureuse. Il prend sa revanche. Il se défie de tous. Il a connu les conspirations de ses plus proches parents. Il a affronté la Fronde des princes et celle des parlementaires. Il a subi la trahison de Condé. Il a dû fuir Paris. Et il ne peut pas aimer cette capitale dont la population, depuis des siècles, soutient les adversaires du roi et dresse des barricades.
La détermination de Louis XIV et la longueur de son règne font de cet absolutisme l'une des données majeures de l'histoire nationale. Pour le meilleur et pour le pire, il est au cœur de l'âme de la France.
Et ce d'autant plus que Louis XIV ne cherche en rien à dissimuler le principe absolutiste de son règne, mais qu'au contraire il l'affiche avec force, il le revendique comme l'essence même du pouvoir monarchique.
Le roi n'est-il pas choisi et jugé seulement par Dieu ? Voilà qui fonde l'absolutisme.
« Celui qui a donné des rois aux hommes, écrit Louis XIV, a voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d'examiner leur conduite. Sa volonté est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement. »
Nul ne peut contester, juger, refuser d'appliquer une décision du souverain.
Aucune autorité n'existe en dehors de la sienne. Aucune assemblée – même celle du clergé, et même le pouvoir pontifical –, aucune cour, aucun parlement, et naturellement pas les états généraux ne peuvent se dresser contre le roi, ou simplement l'interroger.
« Il est Dieu, dit une cousine de Louis XIV. Il faut attendre sa volonté avec soumission et tout espérer de sa justice et de sa bonté, sans impatience, afin d'en avoir plus de mérite. »
Plus aucun corps intermédiaire, plus aucune fonction n'existent hors de la volonté royale.
Les maires des villes, les gouverneurs des provinces, les évêques, sont désignés par le monarque, ou, si leurs nominations échappent à son autorité, ils perdent tout pouvoir. Un lieutenant général de police – celui de Paris, La Reynie – restera en poste de 1667 à 1697. Un intendant de police, de justice et de finance, et les subdélégués au service de celui-ci, sont les agents d'exécution des volontés royales.
L'armée – jusqu'alors aux mains des nobles, propriétaires des grades – devient un rouage essentiel de la monarchie absolutiste. Elle est l'instrument de sa politique étrangère, mais aussi de la répression contre ceux qui se rebellent. Elle est puissante : 67 000 hommes en 1677, 400 000 en 1703. La flotte passe de 18 navires en 1661 à 276 en 1683 !
Des officiers roturiers sont nommés au mérite, leurs grades échappant ainsi à la vénalité des offices.
L'armée est aux ordres exclusifs du roi. Et l'hôtel des Invalides accueille ceux des soldats qui ont été blessés à son service.
Tout est dans les mains du souverain.
Ainsi les Conseils du roi qui se réunissent quotidiennement. Ainsi le Conseil étroit (en présence du monarque), les intendants des provinces, mais aussi les académies créées par Colbert – surintendant des finances et des bâtiments – autour de l'Académie française (Académies des inscriptions et belles-lettres, des sciences, de musique, d'architecture).
L'image de ce pouvoir personnel est Versailles, où la Cour symbolise par sa soumission, son étiquette réglée comme celle d'une cérémonie religieuse, que le roi est au-dessus de tous et que chacun lui doit une obéissance servile.
Hors de son autorité – et de son regard –, personne n'existe.
L'âme de la France est modelée par cette servitude exigée qui devient vite volontaire. Le « fonctionnement » du gouvernement de la France, de toute la société, est déterminé par une « volonté » unique, celle du monarque, qui élève ou brise au gré de son « bon vouloir », de son intérêt dynastique ou de la vision qu'il a de l'intérêt du royaume.
Nicolas Fouquet était surintendant des finances. Le souverain le soupçonne d'avoir une ambition autonome, de parvenir peut-être à regrouper autour de lui des opposants à l'absolutisme, ou simplement d'affaiblir par sa propre lumière le rayonnement solaire du pouvoir royal. Aussi est-il arrêté, emprisonné à vie, sans aucune possibilité de recours (septembre 1661). La lettre de cachet condamne sans explication. L'État absolutiste est un État « totalitaire ». Aucun domaine ne lui échappe : Colbert crée des manufactures, de grandes compagnies de commerce qui devraient concurrencer les hollandaises et les anglaises. Le roi a son historiographe : Racine ; son peintre : Le Brun ; son architecte : Le Vau ; son musicien : Lully. Molière joue ses pièces devant le souverain ; il est son protégé.
L'âme de la France apprend à servir et à louer, à attendre l'impulsion ou l'ordre de l'État pour créer.
Elle vit de l'État et sous la protection de l'État (un tarif protecteur est institué à nos frontières par Colbert en 1667) ; c'est par le service de l'État qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale.
Chacun dépend du roi, est son courtisan et son serviteur, mais, par-delà la personne du monarque, c'est le royaume que l'on sert.
Le roi s'identifie à la France. Et le peuple ne sépare pas le corps symbolique du roi du corps de la nation.
Mais chaque serviteur du roi, lieutenant général de police, intendant ou officier, veut être à son tour un souverain absolu, si bien que la société française devient ainsi une société de castes d'autant plus rigides qu'elles sont constituées de propriétaires de leurs charges. Colbert, qui doit faire face au gouffre financier que creuse la politique de grandeur, multiplie les ventes d'offices, ce qui, à moyen terme, ne peut que saper l'absolutisme.
Le roi risque en effet de ne plus être maître que d'une apparence de pouvoir absolu, celui-ci se réduisant à un rituel et à une étiquette, à une Cour.
Car, les grilles du parc franchies, les propriétaires de charges se sont emparés du pouvoir, puisqu'ils lui fournissent l'argent dont il a besoin.
L'endettement de l'État absolutiste, le déséquilibre endémique des comptes – les recettes n'étant jamais suffisantes, il faut créer de nouveaux impôts, vendre de nouveaux offices –, deviennent ainsi, dès 1670, une maladie pernicieuse qui ronge le royaume.
Mais, au début du règne personnel de Louis XIV, les effets de cette pathologie française – aucun régime n'y échappera – ne sont pas encore trop inquiétants.
L'ambassadeur vénitien souligne en 1661 que « la France est un pays riche de terroirs fertiles, composé de provinces réunies en un corps unique où les communications sont facilitées par les nombreuses rivières... Le royaume n'a pas cessé de s'agrandir depuis deux cents ans... Ses principales richesses, la France ne les tire pas des Indes, mais de son propre sol... La force du royaume vient aussi de son armée, car il est plein de soldats qui par leur instinct naturel sont braves et courageux... Je parlerai maintenant du roi Louis XIV..., prince de complexion vigoureuse, de haute taille, d'aspect majestueux... On ne le voit jamais s'emporter ou se laisser dominer par la passion... Il se consacre effectivement et assidûment aux affaires du gouvernement... »
Cette richesse du royaume semble d'abord inépuisable.
Le roi y puise pour ses « bâtiments » – Versailles, où il s'installe en 1682, Marly –, ses fêtes, ses « jeux », ses « dons » aux courtisans, puisque tout homme est à vendre et que le monarque sait les acheter par des gratifications symboliques – être à la Cour, servir le souverain, assister à son lever, à son coucher – et ses distributions d'argent.
Tout courtisan devient un domestique qui attend son pourboire !
Telle est la logique du pouvoir absolu – qui sera celle de tout pouvoir français : il veut qu'on le serve. Il distingue parmi ses serviteurs, il nomme, promeut, favorise, rétribue, renvoie, bannit.
Car le pouvoir se méfie de ceux qui, par indépendance d'esprit, force de caractère ou orgueil de caste, pourraient ne pas se soumettre à cette domestication généralisée.
Ainsi, la haute noblesse est écartée des responsabilités politiques, à la fois parce que Louis XIV a vécu la Fronde des princes, mais aussi parce qu'il se méfie de l'orgueil de caste des grands.
Les trois ministres composant le Conseil étroit qui gouverne l'État sous la direction personnelle et quotidienne du roi sont de « pleine et parfaite roture », selon Saint-Simon.
C'est le cas de Jean-Baptiste Colbert – et plus tard de son fils et de ses parents – aux Finances, de Michel Le Tellier – puis de son fils Louvois – à la Guerre, de Hugues de Lionne aux Affaires étrangères.
L'amertume pincée des grands se mue en désir de paraître aux côtés du roi à Versailles, à Marly (« Sire, Marly ! »), de partager sa vie quotidienne – les jeux, les dîners, les chasses, les fêtes, les représentations théâtrales, les ballets –, de se repaître de rumeurs, de ragots, de connaître les favorites – mademoiselle de La Vallière, madame de Montespan –, de pousser leurs filles ou leurs épouses dans les bras du roi.
Ce paraître est onéreux. On s'y ruine. On dépend du roi, qui peut rembourser les dettes qu'on a contractées.
Mais il vous faut être près de lui, afin qu'il vous voie.
Des rivalités haineuses déchirent les courtisans. Des intrigues se nouent, certaines criminelles. L'affaire des poisons compromet madame de Montespan ; le roi clôt l'enquête, mais trente-six personnes sont condamnées, exécutées, parmi les complices ou clients de l'avorteuse, sorcière, empoisonneuse, vendeuse de « filtres », organisatrice de messes noires : la Voisin.
Ainsi dépendante du roi, la haute noblesse n'a plus les moyens de se dresser contre le souverain. On ne prend plus les armes. On ose à peine prendre la plume.
La servilité, qui masque sa lâcheté sous le nom de « service de l'État », alors qu'elle n'est que soumission pour la recherche d'une charge, d'une distinction, d'une rétribution, s'inscrit elle aussi dans l'âme de la France.
Et Louis XIV fait preuve d'une lucidité cynique et machiavélienne lorsqu'il écrit :
« Je crus qu'il n'était pas dans mon intérêt de chercher des hommes d'une qualité plus éminente – pour me servir –, parce que ayant besoin sur toutes choses d'établir ma propre réputation, il était important que le public connût par le rang de ceux dont je me servais que je n'étais pas en dessein de partager avec eux mon autorité, et qu'eux-mêmes, sachant ce qu'ils étaient, ne conçussent pas de plus hautes espérances que celles que je leur voudrais donner. »
Il ajoute, dévoilant sa méthode de gouvernement solidaire excluant la désignation d'un ministre principal : « Il était nécessaire de partager ma confiance et l'exécution de mes ordres sans la donner entière à personne. »
Ce changement dans l'administration du royaume (conseillers d'État, maître des requêtes, intendants, subdélégués et officiers appliquent le plus souvent avec rudesse les ordres du roi), s'il en renforce la cohésion, ne fait pas pour autant disparaître la misère des plus humbles.
Au contraire. C'est en cascade que les besoins financiers de l'État vont écraser de taxes et d'impôts les « jacques ».
Ceux-ci se rebellent dès 1661-1662 dans tout le nord du royaume, puis en Sologne, en Bretagne. Les troupes répriment avec une cruelle efficacité ces « émotions paysannes » que la disette ou la famine provoquent.
On pend les « meneurs ». On condamne aux galères : les navires construits sur l'ordre de Colbert ont besoin de bras. On sévit sans hésitation, sans remords ni regrets. Se rebeller contre le souverain est sacrilège. Le pouvoir absolu l'affirme avec netteté :
« Quelque mauvais que puisse être un prince, écrit Louis XIV, la révolte de ses sujets est toujours infiniment criminelle. »
Le roi peut donc gouverner selon son « bon plaisir », qui est aussi, par nature, le choix propre à assurer sa gloire et celle du royaume.
Dans le pouvoir absolu, il n'y a pas séparation entre les désirs du monarque et les besoins de la nation.
Tout gouvernement de la France sera plus ou moins consciemment l'héritier de cette conviction et de cette pratique absolutiste dont Louis XIV a imprégné l'âme de la France.
Le roi en fait le ressort de sa politique religieuse et de sa politique étrangère.
Il s'agit là des deux domaines où il est confronté à d'autres pouvoirs éminents : ceux du pape et des autres souverains.
Il veut affirmer face au pape son autonomie, alors qu'il est le Roi Très-Chrétien de la fille aînée de l'Église, et montrer aux autres monarques qu'il leur est supérieur.
En 1682, dans la Déclaration des quatre articles, Louis XIV s'arroge notamment le droit de nomination des évêques, exaltant ainsi le « gallicanisme » traditionnel de l'Église de France.
Il affirme : « Les rois et les souverains ne peuvent être soumis par ordre de Dieu à aucun pouvoir ecclésiastique dans les choses temporelles, ni déposés directement ou indirectement par l'autorité des chefs de l'Église, ou leurs sujets dispensés de foi et d'obéissance et déliés de leur serment de fidélité. »
Dans cette compétition de pouvoir entre le roi et le pape, Louis précise que les conciles sont supérieurs au souverain pontife et qu'il ne saurait donc être question d'infaillibilité pontificale.
Le pouvoir absolu se veut seul de son espèce.
Le roi de France est supérieur à tous les autres.
L'âme de la France se grisera de ces certitudes.
Le roi peut à sa guise, selon son bon plaisir, mettre fin à la « paix établie » avec ses voisins.
« Tout était calme en tous lieux, reconnaît-il. Vraisemblablement pour autant que je le voudrais moi-même. »
Mais le veut-il ?
« Mon âge et le plaisir d'être à la tête de mes armées m'auraient fait souhaiter un peu plus d'affaires au-dehors », admet-il encore.
C'est qu'il s'agit de sa gloire.
Et à Londres comme à Rome, pour des questions de préséance, ou après un incident diplomatique, il réagit en affirmant sa prééminence et en obtenant réparation.
« Je ne sais si depuis le commencement de la monarchie il s'est jamais passé rien de plus glorieux pour elle, écrit Louis XIV. C'est une espèce d'hommage de roi à roi, de couronne à couronne, qui ne laisse plus douter à nos ennemis mêmes que la nôtre ne soit la première de la chrétienté. »
En 1664, six mille soldats français iront combattre aux côtés des Impériaux et seront victorieux des Turcs au Saint-Gothard.
C'est manière d'affirmer que le roi de France peut agir dans toute l'Europe selon sa volonté, et qu'il ne craint ni les Habsbourg de Vienne ni ceux d'Espagne.
À la mort du roi d'Espagne, Louis XIV réclame les biens de Marie-Thérèse, son épouse, dont la dot n'a pas été versée par Madrid. C'est la guerre de Dévolution (1667-1668). La France obtient Lille, Tournai et Douai au traité d'Aix-la-Chapelle.
De 1672 à 1679, il mène la guerre contre la Hollande, la plus grande puissance marchande d'Europe et donc du monde. Les peintres, les écrivains, les musiciens, Racine, l'historiographe du roi, célèbrent le « passage du Rhin » à Tolhuis, le 16 juin 1672.
Mais la guerre est longue, coûteuse, incertaine malgré les victoires de Condé et de Turenne. Louis XIV et la Cour sont présents sur le front. La guerre est pour eux un grand jeu glorieux qui enfle l'endettement de l'État. Mais la gloire n'a pas de prix, et le royaume s'agrandit de la Franche-Comté au traité de Nimègue, en 1679.
La prépondérance française – déjà inscrite dans les traités de Westphalie (1648) et des Pyrénées (1659) – en sort renforcée.
Qui pourrait dès lors s'opposer à la politique de « réunion » de villes au royaume de France – Strasbourg en 1681 –, qui ne sont que des annexions masquées par des arguties juridiques, voire des coups de force que l'armée et le royaume le plus puissant d'Europe imposent ?
Ceux qui ne se plient pas doivent méditer le sort de Gênes, bombardée par la flotte française qui l'écrase sous dix mille bombes incendiaires (19 mai 1684) pour la punir d'avoir fourni des galères à l'Espagne.
À Ratisbonne (15 août 1684), une trêve est conclue entre l'empereur, l'Espagne et Louis XIV : le roi de France est l'arbitre de l'Europe. Non seulement il paraît capable d'imposer sa loi à tous les autres royaumes, mais il est un « modèle ».
La langue française est devenue la langue diplomatique. Versailles et sa Cour sont imités dans toute l'Europe.
Cette prééminence fait naître parmi les élites, puis parmi le peuple français, un sentiment de supériorité, d'impunité, même, qui va caractériser l'âme de la France.
En 1683, quand meurent l'épouse de Louis XIV, Marie-Thérèse, et Colbert, qui a été le bon ouvrier de l'absolutisme, Louis XIV est dans la plénitude de sa force. Il n'a que quarante-cinq ans.
Il est le Roi-Soleil.
28.
La mort, en 1683, a donc commencé à rôder dans les galeries du château de Versailles inachevé où le roi et sa Cour se sont installés.
Le soleil brille encore, mais il est froid comme dans un précoce automne qui annonce un hiver rigoureux.
L'absolutisme a sa logique. Il veut tout dominer : les grands, les humbles, les États étrangers. Comment accepterait-il qu'une minorité conserve ses croyances, continue de se rassembler autour de pasteurs formés en Angleterre, dans les Provinces-Unies, ces puissances ennemies du royaume, et à Genève ?
« Je crus au début, dit Louis XIV, que le meilleur moyen pour réduire peu à peu les huguenots de mon royaume était de ne les point presser du tout par quelques rigueurs nouvelles, de faire observer ce qu'ils avaient obtenu sous les règnes précédents, mais aussi de ne leur accorder rien de plus et d'en renfermer même l'exécution dans les plus étroites bornes que la justice et la bienséance le pouvaient permettre. »
Les intendants, dans les provinces, serrent le lacet, appliquent les édits qui restreignent ou interdisent le culte protestant. Les huguenots ne peuvent exercer certains métiers et n'ont pas l'accès à la maîtrise.
Une Caisse de conversion est créée pour les inciter à quitter la religion prétendument réformée et à rejoindre celle du roi, censée être celle de tous les sujets du royaume.
L'émigration est contrôlée.
Un édit royal – du 14 juillet 1682 – interdit aux sujets de quitter la France pour s'installer à l'étranger sans en avoir obtenu l'autorisation.
Parce qu'il est le plus centralisé, le plus administré d'Europe, le royaume de France esquisse avant tous les autres certaines des formes totalitaires de l'État.
On est condamné pour son être ou sa foi avec une rigueur qui devient peu à peu implacable, les rouages de l'État gagnant en efficacité et les édits royaux étant appliqués dans toutes les provinces.
Le seul fait d'être bohémien est ainsi un délit.
Les agents du roi doivent « faire arrêter tous ceux qui s'appellent bohémiens ou égyptiens, leurs femmes, enfants et autres de leur suite, faire attacher les hommes à la chaîne des forçats pour être conduits dans nos galères et y servir à perpétuité ; et à l'égard de leurs femmes et filles, ordonnons de les faire raser la première fois qu'elles auront été trouvées menant la vie de bohémienne, et de faire conduire, dans les hôpitaux les plus prochains des lieux, les enfants qui ne seront pas en état de servir dans nos galères, pour y être nourris et élevés comme les autres enfants qui y sont enfermés ».
Une ordonnance de 1684 décide que tous les déserteurs des troupes ne seront plus exécutés, « mais condamnés à avoir le nez et les oreilles coupés, à être marqués de deux fleurs de lis aux joues, et à être rasés et enchaînés pour être envoyés aux galères ».
L'âme de la France s'accoutume à cette violence étatique, à cette discrimination des individus en fonction non seulement de la faute commise, mais de leur qualité, de leur origine, de leur confession.
Cette mise à l'Index de certaines catégories de sujets, puis cette sélection en fonction de la « race », de la « foi », et la traque des « exclus », doivent se conclure par une peine dont l'exécution sert le royaume : la flotte royale a besoin de bras pour la chiourme de ses galères !
C'est aussi parce que le contrôle par l'État absolutiste veut s'étendre à tous les domaines, régenter les différentes activités du royaume, qu'est édictée en 1685 l'ordonnance coloniale, ou Code noir, « touchant la police des îles de l'Amérique ».
Il s'agit de définir les droits et devoirs des propriétaires d'esclaves dans les colonies françaises des Antilles : la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue.
La traite négrière transporte dans des conditions inhumaines des milliers d'Africains vers ces îles où les plantations de canne à sucre se sont étendues et où leur production donne naissance à un commerce fructueux, « triangulaire », entre l'Afrique, les îles et les ports de l'Atlantique (Bordeaux, Nantes).
Le Code noir reconnaît la légitimité de la traite, il fait des Africains des « biens meubles ».
L'État absolutiste devient ainsi le garant et le régent de l'esclavage, en même temps qu'il veille à rendre le baptême des esclaves obligatoire, leur interdisant toute autre religion, définissant juridiquement tout ce qui concerne l'État et la qualité d'esclave.
L'État absolutiste légifère, surveille, fait entrer l'esclavage dans les rouages juridiques – modernes – du royaume. La vie quotidienne des esclaves est réglementée. Quant à la justification de l'esclavage, elle est double : d'une part, elle exprime « le besoin indispensable qu'on a d'eux pour les cultures des sucres, des tabacs, des indigos » ; d'autre part, on leur apporte le salut « à raison de l'instruction chrétienne qu'on leur donne ».
Car l'État absolutiste a désormais explicitement comme l'un de ses buts majeurs de contraindre tous les sujets du royaume – et les esclaves eux-mêmes – à pratiquer la religion du roi.
Les huguenots ne sont plus seulement dépossédés de leurs droits, cantonnés, surveillés, ils sont désormais « forcés ».
La conversion des enfants de sept ans est autorisée.
Les intendants peuvent imposer une « garnison de gens de guerre » aux religionnaires réticents.
Ces « dragonnades », qui entraînent humiliations, déprédations et saccages, vols, violences, viols, morts, sont mises en œuvre avec zèle par les intendants. Dans le Poitou, Marillac aurait ainsi obtenu plus de 30 000 conversions. Convertir devient une manière, pour les agents du roi, de faire leur cour. Car Louis XIV, remarié secrètement à madame de Maintenon, pieuse et habile ambitieuse qui l'entoure de ses attentions, est désormais résolu à extirper l'hérésie.
La Cour est devenue dévote. Madame de Maintenon et le confesseur jésuite du monarque l'en félicitent.
« La conversion du roi est admirable, écrit madame de Maintenon, et les dames qui en paraissaient les plus éloignées ne partent plus de l'église... Les simples dimanches sont comme autrefois les jours de Pâques. »
Chaque jour, le roi se réjouit des listes de conversions qu'on lui envoie, qui ne relatent pas les scènes cruelles que provoquent les dragonnades ni les résistances qui déjà s'organisent dans les Cévennes.
Car le système absolutiste, en même temps qu'il accroît le contrôle et la domination de l'État sur tout le royaume, rend opaque la réalité.
Le souverain ne tolère plus qu'on échappe à l'État. « Il est de plus en plus jaloux et amoureux de gloire et d'autorité » (Saint-Simon), mais il ne connaît pas la situation réelle du royaume alors qu'ici et là, devant l'augmentation des taxes et des impôts, la misère s'aggrave, la disette reparaît et les communautés protestantes sont occupées par les dragons.
En fait, le roi ne veut pas voir.
Il veut à n'importe quel prix en finir avec « les obstinés religionnaires », ces « mauvais Français ».
Il décide donc, le 18 octobre 1685, par l'édit de Fontainebleau, la révocation de l'édit de Nantes, qui entraîne aussitôt l'exil de près de deux cent mille huguenots en Angleterre, dans les Provinces-Unies et au Brandebourg. Ils apportent à ces États leur savoir, leur esprit d'initiative, leur énergie, mais aussi leur haine envers celui qu'ils vont décrire comme le « souverain turc des chrétiens », et contre lequel ils vont contribuer à dresser toute l'Europe, inquiète de cette prépondérance française qui ne se reconnaît pour limites que celles qu'elle se donne elle-même.
Mais la révocation de l'édit de Nantes est approuvée dans le royaume de France. L'unité de la foi apparaît comme l'état naturel et indispensable de la monarchie.
Et Louis XIV, en conflit avec la papauté, jaloux de la victoire remportée par l'empereur Léopold et ses armées chrétiennes sur les 200 000 Turcs qui assiégeaient Vienne – bataille du Kalhenberg, le 12 septembre 1683 –, veut, avec la révocation, confirmer qu'il est bien le Roi Très-Chrétien.
Cette mesure absolutiste marque très profondément l'âme de la France.
L'unité religieuse autour du pouvoir royal – central – y est confirmée, renforcée. La puissance étatique doit l'imposer aux sujets réticents.
L'État est violence. Contre lui, on en vient à se dresser, à prendre les armes : ce que feront les huguenots dans les Cévennes. Et les paysans se rebellent contre les « percepteurs » d'impôts. C'est dire que l'âme de la France est aussi marquée par ces résistances.
Plus l'État est unifié, mieux il impose sa loi en tous domaines, plus il risque de susciter des oppositions, d'autant plus violentes qu'aucun espace de tolérance ne leur est ménagé.
Le royaume doit affronter non seulement ces risques d'insurrection intérieure – de guerre civile –, mais aussi ceux de guerre contre l'Europe coalisée, dressée contre Louis XIV, « souverain turc des chrétiens ».
Dans une dialectique équivalant à celle qui régit la vie intérieure du royaume – contrôle de plus en plus étendu de l'État, et résistances –, l'Europe est subjuguée par le royaume de France, fascinée par la majesté de Louis XIV, par sa puissance, sa Cour, Versailles, et en même temps décidée à se coaliser contre lui dans une guerre prolongée, si nécessaire.
Le maître d'œuvre de cette coalition est Guillaume d'Orange. Au terme d'une révolution (1688), il a chassé d'Angleterre le roi Jacques II Stuart, catholique, qui se réfugie en France. Il a reconnu les droits du Parlement anglais et s'est fait proclamer par lui roi d'Angleterre.
Deux « modèles » s'opposent ainsi en Europe : le français, continental, absolutiste, catholique, et l'anglais – lié aux Provinces-Unies –, antipapiste, s'appuyant sur une Déclaration des droits, instaurant une « monarchie » contrôlée.
La guerre entre les deux « modèles » paraît inéluctable.
L'empereur des princes allemands, l'Angleterre et les Provinces-Unies, mais aussi l'Espagne catholique, se rassemblent dans la ligue d'Augsbourg dès 1686.
Quant à Louis XIV, renforcé par le succès de sa révocation de l'édit de Nantes, sûr de sa puissance, il a une ambition plus grande encore : il est le « Nouveau Constantin » dont les courtisans chantent les mérites, que madame de Sévigné, La Fontaine et La Bruyère louent pour son action pieuse.
Il n'est que Vauban pour mesurer les conséquences négatives du départ de tant de talents huguenots à l'étranger alors même que le royaume est de plus en plus endetté, qu'au lieu d'investir leur fortune dans les activités manufacturières ou marchandes les riches préfèrent l'achat de terres, le prêt à intérêt, l'acquisition d'offices, les garanties offertes par un État absolutiste plutôt que les risques économiques.
Car les huguenots exilés étaient précisément ouverts sur l'économie moderne telle qu'elle se pratiquait aux Provinces-Unies et déjà en Angleterre.
Sur ce plan-là aussi, le « modèle français » s'oppose au « modèle anglo-hollandais ».
Louis XIV a une vision de la puissance et de la gloire qui s'accorde à ce goût de la terre, de la rente et de l'héritage qui caractérise les élites françaises.
Il revendique ainsi – au nom de sa belle-sœur, la princesse Palatine – le Palatinat.
Ses troupes entrent en Dauphiné pour y combattre les vaudois hérétiques.
Louis tente d'aider Jacques II à reconquérir son trône, mais le débarquement de troupes dans l'Irlande catholique se solde par un échec.
Reste donc la guerre continentale contre la ligue d'Augsbourg, conduite depuis 1686 mais déclarée le 15 avril 1689. Et marquée par l'impitoyable violence des troupes françaises, qui mettent le Palatinat à sac en 1688-1689 :
« Je vois le roi assez disposé à faire raser entièrement la ville et la citadelle de Mannheim, écrit Louvois, et, en ce cas, d'en faire détruire entièrement les habitations. »
On brûle « les villes que l'on ne peut forcer », on fait mettre « le feu dans les villages et leurs dépendances ».
La France apparaît ainsi au reste du continent comme une puissance menaçante et oppressive, persécutrice de ses propres sujets protestants, et les huguenots exilés – Pierre Bayle, Jurieu – décrivent les horreurs des dragonnades, la menace que Louis XIV fait peser sur l'Europe entière.
Ces années 1683-1689 sont bien le tournant du règne de Louis XIV. L'absolutisme s'y déploie et y dévoile sa violence.
Devenu dévot, en quête de toujours plus de gloire et d'autorité, le monarque commence aussi à être harcelé par la maladie – on procède à « la grande opération » d'une fistule le 18 novembre 1686. « Le roi a souffert aujourd'hui sept heures durant comme s'il avait été sur la roue », confie madame de Maintenon.
Louis XIV fait face à la douleur comme à l'Europe coalisée.
Mais on ne danse plus le ballet à Versailles.
29.
C'est la guerre. Elle écrase le dernier quart de siècle du règne de Louis XIV et marque de son empreinte profonde et cruelle l'âme de la France.
Le roi a voulu imposer aux États d'Europe la prépondérance française. Mais, malgré les victoires militaires – Fleurus en 1690, Steinkerke en 1692, Neerwinden en 1693 –, la suprématie navale de l'Angleterre (bataille de la Hougue, 1692) et la résistance des États obligent Louis XIV, aux traités de Turin et de Ryswick (1696, 1697), à renoncer à toutes ses conquêtes. Il ne conserve que Strasbourg. La leçon est nette : une nation ne peut dominer par la force le reste de l'Europe.
Et pourtant la guerre reprend dès 1701.
Le petit-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou, devient Philippe V, roi d'Espagne, sans renoncer pour autant à la couronne de France.
Les Français gouvernent à Madrid.
Une compagnie française se voit attribuer l'asiento, le privilège du transport des esclaves vers l'Amérique ; Philippe V et Louis XIV sont actionnaires de cette compagnie négrière.
Ce n'est plus seulement à un empire occidental que s'opposent l'Angleterre, la Hollande, les princes allemands. Au-delà de la question de la succession d'Espagne, la guerre a pour enjeu la domination économique, le grand commerce.
Aux traités d'Utrecht et de Rastadt (1713, 1714), Philippe V doit renoncer à la couronne de France.
L'Angleterre, puissance maritime, commence son ascension. Elle conserve Gibraltar. Elle a brisé l'empire continental qui risquait de se constituer entre Madrid et Paris ; elle s'apprête à contrôler les mers.
Deuxième leçon pour le royaume de France : les États – et d'abord l'Angleterre et les Provinces-Unies – n'acceptent pas le risque de voir un nouvel empire à l'image de celui de Charles Quint se reconstituer en Europe, cette fois au bénéfice de la France.
Ces deux leçons infligées à la France, Louis XIV, qui meurt le 1er septembre 1715, les a-t-il comprises, et ses successeurs les ont-ils retenues, ou, au contraire, voudront-ils poursuivre cette ambition d'une prépondérance française sur le continent ?
Pour le royaume de France – et pour le Grand Roi –, ces années de guerre ont été un long hiver au terme duquel les gains ont été nuls, les souffrances, immenses, les morts, nombreuses, les transformations de la monarchie, profondes.
Si l'on ajoute que les rapports avec les États européens ennemis ont été dominés par ces guerres, on mesure que ces vingt-cinq années ont été décisives pour le royaume et pour l'image que la France a donnée d'elle-même aux peuples d'Europe.
Elle est la nation militaire : plusieurs centaines de milliers d'hommes – de 200 à 400 000 – engagés dans ces guerres.
Elle est la nation guerrière : les défaites, nombreuses, n'ont pas découragé le royaume, les victoires – Denain en 1702 – ayant permis le redressement de la situation.
Elle est la nation brutale (le sac du Palatinat), impérieuse, aux ambitions démesurées, le royaume dont il faut se méfier parce qu'il est puissant, riche et peuplé.
L'âme de la France a enregistré en elle-même ces éléments contradictoires qui ont été à l'œuvre durant ce quart de siècle français (1689-1715).
Et d'abord le coût de la guerre.
Le problème financier est bien la maladie endémique du royaume. L'endettement, l'emprunt, la manipulation des monnaies, l'augmentation des impôts, sont les caractéristiques permanentes des finances de la France.
Pour tenter de colmater le déficit, on multiplie les créations d'offices : vendeurs de bestiaux ou emballeurs, experts jurés, procureurs du roi, contrôleurs aux empilements de bois, visiteurs de beurre frais, visiteurs de beurre salé, etc.
L'argent rentre, mais la société française se fragmente en milliers d'officiers héréditaires.
Les fonctions de maire et de syndic sont mises en vente. Un édit de 1695 décide de l'anoblissement, moyennant finance, de 500 personnes distinguées du royaume.
On crée des « billets de monnaie », et le contrôleur général des finances, Chamillart, écrit à Louis XIV, faisant le bilan de cette introduction du « papier-monnaie » : « Toutes les ressources étant épuisées (en 1701), je proposai à Votre Majesté l'introduction de billets de monnaie non pas comme un grand soulagement, mais comme un mal nécessaire. Je pris la liberté de dire à Votre Majesté qu'il deviendrait irrémédiable, si la guerre obligeait d'en faire un si grand nombre, que le papier prît le dessus de l'argent. Ce que j'avais prévu est arrivé, le désordre qu'ils ont produit est extrême. »
Sur une idée de Vauban, on crée un impôt de capitation qui devrait être payé par tous (1694), puis ce sera l'impôt du dixième (1710).
Ces mesures – qui ne résolvent en rien la crise financière – permettent de payer la guerre, mais appauvrissent le pays, et, conjuguées à des hivers rigoureux, à des printemps pluvieux, aggravent en 1693-1694, puis en 1709 – le grand hiver –, la crise des subsistances, la disette, la famine.
Ainsi s'installe dans l'âme française le sentiment que l'État est un prédateur, que l'inégalité s'accroît, qu'elle s'inscrit définitivement dans ces « statuts » d'officiers qui ont le droit de transmettre leurs charges.
Les « réformateurs » comme Vauban (dans son ouvrage Projet d'une dîme royale) ou Boisguilbert (dans Le Détail de la France, ou Traité de la cause de la diminution de ses biens et des moyens d'y remédier) ont le sentiment qu'ils ne sont pas entendus quand l'un propose un impôt levé sur tous les revenus sans aucune exception, et quand l'autre, condamnant la « rente », l'usure, les ventes d'offices, affirme que « la richesse d'un royaume consiste en son terroir et en son commerce ».
En fait, le cancer du déséquilibre des finances s'installe et commence à ronger l'État, la confiance qu'on lui porte, à désagréger la société et à rendre quasi impossibles les réformes.
Pour trouver des ressources, l'État crée des cohortes d'officiers en leur vendant des parcelles de son autorité, en leur concédant des privilèges qui ne pourront être annulés sans épreuve de force.
Or le privilège est le cœur même du principe social sur lequel s'est bâtie la monarchie, société d'ordres.
Et voici que la noblesse elle-même est mise en vente !
D'un côté, on domestique les grands et les nobles ; de l'autre, on multiplie leur nombre, on vend les privilèges afférents à cet ordre, qui en font un obstacle à la réforme !
Certes, il y a la gloire du monarque, que la guerre accroît. Et son historiographe, Racine, s'enthousiasme quand, en 1692, il assiste à une revue de 120 000 hommes, « ce plus grand spectacle qu'on ait vu depuis plusieurs siècles... Je ne me souviens point que les Romains en aient vu un tel ».
Boileau n'est pas en reste, qui exalte la présence du roi au siège de Namur (1692) et la capitulation de la ville, que César lui-même n'avait pas obtenue.
Louis XIV est bel et bien le Roi-Soleil :
À cet astre redoutable
Toujours un sort favorable
S'attache dans les combats
Et toujours avec la Gloire
Mars amenant la Victoire
Vole et le suit à grands pas.
Par cette propagande, célébration de la gloire militaire du monarque, le pouvoir absolutiste cherche à se consolider, à justifier la guerre.
Dans le même temps, les exigences nées du conflit le conduisent à accroître le contrôle des activités. La guerre impose une concentration des pouvoirs. Elle entraîne non seulement un perfectionnement technique de l'armée – fusil, baïonnette, artillerie –, mais aussi une rationalisation de toute la vie civile.
Colbert crée ainsi des administrations nouvelles, des bureaux des hypothèques. Un Conseil du commerce est mis en place. Dans chaque ville – comme cela s'est fait à Paris dès 1667 – son nommés des lieutenants de police.
Car la guerre entraîne un renforcement de la surveillance. Le courrier, et d'abord celui des courtisans, est surveillé, lu.
« C'est une misère, la façon dont on agit avec les lettres », écrit la princesse Palatine, belle-sœur du roi et grande épistolière.
De même, la répression exercée contre tous ceux qui tentent de se dresser contre l'autorité royale ou de lui échapper est implacable.
C'est l'armée du maréchal de Villars qui fait la guerre aux camisards des Cévennes, ces huguenots que commande Jean Cavalier.
Des gentilshommes traquent les jeunes paysans qui cherchent à éviter l'enrôlement dans la milice royale.
L'armée a besoin d'hommes, et ce service militaire obligatoire avec tirage au sort permettra de lever, entre 1705 et 1713, 455 000 hommes !
« La jeunesse épouvantée allait se cacher dans les réduits les plus écartés et parmi les plus grandes forêts », note un témoin, « ou bien ils cherchaient à se marier afin d'échapper à la Milice, mais certains vautours, à qui l'on donnait le nom odieux de vendeurs de chair humaine, les enlevaient jusque dans le sein de leurs familles pour les traîner au champ de Mars, servir à émousser les épées anglaises et germaniques ».
Cette « militarisation » de la société, qui est une des conséquences de l'absolutisme et un produit de la guerre, suscite la méfiance envers l'État, et la situation dramatique du royaume, à partir des années 1690, fait naître de nombreuses critiques qui mettent en cause – c'est un signe de la profondeur de la crise – la personnalité même du souverain.
Fénelon, archevêque de Cambrai, ose écrire à Louis XIV, roi désormais dévot :
« Vous n'aimez pas Dieu, vous ne le craignez même que d'une crainte d'esclave, votre religion ne consiste qu'en superstition et en pratique superficielle. »
Ce propos violent complète une Lettre anonyme à Louis XIV qui est une critique radicale de l'absolutisme et de la politique suivie.
« On n'a plus parlé de l'État et de ses règles, on n'a plus parlé que du Roi et de ses plaisirs », souligne Fénelon.
L'une des manifestations de cette évolution absolutiste est la guerre.
« On a causé depuis plus de vingt ans des guerres sanglantes..., la guerre de Hollande (1672-1678) a été la source de toutes les autres. Elle n'a eu pour fondement qu'un motif de gloire et de vengeance, ce qui ne peut jamais rendre une guerre juste. »
Et la conséquence en est que « la France entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provisions. Les magistrats sont avilis et épuisés. La noblesse, dont tout le bien est en décret, ne vit que de lettres d'État... Le peuple même qui vous a tant aimé commence à perdre l'amitié, la confiance et même le respect. Vos victoires et vos conquêtes ne le réjouissent plus, il est plein d'aigreur et de désespoir. La sédition s'allume un peu de toutes parts... Voilà, Sire, l'état où vous êtes. Vous vivez comme ayant un bandeau fatal sur les yeux. »
On est loin des louanges de Racine et de Boileau !
En 1709, la misère empoigne tout le royaume. Nicolas Desmarets, contrôleur général, note la « mauvaise disposition des esprits et des peuples ».
Il souligne que des mouvements de révolte ont lieu ici et là dans les provinces où la hausse du prix du blé – consécutive à de mauvaises récoltes – provoque la disette, la famine ; et où les fermiers généraux ne réussissent plus à lever l'impôt et n'ont plus aucun crédit : ne parvenant plus à emprunter, ils ne prêtent plus et n'avancent plus le montant des impôts.
La dégradation de la situation (levée forcée de soldats, misère, etc.) conduit à cette montée des critiques.
On mesure ainsi qu'en dépit des renforcements continus de l'absolutisme, du développement de la coercition, de la réglementation, de la centralisation, du culte du roi, l'âme de la France est encore capable de se rebiffer.
Sous la chape de l'absolutisme, le pays – du peuple aux aristocrates – conteste ce mode de gouvernement, et les oppositions se raniment aussitôt. On n'accepte et subit l'absolutisme que parce que l'État exerce avec violence son autorité, mais cela ne vaut que si sa politique est favorable aux intérêts de la nation et à la prospérité de son peuple.
Que les résultats soient mauvais, que l'inégalité s'aggrave, et l'esprit de critique et de sédition reparaît. Contre l'absolutisme, on dresse le souvenir des états généraux, du gouvernement des princes, de l'aristocratie, des cours souveraines.
Le roi se retrouve ainsi isolé. Et il n'a pour toute ressource que de faire appel au « patriotisme » de la nation afin qu'elle se rassemble autour de lui, non plus dans un mouvement imposé par la répression, les édits, mais dans un mouvement d'adhésion nationale.
C'est ainsi que, le 12 juin 1709, dans l'abîme qu'est cet hiver de glace et de misère, de défaites et de doutes, Louis XIV adresse un Appel à ses évêques et à ses gouverneurs afin qu'ils le diffusent dans toutes les paroisses du royaume.
Louis XIV se dépouille de son autorité de souverain absolu.
Il ne dit plus : « Tel est mon bon plaisir. » En s'adressant à ses sujets, en leur expliquant les raisons de ses choix politiques, il les élève à la dignité d'interlocuteurs habilités à comprendre, à approuver, et donc aussi à discuter et à contester.
Louis XIV explique pourquoi il n'a pas pu conclure la paix : « Quoique ma tendresse pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j'ai pour mes propres enfants, quoique je partage tous les maux que la guerre fait souffrir à des sujets aussi fidèles, et que j'aie fait voir à toute l'Europe que je désirais sincèrement de les faire jouir de la paix, je suis persuadé qu'ils s'opposeraient eux-mêmes à la recevoir à des conditions également contraires à la justice et à l'honneur du nom français. »
L'intérêt dynastique devient là, simplement, le visage de l'intérêt national, la gloire et l'honneur du roi ne sont que l'expression de la « justice et de l'honneur du nom français ».
Face à l'échec de la politique de Louis XIV, cet appel royal, au cœur de la détresse qui frappe le royaume, exprime la force et la réalité de la conscience nationale. Mais cet appel confirme dans l'âme française que le roi n'est un souverain pleinement légitime que par la politique qu'il mène, et qu'en dernier ressort c'est le peuple qui l'adoube, qui lui accorde le second sacre déterminant la valeur du premier.
La contestation de l'absolutisme, l'importance du peuple, la permanence des « ordres » traditionnels du royaume, refont ainsi irruption au bout de près d'un demi-siècle – depuis 1661 – de monarchie absolutiste.
L'appel de Louis XIV au patriotisme est entendu.
La foule attend devant les imprimeries le texte du roi.
On l'approuve de ne pas avoir accepté de contribuer par les armes, comme le demandaient les puissances en guerre, à chasser son propre petit-fils, Philippe V, du trône d'Espagne.
Le maréchal de Villars lit l'appel aux troupes, qui l'acclament. Et le 11 septembre 1709, à Malplaquet, au terme d'une bataille sanglante, incertaine, s'il n'est pas victorieux de Marlborough et du prince Eugène de Savoie, il arrête l'avance ennemie.
Puis, le 24 juillet 1712, à Denain, il bat le prince Eugène.
Les alliés doivent alors se convaincre qu'ils ne pourront pas écraser la France et qu'il vaut mieux traiter, d'autant plus que l'Angleterre et les Provinces-Unies ne veulent pas que l'Empire germanique profite de la défaite française.
Dès lors que Philippe V renonce à la couronne de France, la paix est possible.
Les traités d'Utrecht et de Rastaadt la rétabliront en 1713 et 1714.
Mais le royaume et la dynastie sont affaiblis.
« Sire, vous le savez, écrit dans une lettre anonyme Saint-Simon, votre royaume n'a plus de ressources... Jetez, Sire, les yeux sur les trois états qui forment le corps de votre nation... Le clergé est tombé dans une abjection de pédanterie et de crasse qui l'a tout à fait enfoncé dans un profond oubli... La noblesse n'est pas plus heureuse... Ce n'est plus qu'une bête morte, qu'un mari insipide, qu'une foule séparée, dissipée, imbécile, impuissante, incapable de tout et qui n'est plus propre qu'à souffrir sans résistance... Le tiers état, infiniment élevé dans quelques particuliers qui ont fait leur fortune par le ministère ou par d'autres voies, est tombé en général dans le même néant que les deux premiers corps. »
Certes, la description de Saint-Simon est en fait un plaidoyer en faveur d'un gouvernement aristocratique.
« Que Votre Majesté règne enfin par elle-même », dit-il, contestant l'action des ministres, de l'épouse, madame de Maintenon, ou du confesseur jésuite, et rêvant à des princes entourant le roi.
Mais, au-delà de cette limite, c'est la succession de Louis XIV elle-même qui semble menacée.
La mort a frappé comme à grands coups de hache.
En 1711, le Grand Dauphin, fils de Louis XIV, est mort.
Puis, en 1712, le duc et la duchesse de Bourgogne (le petit-fils de Louis XIV et son épouse).
En 1712 encore, le duc de Bretagne, arrière-petit-fils aîné de Louis XIV, et, en 1714, Charles, duc de Berry, petit-fils du roi et frère de Philippe V d'Espagne – autre petit-fils de Louis XIV –, mais qui a renoncé à la couronne de France.
Ne survit donc qu'un arrière-petit-fils, le duc d'Anjou, d'à peine cinq ans et demi en 1715.
Le régent serait le neveu de Louis XIV, Philippe d'Orléans, fils du frère du roi et de la princesse Palatine.
Mais la défiance de Louis XIV est grande envers lui, qu'à la Cour on a même soupçonné d'avoir fait empoisonner les membres de la famille royale afin d'accéder au trône.
Louis XIV a d'ailleurs créé un conseil de régence afin de contrôler Philippe d'Orléans, qui en assurera cependant la présidence.
Le 1er septembre 1715 à 8 h 15, Louis XIV meurt au château de Versailles à l'âge de soixante-dix-sept ans.
Il était monté sur le trône soixante-douze ans auparavant et avait régné personnellement cinquante-quatre ans.
À sa mort, c'est à nouveau un enfant – Louis XV – qui accède au trône.
L'absolutisme survivra-t-il à la régence de Philippe d'Orléans, prince libertin ?
CHRONOLOGIE II
Vingt dates clés (1515-1715)
1515 : Victoire de Marignan, remportée par François Ier (1515-1547) sur les Suisses alliés du duc de Milan
1519 : Début de la construction du château de Chambord
1522 : Début de la première guerre contre Charles Quint
1539 : Ordonnance de Villers-Cotterêts – tous les actes officiels doivent être rédigés en français
1562 : Première guerre de Religion
1572 : Massacre de la Saint-Barthélemy (24 août)
1593 : Abjuration de Henri IV à Saint-Denis
1598 : Édit de Nantes
1624 : Richelieu, Premier ministre de Louis XIII (1610-1643)
1643 : Mort de Louis XIII et de Richelieu ; Régence d'Anne d'Autriche
1648 : Traité de Westphalie
1649 : Fuite du roi Louis XIV, onze ans, de Mazarin et d'Anne d'Autriche, de Paris à Saint-Germain
1661 : Mort de Mazarin, gouvernement personnel de Louis XIV
1682 : Le roi s'installe à Versailles
1684 : Mariage secret de Louis XIV et de madame de Maintenon
1685 : Révocation de l'édit de Nantes
1685 : Code noir sur l'esclavage
1701 -1714 : Guerre de Succession d'Espagne
1709 : L'année terrible – défaite, froid, famine
1715 : Mort de Louis XIV
LIVRE III
L'ÉCLAT DES LUMIÈRES – L'IMPOSSIBLE RÉFORME
ET LA RÉVOLUTION ARMÉE
1715-1799
1
LOUIS XV
Le vent se lève
1715-1774
30.
1715 : on entre dans un nouveau siècle.
C'est le temps des salons parisiens et non plus celui de la chapelle et des confessionnaux de Versailles.
On loue en Louis XIV « cette fermeté d'âme, cette égalité extérieure, cette espérance contre toute espérance, par courage, par sagesse et non par aveuglement », mais, après avoir ainsi salué le monarque défunt, édenté et dévot, Saint-Simon, l'ami et porte-parole du Régent Philippe d'Orléans, le pousse à rompre et à oublier le vieux roi qui s'était prolongé en ce xviiie siècle et qu'on ne supportait plus.
On veut participer aux fêtes du Régent, pétillantes et libertines.
On veut tomber le masque. On rejette les bigoteries et les jésuites.
Les élites françaises – princes du sang, haute noblesse – désirent à la fois retrouver leur pouvoir et leur influence, contenus par l'absolutisme de Louis XIV, et se mêler aux beaux esprits, aux jeux de l'amour et de la pensée.
En 1715, Marivaux a déjà vingt-sept ans, Montesquieu, vingt-six, Voltaire, vingt et un.
Philippe d'Orléans, homme de tous les talents, brillant et beau, libertin mais conscient de ses devoirs, incarne cette dizaine d'années de régence. Il meurt en 1723, l'année de la majorité de Louis XV, et le duc de Bourbon lui succède jusqu'en 1726 – cette année-là, le roi, assisté du cardinal Fleury, gouverne.
La décennie de la Régence est, après le long hiver du Grand Roi, une période de retournement et de créativité qui marque l'âme et la mémoire de la France.
Louis XIV a tenté de prolonger son règne au-delà de sa propre mort. Le conseil de régence doit tenir en tutelle ce neveu, Philippe d'Orléans, dont il s'est toujours méfié : trop beau, trop talentueux, donc trop ambitieux, trop dangereux pour un monarque absolutiste.
Avant de mourir, Louis XIV a fait de ses deux bâtards légitimés – les fils de madame de Montespan –, le duc du Maine et le comte de Toulouse, des princes du sang ayant le droit de succéder à leur père. Pis : le duc du Maine a été désigné par Louis XIV pour prendre en main l'éducation de Louis XV.
Le Régent veut le pouvoir. Il fait casser le testament de Louis XIV par le parlement de Paris, auquel il rend en échange son droit de remontrance ; il fait de même pour toutes les cours souveraines.
Ainsi les parlementaires, écartés du jeu par la monarchie absolutiste, retrouvent-ils leur pouvoir de contrôle, de contestation, d'opposition.
Défaite posthume de Louis XIV et de la volonté absolutiste qui, depuis la dernière convocation des états généraux, en 1614 – il y a alors un siècle –, l'avait emporté. Le Parlement et les cours souveraines se présentent à nouveau comme le « corps » de la nation.
Imposture, puisque les parlementaires sont propriétaires de leurs charges héréditaires, qu'ils représentent un groupe social puissant qui peut certes s'attribuer le rôle de « défenseur » du peuple, mais qui est partie prenante dans la caste des privilégiés. Cependant, en réintroduisant les parlements dans le jeu politique comme acteurs influents, le Régent veut aussi faire contrepoids aux princes, à la haute noblesse, à laquelle – dans sa lutte contre les bâtards de Louis XIV – il a sacrifié le gouvernement ministériel, celui de « la vile bourgeoisie », instrument de l'absolutisme royal.
Durant trois années (1715-1718), huit Conseils – de conscience, des finances, de justice, etc. – peuplés par la haute noblesse gouvernent en lieu et place des descendants des familles ministérielles, les Colbert, les Louvois, les Pontchartrain, etc.
Cette « polysynodie » est une réaction aristocratique à la pratique de Louis XIV. Elle tente de mettre sur pied un autre mode de gouvernement, mais l'incompétence, la futilité de cette haute noblesse, ses rivalités, tout comme le désir du Régent de gouverner lui-même, mettent fin à cette expérience qui avait aussi un but tactique : permettre à Philippe d'Orléans de s'imposer en rassemblant autour de lui les princes contre les bâtards de Louis XIV et contre les parlementaires, auxquels on a rendu leurs pouvoirs.
Cet exercice d'équilibre, qui se termine par la création de secrétariats à la Guerre, aux Affaires étrangères (pour le cardinal Dubois), donc par un retour du gouvernement ministériel, n'en a pas moins fissuré l'absolutisme.
On mesure même, à cette occasion, combien les élites françaises sont divisées, le pouvoir, fragmenté, les ambitions de chaque « clan », contradictoires.
Les risques d'éclatement du groupe social des élites ne sont pas encore perçus. Et cependant, en 1721, paraissent les Lettres persanes de Montesquieu. En 1720, Marivaux, sur le modèle anglais du Spectator, lance un périodique, Le Spectateur français.
Ainsi, une « opinion » souvent critique – prenant modèle sur ce qui se passe à Amsterdam, à Londres – commence d'apparaître. Elle est influente dans les salons. Elle attire telle ou telle personnalité de la haute noblesse, du Parlement.
En face d'elle, le pouvoir est hésitant.
Voltaire a déjà connu la Bastille en 1717. Mais, à sa sortie, ses premières œuvres lui ont valu la notoriété. Ses pièces sont jouées en 1725 lors du mariage du roi avec Marie Leszczynska, fille du roi de Pologne détrôné. Une épigramme contre le Régent le renvoie à la Bastille. En 1726, il s'exilera en Angleterre au terme d'une querelle avec le chevalier de Rohan qui l'a fait bâtonner, refusant de se battre en duel avec un homme qui « n'a même pas de nom ». Et Voltaire a répondu, comme s'il pressentait l'avenir : « Mon nom je le commence, vous finissez le vôtre ! »
Épisode symbolique illustrant comment, sous l'apparence d'un système politique et social qui est l'ordre naturel et sacré du monde, des ferments de division prolifèrent.
Et si les « idées nouvelles » – les « Lumières », dira-t-on bientôt – sont acceptées, c'est que le royaume continue d'être rongé par la « maladie » financière, l'endettement, la recherche haletante de revenus, l'anticipation des recettes pour faire face aux dépenses courantes, à l'impossibilité de prélever de nouveaux impôts.
Naturellement, le regain de pouvoir des parlements et de la haute noblesse réduit encore les marges de manœuvre de la monarchie.
Comment faire payer les privilégiés qui sont le socle du système social et le symbole même de la société d'ordres ?
Ce dilemme, la Régence essaie de le contourner, à défaut de le résoudre.
La fondation en 1716 par l'Écossais John Law d'une Banque générale est le point de départ de cette tentative.
Il s'agit de créer des billets circulant rapidement, en nombre suffisant pour impulser la croissance économique, favoriser le grand commerce maritime et, sinon remplacer, en tout cas entamer le monopole des « espèces sonnantes et trébuchantes », or ou argent, dont la frappe est limitée.
Ce modèle de banque – devenue Banque royale – est emprunté à la Hollande et à l'Angleterre, qui ont créé leurs propres banques respectivement dès 1609 et 1694.
C'est aussi sur les modèles anglais et hollandais que Law fonde en 1717 la Compagnie d'Occident, devenue Compagnie française des Indes.
Ces premières initiatives sont un succès.
Elles permettent, par le jeu de la valeur des billets, des taux d'intérêt, de réduire les endettements – ce qui ruine certains prêteurs. Elles facilitent les investissements, donnent une impulsion aux manufactures et à l'artisanat de luxe favorisés par le grand commerce.
Mais cette économie et cette finance nouvelles se heurtent à la réalité du modèle français.
Law propose une circulation rapide de la monnaie et la prépondérance du commerce dans un royaume où la fortune est foncière, liée à la rente, aux revenus que l'on tire de son statut, de son office, au rôle que l'on joue dans le prêt d'argent à l'État.
Or, en 1719, Law se fait attribuer la Ferme générale – la levée des impôts –, puis, en 1720, il devient contrôleur général des finances.
Cette rencontre entre fonctions liées à l'État et nouvelle économie et nouvelle finance suscite des inquiétudes parmi les princes, prêteurs habituels. Ils retirent leur or de la Banque, la valeur du papier s'effondre, la Bourse de la rue Quincampoix ferme.
Le système novateur a fait faillite. Il s'est brisé contre la structure traditionnelle de la finance dans le royaume. Et aussi sur la rapacité des grands, qui se sont enrichis dans cette spéculation sur le « papier-monnaie », entraînant, par leur volonté de sauver leurs gains en or, le naufrage de la Banque.
Les conséquences de la « banqueroute » de Law vont s'inscrire dans la longue durée de la mémoire nationale.
La défiance à l'égard de l'État, des « élites » qui se sont enrichies, des affaires d'argent, en est renforcée.
Elle se double d'un rejet du « papier-monnaie », d'un attachement aux pièces d'or ou d'argent – la livre-tournoi, dont le cours est stabilisé en 1726 et le restera pour près de deux siècles.
La conviction s'enracine dans l'âme des Français que les « rentes » d'État ou les fermages, l'achat de terres ou d'immeubles, sont les seuls moyens de protéger sa fortune.
Ainsi, le « modèle » marchand et l'aventure coloniale tels que les pratiquent les Hollandais et les Anglais n'entraîneront jamais la totalité des élites françaises dans un projet commun.
Certes, l'économie, grâce à la circulation des billets de John Law, a été fouettée, le commerce du sucre, la traite négrière, se sont développés, de même que les villes portuaires : Bordeaux, Nantes, Lorient, et aussi, pour le commerce avec le Levant, Marseille. Mais le « système » – rente, usure, propriété foncière, achat d'« offices » – n'est pas modifié en profondeur.
Quant à la crise financière, elle n'est pas réglée.
La tentative du duc de Bourbon, principal ministre après la mort du duc d'Orléans en 1723, de créer un impôt du cinquantième – sur les revenus de tous les propriétaires – est rapidement abandonnée.
La monarchie se révèle capable de formuler le diagnostic de sa maladie financière, mais est impuissante à appliquer les thérapies qu'elle élabore.
Le mal et les remèdes sont identifiés, connus ; mais le régime est incapable d'entreprendre l'opération qui permettrait d'extirper la tumeur.
D'autant que le pouvoir des parlementaires rend encore plus difficile l'action du roi.
Cependant, une partie des élites – dans le gouvernement (ainsi le cardinal Dubois, chargé des Affaires étrangères jusqu'à sa mort en 1723) mais aussi dans les mondes juridique et littéraire – regarde les modèles anglais et hollandais avec attention, persuadée qu'il y a là une voie nouvelle pour l'organisation sociale et politique, économique et financière.
C'est une des raisons qui expliquent le « retournement » de la politique extérieure du royaume.
On s'allie avec l'Angleterre et la Hollande, puis avec le Habsbourg de Vienne (1717-1718), et l'on renonce ainsi au rôle d'arbitre ou à une posture impériale en Europe, au bénéfice d'une pacification des rapports avec la puissance britannique, différente mais alors en plein essor.
Et on n'hésite pas, en 1719, à faire la guerre à l'Espagne où continue de régner le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, pour lui imposer de se joindre à l'accord passé avec Londres !
L'Angleterre est la référence et en même temps la vraie rivale.
Ruiné par la banqueroute de Law, Marivaux imite les Anglais quand il veut créer un périodique.
Et Voltaire, sortant de la Bastille, s'exile outre-Manche en 1726.
Louis XV, qui, cette année-là, décide de gouverner avec son précepteur, le cardinal de Fleury, n'a encore que seize ans.
Va-t-il, peut-il saisir l'avantage que lui donne la perspective d'un long règne ?
31.
Le temps n'a pas manqué à Louis XV.
Lorsque le cardinal de Fleury, son ancien précepteur devenu en 1726 son principal ministre, meurt en 1743 à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, le roi n'en a que trente-trois.
Il règne sur un royaume taraudé par une crise financière permanente, mais qui connaît un vif essor économique.
Fleury a gouverné prudemment. Des guerres, certes, mais qui n'épuisent pas le pays. Les blés sont abondants. Le grand commerce, actif. Les foires, prospères. L'administration du royaume – intendants, subdélégués, gouverneurs –, efficace. On trace des routes. On enquête pour connaître la réalité des fortunes, des récoltes, des revenus, le nombre des habitants. On en dénombre une vingtaine de millions, soit la population la plus importante d'Europe.
Certes, les inégalités s'accroissent entre fermiers, coqs de village et manouvriers. Mais chacun se souvient du pire qu'ont connu ses aïeux : disette, famine, épidémies, peste, guerres civiles, soldatesque répandue comme une vermine sur les campagnes.
L'ordre règne. L'armée est réorganisée. On crée des écoles militaires. On ouvre des classes pour apprendre à lire aux fils de paysans. La misère s'éloigne un peu des masures.
On sait que le monarque est jeune, beau, séducteur, conquérant. À Paris, on connaît le nom de ses maîtresses, nombreuses, titrées, comtesses, duchesses ou marquises : la Pompadour, la Du Barry. Mais au royaume de France on ne juge pas un roi sur ses fréquentations d'alcôve.
Le sacre en fait un être distingué par Dieu, homme au-dessus des autres humains.
Les conseillers, ses ministres, ses maîtresses, ses confesseurs, peuvent le tromper, lui faire commettre des erreurs. Mais lui est sacré. On prie pour son salut, afin que Dieu l'éclaire dans les choix qu'il doit faire pour ses sujets.
Quand, en 1744, il tombe malade à Metz, les églises se remplissent. Il faut sauver Louis le Bien-Aimé.
Mais, treize ans plus tard, quand, dans les jardins du château de Versailles, un domestique, Robert François Damiens, frappera le roi d'un coup de canif, l'écorchant à peine, on ne relèvera aucune émotion dans le royaume, plutôt une indifférence méprisante. Et presque de la pitié et de l'indulgence pour ce Damiens qu'on va rouer, cisailler aux aines et aux aisselles pour faciliter l'écartèlement par quatre chevaux attelés à ses membres.
Au mitan du xviiie siècle, dans les années 1740-1760, quelque chose de décisif s'est donc produit dans le rapport du peuple et de son roi.
Le monarque et l'institution monarchique paraissent désacralisés.
Dans la constitution et l'évolution de l'âme de la France, ce tournant est capital.
Il s'agit en fait d'une véritable révolution intellectuelle.
Les esprits de ceux qui pensent, écrivent, publient, font jouer leurs pièces sur les scènes des théâtres, lisent leurs œuvres dans les salons parisiens, entretiennent une correspondance quotidienne avec Londres ou Berlin, ont échappé à la monarchie absolue.
Ils portent un regard différent sur le monde.
La raison plus que la foi guide leur pensée. Ils décrivent, ils analysent. Ils sont écoutés, applaudis.
Face à ce mouvement des idées, à ces Lumières qui se répandent, la monarchie est hésitante.
Ces esprits indépendants n'appellent pas à la révolte. Cette fronde intellectuelle ne fait pas tirer le canon sur les troupes royales. Ces « philosophes » – puisque c'est ainsi qu'on les nomme – fréquentent les salons, sont accueillis à la Cour, courtisés et protégés par les aristocrates.
Mais cette révolution dans les esprits sape les fondements de la monarchie absolue.
Marivaux, Voltaire (les Lettres philosophiques en 1734, Zadig en 1747, l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations en 1757, année de Damiens, le régicide), Rousseau, qui, lui, s'avance au nom de l'égalité et ébranle ainsi les bases sociales du système monarchique, font triompher l'esprit laïque.
Quand, en 1752, Voltaire publie Le Siècle de Louis XIV, il jauge le règne avec une indépendance d'esprit qui, par-delà les jugements qu'il porte sur la période, sont un acte révolutionnaire.
Et la parution en 1751 du premier tome de l'Encyclopédie, qui s'approprie tous les domaines pour les reconstruire hors de la « superstition », a la même signification.
Que faire avec ces philosophes ?
En 1749, Diderot a été emprisonné à Vincennes. En 1752, un arrêt du Conseil annule l'autorisation de paraître des deux premiers volumes de l'Encyclopédie.
Mais, outre que les philosophes bénéficient de la protection de membres influents de la Cour (madame de Pompadour), chaque mesure prise à leur encontre les renforce en attirant l'attention sur leurs discours. Un « parti philosophique » se constitue ainsi, vers les années 1750, autour de l'Encyclopédie, de Voltaire, de Diderot et de d'Alembert.
Il devient un acteur déterminant de l'évolution du royaume. Sa vigueur, sa créativité et sa diversité en font un des éléments constitutifs de l'âme de la France.
Pour la première fois dans l'histoire nationale, un pouvoir « intellectuel » se crée hors des institutions – la Cour, l'Église, les parlements, etc. –, transcendant les ordres, les classes – noblesse, clergé, tiers état –, et fait face à celui de la monarchie.
Avec De l'esprit des lois, Montesquieu lui confère en 1748 une dimension politique en mettant l'accent sur le risque de dérive despotique de la monarchie absolue.
Il souligne que la seule manière de l'empêcher est de dresser contre le pouvoir un autre pouvoir. Ce « contre-pouvoir », les corps intermédiaires en sont l'expression.
Ainsi se dessine une caractéristique majeure de l'histoire française : le parti philosophique devient un pouvoir intellectuel qui intervient dans l'arène politique.
Ces philosophes, ces écrivains transmettent l'exemple d'une monarchie contrôlée telle qu'elle existe en Angleterre. Voltaire est le propagateur de ce modèle. Rousseau s'interroge sur l'origine de l'inégalité. L'Encyclopédie – dont le pouvoir se voit contraint de tolérer la diffusion – examine dans un esprit laïque tous les sujets.
La diffusion de cet « esprit des Lumières » imprègne toutes les élites.
Le débat intellectuel, la polémique, deviennent un des traits significatifs de la vie parisienne, des théâtres aux salons.
On discute, on conteste. Plus rien ne va de soi.
Une idéologie nouvelle aux multiples nuances se constitue. Les divergences et les polémiques qui la caractérisent – entre Voltaire et Rousseau, il y a un fossé – n'empêchent pas qu'elle porte une critique radicale de la monarchie absolue et qu'elle exprime, avec Montesquieu, un « libéralisme » politique, une idée de l'équilibre et de la limitation des pouvoirs qui s'inscrit à contre-courant de l'évolution du régime en place.
Cette influence des « philosophes » au cœur du xviiie siècle donne ainsi naissance à une spécificité nationale, à une orientation singulière de l'âme de la France.
Le parti philosophique pèse d'autant plus que sa contestation de la monarchie absolue rencontre celle que, pour des raisons différentes, conduisent les parlementaires.
Ces privilégiés auxquels le Régent a rendu leur pouvoir de remontrance contestent la plupart des décisions de la monarchie.
Quel que soit le sujet – création d'un impôt du vingtième sur tous les revenus (1749) ou bien problèmes posés au clergé français par la bulle pontificale Unigenitus –, les parlementaires se dressent contre le pouvoir royal en affirmant qu'ils représentent les corps intermédiaires, là où se conjoignent l'autorité souveraine et la confiance des sujets. Qu'en somme rien ne peut se faire sans leur approbation.
Les « lits de justice » – ces manifestations de l'autorité royale censées imposer sa décision – sont inopérants.
Les parlementaires se mettent en grève. Le pouvoir les exile hors de Paris, à Pontoise en 1752. Mais les cours souveraines de province relaient le parlement de Paris empêché.
Contre les évêques décidés à suivre le pape et donc à reconnaître l'autorité de la bulle Unigenitus contre les jansénistes, les « convulsionnaires », les parlementaires se présentent comme les défenseurs des traditions gallicanes, alors que le roi choisit pour sa part de soutenir les décisions pontificales.
Une véritable opposition frontale – à propos des sacrements refusés aux mourants qui ne disposent pas d'un billet de confession signé par un prêtre favorable à la bulle Unigenitus – se manifeste ainsi entre les parlements et le pouvoir royal.
C'est bien l'ancienne querelle sur la question de la monarchie absolue qui se rejoue à propos du gallicanisme, celui-ci n'étant qu'un prétexte, mais dans un contexte nouveau déterminé par l'esprit des Lumières.
S'il y a désaccord profond entre les parlementaires et les philosophes, ils se retrouvent côte à côte contre la monarchie absolue.
Et Louis XV cède.
Le pouvoir monarchique est ainsi atteint alors que le pays voit non sans inquiétude les guerres succéder aux guerres.
Elles ne pèsent pas encore sur la vie du royaume – rien qui rappelle le « grand hiver » de 1709 –, mais on n'en comprend pas les mobiles. Elles sont décidées hors du Conseil, dans le « secret du roi ». Elles apparaissent plus dynastiques que nationales. Encore et toujours, il faut les financer.
La première, la guerre pour la succession de Pologne, contre l'Autriche qui réussit à imposer son candidat en empêchant le retour du beau-père de Louis XV, se solde au traité de Vienne (1738) par la promesse qu'à la mort de Stanislas Leszczynski la Lorraine, qu'on lui a attribuée en compensation, reviendra à la France.
On mesure à cette occasion, puis surtout à propos de la succession d'Autriche – à la mort de l'empereur, sa fille Marie-Thérèse lui succède, mais la France conteste qu'elle puisse être élue au trône impérial –, que la situation a profondément changé en Europe.
La Prusse est devenue un royaume puissant que Frédéric II a doté d'une remarquable armée. La France s'allie à lui dans un premier temps contre l'Angleterre, la Hollande, la Russie, qui soutiennent Marie-Thérèse d'Autriche et ses ambitions impériales.
Les Français entrent dans Prague, remportent le 11 mai 1745 la bataille de Fontenoy contre les Anglo-Hollandais. Mais, à la paix d'Aix-la-Chapelle, Louis XV renonce à ses conquêtes : « Nous ne faisons pas la guerre en marchand, mais en roi. »
Il a, en fait, « travaillé pour le roi de Prusse » alors que, durant cette guerre inutile, s'est profilé le concurrent principal : l'Angleterre.
Cette rivalité avec Londres est « atlantique », « moderne », lourde d'avenir, puisqu'elle a pour enjeu le contrôle des colonies américaines, des Antilles, des comptoirs des Indes.
Elle supposerait soit qu'on passe un accord avec l'Angleterre – une bonne entente ne prévaut-elle pas depuis vingt ans ? –, soit, si on choisit la guerre, que la France réoriente ses efforts vers la constitution d'une puissante marine et d'une économie ouverte, structurée par de grandes compagnies marchandes.
Mais la fortune française est « rentière », foncière. Et Paris poursuit son rêve de dominer le continent, d'arbitrer les conflits européens.
Dès lors, autour du roi, les « conservateurs » choisissent l'alliance avec Vienne au traité de Versailles de 1756.
C'est là un véritable renversement d'alliance.
Or cette nouvelle orientation est pleine de contradictions. Le parti philosophique admire l'Angleterre – l'adversaire –, ses institutions, ses mœurs. Il est fasciné par Frédéric II, le souverain philosophe, alors que la Prusse est l'ennemie de Vienne.
Ainsi, alors que commence en 1756 une nouvelle guerre, celle-ci franco-anglaise, le royaume de France est parcouru de courants contradictoires.
Le roi n'est plus Louis le Bien-Aimé. Et Voltaire, en brossant l'histoire du Siècle de Louis XIV, fait à sa manière une critique de celui de Louis XV : le Roi-Soleil, majestueux, était implacable mais glorieux. Louis XV est un souverain de cinquante-sept ans qui n'inspire plus la ferveur quasi religieuse qu'on doit à celui que Dieu a sacré.
Le geste de Robert François Damiens, le 5 janvier 1757, même s'il n'inflige qu'une blessure légère au souverain, frappe durement le principe de la monarchie absolue.
32.
Louis XV va encore régner dix-sept ans.
Le temps ne lui est donc pas compté. Mais son gouvernement personnel est déjà vieux de trente et une années. Et l'on s'est lassé de ce roi dont les pamphlets affirment qu'il ne s'intéresse qu'à la chasse et aux dames.
Certes, l'économie est prospère, le commerce, actif, les récoltes, abondantes, car l'embellie climatique se poursuit et les « physiocrates » élaborent les premiers rudiments d'une science des échanges, une réflexion sur l'économie.
En juin 1763 est même autorisée la libre circulation des grains.
Cependant, le monarque n'est ni vénéré ni respecté.
On est impitoyable avec sa maîtresse, la comtesse Du Barry, auquel le banquier de la Cour remet 300 000 livres par mois.
On serait indulgent pour la débauche de luxe qui entoure la favorite si le roi n'apparaissait pas seulement comme l'homme des plaisirs, mais comme un souverain attentif au sort de son royaume, homme au-dessus des autres hommes, incarnation de la majesté et de la gloire.
Or la guerre contre l'Angleterre et la Prusse est une succession humiliante de désastres.
Elle blesse le sentiment national.
En 1757, à Rossbach, Soubise cherche son armée franco-autrichienne défaite par les Prussiens. Et toute l'Europe salue le roi Frédéric II, constructeur d'une nation puissante, modèle d'administration, qui change la donne sur le continent.
Le parti philosophique loue le prince éclairé et conteste l'alliance française avec l'Autriche.
Le pacte de famille conclu entre Louis XV et les Bourbons de Madrid et de Naples ne peut changer l'équilibre des forces.
Les colonies tombent les unes après les autres : le Canada est perdu, Montréal capitule (1759-1760), Pondichéry connaît le même sort en 1761.
Le 10 février 1763, le traité de Paris dépouille la France de l'essentiel de ses possessions d'outre-mer.
Comment faire face à cette humiliante défaite infligée par ceux qu'on admire, Anglais, Prussiens, les « modernes », alors qu'on a pour alliée cette Autriche archaïque à laquelle Louis XV veut rester fidèle, mariant son petit-fils Louis avec l'archiduchesse Marie-Antoinette, une Habsbourg (mai 1770).
L'opinion, suivant le parti philosophique, ne peut que se détourner de ce roi et de son gouvernement qui infligent à la nation une telle banqueroute internationale.
On se moque des ministres (Choiseul), des généraux (Soubise), du monarque lui-même.
Le pouvoir royal n'est plus respecté. On l'accuse d'avoir sacrifié les intérêts de la nation. Comment, dès lors, accepterait-on que la monarchie demeure absolue alors qu'elle est si peu glorieuse ?
Chanter les louanges de Frédéric II et de la Prusse, c'est une manière de refuser d'être confondu avec un pouvoir incapable. Et c'est un ministre, le cardinal de Bernis, qui, jugeant le rôle des différents États, écrit : « Le nôtre a été extravagant et honteux. »
On mesure à quel point s'élargit la faille, si souvent présente dans notre histoire, entre le « pouvoir » et l'« opinion ». Comment se reconstitue, pour les meilleures raisons philosophiques, et parce que en effet la politique extérieure a eu des résultats désastreux, un « parti de l'étranger » d'autant plus menaçant, cette fois-ci, qu'il rassemble contre le pouvoir politique le pouvoir intellectuel.
Ce dernier devient une véritable force capable de mener des campagnes politiques au nom des principes « éclairés » qu'il défend.
Le pouvoir politique apparaît ainsi acculé, affaibli, injuste et corrompu.
Mais le roi n'est pas seul atteint. Ce sont les piliers de la monarchie qui se fissurent.
On critique le clergé. On critique les parlementaires, même si parfois on se ligue avec eux contre l'absolutisme.
Le « pouvoir » en tant que tel est ainsi remis en cause.
Voltaire prend parti pour le huguenot Calas, roué en mars 1762, accusé à tort d'avoir tué son fils afin de l'empêcher d'abjurer la foi réformée.
La campagne que mène Voltaire renvoie tous les « pouvoirs » – religieux, judiciaire, monarchique – du côté de l'injustice. La réhabilitation de Calas, en 1765, est une victoire du parti philosophique et une nouvelle perte d'autorité des institutions « monarchiques ».
Même combat pour faire acquitter un autre protestant, Sirven. Mêmes campagnes pour tenter de sauver du bourreau Lally-Tollendal, gouverneur de Pondichéry, condamné pour s'être rendu sans combattre, et le jeune chevalier de La Barre, condamné à mort pour un geste sacrilège.
Les deux hommes sont exécutés, mais l'obstination du pouvoir – le roi a refusé la grâce de La Barre – l'isole, et constitue pour lui, en fait, une défaite morale.
La légitimité sans laquelle il n'est pas de pouvoir fort et respecté passe du côté du parti philosophique, qui étend son influence (le Grand Orient de France est créé en 1773 ; le duc d'Orléans lui-même, neveu du roi, est initié à la franc-maçonnerie).
Les loges maçonniques sont des lieux de débat, des « sociétés de pensée » où se constitue une « opinion éclairée » qui reconnaît le « Grand Architecte de l'Univers » et critique les Églises au nom du déisme.
Les représentants du pouvoir politique en prennent conscience, et, en 1770, l'avocat général Séguier prononce un réquisitoire lucide, mais qui est un constat de défaite :
« Les philosophes se sont élevés, dit-il, en précepteurs du genre humain. Liberté de penser : voilà leur cri, et ce cri s'est fait entendre d'une extrémité du monde à l'autre. Leur objet était de faire prendre un autre cours aux esprits sur les institutions civiles et religieuses, et la révolution s'est pour ainsi dire opérée. »
En 1717, Voltaire était emprisonné à la Bastille. En 1770, madame Necker, épouse de financier, ouvre une souscription pour lui faire élever une statue.
Ces années sont décisives pour l'évolution de l'âme de la France. Paris est la capitale des Lumières. Le roi est vaincu sur les champs de bataille, mais les « philosophes », lus dans toute l'Europe, sont invités à Berlin et à Saint-Pétersbourg.
Ce que le pouvoir monarchique a perdu en gloire et en influence en Europe, les philosophes l'ont reconquis.
La dissociation s'accuse encore entre pouvoir politique et pouvoir intellectuel.
Mais – c'est une autre spécificité française qui apparaît là – une séparation s'opère au sein du parti philosophique, entre ceux – tel Voltaire – qui ne remettent pas en cause l'organisation sociale, et ceux – tel Rousseau – qui condamnent l'« inégalité ».
Radicale, cette pensée se répand aussi dans la société, enflamme les esprits, isole davantage encore le pouvoir monarchique, dont le mode de vie, naguère accepté comme naturel et légitime, devient une manifestation de l'injustice :
« Le goût du faste ne s'associe guère dans les mêmes âmes avec celui de l'honnête, écrit Rousseau. Non, il n'est pas possible que des esprits dégradés par une multitude de soins futiles s'élèvent jamais à rien de grand, et quand ils en auraient la force, le courage leur manquerait. »
Plus critique encore, cette dénonciation du luxe comme cause de la pauvreté : « Le luxe nourrit cent pauvres de nos villes et en fait périr cent mille dans nos campagnes... Il faut des jus dans nos cuisines ; voilà pourquoi tant de malades manquent de bouillon. Il faut des liqueurs sur nos tables ; voilà pourquoi le paysan ne boit que de l'eau. Il faut de la poudre à nos perruques ; voilà pourquoi tant de paysans n'ont pas de pain. »
Critiqué, dénoncé, accusé, méprisé, le pouvoir royal, affaibli et isolé, est contesté par les parlementaires, ces « Grandes Robes » privilégiées qui prétendent défendre les sujets du royaume alors que, propriétaires de leurs charges, ils se soucient d'abord et avant tout des intérêts de leur caste.
Le roi, dont ils sont fondamentalement solidaires, est cependant leur adversaire. Ils réclament la convocation des états généraux. Ils se mettent en « grève ». Ils décident – contre lui – l'expulsion des Jésuites en 1764. Ils contestent toute remise en cause des privilèges fiscaux. Et, pour donner plus de force à leurs prises de position, ils organisent la concertation du parlement de Paris avec ses homologues provinciaux.
Ce sont là deux conceptions de la monarchie qui s'opposent. En mars 1766, dans un lit de justice, la « séance de la flagellation », Louis XV rappelle que les cours souveraines ne forment pas un seul corps, mais qu'elles tiennent leur autorité du roi :
« C'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, déclare Louis XV. C'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage. L'ordre public tout entier émane de moi, et les droits et les intérêts de la nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu'en mes mains. »
Il y a ainsi forte contradiction entre le roi et les parlementaires, en même temps qu'une complicité de fait.
Quand le parlement de Paris a à juger le chevalier de La Barre, en 1766, il le condamne à mort pour marquer qu'en dépit de sa décision d'expulser les Jésuites il ne protège pas l'impiété ni le parti philosophique – n'a-t-on pas trouvé chez La Barre un exemplaire du Dictionnaire philosophique de Voltaire ? –, mais sait se ranger à l'avis du roi, hostile à la grâce du jeune homme.
Mais les parlementaires et le souverain, complices, perdent aux yeux de l'opinion toute autorité morale.
Ces Grandes Robes « font périr dans les plus terribles supplices des enfants de seize ans ! » s'écrie Voltaire.
Diderot ajoute : « La bête féroce a trempé sa langue dans le sang humain, elle ne peut plus s'en passer, et n'ayant plus de jésuites à manger, elle va se jeter sur les philosophes ! »
Quand, en 1771, le nouveau chancelier et garde des Sceaux, Maupeou, et l'abbé Terray, contrôleur général des finances, décident, devant l'attitude des parlements, de faire un « coup de majesté », autrement dit d'arrêter les parlementaires, de restreindre la juridiction du parlement de Paris, de mettre fin à la vénalité des offices et de la justice, de nommer dans les cours souveraines des « fonctionnaires » au service du roi, Voltaire soutient ce qui constitue à ses yeux une mesure révolutionnaire, une tentative de la monarchie de réaffirmer ses pouvoirs contre le « féodalisme » des Grandes Robes.
Mais d'autres écrivains – tel Beaumarchais – défendent les parlementaires et entraînent derrière eux l'opinion, tant le rejet de la monarchie absolue est devenu grand.
La réforme vient trop tard.
La monarchie est déjà trop affaiblie pour la mettre à exécution !
La maladie du roi, en avril-mai 1774, illustre de manière tragique cette situation nouvelle de la monarchie. Le monarque est atteint de la petite vérole, son visage se couvre de croûtes ; méconnaissable, il exhale une odeur fétide.
Son confesseur a beau murmurer : « Messieurs, le roi m'ordonne de vous dire que s'il a causé du scandale à ses peuples, il leur en demande pardon », le peuple ne pardonne pas.
En 1744, alors que le souverain était tombé malade à Metz, six mille messes avaient été célébrées pour le salut de Louis le Bien-Aimé. Trente ans plus tard, on n'en compte plus que trois.
Et après la mort du roi, le 10 mai 1774, le cortège qui conduit la dépouille de Versailles à Saint-Denis n'est accompagné dans la nuit que par des gardes et quelques domestiques.
Se souvenant des passions du défunt, certains, parmi ceux qui voient passer le cortège, lancent : « Taïaut ! Taïaut ! » et : « Voilà le plaisir des dames ! Voilà le plaisir ! »
C'est un roi de vingt ans, Louis XVI, qui doit assumer le périlleux héritage.
2
L'IMPUISSANCE DU ROI
1774-1792
33.
Il va suffire de dix-neuf ans pour que Louis XVI, accueilli avec enthousiasme et espérance en mai 1774 par le peuple de Paris, gravisse, le 21 janvier 1793, les marches de l'échafaud et que sa tête tranchée soit montrée par le bourreau au peuple fasciné, rassemblé sur la place de la Révolution.
Événement majeur, fondateur d'une nouvelle période de l'histoire nationale.
L'exécution du roi est une rupture symbolique avec la monarchie, mais qui, cependant, plonge ses racines profond dans le passé.
C'est un orage dévastateur et créateur qui n'a pas surgi d'un coup dans un ciel serein.
On l'a vu s'avancer, on a craint sa venue, sans jamais imaginer sa violence destructrice.
On a voulu le tenir à distance, résoudre les problèmes qui le nourrissaient, mais sans y parvenir.
Et, de ce fait, il est apparu à certains comme une fatalité, une punition divine, voire comme le résultat d'un complot dont on s'est mis à rechercher bien en amont les prémices : l'une des causes en aurait été l'expulsion des Jésuites, en 1764, ou encore les agissements du parti philosophique et des sociétés de pensée conjoignant leurs efforts pour saper les fondements de la monarchie.
En fait, l'orage n'est puissant et sa venue inéluctable que parce que la monarchie est aboulique, qu'elle n'ose affronter les forces qui sont liées à elles et qui l'épuisent comme les sangsues vident un corps de son énergie.
C'est dès les premiers mois du règne de Louis XVI, roi si bien accepté qu'on l'appelle Louis le Bienfaisant et qu'on s'entiche de sa jeune épouse Marie-Antoinette, qu'on voit ce pouvoir capituler.
Les « réformateurs », le chancelier Maupeou et le contrôleur général des finances Terray, qui ont privé les parlements de leurs privilèges et de leurs exorbitantes prétentions politiques, sont renvoyés.
Dès le 12 novembre 1774, le nouveau contrôleur des finances, Turgot, rétablit les parlements dans leurs fonctions et leur rend leurs prérogatives. Dès lors, ce réformateur, avant même d'avoir agi, est affaibli.
Il veut rétablir la libre circulation des grains, sur laquelle Terray était revenu. Mais les récoltes sont mauvaises, la spéculation fait monter le prix du blé. Les émeutes se multiplient, parce que le pain est devenu rare et cher. C'est la « guerre des farines ». Et quand Turgot veut supprimer les corvées et les corporations afin de modifier le système fiscal et de libérer le travail, le Parlement proteste.
Un « front » se constitue ainsi entre les parlementaires, qui ne sont que des privilégiés, et le « peuple » misérable. La réforme n'a plus que le roi pour soutien.
Or la Cour elle-même est divisée.
Le duc d'Orléans est un « opposant » riche et ambitieux. Les frères du roi, le comte de Provence (futur Louis XVIII) et le comte d'Artois (futur Charles X), la jeune reine, sont hostiles aux réformes qui mettent en cause les privilèges fiscaux, les statuts immuables qui sont, dans le domaine du travail (les corporations), autant de formes de privilèges.
Turgot est renvoyé le 12 mai 1776 ; la corvée et les corporations, rétablies dès le mois d'août.
Ainsi, la réforme amorcée sous Louis XV est effacée, et la monarchie révèle son impuissance à l'imposer.
D'abord parce qu'il y faudrait un grand roi mû par une volonté inflexible, capable de domestiquer son entourage – à la manière d'un Louis XIV –, de rabaisser l'orgueil des grands et les pouvoirs des parlements, comme l'avait fait un Richelieu. Louis XVI est honnête, mais il ne sait pas s'arracher à ses proches, à leur influence. Et on colporte – les pamphlets en répandent la rumeur – qu'il ne réussit pas même à consommer son mariage.
Sans roi déterminé – ou soutenant contre tous un ministre de combat –, il ne peut y avoir de monarchie forte ni donc de réforme d'envergure.
Il y a aussi le fait que personne ne peut concevoir l'avenir cataclysmique qui attend les privilégiés et le royaume.
Qui peut jamais imaginer la fin d'un monde ?
Les acteurs sont aveugles.
Mais, à cette caractéristique partagée par tous les régimes, s'ajoutent, pour la France de la fin du xviiie siècle, des circonstances particulières.
Une crise de subsistances frappe le royaume. Le peuple souffre dans les villes et les campagnes. Il est souvent au bord de l'émeute. Il s'en prend aux « puissants », et donc à la Cour, aux privilégiés, à la reine. Ces « émotions populaires », cette exacerbation des tensions sociales, prennent une signification politique, parce que l'esprit des Lumières s'est répandu non seulement parmi les élites, mais aussi au sein du peuple.
On sait ce qui se joue au théâtre : en 1775, Beaumarchais donne Le Barbier de Séville, et bientôt ce sera Le Mariage de Figaro. On n'a pas feuilleté l'Encyclopédie, mais on connaît son existence. Malesherbes, que Louis XVI a appelé à son Conseil, s'en est fait le protecteur. Lorsque, en mars 1778, il séjourne à Paris – où il meurt –, Voltaire, dont on n'ignore pas qu'il a contesté avec succès les verdicts de la justice – Calas, Sirven, La Barre, Lally-Tollendal –, est célébré comme le roi des Lettres et du parti philosophique. On couronne en sa présence son buste sur la scène de la Comédie-Française.
Tel est le climat social et intellectuel qui cerne la monarchie et ses privilégiés.
Or ce pouvoir « central » est divisé : les parlementaires et les grands sont hostiles aux réformes qui amputeraient leurs privilèges. Le roi ne pourrait s'opposer à eux qu'en s'appuyant sur la volonté réformatrice du tiers état, qu'anime désormais une bourgeoisie d'affaires et de talent.
Mais celui-ci est le groupe social le plus pénétré par l'esprit des Lumières. Il se rend au théâtre. Il lit. Il participe aux assemblées des sociétés de pensée, aux tenues des loges maçonniques.
Ce tiers état – et de jeunes nobles : La Fayette, le comte de Ségur, le duc de Noailles – s'enthousiasme pour la rébellion des « Américains » (des Insurgents) contre l'Angleterre.
Volonté de revanche contre Londres après la guerre de Sept Ans – c'est Vergennes, chargé des Affaires étrangères, qui aura conduit avec talent la diplomatie française jusqu'à la guerre en 1778 –, mais, surtout une sympathie pour la « révolution américaine » semble portée par les Lumières.
On publie à Paris les textes de la Déclaration des droits de Philadelphie, la Constitution républicaine de la Virginie (1776) et la Déclaration d'indépendance (4 juillet 1776).
Ces textes qui affirment que « tous les hommes sont par nature libres et indépendants », que « tout pouvoir appartient au peuple et donc dérive de lui », sont lus comme autant d'incitations à contester la monarchie absolue.
On y évoque la séparation des pouvoirs, on y déclare qu'il existe des droits inaliénables, et que les gouvernements n'ont été institués que pour les faire respecter.
« Ils ne tirent leur juste pouvoir que du consentement de ceux qui sont gouvernés. »
« Liaisons dangereuses » (le livre de Laclos paraît en 1782) que celles qui se nouent entre une monarchie arc-boutée sur des principes immuables et les États-Unis d'Amérique, que cette même monarchie aide à vaincre et donc à instaurer un pouvoir républicain !
Même si le traité de Versailles – 3 septembre 1783 – marque la revanche française sur Londres et efface l'humiliation subie, conférant une once de gloire à Louis XVI, ce succès est lourd de conséquences.
Le retour de La Fayette à Paris, en 1782 est triomphal. Il est nommé maréchal de camp. L'esprit des Lumières, réformateur, est hissé au cœur du pouvoir.
Louis XVI a d'ailleurs choisi comme « directeur du Trésor » – il n'est pas membre du Conseil du roi – un banquier suisse, huguenot, donc hérétique, Necker, dont le salon parisien – son épouse est fille de pasteur ; sa fille Germaine est la future madame de Staël – est un lieu de rencontres entre tenants du parti philosophique et hommes de pouvoir.
Mais cette situation même affaiblit Necker aux yeux des adversaires des réformes.
Or, chargé par le roi de rétablir les finances du royaume, il ne peut que songer à réformer le système fiscal.
Afin de tourner l'opposition des parlements, il crée des assemblées territoriales où le tiers état obtient autant de sièges que ceux, additionnés, des ordres de la noblesse et du clergé. Il tente donc par là une politique qui cherche à s'appuyer sur l'opinion éclairée.
Le problème est d'autant plus grave qu'il a fallu financer la guerre d'Amérique, que les emprunts contractés ont été levés à 10 % d'intérêt et que la moitié des dépenses du royaume est affectée au service de la dette !
À la recherche du soutien de l'opinion, Necker, qui se heurte aux milieux privilégiés, publie un Compte rendu au roi sur l'état des finances du royaume. Il y dissimule l'ampleur du déficit, mais dévoile les dépenses de la Cour, le coût des fêtes, des cadeaux offerts par le roi ou la reine à tel ou tel membre de son entourage. Les chiffres cités – 800 000 livres de dot pour la fille d'une amie de la reine ! – représentent, pour l'opinion, des sommes inimaginables : le salaire quotidien d'un ouvrier est alors d'environ une livre...
Comment ne pas s'indigner, alors même que le pouvoir célèbre la victoire des Insurgents dont les textes constitutionnels affirment : « Tous les hommes ont été créés égaux et ont reçu de leur Créateur des droits inaliénables » ?
Le pouvoir monarchique est pris dans une contradiction difficile à résoudre.
Solidaire des privilégiés, il ne peut faire la réforme que contre eux, mais il n'ose la conduire, et, pour le peuple et le tiers état, il est l'incarnation même des privilégiés et de l'inégalité.
Lorsque, le 12 mai 1781, Necker remet sa démission au roi, constatant que le souverain ne le soutient pas, il est, pour le parti philosophique et l'opinion, la preuve vivante que le souverain ne veut pas introduire plus de justice et d'égalité dans le système fiscal, mais est le défenseur des ordres privilégiés.
On ne s'étonne donc pas que Louis interdise la représentation aux Menus Plaisirs du Mariage de Figaro, et qu'il nomme en novembre 1783, comme contrôleur général des finances, un ancien intendant, Charles Alexandre de Calonne.
Necker est l'homme du parti philosophique ; Calonne apparaît comme le serviteur du monarque, donc le défenseur des privilèges.
L'un est populaire, l'autre, suspect à l'opinion éclairée.
Mais l'un et l'autre, comme Louis XVI, sont confrontés en fait au même problème : comment résoudre la crise financière du royaume ?
34.
Que peut encore le roi de France en ces années 80 du xviiie siècle ?
Rien ne paraît devoir changer dans le grand apparat du pouvoir monarchique.
Et cette permanence du décor et du rituel, cette succession des fêtes, cet isolement de la Cour, dans les jardins illuminés de Versailles, renforcent le sentiment des souverains que rien ne saurait détruire l'ordre royal, qu'on peut indéfiniment continuer la partie, même s'il faut rebattre les cartes, changer les hommes.
Mais qu'à la fin le roi, parce qu'il est le roi, finira bien par imposer son autorité.
C'est le propre d'une vieille et grande nation, d'un pouvoir plusieurs fois séculaire, que de donner l'illusion qu'ils ne peuvent s'effondrer.
La politique de Calonne entretient ce mirage.
Il multiplie les emprunts, creuse encore le gouffre du déficit, mais l'argent roule.
Il achète les châteaux de Saint-Cloud et de Rambouillet pour le roi. Il investit dans la Compagnie des Indes orientales.
Disciple des physiocrates, il pense qu'une politique « libérale », facilitant la circulation des marchandises et de l'argent, fera naître la prospérité, mettra fin à cette crise économique qui ronge le royaume, suscite rébellion et misère.
Il signe le premier traité de libre-échange avec l'Angleterre en 1786. Il entend supprimer toutes les douanes intérieures.
Mais la réalité des finances vient crever le soyeux rideau de l'illusion.
Calonne est confronté, comme Turgot, comme Necker, à l'obligation de modifier le système fiscal afin de faire payer les privilégiés, ceux qu'on commence à appeler les aristocrates.
Il imagine un impôt général – la subvention territoriale – et reprend l'idée de Necker d'assemblées territoriales, tournant ainsi les parlements et même les intendants.
Il va jusqu'à envisager l'aliénation du domaine royal afin de rembourser les dettes ! Et il croit habile de faire approuver ces mesures par une assemblée de notables.
Il dénonce devant elle les supercheries de Necker, qui a dissimulé l'ampleur du déficit dans son Compte rendu au roi.
En attaquant l'homme du parti philosophique, Calonne renforce encore l'opposition de l'opinion éclairée, et en proposant des réformes à des notables, il se condamne à leurs yeux.
La reine et son entourage obtiennent son renvoi le 9 avril 1787. Il est remplacé par le cardinal Loménie de Brienne, un de ces notables qui l'ont combattu.
Turgot, Necker, Calonne, Loménie de Brienne : le roi, changeant les hommes, croit renouveler la donne, mais c'est à chaque fois son autorité qui est entamée, son impuissance qui est dénoncée, sa soumission à la reine qui concentre sur elle les critiques.
La crise financière devient aussi une crise morale qui exige des solutions politiques. Elle cesse d'être seulement financière pour devenir une crise de régime.
Les rumeurs, les libelles, les pamphlets, font de la reine une pervertie, capable de se vendre à un cardinal de Rohan, grand aumônier de France, de le rencontrer dans les bosquets de Versailles et de se faire offrir – en échange de quoi, sinon de ses faveurs ? – un collier de 1 600 000 livres.
Les bijoutiers, grugés, portent plainte, et le parlement de Paris se saisit de l'affaire. L'assemblée générale du clergé proteste contre l'arrestation de Rohan, qui sera acquitté ; une comtesse descendante des Valois, qui a abusé de la naïveté de Rohan, sera seule condamnée mais s'enfuira en Angleterre.
La reine, innocente, est à jamais compromise. Et le roi devient, aux yeux de l'opinion, le jouet d'une épouse corrompue.
L'opinion s'indigne, s'abreuve de ragots, partage le sentiment de ce magistrat : « Un cardinal escroc, la reine impliquée dans une affaire de faux ! Que de fange sur la crosse et le sceptre ! Quel triomphe pour les idées de liberté ! »
C'est une constante de l'histoire française – peut-être aussi de l'histoire de toutes les autres nations – qu'une rupture morale entre le pouvoir et l'opinion précède toujours la rupture politique. En France, c'est le mépris de l'opinion qui donne naissance à la crise de régime.
On ne rejette un pouvoir que lorsqu'on s'est convaincu qu'il n'est plus vertueux.
Naturellement, les opposants à ce pouvoir, quand ils ne les créent pas, exploitent les conditions pour que le mépris isole le pouvoir et le mine.
Que peut encore le roi alors que son autorité morale est atteinte et que, face à l'opposition aux réformes indispensables, il n'apparaît plus légitime, qu'on cherche donc ailleurs – dans l'esprit des Lumières – d'autres sources de légitimité ?
Les sociétés de pensée et les « clubs » se multiplient.
Au club Valois, à la Société des trente, à la Société des amis des Noirs, dans les loges maçonniques, on rencontre le duc d'Orléans, Mirabeau, Sieyès, La Fayette, Condorcet, Talleyrand, des membres de la noblesse « libérale », des représentants du tiers état et du clergé.
Une « opinion publique » se crée, nourrie par les pamphlets, les « correspondances », les livres ; publiés en 1788, ceux de Sieyès – Essai sur les privilèges, Qu'est-ce que le tiers état ? – sont parmi les plus lus.
On voit ainsi se dessiner une confrontation entre les « patriotes » – mot venu d'Amérique – et les aristocrates.
Or c'est dans ce contexte qu'avec Loménie de Brienne – l'homme de la reine – Louis XVI tente une nouvelle politique qui apparaît comme un regain d'absolutisme.
Il impose au Parlement un emprunt de 420 millions de livres. « C'est légal parce que je le veux », répond-il au duc d'Orléans, qui juge cet emprunt « illégal ».
Il exile les parlementaires ; deux d'entre eux sont arrêtés.
Ces « privilégiés », dans le climat de crise du régime, apparaissent comme les défenseurs de la nation.
Il n'est pas jusqu'à l'assemblée du clergé qui ne proclame, en juin 1788, que « le peuple français n'est pas imposable à volonté. La propriété est un droit fondamental et sacré, et cette vérité se trouve dans nos annales... Le principe ne se perd jamais de vue que nulle imposition ne peut se lever sans assembler les trois états et sans que les gens de ces trois états y consentent. »
À Grenoble – journée des Tuiles, 7 juin 1788 –, la foule s'insurge pour défendre les parlementaires. L'armée intervient, tire.
Au château de Vizille, le 21 juillet 1788, les états du Dauphiné se réunissent et se présentent comme porte-parole de la nation.
Dès lors, les réformes esquissées par Loménie de Brienne et par son garde des Sceaux Lamoignon (qui veut retirer le pouvoir judiciaire aux parlements) sont dans l'impasse. Et le mot de Louis XVI – « C'est légal parce que je le veux » – n'est plus que ridicule, en ce qu'il témoigne de la prétention et de l'impuissance royales.
Outre le droit à l'état civil accordé aux protestants et la reconnaissance des quarante mille juifs de France, ne reste du passage de Loménie de Brienne au pouvoir que la décision de convoquer les états généraux pour le 1er mai 1789.
Mais dans quelles conditions les délégués seront-ils désignés ?
C'est Necker, que le roi appelle en août 1788, qui va définir ces modalités.
Le retour de l'homme des Lumières apparaît comme une victoire du parti philosophique après l'échec de la solution « libérale » (Calonne) et de la tentative absolutiste (Brienne).
Mais Necker commence par reculer : il abroge les édits royaux, annule la réforme judiciaire de Lamoignon, rappelle les parlements.
Reste une décision confirmée par le roi le 27 décembre 1788, qui double le nombre des députés du tiers état aux états généraux.
Face à l'ordre du clergé et à celui de la noblesse, le tiers état rassemblera donc autant de députés qu'eux.
La manœuvre se veut habile. Elle satisfait les « patriotes », mais inquiète les ordres privilégiés. Elle ne paraît pas décisive, car si le vote par ordre est maintenu, le tiers état restera toujours minoritaire. En revanche, si le vote par tête s'impose, la règle « un délégué, une voix » ouvrira le jeu, car des curés élus dans les baillages pourront rallier le tiers état, et des nobles « éclairés », patriotes, pourront faire de même.
La majorité pourra alors changer de camp.
Une bataille politique capitale va donc s'engager autour de la question du vote par ordre ou par tête.
Que peut encore le roi de France ?
L'heure n'est plus aux hésitations et à l'habileté, mais au choix.
Or, à la fin de l'année 1788, Louis XVI a seulement redistribué les cartes sans fixer de règle du jeu.
35.
Voici l'année 1789 qui commence.
D'aucuns voient la France naître avec elle, comme si, avant, il n'y avait eu qu'un Ancien Régime et non une nation millénaire changeant de route, certes, en 1789, mais restant elle-même.
Comme le dira plus tard, analysant les circonstances et les causes de l'« étrange défaite » de 1940, l'historien Marc Bloch : « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France : ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération (1790). Peu importe l'orientation de leurs préférences, leur imperméabilité aux jaillissements de l'enthousiasme collectif suffit à les condamner. »
La France, donc, avant et après 1789.
Témoin des événements de cette année qui se conjuguera avec le mot révolution, Chateaubriand écrit :
« Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et de l'avenir, le mélange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles, forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d'ennui, les passions et les caractères en liberté se montrent avec une énergie qu'ils n'ont point dans la cité bien réglée. L'infraction des lois, l'affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même ajoutent à l'intérêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues, rentré pour un moment dans l'état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social que lorsqu'il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence. »
Au cours des premiers mois de 1789, c'est l'effervescence.
« Dans tous les coins de Paris il y avait des réunions littéraires, des sociétés politiques et des spectacles, les renommées futures étaient dans la foule sans être connues », écrit encore Chateaubriand.
Jamais, à aucun moment de son histoire, la France n'a connu – ni ne connaîtra – une telle multitude de débats dans des assemblées électorales, des réunions tenues dans les plus petits villages, avec la participation du plus grand nombre. Il suffit, pour avoir le droit de suffrage, d'avoir vingt-cinq ans et d'être inscrit sur le rôle des contributions.
Chacun s'exprime, participe à l'élaboration des Cahiers de doléances, ou bien approuve et recopie ceux que font circuler les sociétés de pensée, le parti des patriotes.
Des journaux se créent chaque jour, des libelles et des pamphlets sont imprimés (plus de cent par mois en 1788, davantage en 1789). On peut y lire : « Point d'ordres privilégiés, plus de parlement, la Nation et le Roi ! » Le paysan revendique la propriété de la terre, l'égalité, la juste répartition des impôts, la fin de la misère.
Ce débat qui s'étend à toutes les classes de la société, cette liberté de parler, de tout dire, de tout revendiquer, cette exigence d'égalité, cette fraternité, le recours à l'élection pour désigner les délégués aux états généraux qui vont « représenter » leurs électeurs, marquent en quelques mois, de façon définitive, l'âme de la France.
C'est comme si la tradition du débat, confinée dans les parlements, les cours souveraines, les assemblées de notables, les états généraux eux-mêmes, s'était étendue à tout le territoire national, au peuple entier.
La réforme démocratique, le droit universel au suffrage, la prise de parole, l'égalité entre tous les intervenants, se dessinent en ce printemps 1789.
Moment capital dans l'histoire nationale : « L'esprit de la révolution qui agitait les bourgeois des villes, écrira Tocqueville, se précipita aussitôt par mille canaux dans cette population agricole ainsi remuée à la fois dans toutes ses parties et ouverte à toutes les impressions du dehors, et pénétra jusqu'au fond... Mais tout ce qui était théorie générale et abstraite dans l'esprit des classes moyennes prit ici des formes arrêtées et précises. Là, on se préoccupa surtout de ses droits ; ici, de ses besoins. »
Car la misère et la faim sont là, aggravées par la crise des subsistances, la hausse du prix du pain.
Le salaire d'un ouvrier (quinze sous par jour) lui permet seulement d'acheter du pain pour sa famille.
Dès lors, en même temps que surgit une démocratie, la violence sociale ensanglante ce printemps et cet été.
Les paysans attaquent les châteaux. Ils arrêtent, pillent des convois de grain.
À Paris, les 27 et 28 avril 1789, dans le faubourg Saint-Antoine, des milliers d'ouvriers des manufactures, toute une foule, assiègent les fabriques de papier peint appartenant à un riche membre du tiers état, Réveillon. On brûle son effigie en place de Grève. On pille sa maison. L'armée intervient. On dénombre au moins 300 morts et des milliers de blessés.
Ainsi s'affirme une caractéristique française : la conjonction entre le débat politique, la pratique – naissante – de la démocratie électorale, et les question sociales posées par et dans l'émeute, à Paris mais aussi dans les campagnes.
À côté du tiers état – aucun paysan, aucun artisan parmi les délégués, mais 300 avocats ou juristes, des hommes d'affaires, etc. – existe un quart état, celui des « infortunés ».
Les liens ou les ruptures entre ces deux réalités sociales, leur alliance ou leur guerre, vont donner un visage nouveau à l'histoire nationale.
Il se dessine dès ce printemps 1789.
L'existence à l'arrière-plan de ce quart état – le peuple des pauvres, manouvriers et brassiers, paysans ne disposant que d'un petit lopin, ouvriers, artisans, infortunés des villes – amplifie la force du tiers état.
« Qu'est-ce que le tiers état ? interroge Sieyès. Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose. »
Ce « quelque chose », imprécis et modeste au mois de janvier 1789, devient en quelques semaines – de la réunion des états généraux, le 5 mai, à Versailles, au 23 juin, quand les députés du tiers refusent de quitter la salle du Jeu de paume où ils se sont rassemblés dès le 20 juin, le roi ayant fait fermer les portes de la salle des séances – le « tout ».
Le tiers état se donne le 17 juin le nom d'Assemblée nationale et fait le serment de ne se séparer qu'après avoir donné une Constitution au royaume.
Le roi invite le 27 juin le clergé et la noblesse à se réunir au tiers état. Il y aura donc vote par tête, et non plus par ordre.
La réunion des députés devient « Assemblée nationale constituante ».
Une révolution politique vient de se produire, renversant l'absolutisme royal, affirmant la primauté de la nation, incarnée par ses représentants et régie par une Constitution.
Parce que l'opinion – le quart état – emplit de sa rumeur et de sa violence encore contenue la salle du théâtre politique, et parce que les acteurs sur la scène l'entendent « remuer », on est passé des suppliques et des souhaits à l'exigence politique.
Cette conquête du pouvoir constituant par la « représentation nationale » s'opère contre l'exécutif royal, qui a tenté chaque jour d'enrayer ce processus.
On ferme la salle du jeu de Paume, et le 23 juin encore le roi menace de dissoudre les états généraux : « Si vous m'abandonniez dans une si belle entreprise, dit-il, seul je ferais le bonheur de mes peuples... Je vous ordonne de vous séparer tout de suite et de vous rendre demain matin chacun dans les salles affectées à votre ordre pour y reprendre vos délibérations. »
« La nation rassemblée ne peut recevoir d'ordres », réplique l'astronome Bailly, doyen du tiers état, et Mirabeau ajoute : « Nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes ! »
La violence est brandie.
C'est contre l'exécutif que le constituant s'affirme.
Il y aura toujours, depuis ce temps, un rapport fait de tensions, de soupçons, entre l'exécutif et l'assemblée.
Cette caractéristique nationale se fait jour en ce mois de juin 1789.
Le pouvoir a paru céder. En fait, il prépare sa contre-attaque. La « radicalité » est déjà devenue une donnée essentielle de la vie politique française.
Des troupes royales sont ramenées des frontières à Paris. Il y aura trente mille hommes, armés de canons de siège, autour de la capitale.
Le 11 juillet, le roi renvoie Necker : la contre-attaque est ouvertement déclenchée.
Il suffira de cinq jours pour que Louis XVI rappelle Necker, avouant sa défaite, perdant encore un peu plus d'autorité et de légitimité.
C'est que, durant ces cinq journées, l'opinion – le quart état – s'est embrasée.
Les précédents historiques rappelés par les journaux frappent l'opinion : on craint une « Saint-Barthélemy des patriotes ».
On affronte les mercenaires du régiment de cavalerie Royal-Allemand.
On pousse les gardes-françaises à la désobéissance et à la désertion avec leurs armes.
Le pouvoir perd son glaive. Puis son symbole.
Le 14 juillet, la Bastille est prise après de réels combats – 98 morts, 73 blessés –, et la violence devient terreur dès ces jours de juillet : les têtes de Launay, gouverneur de la Bastille, de Foulon de Doué, du nouveau ministre Breteuil, de Bertier de Sauvigny, intendant de Paris, sont promenées au bout des piques.
Le quart état, qui a donné l'assaut à la Bastille, exerce à sa manière sa justice terroriste.
Le 16 juillet, le roi rappelle donc Necker. Le 17, il se rend à l'hôtel de ville, où Bailly a été élu maire de Paris, et La Fayette, désigné pour commander la milice constituée afin de défendre la capitale.
Le monarque arbore la cocarde bleu et rouge.
On lui dicte ce qu'il doit faire : « Vous venez promettre à vos sujets que les auteurs de ces conseils désastreux [le renvoi de Necker] ne vous entoureront plus, que la vertu [Necker] trop longtemps exilée reste votre appui. »
Le fracas de la foudre, la violence, la terreur, le heurt sanglant avec le pouvoir : tous les traits de la vie politique française sont dessinés.
Chateaubriand ne s'y trompe pas quand il mesure la signification de la prise de la Bastille : « La colère brutale faisait des ruines, et sous cette colère était cachée l'intelligence qui jetait parmi ces ruines les fondements du nouvel édifice. »
Mais les « déguenillés » agitent devant ses yeux les têtes « échevelées et défigurées » portées au bout d'une pique.
« Ces têtes, et d'autres que je rencontrai bientôt après, changèrent mes dispositions politiques, écrit Chateaubriand. J'eus horreur des festins de cannibales, et l'idée de quitter la France pour quelque pays lointain germa dans mon esprit. »
L'émigration commence dès ce printemps de 1789.
Il y aura bientôt, comme si souvent dans notre histoire nationale, un « parti de l'étranger » pour se vouloir, se rêver et se proclamer parti de la « vraie France ».
36.
Le bruit que font les tours de la Bastille en s'effondrant sous la pioche des démolisseurs, ces ouvriers à demi nus que la foule acclame, pas un Français qui ne l'entende.
La surprise, l'angoisse, l'enthousiasme et la colère se mêlent, créant en quelques jours une « émotion nationale » qui prolonge les débats auxquels ont donné lieu, au printemps, les élections des délégués aux états généraux. Jamais l'existence d'une nation centralisée, déjà fortement unifiée, ne s'était manifestée avec une telle force, une telle rapidité.
C'est bien une spécificité française qui est à l'œuvre : entre la capitale – l'épicentre – et les périphéries, entre les villes et les campagnes, un échange s'établit, les événements se renforçant les uns les autres.
C'est l'état du royaume, secoué par les jacqueries, et les questions fiscales qui ont conduit à la réunion des états généraux ; ce sont les événements parisiens qui attisent maintenant les foyers provinciaux.
Il y a bien, en cet été 1789, une nation qui se reconnaît comme « une » en réagissant avec la même exaltation aux nouvelles et aux rumeurs que répandent journaux, pamphlets et voyageurs. Et que rapportent les députés du tiers quand ils retournent auprès de leurs mandants, ou que, comme presque chaque jour, dans leurs lettres détaillées, ils leur font le récit de ce qui se passe à l'Assemblée nationale constituante, dans les rues de Paris ou autour de cette Bastille où l'on a dressé des tentes pour des cafés provisoires, où l'on se presse comme à la foire Saint-Germain et à Longchamp, où l'on rencontre « les orateurs les plus fameux, les gens de lettres les plus connus, les peintres les plus célèbres, les acteurs et les actrices les plus renommés, les danseuses les plus en vogue, les étrangers les plus illustres, les seigneurs de la Cour et les ambassadeurs de l'Europe : la vieille France était venue là pour finir, la nouvelle pour commencer » (Chateaubriand).
Mais, devant ce champ de ruines, cette forteresse abattue, ce qui l'emporte dans tout le royaume, c'est une « grande peur ». On craint les brigands, on redoute les troupes étrangères appelées par le roi pour mettre fin à cette « jacquerie » nationale.
Les rumeurs se répandent. Les paysans se souviennent des grappes de pendus aux arbres après chacune de leurs jacqueries. Ils s'arment. Ils pillent les convois de grain. Ils tuent. Ils attaquent les châteaux. Ils incendient. Ils réclament la fin des privilèges. Ils veulent la terre. Ils exigent l'égalité.
Comment arrêter cette marée du quart état, des « déguenillés », des « infortunés », paysans pauvres, manouvriers et sans-culottes des villes ?
Tous réclament la « fin d'un monde », un renversement de l'ordre, afin de voir naître une autre organisation sociale dont ils savent seulement qu'elle doit mettre fin aux privilèges.
L'Assemblée nationale constituante les entend, veut les apaiser : elle abolit les privilèges dans la nuit du 4 août, et vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août de cette même année 1789.
On proclame que « les hommes naissent libres et égaux en droit », que « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ».
Pensées et principes radicaux. La France fait l'expérience nationale unique de la naissance, à partir d'une rébellion nationale, d'une révolution. De l'avènement d'un nouveau monde.
La violence a imposé la défaite politique et militaire du pouvoir en place.
Mais, dans le même temps, le peuple va découvrir que les principes d'égalité s'arrêtent à la porte des propriétés.
On abolit le régime féodal, mais seulement pour ce qui concerne les droits personnels. Ceux qui sont liés à la terre doivent être rachetés.
On décrète que les « hommes sont égaux », mais seuls voteront les citoyens « actifs », seuls seront élus ceux qui disposent de plus encore de biens.
Démocratie limitée, égalité bornée : la devise de ce monde nouveau est « Liberté, égalité, propriété ».
L'expérience de la nation, au terme de cet été 1789, est donc complexe. Le peuple a fait l'apprentissage de la démocratie politique ; il sait qu'il pèse, que les luttes qu'il mène peuvent être fructueuses, mais, en même temps, ses victoires sont bornées.
Il a des droits, mais il a faim.
Il voit, il éprouve l'existence d'une fracture entre lui, le déguenillé, le quart état, et le tiers état des citoyens actifs qui, payant l'impôt, sont les vrais acteurs du jeu politique institutionnel – vote, élections, décisions.
Et comme la faim perdure, qu'on craint la répression organisée par le roi et la reine, toujours en leur château, arborant au cours d'un banquet la cocarde noire avec des officiers du régiment de Flandre, on marche sur Versailles, les 5 et 6 octobre. Il y a là des milliers de femmes. On force les grilles. On pénètre dans les appartements de la reine. On tue les gardes du corps, on brandit leurs têtes. On ramène à Paris « le boulanger, la boulangère et le petit mitron ».
Victoire de la violence, révolution qui s'amplifie au lieu de s'atténuer.
On veut masquer cette réalité. Le maire de Paris parle d'un « peuple humain, respectueux et fidèle, qui vient de conquérir son roi ».
Et Louis XVI se déclare « fort touché et fort content », affirmant qu'il est venu à Paris « de son plein gré ».
« Indignes faussetés de la violence et de la peur qui déshonoraient alors tous les partis et tous les hommes. Louis XVI n'était pas faux, il était faible ; la faiblesse n'est pas la fausseté, mais elle en tient lieu et elle en remplit les fonctions » (Chateaubriand).
En fait, on soupçonne – ou on accuse – le roi, et surtout la reine et le parti des aristocrates, de préparer avec la complicité de l'étranger – Marie-Antoinette n'est-elle pas « l'Autrichienne » ? – cette « Saint-Barthélemy des patriotes » qui leur permettrait de rétablir leur pouvoir absolu.
On souhaiterait qu'il n'en soit pas ainsi, et l'opinion oscille entre l'espérance d'une « fraternité », d'une « union » autour du roi, et la crainte d'une trahison. Dans les clubs – les Jacobins, les Feuillants –, dans les « sections » électorales, chez les « sans-culottes », on surveille avec plus ou moins de suspicion le parti de la Cour.
Il y a donc un double mouvement :
Il conduit d'une part à l'organisation de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, où 100 000 personnes rassemblées sur le Champ-de-Mars prêtent serment à la Constitution. Des pancartes répètent aux citoyens : « La Nation, c'est vous ; la Loi, c'est vous ; le Roi en est le gardien ». C'est la mise en place d'une monarchie constitutionnelle où le roi de France n'est plus que le « roi des Français », où ce qui le sacre n'est plus l'onction de Reims, mais le choix du peuple de par la Constitution. Et Louis XVI paraît accepter ce régime qui met fin à la monarchie absolue : « Moi, roi de France, dit-il, je jure à la Nation d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi constitutionnelle de l'État à maintenir la Constitution et à faire exécuter les lois. »
Mais, d'autre part, on soupçonne le roi et le parti des aristocrates de ne pas accepter la nationalisation des biens du clergé – décidée le 17 avril 1790 pour garantir la monnaie des assignats créée en décembre 1789 –, puis la Constitution civile du clergé, qui fait de celui-ci un « corps de l'État » et exige des fonctionnaires qu'ils prêtent serment d'accepter cette mesure « gallicane » que le pape, pour sa part, condamne (13 avril 1791).
Ainsi les choix politiques deviennent-ils aussi, de par cette Constitution civile du clergé, des choix religieux.
Et la « politique » renvoie dès lors aux passions des guerres de religion.
Il ne s'agit plus seulement de monarchie constitutionnelle ou de monarchie absolue, mais de fidélité au pape ou de rejet de son autorité.
On est prêtre jureur ou prêtre réfractaire.
Et, le 17 avril 1791, la foule empêche Louis XVI de se rendre au château de Saint-Cloud où il doit entendre une messe célébrée par un prêtre réfractaire.
Parce que le sacre du roi de France en fait le représentant de Dieu sur la terre du royaume, entrer en conflit avec lui, c'est commettre un acte sacrilège, attester qu'on veut créer une « Église » constitutionnelle.
La cohérence existant sous la monarchie absolue entre religion et royauté, l'Assemblée constituante semble vouloir la maintenir, mais entre un monarque constitutionnel et une Église soumise à l'État, et non plus au pape.
« L'Église est dans l'État, l'État n'est pas dans l'Église », dira un député du tiers.
Mais si le roi, en bon catholique, refuse la Constitution civile du clergé, cela signifie aussi qu'il rejette l'idée de monarchie constitutionnelle à laquelle il a semblé se rallier.
Quand il tente de fuir avec la famille royale, le 20 juin 1791, il manifeste, comme il l'écrit, qu'il ne peut accepter les nouveaux pouvoirs, ceux des députés, des clubs, des citoyens. Il se dit fidèle au gouvernement monarchique « sous lequel la nation a prospéré pendant mille quatre cents ans ».
Arrêté à Varennes, reconduit à Paris, il aura fini de perdre, aux yeux de la foule silencieuse qui assiste à son retour dans la capitale, tel un prisonnier, toute légitimité. Les soupçons se sont mués en accusation.
Et certains, le 17 juillet 1791, au Champ-de-Mars où Louis XVI avait juré fidélité à la Loi, déposent une pétition réclamant sa déchéance et la proclamation de la république.
L'engrenage révolutionnaire a franchi une nouvelle étape.
Mais l'Assemblée, le tiers état, tous ceux qui veulent enrayer cette fuite en avant, cette radicalité qui peut remettre en cause toute l'organisation sociale (les propriétés), échafaudent la fiction d'un enlèvement du roi, et la garde nationale commandée par La Fayette ouvre le feu sur les pétitionnaires.
Le souverain sera maintenu au prix d'un mensonge et d'une cinquantaine de morts.
Journée décisive, lourde de conséquences non seulement pour le mouvement de la Révolution, mais pour l'histoire nationale.
Un fossé sanglant vient de se creuser entre « modérés », partisans de la monarchie constitutionnelle, et « radicaux », entre ceux qui recherchent un compromis politique – donc un accord avec le roi – et ceux qui jugent que le monarque est un traître.
Louis XVI innocenté – mais nul n'est dupe de cette fable de l'enlèvement – va prêter serment à la Constitution le 14 septembre 1791.
Et l'Assemblée nationale constituante cède la place le 30 septembre 1791 à l'Assemblée législative.
Après la fuite manquée du roi, l'émigration de la noblesse s'est accélérée. L'armée est en crise et le soupçon de trahison pèse sur toute la Cour.
Avec une lucidité aiguë, Barnave – avocat libéral, élu du Dauphiné, partisan d'une monarchie constitutionnelle, un des acteurs de la réunion de Vizille en 1788 – écrit :
« Ce que je crains, c'est le prolongement indéfini de notre fièvre révolutionnaire. Allons-nous terminer la révolution, allons-nous la recommencer ? Si la révolution fait un pas de plus, elle ne peut le faire sans danger ; c'est que, dans la ligne de la liberté, le premier acte qui pourrait suivre serait l'anéantissement de la royauté ; c'est que, dans la ligne de l'égalité, le premier acte qui pourrait suivre serait l'attentat à la propriété... »
Mais comment stabiliser une situation dès lors que l'une des pièces principales de l'échiquier politique – le roi, la Cour, le parti aristocratique – cherche à reprendre le royaume en main comme si rien ne s'était passé depuis le printemps 1789 ?
37.
C'est une France nouvelle que représentent les 745 députés de l'Assemblée législative qui se réunissent à Paris pour la première fois le 1er octobre 1791.
Robespierre avait fait voter par l'Assemblée constituante une proposition décrétant, avant de se séparer, l'inéligibilité de ses membres.
Ce sont donc des hommes nouveaux, surgis des assemblées locales, qui ont été élus.
Avocats, médecins, militaires, ils sont le visage de cette France qui, depuis près de trois ans, est labourée par les événements révolutionnaires, les affrontements sociaux, les bouleversements institutionnels et cette nouvelle guerre de religion qui oppose prêtres jureurs et prêtres réfractaires.
Ainsi naissent à partir des débats électoraux et des « émotions » populaires – Grande Peur, jacqueries, émeutes, cortèges, violences urbaines – les pratiques politiques de la France contemporaine.
Depuis 1788, dans le creuset de la Révolution, ces comportements et ces sensibilités politiques vont s'inscrire dans l'âme de la France.
Comme l'écrit Chateaubriand, témoin privilégié, l'Assemblée constituante avait déjà été, « malgré ce qui peut lui être reproché, la plus illustre congrégation populaire qui ait jamais paru chez les nations, tant par la grandeur de ses transactions que par l'immensité de leurs résultats ».
L'Assemblée législative est tout aussi importante : elle précise les contours d'une exception française.
Aucun peuple n'a fait à un tel degré, dans toute son épaisseur sociale, une telle expérimentation politique.
La France devient la nation politique par excellence.
Il y a à l'Assemblée et dans le pays une « droite » et une « gauche ».
Des ébauches de partis politiques reclassent les députés, rassemblent leurs partisans dans des débats passionnés.
Une opinion politique se constitue, se déchire, excommunie telle ou telle de ses tendances.
Le club des Feuillants (Barnave, La Fayette) est partisan de la monarchie constitutionnelle. Il veut arrêter la révolution au point où elle est parvenue.
Les clubs des Jacobins (Robespierre) et des Cordeliers (Danton, Desmoulins) veulent démasquer les trahisons de la monarchie.
La presse – Marat et son Ami du peuple, l'abbé Royou et son Ami du roi –, les libelles, expriment ces combats d'idées, galvanisent les « aristocrates » ou les « patriotes ».
La foule fait irruption dans la salle du Manège, où siège l'Assemblée. Elle envahit les tribunes, distingue parmi les députés ces élus de Bordeaux, ces Girondins – Brissot, Vergniaud, Roland… – au grand talent oratoire.
Ceux-là clament que l'Europe doit suivre l'exemple français.
Ainsi se forge, dans ces premiers mois de la Législative, l'idée que la nation française a une mission particulière, qu'elle est exemplaire. Il lui faut devancer par une guerre patriotique celle que s'apprêtent à lui faire – lui font déjà – les émigrés rassemblés dans une armée des princes qui se constitue à Coblence autour des frères du roi, les comtes de Provence et d'Artois.
Le girondin Isnard déclare : « Le peuple français poussera un grand cri, et tous les autres peuples répondront à sa voix. »
Certains – tel Robespierre – récusent cette prétention, se méfient de ce patriotisme révolutionnaire qui devient belliciste, qui s'imagine que les peuples vont accueillir avec enthousiasme les « missionnaires armés ». Mais l'idée de guerre s'impose et paraît une solution aux problèmes auxquels est confronté le pays.
Surtout, elle canalisera la passion révolutionnaire.
Elle permettra par les prises de guerre – le butin – de faire face à la crise financière et économique qu'aggrave la mauvaise récolte de 1791.
Dans les campagnes, dans les villes, le pain, la viande et le sucre manquent ou sont hors de prix. Dans le débat politique, des voix de plus en plus nombreuses, venues du quart état, mais qui trouvent écho dans L'Ami du peuple et dans les clubs, réclament la taxation des denrées.
La faim, la cherté de la vie poussent à l'émeute, aux violences.
On dénonce les « accapareurs ». On impose par la force les prix de vente.
Une aile radicale s'exprime, s'organise, agit, élargissant encore la palette des courants politiques, enfournant dans la machine révolutionnaire de nouveaux combustibles.
Flambent cependant déjà, dans de nombreuses régions, les oppositions entre prêtres jureurs et réfractaires.
Les paysans de l'Ouest s'opposent à ce que de nouveaux prêtres viennent dire la messe en lieu et place de leurs curés.
Ici et là, en Bretagne, en Provence, dans la vallée du Rhône, des « aristocrates » s'organisent militairement, parfois en liaison avec les émigrés.
Le 9 novembre 1791, l'Assemblée législative vote un décret exigeant de tout émigré qu'il rentre en France avant le 1er janvier 1792 sous peine d'être coupable de conspiration.
Le 21 novembre, un autre décret exige des prêtres qu'ils prêtent serment à la Constitution.
À chacun de ces décrets, le roi oppose, conformément aux pouvoirs que lui accorde la Constitution, son droit de veto.
Une épreuve de force s'ébauche entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif appuyé sur le mouvement des clubs et sur cette opinion publique soupçonneuse envers un monarque qui a déjà tenté de prendre la fuite et que les Jacobins, les Cordeliers, les Girondins et naturellement Marat suspectent d'être complice des émigrés – ses frères ! –, du nouvel empereur germanique, François II, et du roi de Prusse Frédéric-Guillaume.
Au plus grand nombre, la guerre paraît le moyen de dénouer ces contradictions.
Le roi sera contraint de se démasquer, de choisir son camp. Et elle obligera les monarchistes, les ennemis de l'intérieur, à prendre soit le parti de la France, soit celui de l'étranger.
Cette fuite en avant, rares sont ceux qui mesurent qu'elle ne peut que favoriser une dictature militaire et la radicalisation de la situation.
Le « parti de la Cour » la souhaite.
Le roi nomme donc un ministre girondin favorable à la guerre.
Le 20 avril 1792, un ultimatum est lancé à l'empereur et aux princes allemands pour qu'ils dispersent les émigrés massés sur leurs territoires.
La Cour imagine que l'armée française, affaiblie par les luttes politiques et l'émigration de nombre de ses officiers, va s'effondrer, et qu'avec le concours des Prussiens et des Autrichiens l'ordre sera rétabli dans le royaume, et le peuple, enfin châtié.
Ainsi la France s'engage-t-elle dans la politique du pire.
3
LA LOI DES ARMES
1792-1799
38.
La guerre commence le 20 avril 1792.
Premières défaites sur les frontières nord et est, le long des routes traditionnelles des invasions.
Le peuple se souvient. Il s'inquiète pour le sort de cette ville-verrou, Verdun, qui commande le chemin de Paris et dont le nom, depuis le temps de Charlemagne, est inscrit dans la mémoire nationale.
La guerre ravive les souvenirs de tous les combats pour la défense de la patrie.
Quand, le 25 avril 1792, à Strasbourg, Rouget de L'Isle entonne pour la première fois son Chant de guerre pour l'armée du Rhin, il emprunte ces mots : Aux armes, citoyens ! aussi bien aux affiches de la Société des amis de la Constitution, qui invitent à s'enrôler, à « vaincre ou à mourir », qu'aux appels à résister à l'armée espagnole lancés en 1636 et qui souhaitaient qu'un « sang impur abreuve nos sillons ».
Quant à la musique de son Chant de guerre, elle s'inspire d'un thème de Mozart, le franc-maçon, le musicien des Lumières, mort en 1791.
Dans un pays centralisé où existe depuis des siècles un sentiment patriotique, la guerre, dès les premiers combats de 1792, associe nation et révolution, défense de la patrie et défense des droits nouveaux.
Le citoyen est patriote.
L'ennemi de la révolution est un traître à la nation.
À ceux qui crient « Vive le roi ! » on répond « Vive la nation ! ».
La loi des armes simplifie, radicalise, exclut, condamne.
Point de place pour les modérés – les Feuillants – adeptes du compromis, par sagesse, par intérêt, pour protéger les propriétés, maintenir la monarchie constitutionnelle, garante de la paix civile et de l'ordre social.
En choisissant la politique du pire – la guerre –, le parti de la Cour a cru pouvoir éteindre le brasier révolutionnaire. C'est l'incendie général qu'il déchaîne contre lui.
En souhaitant la guerre, les Girondins, qui espéraient ainsi gouverner la révolution, ont ouvert la porte aux hommes les plus décidés, aux « sans-culottes » les plus radicaux.
Le temps n'est plus ni à Louis XVI, ni à Barnave ou La Fayette, ni même à Brissot, mais à Danton, Desmoulins et bientôt Robespierre.
La loi des armes, les idées extrêmes, imposent dès lors leur empreinte profonde dans l'âme de la France.
Que le roi – en mai puis en juin – oppose son veto à un décret instituant la déportation des prêtres réfractaires, puis à un autre créant un camp de 20 000 fédérés à Paris, et aussitôt on demande sa suspension.
On envahit le 20 juin les Tuileries, on contraint Louis XVI à se coiffer d'un bonnet phrygien, on l'humilie.
Il ne cède pas.
La presse royaliste invite les amis du roi à rejoindre Paris pour défendre le souverain.
L'amalgame est fait entre les aristocrates, le monarque, et ces Autrichiens et Prussiens qui avancent vers la capitale. On crie : « Périssent les tyrans ! Un seul maître, la Loi ! » Et on proclame « la patrie en danger » (le 11 juillet). L' amalgame se fait entre citoyens et patriotes.
Toute la France entend rouler le tambour, battre le tocsin ; 200 000 volontaires s'enrôlent dans les armées de la nation.
Les fédérés marseillais marchent vers Paris en entonnant le Chant de guerre pour l'armée du Rhin, devenu La Marseillaise.
Les camps sont face à face. Entre eux, ce ne peut plus être que la guerre, la victoire de l'un et l'écrasement de l'autre.
La loi des armes est sans appel.
Elle s'exprime dans le manifeste, connu à Paris le 28 juillet, du général prussien Brunswick.
Il a été écrit par le marquis de Limon, un émigré.
Il menace Paris d'une « exécution militaire et d'une subversion totale, et les révoltés au supplice si les Parisiens ne se soumettent pas immédiatement et sans condition à leur roi ».
« Les vengeances approchent », écrivent les journaux royalistes.
C'est la guerre dans Paris.
Le 10 août 1792, l'assaut est donné aux Tuileries.
Les défenseurs du roi sont des aristocrates et des mercenaires suisses ; les gardes-françaises ont rejoint les assaillants, les sans-culottes et les fédérés marseillais. Vrais combats : plus de mille morts, dont six cents défenseurs massacrés.
Une Commune insurrectionnelle est créée.
Désormais, il existe encore une Assemblée législative – auprès de laquelle le roi s'est réfugié –, mais cette démocratie représentative a en face d'elle, détenant la force des sans-culottes en armes, la Commune, démocratie directe, vrai pouvoir qui fait emprisonner le monarque et sa famille au Temple, obtient sa suspension et la création d'un tribunal extraordinaire.
Commence le temps des suspects, des visites domiciliaires.
Sous la pression de la guerre, l'engrenage de la violence et de la terreur tourne de plus en plus vite, parce que les troupes austro-prussiennes avancent, qu'elles occupent Verdun le 2 septembre, et que la peur des représailles, de la vengeance annoncée par le manifeste de Brunswick, suscite la haine.
On massacre, dans les premiers jours de septembre, les suspects emprisonnés à Paris – plus de 1 300 victimes –, et cette « Saint-Barthélemy » révolutionnaire s'étend à tout le royaume.
On tue sans jugement, on profane les corps – ainsi celui de la princesse de Lamballe.
La révolution engendre une nouvelle passion « religieuse », terroriste ; deux cent vingt ans après la Saint-Barthélemy, les rues de Paris sont à nouveau rouges de sang.
La patrie en danger, les volontaires, l'assaut des Tuileries, le 10 août, La Marseillaise, la Commune, les massacres de Septembre : autant de références qui se gravent dans la mémoire nationale, dans l'âme de la France.
L'élan des volontaires, le sang de la guerre et des massacres, déchirent et cimentent à la fois la nation.
Parti des aristocrates contre parti des patriotes.
Ennemis de la révolution face aux révolutionnaires.
Drapeau blanc et fleur de lys contre drapeau tricolore.
Blanc contre bleu.
Mais aussi « bleu » différent du « rouge », car l'exigence d'égalité s'est imposée en même temps que la guerre.
Mourir pour la patrie ? Soit. Mais qu'elle devienne alors aussi la patrie du quart état !
Ces divisions, ces revendications, sont autant de nervures qui se superposent ou s'opposent dans l'âme de la France.
Mais la guerre favorise aussi l'amalgame des patriotes contre l'étranger et ses alliés, les émigrés.
Les paysans mènent une guerre de partisans contre les troupes austro-prussiennes qui avancent vers Valmy, une fois Verdun conquise.
Les troupes françaises composées de jeunes enrôlés, encadrées par des généraux (Dumouriez, Kellermann) et des officiers de l'armée du roi, avec, parmi eux, des aristocrates, comme le duc de Chartres – futur Louis-Philippe –, font reculer les troupes de Brunswick au cri de « Vive la Nation ! »
Mais ce « Vive la Nation ! » a valeur universelle.
« De ce lieu, de ce jour date une nouvelle époque de l'histoire du monde », dira un témoin de l'affrontement de Valmy.
Il se nomme Goethe.
39.
La victoire de l'armée de la nation signe la défaite de la monarchie et la condamnation du roi.
La nouvelle Assemblée, la Convention, abolit à l'unanimité la royauté dès le lendemain de Valmy, le 21 septembre 1792.
Elle proclame la « République une et indivisible ».
Ainsi s'ouvre une séquence majeure de l'histoire nationale, après plus d'un millénaire de monarchie.
Mais cette rupture institutionnelle naît dans le fracas des armes.
La République est combattante. Elle n'a pas surgi du lent travail consensuel de partis qui s'opposent en se respectant. Elle n'est pas enfantée par des débats parlementaires dans le cadre d'une assemblée.
La Convention entérine et traduit le rapport des forces sur le champ de bataille.
Les soldats criaient : « Vive la Nation ! » Cela devient : « Vive la République ! »
Après Valmy, il y aura Jemappes – le 6 novembre 1792 –, l'invasion, l'occupation, l'annexion de la Belgique.
La République est conquérante.
Elle se veut libératrice. Elle annexe les royaumes, les villes, les principautés, pour le bien des peuples. Elle est le germe d'une « Grande Nation ».
Elle apporte « secours et fraternité à tous les peuples qui veulent recouvrer la liberté ». Et la Convention « charge le pouvoir exécutif de donner aux généraux les ordres nécessaires pour porter secours et défendre les citoyens qui auraient été vexés et pourraient l'être pour la cause de la liberté ».
Voici venu le temps des « missionnaires armés » et celui des coalitions antifrançaises qui vont – de 1793 à 1815 – rassembler, au gré des circonstances, l'Angleterre – qui ne saurait tolérer un Anvers français –, l'Autriche, la Hollande, la Prusse, l'Espagne, la Russie, Naples, la Sardaigne...
La République vit sous la menace. L'armée est son glaive et son bouclier.
Mais la guerre n'est pas qu'aux frontières.
Parce qu'il faut une levée en masse pour constituer une armée immense – 400 000 volontaires, 700 000 soldats –, il faut des réquisitions, des fournitures – vivres, armes, uniformes, etc. –, et l'assignat s'effondre. Tandis que les « munitionnaires » font fortune, les paysans se rebiffent contre cet impôt du sang.
Il faut tenir, sévir. La terreur est l'envers de la guerre. Soixante départements – sur quatre-vingt-trois – seront bientôt en insurrection.
La République une et indivisible crée, en même temps qu'elle unifie, le sillon qui divise la nation.
L'âme de la France est ainsi couturée par ces cicatrices sanglantes qui défigurent le pays, en ces années cruciales 1793-1794, et le marquent aussi profondément que des siècles de monarchie.
Il y a la division entre républicains au sein de la Convention.
Les Jacobins « montagnards » – ils siègent en haut de l'Assemblée – sont centralisateurs comme l'étaient – car, sous la rupture, les continuités s'affirment – Richelieu et Louis XIV.
En face, les Girondins sont fédéralistes, veulent réduire « Paris à un quatre-vingt-troisième d'influence ».
Mais la guerre exige – techniquement, mentalement – que la nation se plie à la discipline unique qui s'impose à toute armée. Et les défaites (Neerwinden en mars 1793), les trahisons (Dumouriez passe à l'ennemi), les insurrections (en Vendée, à Lyon, en Provence, où les royalistes livrent Toulon aux Anglais), condamnent en juin 1793 les Girondins – arrêtés, jugés, décapités.
Dès les origines, la République a ainsi deux visages : le jacobin s'oppose au girondin.
Cette division perdurera, rejouant la scène sans fin sous des noms différents, avec plus ou moins de violence : Parisiens contre provinciaux « décentralisateurs », républicains autoritaires contre républicains démocrates.
En fait, cette fracture entre républicains est d'autant plus nette qu'elle se superpose à d'autres divisions, et qu'ainsi, malgré l'affirmation réitérée de République une et indivisible, la France, pays toujours menacé de tensions et de déchirements, reste aussi émiettée qu'elle l'a souvent été.
D'un côté, on retrouve ceux qui veulent ouvrir le procès du roi afin de le condamner, de l'exécuter. De l'autre se regroupent les modérés, les attentistes qui craignent une division radicale entre la France ancienne et la nouvelle.
Mais la guerre est là. Les royalistes sont à Toulon, à Lyon, à Nantes, aux côtés des armées ennemies.
Le procès du monarque est un des aspects de la guerre. La Convention l'ouvre dès novembre 1792. « L'élimination du roi est une mesure de salut public, une providence nationale », dit Robespierre.
« Tout roi est un rebelle et un usurpateur, ajoute Saint-Just. Louis est un étranger parmi nous. On ne peut régner innocemment, la folie en est trop évidente. »
La mort est votée par 361 voix contre 360. Louis Capet sera exécuté le 21 janvier 1793, et sa tête montrée, sanglante, au peuple rassemblé.
Cette mort de Louis XVI laisse un vide béant au cœur de l'histoire nationale.
Plus d'un millénaire d'acceptation, de respect, de vénération, d'obéissance à l'égard de ce roi sacré, thaumaturge, représentant de Dieu sur terre, unissant la France à l'Église et au divin, se trouve ainsi tranché net.
La France, nation mystique et politique, en est profondément divisée et blessée.
Et alors que les rébellions armées – en Vendée notamment – se prolongent, s'amplifient, que l'élan patriotique est nécessaire pour repousser l'ennemi aux frontières, il ne faut pas que soit entendue la voix de Louis XVI qui, sur l'échafaud, crie, dans les roulements des tambours : « Français, je meurs innocent, je pardonne à mes ennemis, je souhaite que ma mort soit utile au peuple ! Je remets mon âme à Dieu. »
On a besoin d'une autre « religion », d'une autre mystique pour soutenir la République.
D'abord, il faut qu'on en finisse avec le christianisme, lié à la monarchie.
Voltaire a été admis au Panthéon dès le 11 juillet 1791, et on a célébré « l'homme qui combattit les athées et le fanatique, qui inspira la tolérance, qui réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité ».
La Convention a réhabilité le chevalier de La Barre. Elle abolit l'esclavage le 4 février 1794. Elle va tenter, avec un nouveau calendrier – le décadi remplaçant le dimanche, thermidor, juillet, brumaire, novembre, etc. –, de parachever la déchristianisation.
Elle organise le culte de la Raison, adopte le « déisme voltairien », célèbre l'Être suprême.
Elle veut transformer la République en mystique.
Mais elle dresse ainsi contre cette parodie de religion aussi bien les catholiques que les sceptiques, les croyants que les cyniques.
Dans l'âme de la France, ces divisions aux origines de la République, cette fracture entre plusieurs France, ce mysticisme républicain, cette idée d'une mission universelle de libération des peuples assumée par la nation, sont autant de sources de frictions, de ferments de guerre civile.
La France de 1793-1794 est une fois encore le pays de la Saint-Barthélemy, des guerres de Religion.
Si la nation n'éclate pas, c'est d'abord que le pays défend son sol contre l'étranger. Que le patriotisme – « Mourir pour la patrie est le sort le plus beau, le plus digne d'envie », chante-t-on – soulève et rassemble la majorité de la nation.
Celle-ci est en armes. Elle résiste.
L'amalgame entre soldats volontaires, conscrits de la levée en masse, anciens des régiments du roi promus officiers de la République, bientôt jeunes généraux, se réalise.
Le patriotisme et l'héroïsme, la jeunesse de ce pays, le plus peuplé d'Europe et à l'armée la plus nombreuse, cimentent la nation.
L'âme de la France, monarchiste aussi bien que républicaine, est martiale.
Cela ne suffirait pas à empêcher la désagrégation.
Si la République en armes dessine l'ébauche d'un pouvoir totalitaire, c'est moins par la mise en œuvre d'une idéologie qui en contiendrait le germe que par les nécessités « techniques » de la guerre aux frontières, et surtout à l'intérieur.
Si la France est divisée, c'est qu'il existe des « traîtres ». On ouvre les « armoires de fer » de la monarchie ; on y trouve les noms des « stipendiés » de la Cour, et, parmi eux, Mirabeau et Barnave. Dumouriez, le vainqueur de Valmy, est passé à l'ennemi. La Fayette l'a déjà fait, comme des milliers d'officiers, d'émigrés.
Il faut un Tribunal révolutionnaire, une loi des suspects, un Comité de sûreté générale, un Comité de salut public. D'abord à Paris, puis dans les départements, près de 200 000 sans-culottes sont réunis et organisés en parti révolutionnaire, le parti jacobin, qui s'appuie sur des représentants en mission.
Le parti est l'œil de la surveillance. Il dénonce. Il châtie.
Car, au bout de cette suspicion, la Terreur est à l'ordre du jour.
On dénombre 500 000 suspects. On guillotine. Peut-être y a-t-il plus de 100 000 victimes.
On confisque, avec les lois de ventôse (février 1794), les biens des suspects.
On veut s'attacher, avec les lois sur le maximum des prix, les citoyens les plus pauvres. On leur promet l'« égalité sainte » en votant la Constitution de l'an I (24 juin 1793), laquelle ne sera pas appliquée puisque, face à la guerre, le gouvernement est dit « révolutionnaire jusqu'à la paix ».
La répression – à Lyon on tire au canon sur les « royalistes », à Nantes on les noie, en Vendée on les fusille, partout on les décapite – n'épargne personne, puisque tout le monde, dès lors qu'il s'oppose à la politique du Comité de salut public où Robespierre a fait son entrée en juillet 1793, est suspect.
On guillotine les « enragés » qui réclamaient pour le quart état une « révolution sociale », un nouveau maximum des prix, et non pas l'application d'un maximum pour les salaires.
Marat a été assassiné le 13 juillet 1793 par Charlotte Corday, sinon il aurait été de la charrette qui, au printemps 1794, conduit les enragés à l'échafaud.
Puis ce sera le tour des « indulgents » – Danton, Desmoulins –, accusés de vouloir mettre fin à la Terreur, à la guerre, donc à la révolution, et soupçonnés de vouloir abandonner la mystique républicaine.
Procès bâclé pour étouffer la grande voix de Danton en ce printemps 1794.
Certes, les armées de la République terroriste sont victorieuses en ce même printemps (Fleurus, le 26 juin), mais le pouvoir est isolé.
Les enragés sont toujours en quête de pain bon marché, et crient devant le blocage de leurs salaires : « Foutu maximum ! »
La République n'est plus pour eux qu'un régime parmi d'autres.
La nation est épuisée, et chacun se sent suspect.
Pourquoi cette surveillance, ces exécutions, si la victoire est acquise ?
Robespierre et ses partisans se retrouvent seuls parmi les cadavres des enragés et des indulgents, cibles toutes désignées pour tous ceux qui, après avoir mis en œuvre une implacable terreur (Barras, Fouché), craignent qu'elle ne se retourne contre eux.
Le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), Robespierre est renversé. Cent sept de ses partisans sont décapités. Jamais on n'a autant exécuté en un jour.
Ce paroxysme terroriste et républicain, cette politique mystique et patriotique, ces luttes inexpiables entre factions, se gravent dans l'âme de la France.
Au moment où le pays invente la démocratie moderne – élections aux états généraux, débats, Constitution –, il en génère aussi les pathologies : le parti « unique », la loi des suspects, le Tribunal révolutionnaire, la Terreur.
La guerre contamine ainsi tout l'ordre politique.
Saint-Just, l'une des victimes du 9 thermidor, a dit : « La Révolution est glacée. »
La République l'est tout autant.
40.
Cinq années seulement, mais un fleuve d'événements et de sang, séparent cet été 1794 de l'an 1789, quand la prise et la destruction de la Bastille allaient faire entrer la France dans ce territoire inconnu nommé Révolution.
Les hommes qui siègent à la Convention, après la chute des robespierristes, savent qu'ils sont tous des survivants de cette imprévisible et interminable odyssée.
Pendant la Terreur, comme le dira Sieyès, ils ont « vécu » en s'enfonçant dans le « marais », évitant de choisir entre Girondins et Jacobins, pour échapper à la loi des suspects, au Tribunal révolutionnaire, à la colère des enragés.
Mais, à la Convention, ils ont approuvé les mesures de salut public, pas seulement parce qu'ils craignaient, en s'y opposant, de faire figure de suspects et de monter dans la charrette pour l'échafaud, mais parce qu'ils ne voulaient pas du retour à l'Ancien Régime. Ils en auraient été les premières victimes, trop révolutionnaires pour ces émigrés qui se pressaient aux frontières avec les armées étrangères.
Maintenant que la « crête » de la Montagne a été arasée, ils veulent endiguer le fleuve, le canaliser afin qu'il s'apaise, que la République profite aux républicains, c'est-à-dire à eux.
Car, après ces temps tumultueux, ces jours de terreur, les survivants aspirent à jouir de leur victoire. Ils sont la République.
Ceux qui, comme les frères du défunt roi, le comte de Provence (successeur en titre de Louis XVI après la mort à la prison du Temple, le 8 juin 1795, du Dauphin Louis XVII), le comte d'Artois, imaginent qu'ils vont pouvoir restaurer l'Ancien Régime (catholicisme religion d'État, ordres reconstitués, parlements rétablis, déclare le futur Louis XVIII dans sa proclamation de Vérone, le 24 juin 1795), ne comprennent pas que les conventionnels entendent créer « leur » République.
Ils ne veulent ni de l'Ancien Régime ni même d'une monarchie constitutionnelle que les plus lucides parmi les royalistes envisagent encore.
Ce « marais », ces habiles, ces prudents, ces chanceux, ces réalistes, ces survivants qui détiennent enfin le pouvoir, veulent le garder pour eux. Certains se sont enrichis. Ils expriment le désir de cette couche sociale qui a acheté les biens confisqués aux émigrés, aux suspects, à l'Église. Ces hommes sont patriotes par conviction autant que par intérêt. Ils ne veulent être spoliés ni par les aristocrates réclamant leurs biens, ni par les sans-culottes exigeant qu'on les partage.
Avec cette Convention thermidorienne, la France expérimente une forme politique nouvelle : le gouvernement républicain du centre, une sorte de « troisième force » hostile avec autant de détermination aux royalistes qu'aux jacobins sans-culottes.
Et se servant de l'une ou l'autre de ces factions pour écraser la plus menaçante des deux et renforcer ainsi le centre.
Certes, pour briser ces extrêmes, il faut disposer d'une force armée.
Précisément, les soldats de la nation sont victorieux aux frontières. Après la Belgique, la Hollande est conquise. On imagine des « républiques sœurs », un agrandissement de la France jusqu'aux frontières « naturelles » (le Rhin). Et la première coalition se disloque : la Prusse, la Hollande et l'Espagne s'en retirent.
Reste l'intraitable Angleterre, toujours menaçante, ravivant la guerre en débarquant dans la presqu'île de Quiberon 4 000 émigrés (26 juin 1795) afin de ranimer dans tout l'Ouest l'insurrection vendéenne avec laquelle Paris avait réussi à négocier une trêve.
En quelques semaines, le général Hoche va écraser ces émigrés : on les fusillera par centaines, et leurs chefs, Stofflet, Charette, seront exécutés quelques mois plus tard.
Ces conventionnels qui veulent gouverner « au centre » ne sont pas des hommes à scrupules.
En cinq années, ils ont appris qu'il faut savoir annihiler l'adversaire, détruire la faction rivale. La Révolution a fait de tous les hommes politiques français des cyniques qui se déterminent en fonction du rapport des forces.
Ces thermidoriens n'ont pas hésité à se servir de la « jeunesse dorée », de ces « muscadins » royalistes, pour fermer le club des Jacobins (12 novembre 1794), briser les sans-culottes, cette « queue de Robespierre » qui réclamait du pain pour les plus pauvres.
Car on a faim, dans le quart état. L'assignat n'est plus qu'à 8 % de sa valeur nominale. Les prix des denrées (viande, pommes de terre) ont augmenté de 400 à 900 %.
Des mères se suicident avec leurs enfants en se jetant dans la Seine.
D'un côté, ces républicains thermidoriens jouissent de leurs biens, mais, à la porte des cafés où ils se gobergent, des républicains sans-culottes crient famine.
Le peuple fait l'expérience que la République peut le laisser mourir de faim, que les changements institutionnels n'effacent pas la misère.
Alors on se rassemble, on se souvient des « journées révolutionnaires ». Les femmes et les sans-culottes envahissent la Convention le 12 germinal (1er avril 1795) et le 1er prairial (20 mai 1795). On lance aux conventionnels : « Que le sang coule, celui des riches, des monopoleurs et des spéculateurs ! Du temps de Robespierre, la guillotine fonctionnait, mais on mangeait à sa faim ! »
Le pouvoir laisse l'insurrection se déployer, certains députés montagnards se rallier à elle, puis l'armée et les sections modérées de l'ouest de Paris encerclent le faubourg Saint-Antoine. Après quelques jours de résistance, cette « Commune » de sans-culottes est écrasée par les armes.
On exécute. On condamne à mort. Six députés montagnards se suicident.
Les républicains du centre prouvent qu'ils savent eux aussi se montrer impitoyables.
Ainsi s'inscrit dans l'âme de la France l'idée que l'ordre, le respect des biens et des propriétés, l'emploi de la force contre ceux qui veulent les violer, peuvent aussi faire partie d'une politique républicaine.
Un jour, dans les années 1870, Thiers dira : « La République sera conservatrice ou ne sera pas. » Et les troupes versaillaises materont le Paris de la Commune.
La période révolutionnaire a aussi « inventé » cette politique-là.
Elle laisse faire les bandes royalistes qui, à Lyon, à Marseille, en Provence, traquent les Jacobins, les massacrent dans les prisons – à Aix, à Tarascon, à Marseille, etc., on dénombrera près d'un millier de victimes de cette « terreur blanche ».
Mais, dès lors que ces mêmes royalistes représentent à nouveau une menace pour le pouvoir, les thermidoriens sont prêts à tout pour défendre leur République, qui est aussi la République.
Ils l'ont montré dans la presqu'île de Quiberon en fusillant les émigrés débarqués par les navires anglais et faits prisonniers.
Pour défendre le nouveau régime, ils dressent aussi une forteresse constitutionnelle, la Constitution de l'an III (août 1795), qui comporte deux Conseils élus par les 20 000 Français les plus riches : celui des Anciens et celui des Cinq-Cents, ainsi que cinq Directeurs, renouvelables les uns et les autres par tiers chaque année ou tous les trois ans. Le peuple « approuve » par un million de voix pour, 50 000 contre et... cinq millions d'abstentions.
Mais peu importe : la procédure est « démocratique », elle est bien formellement républicaine. Et les royalistes, qui espéraient subvertir la République en pénétrant légalement ses institutions par la voie électorale, sont bernés.
Par 200 000 voix contre 100 000, les conventionnels ont en effet fait adopter un décret dit des deux tiers qui précise que les deux tiers des membres des nouveaux Conseils législatifs devront être choisis parmi les... conventionnels ! Les royalistes et le peuple découvrent qu'on peut concevoir des institutions formellement républicaines qui permettent de contrôler les élections par un jeu politique truqué.
Nouvelle leçon de politique « moderne » donnée par la Révolution, la grande école du cynisme politique.
Il ne reste plus aux royalistes qu'à tenter eux aussi une « insurrection », une « journée révolutionnaire ».
Le 13 vendémiaire (5 octobre 1795), ils rassemblent vingt mille manifestants en armes qui se dirigent vers la Convention.
Barras – ancien terroriste, bien décidé à jouir des biens et du pouvoir dans ce régime qui désormais est le sien –, chargé du commandement des troupes de Paris, va s'adjoindre des généraux connus pour leurs sentiments jacobins. L'un d'eux, suspect de « robespierrisme », a même été arrêté en thermidor. Depuis lors, il traîne son sabre inutile dans Paris.
Il va disperser au canon les royalistes, qui laissent trois cents morts sur les marches de l'église Saint-Roch et dans les rues avoisinantes.
La République est donc « sauvée ». La Convention peut se séparer, le 26 octobre 1795, pour laisser place au Directoire.
Mais ce « centre » républicain n'a survécu, ne l'a emporté que parce que l'armée lui a obéi.
La guerre aux frontières a fait de l'armée la garante de l'ordre intérieur, et donc de la République.
Elle est entrée sur la scène politique et y a joué aussitôt un rôle déterminant.
Peut-elle accepter de retourner dans l'ombre ?
Le « général Vendémiaire » se nomme Napoléon Bonaparte.
41.
Ce général Bonaparte qui noie dans le sang, à coups de canons, une tentative d'insurrection royaliste, la France ne pourra plus l'oublier.
Ainsi, le 13 vendémiaire (5 octobre 1795) commence à se creuser un nouveau sillon dans l'histoire nationale. L'âme de la France va s'en trouver marquée en profondeur. Une tradition, celle de l'homme providentiel, de l'homme du recours, hissé au-dessus des factions – ou des partis – qui s'opposent, se dessine de plus en plus nettement durant ces quatre années qui vont se terminer par le coup d'État des 18 et 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799), quand Bonaparte mettra fin au Directoire et s'emparera de la réalité du pouvoir.
La Révolution qui avait mis en place un régime d'assemblée, qui s'était définie, avec la République, comme la structure la plus opposée à la monarchie absolue, donne donc naissance au pouvoir personnel d'un général, lecteur et admirateur de César.
Les thermidoriens, qui avaient affirmé qu'ils ne voulaient ni « de la dictature de César ni de la royauté de Tarquin », ont fait appel pour les défendre à un homme qui se rêve empereur après avoir conquis la gloire sur les champs de bataille, à l'image de César.
Dans l'âme de la France, son aventure devient une référence.
Pour certains, il est l'antimodèle, l'ogre « infamant », le général putschiste. Pour d'autres, il est le chef exemplaire, charismatique, qui balaie les politiciens corrompus, lâches, incapables, petits hommes sans gloire que la vue d'un manipule suffit à disperser comme des oiseaux apeurés.
Mais, quel que soit le jugement qu'on porte sur le personnage, il est l'un des môles qui marquent les débuts de la période contemporaine de notre histoire.
Un courant politique se forme autour de lui : espérance ou menace, c'est le bonapartisme. Face à l'impuissance des politiciens, l'homme du recours, par un coup d'État que légitime la situation de la nation et restaure l'ordre et l'autorité. Il unifie le peuple. Il défend les intérêts de toute la patrie contre ceux qui, révolutionnaires ou monarchistes, n'agissent qu'en fonction de leur idéologie ou de leur clientèle.
Il incarne le centre opposé aux extrêmes.
Sa force lui vient de ce qu'il a le soutien du peuple et des armées.
Si ce général de coup d'État, ce dictateur – ou bien ce héros météorique – s'est imposé jusqu'à occuper pareille place dans l'âme de la France, c'est que la situation de la nation favorise son entreprise et permet à son ambition de se réaliser.
En ces dernières années du xviiie siècle, après la tourmente révolutionnaire, la société française a soif de paix intérieure et de stabilité.
Les notables, les nantis, les paysans, qui ont profité les uns de la vente des biens nationaux, les autres, de la suppression des droits seigneuriaux, aspirent au calme.
La guerre ne les affecte qu'indirectement (conscription, impôts). Elle se déroule loin de la France : en Italie, contre l'Autriche, et Bonaparte, qui s'est vu confier le commandement de l'armée d'Italie en guise de récompense pour les services rendus en vendémiaire, s'y couvre de gloire à Arcole, à Rivoli. Il signe le traité de Campoformio. Il envoie son butin – argent et œuvres d'art – au Directoire.
À la manière de César, il écrit sa propre légende, transforme chacune de ses actions en triomphe, conquiert l'opinion.
Il met ainsi en œuvre une stratégie qui combine la gloire militaire (il montre du génie dans cette campagne d'Italie de 1796 à 1797) et la sociabilité politique (il est l'homme de Barras, proche de Sieyès, de Fouché, de Talleyrand) qui le fait apparaître comme le général au service des Directeurs, mais il est aussi le chef indépendant qui porte les espoirs de l'opinion.
Avec son épée, il peut trancher le nœud gordien des intrigues politiciennes.
Son aventure égyptienne – mai 1798 – et son retour « miraculeux », en octobre 1799, font de lui un héros de légende.
Mais il ne peut jouer ce rôle que parce que le Directoire ne parvient pas à stabiliser la situation.
Le pouvoir des Directeurs, qui, comme celui des thermidoriens, entend se situer au centre, est menacé : d'un côté, les héritiers des Jacobins et des enragés parlant au nom du peuple des « infortunés » rêvent d'une société égalitaire ; de l'autre, par le simple jeu électoral, les institutions risquent d'être pénétrées par les « Jacobins blancs », ces royalistes qui veulent en finir avec la République, même s'ils divergent sur le type de monarchie à rétablir (absolue ou constitutionnelle).
Gauche, droite, centre : figures désormais classiques de la politique française.
En mai 1796, le Directoire déjoue la « conspiration des Égaux » fomentée par Babeuf, qui vise à établir un communisme de répartition supprimant la propriété privée.
Babeuf se poignardera au cours de son procès, et une trentaine de ses compagnons seront fusillés en 1797.
Mais leur souvenir, transmis par quelques survivants – Buonarroti –, fera germer au xixe siècle les idées « babouvistes », créant un socle pour le communisme et le socialisme français dont on mesure ainsi l'enracinement profond dans l'histoire nationale.
Le 18 fructidor (avril 1797), le Directoire doit faire face à une poussée électorale royaliste ; les Directeurs font alors appel au général Bonaparte, qui leur délègue le général Augereau.
Terreur froide : arrestations, épurations, déportations.
La preuve est faite à nouveau que le centre ne peut imposer sa politique républicaine – défendant les transferts de propriété qui ont eu lieu pendant la Révolution, affirmant le caractère laïque de l'État dans une perspective voltairienne – que s'il dispose du soutien de l'armée.
Ce soutien est d'autant plus nécessaire qu'en 1798 (le 21 floréal), le Directoire doit faire face à une poussée électorale de la « gauche », cette fois, et que seul un coup de force – un vrai coup d'État – permet d'exclure les députés élus de cette tendance.
Malgré cela, l'influence des néojacobins s'accroît en juin 1799. On parle à nouveau de « bonheur du peuple ». On exige des mesures en sa faveur : « Élaguez ces fortunes immenses qui font le scandale des mœurs, établissez l'impôt progressif sur les fortunes, réduisez les impôts indirects, faites des économies en renvoyant les fonctionnaires inutiles, en diminuant l'indemnité des députés et les pensions des Directeurs ! »
Des revendications « modernes » se font ainsi jour dans le langage politique. Elles traverseront les décennies.
En même temps, on veut en finir avec le « système de bascule », l'instabilité qui fait soutenir la gauche contre la droite, et vice versa.
Derrière les néojacobins se profile le parti des généraux. Ils sont victorieux. Ils ont créé des républiques sœurs : la Batave, la Cisalpine, la Romaine, l'Helvétique, la Parthénopéenne (napolitaine). Ils ont accumulé des « trésors de guerre ». Les soldats leur sont dévoués, puisque ce sont les généraux qui les paient.
Ce néojacobinisme « armé » annoncerait-il le retour à un robespierrisme rebouilli ?
Sieyès s'en inquiète. Il dénonce la « sanglante tyrannie » des Jacobins de l'an II et leur « pouvoir monstrueux », dont il faut empêcher la renaissance.
Les « républicains du centre » – Sieyès, Fouché, Talleyrand – se tournent vers Bonaparte rentré d'Égypte.
Il est l'homme providentiel. Il se présente comme sans ambition personnelle, prêt seulement à mettre sa popularité au service du parti de l'ordre.
Son frère Lucien a été élu président du Conseil des Cinq-Cents, mais lui, « le plus civil des généraux », évoque moins ses exploits militaires que les découvertes que les savants qui l'ont accompagné en Égypte ont réalisées au pays des pharaons.
À Saint-Cloud, où se sont réunis les conseillers, après un moment difficile, Murat, à la tête d'une compagnie de grenadiers, disperse les élus en criant à ses soldats : « Foutez-moi tout ce monde-là dehors ! »
C'est la technique d'un coup d'État moderne, mêlant le coup de force parlementaire à l'action armée, l'apparence légale à la violence, que Bonaparte et ses complices ont appliquée.
Bonaparte peut se présenter comme l'homme du centre, au-dessus des partis, incarnant l'union des Français contre les « anarchistes » et les « royalistes ».
« Tous les partis sont venus à moi, m'ont confié leurs desseins, dévoilé leurs secrets, et m'ont demandé mon appui : j'ai refusé d'être l'homme d'un parti », dit-il.
En fait, il veut rassembler tous les notables et, autour d'eux, le peuple, en ne revenant pas sur les conquêtes majeures de la Révolution dans l'ordre social : abolition des droits seigneuriaux, liberté de la propriété, vente des biens nationaux.
Le ciment de cette union, c'est le patriotisme.
Il dit : « Ni bonnet rouge [révolutionnaire] ni talon rouge [aristocratique] : je suis national ! »
La Révolution, la République, sont l'assomption de la nation.
CHRONOLOGIE III
Vingt dates clés (1715-1799)
1715-1723 : Régence de Philippe d'Orléans. Louis XV a cinq ans
1757 : Attentat de Damiens contre Louis XV (1715-1774)
1771 : Réformes de Maupeou : abolition de la vénalité des offices, gratuité de la justice, etc.
1774 : Louis XVI (1774-1792) rétablit les parlements dans leurs privilèges
1784-1785 : Affaire du « collier de la reine » qui discrédite la monarchie
1788 : À Vizille, les états du Dauphiné réclament la convoca-tion des états généraux
5 mai 1789 : Ouverture des états généraux à Versailles
14 juillet 1790 : Fête de la Fédération au Champ-de-Mars
20-21 juin 1791 : Fuite du roi à Varennes
20 avril 1792 : Déclaration de guerre à l'Autriche et à la Prusse
20 septembre 1792 : Victoire de Valmy et, le 21 septembre, abolition de la royauté, puis proclamation de la Répu-blique une et indivisible (25 septembre)
21 janvier 1793 : Exécution de Louis XVI
Mars 1793 : Soulèvement de la Vendée contre la Convention
Septembre 1793 : Loi des suspects et loi sur le maximum des prix et salaires
8 juin 1794 : Fête de l'Être suprême
27 juillet 1794 : (9 thermidor an II) Chute de Robespierre
5 octobre 1795 : (13 vendémiaire) Bonaparte écrase un soulè-vement royaliste
1796 : Bonaparte général de l'armée d'Italie
Mai 1798 – août 1799 : Bonaparte conduit l'expédition d'Égypte
9-10 novembre 1799 : (18 et 19 brumaire) Coup d'État de Bonaparte, fin du Directoire, Bonaparte premier consul
LIVRE IV
LA RÉPUBLIQUE IMPÉRIALE
1799-1920
1
LA COURSE DU MÉTÉORE
1799-1815
42
Il suffit à Napoléon Bonaparte de moins de cinq années – 1799-1804 – pour, comme il le dit, « jeter sur le sol de la France quelques masses de granit ».
Ces menhirs et ces dolmens institutionnels, du Code civil à l'Université et à la Banque de France, y demeurent souvent encore, et même quand ils ont été érodés, remodelés, parfois enfouis, les empreintes qu'ils ont laissées dans l'âme de la France sont si nettes qu'on peut dire que Napoléon Bonaparte, premier consul ou empereur, a dessiné la géographie administrative et mentale de la nation.
Certes, il a souvent utilisé les « blocs » déjà mis en place par la Révolution – les départements – et, avant elle, par des souverains qui voulaient bâtir une monarchie centralisée, absolue.
Symboliquement, dès le 19 février 1800, Bonaparte s'est d'ailleurs installé aux Tuileries.
Il y a trois consuls dans la nouvelle Constitution, mais Bonaparte est le premier ; les deux autres ne sont que les « deux bras d'un fauteuil dans lequel Bonaparte s'est assis ».
Il suffira de ces cinq années pour que le général de Brumaire devienne d'abord consul pour dix ans, puis à vie, enfin empereur, sacré par le pape Pie VII à Notre-Dame.
Mais à chaque étape de cette marche vers l'Empire – la souveraineté absolue – le peuple a été consulté par plébiscite. Et, quelles que soient les limites et les manipulations de ces scrutins, ils ont ancré dans le pays profond l'idée que le vote doit donner naissance au pouvoir, et que le suffrage populaire lui confère sa légitimité.
Le premier plébiscite – en février 1800 – rassemble 3 millions de oui et 1 562 non ; le consulat à vie est approuvé le 2 août 1802 par 3 568 885 voix contre 8 374 ; le 2 août 1804, le plébiscite en faveur de l'Empire recueille 3 572 329 voix contre 2 568 !
Sans doute, au moment du sacre, Napoléon s'est-il agenouillé devant le pape, mais le plébiscite a précédé cette « sacralisation » traditionnelle, suivie par le geste de Napoléon se couronnant lui-même et couronnant Joséphine de Beauharnais, puis prêtant serment devant les citoyens.
« Ce n'est qu'en compromettant successivement toutes les autorités que j'assurerai la mienne, c'est-à-dire celle de la Révolution que nous voulons consolider », explique-t-il.
Comme le dira une citoyenne interrogée après le sacre : « Autrefois nous avions le roi des aristocrates ; aujourd'hui nous avons le roi du peuple. »
C'est bien, dans des « habits anciens » – ceux de la monarchie, voire des empires romain ou carolingien –, un nouveau régime qui surgit et qui entend élever sur le double socle – monarchique et révolutionnaire – une nouvelle dynastie, une noblesse d'Empire rassemblée dans un ordre (celui de la Légion d'honneur), hiérarchisée (les maréchaux d'Empire), héréditaire, mais ouverte par le principe réaffirmé de l'égalité.
Les émigrés sont amnistiés (en 1802), ils peuvent s'insérer dans les rouages du pouvoir, mais la rupture avec la monarchie d'Ancien Régime est franche et tranchée.
En septembre 1800, à Louis XVIII qui l'invite à rétablir la monarchie légitime, Bonaparte répond : « Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France. Il vous faudrait marcher sur 100 000 cadavres. »
Et au mois de mars 1804, le duc d'Enghien, soupçonné de préparer le retour de la monarchie en prenant la tête d'un complot monarchiste (Cadoudal, les généraux Pichegru et Moreau), est enlevé dans le pays de Bade et fusillé dans les fossés de Vincennes (21 mars).
Cadoudal le Vendéen est guillotiné en place de Grève par le fils du bourreau Sanson qui avait décapité Louis XVI.
Même quand il entre dans la grande nef de Notre-Dame pour s'y faire sacrer empereur, Napoléon est l'héritier des Jacobins. Les membres de l'ordre de la Légion d'honneur, lorsqu'ils prêtent serment, s'engagent à conserver les territoires français – donc les conquêtes de la Révolution – dans leur intégrité, à défendre la propriété libérée des contraintes féodales, à reconnaître comme définitif le transfert de propriété résultant de la vente des biens nationaux et à affirmer le principe d'égalité.
Dès le lendemain du coup d'État de Brumaire, Bonaparte avait dit : « La Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée : elle est finie. »
« Je suis la Révolution », a même ajouté Bonaparte en commentant et assumant l'exécution du duc d'Enghien.
Mais c'est un régime original qui façonne l'âme de la France.
La consultation des citoyens par le moyen de votes successifs tamise une minorité de notables désignant les représentants des Français au Tribunat – qui discute mais ne vote pas – au Corps législatif – qui vote mais ne discute pas.
Par le jeu des plébiscites, Napoléon est formellement l'empereur des Français, alors que l'autorité vient en fait d'en haut, et non du peuple.
Mais les « apparences » démocratiques sont capitales.
L'âme de la France va s'en imprégner.
Elle y voit conforté le principe d'égalité, ressort de l'histoire nationale. Un libéral comme Benjamin Constant peut bien dire que le Consulat, puis l'Empire sont des « régimes de servitude et de silence », rappeler le rôle de la police, les nombreuses violations des droits de l'homme, la censure généralisée, le peuple mesure la différence avec l'Ancien Régime.
Le vent de l'égalité continue de souffler : chaque soldat a un bâton de maréchal dans sa giberne. Illusion, certes, mais le mirage dure, enivre l'âme de la France.
En même temps, la société s'imprègne des valeurs militaires que Napoléon Bonaparte incarne : ordre, autorité, héroïsme, gloire, nation.
Et ce régime est accepté, plébiscité.
C'est une dictature, mais le despote est éclairé. Il est homme des Lumières.
Son frère Lucien est Grand Maître du Grand Orient de France, qui regroupe alors toutes les loges maçonniques.
Quand la paix religieuse est rétablie – le concordat date du 16 juillet 1802 –, le catholicisme n'est pas décrété religion d'État, mais seulement religion de la majorité des Français. Nombreux, parmi les officiers, les voltairiens de son entourage, sont ceux qui bougonnent, mais ce compromis leur convient. Juifs et protestants trouveront d'ailleurs leur place aux côtés des catholiques sous la férule d'un empereur qui se serait fait « mahométan chez les mahométans ».
Cette pacification religieuse, qui place les Églises dans la dépendance de l'État, n'est qu'un des aspects de ce régime d'autorité et d'ordre qu'en l'espace de cinq années Napoléon Bonaparte met en place.
Banque de France, Code civil, préfets et sous-préfets, lycées, école de Saint-Cyr, réorganisation de l'Institut en quatre classes, chambres de commerce, divisions administratives, dotation à la Comédie-Française, pension de retraite des fonctionnaires, préfecture de police à Paris, organisation hiérarchisée de l'Université, Légion d'honneur : la France moderne, fille de la monarchie et de la Révolution, sort de terre.
À cela s'ajoute la gloire militaire, après que Napoléon Bonaparte a défait les Autrichiens en Italie, à Marengo (14 juin 1800).
Bataille et victoire exemplaires, puisque le mérite en revient à Desaix – qui y trouve la mort – et à Kellermann, mais dont la presse aux ordres attribue tout le mérite à Napoléon Bonaparte.
Ainsi se confirme le rôle moderne de la propagande dans le fonctionnement d'un régime qui accentue la personnalisation – les grands tableaux historiques, les images d'Épinal, figurent et diffusent sa geste héroïque – et construit ainsi la légende napoléonienne.
Elle masque les répressions et les reniements : ainsi du plus symbolique et du plus inacceptable d'entre eux, le rétablissement, le 20 mai 1802, de l'esclavage aboli par la Convention, la déportation et la mort de Toussaint-Louverture, les massacres de Noirs à Saint-Domingue.
Ou bien la surveillance policière qui, par le biais du « livret ouvrier », contrôle la population laborieuse des villes, la plus rebelle parce que ne bénéficiant pas, comme la paysannerie, du transfert de propriété, de l'abandon des droits seigneuriaux réalisés pendant la Révolution.
Le régime s'appuie ainsi sur la gloire du premier consul, la paix qu'il apporte – elle est signée avec l'Angleterre à Amiens en 1802, mais ne durera qu'un an –, le silence qu'il impose.
Il assure la protection des propriétés et la stabilité monétaire avec la création du franc germinal et la concession à la Banque de France du privilège de l'émission.
Les notables, les propriétaires et les rentiers sont satisfaits. Les formes de la politique propres à la France contemporaine se dessinent ici.
Le fonctionnement démocratique – le vote – est corseté et manipulé par le pouvoir incarné par une personnalité héroïque au-dessus des factions, des partis et des intérêts. C'est un régime de notables, de « fonctionnaires » d'autorité (militaires, préfets), auquel la paysannerie sert de base populaire. Mais Napoléon Bonaparte en est la clé de voûte.
C'est dire que cette construction politique dépend étroitement de la « gloire » du « héros », donc d'une défaite militaire ou de la disparition de la personne du consul.
Ainsi, la rumeur de la défaite et de la mort de Napoléon à Marengo ébranle tout le régime en 1800.
La création de l'Empire est une tentative pour le pérenniser.
Un député du Tribunat – Curée – déclare ainsi le 30 avril 1804 : « Il ne nous est plus permis de marcher lentement, le temps se hâte. Le siècle de Bonaparte est à sa quatrième année ; la Nation veut qu'un chef aussi illustre veille sur sa destinée. »
Napoléon Bonaparte est sacré empereur des Français le 2 décembre 1804.
Mais la course d'un météore ne peut que s'accélérer.
43
En cinq nouvelles années, de 1804 à 1809, Napoléon plonge l'âme de la France dans l'ivresse de la légende. Et durant deux siècles la nation titubera au souvenir de ce rêve de grandeur qui a le visage des grognards d'Austerlitz, d'Iéna, d'Auerstaedt, d'Eylau et de Friedland.
Napoléon entre et couche dans les palais de Vienne, de Berlin, de Varsovie, de Madrid, de Moscou. Il est le roi des rois.
À Milan, il s'est fait couronner roi d'Italie. Son frère Joseph est roi de Naples avant d'être roi d'Espagne. Son frère Louis est roi de Hollande. Sa sœur Elisa est princesse de Lucques. Les maréchaux d'Empire deviennent à leur tour rois selon le bon plaisir de l'Empereur.
Ses soldats sont à Lisbonne et sur les bords du Niémen. Ils occupent Naples et Rome.
Cette légende napoléonienne n'imprègne pas seulement la France, elle bouleverse l'Europe, dont elle modifie l'équilibre et change l'âme.
La Grande Armée apporte dans ses fontes le Code civil, mais aussi les semences de la révolte contre cette France impériale qui annexe et qui s'institue, de la Russie au Portugal, maîtresse du destin des peuples.
Or ceux-ci, de Madrid à Berlin, du Tyrol à Naples, affirment leur identité.
Fichte écrit ses premiers Discours à la nation allemande (1807) et Goya peint les insurgés qui, el dos y el tres de Mayo – les 2 et 3 mai 1808 –, attaquent les troupes françaises à Madrid, puis dans toute l'Espagne et sont réprimés.
De 1804 à 1809 s'esquisse l'Europe du xixe siècle et de la plus grande partie du xxe, dans laquelle les nations, nouant et dénouant leurs alliances, s'affrontent dans des guerres dont ces cinq années napoléoniennes auront été les ferments.
L'âme même de la France est profondément modelée par cette période où se fixent son destin, celui de l'Empire napoléonien et le regard que ce pays porte sur lui-même et sur l'Europe.
Car on n'est pas impunément la nation dont les soldats ont vu se lever le soleil d'Austerlitz le 2 décembre 1805.
D'abord, cette nation s'imprègne des valeurs d'autorité.
Le régime n'est pas seulement cet Empire plébiscitaire où l'égalité et les bouleversements produits par la Révolution sont admis, « codifiés ».
Il est aussi une dictature militaire, avec son catéchisme impérial, son université impériale, ses lycées qui marchent au tambour (1 700 bacheliers en 1813), sa noblesse d'Empire (1808).
La France voit ainsi se poursuivre la tradition d'une monarchie absolue, centralisée.
Le contrôle de tous les rouages de la nation est même plus pointilleux, plus efficace, plus « bureaucratique » qu'il n'était au temps des monarques légitimes, quand le pays restait souvent « un agrégat inconstitué de peuples désunis ».
Napoléon, empereur « jacobin », régente toutes les institutions. Il a ses préfets, ses évêques, ses gendarmes, sa Légion d'honneur, son Code civil et sa Cour des comptes (1808) pour tenir toute la nation serrée.
Il promeut aux « dignités impériales ». Il dote les siens. Car l'Empire des Français entend bien devenir celui d'une dynastie.
Dès 1807, on s'inquiète, dans l'entourage de Napoléon, de sa descendance. On songe au divorce de l'Empereur d'avec Joséphine de Beauharnais, incapable de donner naissance à un fils.
Napoléon a marié son frère Louis, roi de Hollande, à Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine, et en 1808 naîtra de cette union Louis-Napoléon, futur Napoléon III, qui régnera jusqu'en 1870.
À cette réalité dynastique, on mesure le prolongement, durant tout le xixe siècle français, de ce qui s'est joué au cours de ces années légendaires.
Napoléon renforce – aggrave – les traits de la monarchie, qu'il associe à l'héritage révolutionnaire. Et toutes les intrigues de la Cour, les pathologies politiques liées au pouvoir d'un seul, s'en trouvent soulignées.
Car Napoléon a la vigueur brutale d'un fondateur de dynastie. C'est un homme d'armes. Il a conquis son pouvoir par l'intrigue et le glaive, non par la naissance.
Il est vu et se voit comme un « homme providentiel », une sorte de substitut laïque – même s'il a été sacré par le pape – au monarque de droit divin.
Dans son entourage, il y a d'ailleurs des régicides.
Ainsi ce Fouché, homme de toutes les polices, auquel Napoléon reproche de susciter rumeurs et intrigues. Ou bien ce Talleyrand qui a célébré comme évêque d'Autun la fête de la Fédération (14 juillet 1790) et que, publiquement, l'Empereur rudoie :
« Vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans foi ! Vous avez toute votre vie trompé, trahi tout le monde. Je vous ai comblé de biens et il n'y a rien dont vous ne soyez capable contre moi. Vous mériteriez que je vous brisasse comme du verre, j'en ai le pouvoir, mais je vous méprise trop pour en prendre la peine. Oh, tenez, vous êtes de la merde dans un bas de soie » (janvier 1809).
Après la longue durée monarchique et la période sanglante de la Révolution, ces années napoléoniennes achèvent d'éclairer la nation sur la nature du pouvoir politique.
Elle en mesure l'importance et en même temps s'en méfie. Elle s'en tient à distance tout en rêvant à l'homme placé par le destin au-dessus des autres et qui, un temps, est capable de l'incarner, elle.
Elle rejette et méprise ceux qui grouillent et grenouillent autour de lui. Elle n'est pas dupe du pouvoir, qu'il se présente comme monarchique ou révolutionnaire.
Mais elle continue d'espérer en l'homme providentiel capable de résoudre ses contradictions, de la porter un temps au-dessus d'elle-même, dans l'éclat de sa gloire.
Napoléon conforte ce penchant national.
Il l'encourage par une propagande systématique.
Les Bulletins de la Grande Armée (le premier date d'octobre 1805) rapportent ses exploits, reconstituent les batailles pour en faire autant de chapitres de la légende.
Le 30 décembre 1805, le Tribunat lui décerne le titre de Napoléon le Grand. On fête le 15 août la Saint-Napoléon. On célèbre ses victoires par des Te Deum et des salves de canons. On édifie des arcs de triomphe à sa gloire.
Car la réalité quotidienne de ces années, c'est la guerre dans toute l'Europe.
Les coalitions anti françaises se succèdent, rassemblant, selon les séquences, l'Autriche, la Russie ou la Prusse autour de la clé de voûte qu'est l'Angleterre.
Ainsi se dessine une géopolitique européenne qui perdurera et dont Napoléon est à la fois l'héritier et le concepteur.
L'âme de la France en épouse les contours.
Il y a l'Angleterre, qu'on ne peut conquérir (le 21 octobre 1805, Trafalgar a vu le naufrage de la flotte franco-espagnole). Elle est l'organisatrice de la résistance à cet effort d'unification du continent européen qu'est aussi la conquête impériale. Que Londres rallie la totalité des puissances européennes ou seulement quelques-unes, son dessein reste inchangé : réduire les ambitions françaises, empêcher la création du Grand Empire, s'appuyer sur l'Autriche, la Prusse, la Russie.
À rebours, Napoléon s'efforce de détacher l'une ou l'autre de ces puissances de la coalition anglaise.
Il annexe. Il se fait roi d'Italie. Il couronne ses frères. Il est le protecteur de la Confédération du Rhin. Il songe déjà à un mariage avec une héritière des Habsbourg pour renouer avec la tradition monarchique de l'alliance avec Vienne.
Le 21 novembre 1806, à Berlin, il décrète que les îles Britanniques sont en état de blocus. Et ce Blocus continental – interdiction à l'Angleterre de vendre ou d'importer, saisie de ses navires et des bâtiments qui commercent avec elle – contient le principe d'une guerre infinie, puisque, pour être efficace, la mesure doit s'appliquer à toute l'Europe, au besoin par la force.
Réciproquement, l'Angleterre ne peut accepter l'existence de cet Empire continental qui menace sa suprématie commerciale et diplomatique.
De même, les puissances monarchiques européennes – de plus en plus soutenues par une opinion qui découvre la nation, le patriotisme – ne peuvent admettre cet empereur qui chevauche la Révolution et diffuse un Code civil, un esprit des Lumières sapant l'autorité des souverains.
La guerre est donc là, permanente, grande consommatrice d'hommes et de capitaux, modelant l'âme de la France, valorisant l'héroïsme, le « militaire » plutôt que le « marchand », « brutalisant » la France et l'Europe.
C'est un engrenage où il faut non point de « l'humeur et des petites passions, mais des vues froides et conformes à sa position ».
Dès lors, l'inspiration « révolutionnaire » de l'Empire napoléonien cède la place aux exigences géopolitiques. L'idée s'impose que l'on pourrait contrôler l'Europe continentale en la serrant entre les deux mâchoires d'une alliance franco-russe.
Après Eylau et Friedland (1807), Napoléon rencontre le tsar Alexandre au milieu du Niémen et signe avec lui le traité de Tilsit (1807).
Ainsi naît une « tradition » diplomatique liant Paris à Saint-Pétersbourg, fruit de l'illusion plus que de la réalité.
Mais il faut aussitôt courir à l'autre bout de l'Europe parce que le Portugal est une brèche dans le Blocus continental, qu'il convient de refermer.
Les troupes françaises s'enfoncent en Espagne, dont Lucien Bonaparte devient roi, mais le peuple espagnol se soulève.
La France n'est plus la libératrice qui porte l'esprit des Lumières, mais fait figure d'Antéchrist.
« De qui procède Napoléon ? interroge un catéchisme espagnol. De l'Enfer et du péché ! »
Ainsi se retourne l'image de la France, nation tantôt admirée, tantôt haïe.
Ce sont ses soldats, parfois des anciens de Valmy, devenus fusilleurs, que Goya peint dans Les Horreurs de la guerre.
44.
Cinq années encore – 1809-1814 –, et la course du météore Napoléon s'arrête.
Les « alliés » – Russes, Autrichiens, Prussiens – entrent dans Paris. Le 31 mars, une foule parisienne – des royalistes – acclame le tsar Alexandre : « Vive Alexandre ! Vivent les Alliés ! » On embrasse ses bottes.
Quelques jours plus tard, le 20 avril, après avoir abdiqué, Napoléon s'adresse à sa Garde.
Les mots sonnent comme une tirade d'Edmond Rostand, ils s'inscrivent dans la mémoire collective, reproduits par des millions d'images d'Épinal montrant les grognards en larmes écoutant leur chef.
Le météore s'est immobilisé, mais la légende s'amplifie, envahit l'âme de la France, répète les mots de l'Empereur :
« Soldats de ma vieille Garde, je vous fais mes adieux. Depuis vingt ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire.
« Avec des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue, mais la guerre était interminable : c'eût été la guerre civile, et la France n'en serait devenue que plus malheureuse. J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de notre patrie.
« Je pars. Vous, mes amis, continuez à servir la France. Je voudrais vous presser tous sur mon cœur ; que j'embrasse au moins votre drapeau !
« Adieu encore une fois, mes chers compagnons ! Que ce dernier baiser passe dans vos cœurs ! »
Napoléon échappe ici à l'histoire pour entrer dans le mythe. Mais c'est l'histoire qui, au jour le jour de ces cinq dernières années, l'a vaincu.
Pourtant, la légende est si puissante, si consolante, que l'âme de la nation aura de la peine à reconnaître que, contre la France, ce sont les peuples d'Europe qui se sont dressés.
En Espagne, la guérilla ne cesse pas.
Pour obtenir la reddition de Saragosse, « il a fallu conquérir la ville maison par maison, en se battant contre les hommes, les femmes et les enfants » (février 1809).
En Autriche, un jeune patriote, Friederich Staps, tente à Schönbrunn d'assassiner l'Empereur, qui s'étonne : « Il voulait m'assassiner pour délivrer l'Autriche de la présence des Français » (octobre 1809).
Les victoires des armées impériales (Eckmühl, Essling, Wagram) ne peuvent contenir ce mouvement patriotique qui embrase l'Europe contre la France impériale.
Sous la conduite d'Andreas Hofer, les Tyroliens se soulèvent. Hofer est fusillé. La résistance persiste, encouragée par l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse, la Russie.
Les annexions françaises – la Hollande est rattachée à l'Empire, tout comme la Catalogne, Brême, Lübeck, Hambourg, le duché d'Oldenburg, les États de l'Église – ne renforcent pas l'Empire, mais, au contraire, créent de nouvelles oppositions.
La Russie, dont Napoléon espérait faire un partenaire, rejoint les coalisés.
L'Europe des nations refuse l'Empire napoléonien, qui reste, aux yeux des souverains, une excroissance de la Révolution.
Napoléon n'était qu'un Robespierre à cheval !
Là gît la contradiction majeure de la politique impériale. Elle explique pour une part la place de la légende napoléonienne dans l'âme de la France. On oublie les peuples dressés contre la nation révolutionnaire pour ne retenir que la guerre que lui font les rois.
De fait, Napoléon a tenté de mettre fin à la guerre en concluant le traité de Tilsit avec le tsar, ou par son mariage avec Marie-Louise d'Autriche (1810). Cette union entre l'ancien général – arrêté en 1794 pour robespierrisme – et la descendante des Habsbourg est un acte symbolique de Napoléon pour devenir un « souverain comme les autres », peut-on dire, dans la lignée d'un Louis XVI époux de Marie-Antoinette d'Autriche !
Comme il le déclarera à Metternich, Napoléon espère ainsi « marier » les « idées de mon siècle et les préjugés des Goths », l'empereur des Français issu de la Révolution et la fille de l'empereur d'Autriche.
Ce « mariage » échouera.
La légende réduit à une déception amoureuse ce qui est l'échec d'un compromis politique.
L'Europe monarchique – soutenue par ses peuples dressés contre les armées françaises – se refuse à reconnaître la dynastie napoléonienne. Elle veut briser en Napoléon la Révolution française. L'Autriche elle-même entrera dans la coalition antifrançaise en 1813.
Quant à l'Angleterre, elle poursuit son objectif particulier : empêcher la constitution de l'Empire continental, l'unité de l'Europe sous direction française.
Napoléon est ainsi contraint à la guerre, puisque ce que l'Angleterre et l'Europe monarchique recherchent, c'est non pas un compromis, mais sa capitulation, laquelle serait, plus que la défaite de sa dynastie, celle de la Révolution.
Mais la guerre incessante sape les bases de sa popularité et mine la situation de la nation. Crise financière et crise industrielle affaiblissent le pays en 1811. Il suffit d'une mauvaise récolte, en 1812, pour que le prix du blé augmente, pour que dans de nombreux départements on revive une « crise des subsistances », avec ses conséquences : attaque de convois de grains, émeutes.
Et ce ne sont pas les distributions quotidiennes et gratuites de soupe qui les font cesser, mais une répression sévère qui se solde par de nombreuses exécutions.
Cependant, la guerre ne peut être arrêtée.
Elle s'étend au contraire à la Russie, qui ne respecte pas le Blocus continental et exige l'évacuation de l'Allemagne par les troupes françaises.
Cette campagne de Russie, qui s'ouvre le 24 juin 1812, porte à incandescence toutes les contradictions de la politique napoléonienne.
L'Empereur se heurte à une résistance nationale exaltée par le tsar :
« Peuple russe, plus d'une fois tu as brisé les dents des lions et des tigres qui s'élançaient sur toi, écrit le souverain russe dans une adresse à ses sujets.
« Unissez-vous, la croix dans le cœur et le fer dans la main... Le but, c'est la destruction du tyran qui veut détruire toute la terre.
« Que partout où il portera ses pas dans l'empire, il vous trouve aguerris à ses fourberies, dédaignant ses mensonges et foulant aux pieds son or ! »
Napoléon entre dans Moscou, mais n'a pas osé proclamer l'abolition du servage qui eût pu, peut-être, lui rallier les paysans. Il fait désormais partie de la « famille des rois », et se refuse à provoquer « l'anarchie ».
Mais ses difficultés, son éloignement, sa retraite – il franchit la Bérézina le 29 novembre 1812 –, fragilisent son régime au point qu'un complot, celui du général Malet, se développe à Paris. On tente de s'emparer du pouvoir en prétextant la mort de l'Empereur.
Dans l'entourage même de Napoléon, les généraux faits rois – Bernadotte et Murat en Suède et à Naples – et une bonne partie de la noblesse impériale ne songent plus qu'à trahir ou à s'éloigner de l'Empereur afin de parvenir à un compromis avec les « alliés ».
Au Corps législatif, le 29 décembre 1813, un rapport voté par 223 voix contre 51 décrit une France épuisée et condamne implicitement la politique impériale.
« Une guerre barbare et sans but engloutit périodiquement une jeunesse arrachée à l'éducation, à l'agriculture, au commerce et aux arts... Il est temps que l'on cesse de reprocher à la France de vouloir porter dans le monde entier les torches révolutionnaires. »
C'est un appel à la restauration de l'ordre monarchique.
Face à cet abandon des notables, et avant de choisir d'abdiquer, Napoléon tente, par une brillante campagne de France, d'arrêter l'avance des troupes des coalisés qui, pour la première fois depuis 1792, pénètrent sur le sol national.
Napoléon retrouve alors les tactiques et les mots du général de 1793, de l'empereur qui a été « choisi par quatre millions de Français pour monter sur le trône ».
Et la légende napoléonienne se grossit de ce retour au patriotisme de l'époque révolutionnaire.
« J'appelle les Français au secours des Français ! » s'écrie Napoléon.
« La patrie est en danger, il faut reprendre ses bottes et sa résolution de 93 ! »
Les victoires de Champaubert, de Montmirail, de Château-Thierry, scandent ce retour. Des paysans, sur les arrières des coalisés, mènent une guerre d'embuscades contre les troupes occupantes.
Mais, abandonné par ses généraux, trahi, Napoléon sera contraint de capituler et de faire à Fontainebleau ses adieux à la Garde impériale avant de gagner l'île d'Elbe, dont les coalisés lui ont offert la royauté.
Première Restauration.
Les frères de Louis XVI, Louis XVIII et le comte d'Artois, rentrent à Paris.
La France est « ramenée » aux frontières de 1792.
Une charte est octroyée.
La Révolution a-t-elle eu lieu ? Le drapeau blanc à fleurs de lys remplace le drapeau tricolore.
Des milliers de soldats et d'officiers, les grognards qui ont construit la légende napoléonienne, sont placés en demi-solde.
La maison militaire du roi est rétablie.
Les nobles rentrent de l'émigration. Certains sont réintégrés dans l'armée ; ils ont acquis leurs grades dans les armées des coalisés.
On célèbre le sacrifice de Cadoudal, et une cérémonie expiatoire est organisée à la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Ici et là, des actes de vengeance sont perpétrés. Et le ministre de la Guerre nomme généraux des contre-révolutionnaires qui ont participé aux guerres de Vendée.
Il semble à la nation qu'une France, celle des princes, des émigrés, de ceux qui ont fait la guerre aux côtés de l'étranger, veuille imposer sa loi et ses valeurs à la France non plus de 1794 – celle de la Terreur –, ni à celle de 1804 – celle du sacre de Napoléon –, mais à celle de 1789.
Les ci-devant ont en effet recouvré leur arrogance, et souvent leurs châteaux.
Ce n'est donc pas une nation réconciliée que désirent Louis XVIII et les royalistes, mais cette France d'Ancien Régime que les Français avaient rejetée.
Dans l'âme de la nation, dès ces années 1814-1815, la monarchie apparaît ainsi liée à l'étranger.
Elle est rentrée dans les fourgons des armées ennemies.
Dans ce climat, Napoléon incarne, au contraire, l'amour de la patrie.
Le 1er mars 1815, il débarque à Golfe-Juan.
Il adresse une proclamation à l'armée :
« La victoire marchera au pas de charge ; l'Aigle avec les couleurs nationales volera de clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame : alors vous pourrez montrer avec honneur vos cicatrices – vous serez les libérateurs de la France ! »
Le souffle de la légende balaie à nouveau le pays.
Napoléon est l'homme des trois couleurs de la Révolution et de La Marseillaise, du patriotisme et de la gloire. Et même, ô paradoxe, de la République !
45.
En cent jours, du 1er mars au 22 juin 1815, du débarquement de Golfe-Juan à l'abdication, la légende s'empare de tous les actes de Napoléon et achève de transformer son parcours historique en mythe qui, irriguant l'âme de la France, oriente par là l'histoire de la nation.
Homme providentiel, Napoléon est grandi par la défaite, la déportation à Sainte-Hélène.
Il devient le persécuté, le héros crucifié, et ces Cent-Jours, la défaite sacrificielle de Waterloo, font de lui, par une forme de « sacre », ainsi que l'écrira Victor Hugo, l'« homme-peuple comme Jésus est l'homme-Dieu ».
Lucidement, méticuleusement, lorsque, à Sainte-Hélène, il dicte à Las Casas ses Mémoires, ce Mémorial de Sainte-Hélène qui deviendra le livre de chevet de centaines de milliers de Français – mais aussi d'Européens –, Napoléon s'applique à faire coïncider l'histoire avec le mythe, avec les désirs des nouvelles générations, et à transformer son destin en épopée de la liberté.
Hugo, Stendhal, Vigny, Edmond Rostand, une foule d'écrivains ont contribué à façonner cette légende, et, par là même, à créer dans l'imaginaire français – dans l'âme de la France – une nostalgie qui est attente de l'homme du destin.
Tel Napoléon Bonaparte, celui-ci sera l'incarnation de la nation, il lui procurera grandeur et gloire, confirmera qu'elle occupe avec lui une place singulière dans l'histoire des nations.
Il sera aussi un homme du sacrifice, gravissant le Golgotha, aimé, célébré, entrant au Panthéon de la nation après avoir été trahi par les judas qui l'auront vendu pour quelques deniers.
La légende napoléonienne sous-tend à son tour et renforce cette lecture « christique » de l'histoire nationale.
La France se veut une nation singulière, et il lui faut des héros qui expriment l'exception qu'elle représente.
Elle les attend, les sacre, s'en détourne, puis elle prie en célébrant leur culte.
« Fille aînée de l'Église », cette nation a gardé le souvenir des baptêmes et des sacres royaux, des rois thaumaturges.
La Révolution laïque n'a changé que les apparences de cette posture.
Robespierre lui-même ne conduisit-il pas un grand cortège célébrant l'Être suprême dont il apparaissait comme le représentant sur terre ? Et sa chute, sa mort, ne furent-elles pas autant de signes de cette « passion » révolutionnaire qui l'habitait ?
Et lorsque l'on célèbre, dans une cérémonie expiatoire, la mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette, c'est, sur l'autre versant du Golgotha, le même sacrifice, le même destin qu'on magnifie.
Plus prosaïquement, et avec habileté, durant les Cent-Jours, Napoléon joue du rejet par l'opinion de la restauration monarchique.
Il se présente comme l'homme de 1789 et même de 1793.
Dès le 12 mars, par les décrets de Lyon (ville d'où le comte d'Artois vient de s'enfuir), il réaffirme que l'ancienne noblesse est « abolie », que les chambres sont dissoutes, que les électeurs sont convoqués pour en élire de nouvelles, et que le drapeau tricolore est à nouveau celui de leur nation.
Tout au long de cette marche vers Paris, les troupes se rallient – autant de faits qui deviendront des images d'Épinal, des épisodes de légende –, les paysans l'acclament. Il a choisi de passer par les Alpes et non par la vallée du Rhône, « royaliste ». On plante des « arbres de la liberté », comme en 1789. Il répond qu'il compte « lanterner » les prêtres et les nobles qui veulent rétablir la dîme et les droits féodaux, et il affirme même : « Nous recommençons la Révolution ! »
À son arrivée à Paris, le 20 mars, le « quart état » manifeste dans les faubourgs du Temple, de Saint-Denis, de Saint-Antoine, en chantant La Marseillaise et en brandissant des drapeaux tricolores.
Le Paris des journées révolutionnaires qui, depuis 1794, n'a connu que des défaites et des répressions sort de sa torpeur.
Et les vieux jacobins régicides appellent à soutenir ce nouveau Napoléon qui promulgue l'« Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire », texte libéral qui élargit les pouvoirs des élus.
1 536 000 oui contre 4 802 non approuveront ces nouvelles dispositions.
Ce n'est pourtant là qu'une face de la réalité.
Napoléon n'est pas un jacobin, mais un homme d'ordre, qu'il ne veut pas rompre avec les « notables » qui l'accueillent aux Tuileries pendant que l'on manifeste dans les faubourgs.
« Il faut bien se servir des jacobins pour combattre les dangers les plus pressants, dit Napoléon. Mais soyez tranquilles : je suis là pour les arrêter. »
Le cynisme de l'homme d'action dévoile, dans cette déclaration, l'une des caractéristiques essentielles de l'histoire politique française telle que la Révolution en a redessiné les contours.
La France est une nation « politique ».
Depuis la préparation des élections aux états généraux et par le biais des cahiers de doléances, le peuple est descendu dans l'arène non pas seulement pour protester ou défendre telle ou telle revendication particulière, mais pour intervenir et même s'emparer des problèmes politiques généraux de la nation.
Il y a donc désormais une « opinion populaire », celle qui a provoqué les journées révolutionnaires.
Les « sections » de sans-culottes et les clubs l'orientent.
Elle a pesé sur le sort de la Révolution. Elle est responsable de ses « dérapages » – les massacres de Septembre, la Terreur, l'ébauche de dictature jacobine –, qui, selon certains historiens, sont venus rompre le raisonnable ordonnancement de la monarchie constitutionnelle.
Napoléon Bonaparte a tenté de gouverner au centre de l'échiquier – « ni bonnets rouges ni talons rouges, je suis national » –, mais les « extrémistes » continuent de peser.
Ces néojacobins peuvent servir de contrepoids aux royalistes.
Pour les rallier, il lui faut emprunter leur langage, faire mine de « recommencer la Révolution ».
Et alors que Louis XVIII vient à peine de s'enfuir de Paris pour gagner Gand avec la Cour, Napoléon nomme le régicide Carnot, ancien membre du Comité de salut public, ministre de l'Intérieur.
Manière de rallier à soi les jacobins, de montrer aux royalistes qu'on n'est prêt à aucun compromis avec eux, mais façon aussi de persuader les notables qu'on ne cédera pas aux « anarchistes ».
Cette posture ultime renforce l'image « révolutionnaire » et « républicaine » de l'Empereur.
Ce jeu de bascule – s'appuyer sur le quart état, les sentiments révolutionnaires d'une partie du peuple, pour combattre les royalistes tout en rassurant les notables, puis, une fois le pouvoir consolidé, se dégager du soutien jacobin – devient une figure classique de la vie politique française.
Napoléon Bonaparte en fut l'un des premiers et grands metteurs en œuvre.
Mais, au printemps de 1815, alors que toute l'Europe monarchiste se rassemble pour en finir avec cet « empereur jacobin », la manœuvre ne peut réussir.
Certes, un frémissement patriotique parcourt le pays. On s'enrôle pour aller combattre aux frontières. On entonne Le Chant du départ et La Marseillaise. Et Napoléon ne manquera pas d'hommes pour affronter la septième coalition.
Certes, les fédérés des faubourgs parisiens réclament des armes. Mais Napoléon ne leur en donne pas.
Il veut l'appui des notables, de ce Benjamin Constant qui a rédigé l'« Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire » et qui est précisément un adversaire résolu de la Révolution et de... l'Empire !
Quant aux royalistes, ils se soulèvent en Vendée. Et les électeurs – ce sont des notables – élisent pour la Chambre des représentants des « libéraux » qui aspirent à l'ordre et à la paix.
Or Napoléon ne peut leur apporter que la guerre – puisque les coalisés ont refusé d'entendre ses appels à la paix –, et les notables savent d'expérience que la guerre est un engrenage d'où peut surgir une nouvelle fois le désordre, la terreur, et, au mieux, un renforcement des pouvoirs de ce Napoléon dont l'Europe ne veut plus.
Ainsi, avant même que ne s'engage la bataille de Waterloo, Napoléon a-t-il perdu la guerre politique.
La défaite militaire ne peut que se traduire par une abdication.
Sans doute, après l'annonce de la défaite de Waterloo – un 18 juin –, la foule continue-t-elle à défiler dans Paris, réclamant des armes et criant « Vive l'Empereur ! ». Et Carnot de proposer l'instauration d'une dictature de salut public confiée à Napoléon Bonaparte.
Mais la Chambre des représentants et la Chambre des pairs ne laissent à Napoléon que le choix entre la déchéance – qu'elles voteraient – et l'abdication.
Il faudrait faire contre elles un « 18 Brumaire » du peuple. Mais Napoléon – l'ancien lieutenant qui, en 1789, avait réprimé des émeutes paysannes sans états d'âme – déclare qu'il ne veut pas être « le roi de la Jacquerie ».
Ce ne sont pas ces mots-là que retiendra la légende, mais le retour, le 8 juillet 1815, après la défaite des armées françaises, de Louis XVIII, la trahison de Talleyrand et de Fouché, nommés par le roi l'un à la tête du ministère, l'autre à celle de la police.
La nation retient la Terreur blanche qui se déchaîne contre les bonapartistes et les jacobins, les exécutions de généraux qui ont rejoint Napoléon à son retour de l'île d'Elbe, l'élection d'une Chambre « introuvable » composée d'ultraroyalistes, et la conclusion, le 26 septembre, au nom de la sainte Trinité, d'une Sainte-Alliance des souverains d'Autriche, de Prusse et de Russie pour étouffer tout mouvement révolutionnaire en Europe.
La France, qui subit cette réaction, est fascinée par la déportation de Napoléon – il arrive à Sainte-Hélène le 16 octobre 1815.
Elle pleurera sa mort le 5 mai 1821.
Elle lira avec passion le Mémorial de Sainte-Hélène et, en 1840, elle célébrera le retour de ses cendres.
En 1848, elle élira comme président de la République Louis Napoléon Bonaparte, auteur d'un essai sur L'Extinction du paupérisme, et bientôt du coup d'État du 2 décembre 1851.
Brève – quinze ans –, la séquence napoléonienne s'inscrit ainsi de manière contradictoire dans la longue durée de l'âme et de la politique françaises.
2
L'ÉCHO DE LA RÉVOLUTION
1815-1848
46.
Quel régime pour la France ?
Cette nation qui, en 1792, a déchiré le pacte millénaire qui en faisait une monarchie de droit divin réussira-t-elle, maintenant que l'« Usurpateur » n'est plus que le prisonnier d'une île des antipodes où tous les souverains d'Europe sont décidés à le laisser mourir, à renouer le fil de son histoire après un quart de siècle – 1789-1814 – de révolutions, de terreurs et de guerres ?
Ou bien le pouvoir n'apparaîtra-t-il légitime qu'à une partie seulement de la nation, et la France continuera-t-elle d'osciller d'un régime à l'autre, incapable de trouver la stabilité institutionnelle et la paix civile ?
C'est l'enjeu des trente-trois années qui vont de 1815 à 1848, longue hésitation comprise entre le bloc révolutionnaire et impérial et la domination politique de Louis Napoléon Bonaparte qui va durer vingt-deux ans, de 1848 à 1870.
C'est comme si, de 1815 à 1848, des répliques – en 1830, en 1848 – du grand tremblement de terre révolutionnaire venaient périodiquement saper les régimes successifs, qu'il s'agisse de la restauration monarchique – drapeau blanc et Terreur blanche, fleur de lys et règne des frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, renversée en juillet 1830 – ou bien de la monarchie bourgeoise – drapeau tricolore et roi citoyen, Louis-Philippe d'Orléans, fils de régicide, combattant de Jemmapes, balayé lui aussi par une révolution, en février 1848, donnant naissance à une fugace deuxième République qui choisit pour président un Louis Napoléon Bonaparte élu au suffrage universel !
Parmi les élites de cette France de la Restauration, puis de la monarchie orléaniste dite de Juillet, il existe des « doctrinaires » libéraux.
Après les « dérapages » révolutionnaires et la dictature impériale, ils voudraient voir naître une France pacifique et sage gouvernée par une monarchie constitutionnelle, retrouvant ainsi les projets des années 1790-1791.
Ces hommes – Benjamin Constant, François Guizot… – sont actifs, influents ; ils seront même au pouvoir aux côtés de Louis-Philippe d'Orléans.
Comme Constant, ils affirment : « Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées, et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances... Par liberté, j'entends le triomphe de l'individualité tant sur l'autorité qui voudrait gouverner par le despotisme que sur les masses qui réclament le droit d'asservir la minorité à la majorité » (1819).
Guizot inspire les lois de 1819 sur la presse, qui précisent dans leur préambule que « la liberté de presse, c'est la liberté des opinions et la publication des opinions. Une opinion quelle qu'elle soit ne devient pas criminelle en devenant publique. »
Les journaux peuvent désormais paraître sans autorisation préalable. Les jurys d'assises sont seuls juges des délits de presse.
Après les années de censure et de propagande napoléoniennes, ainsi surgissent, en pleine Restauration, des journaux d'opinion qui vont peser sur la vie politique. Et la bataille pour la liberté de la presse devient dès lors un élément majeur du débat public. Un tournant est pris à l'initiative des libéraux :
« La liberté de la presse, c'est l'expansion et l'impulsion de la vapeur dans l'ordre intellectuel, écrit Guizot, force terrible mais vivifiante qui porte et répand en un clin d'œil les faits et les idées sur toute la face de la terre. J'ai toujours souhaité la presse libre ; je la crois, à tout prendre, plus utile que nuisible à la moralité publique. »
Ce mouvement que les pouvoirs vont tenter d'entraver est cependant irrésistible, parce que l'aspiration à la liberté, après la discipline militaire d'un Empire engagé en permanence dans la guerre, est générale.
C'est ainsi que le romantisme, qui marquait par de nombreux aspects une rupture avec l'esprit des Lumières et le triomphe de la Raison, et donc un retour à la tradition, à la sensibilité, rencontre le « libéralisme ».
L'évolution de Victor Hugo, poète monarchiste en 1820 – il célèbre le sacre de Charles X en 1825 –, le porte à écrire dans la préface de Cromwell, en 1827 :
« La liberté dans l'art, la liberté dans la société, voilà le double but auquel doivent tendre d'un même pas tous les esprits conséquents et logiques. Nous voilà sortis de la vieille formule sociale. Comment ne sortirions-nous pas de la vieille formule poétique ? »
Phénomène générationnel : en 1827, les deux tiers de la génération nouvelle sont nés après 1789, et la majorité du corps électoral (100 000 notables) avait moins de vingt ans lors de la prise de la Bastille.
Cependant, ces « libéraux », ces « modernes », qui ont un projet politique clair, des convictions arrêtées, ne parviennent pas, malgré leur proximité du pouvoir et l'influence qu'ils exercent, à l'emporter.
Un Bonaparte va sortir vainqueur de l'épisode 1815-1848.
Un empire va succéder à une monarchie qui s'était voulue « constitutionnelle » et à une république « conciliatrice ».
Des « journées révolutionnaires se sont succédé, renversant des régimes en juillet 1830 et en février 1848, ou provoquant des heurts sanglants en 1831, 1832 et juin 1848.
Cet échec des « libéraux », cet écho de la révolution répercuté tout au long du xixe siècle, marquent profondément l'âme du pays et orientent son histoire.
De 1815 à 1848, la France n'a pas pris le tournant libéral, mais est restée une nation partagée en camps qui s'excluent l'un l'autre de la légitimité.
On le voit bien de 1815 à 1830. Les doctrinaires libéraux, les partisans de la prise en compte des conséquences politiques, sociales, économiques et psychologiques de la Révolution, sont constamment débordés par les ultraroyalistes sans obtenir pour autant l'appui des révolutionnaires « jacobins » ou des bonapartistes.
Une fois encore, la France élitiste, celle des « notables » du centre, est écrasée par les « extrêmes » qui les excommunient tout en se combattant, selon la règle : « Qui n'est pas avec moi totalement est contre moi ! »
Le réaliste Louis XVIII et les libéraux ont d'abord accepté, en 1814-1815, que la Terreur blanche massacre, que des bandes royalistes – les Verdet – se comportent en brigands, qu'on proscrive et qu'on assassine les généraux Brune et Ramel, qu'on fusille le maréchal Ney et le général de La Bédoyère.
Il faut peser les conséquences de cette politique terroriste de revanche et de vengeance royaliste, appliquée alors que le pays est encore occupé – jusqu'en 1818 – par des troupes étrangères.
Elle achève de « déchirer » le lien entre le peuple et les Bourbons.
Ils apparaissent comme la « réaction », la « contre-révolution », le « parti de l'étranger ». Certes, le monde paysan (75 % de la population) reste silencieux, mais, dans les villes et d'abord à Paris – 700 000 habitants –, la rupture est consommée entre une grande partie de la jeunesse des « écoles » et le camp « légitimiste ».
Durant la Restauration, ce dernier joue son avenir.
Plus profondément encore, le retour en force du clergé catholique et d'associations secrètes liées à l'Église qui contrôlent l'esprit public – Chevaliers de la foi, Congrégation – dresse contre le « parti prêtre » une partie de l'opinion.
L'Université, placée sous l'autorité du grand maître, monseigneur de Frayssinous, bientôt ministre des Cultes, est mise au pas.
Les Julien Sorel grandissent dans ce climat politique d'ordre moral, de surveillance et de régression.
L'âme de la France, déjà pénétrée par les idées des Lumières, se rebiffe contre cette « conversion » forcée que pratiquent « missions » et directeurs de conscience.
L'anticléricalisme français qu'on verra s'épanouir dans la seconde moitié du siècle trouve une de ses sources dans ces quinze années de restauration et de réaction.
Cette politique ultra ne peut changer qu'à la marge (dans la période 1816-1820) sous l'influence du ministre Decazes, qui a la confiance de Louis XVIII.
Les ultraroyalistes la condamnent, pratiquent la politique du pire : « Il vaut mieux des élections jacobines que des élections ministérielles », disent-ils.
Ils favorisent ainsi l'élection du conventionnel Grégoire, ancien évêque constitutionnel, partisan de la Constitution civile du clergé.
Or « jacobins » et bonapartistes se sont organisés en sociétés secrètes (sur le modèle de la Charbonnerie, ou dans la société « Aide-toi, le Ciel t'aidera »). Ils complotent.
Le 13 février 1820, le bonapartiste Louvel assassine le duc de Berry, fils du comte d'Artois, seul héritier mâle des Bourbons.
La France se trouve ainsi emportée dans un cycle politique où s'affrontent tenants de la réaction, ultraroyalistes et révolutionnaires. À peine entr'ouverte, la voie étroite de la monarchie constitutionnelle se referme.
Quand il déclare, parlant de Decazes : « Les pieds lui ont glissé dans le sang », Chateaubriand exprime l'état d'esprit ultra, mettant en accusation les « modérés », les royalistes tentés par le libéralisme.
« Ceux qui ont assassiné monseigneur le duc de Berry, poursuit-il, sont ceux qui, depuis quatre ans, établissent dans la monarchie des lois démocratiques, ceux qui ont banni la religion de ses lois, ceux qui ont cru devoir rappeler les meurtriers de Louis XVI, ceux qui ont laissé prêcher dans les journaux la souveraineté du peuple et l'insurrection. »
La mort de Louis XVIII en 1824, le sacre de Charles X à Reims en 1825, creusent encore le fossé entre les « deux France ».
La répression des menées jacobines et bonapartistes (exécution en 1827 des quatre sergents de La Rochelle qui ont comploté contre la monarchie), les nouvelles lois électorales – un double vote est accordé aux plus riches des électeurs –, révoltent la partie de l'opinion qui reste attachée au passé révolutionnaire et napoléonien.
Elle ne peut accepter le gouvernement du duc de Polignac, constitué en août 1829, au sein duquel se retrouvent le maréchal Bourmont et La Bourdonnais.
Une nostalgie patriotique l'habite. Elle a été émue par la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, le 5 mai 1821.
Elle lit le Mémorial de Sainte-Hélène, publié en 1823, qui connaît d'emblée un immense succès. À gauche, l'historien Edgar Quinet peut écrire :
« Lorsque, en 1821, éclata aux quatre vents la formidable nouvelle de la mort de Napoléon, il fit de nouveau irruption dans mon esprit... Il revint hanter mon intelligence, non plus comme mon empereur et mon maître absolu, mais comme un spectre que la mort a entièrement changé... Nous revendiquions sa gloire comme l'ornement de la liberté. »
Et Chateaubriand de noter lucidement :
« Vivant, Napoléon a manqué le monde ; mort il le conquiert. »
Dans ce climat, le ministère Polignac-Bourmont-La Bourdonnais apparaît comme une provocation ultraroyaliste.
Il manifeste la fusion qui s'opère dans les esprits entre les Bourbons, l'étranger et donc la trahison, et, réciproquement, entre leurs adversaires et le patriotisme. Dès lors, le pouvoir royal n'est plus légitime, et rejouent toutes les passions de la période révolutionnaire.
Le Journal des débats écrit ainsi : « Le lien d'amour qui unissait le peuple au monarque est brisé. »
Quelques jours plus tard, Émile de Girardin ajoute : Polignac est « l'homme de Coblence et de la contre-révolution ». Bourmont est le déserteur de Waterloo et La Bourdonnais, le chef de la « faction de 1815, avec ses amnisties meurtrières, ses lois de proscription et sa clientèle de massacreurs méridionaux »... « Pressez, tordez ce ministère – Coblence, Waterloo, 1815 –, il ne dégoutte qu'humiliation, malheurs et chagrins ! »
Bertin l'aîné, propriétaire du Journal des débats, sera condamné à six mois de prison pour la publication de ces articles.
La réaction se déploie : la pièce de Victor Hugo, Marion Delorme, est interdite, et une commission examine les cours donnés par Guizot et Victor Cousin.
L'affrontement avec le pouvoir est proche.
Le 3 janvier 1830, Thiers, Mignet et Armand Carrel fondent le journal Le National.
On mesure alors combien le patriotisme est le ressort de l'opposition.
C'est la question nationale qui met l'âme française en révolte.
Mais la confrontation est en fait limitée à Paris.
La France paysanne reste calme, presque indifférente à ces déchaînements politiques qui, s'ils vont prendre la forme de journées révolutionnaires – les 27, 28 et 29 juillet 1830 –, et, à ce titre, s'inscrivent dans la « mythologie révolutionnaire », marquent davantage un glissement de pouvoir qu'une profonde rupture.
Les acteurs de ces journées de juillet ne sont en effet qu'une minorité, une nouvelle génération romantique (la « bataille » d'Hernani est de 1830, et c'est cette année-là que Stendhal écrit Le Rouge et le Noir). Les inspirateurs politiques sont des « libéraux » (Thiers, La Fayette, Guizot) qui vont réussir à imposer leur candidat au trône : Louis-Philippe d'Orléans.
Ils réalisent ainsi avec le fils ce que d'autres « modérés » (déjà La Fayette) avaient tenté, en 1790-1791, avec le père, Philippe Égalité.
Ils veulent instaurer une monarchie constitutionnelle qui arborera les trois couleurs. Le monarque sera un roi citoyen.
Le peuple, utilisé et dupé, doit se contenter de cette mutation politique qui ne change rien à sa condition.
Après ces « trois glorieuses » journées de juillet 1830, Stendhal écrira :
« La banque est à la tête de l'État, la bourgeoisie a remplacé le faubourg Saint-Germain, et la banque est la noblesse de la classe bourgeoise. »
Et le banquier Laffitte de conclure : « Le rideau est tombé, la farce est jouée. »
Mais, dans la mémoire de la nation – dans l'âme de la France –, ces journées de 1830 sont l'un des maillons qui confortent et enrichissent la légende de la France révolutionnaire dont Paris, qui s'est couvert de six mille barricades, est le cœur.
Une source qui n'est pas tarie peut jaillir à nouveau avec d'autant plus de force qu'elle a été détournée, contenue.
47.
Dans ce deuxième tiers du xixe siècle, l'histoire de France semble bégayer.
Paris a pris les armes en juillet 1830 pour chasser Charles X et les légitimistes, mais en février 1848 les émeutiers parisiens contraignent les orléanistes et Louis-Philippe, vainqueurs en 1830, à l'exil.
Par leur éclat symbolique – Paris se couvre de barricades, Paris s'insurge, Paris compte ses morts et les charge sur les tombereaux, allumant partout dans la capitale l'incendie de la révolte –, ces journées révolutionnaires qui voient surgir puis disparaître la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe marquent l'importance, pour le destin français, de ces dix-huit années.
Car ce qui s'est scellé, entre 1830 et 1848, c'est le sort final de la monarchie.
Les journées de 1830 ont signé l'échec du retour à l'Ancien Régime, tenté avec plus ou moins de rigueur par Louis XVIII et Charles X.
Mais la France ne veut ni d'une charte octroyée, ni d'un roi sacré à Reims, ni d'un drapeau à fleurs de lys cachant sous ses plis le tricolore de Valmy et d'Austerlitz.
Les monarchistes partisans d'une royauté constitutionnelle l'ont compris. Ce sont eux qui provoquent, puis confisquent, les journées révolutionnaires de juillet 1830.
Ces idéologues – des historiens (Guizot, Thiers, Mignet) et des banquiers (Laffitte, Perier) – veulent renouer avec la « bonne Révolution », celle des années 1790-1791, quand les modérés espéraient stabiliser la situation et instaurer avec Louis XVI une monarchie constitutionnelle.
Leur grand homme, le garant militaire de leur tentative, leur glorieux porte-drapeau, c'était La Fayette, et c'est encore lui qui, en juillet 1830, présente à la foule le « roi patriote », Louis-Philippe.
Cette monarchie-là se drape dans le bleu-blanc-rouge.
Si elle parvient à s'enraciner, alors le sillon commencé avec la fête de la Fédération en 1790, puis interrompu par la Terreur et détourné au profit de Bonaparte, pourra enfin être continué.
Thiers, Guizot, qui gouverneront si souvent de 1830 à 1848, rêvent de ce pouvoir à l'anglaise, avec des Chambres élues au suffrage censitaire, un roi qui règne mais ne gouverne pas.
Malheureusement pour eux, Louis-Philippe veut régner et ne joue pas le jeu du Parlement.
Certes, le « roi citoyen » rompt avec l'idée d'un retour à l'Ancien Régime. Cela suffit d'ailleurs à dresser contre lui tous les monarchistes légitimistes.
Mais, naturellement, les républicains et les révolutionnaires qui découvrent que leur héroïsme de juillet 1830 n'a servi qu'à installer sur le trône un monarque, à la place d'un autre, le haïssent.
On essaiera – des régicides issus de toutes les oppositions – à six reprises de le tuer. Et on visera aussi son fils, le duc d'Aumale.
On ignorera les réussites d'une monarchie qui conclut une entente cordiale avec l'Angleterre et ne se lance dans aucune aventure guerrière.
Elle achève de conquérir l'Algérie et de la pacifier.
Elle jette les bases d'un empire colonial.
Elle unifie le pays en créant soixante mille kilomètres de chemins vicinaux, 4 000 kilomètres de voies ferrées, qui contribuent à renforcer la centralisation de la nation.
Paris est la tête où tout se décide, où tout se joue.
Les campagnes restent soumises à leurs nobles légitimistes, méprisants envers ce roi boutiquier, inquiets de voir Guizot exiger des communes qu'elles créent une école primaire, et de certains départements, qu'ils bâtissent une école normale d'instituteurs.
Cet enseignement n'est encore ni obligatoire, ni gratuit, ni laïque, mais il ouvre le chemin à l'Instruction publique.
Cependant, la monarchie constitutionnelle reste une construction fragile, et son renversement en février 1848 clôt, dans l'histoire nationale, le chapitre de la royauté.
On ne confiera jamais plus le pouvoir à un souverain issu de l'une ou l'autre des branches de la dynastie, qu'il arbore les fleurs de lys ou les trois couleurs.
Ce que le peuple de France rejette depuis 1789, ce n'est point tant le gouvernement d'un seul homme – Napoléon fut le plus autoritaire, le plus dictatorial des souverains – que l'accession au trône par filiation héréditaire.
Même le fils de Napoléon ne peut accéder au trône. Le roi de Rome n'est que le sujet d'une pièce mélodramatique qui sera écrite beaucoup plus tard.
Ce ne sont plus ni les liens de sang ni le sacre qui légitiment le pouvoir, mais l'élection.
En 1848, quand Louis-Philippe part en exil, alors que Paris ignore que le roi a abdiqué en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, une nouvelle période de l'histoire de France commence.
Les nostalgies monarchiques – légitimistes ou orléanistes – pourront bien perdurer, susciter d'innombrables manœuvres politiques, elles ne donneront plus naissance qu'à des chimères et à des regrets.
Des quatre modèles politiques qui ont composé la combinatoire institutionnelle de la France à partir de 1789 – monarchie d'Ancien Régime, monarchie constitutionnelle, empire, république –, il ne restera plus, après l'échec de la monarchie constitutionnelle, que les deux derniers.
C'est dire l'importance du sort de cette monarchie louis-philipparde pour l'orientation de toute l'histoire nationale à partir des années 1830-1848. En fait, se mettent alors en place de nouvelles forces sociales et politiques, des manières de penser – des idéologies – qui coloreront l'âme de la France durant le dernier tiers du xixe siècle et tout le xxe.
De nouveaux mots apparaissent : socialisme, socialistes, communisme, prolétaires.
Surtout, s'opère la fusion entre ces « prolétaires », ces ouvriers, et le mouvement républicain. On se souvient de la conspiration des Égaux de Babeuf, du Comité de salut public.
Pour les notables, les propriétaires, ce sont là des « monstruosités » dont il convient d'éviter à tout prix le retour.
Pour d'autres – les républicains révolutionnaires –, c'est un exemple, une voie à prolonger. Au bout, il y a la république sociale fondée sur l'égalité.
L'un de ces idéologues – Laponneraye – écrira en 1832 : « Il s'agit d'une république où l'on ne connaîtra point la distinction de bourgeoisie et de peuple, de privilèges et de prolétaires, où la liberté et l'égalité seront la propriété de tous et non le monopole exclusif d'une caste. »
Dans les campagnes, chez les idéologues libéraux, on craint ces « partageux ». Et ce d'autant plus qu'on a pu mesurer en 1830 la force révolutionnaire de Paris.
Un notable libéral, Rémusat, avouera : « Nous ne connaissions point la population de Paris, nous ne savions pas ce qu'elle pouvait faire. »
On s'inquiète de la prolifération des sociétés secrètes, de la liaison entre « républicains déterminés » et prolétaires.
En 1831, les canuts lyonnais se révoltent. Les « coalitions » (grèves) se multiplient.
La condition ouvrière est en effet accablante : « Le salaire n'est que le prolongement de l'esclavage », résume Chateaubriand. La misère, le chômage, la faim, l'absence de protection sociale, le travail des enfants et la mortalité infantile sont décrits par toutes les enquêtes. Un christianisme social – Lamennais, Lacordaire – se penche sur cette situation insoutenable.
Ces foules « misérables », entrant en contact avec les républicains, modifient la donne politique. Cette rencontre entre le social et la République est encore une exception française.
Après la révolte des canuts, on peut lire sous la plume de Michel Chevalier : « Les événements de Lyon ont changé le sens du mot politique ; ils l'ont élargi. Les intérêts du travail sont décidément entrés dans le cercle politique et vont s'y étendre de plus en plus. »
Cette présence ouvrière et sa jonction avec les républicains terrorisent les notables, les modérés, les propriétaires – et, à leur suite, la paysannerie.
« La sédition de Lyon, écrit Saint-Marc de Girardin dans Le Journal des débats, a révélé un grave secret, celui de la lutte intestine qui a lieu dans la société entre la classe qui possède et celle qui ne possède pas. Notre société commerciale et industrielle a sa plaie, comme toutes les autres sociétés : cette plaie, ce sont ses ouvriers. Les barbares qui menacent la société sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières ; c'est là qu'est le danger de la société moderne. Il ne s'agit ici ni de république, ni de monarchie, il s'agit du salut de la société. »
Et Girardin de lancer un appel à l'union :
« Républicains, monarchistes de la classe moyenne, quelle que soit la diversité d'opinion sur la meilleure forme de gouvernement, il n'y a qu'une voie portant sur le maintien de la société ! »
Mais ce discours d'ordre, d'intérêt, de raison, prônant l'unité de tous ceux dont les intérêts sociaux convergent, même si leurs préférences politiques divergent, se heurte à la passion républicaine, à la nostalgie révolutionnaire ravivée par la misère, la répression, l'autoritarisme d'un pouvoir qui ne réussit pas ou ne tient pas à s'ouvrir, à concéder des avantages aux classes les plus démunies, mais qui, au contraire, avec Guizot en 1836, s'insurge contre les revendications des « prolétaires » :
« Nous sommes frappés de cette soif effrénée de bien-être matériel et de jouissances égoïstes qui se manifeste surtout dans les classes peu éclairées. »
Ce sont en fait, selon les mots de Victor Hugo, les « misérables » qui « meurent sous les voûtes de pierre » des caves des villes ouvrières.
Et Guizot, pour contenir cette révolte qui couve, de suggérer :
« Croyez-vous que les idées religieuses ne sont pas un des moyens, le moyen le plus efficace, pour lutter contre ce mal ? »
Cette attitude répressive et aveugle du pouvoir, que les « scandales » et la corruption délégitiment un peu plus, favorise l'amalgame entre républicains, mouvement, revendications sociales et même anticléricalisme. C'est là un trait majeur de notre histoire.
Et puisque les revendications partielles ne sont pas entendues, que le souvenir de la Révolution revient hanter les mémoires, le « mouvement » remet en cause toute structure de la société, comme le perçoit bien Tocqueville, qui note en janvier 1848 :
« Il se répand peu à peu, dans le sein des opinions des classes ouvrières, des idées qui ne visent pas seulement à renverser telles lois, tel ministère, tel gouvernement, mais la société même, à l'ébranler des bases sur lesquelles elle repose aujourd'hui. »
Et d'ajouter :
« Le sentiment de l'instabilité, ce sentiment précurseur des révolutions, existe à un degré très redoutable dans ce pays. »
Si la situation est à ce point menaçante en janvier 1848, c'est que, tout au long de ces dix-huit années, le mouvement républicain, social et révolutionnaire s'est renforcé.
D'abord, les émeutes parisiennes – mais la révolte des canuts de 1831 a déjà fissuré à elle seule la société – naissent du sentiment que les protagonistes des journées de juillet 1830 ont été bernés, spoliés de leur victoire.
Cette manipulation politique réussie par Thiers, La Fayette et Louis-Philippe conforte l'opinion « avancée » dans l'idée que les « élites » trompent le peuple et se jouent de lui. Qu'à l'hypocrisie de la politique il faut opposer la brutale « franchise » de l'insurrection armée.
En 1831, 1832, 1834, puis en 1839, des groupes d'insurgés dressent des barricades à l'occasion de l'enterrement d'un général républicain (Lamarque, juin 1832) ou pour tenter de s'emparer de l'Hôtel de Ville de Paris en 1839 (Blanqui et Barbès).
Paris est le creuset où, émeute après émeute, se perpétue et se forge la légende révolutionnaire.
C'est le temps de la « grandeur de l'idéologie » (Fourier, Proudhon, Pierre Leroux), de l'alliance des révolutionnaires avec certains écrivains (Sue, Hugo, Sand, Lamartine).
Les opinions sont radicales : « La propriété c'est le vol », décrète Proudhon. Mais le mouvement insurrectionnel et politique reste faible. La répression conduite par Thiers ou Guizot est implacable : un « massacre » est perpétré rue Transnonain, le 14 avril 1834, par Bugeaud, qui plus tard sera gouverneur de l'Algérie (1840).
On voit ainsi s'entrelacer en des nœuds complexes mais serrés les traditions révolutionnaires, le recours à la violence, le rôle de Paris, la liaison entre républicains et ouvriers (surtout parisiens). Et, malgré le recours à la force armée, la monarchie constitutionnelle paraît de plus en plus incapable de contrôler une situation qui inquiète les possédants.
Depuis 1836, un Bonaparte s'est campé dans le paysage politique. Ce Louis Napoléon, neveu de l'Empereur, a tenté un coup de force à Strasbourg (1836), un autre à Boulogne (1840). Emprisonné, il s'évade du fort de Ham en 1846.
On voit ainsi réapparaître l'un des quatre modèles institutionnels de la France du xixe siècle. Louis Napoléon Bonaparte propose en effet une « synthèse » :
« L'esprit napoléonien peut seul concilier la liberté populaire avec l'ordre et l'autorité », dit-il.
Il publie De l'Extinction du paupérisme (1844) :
« La gangrène du paupérisme périrait avec l'accès de la classe ouvrière à la prospérité », y affirme-t-il.
S'esquisse là, adossé à la légende napoléonienne, un « national-populisme » autoritaire, incarné mais recherchant le sacre du peuple et non d'abord la légitimité par la filiation dynastique, même si elle tient lieu de point d'appui essentiel.
La situation du pays est incertaine.
« Il se dit que la division des biens jusqu'à présent dans le monde est injuste..., que la propriété repose sur des bases qui ne sont pas des bases équitables, note Tocqueville. Et ne pensez-vous pas que quand de telles opinions descendent profondément dans les masses, elles amènent tôt ou tard les révolutions les plus redoutables ? »
Or, pour y faire face, le national-populisme autoritaire n'est-il pas mieux armé que la monarchie constitutionnelle ?
On se souvient de Bonaparte brandissant le glaive de la force et de la loi contre tous les fauteurs de désordre, garantissant les fortunes à la fois contre les partisans de l'Ancien Régime et les jacobins.
Ainsi resurgit de la mémoire française cette solution « bonapartiste », puisque la monarchie constitutionnelle est un système « bloqué », freiné sur la voie parlementaire par l'autoritarisme du monarque – ce qui déçoit ses partisans modérés – et incapable de se doter d'un soutien populaire.
Il n'y a plus alors que deux issues : la république ou le bonapartisme.
La crise que provoque le doublement du prix du pain à la suite des mauvaises récoltes de 1846 est donc essentiellement politique : face à la montée des oppositions, le pouvoir refuse d'ouvrir le « système », de faire passer le nombre des électeurs de 240 000 à 450 000.
Il se coupe ainsi de ceux (Thiers) qui souhaitent élargir la base de la monarchie constitutionnelle pour la préserver, cependant que ses adversaires républicains et révolutionnaires, de leur côté, se renforcent. Presse « communiste », troubles dans les villes ouvrières, émeutes de la misère : les signes de tension se multiplient.
Des anciens ministres sont accusés de concussion. Un modéré – Duvergier de Hauranne – peut écrire :
« Tous ces scandales, tous ces désordres, ne sont pas des accidents, c'est la conséquence nécessaire, inévitable, de la politique perverse qui nous régit, de cette politique qui, trop faible pour asservir la France, s'efforce de la corrompre. »
Dès le mois de janvier 1847, une « campagne de banquets » mobilise l'opinion modérée sur le thème des « réformes ». L'un de ces banquets, prévu à Paris le 14 février 1848, est interdit. Un manifeste réformiste est lancé.
Il ne s'agit pas de renverser Louis-Philippe, mais de le contraindre à renvoyer Guizot, à élargir le corps électoral, à donner vigueur et perspective à la monarchie constitutionnelle.
Mais Paris, quand il voit les corps des manifestants tués au cours d'une fusillade avec la troupe, s'enflamme.
La ville est celle des minorités révolutionnaires. Ce sont elles qui agissent, débordant les réformistes.
L'Hôtel de Ville est envahi. Lamartine et les manifestants proclament la république le 24 février.
Ce qui avait été manqué en juillet 1830 réussit en février 1848. Par un bel effet d'éloquence, Lamartine parvient à faire écarter le drapeau rouge que les manifestants voulaient d'abord imposer à « leur » république. Elle restera « tricolore ». Mais on mesure, à l'ambiguïté et à la complexité de ces événements, que rien n'est tranché.
La révolution de Février n'est qu'une émeute de plus qui a réussi. Ce succès est dû au fait que la France rurale est restée passive, que les forces de l'ordre ont été hésitantes, et que l'assise sociale et politique du pouvoir s'est divisée.
Dans le même temps, cette « révolution » entre dans le légendaire national. La république et la révolution sont associées dans la reconstruction de l'événement. Dans cette « imagerie », il a suffi au peuple de se révolter, de dresser des barricades dans Paris, pour l'emporter sur le pouvoir.
48.
Quel peut être le destin de cette république officiellement proclamée le 26 février 1848 et née d'une révolution ambiguë ?
Elle est la deuxième, et elle fait resurgir tous les souvenirs de la Grande Révolution et de la Ire République, celle de 1792. Mais son sort sera scellé avant la fin de l'année, puisque le 10 décembre 1848 Louis-Napoléon Bonaparte en sera élu président par 5 434 000 voix.
Les autres candidats, – Cavaignac, Ledru-Rollin, Raspail et Lamartine – rassemblent respectivement 1 448 000, 371 000, 37 000, et, pour le dernier, Lamartine, le héros de Février, celui qui a réussi à maintenir le drapeau tricolore... 8 000 voix !
C'est une période charnière que ces dix mois de l'année 1848.
Ils dessinent une fresque politique qui sera souvent copiée dans l'histoire nationale, parce qu'elle met en jeu des forces et des idées qui resteront à l'œuvre durant le reste du xixe et tout le xxe siècle.
Au cours de ces dix mois, les illusions de Février sont déchirées.
Deux mesures capitales permettent ce retour à la réalité.
D'abord, sous la pression populaire, et parce qu'il faut bien satisfaire ces ouvriers, ces partisans de la république sociale qui, armés, manifestent, le gouvernement crée pour les chômeurs des ateliers nationaux.
Les chômeurs y percevront un salaire.
L'État prend ainsi en charge l'assistance sociale, en même temps que des lois fixent la durée quotidienne maximale du travail à dix heures à Paris, à onze heures en province, puis à douze heures sur l'ensemble du territoire national.
Il faut payer ces « ouvriers » qu'on n'emploie guère et qui deviennent une masse de manœuvre réceptive aux idées « socialistes » ou bonapartistes.
C'est en même temps un abcès de fixation. Il suffira de le vider pour que soit brisée l'avant-garde, écho de ce « printemps des peuples » qui fait souffler le vent de la révolution sur l'Europe entière.
La seconde mesure, décisive, est l'instauration, le 5 mars 1848, du suffrage universel (masculin).
Le droit de vote est accordé à tous les Français dès lors qu'ils ont atteint vingt et un ans.
Innovation capitale qui va devenir le patrimoine de toute la nation.
Mesure anticipatrice, comparée aux régimes électoraux en vigueur dans les autres nations européennes.
Au lieu de 250 000, la France compte désormais dix millions d'électeurs, dont les trois quarts sont des paysans et plus de 30%, des illettrés.
Les « révolutionnaires », les « républicains avancés », qui se proclament l'« avant-garde », comprennent que le suffrage universel va se retourner contre eux.
Ils connaissent le conservatisme des campagnes, le poids des notables sur les paysans, le rôle qu'y joue l'Église.
Ils manifestent donc à Paris pour tenter de faire reculer la date des élections.
Paradoxe : le peuple est craint par ceux qui prétendent défendre ses intérêts.
Le suffrage universel devient l'arme des « conservateurs » contre les « progressistes » !
Les élections sont fixées au 25 avril 1848, malgré les manifestations des « révolutionnaires ». Et les « modérés » peuvent brandir devant les électeurs rassemblés le « spectre rouge », la menace des « partageux », celle de la dictature et du retour de la Terreur, comme en 1793-1794.
L'Assemblée constituante élue ne compte qu'une centaine de « socialistes » sur près de neuf cents sièges. La République a accouché d'une Assemblée conservatrice et orléaniste. Le pouvoir exécutif se donne pour chef le général Cavaignac, et des scrutins complémentaires permettent la désignation de Thiers, de Proudhon et de... Louis Napoléon Bonaparte.
Cette Assemblée régulièrement élue au suffrage universel représentant, contre les minorités révolutionnaires, le « pays réel », peut, maintenant qu'elle détient le pouvoir légal, supprimer les ateliers nationaux – pourquoi verser un franc par jour à des chômeurs ? –, viviers de la contestation, symboles d'une république sociale dont la France ne veut pas.
L'annonce de la fermeture des ateliers – les ouvriers n'ont le choix qu'entre le licenciement, le départ vers la Sologne pour assécher les marais et l'engagement dans l'armée – provoque l'émeute.
Ces journées de juin 1848 – du 22 au 26 – sont une véritable guerre sociale, opposant l'est de Paris, qui se couvre de barricades, et le Paris de l'Ouest, d'où partent les troupes de ligne.
Celles-ci vont perdre un millier d'hommes, contre 5 000 à 15 000 chez les insurgés, fusillés le plus souvent. Quinze mille prisonniers seront déférés à des conseils de guerre, déportés en Algérie (5 000), les autres étant emprisonnés au terme de ces « saturnales de la réaction » (Lamennais).
« Les atrocités commises par les vainqueurs me font frémir », écrit Renan.
En même temps, les libertés – accordées en février – sont rognées : « Silence aux pauvres ! » lance encore Lamennais.
Pourtant, en août, on vote – toujours au suffrage universel – pour élire les conseils généraux, d'arrondissement et municipaux.
Le peuple s'exprime, apprend à choisir, à peser par le scrutin sur les décisions.
Ambiguïté de cette République qui massacre ceux qui veulent aller au-delà des limites fixées par les notables, mais qui apprend au peuple les règles de la démocratie !
Ainsi se façonne l'âme française.
Les « prolétaires », les révolutionnaires, mesurent que la république aussi peut être conservatrice et durement répressive. Leur méfiance envers le suffrage universel s'accroît. Ils découvrent le Manifeste du parti communiste, publié par Marx et Engels à Londres le 24 février 1848.
Ils vont se persuader que les « avant-gardes » doivent choisir pour le peuple, y compris même contre les résultats du suffrage universel.
Et ce d'autant plus que, aux élections du 10 décembre 1848, Louis Napoléon Bonaparte écrase tous les autres candidats, à commencer par le général « républicain » Cavaignac, qui a conduit la répression de juin.
En un tiers de siècle, de 1815 à 1848, les Français ont donc vu se succéder à la tête de la nation une monarchie légitimiste, une monarchie constitutionnelle, une république dont le président est un Bonaparte, neveu de l'empereur Napoléon Ier !
Les Français ont voulu ces changements ou les ont laissé faire. Ils ont usé de la violence ou du bulletin de vote pour les susciter.
Mais ceux qui ont pris part aux journées révolutionnaires n'ont représenté que des minorités.
Rien de comparable au mouvement qui avait embrasé le pays en 1789 et l'avait soulevé en 1792.
Peu à peu, acquérant une expérience politique qu'aucun autre peuple au monde ne possède à un tel degré, et qui fait de la France la nation politique par excellence, la majorité des Français aspire en fait à la paix civile.
Dans ses profondeurs, le peuple a découvert que le vote peut être un moyen pacifique de changer les choses, lentement et sans violences.
Ainsi, cette nation révolutionnaire qui périodiquement dresse dans Paris des barricades est aussi désireuse d'ordre.
Elle continue d'osciller, comme si après la gigantesque poussée révolutionnaire de 1789 elle n'avait pas encore recouvré son équilibre. Les journées d'émeutes – les révolutions – se répètent, les régimes se succèdent, mais, dans le même temps, elle ne souhaite plus retomber dans les violences généralisées.
À Paris, grand théâtre national, elle met en scène la révolution comme pour se souvenir de ce qu'elle a vécu.
Puis elle interrompt le spectacle et sort du théâtre aussi vite qu'elle y est entrée.
Elle veut, au fond, vivre tranquillement, jouir de ses biens, de son beau pays.
C'est cette réalité contradictoire qui caractérise, au mitan du xixe siècle, l'âme de la France.
3
RENOUVEAU ET EXTINCTION DU BONAPARTISME
1849-1870
49.
À partir de décembre 1848, la République est donc présidée par un Bonaparte que le peuple a élu au suffrage universel.
Peut-on imaginer que cet homme-là, symbole vivant de la postérité napoléonienne, incarnation de la tradition bonapartiste, se contentera d'un mandat de président de la République de quatre années, non renouvelable ?
Cependant, son entreprise – conserver le pouvoir au-delà de 1852, fût-ce par le recours au coup d'État, et peut-être proclamer l'Empire – paraît aléatoire et difficile.
Les élites politiques conservatrices sont désireuses de garder, par le moyen des Assemblées, la réalité du pouvoir. Elles sont favorables à un régime – monarchie ou république – constitutionnel dans lequel le président ou le monarque n'aura qu'une fonction de représentation.
Elles se défient d'un Bonaparte, élu d'occasion, qu'elles espèrent manœuvrer à leur guise.
Elles craignent davantage encore les « rouges », les partageux, ce peuple auquel on a dû accorder le droit de vote.
Elles aspirent à l'ordre.
Leur parti s'appellera d'ailleurs le parti de l'Ordre.
Mais Louis Napoléon Bonaparte trouve aussi sur sa route ces « démocrates socialistes – « démocsoc » – qui se réclament de la Montagne et de 1793, qui aspirent à une république sociale et constitueront le parti des Montagnards, hostile à la fois au prince-président et au parti de l'Ordre.
C'est donc un jeu politique à trois qui va commencer dès le lendemain de l'élection de Louis Napoléon Bonaparte à la présidence de la République.
Partie difficile, car il existe un quatrième joueur, le plus souvent sur la réserve, mais toujours sollicité par les trois partis – le bonapartiste, le parti de l'Ordre et les Montagnards : il s'agit du peuple.
Et puisqu'il y a suffrage universel, la bataille politique s'étend des villes aux campagnes, là où se concentre la majeure partie de la population.
Celui qui tient et convainc le monde paysan, celui-là peut imposer ses choix.
Le suffrage universel est ainsi un facteur d'unification politique de la nation, et, en même temps, il divise le monde paysan en partisans de l'un ou l'autre des trois « partis ».
Les paysans apporteront-ils toujours leurs voix à un descendant de Napoléon (ils viennent de le faire en décembre 1848), ou aux représentants des notables, ou encore seront-ils gagnés par les idées socialisantes des « démocrates socialistes », et suivront-ils les Montagnards ?
Les quatre années qui vont de décembre 1848 à décembre 1852, date de la proclamation du second Empire, sont décisives pour la vie politique nationale. C'est là, autour de la République, du suffrage universel, du conflit entre bonapartisme, parti de l'Ordre et Montagnards, que se précisent les lignes de fracture politiques de la société française.
L'âme de la France contemporaine y acquiert de nouveaux réflexes.
Les thèmes de l'homme providentiel – au-dessus des partis – et du coup d'État (celui que va perpétrer Louis Napoléon Bonaparte) s'enracinent dans les profondeurs nationales.
Naturellement, la référence au passé pèse sur les choix. Marx qualifie ainsi le coup d'État du 2 décembre 1851 de « 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte ».
Mais cette « répétition », cinquante-deux ans après la prise du pouvoir par Napoléon Bonaparte, peut-elle être autre chose qu'une farce, comme si l'histoire se parodiait, comme si Napoléon le Petit pouvait être comparé à Napoléon le Grand, et le républicain socialisant Ledru-Rollin, à Robespierre ?
Marx conclut à la « farce ».
Dans l'histoire nationale, les événements de ces quatre années n'en sont pas moins d'une importance majeure : ils suscitent des comportements politiques, des réactions « instinctives » qui détermineront les choix du pays.
Ainsi, alors que le pouvoir personnel de Louis Napoléon est installé à l'Élysée, que quelques observateurs lucides craignent « une folie impériale » que « le peuple verrait tranquillement », les élections législatives du 13 mai 1849 marquent la constitution et l'opposition à l'échelle de la nation – et non plus seulement dans les villes – du parti de l'Ordre et du parti montagnard.
Deux blocs – on dira plus tard une droite et une gauche – se sont affrontés. Les résultats sont nets : le parti de l'Ordre – religion, famille, propriété, ordre – remporte 500 sièges à l'Assemblée législative, contre 200 aux Montagnards de Ledru-Rollin, et moins d'une centaine à un « centre ».
« La majorité – sur 750 sièges – est aux mains des ennemis de la République », note Tocqueville.
Mais le parti de l'Ordre n'est pas pour autant rassuré par cette victoire.
Les milieux ruraux ont été – fût-ce marginalement – pénétrés par les idées des Montagnards.
Dans le nord du Massif central – de la Vienne à la Nièvre et à la Saône –, dans les départements alpins (de l'Isère au Var) et dans l'Aquitaine (Lot-et-Garonne, Dordogne), les démocrates sociaux sont présents.
Les villes moyennes sont touchées.
Le parti de l'Ordre mesure qu'à partir de Paris – et des villes ouvrières – les idées socialistes se sont répandues par le biais du suffrage universel dans tout le territoire national.
Elles sont minoritaires, mais le germe en est semé.
Au sein du parti montagnard, on commence à croire que le socialisme peut vaincre pacifiquement grâce au suffrage universel. Des associations et des sociétés secrètes se constituent pour diffuser les idées « montagnardes » et organiser les « militants ».
Dès lors, il reste au parti de l'Ordre, majoritaire à l'Assemblée, à faire adopter un ensemble de lois qui interdiront la propagande socialiste (lois Falloux livrant l'enseignement à l'Église, lois restreignant la liberté de la presse).
L'élection de l'écrivain socialiste Eugène Sue (28 avril 1850) contre un conservateur conduit le parti de l'Ordre à voter, le 31 mai 1850, l'abrogation de fait du suffrage universel, les plus pauvres, par une série de dispositions, se voyant retirer le droit de vote.
Mais puisque la voie électorale est ainsi fermée, resurgissent dans la « Nouvelle Montagne » les idées de prise du pouvoir par les armes.
La fascination et la mystique de la révolution, de la « journée » révolutionnaire, des barricades, trouvent alors une nouvelle vigueur.
Cela ne concerne évidemment que des « minorités ». Mais le peuple constate qu'on le prive de ce droit de vote qu'il avait commencé à s'approprier.
Le parti de l'Ordre croit avoir remporté la mise contre les Montagnards. Fort de cette victoire, il s'oppose à toute révision constitutionnelle qui aurait permis à Louis Napoléon, en 1852, de se présenter pour un nouveau mandat.
Les Montagnards ont voté en l'occurrence avec le parti de l'Ordre. Mais ils mêleront leurs voix à celles du parti bonapartiste pour s'opposer à la constitution d'une force militaire destinée à protéger l'Assemblée d'un coup d'État.
En fait, ces manœuvres politiciennes laissent Louis Napoléon Bonaparte maître du jeu.
Le 13 novembre 1851, il peut proposer à l'Assemblée l'abrogation de la loi du 31 mai 1850 qui a aboli le suffrage universel.
L'Assemblée conservatrice repousse cette proposition, et le prince-président apparaît ainsi comme l'homme qui, contre les notables, mais aussi contre les rouges partageux, entend redonner la parole au peuple.
Il retrouve de cette manière l'une des sources du bonapartisme, qui veut tisser un lien direct avec la nation en se dégageant de l'emprise des partis.
Il dispose dans l'armée – épurée par ses soins – du soutien que lui apporte le « souvenir napoléonien ».
Et parce qu'il est au cœur de l'institution – à l'Élysée –, il va pouvoir préparer son coup d'État, exécuté le 2 décembre 1851, jour anniversaire d'Austerlitz.
Des députés, dont Thiers, sont arrêtés.
Ceux qui résistent et tentent de soulever le peuple parisien sont dispersés par la troupe, qui tire.
Le député Baudin est tué sur une barricade pour avoir montré au peuple comment on meurt pour 25 francs par jour, cette indemnité parlementaire que le peuple, spectateur, conteste.
Sur les boulevards, dans Paris, afin d'empêcher par la terreur l'extension de la résistance, les troupes de ligne ouvrent le feu sur la foule des badauds (trois à quatre cents morts).
La résistance est vive dans les départements pénétrés par les idées républicaines, ceux qui ont voté « rouge » en 1849. La répression est sévère : 84 députés expulsés, 32 départements en état de siège, 27 000 « rouges » déférés devant des commissions mixtes (tribunaux d'exception : un général, un préfet, un procureur), dix mille déportés en Algérie et en Guyane, des milliers d'internés et d'exilés.
Mais le suffrage universel est rétabli, et, le 20 décembre, 7 500 000 voix approuvent le coup d'État, contre 650 000 opposants. On compte un million et demi d'abstentions.
Un an plus tard, un nouveau plébiscite – 7 800 000 oui – permet à Louis Napoléon, devenu Napoléon III, de rétablir l'Empire. Celui-ci est proclamé le 1er décembre 1852, cinquante-huit ans après le sacre du 2 décembre 1804.
C'est le renouveau du bonapartisme, mais aussi le début de son extinction.
Car la résistance au coup d'État et la rigueur de la répression marquent une rupture irréductible entre une partie du peuple et la figure de Bonaparte.
Certes, l'immense succès des plébiscites de 1851 et 1852 montre bien que le mythe demeure, que l'homme providentiel, la figure d'un empereur tirant sa légitimité du peuple consulté dans le cadre du suffrage universel, continuent de fonctionner.
Mais les républicains ont une assise populaire.
La grande voix de Victor Hugo, l'exilé, va commencer de se faire entendre.
Le 2 décembre 1851 sera qualifié de « crime ».
Louis Napoléon est un « parjure » que Marx désigne sous le nom de Crapulinsky.
Louis Napoléon a beau répéter : « J'appartiens à la Révolution » et décréter la mise en vente de tous les biens immobiliers des Orléans, on sait aussi que les préfets ont reçu l'ordre, dès le 6 janvier 1852, d'effacer partout la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Et le ralliement de la plupart des conservateurs du parti de l'Ordre à l'Empire confirme que ce régime n'est pas au-dessus des « partis » : il est « réactionnaire ».
On le sait, même si on le soutient ou si on l'accepte par souci de paix civile.
Mais les républicains refuseront ce « détournement » du suffrage universel. Et, fruit de cette expérience, ils garderont une défiance radicale à l'endroit du plébiscite, de la consultation directe du peuple mise au service d'un destin personnel.
L'âme de la France contemporaine vient d'être profondément marquée. La République avait massacré les insurgés de juin 1848, ce qui avait conduit le « peuple » à choisir pour président Louis Napoléon Bonaparte.
Après le coup d'État du 2 décembre 1851, il y a désormais, minoritaire mais résolu, un antibonapartisme populaire.
Ce Napoléon III, c'est Badinguet, Napoléon le Petit !
La colère et le mépris qu'il suscite renforcent le désir de République et le souvenir de la Révolution.
50.
Au lendemain de la création du second Empire, les Français ne croient pas à la longévité de ce régime né d'un coup d'État sanglant et que deux plébiscites ont légitimé.
L'âme de la France est une âme sceptique.
Depuis le 21 septembre 1792, les citoyens de cette nation « politique » ont vu se succéder la Ire République, le Directoire, le Consulat, l'Empire, une monarchie légitimiste, une monarchie orléaniste et constitutionnelle, la IIe République et enfin le second Empire. Déclarations, Chartes, Actes additionnels, Constitutions ont tour à tour régenté la vie publique.
On a débattu, en 1789, dans les villages des cahiers de doléances, on a voté pour celui-ci ou pour celui-là, on a disposé du droit de vote, puis on l'a perdu, et on en a de nouveau bénéficié.
Le Français, si éprouvé par les changements politiques, est devenu prudent, attentiste.
Puisque la monarchie millénaire de droit divin s'est effondrée et que Louis XVI a été décapité, lui qui avait été sacré à Reims, qui peut croire qu'en ce bas monde un régime politique soit promis à la longue durée ?
Le sacre par le pape de Napoléon Ier n'a pas empêché l'Empereur d'être vaincu et de mourir en exil à Sainte-Hélène.
Et Charles X n'a pas durablement bénéficié de la protection divine, bien qu'il eût été lui aussi sacré à Reims.
Comment imaginer dès lors que ce Louis Napoléon Bonaparte, même devenu Napoléon III, puisse régner plus longtemps que son oncle Napoléon Ier ?
Nul ne peut le concevoir.
On observe. On ne commente pas : trop d'argousins, trop de mouchards, trop de gendarmes. Trop de risques à prendre parti pour un régime dont on comprend bien qu'il est fragile, comme tous les régimes, et que viendra son tour de chanceler, de se briser.
Telle est alors l'âme de la France, qui, en soixante années, a subi tant de pouvoirs, entendu tant de discours, qu'elle baisse la tête et fait mine de se désintéresser des affaires publiques que gèrent ces messieurs les intelligents, les notables.
Or ceux-ci, précisément, ne croient guère à la longévité du second Empire.
Guizot, qui exprime la pensée des milieux de la bourgeoisie libérale, déclare : « Les soldats et les paysans ne suffisent pas pour gouverner. Il y faut le concours des classes supérieures, qui sont naturellement gouvernantes. »
Tocqueville est tout aussi réservé sur l'avenir du régime quand il écrit en 1852 :
« Quant à moi qui ai toujours craint que toute cette longue révolution française ne finît par aboutir à un compromis entre l'égalité et le despotisme, je ne puis croire que le moment soit encore venu où nous devrions voir se réaliser définitivement ces prévisions, et, en somme, ceci a plutôt l'air d'une aventure qui se continue que d'un gouvernement qui se fonde. »
Il n'empêche : l'« aventurier » Louis Napoléon, entouré d'habiles et intelligents complices – dont Morny, son demi-frère –, va régner de 1852 à 1870, soit sept ans de plus que Napoléon Ier, sacré en 1804 et définitivement vaincu en 1815 !
Cette longue durée du second Empire et les transformations qui la caractérisent vont servir de socle à la fin du xixe siècle et aux premières décennies du xxe.
Le second Empire dit « autoritaire » est ainsi, durant quinze années – de 1852 à 1867 –, le moule dans lequel l'âme de la France prend sa forme contemporaine.
L'État centralisé – répressif, policier même – organise et régente la vie départementale, sélectionne les candidats aux élections.
Ces « candidatures » officielles bénéficient de tout l'appareil de l'État.
Le préfet devient pour de bon la clé de voûte de la vie locale sous tous ses aspects. Il fait régner l'« ordre » politique et moral. Il est le lien entre le pouvoir central – impérial – et toutes les strates de la bourgeoisie : celle qui vit de ses rentes, de la perception de ses fermages ; celle qui est, d'une certaine façon, l'héritière des « robins » : avocats, médecins et apothicaires, notaires, parfois tentée par un rôle politique, mais prudente et surveillée.
L'Empire n'aime pas les esprits forts, les libres penseurs.
D'ailleurs, aux côtés du préfet, l'évêque est, avec le général commandant la place militaire, le personnage principal. Il a la haute main sur l'enseignement, entièrement livré à l'Église. Les ordres religieux – au premier rang desquels les Jésuites – ont été à nouveau autorisés.
L'Empire est clérical.
La police et les confesseurs veillent aux bonnes mœurs.
Le réalisme de certains peintres (Manet, Courbet) est suspect. Madame Bovary, Les Fleurs du mal, sont condamnées par les tribunaux.
Les journaux sont soumis à l'autorisation préalable.
Un « homme de lettres » qui est perçu comme un opposant, un rebelle – ainsi Jules Vallès –, est réduit à la misère, voire à la faim. Il n'écrit pas dans les journaux, il ne peut enseigner – l'Église est là pour le lui interdire –, il remâche sa révolte. Il se souvient des espoirs nés en février 1848 et noyés dans le sang des journées de juin. Il rêve à de nouvelles journées révolutionnaires qui lui permettraient de prendre sa revanche.
On voit ainsi s'opposer deux France complémentaires mais antagonistes.
Une France « officielle », adossée aux pouvoirs de l'État, qui cherche dans l'Église, l'armée, la police, la censure, les moyens de contenir l'autre France.
Celle-ci est minoritaire, souterraine, juvénile, conduite parfois par le sentiment qu'elle ne peut rien contre la citadelle du régime à une sorte de rage désespérée.
L'hypocrisie du pouvoir, qui masque sa corruption et sa débauche sous le vernis des discours moralisateurs, révolte les « vieux » républicains révolutionnaires – ils avaient, pour les plus jeunes, une vingtaine d'années en 1848. Ils sont rejoints par des éléments des nouvelles générations, « nouvelles couches » elles aussi républicaines.
Mais, jusqu'aux années 1860, le pouvoir semble enfermé dans son autoritarisme. C'est Thiers qui, en 1864, parle au Corps législatif des « libertés nécessaires ».
Il reste aux opposants à s'enivrer, à vivre dans la « bohème », à clamer leur athéisme, leur anticléricalisme, leur haine des autorités.
Mais ils sont le pot de terre heurtant le pot de fer.
Car la France se transforme, et son développement sert le second Empire.
C'est sous Napoléon III que le réseau ferré devient cette toile d'araignée de 6 000 kilomètres qui couvre l'Hexagone.
C'est durant cette période que la métallurgie – et le Comité des forges, où les grandes fortunes se retrouvent – augmente ses capacités. Houillères et sidérurgie dressent pour plus d'un siècle leurs chevalets, leurs terrils et leurs hauts-fourneaux dans le Nord, au Creusot, en Lorraine.
C'est le second Empire qui dessine le nouveau paysage industriel français, qui trace les nouvelles voies de circulation, en même temps qu'ici et là des progrès sont accomplis dans l'agriculture.
Les traités de libre-échange contraignent les industriels français à se moderniser.
Et c'est une fois encore l'État qui donne les impulsions nécessaires, qui soutient le développement du système bancaire.
Vallès écrira : « Le Panthéon est descendu jusqu'à la Bourse. »
Car l'argent irrigue la haute société et ses laudateurs (journalistes, écrivains), ses alliés (banquiers, industriels), ses protecteurs (les militaires, les juges), ses parasites (les corrompus).
Le visage de Paris se transforme : Haussmann perce les vieux quartiers, crée de grands boulevards qui rendront difficile à l'avenir la construction de barricades.
Et chaque immeuble construit sur les ruines d'une vieille demeure enrichit un peu plus ceux qui, avertis parce que proches du pouvoir, anticipent les développements urbains.
Le modèle français se trouve ainsi conforté.
Le pouvoir personnalisé est entouré de ses courtisans et de ses privilégiés.
Centralisé, autoritaire, il préside aux bouleversements économiques et sociaux qu'il encadre. Et la richesse nationale s'accroît.
On fait confiance à cet État qui maintient l'ordre : les emprunts lancés sont couverts quarante fois !
Structure étatique et fortunes privées, pouvoir et épargne, se soutiennent mutuellement.
Quant aux pauvres, aux salariés, aux « misérables », aux « ouvriers » – Napoléon III se souvient d'avoir écrit et voulu L'Extinction du paupérisme –, ces humbles obtiennent quelques miettes au grand banquet de la fête impériale.
C'est la particularité d'un pouvoir personnel issu d'un coup d'État, mais aussi du suffrage universel, de n'être pas totalement dépendant des intérêts de telle ou telle couche sociale.
Napoléon III va accorder en 1864, dans un cadre très strict, le droit de grève.
Dès 1862, il a permis à une délégation ouvrière de se rendre à Londres à l'Exposition universelle, d'adhérer à l'Association internationale des travailleurs à l'origine de laquelle se trouvent Marx et Engels.
Ces ouvriers peuvent faire entendre leurs voix dans le « Manifeste des 60 » sans connaître la prison de Sainte-Pélagie (1864).
Ainsi s'esquisse, toujours en liaison avec l'État – et dans le cadre de sa stratégie politique –, une nouvelle séquence de l'histoire nationale : elle voit apparaître sur la scène sociale des « ouvriers » d'industrie qui manifestent au cours de violentes grèves et créent à Paris, en 1865, une section de l'Internationale ouvrière.
Pourtant, ces manifestations, ces novations, n'affaiblissent pas le régime. L'État les encadre, il conserve l'appui des bourgeoisies et la neutralité bienveillante des paysans, qui constituent encore la majorité de la population française.
Mais Napoléon le Petit aspire à chausser les bottes de Napoléon le Grand. Sa politique étrangère active, après une période de succès, connaîtra des difficultés qui saperont son régime.
La tradition bonapartiste, qui a été l'un des leviers de la conquête du pouvoir, devient ainsi la cause de sa perte.
Dans l'âme française, la quête d'un grand rôle international pour la nation aveugle le pouvoir.
Il croit avoir barre sur le monde comme il a barre sur son pays.
Là est l'illusion mortelle.
Certes, Napoléon III jette les bases d'un empire colonial français au Sénégal, à Saigon. La Kabylie est « pacifiée » ; Napoléon III pense à promouvoir un « royaume arabe » en Algérie, et non pas une domination classiquement coloniale : anticipation hardie !
Il intervient en Italie en s'alliant au Piémont contre l'Autriche, et les victoires de Magenta et de Solferino (4 et 24 juin 1859) permettront à la France, en retour, d'acquérir, après plébiscite, Nice et la Savoie (1860).
Pourtant, la guerre contre la Russie (1855) en Crimée, pour défendre l'Empire ottoman contre les visées russes, était déjà une entreprise discutable.
Elle avait cependant pour contrepartie l'alliance avec l'Angleterre, dont Napoléon III, tirant les leçons de l'échec du premier Empire, voulait faire le pivot de sa politique étrangère, prolongeant ainsi l'Entente cordiale mise en œuvre par Louis-Philippe.
Cette alliance Paris-Londres demeurera d'ailleurs, durant toute la fin du xixe siècle et tout le xxe siècle – et malgré quelques anicroches –, l'axe majeur de la politique extérieure française.
Mais l'expédition au Mexique « au profit d'un prince étranger (Maximilien d'Autriche) et d'un créancier suisse », dira Jules Favre, républicain modéré, alors que la situation en Europe est mouvante et périlleuse pour les intérêts français, constitue un échec cuisant (1863-1866).
Plus graves encore sont les hésitations devant les entreprises de Bismarck, qui, le 3 juillet 1866, écrase l'Autriche à Sadowa, la Prusse faisant désormais figure de grande puissance allemande.
Toutes les contradictions de la politique étrangère de Napoléon III apparaissent alors au grand jour.
Il a été l'adversaire de l'Autriche, servant ainsi le Risorgimento italien. Mais les troupes françaises ont soutenu le pape contre les ambitions italiennes. Et Napoléon III a perdu de ce fait le bénéfice de ses interventions en Italie. À Mentana, en 1867, des troupes françaises se sont opposées à celles de Garibaldi : il fallait bien satisfaire, en défendant le Saint-Siège contre les patriotes italiens, les catholiques français, socle du pouvoir impérial.
Et c'est seul que Napoléon III doit affronter Bismarck, qui, en 1867, rejette toutes les revendications de compensation émises par Paris (rive gauche du Rhin, Belgique, Luxembourg...). Ni l'Angleterre, ni la Russie, ni l'Italie, ni bien sûr l'Autriche, ne soutiennent la France contre la Prusse.
Comme toujours en France, politique extérieure et politique intérieure sont intimement mêlées.
Le premier Empire avait succombé à la défaite militaire et à l'occupation.
Napoléon III peut se souvenir de Waterloo.
51.
Voilà quinze ans que le second Empire a été proclamé.
C'est le temps qu'il faut pour que de nouvelles générations apparaissent et que les conséquences des transformations politiques, économiques et sociales produisent leurs effets.
En 1869, des grèves meurtrières – de dix à quinze morts à chaque fois –, réprimées par la troupe, éclatent à Anzin, à Aubin, au Creusot. Des troubles se produisent à Paris. Des « républicains irréconciliables » s'appuient sur ce mécontentement qui sourd et sur les échecs humiliants subis en politique extérieure – Mexico a été évacué par les troupes françaises en février 1867 – pour rappeler les origines du régime impérial.
On célèbre les victimes du coup d'État du 2 décembre.
On veut dresser une statue au député Baudin.
On manifeste en foule, armes dissimulées sous les redingotes, en janvier 1870, quand le cousin germain de l'empereur, Pierre Bonaparte, tue le journaliste Victor Noir.
Des hommes nouveaux – Gambetta – font le procès du régime, s'expriment au nom des « nouvelles couches », formulent à Belleville un programme républicain : séparation de l'Église et de l'État, libertés publiques, instruction laïque et obligatoire. Les candidats républicains au Corps législatif sont élus à Paris. À ces élections du mois de mai 1869, un million de voix seulement séparent les opposants résolus des candidats de la majorité.
Mais ces derniers sont des partisans de l'ordre plutôt que des « bonapartistes ».
À leur tête, le « vieux » Thiers, qui rassemble autour de lui les « modérés », les anciens soutiens de la monarchie constitutionnelle, ceux que le coup d'État du 2 décembre 1851 a privés du pouvoir.
Ils se sont ralliés à Louis Napoléon Bonaparte. Ils ont participé à la « fête impériale », mais Napoléon III ne leur semble plus capable d'affronter les périls intérieurs et extérieurs. Lorsqu'il était l'efficace défenseur de l'ordre, brandissant le glaive et faisant de son nom le bouclier de la stabilité sociale, on l'acceptait, on l'encensait. Mais le « protecteur » semble devenu impotent.
Thiers l'avertit au printemps de 1867 : « Il n'y a plus une seule faute à commettre. »
Le préfet de police de Paris, Piétri, déclare : « L'empereur a contre lui les classes dirigeantes. »
C'est ce moment où le gouffre se crée sous un régime, et la France, vieille nation intuitive et expérimentée, attend la crise, continuant de vivre comme si de rien n'était, mais pressentant la tempête comme une paysanne qui en flaire les signes avant-coureurs.
Cependant, le décor impérial est toujours en place.
En 1867, Paris est illuminé pour l'Exposition universelle que visitent les souverains étrangers. Victor Hugo a même écrit la préface du livre officiel présentant l'Exposition et le nouveau Paris de Haussmann. N'est-ce pas la preuve que l'Empire autoritaire devient libéral ?
Napoléon III desserre tous les liens : ceux qui étranglaient la presse, qui limitaient le droit de réunion ou les pouvoirs des Assemblées.
L'Empire semble recommencer. Des républicains modérés s'y rallient. L'un d'eux, Émile Ollivier, devient chef du gouvernement.
Au plébiscite du 8 mai 1870, 7 358 000 voix contre 1 572 000 et 2 000 000 d'abstentions approuvent les mesures libérales décidées par l'empereur.
Une fois encore, le suffrage universel – contre les élites – ratifie ses choix.
Napoléon III paraît demeurer l'homme providentiel capable d'entraîner le pays et de le faire entrer dans la « modernité ». C'est un Français, Lesseps qui, en présence de l'impératrice, inaugure en 1869 le canal de Suez, son œuvre.
« L'Empire est plus puissant que jamais », constatent les républicains accablés.
« Nous ferons à l'empereur une vieillesse heureuse », déclare Émile Ollivier en commentant les résultats du plébiscite : après plus de quinze ans de règne, Napoléon III a « retrouvé son chiffre ».
Pourtant, en quelques mois, le régime va s'effondrer. Le piège est ouvert par Bismarck.
Candidature d'un Hohenzollern au trône d'Espagne. Indignation de Paris ! Retrait de la candidature, mais dépêche d'Ems (où le roi prussien Guillaume Ier est en villégiature), humiliante.
Embrasement à Paris. L'entourage de Napoléon III, l'impératrice, les militaires : « La guerre sera une promenade de Paris à Berlin ! » Les journalistes à gages, les courtisans poussent à la guerre afin de laver l'affront et de recouvrer, par la victoire sur la Prusse, l'autorité que l'on a perdue par les réformes libérales.
Illustration et confirmation d'une caractéristique française : un monarque – ici l'empereur – n'accepte pas de n'être qu'un souverain constitutionnel dépendant des élus.
Le pouvoir exécutif refuse d'être entravé ou contrôlé ou orienté par les députés.
La politique étrangère étant le terrain sur lequel il est le seul maître, il va donc y jouer « librement », en souverain absolu, sa partie.
Encore faut-il qu'il soit victorieux.
Le 19 juillet 1870, Émile Ollivier salue la déclaration de guerre à la Prusse d'un « cœur léger ».
La France est pourtant seule face à Berlin, qui dispose d'une armée deux fois plus nombreuse et d'une artillerie – Krupp ! – supérieure.
Ni l'Autriche ni l'Italie ne s'allient à Paris. Et en six semaines de guerre l'état-major français montre son incapacité.
On perd l'Alsace et la Lorraine. On se replie sur Metz, où le maréchal Bazaine – le vaincu du Mexique – s'enferme.
À Sedan, le 2 septembre, Napoléon III – à la tête de ses troupes depuis le 23 juillet – se constitue prisonnier avec près de cent mille hommes.
Que reste-t-il d'un empereur qui a « remis son épée » ?
L'humiliation, cependant que la nation est entraînée dans la débâcle.
La France connaît là un de ces effondrements qui, tout au long des siècles, ont marqué son âme.
Le pays est envahi. L'armée, vaincue. Le pouvoir, anéanti. C'est l'extinction du bonapartisme.
Les républicains, les révolutionnaires qui, en juillet, avaient tenté – c'est le cas de Jules Vallès – de s'opposer au délire guerrier, et que la foule enthousiaste avait failli lyncher, envahissent le Corps législatif.
Ils déclarent l'empereur déchu.
Le 4 septembre 1870, ils proclament la république.
Au coup d'État originel répond ainsi le coup de force républicain et parisien.
Le 2 décembre 1851 a pour écho le 4 septembre 1870.
Au second Empire succède, par et dans la débâcle, la IIIe République.
Mais l'émeute républicaine, révolutionnaire et patriote – on veut organiser la défense nationale contre les Prussiens – n'a pas changé le pays, celui qui, en mai, a apporté 7 358 000 voix à l'empereur, ou plutôt au pouvoir en place, garant pour l'écrasante majorité de l'ordre et de la paix civile.
Rien n'a changé non plus dans les hiérarchies sociales, les rouages du pouvoir.
Les préfets sont en place.
Les généraux vaincus par les Prussiens gardent le contrôle de cette armée qui a été l'armature du pouvoir impérial.
Or tous les notables – le parti de l'Ordre – craignent que la débâcle ne soit l'occasion, pour les « rouges », de s'emparer du pouvoir. L'armée, à leurs yeux, est le recours contre les « révolutionnaires ».
L'un de ces « modérés » – républicain – déclare dès le 3 septembre : « Il est nécessaire que tous les partis s'effacent devant le nom d'un militaire qui prendra la défense de la nation. »
Ce sera le général Trochu.
« Participe passé du verbe trop choir », écrira Victor Hugo.
4
LES VÉRITÉS DE MARIANNE
1870-1906
52.
En neuf mois, entre septembre 1870 et mai 1871, l'âme de la France est si profondément blessée que, durant près d'un siècle, les pensées, les attitudes et les choix de la nation seront influencés, voire souvent dictés, par ce qu'elle a souffert après la chute du second Empire.
C'est là le legs du régime impérial.
Il ne se mesure pas en kilomètres de voies ferrées, en tonnes d'acier, en traités de libre-échange, en longueurs de boulevards tracés à Paris.
L'héritage de Napoléon III, cette honte qu'il a inoculée à la nation, s'appelle la débâcle, la défaite, la reddition du maréchal Bazaine, l'occupation du pays, l'entrée des troupes prussiennes dans Paris, la proclamation de l'Empire allemand dans la galerie des Glaces, à Versailles, le 18 janvier 1871.
Le roi de Prusse devient, par le génie politique de son chancelier de fer, Bismarck, l'empereur Guillaume. Et c'est comme si la botte d'un uhlan écrasait la gorge des patriotes français.
Ils songeront à la revanche, à leurs deux « enfants », l'Alsace et la Lorraine, livrées aux Prussiens en dépit des protestations des députés de ces deux provinces.
Et cette peste, cette guerre perdue, cette suspicion entre les peuples français et allemand, l'un voulant effacer la honte de la défaite et recouvrer Strasbourg, l'autre soucieux d'empêcher ce réveil français, la haine mêlée de fascination qui les unit, ne pouvaient que créer les conditions psychologiques d'une nouvelle guerre. Puis, elle-même, en générer une autre !
Bel héritage que celui de Napoléon III !
Et, comme si cela ne suffisait pas, la guerre contre les Prussiens nourrit la guerre civile.
Le parti de l'Ordre, même s'il fait mine, après Sedan et le siège de Paris, de vouloir poursuivre la guerre, songe d'abord à conclure au plus vite l'armistice puis la paix avec Bismarck.
Les Thiers, les Jules Favre, les Jules Ferry, les notables du parti de l'Ordre et, derrière eux, l'immense majorité des Français craignent que de la prolongation de la guerre ne jaillisse la révolution parisienne.
Alors, même si Gambetta réussit à quitter Paris en ballon, à rejoindre Tours et à constituer sur la Loire une armée de 600 000 hommes, même si des généraux comme Chanzy et Bourbaki, des officiers valeureux comme Denfert-Rochereau ou Rossel, se battent vaillamment et remportent quelques victoires, la guerre est perdue.
Jules Favre rencontre Bismarck dès le 15 septembre 1870. Les républicains, les révolutionnaires, les patriotes, rêvent encore de mener la lutte jusqu'au bout, de « chasser l'envahisseur » ; ils en appellent aux souvenirs des armées révolutionnaires. Victor Hugo, septuagénaire, veut s'engager, exalte les combats des « partisans et francs-tireurs ». Mais ces irréductibles sont minoritaires.
Toutes les consultations électorales pour approuver les mesures gouvernementales – le 3 novembre 1870, à Paris, 550 000 voix pour, 68 000 contre, puis dans toute la France, le 8 février 1871, donnent une majorité écrasante en faveur de la paix à n'importe quel prix : cinq milliards de francs-or pour les Prussiens et, par surcroît, l'Alsace et la moitié de la Lorraine.
L'Assemblée qui se réunit à Bordeaux en février 1871 est l'expression de ce désir d'ordre et de paix, mais aussi de cette haine contre les révolutionnaires parisiens, cette minorité qui crée une Commune de Paris, un Comité de salut public, qui, le 18 mars 1871, quand on veut lui reprendre les canons qu'elle a payés, se rebelle – et les soldats rejoignent les insurgés, et l'on fusille deux généraux dont l'un avait participé à la répression des journées de juin 1848 !
Car, de manière inextricable, le passé se noue au présent, et ce nœud emprisonne l'avenir.
Les « communards » de 1871 sont les jeunes gens de 1848, vaincus, censurés, marginalisés durant tout l'Empire.
C'est long, vingt ans à subir un régime arrogant, soutenu par des majorités plébiscitaires, vainqueur jusqu'au bout, avant, « divine surprise », de s'effondrer tout à coup comme une statue de plâtre.
Ce sont ces jeunes gens devenus des hommes de quarante ou cinquante ans qui manifestent, imposent la proclamation de la république, puis s'arment dans Paris parce que la Révolution c'est Valmy, et qu'ils veulent donc défendre Paris contre les Prussiens.
Pour ces hommes-là, sonne l'heure de leur grande bataille, l'épreuve décisive, la chance à saisir.
À l'enthousiasme se mêle chez eux l'angoisse, car ils sont divisés. Ils savent qu'ils ne sont qu'une minorité, que le pays ne les suit pas, que les quartiers ouest de Paris se sont vidés de leurs habitants, que les Prussiens ont libéré des prisonniers afin qu'ils rallient l'armée hier impériale, aujourd'hui « républicaine », mais ce sont toujours les mêmes officiers qui commandent – bonapartistes ou monarchistes, soldats de l'ordre qui, vaincus par les Prussiens, veulent écraser ces révolutionnaires, ces républicains.
Entre la République et la reddition aux Prussiens, le maréchal Bazaine, à Metz, choisit de déposer les armes.
Ainsi se creuse le fossé entre les révolutionnaires, les républicains patriotes et l'armée. Et, réciproquement, l'armée ne se sent pas républicaine : quand elle entrera dans Paris, le 21 mai 1871, elle fusillera ces insurgés, ces communards.
Trente mille morts. Des milliers de déportés en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Pour cette fraction minoritaire du peuple, déjà soupçonneuse envers la République fusilleuse de juin 1848, la conviction s'affirme qu'il n'y a rien à attendre de ce régime-là, pas plus que d'un autre.
L'idée s'enracine que les régimes politiques, quelle que soit leur dénomination, monarchie, empire, république, ne sont que des « dictatures ».
Alors, pourquoi ne pas imposer la dictature du prolétariat pour remplacer la dictature militaire, celle des aristocrates ou des notables ?
On mesure ce qui germe dans cette « guerre civile » du printemps 1871 – la qualification est de Karl Marx, qui publie La Guerre civile en France –, et comment la violence des combats dans Paris – exécution d'otages par les communards qui incendient les Tuileries, l'Hôtel de Ville, répression sauvage par les troupes, tout cela sous l'œil des Prussiens – crée des divisions politiques profondes, des cicatrices qui marqueront longtemps l'âme de la France.
L'on s'accusera mutuellement de barbarie, de faire le jeu du Prussien, et toutes les oppositions anciennes – monarchistes contre républicains, patriotes contre « parti de l'étranger » – sont confirmées par cette impitoyable « guerre civile » qui voit Paris perdre au terme des combats, en mai, 80 000 de ses habitants.
Cet événement devient une référence pour confirmer les accusations réciproques. Il est un mythe que l'on exalte, comme un modèle à suivre, avec ses rituels – ainsi le défilé au mur des Fédérés, chaque 28 mai.
Il est la preuve de l'horreur et de la barbarie dont sont capables et coupables ces « rouges » qui ont tenté d'incendier Paris.
La Commune s'inscrit dans la longue série des « guerres civiles » françaises – guerres de Religion, Révolution avec ses massacres de Septembre, la Vendée, la guillotine, les terreurs jacobine ou blanche, les journées révolutionnaires et les révolutions de 1830 et de 1848 qui en sont l'écho, les journées de juin – dont le souvenir réverbéré rend difficile toute politique apaisée.
Avec de telles références mythiques, le jeu démocratique aura du mal à être considéré comme possible, comme le but à atteindre.
Les oppositions sont d'autant plus marquées que le parti de l'Ordre s'inscrit lui aussi dans une histoire longue.
Thiers, qui est désigné par les élections du 8 février 1871 « chef du pouvoir exécutif du Gouvernement provisoire de la République », a été l'un des ministres de Louis-Philippe. En février 1848, il a conseillé que l'on évacue Paris, abandonnant la capitale à l'émeute pour la reconquérir systématiquement et en finir avec les révolutionnaires. Puis il a été le mentor de Louis Napoléon, qu'il a cru pouvoir mener à sa guise et qu'il a fait élire président de la République en 1848.
En 1871, face à la Commune, Thiers applique son plan de 1848 avec une détermination cynique. L'Assemblée s'installe à Versailles pour bien marquer ses intentions : Paris doit être soumis à un pouvoir qui, symboliquement, siège là où le peuple parisien avait imposé sa loi à Louis XVI et à Marie-Antoinette dès octobre 1789.
En 1871, c'est la revanche de Versailles : versaillais contre communards, province contre Paris, l'armée fidèle contre les émeutiers, parti de l'Ordre contre révolutionnaires.
Et le pays dans sa majorité soutient l'entreprise de Thiers.
Il faut extirper les rouges de l'histoire nationale en les fusillant, en les déportant.
Au terme de la Semaine sanglante, le 28 mai 1871, le mouvement révolutionnaire est brisé pour une vingtaine d'années.
La France des épargnants fait confiance à Thiers.
Les emprunts lancés pour verser aux Prussiens les cinq milliards de francs-or prévus par le traité de paix signé à Francfort le 10 mai 1871 sont largement couverts.
La France est riche.
Les troupes prussiennes évacueront le pays à compter du 15 mars 1873. Thiers est le « libérateur du territoire ».
La France est calme.
Elle est prête à accepter une monarchie constitutionnelle. Mais alors que la majorité de l'Assemblée est monarchiste, les deux branches de la dynastie – la branche aînée, légitimiste, avec le comte de Chambord ; la branche cadette, orléaniste, avec le comte de Paris – ne peuvent s'entendre.
Le pays « entre ainsi dans la République à reculons ».
Thiers est élu président de la République le 31 août 1871. Mais les institutions ne sont pas fixées. Et lorsque, constatant la division des monarchistes, Thiers se rallie à la République en précisant : « La République sera conservatrice ou ne sera pas », la majorité monarchiste l'écarte, le 24 mai 1873, préférant élire comme nouveau président de la République le maréchal de Mac-Mahon, l'un des chefs de l'armée impériale, l'un des vaincus de la guerre de 1870, l'un des responsables de la débâcle !
Mais le mérite de Mac-Mahon est de n'être pas républicain. L'Assemblée peut donc, puisque le comte de Chambord refuse de renoncer au drapeau blanc, ce symbole de l'Ancien Régime, voter la loi qui fixe à sept ans la durée du mandat du président de la République, en espérant que ce délai sera suffisant pour que les prétendants monarchistes se réconcilient, acceptent les principes d'une monarchie constitutionnelle et le drapeau tricolore qui en est l'expression.
L'entente ne se fera pas, et, le 29 janvier 1875, l'amendement du député Wallon est voté à une voix de majorité, introduisant donc le mot « république » dans les lois constitutionnelles.
C'est ainsi, au terme d'un compromis entre républicains modérés – Jules Grévy, Jules Ferry – et monarchistes constitutionnels, que la République s'installe presque subrepticement.
Avec son Sénat, contrepoids conservateur à la Chambre des députés, son président qui ne peut rien sans l'accord du président du Conseil des ministres responsable devant les Chambres, la République est parlementaire.
Mais ces lois constitutionnelles peuvent aussi bien servir de socle à une monarchie constitutionnelle qu'à une république conservatrice.
L'âme de la France blessée, gorgée de mythes du passé, a vécu durant les deux premiers tiers du xixe siècle des alternances chaotiques entre les régimes, les brisant l'un après l'autre par le biais des révolutions ou à l'occasion d'une défaite devant les armées étrangères.
Révolution et débâcle, guerre civile et pouvoir dictatorial, se sont ainsi succédé.
Mais les passions politiques ont de moins en moins concerné la majorité du pays.
La nation a appris à user du suffrage universel. À chaque fois, elle a voté pour l'ordre – fût-il impérial –, pour la paix, pour le respect des propriétés.
Les journées révolutionnaires ont certes occupé le devant de la scène. Elles ont constitué l'imaginaire national. Elles font partie du rituel français. Elles sont célébrées par une minorité qui veut croire que le pays la suit. Pourtant, dans sa profondeur et sa majorité, le peuple choisit la modération, même s'il écoute avec intérêt et peut même applaudir, un temps, les discours extrêmes, les utopies qui se nourrissent de la sève nationale.
Même si, rituellement, chaque année, les cortèges couronnés de drapeaux rouges célèbrent, au mur des Fédérés du cimetière du Père-Lachaise, la mémoire des insurgés du printemps 1871, les institutions de la IIIe République, nées de la débâcle et du massacre des communards, expriment le choix de la modération.
53.
En 1875, rien n'est encore définitivement acquis pour la République.
Elle n'est qu'un mot dans les lois constitutionnelles.
Ce mot peut en devenir la clé de voûte ou bien être remplacé par cette monarchie constitutionnelle qui est le régime de prédilection de la majorité des députés et du président de la République, Mac-Mahon.
Ils attendent l'union des héritiers de la monarchie. Ils s'emploient à faire régner dans le pays l'« ordre moral », à leurs yeux condition indispensable de l'ordre public et de la préservation des traditions, si nécessaire à une restauration monarchique.
C'est encore un moment important pour l'âme de la France. On la voue au Sacré-Cœur. On construit, pour expier les crimes de la Commune, la basilique du Sacré-Cœur, sur la butte Montmartre. On fait repentance. On multiplie les processions, les messes d'expiation. Et l'on ravive ainsi, en réaction, l'esprit des Lumières.
L'ancienne et profonde fracture qui, au cours des décennies, avait séparé les Français en défenseurs de l'Église et en libertins, esprits forts, laïques et déistes, redevient une césure majeure.
« Le cléricalisme, voilà l'ennemi ! » s'écrit Gambetta.
C'est un combat passionnel qui s'engage et qui sert de ligne de front entre monarchistes et républicains.
D'un côté les cléricaux, de l'autre, les anticléricaux.
La France croit se donner ainsi une vraie division qui est en même temps un leurre. Car elle dissimule l'entente profonde qui existe entre les « modérés » que sont les monarchistes constitutionnels et les notables républicains.
Tout les rapproche : la même crainte du désordre, le même refus de remettre en cause la propriété et l'organisation sociale, le même souci d'éradiquer les révolutionnaires, les socialistes, et de se garder de ces « républicains avancés » à la Gambetta qui veulent obtenir l'amnistie pour les communards condamnés ou en exil.
Lorsque Jules Ferry déclare : « Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu et sans roi » (« Mais non sans patron... », commentera Jaurès), il marque ce qui l'oppose aux cléricaux. Mais lorsqu'il dit, évoquant la répression versaillaise de la Commune : « Je les ai vues, les représailles du soldat vengeur, du paysan châtiant en bon ordre. Libéral, juriste, républicain, j'ai vu ces choses et je me suis incliné comme si j'apercevais l'épée de l'Archange », il est en « communion » avec le parti de l'Ordre.
Rien, sur ce point-là comme sur les orientations économiques et sociales, ne l'en sépare.
Et il en va de même de Jules Grévy, de Jules Favre ou de Jules Simon, qui déclare : « Je suis profondément républicain et profondément conservateur. »
Il faut donc, pour souligner l'opposition qui sépare républicains et monarchistes, choisir ce terrain du rapport entre l'État et l'Église.
Ce qui unira les républicains, de Jules Simon à Gambetta, et même aux communards, c'est l'anticléricalisme.
Cette posture – cette idéologie – a l'avantage de laisser dans l'ombre des divergences qui opposent les républicains « avancés », devenant peu à peu socialistes, et les républicains conservateurs.
L'alliance entre tous les républicains sur la base de l'anticléricalisme est d'autant plus aisée que la répression versaillaise a décapité pour une longue durée le mouvement ouvrier et le mouvement social.
Les « notables », monarchistes ou républicains, peuvent se défier sans craindre qu'un troisième joueur ne vienne troubler leur partie en parlant salaires, durée du travail, organisation sociale, égalité...
C'est ainsi que, assurés du maintien de l'ordre, les modérés peuvent glisser peu à peu vers une République dont ils savent qu'hormis le thème de l'anticléricalisme elle sera conservatrice dans ses institutions et dans sa politique économique et sociale.
Surtout, ces adeptes d'un régime « constitutionnel » qui veulent à tout prix le maintien de l'ordre peuvent désormais – c'est une grande novation dans l'histoire de la nation – régler leurs différends politiques sur le terrain parlementaire.
Alors que, depuis un siècle, c'est l'émeute, la révolution, le coup d'État, la journée révolutionnaire, les « semaines sanglantes », la violence, la terreur, la répression, qui départagent les adversaires politiques, c'est maintenant dans l'enceinte des Chambres (celle des députés et le Sénat) et par le recours au suffrage universel que s'évalue le rapport des forces.
Il a donc fallu près d'un siècle (1789-1880) pour que le parlementarisme l'emporte enfin en France.
Et c'est une dernière crise – frôlant les limites de la légalité institutionnelle – qui permet la victoire parlementaire de la République.
Mac-Mahon a, en effet, imposé à une Chambre « républicaine » le duc de Broglie comme président du Conseil.
Ce 16 mai 1877 marque un tournant politique. De Broglie va être contraint de démissionner en novembre. Les 363 députés qui se sont opposés à lui seront réélus après que la Chambre aura été dissoute par Mac-Mahon.
« Il faudra se soumettre ou se démettre », a lancé Gambetta, stigmatisant « ce gouvernement des prêtres, ce ministère des curés ».
Le 30 janvier 1879, quand le Sénat connaîtra à son tour une majorité républicaine, Mac-Mahon démissionnera et sera remplacé par Jules Grévy, républicain modéré.
Le pays, « saigné » par un siècle d'affrontements sanglants, a résolu cette crise dans un cadre où les violences ne sont plus que verbales.
En quelques mois, la IIIe République s'installe.
Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, crée un enseignement laïque, veille à la formation des instituteurs dans ces « séminaires républicains » que sont les écoles normales départementales. Il s'attaque aux congrégations, notamment aux Jésuites.
La République, c'est l'anticléricalisme.
Elle prend des décisions symboliques : les deux Chambres quittent Versailles pour siéger à Paris. Le 14 juillet devient fête nationale à compter de 1880, et La Marseillaise sera l'hymne de la nation.
Le 11 juillet 1880, Gambetta incite les députés à voter une loi d'amnistie pour les communards condamnés ou exilés.
« Il faut que vous fermiez le livre de ces dix années, dit-il. Il n'y a qu'une France, et qu'une République ! »
Mais le retour des communards signe aussi le retour de la contestation sociale. Donc celui de visions différentes de la France et de la République.
Sur la scène politique où monarchistes et bonapartistes viennent de quitter les premiers rôles, d'autres acteurs vont faire leur entrée.
54.
En un quart de siècle – 1880-1906 –, un modèle républicain français se constitue.
Des lois fondamentales sont votées, des forces politiques prennent forme, partis et syndicats structurent la vie sociale.
Profondes, les crises sont gérées pacifiquement, même si elles dressent encore les Français les uns contre les autres. La violence est certes présente, mais contenue.
Ainsi se fixent des traits majeurs de l'âme de la France qui se conserveront jusqu'aux années 40 du xxe siècle, au moment où l'« étrange défaite » de 1940, cette autre débâcle, entraînera la chute de la IIIe République et renverra aux pires souvenirs de 1870.
Mais, jusque-là, le bâti qui a été construit entre 1880 et 1906 tient.
D'ailleurs, les hommes politiques qui ont surgi dans les années 1890 occupent encore, pour les plus illustres d'entre eux – Poincaré (1860-1934), Barthou (1862-1934), Briand (1862-1932) –, des fonctions éminentes dans les années 30 du xxe siècle. Philippe Pétain (1856-1951) est un officier déjà quadragénaire en 1900. À cette date, Léon Blum (1872-1950) est un intellectuel d'une trentaine d'années engagé dans les combats de l'affaire Dreyfus. Le journal L'Humanité de Jaurès (1859-1914) est créé en 1904.
Pétain couvrira de son nom et de sa gloire de maréchal la capitulation de 1940, et on le qualifiera de nouveau Bazaine.
En 1936, Léon Blum sera le président du Conseil du Front populaire, et L'Humanité, le quotidien emblématique des communistes.
C'est dire que la IIIe République a su traverser le traumatisme de la Première Guerre mondiale (1914-1918), et, dans l'apparente continuité des institutions et des hommes, « digérer » les bouleversements des premières décennies du xxe siècle.
La Russie, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne sont submergées par le communisme, le fascisme, le nazisme, le franquisme. La France républicaine, elle, résiste aux révolutions et aux contre-révolutions.
Comme si elle était sortie définitivement, pour les avoir vécus jusqu'aux années 1870, de ces temps de guerre civile, et qu'elle avait construit au tournant du siècle, entre 1880 et 1906, un modèle adapté enfin à la nation.
On le constate en examinant les lois proposées par les républicains modérés. Elles sont à leur image – prudentes –, mais elles définissent les libertés républicaines, qui concernent aussi bien le droit de réunion, d'association, de création de syndicats, de publication, que l'élection des maires, mais aussi le droit au divorce.
Ces lois votées entre 1881 et 1884 expriment à la fois la résolution et l'opportunisme de leurs initiateurs. Elles créent un « État de droit ».
Elles sont l'affirmation d'une démocratie parlementaire qui suit une voie moyenne, « modérée ».
De ce fait, Gambetta est écarté après un court et grand ministère d'une dizaine de semaines (novembre 1881-janvier 1882). L'homme est considéré comme trop « avancé », à l'écoute des couches populaires. Son échec comme président du Conseil, alors qu'il est le « leader » le plus prestigieux des républicains, qu'il a animé les campagnes contre le second Empire, puis Mac-Mahon, est révélateur d'un trait du fonctionnement politique de cette IIIe République.
Puisque le président de la République, quelle que soit son influence, se tient en retrait dans une fonction de représentation et d'arbitrage, l'exécutif est dans la dépendance des majorités parlementaires. Celles-ci varient au gré des circonstances et des ambitions individuelles qui, déplaçant quelques dizaines de voix, font ainsi « tomber » les gouvernements.
Cette faiblesse de l'exécutif, cette instabilité ministérielle, seront, dès les origines, une tare du régime républicain, qui le caractérisera jusqu'à sa fin, en 1940. Si un gouvernement veut « durer », il doit « composer ».
Un Jules Ferry le dira clairement : « Le gouvernement est résolu à observer une méthode politique et parlementaire qui consiste à ne pas aborder toutes les questions à la fois, à limiter le champ des réformes..., à écarter les questions irritantes. »
Cependant, Ferry est l'un des initiateurs majeurs de ce « modèle républicain ».
Ses lois scolaires (1882-1886) introduisent la laïcité aux côtés de l'obligation et de la gratuité de l'instruction publique.
Elles créent un enseignement féminin.
Jules Ferry est ainsi celui qui, avec lucidité et conviction, veut arracher les citoyens à l'emprise cléricale identifiée à la cause monarchiste.
Cette « laïcité » déborde le domaine scolaire en devenant, à partir de 1901, le grand thème républicain.
Des lois sur les associations visent les congrégations enseignantes, puis imposent l'inventaire des biens de l'Église.
On débouche ainsi sur la loi capitale de séparation des Églises et de l'État en 1905. Ses deux premiers articles précisent que la République garantit la liberté de conscience et qu'elle « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
Cette « séparation » crée une « exception française ». Elle définit la République.
Elle a été voulue par des forces politiques nouvelles – radicaux, socialistes (son rapporteur est Aristide Briand) –, des courants de pensée – franc-maçonnerie du Grand Orient de France, farouchement anticlérical et vigoureusement athée depuis 1877 ; protestantisme.
Hostile à tout « ralliement » des catholiques à la République, l'attitude de la papauté a conféré à cette législation laïque le caractère d'une politique de « défense républicaine ».
La laïcité, disent Jean Jaurès et Émile Combes (1835-1921, ancien séminariste), est une manière de « républicaniser la République ». « Le parti républicain a le sentiment du danger. Il a perçu […] que la congrégation s'était accordée avec le militarisme. Il exige qu'il soit agi contre elle. »
Car la République, en ces années 1880-1906, se sent en effet menacée.
Dans ses profondeurs, le pays reste rural et modéré. Le nouveau régime ne s'y enracine que lentement.
L'élection des maires, le rôle des instituteurs (les « hussards noirs de la République »), l'action des notables laïques « libres penseurs », opposés au curé, à l'aristocrate, au grand propriétaire, au milieu clérical, favorisent le développement de l'esprit républicain.
L'école laïque gratuite et obligatoire enseigne un « catéchisme républicain » qui redessine les contours de l'histoire officielle.
Il est relayé par les symboles et rituels républicains : La Marseillaise, le 14 Juillet, Marianne...
Mais le fonctionnement politique du régime – l'instabilité ministérielle, la corruption, les scandales (celui du canal de Panama, dans lequel des députés sont compromis : la « plus grande flibusterie du siècle ») – crée des foyers de troubles.
Nostalgie du militaire providentiel : le général Boulanger, « brave général », « général revanche », un temps ministre de la Guerre (1887), soutenu par la Ligue des patriotes de Paul Déroulède, est tenté de prendre le pouvoir. Ce n'est qu'un rêve vite brisé.
Un courant anarchiste se dresse contre la « société bourgeoise », contre l'État, veut mener une « guerre sans pitié » contre cette société injuste. Une vague d'attentats – la « propagande par le fait », à savoir des actes de délinquance comme la « reprise individuelle » – culmine avec l'assassinat, en 1894, du président de la République Sadi Carnot par l'anarchiste Caserio.
La guillotine fonctionne.
La police, qui manipule parfois ces anarchistes de manière à déconsidérer toute protestation sociale, contrôle en fait cette poussée qui ne met pas le régime en péril.
Derrière l'autosatisfaction des « notables » républicains et les « frous-frous » de la « Belle Époque », ces troubles n'en révèlent pas moins l'existence d'une question sociale, de plus en plus présente.
Des syndicats se créent par branches professionnelles. La CGT, née en 1895, les regroupe.
En 1906, au congrès d'Amiens, elle adopte une charte « anarcho-syndicaliste ». La charte d'Amiens préconise la grève générale, affirme la volonté d'en finir un jour avec le patronat et le salariat. Dans le même temps, cette confédération veut rester « indépendante des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale ».
Cette radicalité syndicale et ce souci d'autonomie sont d'abord le reflet de la violence de la répression qui frappe les ouvriers grévistes à Anzin (1884), à Fourmies (1899-1901), à Courrières (1906) après un accident minier qui a fait 1 100 morts. Clemenceau (1841-1929), ministre de l'Intérieur, « premier flic de France », fait donner la troupe qui ouvre le feu, et qui, le 1er mai 1906, met en état de siège la capitale, où toute manifestation est interdite.
Face aux socialistes et aux revendications ouvrières, un bloc républicain s'est constitué ; il regroupe les radicaux-socialistes (Clemenceau), les modérés (Poincaré, Barthou). Il s'oppose aux socialistes (leur premier congrès a lieu en 1879). Ceux-ci s'unifieront dans la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) en 1905.
Il y a là, en fait, deux conceptions de la République qui s'opposent. Cet affrontement est symbolisé par le débat qui met face à face, à la Chambre des députés, en avril 1906, le radical Clemenceau et le socialiste Jaurès.
Jaurès dénonce l'inégalité, dépose une proposition de loi sur la transformation de la propriété individuelle en propriété collective.
Clemenceau voit dans le socialisme une rêverie prophétique et choisit « contre vous, Jaurès, la justice et le libre développement de l'individu. Voilà le programme que j'oppose à votre collectivisme ! »
En fait, pour importants qu'ils soient et pour majeurs que soient les enjeux qu'ils sous-tendent, ces débats ne mobilisent pas les grandes masses du pays. Elles s'expriment néanmoins dans le cadre du suffrage universel.
Le nombre des électeurs qui votent pour le Parti socialiste augmente ainsi lentement.
Mais ce parti, comme les syndicats ou comme le Parti radical, ne compte que peu d'adhérents. Le citoyen est individualiste et sceptique. Il accepte le système politique en place. Ceux qui le contestent autrement que dans les urnes ne sont qu'une minorité.
La République « intègre » : en 1899, Millerand devient le premier socialiste à accéder à un ministère, et Jaurès soutient ce gouvernement Waldeck-Rousseau « de défense républicaine », bien que le ministre de la Guerre y soit le général de Galliffet, l'un des « fusilleurs » des communards.
Maurice Barrès (1862-1923), écrivain et député nationaliste, avait écrit à propos du ministère Jules Ferry : « Il donne à ses amis, à son parti, une série d'expédients pour qu'ils demeurent en apparence fidèles à leurs engagements et paraissent s'en acquitter, cependant qu'ils se rangent du côté des forces organisées et deviennent des conservateurs. »
Tel sera le chemin suivi par Alexandre Millerand ou Aristide Briand, tous deux socialistes, puis ministres « républicains » et cessant, du coup, d'agir en socialistes.
Produit d'une longue histoire « révolutionnaire », la IIIe République a construit entre 1880 et 1906 un système représentatif imparfait, contesté, mais capable de résister, dès lors qu'il sent sa politique républicaine modérée menacée soit par l'Église (et ce sont les lois laïques), soit par l'anarchisme et le socialisme (et c'est la répression), soit par le « militarisme », et ce seront les combats contre le général Boulanger ou pour la défense de l'innocent capitaine Alfred Dreyfus.
Par l'ampleur qu'elle prend de 1894 à 1906 – de la condamnation du capitaine pour espionnage à sa réhabilitation complète et à sa réintégration dans l'armée –, l'affaire Dreyfus est significative des divisions de l'âme de la France en cette fin de siècle.
Car la culpabilité de Dreyfus est dans un premier temps acceptée : seuls quelques proches la contestent.
Cela reflète d'abord la confiance que l'on porte à l'autorité militaire, liée à la volonté de revanche. Personne ne doute que l'Allemagne ne soit l'ennemi, capable de toutes les vilenies.
Ensuite, la vigueur de l'antisémitisme donne un crédit supplémentaire à la culpabilité de Dreyfus, Alsacien d'origine juive.
Cet antisémitisme ne touche pas seulement les milieux conservateurs qui condamnent le « peuple déicide » dans la tradition de l'antisémitisme chrétien. Il existe aussi un antisémitisme « populaire », républicain, socialiste, anticapitaliste. On répète les thèses de Toussenel exposées dans son livre Les Juifs, rois de l'époque, histoire de la féodalité financière. Juif, usurier et trafiquant sont « pour lui synonymes ».
Le livre d'Édouard Drumont (1844-1917), La France juive, rencontre un large écho, tout comme son journal, La Libre Parole, lancé en 1892. La presse catholique – La Croix, Le Pèlerin – reprend quotidiennement ces thèmes.
On mesure la difficulté qu'il y a à obtenir une révision du procès d'Alfred Dreyfus.
On se heurte à l'antisémitisme.
On est accusé d'affaiblir l'armée, donc, d'une certaine manière, de prendre parti pour l'Allemagne.
Dans ces conditions, le rôle d'un Clemenceau, d'un Péguy (1873-1914), d'un Jaurès, des intellectuels – le terme apparaît à l'époque –, de la Ligue des droits de l'homme qu'ils constituent, est déterminant.
C'est dans L'Aurore de Clemenceau que, le 14 janvier 1898, Zola, au faîte de sa gloire, publie son « J'accuse » : « Je n'ai qu'une seule passion, celle de la lumière... La vérité est en marche, rien ne l'arrêtera ! »
Le pays se divise en dreyfusards et antidreyfusards.
Les corps constitués, les monarchistes, les catholiques, les ligues – des patriotes, de la patrie française –, la France antirépublicaine, sont hostiles à la révision.
Les républicains avancés, les « professeurs », les socialistes – après avoir longtemps hésité : Dreyfus n'est-il pas un « bourgeois » ? – en sont partisans.
Cette bataille qui prend l'opinion à témoin, qui pousse les « intellectuels », les écrivains, à s'engager – Barrès contre Zola –, ces valeurs de vérité et de justice désormais considérées comme plus importantes que la « raison d'État », font de l'affaire Dreyfus un événement exemplaire témoignant qu'il y a bien une « exception française ».
La justice ne doit pas s'incliner devant l'armée.
Les valeurs de vérité et le respect des droits de l'homme sont supérieurs aux intérêts de l'État dès lors que celui-ci viole les principes.
Il est capital pour l'âme de la France qu'à la fin d'un combat de plus de dix ans les dreyfusards l'emportent.
Les « valeurs » s'inscrivent ainsi victorieusement au cœur du patriotisme républicain qui s'oppose à un nationalisme arc-bouté sur une vision sincère mais étroite des intérêts de l'État.
En ce sens, l'affaire Dreyfus prolonge la tradition qui avait vu Voltaire prendre parti pour Calas et le chevalier de La Barre contre les autorités cléricales et royales.
L'esprit républicain qui l'a emporté au terme de l'affaire Dreyfus va s'affirmer tout au long du xxe siècle avec le rôle combiné des intellectuels et de la Ligue des droits de l'homme (40 000 adhérents en 1906).
Mais ce sont davantage des personnalités extérieures à la société politique qui se sont engagées. Pour un Jaurès, que de silences prudents !
Quant au pays provincial et rural, aux notables locaux, ils ont été bien moins concernés par l'« Affaire » que les milieux parisiens. Les élections de 1898 changent peu la composition de l'Assemblée : Jaurès, dreyfusard, soutien de Zola, est battu.
Le souci de ne point affaiblir l'armée, dans la perspective d'une future confrontation avec l'Allemagne, en proclamant qu'elle a failli, intervient sans doute dans la réticence d'une large partie de l'opinion.
Ce qui tendrait à montrer qu'au fond les Français, qu'ils soient dreyfusards ou antidreyfusards, républicains ou ennemis de la « Gueuse », sont d'abord des patriotes, les uns privilégiant les valeurs des droits de l'homme identifiées à la République, les autres, la tradition étatique, certes, mais patriotique elle aussi.
À l'heure où, par l'alliance franco-russe (1893) et par le maintien, malgré des différends coloniaux, de bons rapports avec le Royaume-Uni, les gouvernements successifs préparent la « revanche », il est vital que la IIIe République soit capable de susciter, malgré les fractures de l'opinion, une « union patriotique ».
5
L'UNION SACRÉE
1907-1920
55.
De 1907 à 1914, la France marche vers l'abîme de la guerre en titubant.
D'un côté, elle semble décidée à l'affrontement avec l'Allemagne de Guillaume II afin de prendre sa revanche et de récupérer l'Alsace et la Lorraine tout en effaçant le souvenir humiliant de Sedan et de la débâcle de 1870.
Dans les milieux littéraires parisiens, après la réhabilitation de Dreyfus en juillet 1906, et comme pour affirmer que l'on continue à avoir confiance dans l'armée, on constate un renouveau du nationalisme et du militarisme.
Barrès, Maurras (1868-1952), mais aussi Péguy, l'ancien dreyfusard, chantent les vertus de la guerre : « C'est dans la guerre que tout se refait ; la guerre n'est pas une bête cruelle et haïssable, c'est du sport vrai, tout simplement », va-t-on répétant.
On vante la « race française », catholique, on se dit prêt au sacrifice, on institue la célébration nationale de Jeanne d'Arc.
On manifeste. On conspue les pacifistes, les socialistes, ce « Herr Jaurès qui ne vaut pas les douze balles du peloton d'exécution, une corde à fourrage suffira »...
En janvier 1913, une coalition rassemblant des élus traditionalistes (monarchistes), des républicains modérés, des radicaux-socialistes, élit Raymond Poincaré, le Lorrain, incarnation de l'esprit de revanche, président de la République.
Les diplomates et les militaires, qui échappent de fait au contrôle parlementaire, trouvent ainsi au sommet de l'État un appui déterminé. Ils font de la France la clé de voûte de la Triple-Entente entre Royaume-Uni, France et Russie.
Elle n'a pas été ébranlée par la défaite de la Russie face au Japon, en 1905, ni par la révolution qui a suivi. Elle souscrit des emprunts russes à hauteur de plusieurs milliards de francs-or. Elle appuie le tsar, qui tente de moderniser son pays sur les plans économique et politique.
Elle ne tient aucun compte de l'agitation « bolchevique » qui se déclare hostile à la guerre contre l'Allemagne et qui, à cette « guerre entre impérialismes », oppose le « défaitisme révolutionnaire ».
Dans cette préparation à la guerre, le haut état-major français obtient le vote d'une loi portant le service militaire à trois ans (avril 1913) pour faire face à une armée allemande plus nombreuse, la France ne comptant que quarante millions d'habitants et l'Allemagne, soixante.
Mais ces signes, ces décisions, les initiatives françaises prises au Maroc pour y instaurer un protectorat auquel l'Allemagne est hostile, et qui manifestent une volonté d'affrontement, le choix délibéré du risque de guerre, sont contredits par d'autres attitudes.
C'est comme si, à tous les niveaux de la vie nationale, le pays était divisé.
D'abord, les conflits sociaux se durcissent : la troupe intervient à Draveil en 1908 et tire sur les cheminots grévistes.
En 1909, les électriciens plongent Paris dans l'obscurité.
Ministre de l'Intérieur, puis président du Conseil, Clemenceau réagit durement face à ce syndicalisme révolutionnaire qui paralyse les chemins de fer cependant que les inscrits maritimes bloquent les ports.
Opposés à la troupe dans ces conflits sociaux, les ouvriers développent un antimilitarisme radical, cependant qu'en 1907 les viticulteurs ruinés par le phylloxéra réussissent à gagner à leur cause des soldats du 17e régiment d'infanterie, qui se mutinent : « Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. »
Ces incidents semblent miner la cohésion nationale indispensable à une entrée en guerre.
Les socialistes sont gagnés par ce climat. Ils prônent dans leurs congrès la « grève générale » pour s'opposer à la guerre.
« Prolétaires de tous les pays, unissez vous ! » scande-t-on.
Cette poussée verbalement révolutionnaire fait contrepoids, en même temps qu'elle le renforce, au courant nationaliste et belliciste.
De là ces appels au meurtre lancés contre Jaurès, le pacifiste, membre de l'Internationale socialiste, qui déclare à Bâle en juin 1912 : « Pour empêcher la guerre, il faudra toute l'action concordante du prolétariat mondial. »
Il rêve de préparer une grève générale « préventive » pour dissuader les gouvernements de se lancer dans un nouveau conflit.
Jaurès sous-estime ainsi la logique mécanique des blocs – à la Triple-Entente s'oppose la Triple-Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie). Il ne mesure pas l'engrenage des mesures militaires, les décisions d'un état-major entraînant la réplique d'un autre, et, une fois les mobilisations commencées, comment freiner un mouvement lancé, doté d'une puissante force d'inertie ?
En outre, Jaurès ne perçoit pas que des groupes marginaux – ainsi les nationalistes serbes –, des États « archaïques » – dans les Balkans, mais la Russie est aussi l'un d'eux –, peuvent, par leurs initiatives échappant à tout contrôle, déclencher des incidents qui entraîneront dans un conflit régional les grands blocs alliés, lesquels, par leur intervention, généraliseront le conflit.
En fait, en ces années cruciales durant lesquelles se jouent le sort de la paix et le destin de la France, le système politique de la IIIe République révèle ses limites. Car il ne s'agit plus seulement de constituer un gouvernement, de voter des lois, de trouver une issue à telle ou telle affaire intérieure – affaire Dreyfus ou scandale de Panama –, mais bien de prendre des décisions qui engagent la France sur le plan international.
Ici, le rôle du président de la République, celui du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Guerre, échappent en partie au contrôle parlementaire.
De plus, la grande presse – Le Matin, Le Petit Parisien – pèse sur l'opinion et influe donc sur le choix des députés, qui ne respectent pas les accords passés entre leurs partis.
On perçoit aussi un fossé entre les manœuvres et rivalités politiciennes des leaders parlementaires – Clemenceau est le rival de Poincaré, celui-ci, l'adversaire de Joseph Caillaux (1863-1944) et de Jaurès – et la gravité des problèmes qui se posent aux gouvernements alors que s'avivent les tensions internationales.
C'est le cas entre le Royaume-Uni et l'Allemagne à propos de la question de leurs flottes de guerre respectives ; entre la France et l'Allemagne sur la question du Maroc ; entre l'Autriche-Hongrie, liée à l'Allemagne dans le cadre de la Triple-Alliance, et la Serbie, soutenue par la Russie, orthodoxe comme elle, une Russie qui est l'alliée de la France dans le cadre de la Triple-Entente.
Une République dont l'exécutif est ainsi soumis aux combinaisons parlementaires peut-elle conduire une grande politique extérieure alors que le chef de son gouvernement est menacé à tout instant de perdre sa majorité ?
Cette interrogation se pose dès les années 1907-1914, qui comportent deux séquences électorales : en 1910 et en 1914.
Au vrai, le problème est structurel : il demeurera, puisqu'il est le produit du système constitutionnel qui a été choisi.
Ce système a une autre conséquence : il facilite l'émergence des médiocres et écarte les personnalités brillantes et vigoureuses.
On l'a vu dès l'origine de la République – en 1882 – avec Gambetta.
Cela se reproduit, à partir de 1910, avec Joseph Caillaux, le leader radical qui, en 1911, a résolu par la négociation une crise avec l'Allemagne à propos du Maroc. Il a accepté des concessions pour éviter ou faire reculer la guerre, ce qui le désigne comme un complice du Kaiser. Caillaux est aussi partisan de la création d'un impôt sur le revenu, refusé par tous les modérés. Il est donc l'homme à ostraciser.
D'autant plus qu'il associe le Parti radical au Parti socialiste de Jaurès en vue des élections de mai 1914. Au cœur de leur programme commun : l'abolition de la loi portant le service militaire à trois ans.
Or c'est cette coalition présentée comme hostile à la défense nationale qui l'emporte, faisant élire 300 députés radicaux et socialistes contre 260 élus du centre et de la droite conservatrice.
Est-ce le socle d'une autre politique étrangère ?
En fait, la France continue de tituber. Les députés radicaux élus ne voteront pas l'abolition de la loi des trois ans, soumis qu'ils sont à la pression de l'« opinion » telle que la reflètent les grands journaux parisiens, eux-mêmes sensibles à la fois aux fonds russes qui les abreuvent et au renouveau nationaliste d'une partie des élites intellectuelles.
Et le président de la République, que le vote de mai 1914 vient de désavouer, n'en continue pas moins de prôner la même politique étrangère. Il agit dans l'ombre pour dissocier les députés radicaux de Caillaux et de Jaurès.
De toute façon, il est bien tard pour changer d'orientation.
Le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand est assassiné à Sarajevo par des nationalistes serbes. La mécanique des alliances commence à jouer.
Les ultimatums et les mobilisations se succèdent.
Le 31 juillet 1914, Jaurès est assassiné.
Le 1er août, la France mobilise.
Le 3, l'Allemagne lui déclare la guerre.
La décision a échappé aux parlementaires, à la masse du pays engagée dans les moissons, avertie seulement par le tocsin et les affiches de mobilisation.
Elle répond sans hésiter à l'appel de rejoindre ses régiments.
Mais des différences apparaissent entre l'enthousiasme guerrier qui soulève, à Paris et dans quelques grandes villes, les partisans de la guerre en des manifestations bruyantes – « À Berlin ! » y crie-t-on – et l'acceptation angoissée des nécessités de la mobilisation par la majorité des Français. Les slogans proférés dans la capitale ne reflètent pas l'état d'âme du reste de la France.
On est partout patriote. On part donc faire la guerre. Mais on n'est pas belliciste.
C'est plutôt la tristesse et l'angoisse qui empoignent la masse des Français.
Ceux qui, pacifistes intransigeants, partisans de la grève générale, s'opposent à la guerre sont une minorité isolée. Le gouvernement n'a pas à sévir contre les révolutionnaires, les syndicalistes, ceux qui hier se déclaraient contre la guerre. Les socialistes s'y rallient.
« Ils ont assassiné Jaurès, nous n'assassinerons pas la France », titre même un journal antimilitariste.
Jules Guesde (1845-1922), le « marxiste » du Parti socialiste, qui accusait Jaurès de modérantisme, devient ministre.
C'est donc l'« union sacrée » de tous les Français.
La République rassemble la nation, condition nécessaire de la victoire.
56.
La Grande Guerre qui commence en 1914 est l'ordalie de la France, et donc de la IIIe République qui la gouverne.
L'épreuve, qu'on prédisait courte, de quelques semaines, va durer cinquante-deux mois.
Le 11 novembre 1918, quand, le jour de l'armistice, on dressera un monument aux victimes, on dénombrera 1 400 000 tués ou disparus (10 % de la population active), 3 millions de blessés, dont 750 000 invalides et 125 000 mutilés.
Sur dix hommes âgés de 25 à 45 ans, on compte deux tués ou disparus, un invalide, trois handicapés.
Si l'on recense les victimes par profession, on relève que la moitié des instituteurs mobilisés – les « hussards noirs de la République », officiers de réserve, ont encadré leurs anciens élèves – ont été tués.
Polytechniciens, normaliens, écrivains – d'Alain-Fournier à Péguy – et surtout paysans et membres des professions libérales ont payé leur tribut à la défense de la patrie.
Durant toute la guerre, une large partie du territoire – le Nord et l'Est –, la plus peuplée, la plus industrielle, a été occupée.
En septembre 1914, la pointe de l'offensive allemande est parvenue à quelques dizaines de kilomètres de Paris, et en août 1918 la dernière attaque ennemie s'est rapprochée à la même distance de la capitale.
Des offensives de quelques jours, lançant les « poilus » en Champagne, au Chemin des Dames (en 1915, en 1917), ont coûté plusieurs centaines de milliers d'hommes.
29 000 meurent chaque mois en 1915 ; 21 000 encore en 1918.
La France a été « saignée », et c'est son meilleur sang – le plus vif, parce que le plus jeune – qui a coulé durant ces cinquante-deux mois.
Qui ne mesure la profondeur de la plaie dans l'âme de la France !
Le corps et l'âme de la nation sont mutilés pour tout le siècle.
Chaque Français a un combattant, ou un tué, ou un gazé, ou un invalide dans sa parentèle.
Chacun, dans les générations suivantes, a croisé, côtoyé un mutilé, une « gueule cassée ».
Chacun, jusqu'aux années 40, a vu défiler des cortèges d'anciens combattants.
Puis d'autres, par suite d'autres guerres, les ont remplacés, et à la fin du xxe siècle il n'y avait plus qu'une dizaine de survivants du grand massacre, de celle qui restait la « grande » guerre et dont on avait espéré qu'elle serait la « der des der ».
Sonder la profondeur de la plaie – toutes ces femmes en noir qui n'ont pas enfanté, qui se sont fanées sous leurs voiles de deuil –, prendre en compte les traumatismes des « pupilles de la nation » et ceux de ces survivants qui pensaient à leurs camarades morts près d'eux, c'est réaliser que la Première Guerre mondiale a été pour plusieurs décennies – au moins jusqu'à la fin des années 40 du xxe siècle – le grand déterminant de l'âme de la France.
À prendre ainsi conscience de l'étendue de la blessure, de la durée de cette épreuve de cinquante-deux mois, on devine que c'est au plus profond de l'« être français » que le peuple des mobilisés et celui de l'arrière ont dû aller puiser pour « tenir ». Et d'autant plus qu'année après année la conduite des opérations militaires n'a pas permis de repousser l'ennemi hors du territoire national.
Dès l'été 1914, sous le commandement de Joffre, le front français est percé. Des unités – en pantalons rouges ! – sont décimées et se débandent.
On fusille sans jugement ceux qu'on accuse d'être des fuyards.
Mais ce ne sera pas l'effondrement. Le pouvoir politique tient. Il quitte Paris pour Bordeaux – sinistre souvenir de 1871 ! –, mais demande aux militaires de défendre Paris.
Et c'est la bataille de la Marne, le front qui se stabilise, les soldats qui s'enterrent dans les tranchées.
La République ne s'est pas effondrée. Il n'y aura pas de débâcle comme en 1870. Nul ne manifeste contre le régime et les soldats résistent.
Ces « poilus » sont des paysans. La terre leur appartient. Un patriotisme viscéral, instinctif, les colle à ces mottes de glaise.
Mais, poussés par les politiques, les chefs croient à l'offensive.
Offensive en Champagne en 1915. Échec : 350 000 morts.
En 1916, on s'accroche à Verdun.
En 1917 – la révolution russe de février a changé la donne –, le général Nivelle, qui vient de remplacer Joffre, lance l'offensive du Chemin des Dames.
Échec. Hécatombe. Mutineries.
Pétain, économe des hommes, partisans de la défensive, le remplace. Il veut attendre « les Américains et les tanks ».
Quand les Allemands lancent leurs dernières offensives, en 1918, Foch, généralissime de toutes les armées alliées, dispose d'une supériorité écrasante. Craignant que sa propre armée ne s'effondre – comme s'est dissoute l'armée russe après la révolution d'octobre 1917 –, l'état-major allemand fait pression sur Berlin pour qu'on sollicite un armistice. Ainsi, le sol allemand n'aura pas été envahi.
C'est donc, le 11 novembre 1918, la victoire de la France.
La nation a été le théâtre majeur de la guerre.
Elle a sacrifié le plus grand nombre de ses fils – seuls les Serbes, proportionnellement à leur population, ont subi davantage de pertes.
Le peuple français sous les armes et l'arrière ont tenu parce que l'« intégration » à la nation issue d'une histoire séculaire a été réalisée.
Ce patriotisme aux profondes racines a été revivifié par les lois républicaines, par le suffrage universel, par le « catéchisme national » enseigné par les « hussards noirs de la République ».
Chaque soldat est un citoyen.
Cet attachement à la terre de la patrie – le poilu est souvent un paysan propriétaire de sa ferme – explique sa résistance. Il se bat. Il s'accroche au sol non parce qu'il craint le peloton d'exécution pour désertion ou refus d'obéissance, mais parce qu'il défend sa propre parcelle du sol de la nation.
Et s'il se mutine en 1917, s'il fait la « grève des combats », c'est parce qu'on ne respecte pas en lui le citoyen, que l'on est « injuste » dans la répartition des permissions ou dans la montée en première ligne, qu'on « gaspille » les vies pour « grignoter » quelques mètres, tenter des percées qui ne peuvent aboutir.
Certes, la lassitude, la contestation, la fascination pour la révolution russe, l'antimilitarisme – si présent en 1914 –, progressent en même temps que la guerre se prolonge et que les offensives inutiles se multiplient.
Le poilu se sent solidaire de ses camarades qui « craquent », qui se rebellent et qu'un conseil de guerre expéditif condamne à mort.
Mais le patriotisme l'emporte sur l'esprit de révolte.
Le sol de la patrie occupé appartient aux citoyens. Il leur faut le défendre, le libérer.
Ce sont des citoyens-soldats qui ont remporté la victoire. En première ligne, ils avaient le sentiment de vivre avec les officiers de troupe dans une « société » républicaine où chacun, à sa place, risquait sa vie.
Ils n'avaient pas le même rapport avec les officiers supérieurs, perçus comme des « aristocrates ». Et les généraux qu'ils ont appréciés sont ceux qui, comme Pétain, les respectaient, rendaient hommage à leur courage, ne les considéraient pas comme de la chair à canon.
À la tête du pays, l'union sacrée à laquelle participaient les socialistes confirmait ce sentiment d'une cohésion de tous les Français.
Sans doute les socialistes quittent-ils le gouvernement en novembre 1917, reflétant par là la lassitude qui affecte tout le pays. Mais la personnalité de Clemenceau, président du Conseil, prolonge l'union sacrée. Il a un passé de républicain dreyfusard, même si, dans les milieux ouvriers, on se souvient du « premier flic de France », adversaire déterminé du socialisme. Il incarne un patriotisme intransigeant.
Sa volonté de « faire la guerre » et de conduire le pays à la victoire, la chasse qu'il fait à tous ceux qui expriment le désir d'en finir au plus vite par une paix de compromis donnent le sentiment que le pays est conduit fermement, que la République a enfin un chef à la hauteur des circonstances.
Certes, en poursuivant Joseph Caillaux, qui a été partisan d'une autre politique, pour intelligence avec l'ennemi, il règle de vieux comptes, en habile politicien. Mais, avec Clemenceau, avec Foch et Pétain, la République, qui reçoit en outre le soutien de centaines de milliers de soldats américains, doit et peut vaincre.
Après le 11 novembre 1918, Clemenceau sera surnommé le « Père la Victoire ».
La République et la France auront surmonté l'épreuve.
On sait à quel prix.
57.
La France a vaincu et survécu.
Mais l'ivresse qui a accompagné l'annonce de l'armistice n'a duré que quelques jours.
L'émotion et la joie se sont prolongées en Alsace et en Lorraine quand Pétain, Foch, Clemenceau et Poincaré ont rendu visite, en décembre 1918, aux provinces et aux villes libérées.
L'humiliation de 1870 était effacée, la revanche, accomplie.
Mais cette fierté n'empêche pas la France de découvrir quelle a, comme trop de ses fils, la « gueule cassée ».
On s'est battu quatre ans sur son sol. Forêts hachées par les obus, sols dévastés, villages détruits, mines de fer ou de charbon inondées, usines saccagées : il va falloir réparer.
L'amertume, la rancœur, parfois la rage, se mêlent, dans l'âme de la France, à l'orgueil d'avoir été vainqueur et au soulagement d'avoir survécu.
Les anciens combattants, qui se rassemblent, veulent rester « unis comme au front ». Ils ont des « droits », parce qu'ils ont payé l'« impôt du sang ». Ils exigent que le gouvernement se montre intransigeant, qu'il obtienne le versement immédiat des « réparations ». « Le Boche doit payer ! »
Et le gouvernement répond : « L'Allemagne paiera. »
Mais, déjà, l'historien Jacques Bainville écrit : « Soixante millions d'Allemands ne se résigneront pas à payer pendant trente ou cinquante ans un tribut régulier de plusieurs milliards à quarante millions de Français. Soixante millions d'Allemands n'accepteront pas comme définitif le recul de leur frontière de l'Est, la coupure des deux Prusse, soixante millions d'Allemands se riront du petit État tchécoslovaque... »
Ces lignes sont publiées dans L'Action française en mai 1919, au moment où les conditions du traité de paix sont transmises aux délégués allemands.
Les exigences sont dures, non négociables. Ce traité sera perçu comme un « diktat ».
Il prévoit la démilitarisation partielle de l'Allemagne. Le bassin houiller de la Sarre devient propriété de la France. Les Alliés occupent la rive gauche du Rhin ainsi que Mayence, Coblence et Cologne. Une zone démilitarisée de 50 kilomètres de large est instaurée sur la rive droite du Rhin.
L'Allemagne est jugée responsable de la guerre. Elle doit payer des réparations, livrer une partie de sa flotte, des machines, du matériel ferroviaire. Sur la frontière orientale, la Tchécoslovaquie est créée, la Pologne renaît, la Roumanie existe. Autant d'alliés potentiels pour la France.
Mais chaque clause du traité contient en germe une cause d'affrontement entre l'Allemagne et la France.
D'autant que celle-ci est seule : le président des États-Unis, Wilson, qui a réussi à imposer la création d'une Société des Nations, est désavoué à son retour aux États-Unis. Ceux-ci ne ratifieront pas les conclusions de la conférence de la paix (novembre 1919).
Le Royaume-Uni ne veut pas que l'Allemagne soit accablée, contrainte de payer. L'Italie a le sentiment que sa « victoire est mutilée ».
La France est seule. Orgueilleuse et amère, elle célèbre sa revanche.
Le traité de Versailles est signé dans la galerie des Glaces du château de Versailles, le 28 juin 1919, là même où a été proclamé l'Empire allemand, le 18 janvier 1871.
L'honneur et la gloire sont rendus à la patrie.
La fierté des anciens combattants est aussi méritée que sourcilleuse.
Mais on sent l'angoisse et une sorte de désespoir poindre et imprégner l'âme de la France.
Chaque village dresse son monument aux morts, et le deuil – le sacrifice des fils – se trouve ainsi inscrit au cœur de la vie municipale, dans les profondeurs de la nation.
C'est autour de ce monument aux morts qu'on se rassemble, que les anciens combattants se retrouvent « unis comme au front ».
Aux élections législatives du 16 novembre 1919, le Bloc national, constitué par les partis conservateurs et par les républicains modérés, remporte une victoire éclatante et constitue une « Chambre bleu horizon ». De nombreux anciens combattants y ont été élus.
C'est une défaite pour le Parti socialiste, dont le nombre d'adhérents a augmenté rapidement après l'armistice, qui regarde avec passion et enthousiasme les bolcheviks consolider leur pouvoir, qui s'insurge contre l'envoi de militaires français en Pologne, de navires de guerre en mer Noire, d'armes aux troupes blanches qui combattent les rouges.
Mais le verdict des urnes est sans appel : le suffrage universel renvoie l'image d'une France modérée, patriote, qui refuse l'idée de révolution. Même s'il existe des révolutionnaires dans les rangs de la CGT et au sein du Parti socialiste, qui souhaitent la sortie de l'Internationale socialiste et l'adhésion à la IIIe Internationale communiste.
Les oppositions sont vives entre la majorité Bloc national et la minorité séduite par le discours révolutionnaire.
Un signe ne trompe pas : en avril 1919, un jury d'assises a acquitté Raoul Villain, l'assassin de Jaurès.
Une manifestation de protestation rassemblant la « gauche » a eu lieu à Paris – la première depuis 1914. Elle montre la vigueur de cette composante de l'opinion, mais illustre aussi son caractère minoritaire.
En fait, après l'effort sacrificiel de la guerre, le pays se divise.
Chacun puise dans l'histoire nationale les raisons de son engagement.
Les socialistes tentés par le léninisme font un parallèle entre jacobinisme et bolchevisme. La révolution de 1789 – et surtout de 1793 –, la Commune de 1871, leur paraissent préfigurer la révolution prolétarienne et le communisme. La Russie est une Commune de Paris qui a réussi.
On affirme sa solidarité avec les soviets. Des marins de l'escadre française envoyée en mer Noire pour aider les blancs se mutinent.
On conteste la politique d'union sacrée qui a été suivie par les socialistes en 1914. On se convainc que c'était Lénine qui, en prônant le défaitisme révolutionnaire, avait raison.
Au mois de décembre 1920, à Tours, la majorité du Parti socialiste – contre l'avis de Léon Blum – accepte les conditions posées par Lénine pour l'adhésion à l'Internationale communiste.
À côté de la SFIO va désormais exister un Parti communiste, Section française de l'Internationale communiste (SFIC). L'Humanité de Jaurès devient son journal.
C'est donc sur la tradition française qu'est greffée la souche bolchevique.
En soi, cette volonté d'imitation d'une expérience étrangère, la soumission acceptée à Moscou, sont la preuve que, alors qu'elle est la première puissance du continent après la défaite de l'Allemagne, la France est devenue moins « créatrice » d'histoire, plutôt l'« écho » d'une histoire inventée ailleurs.
Le pays se replie sur sa victoire et sur ses deuils.
Quand le débat s'engage pour savoir quelles dispositions militaires prendre pour se protéger d'une future volonté de revanche et de la contestation allemande du traité de Versailles, le maréchal Pétain propose un système de forteresses qui empêchera toute invasion.
C'est la prise de conscience d'un affaiblissement, malgré la victoire du pays.
On peut lire dans La Nouvelle Revue française, en novembre 1919, sous la plume de l'écrivain Henri Ghéon :
« L'être de la France est en suspens. Si le triomphe de nos armes l'a sauvée de la destruction et du servage, il la laisse si anémiée, et de son plus précieux sang, et de son capital-travail, et de son capital-richesse, que sa position, son assiette, est matériellement moins bonne, moins sûre, moins solide, malgré la récupération de deux provinces et l'occupation provisoire du Rhin, qu'en juillet 1914. »
Et Ghéon d'ajouter :
« Il nous paraît que la France n'aura vaincu, qu'elle ne sera, ne vivra qu'en proportion de nos efforts nouveaux pour faire durer sa victoire. »
Mais, après la tension de la guerre, les sacrifices consentis, l'âme de la France a-t-elle encore les ressources pour faire face aux problèmes que la guerre – et la victoire – lui posent : déclin démographique, reconstruction, accord entre les forces sociales et politiques pour adapter le pays, affronter les périls, crise financière d'une nation endettée, appauvrie ?
Or c'est la division qui s'installe.
Les ouvriers, les cheminots et les fonctionnaires se lancent dans la grève, manifestent pour la journée de huit heures (deux morts le 1er mai 1919).
En utilisant la réquisition et la mobilisation du matériel et des cheminots, le gouvernement brise la grève dans les chemins de fer au printemps de 1920.
Échec syndical et politique : des milliers de cheminots (18 000, soit 5 % de l'effectif) sont révoqués.
La justice envisage même la dissolution de la CGT.
Fort de la majorité qu'il détient, le Bloc national, républicain conservateur, inquiet de la vague révolutionnaire qui, à partir de la Russie, semble déferler sur l'Europe, est décidé à briser le mouvement social, donc à creuser un peu plus le fossé entre la majorité de la population et une minorité plus revendicative et contestatrice que révolutionnaire.
L'union sacrée est bien morte.
Pourtant, au-delà des divisions politiques, la république parlementaire continue d'écarter ceux qui, par leur personnalité, leur popularité, tentent de résister aux jeux des combinaisons politiciennes.
En janvier 1920, les parlementaires ont écarté la candidature à la présidence de la République de Georges Clemenceau, homme politique à l'esprit indépendant. À sa place, ils élisent Paul Deschanel.
Quand la folie aura contraint ce dernier à démissionner, en septembre 1920, ils choisiront Alexandre Millerand, ancien socialiste, devenu homme d'ordre et chef du Bloc national.
Mais dès que le même Millerand s'efforcera de donner quelque pouvoir à sa fonction, il rencontrera des oppositions.
Ainsi, deux ans seulement après l'armistice, la France apparaît à la fois épuisée, saignée par la guerre et divisée, cherchant des modèles dans les révolutions et les contre-révolutions qui fleurissent en Europe.
D'aucuns regardent vers Moscou et adhèrent au bolchevisme.
D'autres se tournent vers Rome, où l'on entend résonner le mot « fascisme », inventé en mars 1919 par Benito Mussolini.
Quant au pays profond, il se souvient de ceux qui sont tombés, il fleurit les tombes et les monuments aux morts.
CHRONOLOGIE IV
Vingt dates clés (1799-1920)
1804 : 21 mars, promulgation du Code civil ; 2 décembre, couronnement de Napoléon empereur
1805 : 2 décembre, Austerlitz
1812 : Campagne et retraite de Russie
1815 : 1er mars, retour de l'île d'Elbe, et, le 18 juin, Waterloo
5 mai 1821 : Mort de Napoléon à Sainte-Hélène
1824 : Mort de Louis XVIII. Accession au trône de son frère Charles X
27, 28, 29 juillet 1830 : les Trois Glorieuses – Louis-Philipped'Orléans, roi des Français
1831 : Révolte des canuts lyonnais
25 février 1848 : Proclamation de la République
Juin 1848 : Répression contre les ouvriers des ateliers nationaux
10 décembre 1848 : Louis-Napoléon Bonaparte élu présidentde la République
2 décembre 1851 : Coup d'État. L'Empire sera proclamé le 1er décembre 1852
4 septembre 1870 : Déchéance de l'Empire. IIIe République
21-28 mai 1871 : Semaine sanglante. Fin de la Commune
1875 : Vote de l'amendement Wallon. Le mot « république » dans les textes constitutionnels
1er mai 1891 : Grèves et incidents à Fourmies
30 janvier 1898 : « J'accuse ! », de Zola, en défense d'Alfred Dreyfus
9 décembre 1905 : Loi de séparation de l'Église et de l'État
3 août 1914-11 novembre 1918 : Déclaration de guerre de l'Allemagne à la France – armistice de Rethondes
28 juin 1919 : Signature du traité de Versailles.
LIVRE V
L'ÉTRANGE DÉFAITE
ET LA FRANCE INCERTAINE
1920-2007
1
LA CRISE NATIONALE
1920-1938
58.
En une quinzaine d'années – des années 20 aux années 30 du xxe siècle –, la France, passe d'un après-guerre à un avant-guerre, même si elle refuse d'imaginer que ce qu'elle vit à partir de 1933 annonce un nouveau conflit contre les mêmes ennemis allemands qu'elle croyait avoir vaincus.
Mais il existe, en fait, plusieurs France, comme si, après la « brutalisation » exercée par la guerre, l'âme de la nation avait non seulement été traumatisée, mais avait éclaté.
Il y a les Français qui pleurent dans les cimetières et se recueillent devant les monuments aux morts.
Il y a les anciens combattants qui se regroupent à partir des années 30 dans une ligue patriotique antiparlementaire rassemblant ceux qui ont combattu en première ligne : les Croix-de-Feu. Ils seront près de cent cinquante mille.
Il y a ceux que la « boucherie » guerrière a révoltés, qui ne veulent plus revoir « ça ». Ils sont pacifistes. D'autres se pensent révolutionnaires parce que, selon Jaurès « le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». Ceux-là sont devenus communistes.
Il y a ceux qui croient à l'entente possible entre les États.
Ils font confiance à la Société des Nations pour régler les différends internationaux. Ils pleurent en écoutant Aristide Briand, pèlerin de la paix, plusieurs fois président du Conseil et ministre des Affaires étrangères durant sept années –, lorsqu'il salue l'adhésion de l'Allemagne à la Société des Nations (1926), signe le pacte Briand-Kellog mettant la guerre hors la loi (1928) ou appelle à la constitution d'une Union européenne (1929) et déclare : « Arrière, les fusils, les mitrailleuses, les canons ! Place à la conciliation, à l'arbitrage, à la paix ! »
Il y a ceux qui, après la « marche sur Rome », la prise du pouvoir par Mussolini (octobre 1922), veulent imiter le fascisme italien et sont parfois financés par lui.
Ils créent un Faisceau des combattants et des producteurs (Georges Valois, 1925), des mouvements qui se dotent d'un uniforme – les Jeunesses patriotes, les Francistes –, comme si ces jeunes hommes qui ont vécu la discipline militaire et porté le bleu horizon ne pouvaient y renoncer et voulaient pour la France un « régime fort », ce que Mussolini a qualifié, dans les années 30, d'État « totalitaire », inventant ce mot.
Et puis il y a les hommes politiques qui continuent à renverser les gouvernements au Parlement – la moyenne de durée d'un président du Conseil est de six mois !
Ils sont radicaux-socialistes, le parti clé de voûte de la IIIe République, dont les chefs – Édouard Herriot (1872-1957), Édouard Daladier (1884-1970) – peuvent s'associer aussi bien avec les socialistes qu'avec les républicains modérés, comme Poincaré – président de la République jusqu'en 1920, puis plusieurs fois président du Conseil.
Il y a ceux qui veulent oublier et la guerre et l'avenir.
Ils dansent et boivent (la consommation d'alcool a été multipliée par quatre entre 1920 et 1930). Ils se laissent emporter par les rythmes nouveaux des « années folles » (autour de 1925).
Car la France n'est pas seulement une « gueule cassée », elle a aussi « le diable au corps ».
L'auteur de ce roman, publié en 1923, Raymond Radiguet, écrit : « Je flambais, je me hâtais comme les gens qui doivent mourir jeunes et qui mettent les bouchées doubles. »
Et Léon Blum, le socialiste qui, en décembre 1920, au congrès de Tours, avait dit à ses camarades qui, majoritaires, allaient fonder le Parti communiste : « Pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste pour garder la vieille maison », se souvient de ces années-là : « Il y eut quelque chose d'effréné, écrit-il, une fièvre de dépenses, de jouissance et d'entreprise, une intolérance de toute règle, un besoin de mouvement allant jusqu'à l'aberration, un besoin de liberté allant jusqu'à la dépravation. »
En fait, ceux qui s'abandonnent ainsi tentent de fuir la réalité française qui les angoisse.
Ils expriment avec frénésie leur joie d'avoir échappé à la mort, aux mutilations que leurs camarades, leurs frères, leurs pères, ont subies et dont ils portent les marques sur leurs visages, dans leurs corps amputés.
Ils rêvent à l'avant-guerre de 14, devenu la « Belle Époque », oubliant les violences, les injustices, les impuissances, les aveuglements qui avaient caractérisé les années 1900.
L'âme de la France se replie ainsi sur les illusions d'un passé idéalisé, d'un avenir pacifique, et, pour certains, d'une force capable d'imposer aux autres les solutions françaises.
C'est cette combinaison entre refus de voir, angoisse, désir de jouir, souvenir des morts et des malheurs de la guerre, croyance en l'invincibilité française, qui caractérise alors l'âme de la France.
On veut croire en 1923 que Poincaré, en faisant occuper militairement la Ruhr, en s'emparant de ce gage, réussira à obtenir que l'Allemagne paie les réparations que le traité de Versailles a fixées.
On veut croire qu'en construisant une ligne fortifiée (la ligne Maginot, du nom du ministre de la Guerre), comme le souhaite Pétain, on se protégera de l'invasion.
On imagine qu'en s'alliant avec les nouveaux États de l'Europe orientale (Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie), on contraindra l'Allemagne « cernée » à une politique pacifique.
Mais on sait aussi que la France s'est affaiblie. Moins de naissances. Aristide Briand confie : « Je fais la politique étrangère de notre natalité. »
On sait que le franc s'est effondré, que l'inflation ronge la richesse nationale, que les prix ont été multipliés par sept entre 1914 et 1928. Les rentiers et les salariés sont les victimes de cette érosion. Et le rétablissement de la stabilité monétaire entre 1926 et 1929 – le « franc Poincaré » – n'est qu'un répit.
On ne respecte pas les politiciens qui occupent à tour de rôle, comme au manège, les postes ministériels, et dont on sent bien qu'ils sont incapables d'affronter la réalité.
Les radicaux-socialistes sont de toutes les combinaisons. Le Cartel des gauches issu des élections de 1924 ne dure que deux années, et Herriot, le leader radical qui dit s'être heurté au « mur de l'argent », se retrouve dans le même gouvernement que Poincaré...
Les communistes, pour leur part, ont transformé leur parti en machine totalitaire, et leur leader, Maurice Thorez (1900-1964), suivant les directives de Moscou, mène une politique « classe contre classe » dont les premières cibles sont les socialistes. Le parti de Léon Blum est qualifié de « social-fasciste », de « social-flic » !
En fait, la France est divisée entre de grandes masses électorales stables. En 1924, en 1932, en 1936, ce sont quelques centaines de milliers d'électeurs – moins de 5 % du corps électoral – qui se déplacent pour donner une majorité de gauche.
La dépendance accrue de l'exécutif à l'égard des combinaisons parlementaires, la « mobilité » des radicaux qui parlent à gauche mais s'associent souvent avec la droite ou freinent les volontés de réforme, conscients du « conservatisme » de leurs électeurs, empêchent toute politique à longue portée.
Un républicain modéré comme André Tardieu (1876-1945), ancien collaborateur de Clemenceau, qui sera à l'origine de la création des assurances sociales (1928) et des allocations familiales (1932), jauge l'impuissance du système politique : il évoque la « révolution à refaire », mais quittera la vie politique devant l'impossibilité de réformer ce système.
Mais voici que la crise économique de 1929 bouleverse en quelques mois la situation mondiale.
Les hommes politiques français, eux, continuent à s'aveugler.
On célèbre l'empire colonial français lors de l'Exposition coloniale de 1931. On parle d'une France de 100 millions d'habitants au moment même où des troubles nationalistes secouent l'Indochine, où, après la guerre du Rif (1921-1923), la situation au Maroc reste périlleuse, où le nationalisme se manifeste en Algérie et en Tunisie.
Mais c'est surtout la politique de Briand qui vole en éclats.
L'Allemagne, frappée par la crise, ne paie plus les réparations.
Hitler devient chancelier le 30 janvier 1933 et le Reich quitte la Société des Nations, décide de réarmer et de remilitariser la rive gauche du Rhin.
Hitler tente même, en 1934, de s'emparer de l'Autriche (l'Anschluss).
Un front antiallemand se constitue, qui rassemble la France, le Royaume-Uni et l'Italie... fasciste.
Pour quelle politique ?
Quelle confiance peut-on avoir en Mussolini pour défendre les principes de la Société des Nations ?
Le ministre des Affaires étrangères, Barthou, retrouve la tradition de l'alliance franco-russe d'avant 1914. Mais la Russie, c'est l'URSS communiste, et le pacte franco-soviétique suscite l'opposition des adversaires du communisme. Barthou sera assassiné à Marseille en 1934 en même temps que le roi de Yougoslavie. La politique internationale avive ainsi les divisions de la vie politique française.
Contre l'Allemagne, soit ! Mais avec qui ? Mussolini ou Staline ?
Et pourquoi pas l'apaisement avec l'Allemagne nazie ? N'est-ce pas plus favorable aux intérêts français, à « nos valeurs » traditionnelles, que l'entente avec la Russie soviétique ?
Les passions idéologiques déchirent l'âme de la France. Des scandales – Stavisky – secouent le monde politique et font se lever une double vague d'antiparlementarisme : celui des ligues – Croix-de-Feu, Jeunesse patriotes, francistes – et celui des communistes.
Lorsque le gouvernement Daladier déplace le préfet de police de Paris – Chiappe –, soupçonné de complicité avec les ligues, celles-ci manifestent, le 6 février 1934.
Journée d'émeute : une dizaine de morts, des centaines de blessés place de la Concorde.
Paris n'avait pas connu une telle violence depuis plusieurs décennies.
Les Croix-de-Feu ne se sont pas lancés à fond dans la bataille. La prudence et la retenue de leur chef, le colonel de La Rocque, ont empêché qu'on jette « les députés à la Seine ».
Le 12 février, les syndicats, les socialistes et les communistes – unis de fait dans la rue – manifestent au cri de « Le fascisme ne passera pas ! ».
On peut craindre que ces affrontements ne conduisent à une situation de guerre de religion ou de guerre civile comme la France en a si souvent connu.
Perspective d'autant plus grave et « classique » que les camps qui s'affrontent affichent aussi des positions radicalement différentes en politique extérieure.
Dès ce mois de février 1934, alors que Hitler passe en revue les troupes allemandes, que Mussolini déclare qu'il faut que l'Italie obtienne en Afrique (en Éthiopie) des récompenses pour sa politique européenne, qu'en Asie le Japon a attaqué la Chine, la République semble être incapable de susciter une nouvelle « union sacrée ».
Où est le parti de la France ? Chacun se réclame de la nation mais regarde vers l'étranger.
Le pouvoir républicain a d'ailleurs cédé devant l'émeute du 6 février.
Daladier a démissionné.
Il est remplacé par Gaston Doumergue (soixante et onze ans) qui a été naguère président de la République. Ce radical-socialiste modéré est entouré de Tardieu et Herriot.
Le ministre de la Guerre est un maréchal populaire parmi les anciens combattants, Philippe Pétain (soixante-dix-huit ans).
Comment ces septuagénaires pourraient-ils unir et galvaniser l'âme de la France blessée, angoissée, repliée sur elle-même ?
De l'autre côté du Rhin, la jeunesse acclame le chancelier Hitler.
Il n'a que quarante-cinq ans.
59.
À partir de 1934, il n'y aura plus de répit pour la France. Durant quelques semaines, au printemps et au début de l'été 1936, l'opinion populaire aura beau se laisser griser par les accordéons des bals du 14 Juillet dans les cours des usines occupées par les ouvriers en grève, ce ne sera qu'une brève illusion.
L'espoir, le rêve, la jouissance des avantages obtenus du gouvernement du Front populaire – congés payés ; quarante heures de travail par semaine, etc. –, seront vite ternis, effacés même, par le déclenchement de la guerre d'Espagne, le 17 juillet 1936, et l'aggravation de la situation internationale.
La France est entrée dans l'avant-guerre.
Mais le pays refuse d'en prendre conscience.
Qui peut accepter, vingt ans seulement après la fin de la Première Guerre mondiale, si présente dans les corps et les mémoires, qu'une nouvelle boucherie recommence à abattre des hommes dont certains sont les survivants de 14-18 ?
Dès lors, on ne veut mourir ni pour les Sudètes, ces 3 millions d'Allemands de Tchécoslovaquie séduits par le Reich de Hitler, ni pour Dantzig, cette « ville libre » séparée du Reich par un « corridor » polonais.
Certes, la France a signé des traités avec la Tchécoslovaquie et la Pologne !
Mais quoi, le respect de la parole donnée vaut-il une guerre ?
Il faut la paix à tout prix, à n'importe lequel !
Et quand, à Munich, le 29 septembre 1938, Daladier et l'Anglais Chamberlain abandonnent sur la question des Sudètes, et donc, à terme, livrent la Tchécoslovaquie à Hitler, c'est dans toute la France un « lâche soulagement », selon le mot de Léon Blum.
Embellie illusoire du Front populaire !
Apparente sagesse de Léon Blum de ne pas intervenir en Espagne pour soutenir un Frente popular menacé par le pronunciamiento du général Franco !
Lâche soulagement au moment de Munich.
Ce sont là les signes de la crise nationale qui rend la France aboulique, passant de l'exaltation à l'abattement, de brefs élans au repliement.
Aussi les volontaires français qui s'enrôlent dans les Brigades internationales pour aller combattre auprès des républicains espagnols – Malraux est le plus illustre d'entre eux – sont-ils peu nombreux (moins de 10 000).
Même si le « peuple » ouvrier est solidaire de ses camarades espagnols, il aspire d'abord à « profiter » des congés payés et des auberges de jeunesse !
Attitude significative : elle révèle qu'on imagine que la France peut rester comme un îlot préservé alors que monte la marée guerrière.
Et, avec la non-intervention en Espagne, la ligne Maginot, l'accord de Munich, les élites renforcent cette croyance, cette illusion.
Comment, dans ces conditions, préparer la France à ce qui vient : la guerre contre l'Allemagne nazie ?
En fait, durant ces quatre années (de 1934 à 1938), c'est comme si le pays et ses élites avaient été incapables – ou avaient refusé – de voir la réalité, de trancher le nœud gordien de cette crise nationale qui mêlait chaque jour de façon plus étroite politiques intérieure et extérieure.
Au temps du Front populaire, le 14 Juillet, on défile avec un bonnet phrygien, et l'entente des communistes, des socialistes et des radicaux se fait ainsi dans l'évocation et la continuité de la tradition révolutionnaire.
L'hebdomadaire qui exprime cette sensibilité du Front populaire s'intitule Marianne.
On célèbre aussi – en mai 1936 – le souvenir de la Commune de Paris en se rendant en cortège au mur des Fédérés en hommage aux communards fusillés au cimetière du Père-Lachaise.
Nouvelle référence révolutionnaire alors que les mesures du Front populaire sont importantes – congés payés, scolarité obligatoire et gratuite jusqu'à quatorze ans –, mais ne « révolutionnent » pas la société française.
Au reste, les radicaux de Daladier, interprètes des classes moyennes, sont des modérés qui n'accepteront jamais une dérive révolutionnaire du Front populaire. D'autant moins que le basculement électoral qui a permis la victoire du Front, aux élections d'avril-mai 1936, ne porte que sur... 150 000 voix !
Les « discours » et « références » révolutionnaires ne sont donc qu'illusion, simulacre.
Mais ils sont suffisants pour provoquer l'inquiétude et même une « grande peur » parmi l'opinion modérée, dans les couches moyennes, chez les paysans.
Parce que, derrière le Front populaire, on craint les communistes ; ils ont désormais 76 députés – plus que les radicaux –, et il y a 149 députés socialistes. Ils ont refusé de participer au gouvernement radical et socialiste de Léon Blum, tout en le « soutenant ». Pourquoi, si ce n'est pour « organiser » les masses (les adhérents du Parti communiste sont passés de 40 000 en 1933 à plus de 300 000 en 1937) ?
Les propos révolutionnaires, joints à ces réalités, aggravent les tensions.
Lorsqu'on entend chanter les militants du Front populaire, portant le bonnet phrygien, « Allons au-devant de la vie. Allons au-devant du bonheur. Il va vers le soleil levant, notre pays », l'opinion modérée ne craint pas seulement un retour à la terreur de 1793. Ce chant est soviétique.
On a donc peur des « bolcheviks » au moment précis où les grands procès de Moscou dévoilent la terreur stalinienne.
Donc, indissociablement, à chaque instant de la vie politique, la situation intérieure renvoie à des choix de politique extérieure.
La peur, la haine entre Français, s'exacerbent. Salengro, ministre de l'Intérieur de Blum, est calomnié et se suicide. Georges Bernanos écrira : « L'ouvrier syndiqué a pris la place du Boche ». La nation, sur tous les sujets, est divisée.
Ainsi, en 1935, les élites intellectuelles s'indignent dans leur majorité que la France, à la Société des Nations, vote des sanctions contre l'Italie fasciste qui a entrepris la conquête de l'Éthiopie, État membre de la SDN.
Dans les rues du Quartier latin, à Paris, les étudiants de droite manifestent contre le professeur Jèze, défenseur du Négus.
Les académiciens évoquent la mission civilisatrice de l'Italie fasciste face à l'un des pays les plus arriérés du monde : cette « Italie fasciste, une nation où se sont affirmées, relevées, organisées, fortifiées depuis quinze ans quelques-unes des vertus essentielles de la haute humanité ». Et c'est pour protéger l'Éthiopie qu'on risque de déchaîner « la guerre universelle, de coaliser toutes les anarchies, tous les désordres » !
D'un côté, les partisans du Front populaire crient : « Le fascisme ne passera pas ! » ; sur l'autre rive de l'opinion, on affirme que le fascisme exprime les « vertus » de la civilisation européenne.
Quand la guerre d'Espagne se déchaîne, cette fracture ne fait que s'élargir, même si des intellectuels catholiques tels Mauriac, Bernanos et Maritain tentent d'empêcher l'identification entre christianisme et fascisme ou franquisme.
Ces oppositions donnent la mesure de la profondeur de la crise nationale française.
Le gouvernement du Front populaire – avec les peurs et les haines qu'il suscite, dont l'antisémitisme est l'un des ressorts – avive ces tensions, même s'il refuse d'intervenir officiellement en Espagne. Les radicaux s'y seraient opposés. De même, les Anglais sont partisans de cette politique de non-intervention qui est un laisser-faire hypocrite, puisque Italiens et Allemands aident Franco.
Si « le Juif » Léon Blum a dissous les « ligues », elles se reconstituent sous d'autres formes : les Croix-de-Feu deviennent le Parti social français (PSF). Son « chef », le colonel de La Rocque, rassemble plus de deux millions d'adhérents qui défilent au pas cadencé !
Un autre mouvement, le Parti populaire français (PPF), créé par un ancien dirigeant communiste, Doriot, réunit plus de 200 000 adhérents autour de thèmes fascistes.
À ces partis légaux s'ajoutent des organisations « secrètes », comme le Comité social d'action révolutionnaire – la « Cagoule » –, financé par l'Italie fasciste, qui se livre à des attentats provocateurs et, à la demande de Mussolini, perpètre l'assassinat d'exilés politiques italiens comme celui des frères Rosselli.
Tous ces éléments semblent préfigurer une « guerre civile », même si la masse de la population reste dans l'expectative, d'abord soucieuse de paix intérieure et extérieure.
C'est cette tendance de l'opinion que les élites politiques suivent et flattent au lieu de l'éclairer sur les dangers d'une politique d'apaisement.
Dans ces conditions, aucune politique étrangère rigoureuse et énergique, à la hauteur des dangers qui menacent le pays, n'est conduite.
D'ailleurs, le système politique marqué par l'instabilité et l'électoralisme l'interdit.
Les radicaux demeurent le pivot sensible de toutes les combinaisons gouvernementales.
Le 21 juin 1937, ceux du Sénat font tomber Léon Blum, qui, sans illusions, demandait les pleins pouvoirs en matière financière.
C'en est fini du Front populaire, et, en novembre 1938, un gouvernement Daladier reviendra même sur les quarante heures. La grève générale lancée par la CGT sera un échec.
Ceux qui avaient cru à l'embellie, à l'élan révolutionnaire, sont dégrisés. Le mirage s'est dissipé. L'amertume succède à l'espérance.
On avait voulu croire aux promesses et aux réalisations du Front populaire.
On retrouve le scepticisme et on s'enferme dans la morosité et la déception.
La politique extérieure, elle, provoque le désarroi.
Quand, le 7 mars 1936, Hitler, en violation de tous les engagements pris par l'Allemagne, a réoccupé militairement la Rhénanie, le président du Conseil, le radical Albert Sarraut, a déclaré :
« Nous ne sommes pas disposés à laisser placer Strasbourg sous le feu des canons allemands ! »
Une réponse militaire française aurait pu alors facilement briser la faible armée allemande et le nazisme.
Mais, après ses rodomontades, le gouvernement français recule. Il ne veut pas se couper de l'Angleterre. Et, à la veille des élections législatives, il pense que le pays n'est pas prêt à une mobilisation que le haut état-major juge nécessaire si l'on veut contrer l'Allemagne.
Capitulation de fait, lâche soulagement...
Mussolini a compris où se situent la force et la détermination : en janvier 1937, il crée un « axe » italo-allemand, abandonnant à leur sort la France et l'Angleterre.
Même impuissance quand Hitler, en mars 1938, réalise l'Anschluss et entre, triomphant, dans Vienne.
Même renoncement à Munich, le 29 septembre 1938, et même lâche soulagement.
On veut croire que c'est « la paix pour une génération ». À son retour de Munich, on acclame Daladier, « le sauveur de la paix ».
Mais c'est tout le système d'alliances français qui se trouve détruit.
La Tchécoslovaquie est condamnée.
Pourquoi se battrait-on pour la Pologne, maintenant menacée par l'Allemagne qui veut recouvrer Dantzig ?
Et que peut penser l'URSS de cet accord de Munich qui, comme l'écrit un journal allemand, « élimine la Russie soviétique du concept de grande puissance » ?
Car la volonté d'écarter l'URSS de l'Europe et de pousser Hitler vers l'est est évidente à la lecture de l'accord de Munich.
En décembre 1938, le ministre des Affaires étrangères du Reich, Ribbentrop, vient signer à Paris une déclaration franco-allemande.
Ce n'est pas une alliance, mais c'est plus qu'un traité de non-agression.
Pour ne pas heurter les nazis, on a conseillé aux ministres juifs du gouvernement français de ne pas se rendre à la réception donnée à l'ambassade d'Allemagne.
Voilà jusqu'où sont prêtes à s'abaisser les élites politiques françaises !
Et c'est le gouvernement républicain d'un pays souverain, qu'aucune occupation ne contraint, qui prend cette décision !
Elle condamne un système politique et les hommes qui le dirigent.
Comment pourraient-ils demain, dans l'orage qui s'annonce, prendre les mesures radicales et courageuses qu'impose la guerre ?
En fait, écrit Marc Bloch, « une grande partie des classes dirigeantes, celles qui nous fournissaient nos chefs d'industrie, nos principaux administrateurs, la plupart de nos officiers de réserve, défendaient un pays qu'ils jugeaient d'avance incapable de résister ».
Marc Bloch ajoute : « La bourgeoisie s'écartait sans le vouloir de la France tout court. En accablant le régime, elle arrivait, par un mouvement trop naturel, à condamner la nation qui se l'était donné. »
2
L'ÉTRANGE DÉFAITE
1939-1944
60.
Pour l'âme de la France, 1939 est la première des années noires.
Le lâche soulagement qui avait saisi le pays à l'annonce de la signature des accords de Munich, la joie indécente qu'avaient manifestée les cinq cent mille Français massés de l'aéroport du Bourget à l'Arc de triomphe pour accueillir le président du Conseil Édouard Daladier, ne sont plus que souvenirs.
La guerre est là, fermant l'horizon.
Des dizaines de milliers de réfugiés espagnols franchissent la frontière française pour fuir les troupes franquistes qui, le 26 janvier 1939, viennent d'entrer dans Barcelone.
On ouvre des camps pour accueillir ces réfugiés qui incarnent la débâcle d'une République qui s'était donné un gouvernement de Frente popular.
Quelques semaines plus tard, le 15 mars, les troupes allemandes entrent dans Prague : violation cynique par Hitler des accords de Munich, et mort de la Tchécoslovaquie.
Quelques semaines encore, et Mussolini signe avec le Führer un pacte d'acier. Les deux dictateurs se sont associés pour conclure avec le Japon un pacte anti-Komintern, se constituant en adversaires de l'Internationale communiste dirigée par Moscou.
La France doit-elle dès lors conclure une alliance avec l'URSS contre l'Allemagne nazie ?
La question qui avait taraudé les élites politiques françaises revient en force. Elle provoque les mêmes clivages.
La droite rejette toujours l'idée d'un pacte franco-soviétique. Elle affirme qu'on doit poursuivre la politique d'apaisement, voire de rapprochement avec ces forces rénovatrices mais aussi conservatrices que sont le fascisme, le nazisme, le franquisme.
Bientôt – le 2 mars 1939 –, le maréchal Philippe Pétain sera nommé ambassadeur de France en Espagne auprès de Franco.
Mais, dans le même temps, quelques voix fortes s'élèvent à droite pour affirmer que parmi les périls qui menacent la France, « s'il y a le communisme, il y a d'abord l'Allemagne » (Henri de Kérillis).
L'industriel français Wendel est encore plus clair : « Il y a actuellement un danger bolchevique intérieur et un danger allemand extérieur, dit-il. Pour moi, le second est plus grand que le premier, et je désapprouve nettement ceux qui règlent leur attitude sur la conception inverse. »
En ces premiers mois de 1939, l'âme de la France est ainsi hésitante et toujours aussi divisée.
Mais on sent, de la classe politique au peuple, comme un frémissement de patriotisme, une volonté de réaction contre les dictateurs pour qui les traités ne sont que « chiffons de papier ».
On est révolté par les revendications des fascistes, qui, à Rome, prétendent que Nice, la Corse, la Tunisie et la Savoie doivent revenir à l'Italie.
À Bastia, à Nice, à Marseille, à Tunis, on manifeste contre ces prétentions qui donnent la mesure de l'arrogance du fascisme et de l'affaiblissement de la France.
Daladier, l'homme de Munich, prend la pose héroïque et patriotique : « La France, sûre de sa force, est en mesure de faire face à toutes les attaques, à tous les périls », déclare-t-il le 3 janvier 1939.
On se rassure.
Un million de Parisiens acclament le défilé des troupes françaises et anglaises, le 14 juillet 1939. Douze escadrilles de bombardement survolent Paris, Lyon et Marseille.
On se persuade – les observateurs du monde entier en sont convaincus – que l'armée, l'aviation et la marine françaises constituent encore la force militaire la plus puissante du monde.
Et il y a la ligne Maginot qui interdit toute invasion !
Car aucun Français ne veut la guerre, et l'on espère que la force française suffira à dissuader Hitler de la commencer. Les Allemands doivent se rappeler que la France les a vaincus en 1918.
Ainsi, chaque Français continue de penser que le conflit peut être évité.
Au gouvernement, Paul Reynaud, libéral, indépendant, qui joue aux côtés de Daladier un rôle de plus en plus important, prend des mesures « patriotiques ».
Les crédits militaires, que le Front populaire avait déjà très largement augmentés, le sont à nouveau.
L'ambassadeur allemand Otto Abetz, qui anime ouvertement un réseau proallemand dans les milieux intellectuels et artistiques, est expulsé (29 juillet 1939).
À Londres comme à Paris, des déclarations nombreuses réaffirment que les deux nations démocratiques n'accepteront pas que Hitler, sous prétexte de reprendre Dantzig, entre en Pologne.
« Nous répondrons à la force par la force ! »
Et à la question posée dans un sondage : « Pensez-vous que si l'Allemagne tente de s'emparer de Dantzig, nous devions l'en empêcher, au besoin par la force », 76 % des Français consultés répondent oui, contre 17 % de non.
Ce n'est ni l'union sacrée ni l'enthousiasme patriotique, plutôt une sorte de résignation devant les nécessités. Une acceptation qui pourrait devenir de plus en plus résolue si les élites se rassemblaient pour exprimer l'obligation nationale d'affronter le nazisme et le fascisme, de se battre et de vaincre parce qu'il n'y a pas d'autre issue.
Mais on entend toujours, parmi les élites, le refus de « mourir pour Dantzig ». Et c'est un ancien socialiste, Marcel Déat, qui le répète.
Le pacifisme reste puissant, toujours aussi aveugle à la menace nazie.
Il est influent dans les syndicats de l'enseignement proches des socialistes et au sein même de la SFIO.
Naturellement, le refus de la guerre antinazie est par ailleurs le ressort des milieux attirés par le nazisme, le fascisme ou le franquisme. L'écrivain Robert Brasillach, l'hebdomadaire Je suis partout, représentent ce courant.
À l'opposé, les communistes apparaissent comme les plus résolus à l'affrontement avec le « fascisme ».
Thorez, leur leader, propose un « Front des Français ».
Le PCF se félicite que des négociations se soient ouvertes, à Moscou, entre Français et Soviétiques. Ces derniers réclament le libre passage de leurs troupes à travers la Pologne pour s'avancer au contact des Allemands. Les Polonais s'y refusent. Ils savent depuis des siècles ce qu'il faut penser de l'« amitié » russe.
Seuls quelques observateurs avertis, comme Boris Souvarine, ancien communiste devenu farouchement antistalinien, n'écartent pas l'éventualité d'un accord germano-soviétique, sorte de figure inversée des accords de Munich, par lequel les deux partenaires, oubliant leurs oppositions idéologiques radicales, associeraient leurs intérêts géopolitiques : les mains libres pour Hitler à l'Est, assorties d'un nouveau partage de la Pologne entre Russes et Allemands, et, à l'Ouest, guerre ouverte contre la France et l'Angleterre.
Ni Berlin ni Moscou n'excluent la guerre entre eux, mais chacun pense que le temps gagné permettra de renforcer sa propre position.
L'aveuglement français face à cette éventualité d'un accord germano-russe participe aussi de la crise nationale.
Les idéologies paralysent la réflexion et repoussent la notion d'intérêt national loin derrière les préoccupations partisanes.
La nation, sa défense et ses intérêts ne sont ni le mobile des choix politiques ni le cœur de l'analyse politique.
C'est là un fait majeur.
Ainsi, pour les communistes, il faut d'abord défendre la politique soviétique, dont ils sont l'un des outils.
Ils en épousent tous les méandres, et, de cette manière, estiment sauvegarder les intérêts de la classe ouvrière française, autrement dit de la France elle-même.
L'idéologie communiste empêche la « compréhension » de ce que sont les intérêts de la nation, qui ne sauraient se réduire à ceux d'une classe, fût-elle ouvrière, encore moins à ceux d'une autre nation, se prétendrait-elle communiste.
Pour les pacifistes, le patriotisme n'est qu'un mot destiné à masquer le nationalisme qui est à l'origine de la guerre. Les nations ne sont que des archaïsmes, des structures d'oppression. Ce ne sont pas leurs intérêts qu'il faut défendre, mais ceux de l'humanité...
Ces pacifistes – qui influencent les socialistes – ne pensent plus en termes de nation.
Les radicaux-socialistes et les socialistes sont des politiciens enfermés dans les jeux du parlementarisme, incapables le plus souvent de prendre une décision et de l'imposer, fluctuant donc entre le désir de paix à tout prix – le « lâche soulagement » – et les rodomontades patriotiques – celles d'un Daladier – intervenant trop tard et qui ne sont pas suivies d'actes d'autorité.
Les modérés, les conservateurs, se souviennent de la « Grande Peur » qu'ils ont éprouvée à nouveau au moment du Front populaire.
Ils craignent les désordres. La guerre antifasciste pourrait permettre aux communistes de prendre le pouvoir, créant une sorte de Commune victorieuse grâce à la guerre.
Ils sont sensibles aux arguments des minorités favorables à une entente avec le fascisme, le franquisme et même le nazisme.
Le succès en Europe de ces régimes d'ordre les fascine. Ils estiment que le moment est peut-être venu, pour les « modérés », de prendre leur revanche sur les partisans d'une République « sociale » qui, à leurs yeux, ont dominé depuis 1880 et sûrement depuis 1924.
Ce courant est influencé par Charles Maurras, qui identifie les intérêts de la nation à ceux des partisans de la « royauté ».
Ainsi, aucune des forces politiques ne place au cœur de son projet et de son action la défense bec et ongles de la nation.
Chacune d'elles est dominée par une idéologie ou par la défense de la « clientèle » qui assure électoralement sa survie.
De ce fait, les « instruments » d'une grande politique extérieure – la diplomatie et l'armée – ne sont ni orientées ni dirigées par la main ferme du pouvoir politique.
Seules quelques personnalités indépendantes d'esprit accordent priorité aux intérêts de la nation et sont capables de prendre des décisions au vu des nécessités nationales sans se soumettre à des présupposés idéologiques.
Mais ces individualités sont peu nombreuses et ne peuvent imposer leurs vues et leurs décisions aux forces politiques ou aux grands corps.
Un Paul Reynaud, par exemple, a soutenu les idées novatrices du colonel de Gaulle – création de divisions blindées – sans réussir à imposer assez tôt leur constitution.
De Gaulle (1890-1970) est évidemment l'un de ces patriotes lucides qui n'ont pas encore le pouvoir de décision ni même celui de l'influence.
Dès 1937, il peut écrire : « Notre haut commandement en est encore aux conceptions de 1919, voire de 1914. Il croit à l'inviolabilité de la ligne Maginot, d'ailleurs incomplète (elle ne couvre pas le massif des Ardennes, réputé infranchissable). [...] Seule la mobilité d'une puissante armée blindée pourrait nous préserver d'une cruelle épreuve. Notre territoire sera sans doute une fois de plus envahi ; quelques jours peuvent suffire pour atteindre Paris. »
De Gaulle anticipe aussi les évolutions de la situation internationale lorsqu'il identifie la menace nazie et le risque d'un accord germano-russe que n'empêchera pas le heurt des idéologies, car, estime-t-il, la géopolitique commande à l'idéologie.
Ils ne sont qu'une poignée, ceux qui ont envisagé cette hypothèse, relevé les signes avant-coureurs du double jeu de Staline.
Le maître de l'URSS négocie avec les Français et les Anglais, d'une part, et, de l'autre, avec les Allemands.
Il écarte le ministre des Affaires étrangères juif, Litvinov, et le remplace par Molotov dès le mois de mai 1939.
Des réfugiés antinazis sont livrés par les Russes aux Allemands.
Le 23 août 1939, la nouvelle de la signature d'un pacte de non-agression germano-soviétique plonge les milieux politiques dans la stupeur, le désarroi, la colère.
Malgré de nombreuses défections, les communistes français vont justifier la position soviétique. Se plaçant ainsi en dehors de la communauté nationale, ils vont subir la répression policière.
Car le pacte signifie évidemment le déclenchement de la guerre.
Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes entrent en Pologne – Russes et Allemands se sont « partagé » le pays. L'Angleterre d'abord, puis la France, le 3 septembre, déclarent la guerre à l'Allemagne.
On n'avait pas voulu se battre pour les Sudètes.
On va mourir pour Dantzig.
L'opinion française perd tous ses repères. Les communistes sont désormais hostiles à la « guerre impérialiste » !
La guerre s'impose comme une fatalité.
On la subit sans enthousiasme.
Le frémissement patriotique qui avait saisi l'âme de la France pendant les six premiers mois de 1939 est retombé.
Restent le devoir, l'acceptation morose, l'obligation de faire cette guerre dont on ne comprend pas les enjeux parce qu'à aucun moment les élites politiques n'ont évoqué clairement les intérêts français ni n'ont agi avec détermination.
Les élites ont oublié la France, prétendant ainsi suivre les Français qui, au contraire, attendaient qu'on leur parle de la nation et des raisons qu'il y avait, vingt ans après la fin d'une guerre, de se battre à nouveau et de mourir pour elle.
61.
En onze mois, de septembre 1939 à juillet 1940, la France, entrée dans la guerre résignée, mais qui s'imaginait puissante, a été terrassée, humiliée, mutilée, occupée après avoir succombé à une « étrange défaite », la plus grave de son histoire.
Car ce n'est pas seulement la crise nationale qui couvait depuis les années 30 qui est responsable de cet effondrement.
Si des millions de Français se sont jetés sur les routes de l'exode, si Paris n'a pas été défendu, si deux millions de soldats se sont rendus à l'ennemi, si la IIIe République s'est immolée dans un théâtre de Vichy, et si seulement 80 parlementaires ont refusé de confier les pleins pouvoirs à Pétain, alors que 589 d'entre eux votaient pour le nouveau chef de l'État, c'est que la gangrène rongeait la nation depuis bien avant les années 30.
C'était comme si, en 1940, la débâcle rouvrait les plaies de 1815, de 1870, qu'on avait crues cicatrisées et qui étaient encore purulentes.
Pis : c'était comme si, à l'origine et à l'occasion de l'« étrange défaite », toutes les maladies, les noirceurs de l'âme de la France s'étaient emparées du corps de la nation, comme s'il fallait faire payer au peuple français aussi bien l'édit de Nantes, la tolérance envers les hérétiques, que la décapitation de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la loi de séparation de l'Église et de l'État, la réhabilitation de Dreyfus et le Front populaire !
Le désastre de 1940 fut un temps de revanche et de repentance, le châtiment enfin infligé à un peuple trop rétif.
Il fallait le faire rentrer dans le rang, lui extirper de la mémoire Henri IV et Voltaire, les communards et Blum, et même ce dernier venu, ce grand rebelle, de Gaulle, ce colonel promu général de brigade à titre temporaire en juin 1940 et qui, depuis Londres, clamait que « la flamme de la Résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ».
Il osait dénoncer le nouvel État français, refuser une « France livrée, une France pillée, une France asservie ».
Le 3 août 1940, on le condamnait à mort par contumace pour trahison et désertion à l'étranger en temps de guerre.
Et Philippe Pétain, beau vieillard patelin de quatre-vingt-quatre ans, derrière lequel se cachaient les ligueurs de 1934, les politiciens ambitieux vaincus en 1936, dont Pierre Laval, tous les tenants de la politique d'apaisement, invitait au retour à la terre, parce que la « terre ne ment pas ».
Il morigénait le peuple, l'invitait à un « redressement intellectuel et moral », à une « révolution nationale » – comme en avaient connu l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Mais celle-ci serait une contre-révolution française : il fallait oublier la devise républicaine, « Liberté, Égalité, Fraternité », et la remplacer par le nouveau triptyque de l'État français : Travail, Famille, Patrie.
L'ordre moral, celui des années 1870, s'avance avec ce maréchal qui avait dix-sept ans au temps du maréchal de Mac-Mahon et du duc de Broglie.
« Depuis la victoire [de 1918], dit Pétain, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on n'a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur. »
Le malheur s'est avancé à petits pas sournois.
« Drôle de guerre » entre septembre et mai 1940.
On ne tente rien, ou presque – une offensive en direction de la Sarre, vite interrompue – pour secourir les Polonais broyés dès le début du mois d'octobre.
Et Hitler, le 6 de ce mois, lance un appel à la paix qui trouble et rassure.
Peut-être n'est-ce là qu'un simulacre de guerre ?
Les Allemands ont obtenu ce qu'ils voulaient ; pourquoi pas une paix honorable ?
Ce qu'il reste de communistes prêche pour elle, contre la guerre conduite par la France impérialiste. Ils ne dénoncent plus l'Allemagne. On les emprisonne, ces martyrs de la paix, et leur secrétaire général, Thorez, a déserté et gagné Moscou !
D'une certaine manière, et bien qu'ils ne soient qu'une minorité, leur propagande renoue avec le vieux fonds pacifiste, antimilitariste, qui travaille une partie du peuple français.
On s'arrange donc de cette « drôle de guerre » sans grande bataille offensive, ponctuée seulement d'« activités de patrouille ». Les élites cherchent tant bien que mal à sortir d'un conflit qu'elles n'ont pas voulu.
Quand les Soviétiques agressent – en novembre – la Finlande, on s'enflamme pour l'héroïsme de ce petit pays dont la résistance est aussi soutenue par... l'Allemagne. On rêve à un renversement d'alliance, à attaquer l'URSS par le sud, à prendre Bakou.
L'idée d'une paix avec Hitler fait son chemin et prolonge la politique d'apaisement de 1938.
Comment, dans ces conditions, le peuple et les troupes seraient-ils préparés à une « vraie » guerre ?
Qui lit, parmi les 80 personnalités auxquelles il l'adresse, le mémorandum du général de Gaulle intitulé L'Avènement de la force mécanique, dans lequel il écrit : « Cette guerre est perdue, il faut donc en préparer une autre avec la machine » ?
On se réveille en plein cauchemar le 10 mai 1940.
La pointe de l'offensive allemande est dans les Ardennes, réputées infranchissables, et Pétain avait approuvé qu'on ne prolongeât pas la ligne Maginot dans ce massif forestier : la Meuse et lui ne constituaient-ils pas des obstacles naturels bien suffisants ?
Symboliquement, c'est autour de Sedan, comme en 1870, que se joue le sort de la guerre.
Les troupes françaises entrées en Belgique sont tournées.
Il suffit d'une bataille de cinq jours pour que le front soit rompu. À Dunkerque, trois cent mille hommes sont encerclés et évacués par la flotte britannique qui sauve d'abord ses propres soldats.
En six semaines, l'armée française n'existe plus.
Le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris.
L'exode de millions de Français – mitraillés – encombre toutes les routes.
Un pays s'effondre.
Le 16 juin, Paul Reynaud, qui a succédé en mars comme président du Conseil à Daladier – et qui a nommé de Gaulle, le 5 juin, sous-secrétaire d'État à la Guerre –, démissionne, remplacé par Philippe Pétain. Le général Weygand, généralissime, a accrédité la rumeur selon laquelle une Commune communiste aurait pris le pouvoir à Paris. La révolution menace. Il faut donc arrêter la guerre.
Le 17 juin, sans avoir négocié aucune condition de reddition et d'armistice, Pétain, s'adresse au pays :
« C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte, dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. »
Des centaines de milliers de soldats se battaient encore.
Cent trente mille étaient déjà tombés dans cette guerre où les actes d'héroïsme se sont multipliés dès lors que les officiers menaient leurs troupes à la bataille.
Mais le discours de Pétain paralyse les combattants. Pourquoi mourir puisque l'homme de Verdun appelle à déposer les armes alors que l'armistice n'est même pas signé ?
De Gaulle, qui a déjà jugé que la prise du pouvoir par Pétain « est le pronunciamiento de la panique », s'insurge contre cette trahison.
La France dispose d'un empire colonial, lance-t-il. La France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre.
Le 18 juin, il parle de Londres : « Le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! La France n'est pas seule... Cette guerre est une guerre mondiale... Quoi qu'il arrive, la flamme de la Résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. »
Voix isolée, qui n'est pas entendue dans un pays vaincu, envahi, livré.
Certes ici et là on refuse la reddition. On veut gagner l'Angleterre. On accomplit les premiers gestes de résistance – ce mot que de Gaulle vient de « réinventer ».
À Chartres, le préfet Jean Moulin tente de se suicider pour ne pas signer un texte infamant pour les troupes coloniales.
Mais la France, dans sa masse, est accablée, anéantie.
À Bordeaux, où le gouvernement s'est replié, on arrête Georges Mandel, l'ancien collaborateur de Clemenceau, républicain intransigeant, patriote déterminé.
On le relâchera, mais le temps de la revanche des anti-républicains commence.
C'est le triomphe, par la défaite et l'invasion, d'une partie des élites, celles qui, dans la République, s'étaient senties émigrées, ou bien dont les ambitions n'avaient pu être satisfaites.
Quant au peuple, il pleure déjà ses soldats morts – et les prisonniers.
Il est à la fois désemparé et soulagé.
Comment ne pas avoir confiance en Pétain, le vainqueur de Verdun ?
À Vichy, le 10 juillet 1940, le Maréchal devient chef de l'État.
Il annonce une Révolution nationale.
Dans quelques mois, on fera chanter dans les écoles, en lieu et place de La Marseillaise bannie :
Maréchal, nous voilà
Devant toi le sauveur de la France
Nous saurons, nous tes gars
Redonner l'espérance
La patrie renaîtra
Maréchal, Maréchal, nous voilà !
62.
1940 : pour la France, c'est le malheur de la défaite et de l'occupation, le règne des restrictions et des vilenies, des lâchetés, même si brûlent quelques brandons d'héroïsme que rien ne semble pouvoir éteindre.
Mais ce sont bien les temps du malheur.
Pétain répète le mot comme un vieux maître bougon qui sait la vérité et veut en persuader le peuple.
Il fustige : le malheur est le fruit de l'indiscipline et de l'esprit de jouissance, mâchonne-t-il. Et tout cela, qui remonte à la Révolution française, doit être déraciné.
Plus de Marseillaise, donc, mais Maréchal nous voilà.
Plus de 14 Juillet, mais célébration de Jeanne d'Arc et institution de la fête des Mères.
Plus de bonnet phrygien, mais la francisque, devenue emblème du régime. Il ne faut plus laisser les illusions, les perversions, corrompre les jeunes qu'on rassemble dans les « Chantiers de jeunesse ».
Quant aux anciens de 14-18, dont Pétain est le glorieux symbole, ils doivent se réunir dans la Légion française des combattants. On les voit, la francisque à la boutonnière, acclamer Pétain à chacun de ses voyages officiels.
Il est le « Chef aimé ». Il suit la messe aux côtés des évêques. Il se promène dans les jardins de l'hôtel du Parc, à Vichy, devenu capitale de l'État français.
On le vénère. On le croit quand il dit, de sa voix chevrotante, pour consoler et rassurer :
« Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. »
Mais l'armistice a attaché la France à la roue d'une vraie capitulation. Et l'occupant, « correct » et « souriant » aux premiers mois d'occupation, pille, démembre, tente d'avilir le pays.
La nation est partagée en deux par une ligne de démarcation : zone occupée, zone libre.
Il y aura même un ambassadeur de France – du gouvernement de Vichy – à Paris !
L'Alsace et la Lorraine sont allemandes, gouvernées par un Gauleiter. Les jeunes gens vont être enrôlés dans la Wehrmacht.
Le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés au commandement allemand de Bruxelles, et une zone interdite s'étend de la Manche à la frontière suisse.
L'Allemand puise dans les caisses : chaque jour, la France lui paie une indemnité suffisante pour nourrir dix millions d'hommes. Il achète avec cet argent les récoltes, les usines, les tableaux.
Les Français qui avaient espéré le retour rapide à l'avant-guerre, le rapatriement des prisonniers, le départ des occupants, s'enfoncent dans l'amertume et le désespoir. Le rationnement, la misère, le froid et l'humiliation ne prédisposent pas à l'héroïsme.
En zone occupée, la présence allemande – armée, police, Gestapo – rappelle à chaque pas la défaite.
En zone libre, on s'illusionne, on arbore le drapeau tricolore le jour de la fête de Jeanne d'Arc. Une « armée de l'armistice » cache ses armes, préparant la revanche, et à Vichy même les officiers du Service de renseignements arrêtent des espions allemands.
La défaite et l'occupation, ce sont aussi ces ambiguïtés, ce double jeu, ces excuses à la lâcheté, aux malversations, au « marché noir », à toute cette érosion des valeurs morales et républicaines.
Le malheur corrompt le pays.
Et la silhouette chenue d'un Pétain en uniforme couvre toutes les compromissions, les délations, les vilenies.
On livre à la Gestapo les antinazis qui s'étaient réfugiés en France.
On promulgue, à partir d'octobre 1940, des lois antisémites, sans même que les Allemands l'aient demandé. Et la persécution commence à ronger la société française, avec son cortège de dénonciations, d'égoïsmes, de lâchetés.
Les 16 et 17 juillet 1942, grande rafle des Juifs à Paris : la tache infamante, sur l'uniforme de l'État français, a la forme d'une étoile jaune.
80 000 de ceux qui ont été raflés, avec le concours de la police française, disparaîtront, déportés, dans les camps d'extermination.
L'ogre nazi est insatiable. Il exige, pour faire fonctionner ses usines de guerre, un Service du travail obligatoire (STO) en Allemagne qui s'applique à tous les jeunes Français.
L'âme de la France est souillée par cette complicité et cette collaboration avec l'occupant, fruits de la lâcheté, de l'ambition – le vainqueur détient le pouvoir, il favorise, il paie, il ferme les yeux sur les malversations –, mais aussi d'un accord idéologique.
Car toutes ces motivations se mêlent.
On est un jeune homme qui, en 1935, manifeste contre les sanctions de la SDN frappant l'Italie fasciste qui a agressé l'Éthiopie.
On a des sympathies pour la Cagoule. On a baigné dans la tradition antisémite illustrée par les œuvres de Drumont, qui ont imprégné les droites françaises.
On aurait été antidreyfusard si l'on avait vécu pendant l'Affaire.
On est aussi patriote, défenseur de cette France-là, « antirévolutionnaire », antisémite.
On fait son devoir en 1939. On est prisonnier, on s'évade comme un bon patriote. On retrouve ses amis cagoulards à Vichy. On y exerce des fonctions officielles. On ne prête pas attention aux lois antisémites. C'est le prolongement naturel de la Révolution nationale.
On est décoré de la francisque par Pétain. Et on a pour ami le secrétaire général de la police, Bousquet, qui organise les rafles antisémites de Paris et fera déporter la petite-fille d'Alfred Dreyfus.
On est resté un beau jeune homme aux mains pures, et quand, en 1943, le vent aura tourné, poussant l'Allemagne vers la défaite, on s'engagera contre elle dans la Résistance.
On pourrait s'appeler François Mitterrand, futur président socialiste de la République.
Jamais d'ailleurs on n'a été pronazi ni même pro-allemand. On a été partisan d'une certaine France, celle du maréchal Pétain, de la Révolution nationale, qui voit bientôt naître un Service d'ordre légionnaire, noyau de la future Milice, force de police, de répression et de maintien de l'ordre aux uniformes noirs, imitation malingre de la milice fasciste, des SA et des SS nazis.
On n'a pas été choqué quand, le 24 octobre 1940, à Montoire, Pétain a serré la main de Hitler et déclaré : « J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. »
On écoute d'autant plus cette voix qui prêche pour une « Europe nouvelle » continentale – Drieu la Rochelle le faisait dès les années 30 – que les événements ont ravivé le vieux fonds d'anglophobie d'une partie des élites françaises.
Il y a eu l'évacuation du réduit de Dunkerque, où les Anglais ont d'abord embarqué les leurs.
Il y a eu surtout, le 3 juillet 1940, l'attaque de la flotte française en rade de Mers el-Kébir par une escadre anglaise : 1 300 marins français tués, l'indignation de toute la France contre cette agression vécue comme une trahison, alors qu'elle n'était pour les Anglais qu'une mesure de précaution contre un pays qui, contrairement à ses engagements, venait de signer un armistice séparé. Et qu'allait devenir cette flotte ? Un butin pour les Allemands ?
Mais le ressentiment français est grand. Et les cadres de la marine (l'amiral Darlan) sont farouchement antianglais.
Le ressentiment vichyste est alimenté chaque jour par la présence à Londres du général de Gaulle, la reconnaissance par Churchill de la représentativité de cette « France libre » qui s'adresse par la radio au peuple français – « Ici Londres, des Français parlent aux Français » –, l'incitant à la résistance.
Il y a en effet des Français qui résistent et qui veulent exprimer et incarner les vertus propres à l'âme de la France.
Car le patriotisme d'une vieille nation survit au naufrage de la défaite. Il est si profondément ancré dans le cœur des citoyens qu'il est présent jusque chez ceux qui « collaborent » ou s'enrôlent dans la Milice ou dans la légion des volontaires français pour défendre – sous l'uniforme allemand – l'Europe contre le bolchevisme.
C'est un patriotisme « dévoyé », criminel, mais même chez un Joseph Darnand – chef de la Milice, héros des guerres de 14-18 et de 39-40 –, il est perceptible.
Et on peut en créditer, sans que cela leur tienne lieu de justification ou d'excuse, bien des serviteurs de l'État français qui côtoient cependant à Vichy des aigrefins, des cyniques, des ambitieux sordides, des politiciens aigris et ratés, voire des fanatiques, journalistes, écrivains, que la passion antisémite obsède.
Mais la pierre de touche du patriotisme véritable et rigoureux, c'est le refus de l'occupation du sol de la nation et l'engagement dans la lutte pour lui rendre indépendance et souveraineté.
Ce patriotisme-là, il ne se calcule pas, il est instinctif.
L'ennemi occupe la France, il faut l'en chasser. C'est nécessaire. Donc il faut engager le combat.
Dès juin 1940, de jeunes officiers (Messmer), des fonctionnaires (Jean Moulin), des anonymes, des chrétiens (Edmond Michelet), des philosophes (Cavaillès) refusent de cesser le combat, rejettent l'armistice. Ils gagnent Londres, puisque là-bas on continue la lutte.
Ils éditent des tracts, des journaux clandestins qui appellent à la résistance, et certains effectuent pour les Anglais des missions de renseignement.
Ainsi, la défaite fait coexister plusieurs France durant les deux premières années (1940-novembre 1942) de l'Occupation.
Il y a les départements qui échappent à toute autorité française : annexés à l'Allemagne, ou rattachés à la Belgique, ou constituant une zone interdite.
Il y a la zone occupée, de la frontière des Pyrénées à Chambéry en passant par Moulins.
Il y a la « zone libre », l'État français, dont la capitale est Vichy.
Et puis il y a la France libre de Charles de Gaulle, qui, à partir de juillet 1942, s'intitulera France combattante. Elle a commencé à rassembler autour d'elle la France de la Résistance intérieure.
De nombreux mouvements clandestins se sont en effet constitués : Combat, Libération, Franc-Tireur, Défense de la France.
À compter du 22 juin 1941, jour de l'attaque allemande contre l'URSS, les communistes se lancent enfin à leur tour dans la Résistance et en deviennent l'une des principales composantes, engageant leurs militants dans l'action armée – attentats, attaques de militaires allemands, etc.
Le STO, à partir de l'année 1943, provoquera la création de maquis, l'apparition d'une autre France, celle des réfractaires.
Mais les divisions idéologiques, les divergences portant sur les modes d'action, les rivalités personnelles ou de groupe, caractérisent aussi bien cette Résistance que la France libre, les zones occupées ou l'État de Vichy.
La défaite a encore aggravé la fragmentation politique, les oppositions, comme si la France était plus que jamais incapable de se rassembler, comme si la division, cette maladie endémique de l'histoire nationale, était devenue plus aiguë que jamais, symptôme de la gravité du traumatisme subi par la nation.
À Londres, de Gaulle ne regroupe durant les premiers mois que quelques milliers d'hommes. Et il y a déjà, au sein de la France libre, des « antigaullistes ».
Lorsqu'il tente la reconquête des colonies d'Afrique noire, les Français vichystes de Dakar font échouer l'entreprise (septembre-octobre 1940). Elle réussit en Afrique-Équatoriale avec Leclerc de Hauteclocque. Peu à peu se constituent des Forces françaises libres, qui compteront, en 1942, près de soixante-dix mille hommes.
Mais la « guerre civile » menace toujours : en Syrie, en 1941, les troupes fidèles à Vichy affrontent les « gaullistes ».
À Vichy, autour du Maréchal – dont l'esprit, dit-on, n'est éveillé, et la lucidité, réelle, qu'une heure par jour ! –, les querelles et les ambitions s'ajoutent aux choix politiques différents.
Pierre Laval, président du Conseil, est renvoyé par Pétain en décembre 1940, puis son retour est imposé (en avril 1942) par les Allemands, qui, en fait, sont les maîtres. Peut-être pour s'assurer encore mieux de leur soutien, Laval déclare : « Je souhaite la victoire de l'Allemagne. »
À Paris, Marcel Déat et Jacques Doriot dirigent, l'un le Rassemblement national populaire, l'autre, le Parti populaire français.
Ils incarnent une collaboration idéologique qui critique la « modération » de Vichy et souhaite une « fascisation du régime ».
Une partie de la pègre, contrôlée par les Allemands, s'est mise au service des nazis pour traquer les résistants, les torturer, dénoncer et spolier les Juifs. Elle bénéficie d'une totale impunité, associant vol, trafic, marché noir, pillage et répression.
La collaboration a ce visage d'assassins.
Mais la Résistance est elle aussi divisée sur les modalités d'action comme sur les projets politiques.
L'entrée des communistes et leur volonté de « tuer » l'ennemi sans se soucier des exécutions d'otages sont critiquées par certains mouvements de résistance, et même par le général de Gaulle.
On s'oppose aussi sur les rapports entre la Résistance intérieure et la France libre. De Gaulle n'aurait-il pas les ambitions d'un « dictateur » ?
D'autres sont hostiles à la représentation des partis politiques au sein de la Résistance, puisque ces partis sont estimés responsables de la défaite par nombre de résistants, alors même que Vichy a fait arrêter, afin de les juger, Blum, Daladier et Reynaud. Mais le procès, amorcé à Riom, tourne à la confusion de Vichy et sera donc interrompu.
On s'interroge même sur les relations qu'il convient d'avoir avec Vichy et avec l'armée de l'armistice. Certains résistants nouent là des liens ambigus, sensibles qu'ils sont à l'idéologie de l'État français.
Ainsi, les cadres de Vichy formés dans l'école d'Uriage sont à la fois des partisans de la Révolution nationale et des patriotes antiallemands.
C'est en fait la question du futur régime de la nation, une fois qu'elle aura été libérée, qui est déjà posée.
On craint une prise de pouvoir par les communistes, ou le retour aux jeux politiciens de la IIIe République, ou le pouvoir personnel de De Gaulle ; on espère une « rénovation » des institutions, des avancées démocratiques et sociales prenant parfois la forme d'une authentique révolution.
Mais ces oppositions, ces conflits, cette guerre civile larvée, ne concernent en fait qu'une minorité de Français.
Le peuple survit et souffre, « s'arrange » avec les cartes de rationnement, le « marché noir », les restrictions de toute sorte.
Il continue de penser – surtout en zone libre – que Pétain le protège du pire.
L'entrée en guerre de l'URSS (22 juin 1941), puis des États-Unis (7 décembre 1941), la résistance anglaise, l'échec allemand devant Moscou (décembre 1941), le confirment dans l'idée que le IIIe Reich ne peut gagner la guerre.
Qu'un jour, donc, la France sera libérée.
On commence à souffrir à partir de 1942 des bombardements anglais et américains (qui deviendront presque quotidiens en 1944). Ils provoquent des milliers de victimes, mais on est favorable aux Alliés. On attend leur « débarquement ». On écoute la radio anglaise et de Gaulle.
On imagine même qu'entre la France libre et la France de Vichy il y aurait un partage des tâches : Pétain protège, de Gaulle combat.
La figure de De Gaulle conquiert ainsi, au fil de ces mois, une dimension héroïque et presque mythologique.
Les exploits des Forces françaises libres – Bir Hakeim, en mai 1942 – sont connus. On ignore en revanche les conflits qui opposent les Américains à de Gaulle.
On désire l'unité de la nation.
Et de Gaulle comprend que, s'il veut s'imposer aux Anglo-Américains, il lui faut rassembler autour de lui toute la Résistance intérieure, unir les Forces françaises libres et les résistants.
La tâche qu'il confie à Jean Moulin est donc décisive : il s'agit d'unifier la Résistance et de lui faire reconnaître l'autorité de De Gaulle. Ce qui assurera, face aux Alliés, la représentativité et la prééminence du Général, adoubé par toutes les forces françaises combattantes, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la France.
Mais, à la fin de 1942, si l'Allemagne engagée dans la bataille de Stalingrad a potentiellement perdu la guerre, rien n'est joué pour la France.
Réussira-t-elle à recouvrer sa souveraineté et son indépendance, donc sa puissance, sa place en Europe et dans le monde ?
Tel a été, dès juillet 1940, le projet de De Gaulle, qui s'est fixé pour objectif de faire asseoir la France « à la table des vainqueurs ».
Mais les États-Unis de Roosevelt ne le souhaitent pas.
De Gaulle est pour eux un personnage incontrôlable, parce que trop indépendant. Or, selon leurs plans, la France cesse d'être une grande puissance. Ils envisagent même de la démembrer et de lui arracher son empire colonial.
Ils n'ont pas même prévenu de Gaulle de leur débarquement en Afrique du Nord française, le 8 novembre 1942.
Ils veulent l'éliminer de l'avenir politique français.
Une nouvelle partie décisive vient de s'engager pour de Gaulle, et donc pour la France.
63.
En ce début du mois de novembre 1942, alors que les barges de débarquement américaines s'approchent des côtes de l'Algérie et du Maroc, le sort de la France est sur le fil du rasoir.
Quel sera son régime alors que la victoire des Alliés sur l'Allemagne est annoncée, même si personne ne peut encore savoir quand elle interviendra ?
Cette incertitude planant sur l'avenir de la nation ne sera pas levée avant le mois d'août 1944, quand Paris prendra les armes, dressera ses barricades, retrouvant le fil de l'histoire, associant les élans et les formes révolutionnaires à l'insurrection nationale.
Mais, jusque-là, tout demeure possible.
La donne internationale change.
Les États-Unis ont pris le pas sur le Royaume-Uni, Roosevelt, sur Churchill.
« De Gaulle est peut-être un honnête homme, écrira le 8 mai 1943 le président des États-Unis au Premier ministre britannique, mais il est en proie au complexe messianique... Je ne sais qu'en faire. Peut-être voudriez-vous le nommer gouverneur de Madagascar ? »
En fait, c'est aux rapports de forces en Europe que pensent Roosevelt et Churchill, et, au fur et à mesure que la menace nazie s'affaiblit – bientôt, on le sait, elle disparaîtra –, au danger croissant que représente l'URSS.
La confrontation avec le communisme a été cachée sous la grande alliance contre l'Allemagne. Mieux valait s'allier avec Staline que se soumettre à Hitler. Mais l'opposition entre les démocraties et l'Union soviétique refait surface et commence même à envahir les esprits à la fin de 1942.
Dans cette perspective, peut-on faire confiance à de Gaulle ?
L'URSS a été parmi les premiers États à reconnaître la France libre.
De plus, le Parti communiste français et ses Francs-tireurs et partisans (FTP), ou encore la Main-d'œuvre immigrée (MOI), auteur des attentats les plus spectaculaires, jouent un rôle majeur dans la Résistance intérieure que de Gaulle entend rassembler autour de lui.
L'ancien préfet Jean Moulin, qu'il a chargé de cette tâche, est soupçonné par certains d'être un agent communiste.
Plus fondamentalement, il y a la tradition française d'alliance avec la Russie comme moyen d'accroître le poids de la France en Europe. Or cela n'apparaît souhaitable ni aux Américains ni aux Anglais.
Dès lors, ce qui s'esquisse en novembre 1942 – puis tout au long de l'année 1943 –, c'est une politique qui favoriserait le passage du gouvernement de Vichy de la collaboration avec l'Allemagne à l'acceptation du tutorat américain.
La continuité de l'État serait ainsi assurée, écartant les risques de troubles, de prise du pouvoir par les communistes et/ou de Gaulle.
Cette politique se met en place à l'occasion du débarquement américain en Afrique du Nord.
L'amiral Darlan – qui, en 1941, a ouvert aux Allemands les aéroports de Syrie, et qui est le numéro un du gouvernement après le renvoi de Laval – se trouve à Alger.
Les Américains le reconnaissent comme président, chef du Comité impérial français : mutation réussie d'un « collaborateur » de haut rang en rallié aux Américains.
« Ce qui se passe en Afrique du Nord du fait de Roosevelt est une ignominie, dira de Gaulle. L'effet sur la Résistance en France est désastreux. »
Les Américains poussent aussi le général Giraud à jouer les premiers rôles – en tant que rival de De Gaulle. Giraud s'est évadé d'Allemagne, c'est à la fois un adepte de la Révolution nationale, un fervent de Pétain et un anti-allemand.
Mais cet « arrangement », qui évite toute rupture politique entre l'occupation et la libération, et ferait de Vichy le gouvernement de la transition, la France changeant simplement de « maîtres », va échouer.
D'abord parce que les hommes de Vichy ne sont pas à la hauteur de ce dessein.
Au lieu de rejoindre Alger – il en aurait eu l'intention –, Pétain reste à Vichy alors même que la zone libre est occupée par les troupes allemandes le 11 novembre 1942.
L'armée de l'armistice n'ébauche pas même un simulacre de résistance.
La flotte – joyau de Vichy – se saborde à Toulon le 27 novembre. Cet acte est le symbole de l'impuissance de Vichy.
Darlan est assassiné le 24 décembre par un jeune monarchiste lié à certains gaullistes, Fernand Bonnier de La Chapelle. Et Giraud, soldat valeureux mais piètre politique, ne peut rivaliser avec de Gaulle, en dépit du soutien américain.
En fait, c'est l'âme de la France qui s'est rebellée contre cette tentative de la soumettre à une nouvelle sujétion.
Le patriotisme, la volonté de voir la nation recouvrer son indépendance et sa souveraineté, de retrouver sa fierté par le combat libérateur, le sentiment que l'histoire de la France lui dicte une conduite à la hauteur de son passé, qu'il faut effacer cette « étrange défaite », ce 1940 qui est un écho de 1815 et de 1870 – Pétain en Bazaine, et non plus le « chef vénéré » –, ont peu à peu gagné l'ensemble du pays.
Cela ne se traduit pas par un soulèvement général.
La Résistance représente à peine plus de 2 % de la population.
Mais ces FFI, ces FTPF, ces réfractaires, ces maquisards, ces « terroristes », ne sont pas seulement de plus en plus nombreux – le risque du travail obligatoire en Allemagne pousse les jeunes vers la clandestinité dans les villages, les maquis : leurs actions sont approuvées.
Les Allemands (la Gestapo) et les miliciens mènent des opérations de répression efficaces, mais, même s'ils remportent des succès – en juin 1943, arrestation à Calluire des chefs de la Résistance, dont Jean Moulin –, ils ne peuvent étouffer ce mouvement qui vient des profondeurs du pays.
Ce désir de voir renaître la France est si fort que, le 27 mai 1943, les représentants des différents mouvements et partis politiques créent – grâce à la ténacité de Jean Moulin, l'« unificateur » – le Conseil national de la Résistance.
Le CNR élabore un programme politique, économique et social qui le situe dans le droit fil de la République sociale et du Front populaire, par opposition aux principes de la Révolution nationale.
Le CNR reconnaît l'autorité du général de Gaulle, chef de la France combattante.
Dès lors, de Gaulle ne peut que l'emporter face à Giraud.
Il deviendra le président du Comité français de Libération nationale, créé le 3 juin 1943. Une Assemblée consultative provisoire est mise en place le 17 septembre 1943.
« C'est le début de la résurrection des institutions représentatives françaises », dit de Gaulle.
Une armée est reconstituée. Elle libérera la Corse en septembre 1943 – après la capitulation italienne du 8 septembre. Cent trente mille soldats (Algériens, Marocains, Européens d'Algérie) combattront en Italie. L'armée française comptera bientôt 500 000 hommes.
Pétain, Laval et leur gouvernement, dans une France entièrement occupée, ne sont plus que des ombres avec lesquelles jouent les Allemands.
Lorsqu'il tente de justifier sa politique, Laval déclare le 13 décembre 1942 : « C'est une guerre de religion que celle-ci. La victoire de l'Allemagne empêchera notre civilisation de sombrer dans le communisme. La victoire des Américains serait le triomphe des Juifs et du communisme. Quant à moi, j'ai choisi... Je renverserai impitoyablement tout ce qui, sur ma route, m'empêchera de sauver la France. »
Mais sa parole – sans doute sincère – ne peut être entendue. Elle se heurte à la réalité d'une occupation qui devient impitoyable.
Le 26 décembre, vingt-cinq Français sont exécutés à Rennes pour avoir fait sauter le siège de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme et le bureau de recrutement de travailleurs français pour l'Allemagne.
Qui peut croire au patriotisme de Laval ?
De Gaulle, au contraire, incarne la France qui a soif de renouveau, d'une République sociale, mais aussi l'ordre, le sens de l'État, le patriotisme qui rassemble toutes les tendances françaises.
Il est le symbole de l'union sacrée.
Cette réussite est due à la conjugaison d'un homme d'État exceptionnel, comme la nation en suscite quand elle est au fond de l'abîme, et du soutien des plus courageux des Français, sachant dépasser leurs divisions et leurs querelles gauloises.
Lui, de Gaulle, a foi en la France, porte un projet pour elle, fait preuve d'une volonté et d'une lucidité hors pair. Il est l'égal des plus grands dont les noms jalonnent l'histoire nationale. Eux, pour le temps du combat salvateur, le soutiennent. Et parce qu'ils sont ensemble, le chef charismatique et les citoyens dévoués à la patrie, rien ne peut leur résister.
Cependant, les Américains s'obstinent.
De Gaulle, chef légitime du Gouvernement provisoire de la République, n'est pas averti de la date et du jour du débarquement en France.
Des dispositions sont prises par les Alliés pour traiter la France en pays « occupé », administré par les autorités militaires. Sa monnaie est déjà imprimée par les Alliés.
La France « libérée » ne pourra recouvrer ni son indépendance ni sa souveraineté.
De Gaulle n'est autorisé à prendre pied en France que huit jours après le débarquement du 6 juin 1944.
Mais la France alors se soulève, payant cher le prix de cet élan (le Vercors, les Glières, tant d'autres combats et tant d'autres villes où sont exécutés des otages : pendus de Tulle, population massacrée d'Oradour-sur-Glane, etc.).
De Gaulle, le 6 juin, a lancé : « C'est la bataille de France, c'est la bataille de la France », et, replaçant ce moment dans la trajectoire nationale, il ajoute : « Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur ! »
Paris s'insurge le 19 août 1944.
Acte symbolique majeur : « Paris outragé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même avec le concours des armées de la France. »
La population a dressé des barricades – tradition des journées révolutionnaires.
Les combats sont sévères (3 000 tués, 7 000 blessés). Les chars de la 2e division blindée du général Leclerc – de Gaulle a dû arracher au commandement allié l'autorisation d'avancer vers Paris – et la démoralisation allemande permettent, le 25 août, d'obtenir la reddition de l'occupant.
Forces françaises de l'intérieur et Forces françaises libres sont donc associées dans cette « insurrection » victorieuse.
Les millions de Parisiens rassemblés le 26 août de l'Arc de triomphe à Notre-Dame, qui acclament de Gaulle, expriment l'âme de la France, lavée de la souillure de la défaite et des compromissions comme si elle voulait faire oublier ses lâchetés, sa passivité, son attentisme.
Ainsi le passé héroïque de Paris et de la nation est-il ressuscité par ces journées de combats.
« L'histoire ramassée dans ces pierres et dans ces places, dit de Gaulle, on dirait qu'elle nous sourit. »
Un témoin ajoute que de Gaulle, ce jour-là, semblait « sorti de la tapisserie de Bayeux ».
Quatre années noires, commencées en mai 1940, s'achèvent en ce mois d'août 1944.
Elles ont condensé dans toutes leurs oppositions, et même leurs haines, les tendances contradictoires de l'histoire de la France. Chaque Français, engagé dans les combats de ces années-là, les a vécus comme la continuation d'autres affrontements enfouis dans le tréfonds de la nation.
La Révolution nationale aura été une tentative, à l'occasion de la défaite, de revenir sur les choix que la nation avait faits avec Voltaire, puis la Révolution française. Il s'agissait de retrouver la « tradition » en l'adaptant aux circonstances du xxe siècle, en s'inspirant de Salazar, le dictateur portugais, de Franco et de Mussolini plus que de Hitler.
Mais c'était nier le cours majeur de l'histoire nationale, la spécificité de la France.
Et aussi la singularité de De Gaulle, homme de tradition, mais ouverte, celle-ci, et unifiant toute la nation, ne la divisant pas.
C'est parce que ce choix et ce projet correspondent à l'âme de la France qu'ils s'imposent en août 1944.
3
L'IMPUISSANCE RÉPUBLICAINE
1944-1958
64.
Combien de temps ceux qui parlent au nom de la France – de Gaulle, les représentants des partis politiques et des mouvements de résistance – resteront-ils unis ?
Dès août 1944, le regard qu'ils portent sur les « années noires » les oppose déjà.
Chacun veut s'approprier la gloire et l'héroïsme de la Résistance, masquer ainsi ses calculs, ses ambiguïtés, ses lâchetés et même ses trahisons.
Les communistes du PCF font silence sur la période août 1939-22 juin 1941, quand ils essayaient d'obtenir des autorités d'occupation le droit de faire reparaître leur journal L'Humanité. N'étaient-ils pas alors les fidèles servants de l'URSS, partenaire des nazis ?
En 1944-1945, alors que la guerre continue (Strasbourg sera libéré le 23 novembre 1944, les troupes de Leclerc entrent à Berchtesgaden le 4 mai 1945, la capitulation allemande intervient le 8 mai et le général de Lattre de Tassigny est présent aux côtés des Américains, des Russes et des Anglais : victoire diplomatique à forte charge symbolique), les communistes se proclament le « parti des fusillés » – 75 000 héros de la Résistance, précise Maurice Thorez, déserteur rentré amnistié de Moscou et bientôt ministre d'État.
Le tribunal de Nuremberg dénombrera 30 000 exécutés.
Ce qui se joue, c'est la place des forces politiques dans la France qui recouvre son indépendance. Le comportement des hommes et des partis durant l'Occupation sert de discriminant. On réclame l'épuration et la condamnation des traîtres, des « collabos », avec d'autant plus d'acharnement qu'on ne s'est soi-même engagé dans la Résistance que tardivement.
La magistrature, qui a tout entière – à un juge près ! – prêté serment à Pétain et poursuivi les résistants, condamne maintenant les « collabos ».
On fusille (Laval), on commue la peine de mort de Pétain en prison à vie. Il y a, durant quelques semaines, l'esquisse d'une justice populaire, expéditive, comme l'écho très atténué des jours de violence qui marquèrent jadis les guerres de Religion ou la Révolution, qui tachent de sang l'histoire nationale. Les passions françaises resurgissent.
En 1944, vingt mille femmes, dénoncées, accusées de complaisances envers l'ennemi, sont tondues, promenées nues, insultées, battues, maculées.
Des miliciens et des « collabos » sont fusillés sans jugement. On dénombre peut-être dix mille victimes de ces exécutions sommaires.
Dans le milieu littéraire, le Comité national des écrivains met à l'index, épure, sous la houlette d'Aragon.
Robert Brasillach est condamné à mort et de Gaulle refuse de le gracier malgré les appels à la clémence de François Mauriac.
Drieu la Rochelle se suicidera, prenant acte de la défaite de ses idées, de l'échec de ses engagements.
Jean Paulhan – un résistant – critiquera, dans sa Lettre aux directeurs de la Résistance, ces communistes devenus épurateurs, qui n'étaient que des « collaborateurs » d'une espèce différente : « Ils avaient fait choix d'une autre collaboration. Ils ne voulaient pas du tout s'entendre avec l'Allemagne, non, ils voulaient s'entendre avec la Russie. »
C'est bien la question de la Russie soviétique et des communistes qui, en fait, domine la scène française.
Ceux-ci représentent en 1945 près de 27 % des voix, et vont encore progresser.
Avec les socialistes (SFIO) – 24 % des voix –, ils disposent de la majorité absolue à l'Assemblée constituante élue le 21 octobre 1945.
Mais les socialistes préfèrent associer au gouvernement le Mouvement républicain populaire (MRP, 25,6 % des voix), issu de la Résistance et d'inspiration démocrate-chrétienne.
Ainsi se met en place un « gouvernement des partis » : d'abord tripartisme (MRP, SFIO, PCF) puis « Troisième Force » quand le PCF sera écarté du pouvoir à partir de 1947.
En 1944-1945, c'est encore l'union, mais déjà pleine de tensions.
De la résistance victorieuse, passera-t-on à la révolution ?
En août 1944, un Albert Camus le souhaitera. Mais la révolution, est-ce abandonner le pouvoir aux mains des communistes ?
Le risque existe : des milices patriotiques en armes, contrôlées par ces derniers, sont présentes dans de nombreux départements.
Le Front national, le Mouvement de libération nationale, sont des « organisations de masse » dépendantes en fait du PCF.
On peut craindre une subversion, voire une guerre civile, en tout cas une paralysie de l'État républicain soumis au chantage communiste.
La première bataille à conduire doit donc avoir pour but d'affirmer la continuité de la République et de l'État.
De Gaulle s'y emploie en déclarant aux membres du CNR qui lui demandent de proclamer la République, le 26 août 1944 : « La République n'a jamais cessé d'être... Vichy fut toujours nul et non avenu. Moi-même, je suis président du gouvernement de la République. Pourquoi vais-je la proclamer ? »
Attitude radicale et lourde de sens.
Si Vichy a « été nul et non avenu », sans légitimité, les lois qu'il a promulguées, les actes qu'il a exécutés, n'ont aucune valeur légale. Ils n'engagent en rien la France.
Les lois antisémites, la rafle des 16 et 17 juillet 1942, ne peuvent être imputées à la nation.
La France n'a pas à faire repentance. Ce sont des individus – Pétain, Laval, Darnand, Bousquet… – qui doivent répondre de leurs actes criminels, et non la France.
La France et la République étaient incarnées par de Gaulle, la France libre et le Conseil national de la Résistance.
Les vilenies, les lâchetés et les trahisons sont rapportées à des individus, non à la nation.
L'âme de la France ne saurait être entachée par les crimes de Vichy.
Pirouette hypocrite ?
Décision raisonnée pour que le socle sur lequel est bâtie la nation, qui doit beaucoup au regard que l'on porte sur son histoire, ne soit pas fissuré, brisé, corrodé.
Mais, dans cette France dont l'histoire ne saurait être ternie, en sorte qu'on puisse continuer à l'aimer et donc à se battre pour elle, à assurer son avenir, l'État ne peut être affaibli.
Or la principale menace vient des communistes, adossés à l'URSS, dont l'ombre s'étend sur l'Europe.
Ils sont forts de leur engagement dans la Résistance – fût-il tardif et plein d'arrière-pensées –, des « organisations de masse » qu'ils contrôlent et de leur poids électoral. De Gaulle, dont la personnalité et l'action, en 1944, ne peuvent être contestées, exige et obtient le désarmement des milices patriotiques, l'enrôlement des résistants dans l'armée régulière, le rétablissement des autorités étatiques (préfets, etc.). Il refuse aux communistes les postes gouvernementaux clés – Affaires étrangères, Intérieur, Armées – et met sa démission en jeu pour imposer cette décision.
En même temps, il applique le programme économique et social du CNR, et répète que « l'intérêt privé doit céder à l'intérêt général ».
Les nationalisations – des houillères, de l'électricité, des banques –, la création des comités d'entreprise, sont les bases d'une « République sociale » dans le droit fil des mesures prises par le gouvernement de Front populaire, mais en même temps relèvent de la tradition interventionniste de l'État dans la vie économique, inscrite dans la longue durée de l'histoire nationale, de François Ier à Louis XIV, de la Révolution aux premier et second Empires.
La France de 1944-1946 retrouve ainsi les éléments de son histoire que la collaboration avait – mais non sur tous les plans – voulu effacer, s'affirmant comme l'expression d'une autre tradition : non pas 1936, mais 1934, non plus l'édit de Nantes, mais la Saint-Barthélemy ; non plus la Ligue des droits de l'homme et les dreyfusards, mais la Ligue des patriotes et les antidreyfusards.
Cette « restauration » de l'État centralisé, issu de la monarchie absolue, mais aussi des Jacobins et des Empires napoléoniens, se retrouve dans la politique extérieure.
Il s'agit d'assurer à la France sa place dans le concert des Grands.
De Gaulle a réussi à imposer la présence d'un général français à la signature de l'acte de capitulation allemande.
Il obtient une zone d'occupation française en Allemagne, à l'égal de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de l'URSS.
Avec cette dernière, il a signé un traité d'amitié (décembre 1944), manière d'affirmer l'indépendance diplomatique de la France alors que s'annonce la politique des blocs.
En même temps, la France reçoit un siège permanent – avec droit de veto – au Conseil de sécurité de l'Organisation des nations unies. Paris est choisi comme siège de l'Unesco. La France a ainsi retrouvé son rang de grande puissance, et quand on se remémore l'effondrement total de 1940 on mesure l'exceptionnel redressement accompli.
Le fait que la France ait été capable, dans la dernière année de la guerre, de mobiliser plusieurs centaines de milliers d'hommes (500 000) engagés dans les combats en Italie et sur le Rhin, puis en Allemagne, a été la preuve de la reconstitution rapide de l'État national et a favorisé la réadmission de la France parmi les grandes puissances.
Elle est l'un des vainqueurs.
Le plus faible, certes, le plus blessé en profondeur, celui qui commence déjà à subir en Indochine et en Algérie – à Sétif, le 8 mai 1945 – les revendications d'indépendance des nationalistes des colonies.
Mais elle peut à nouveau faire entendre sa voix, envisager une entente avec l'Allemagne.
Depuis 1870, entre les deux nations, c'est une alternance de défaites et de revanches : 1870, effacé par la victoire de 1918 ; celle-ci gommée par l'étrange défaite de 1940, annulée à son tour par la capitulation allemande de 1945. Se rendant cette année-là à Mayence, de Gaulle, face à cet affrontement toujours renouvelé et stérile entre « Germains et Gaulois », peut dire :
« Ici, tant que nous sommes, nous sortons de la même race. Vous êtes, comme nous, des enfants de l'Occident et de l'Europe. »
Ces constats ne peuvent devenir les fondations d'une politique étrangère nouvelle que si le régime échappe aux faiblesses institutionnelles qui ont caractérisé la IIIe République.
Ainsi se pose à la France, dès la fin de 1944, la question de sa Constitution.
De Gaulle a obtenu par référendum, contre tous les partis, que l'Assemblée élue le 21 octobre 1944 soit constituante.
Mais, dès les premiers débats, les partis politiques choisissent de soumettre le pouvoir exécutif au pouvoir parlementaire, le président de la République se trouvant ainsi réduit à une fonction de représentation.
On peut prévoir que les maux de la IIIe République – instabilité gouvernementale, jeux des partis, méfiance à l'égard de la consultation directe des électeurs par référendum – paralyseront de nouveau le régime, le réduisant à l'impuissance.
De Gaulle tire la conséquence de cet état de fait et démissionne le 20 janvier 1946 en demandant « aux partis d'assumer leurs responsabilités ».
C'est la fin de l'unité nationale issue de la Résistance. Dès le 16 juin 1946, le Général se présente comme le « recours » contre la trop prévisible impotence de la IVe République qui commence.
La France unie a donc été capable de restaurer l'État, de reprendre sa place dans le monde. Mais les facteurs de division issus de son histoire, avivés par la conjoncture internationale (la guerre froide s'annonce, isolant les communistes, liés perinde ac cadaver à l'URSS), font éclater l'union fragile des forces politiques. Les partis veulent être maîtres du jeu comme sous la IIIe République. L'exécutif leur est soumis. Il ne peut prendre les décisions qui s'imposent alors que, dans l'empire colonial, se lèvent les orages.
65.
De 1946 à 1958, durant la courte durée de vie de la IVe République, la France change en profondeur. Mais le visage politique du pays s'est à peine modifié. Le président du Conseil subit la loi implacable de l'Assemblée nationale. Il lui faut obtenir une investiture personnelle, puis, une fois le gouvernement constitué, il doit solliciter à nouveau un vote de confiance des députés.
L'Assemblée est donc toute-puissante, et le Conseil de la République (la deuxième chambre, qui a remplacé le Sénat) n'émet qu'un vote consultatif.
Dès lors, comme dans les années 30, l'instabilité gouvernementale est la règle. Chaque député influent espère chevaucher le manège ministériel. Mais ce sont le plus souvent les mêmes hommes qui se succèdent, changeant de portefeuilles.
Ces gouvernements, composés conformément aux règles constitutionnelles, sont parfaitement légaux. Mais, question cardinale, sont-ils légitimes ? Quel est le rapport entre le « pays légal » et le « pays réel » ?
Il n'est pas nécessaire d'être un disciple de Maurras pour constater le fossé qui se creuse entre les élites politiques et le peuple qu'elles sont censées représenter et au nom duquel elles gouvernent.
Cette fracture, si souvent constatée dans l'histoire nationale, s'élargit jour après jour, crise après crise, entre 1946 et 1954, année qui représentera, avec le début de l'insurrection en Algérie, un tournant aigu après lequel tout s'accélère jusqu'à l'effondrement du régime, en mai 1958.
La discordance entre gouvernants et gouvernés est d'autant plus nette que le pays et le monde ont, pendant cette décennie, été bouleversés par des changements politiques, technologiques, économiques et sociaux.
À partir de 1947, la guerre froide a coupé l'Europe en deux blocs. Les nations de l'Est sont sous la botte russe.
Le « coup de Prague » en 1948, le blocus de Berlin par les Russes, la division de l'Allemagne en deux États, la guerre de Corée en 1950, la création du Kominform en 1947, de l'OTAN en 1949, auquel répondra le pacte de Varsovie, le triomphe des communistes chinois (1949), tous ces événements ont des conséquences majeures sur la vie politique française.
Le 4 mai 1947, les communistes sont chassés du gouvernement. L'anticommunisme devient le ciment des majorités qui se constituent et n'existent que grâce à une modification de la loi électorale qui, par le jeu des « apparentements », rogne la représentation parlementaire communiste.
Le PCF ne perd pas de voix, au contraire, mais il perd des sièges. En 1951, avec 26 % des voix, il a le même nombre de députés que les socialistes, qui n'en rassemblent que 15 % !
La « troisième force » (SFIO, MRP et députés indépendants à droite) est évidemment légale, mais non représentative du pays.
Elle l'est d'autant moins qu'autour du général de Gaulle s'est créé en 1947 le Rassemblement du peuple français (RPF), qui va obtenir jusqu'à 36 % des voix.
De Gaulle conteste les institutions de la IVe République, « un système absurde et périmé » qui entretient la division du pays alors qu'il faudrait retrouver « les fécondes grandeurs d'une nation libre sous l'égide d'un État fort ».
Même s'il dénonce les communistes, qui « ont fait vœu d'obéissance aux ordres d'une entreprise étrangère de domination », de Gaulle est considéré par les partis de la « troisième force » comme un « général factieux », et Blum dira : « L'entreprise gaulliste n'a plus rien de républicain. »
En fait, l'opposition entre les partis de la « troisième force » et le mouvement gaulliste va bien au-delà de la question institutionnelle. Certes, inscrites dans la tradition républicaine, il y a le refus et la crainte du « pouvoir personnel », le souvenir des Bonaparte, du maréchal de Mac-Mahon, et même du général Boulanger, la condamnation de l'idée d'« État fort ». L'épisode récent du gouvernement Pétain – encore un militaire ! – a renforcé cette allergie.
La République, ce sont les partis démocratiques qui la font vivre. L'autorité d'un président de la République disposant d'un vrai pouvoir est, selon eux, antinomique avec le fonctionnement républicain.
Mais, en outre, le « gaullisme » est ressenti comme une forme de nationalisme qui conduit au jeu libre et indépendant d'une France souveraine.
Or, la « troisième force », c'est la mise en œuvre de limitations apportées à la souveraineté nationale, la construction d'une Europe libre sous protection américaine (l'OTAN).
La Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) est constituée en 1951. Elle doit être le noyau d'une Europe politique de six États membres, et doit déboucher sur une Communauté européenne de défense (CED) dans laquelle l'Allemagne sera présente et donc réarmée.
L'homme qui, par ses idées, sa détermination, son entregent et son activisme diplomatique, est la cheville ouvrière de cette politique européenne a nom Jean Monnet.
Dès 1940, il s'est opposé au général de Gaulle. À chaque étape de l'histoire de la France libre, il a tenté de faire prévaloir les points de vue américains, pesant à Washington pour qu'on écarte de Gaulle et nouant des intrigues à Alger, en 1942-1943, pour parvenir à ce but.
Or il est le grand ordonnateur de cette politique européenne qui trouve sa source dans la volonté d'en finir avec les guerres « civiles » européennes – et donc de parvenir à la réconciliation franco-allemande –, mais ambitionne d'être ainsi un élément de la politique américaine de containment de l'Union soviétique, ce qui implique la soumission des États nationaux fondus dans une structure européenne orientée par les États-Unis.
Sur ce point capital, la « troisième force » dénonce la convergence entre communistes et gaullistes hostiles à l'Europe supranationale. Elle se présente comme l'expression d'une politique démocratique opposée aux « extrêmes » qu'elle combat.
Le général de Gaulle se trouve ainsi censuré, puisqu'il est devenu le chef du RPF.
Quant aux communistes et au syndicat CGT qu'ils contrôlent, leurs manifestations sont souvent interdites, dispersées, suivies d'arrestations.
Les grèves du printemps 1947 – prétexte à l'éviction des communistes du gouvernement –, puis celles, quasi insurrectionnelles, de 1948 sont brisées par un ministre de l'Intérieur socialiste, Jules Moch, qui n'hésite pas à faire appel à l'armée.
En 1952, les manifestations antiaméricaines du 28 mai pour protester contre la nomination à la tête de l'OTAN du général Ridgway, qui a commandé en Corée, donnent lieu à de violents affrontements ; des dirigeants communistes sont arrêtés.
Mais, face à ces ennemis « de l'intérieur », le système politique tient. En 1953, le RPF ne recueille plus que 15 % des voix. Ses députés sont attirés par le manège ministériel, et de Gaulle continue sa « traversée du désert » en rédigeant ses Mémoires à la Boisserie, sa demeure de Colombey-les-Deux-Églises.
Si les oppositions au « système » ne réussissent pas à le renverser, c'est que, de 1946 à 1954, le fait qu'il soit « absurde et périmé » (selon de Gaulle) ne perturbe pas le mouvement de la société.
Car si la vie politique ressemble de plus en plus à celle des années 30 et 40 – instabilité gouvernementale, scandales, « manège ministériel » –, le pays, lui, subit des bouleversements profonds que le système politique ne freine pas, mais tend même à favoriser.
C'est la période des « Trente Glorieuses », de la modernisation économique du pays, de la révolution agricole, qui transforme la société française par la multiplication des activités industrielles et du nombre des ouvriers, l'exode rural, la croissance de la population urbaine.
Cette période est certes traversée de mouvements sociaux – grèves en 1953, par exemple, dans la fonction publique pour les salaires –, du mécontentement de catégories que l'évolution marginalise – artisans, petits commerçants –, sensibles aux discours antiparlementaires d'un Pierre Poujade.
On proteste contre le poids des impôts. Mais, dans le même temps, Antoine Pinay, président du Conseil et ministre des Finances, rassure par sa politique budgétaire, la stabilisation du franc. Le niveau de vie des Français croît.
La voiture, l'électroménager, la vie urbaine, modifient les comportements. Une France différente apparaît. Les mœurs changent. Les femmes ont le droit de vote, elles travaillent. Et un véritable baby-boom – préparé par les mesures natalistes de Paul Reynaud en 1938, puis de Vichy – marque ces années 1946-1954 et confirme la vitalité de la nation. L'« étrange défaite » ne l'a pas terrassée.
Cet après-guerre illustre ainsi la capacité qu'à toujours eue la France, au long de son histoire, à basculer dans les abîmes, à connaître les débâcles, à sembler définitivement perdue parce que divisée, dressée contre elle-même, envahie, « outragée », puis à se ressaisir, renaître tout à coup et reprendre sa place parmi les plus grands.
Autre caractéristique de l'histoire nationale : les crises qui mettent en cause l'âme du pays sont celles qui associent les maladies internes du système politique et les traumatismes nés de la confrontation avec le monde extérieur.
C'est presque toujours dans ses rapports avec les « autres » que la France risque de se briser. Comme si, trop narcissique, trop enfermée dans son hexagone, trop persuadée de sa prééminence, elle pensait depuis toujours qu'elle l'emporterait sur ceux qui osent la défier.
Simplement parce qu'elle est la France.
Cette France « que la Providence a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires [...] n'est réellement elle-même qu'au premier rang... La France ne peut être la France sans la grandeur » (de Gaulle).
Elle ne « voit » pas les autres tels qu'ils sont, y compris ceux qui participent, quoique différents et éloignés de la métropole, à l'Union française, nom donné par la IVe République à l'empire colonial.
C'est sur ce terrain que le système politique va affronter les crises les plus graves.
Le jeu politicien, qui peut être le moyen de régler avec habileté une crise sociale – on élargit sa majorité, on renverse un président du Conseil, on accorde quelques satisfactions aux syndicats –, ne suffit plus.
C'est d'insurrection nationale – et communiste – qu'il s'agit, en 1946, en Indochine. Paris a réagi en faisant bombarder Haiphong.
L'année suivante, la rébellion de Madagascar est noyée dans le sang, comme l'a été, le 8 mai 1945, l'émeute algérienne de Sétif.
Or ces répressions ne résolvent pas le problème posé.
Et le système, prisonnier de ses indécisions, va conduire, de 1946 à 1954, une « sale guerre » en Indochine, ponctuée de défaites, de scandales, de protestations – « Paix en Indochine ! » crieront les communistes.
Des milliers de soldats et d'officiers tombent dans les rizières.
À partir de 1949, la victoire communiste en Chine apporte au Viêt-minh une aide en matériel qui rend encore plus précaire la situation des troupes françaises.
Les chefs militaires jugent que le « système » refuse de leur donner les moyens de vaincre. Le 7 mai 1954, lorsqu'il sont défaits à Diên Biên Phu, dans une bataille « classique », ils le ressentent douloureusement et mettent en cause le régime. Cette défaite ébranle la IVe République.
Pierre Mendès France, combattant de la France libre, radical courageux, est investi le 18 juin 1954. Président du Conseil, il veut incarner, porté par un mouvement d'opinion, une « République moderne » apte à rénover le pays et dont le chef soit capable de prendre des décisions.
C'est un nouveau style politique qui apparaît avec « PMF ».
Il cherche le contact direct avec l'opinion. Un journal est lancé – L'Express – pour le soutenir.
L'homme, vertueux, récuse le soutien des députés communistes. Il ne veut pas des voix des « séparatistes ».
Le 20 juillet 1954, il signe un accord de paix avec le Viêt-minh sur la base de la division provisoire de l'Indochine à hauteur du 17e parallèle. Après ce succès, Mendès France évoque à Carthage un nouveau statut pour la Tunisie.
Pour les uns, la « droite conservatrice », il est celui qui « brade » l'empire.
Pour les autres, la gauche réformatrice et certains gaullistes, il est l'homme politique qui peut rénover la République.
Mais, dans le cadre des institutions existantes, il est à la merci d'un changement de majorité, de la défection de quelques députés.
On lui reproche de ne pas s'être engagé dans la bataille à propos de la Communauté européenne de défense contre laquelle se sont ligués communistes, gaullistes et tous ceux qui sont hostiles au réarmement allemand.
La France rejette la CED le 30 août 1954. Une majorité de l'opinion a refusé d'entamer la souveraineté nationale en matière de défense.
La position de Pierre Mendès France est en outre fragilisée par les attentats qui se produisent en Algérie le 1er novembre 1954, et qui, par leur nombre, annoncent, quelques mois après la défaite de Diên Biên Phu, qu'un nouveau front s'est ouvert.
PMF déclare : « Les départements d'Algérie constituent une partie de la République française. Ils sont français depuis longtemps, et d'une manière irrévocable. »
Et son ministre François Mitterrand de préciser : « L'Algérie c'est la France ! »
Malgré ces déclarations martiales, Pierre Mendès France est renversé le 5 février 1955.
Au-delà même des désaccords politiques qu'on peut avoir avec le président du Conseil, il est dans la logique même du système de ne pas tolérer, à la tête de l'exécutif, une personnalité politique qui s'appuie sur l'opinion et peut ainsi contourner les députés. Le régime d'assemblée peut laisser un chef de gouvernement tenter de régler à ses risques et périls un problème brûlant, la guerre d'Indochine. Mais sa réussite même implique qu'il soit renvoyé pour ne pas attenter, par son autorité et son prestige, aux pouvoirs du Parlement.
Ce régime a besoin de médiocres. Il se défait des gouvernants trop populaires.
Or Pierre Mendès France l'était.
Mais ce système ne peut fonctionner et durer que si les crises qu'il affronte sont aussi « médiocres » que les hommes qu'il promeut. Or, le 1er novembre 1954, l'Algérie et la France ont commencé de vivre une tragédie.
66.
En une dizaine d'années, de 1945 à 1955, la France a repris le visage et la place d'une grande nation.
L'abîme de 1940 semble loin derrière elle, mais, sous ses pas qui se croient assurés, le sol s'ouvre à nouveau.
L'armée est humiliée après Diên Biên Phu.
Et voici qu'on s'apprête à abandonner Bizerte, la grande base militaire de la Méditerranée, parce qu'on accorde l'indépendance à la Tunisie.
On a agi de même au Maroc.
Or on commence déjà à égorger en Algérie. Un Front de libération nationale (FLN) s'est constitué. En août 1955, dans le Constantinois, il multiplie les attentats, les assassinats.
Va-t-on abandonner à son tour l'Algérie ?
Elle est composée de départements. On y dénombre, face à 8 400 000 musulmans, 980 000 Européens.
Les officiers, vaincus en Indochine, soupçonnent le pouvoir politique d'être prêt à une nouvelle capitulation, bien qu'il répète : « L'Algérie c'est la France. »
Le chef d'état-major des armées fera savoir au président de la République, René Coty, que « l'armée, d'une manière unanime, ressentirait comme un outrage l'abandon de ce patrimoine national. On ne saurait préjuger de sa réaction de désespoir. »
Ce message émane, au mois de mai 1958, du général Salan, commandant en chef en Algérie.
Si ce mois de mai 1958 marque le paroxysme de la crise, en fait, dès janvier 1955, tout est en place pour la tragédie algérienne.
Lorsqu'il publie un essai sous ce titre, en juin 1957, Raymond Aron a clairement identifié les termes du problème : la France ne dispose pas des moyens politiques, diplomatiques et moraux pour faire face victorieusement aux revendications nationalistes.
L'attitude de l'armée, l'angoisse des Français d'Algérie – les « pieds-noirs » –, l'impuissance du régime et le contexte international sont les ressorts de cette tragédie.
De Gaulle – toujours retiré à Colombey-les-Deux-Églises, mais l'immense succès du premier tome de ses Mémoires (L'Appel, 1954) montre bien que son prestige est inentamé – confie en 1957 :
« Notre pays ne supporte plus la faiblesse de ceux qui le dirigent. Le drame d'Algérie sera sans doute la cause d'un sursaut des meilleurs des Français. Il ne se passera pas longtemps avant qu'ils soient obligés de venir me chercher. »
Seuls quelques gaullistes engagés dans les jeux du pouvoir – Chaban-Delmas sera ministre de la Défense, Jacques Soustelle a été nommé par Pierre Mendès France, en janvier 1955, gouverneur général de l'Algérie – espèrent ce retour de De Gaulle et vont habilement en créer les conditions.
Mais la quasi-totalité des hommes politiques y sont, en 1955, résolument hostiles, persuadés qu'ils vont pouvoir faire face à la crise algérienne. Ils ne perçoivent ni sa gravité, ni l'usure du système, ni le mépris dans lequel les Français tiennent ce régime.
Il a fallu treize tours de scrutin pour que députés et sénateurs élisent le nouveau président de la République, René Coty !
Aux élections anticipées de janvier 1956, le Front républicain conduit par Pierre Mendès France l'emporte, mais c'est le leader de la SFIO, Guy Mollet, qui est investi comme président du Conseil.
Déception des électeurs, qui ont le sentiment d'avoir été privés de leur victoire. D'autant que Guy Mollet, qui se rend à Alger le 6 février 1958 afin d'y installer un nouveau gouverneur général – Soustelle a démissionné –, est l'objet de violentes manifestations européennes, et que le général Catroux, gouverneur désigné, renonce.
Cette capitulation du pouvoir politique devant l'émeute algéroise – soutenue à l'arrière-plan par les autorités militaires et administratives, et par tous ceux qui sont partisans de l'Algérie française – ferme la voie à toute négociation.
Elle ne laisse place qu'à l'emploi de la force armée contre des « rebelles » prêts à toutes les exactions au nom de la légitimité de leur combat.
Des populations qui ne rallient pas le FLN sont massacrées, des soldats français prisonniers, suppliciés et exécutés.
Ainsi l'engrenage de la cruauté se met-il en branle, et derrière le mot de « pacification » se cache une guerre sale : camps de regroupement, tortures afin de faire parler les détenus et de gagner la « bataille d'Alger » – printemps-été 1957 – par n'importe quel moyen et d'enrayer la vague d'attentats déclenchés par le FLN. Et « corvées de bois » – liquidation des prisonniers. On peut aussi administrer la mort dans les formes légales en guillotinant les « rebelles ».
C'est une plaie profonde, une sorte de gangrène qui atteint l'âme de la France.
Des écrivains – Mauriac, Malraux, Sartre, Pierre-Henri Simon –, des professeurs (Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant, Henri-Irénée Marrou) s'élèvent contre la pratique de la torture par l'armée française.
On les censure, on les poursuit, on les révoque.
Face à eux se dressent d'autres intellectuels, des officiers qui n'entendent pas subir une nouvelle défaite. Ils estiment qu'il faut, dans ce type d'affrontement, pratiquer une « guerre révolutionnaire » inéluctable si l'on veut éradiquer une guérilla, neutraliser les terroristes.
Le débat touche toute la nation à partir de 1956.
Le gouvernement Guy Mollet – qui obtient les pleins pouvoirs – rappelle plusieurs classes d'âge sous les drapeaux, envoie le contingent en Algérie, prolonge de fait le service militaire jusqu'à vingt-neuf mois. Deux millions de jeunes Français ont ainsi participé à cette guerre.
Des manifestations de « rappelés » tentent de bloquer les voies ferrées pour arrêter les trains qui les conduisent dans les ports d'embarquement.
Des écrivains se rassemblent dans un « Manifeste des 121 » pour appuyer le « droit à l'insoumission » (Claude Simon, Michel Butor, Claude Sarraute, Jean-François Revel, Jean-Paul Sartre) en septembre 1960.
Mendès France, ministre d'État, démissionne le 23 mai 1956 du gouvernement Guy Mollet afin de marquer son opposition à cette politique algérienne.
La France vit ainsi de manière de plus en plus aiguë, à partir de 1956, un moment de tensions et de divisions qui fait écho aux dissensions qui l'ont partagée tout au long de son histoire.
On évoque l'affaire Dreyfus. On recueille, à la manière de Jaurès, des preuves pour établir les faits, identifier les tortionnaires, condamner ce pouvoir politique qui a remis aux militaires – le général Massu à Alger – les fonctions du maintien de l'ordre en laissant l'armée agir à sa guise, choisir les moyens qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
La « gangrène » corrompt ainsi le pouvoir politique et certaines unités de l'armée dans une sorte de patriotisme dévoyé.
Certains officiers s'insurgent contre cette guerre qui viole le droit : ainsi le général Pâris de Bollardière, héros de la France libre. D'autres tentent de faire la part des choses afin de conjuguer honneur et efficacité.
Le responsable de ce chaos moral est à l'évidence un pouvoir politique hésitant, instable et impuissant.
En 1956, outre l'envoi du contingent en Algérie – choix d'une solution militaire à laquelle on accorde tous les moyens, et les pleins pouvoirs sur le terrain –, il a tenté de remporter une victoire politique.
Violant le droit international, le gouvernement a détourné un avion de ligne et arrêté les chefs du FLN.
Puis, en octobre-novembre 1956, en accord avec le Royaume-Uni et l'État d'Israël, la France participe à une expédition militaire en Égypte afin de riposter à la nationalisation du canal de Suez décidée par les Égyptiens. Mais, pour Guy Mollet, s'y ajoute l'intention de frapper les soutiens internationaux du FLN en abattant au Caire le régime nationaliste du colonel Nasser.
Le moment paraît bien choisi : les Russes font face à une révolution patriotique en Hongrie.
Les États-Unis sont à la veille d'une élection présidentielle.
Guy Mollet espère aussi obtenir un regain de popularité dans l'opinion, satisfaite d'une opération militaire réussie – et qu'on exalte –, et favorable au soutien à Israël.
Mais Russes et Américains vont dénoncer conjointement cette initiative militaire, et les troupes franco-britanniques seront rapatriées.
Cet échec scelle une nouvelle étape dans la décomposition de la IVe République et annonce celle du Parti socialiste.
Il confirme que la « tragédie algérienne » domine la politique française.
Des événements lourds de conséquences – le traité de Rome, qui crée la Communauté économique européenne et Euratom en 1957, la loi-cadre de Gaston Defferre pour l'Union française, ou même l'attribution d'une troisième semaine de congés payés – sont éclipsés par les graves tensions que crée la guerre d'Algérie.
Le sort de la IVe République est bien déterminé par elle.
Il est scellé au mois de mai 1958, en quelques jours.
Paris et Alger sont les deux pôles de l'action.
À Paris, le 13 mai, Pierre Pflimlin, député MRP, est investi à une très large majorité (473 voix contre 93, les communistes lui ayant apporté leurs suffrages). Président du Conseil, on le soupçonne d'être un partisan de la négociation avec le FLN.
À Alger, depuis plusieurs mois, des gaullistes veulent se servir des complots que trament les « activistes », décidés à maintenir l'Algérie française avec l'appui de l'armée, pour favoriser un retour du général de Gaulle.
Le 13 mai, des manifestants envahissent les bâtiments publics – le siège du Gouvernement général – et les mettent à sac.
Le général Massu prend la tête d'un « Comité de salut public » qui réclame au président de la République la constitution d'un « gouvernement de salut public ».
En même temps, des éléments de l'armée préparent une opération « Résurrection » dont le but est d'envoyer en métropole des unités de parachutistes.
La perspective d'un coup d'État militaire est utilisée par les gaullistes pour lancer l'idée d'un recours au général de Gaulle, seul capable d'empêcher le pronunciamiento.
À Paris, de Gaulle, le 19 mai, au cours d'une conférence de presse, se montre disponible. Tout en n'approuvant pas le projet de coup d'État – qu'il ne désavoue cependant pas –, il affirme qu'il veut rester dans le cadre de la légalité en se présentant en candidat à la direction du pays.
Ce double jeu réussit, avec la complicité du président Coty, qui entre en contact avec le Général et le désigne en fait pour assurer la charge suprême.
Pflimlin démissionne le 27 mai.
La gauche manifeste le 28, dénonçant la manœuvre, répétant que « le fascisme ne passera pas », marchant derrière Mitterrand, Mendès France, Daladier et le communiste Waldeck Rochet.
Mais les jeux sont faits : un accord a été passé avec Guy Mollet et les chefs des groupes parlementaires. Mitterrand seul l'a refusé.
Le 1er juin, la manœuvre gaulliste, utilisant la menace de coup d'État mais demeurant formellement dans le cadre de la légalité, a abouti : devant l'Assemblée nationale, de Gaulle obtient 329 voix contre 224.
Il dispose des pleins pouvoirs.
Le gouvernement – qui comprend notamment André Malraux, Michel Debré, Guy Mollet, Pierre Pflimlin – est chargé de préparer une Constitution.
Le 4 juin, de Gaulle se rend en Algérie. Il est acclamé et lance : « Je vous ai compris » et « Vive l'Algérie française ! »
L'ambiguïté demeure : de Gaulle a été appelé pour résoudre le problème algérien. Par la négociation ou par une guerre victorieuse ? En satisfaisant les partisans de l'Algérie française, ou en inventant un nouveau statut pour l'Algérie, voire en lui accordant l'autodétermination et l'indépendance ?
De Gaulle a les moyens d'agir.
La Constitution, qui est à la fois présidentielle et parlementaire, mais donne de larges pouvoirs au président élu par un collège de 80 000 « notables », permet à l'exécutif d'échapper aux jeux parlementaires, même si le gouvernement doit obtenir la confiance des députés.
Avec l'article 16, le président dispose en outre d'un moyen légal d'assumer tous les pouvoirs et de placer de facto le pays en état de siège.
Le 28 septembre 1958, par référendum, 79,2 % des votants approuvent la Constitution.
La IVe République est morte. La Ve vient de naître.
Le 21 décembre, de Gaulle est élu président de la République par 78,5 % des voix du collège des « grands électeurs », où les élus locaux écrasent par leur nombre les parlementaires.
Le 9 janvier, Michel Debré est nommé Premier ministre.
L'impuissance de la IVe République a donc conduit à sa perte.
La crise, qui pouvait déboucher sur une guerre civile, s'est dénouée dans le respect formel des règles et des procédures républicaines. Mais le passage d'une République à l'autre s'est déroulé sous la menace – le chantage ? – d'un coup d'État.
Aux yeux de certains (Pierre Mendès France avec sincérité, Mitterrand en habile politicien), là est le péché originel de la Ve République. Selon eux, la Constitution gaulliste ne pourrait donner naissance qu'à un régime de « coup d'État permanent ».
En fait, le pays apaisé a choisi l'homme dont il pense qu'il peut en finir avec la tragédie algérienne.
Mais de Gaulle voit plus loin :
« L'appel qui m'est adressé par le pays exprime son instinct de salut. S'il me charge de le conduire, c'est parce qu'il veut aller non certes à la facilité, mais à l'effort et au renouveau. En vérité, il était temps ! »
Est-ce, en germe, la manifestation d'un malentendu ?
Le pays et les hommes politiques appellent ou acceptent de Gaulle pour régler un problème précis. De Gaulle, lui, est porté par une ambition nationale de grande ampleur.
Quoi qu'il en soit, la IVe République était condamnée :
« Quand les hommes ne choisissent pas, écrit Raymond Aron en 1959, les événements choisissent pour eux. La fréquence des crises ministérielles discréditait le régime aux yeux des Français et des étrangers. À la longue, un pays ne peut obéir à ceux qu'il méprise. »
Surtout si ce pays a l'âme de la France.
4
L'EFFORT ET L'ESPOIR GAULLIENS
1958-1969
67.
Durant plus de dix ans, de juin 1958 à avril 1969, la France a choisi de Gaulle.
Au cours de cette décennie, le peuple, consulté à plusieurs reprises par voie de référendum, à l'occasion d'élections législatives ou dans le cadre d'une élection présidentielle au suffrage universel (1965), s'est clairement exprimé.
Jamais, au cours des précédentes Républiques – notamment la IIIe et la IVe –, le pouvoir politique n'a été autant légitimé par le suffrage universel direct. Jamais donc le « pays légal » n'a autant coïncidé avec le « pays réel ».
Si bien que cette pratique politique – usage du référendum, élection du président de la République au suffrage universel direct après la modification constitutionnelle de 1962 – a créé une profonde rupture avec la IVe République, qui avait prorogé toutes les dérives et les impuissances de la IIIe.
La Ve République est bien un régime radicalement nouveau, né de la réflexion du général de Gaulle amorcée avant 1940.
C'est un régime rigoureusement démocratique, même si les conditions de son instauration, on l'a vu, sont exceptionnelles.
Ceux qui, comme Mitterand, ont ressassé que ce régime était celui du « coup d'État permanent » et que de Gaulle n'était qu'une sorte de Franco, un dictateur, ont été – quel qu'ait été l'écho de leurs propos dans certains milieux, notamment la presse et le monde des politiciens – démentis par les faits, le résultat des scrutins venant souvent contredire les éclats de voix et de plume des commentateurs, voire l'ampleur des manifestations de rue.
Lorsque, en avril 1969, de Gaulle propose par voie de référendum une réforme portant sur l'organisation des pouvoirs régionaux, il avertit solennellement le pays :
« Votre réponse va engager le destin de la France, parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous..., ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. »
Ce que les opposants du général de Gaulle qualifient de stratégie du « Moi ou le chaos » n'est que la volonté de placer le débat en toute clarté, à son plus haut niveau de responsabilités.
Battu par 53,18 % des voix au référendum du 27 avril 1969, de Gaulle quitte immédiatement ses fonctions.
Cette leçon de morale politique est l'un des legs de ces dix années gaulliennes.
Elle exprime une conception vertueuse de la politique, tranchant sur celles des politiciens opportunistes qui ont peuplé les palais gouvernementaux avant et après de Gaulle.
Elle reste inscrite dans l'âme de la France. De Gaulle lui doit beaucoup de son aura, de son autorité et du respect qu'il inspire encore.
Pour cela, il est l'une des références majeures de l'histoire nationale.
On en oublie même que sa présidence a d'abord été tout entière dominée par la tragédie algérienne, qui ne trouve sa fin, dans la douleur, l'amertume, la colère, parfois la honte, le remords et le sang, qu'en 1962.
De Gaulle ne peut déployer son projet pour la France qu'après avoir arraché le pays au guêpier algérien. Mais il a consacré à cette tâche plus de quatre années, et il ne lui en reste que cinq – de 1963 à 1968 – pour ouvrir et conduire des chantiers vitaux pour la nation, avant les manifestations de mai 1968.
Ces dernières le conduisent à s'assurer en 1969 que le « pays réel » lui accorde toujours sa confiance.
Au vu de la réponse, il se retire.
D'ailleurs, dès 1958, et tout au long des étapes qui marquent sa politique algérienne, de Gaulle a procédé, de même, à des « vérifications » électorales par consultation des députés ou le plus souvent par référendum.
Il fait ainsi légitimer – par le peuple directement, indirectement par les élus – les initiatives qu'il prend.
En septembre 1959, les députés approuvent sa politique d'autodétermination par 441 voix contre 23.
« Le sort des Algériens, dit-il, appartient aux Algériens non point comme le leur imposerait le couteau et la mitraillette, mais suivant la volonté qu'ils exprimeront par le suffrage universel. »
Ce qui suscite une émeute à Alger chez les partisans de l'Algérie française : cette « journée des barricades » (24 janvier 1960) provoque la mort de 14 gendarmes auxquels les parachutistes n'ont pas apporté le soutien prévu.
Ainsi se dessine un péril qu'aucune République française n'a jamais réellement affronté : celui d'un coup d'État militaire, bien plus grave que la tentative personnelle d'un général cherchant l'appui de l'armée.
Quand, le 14 novembre 1960, de Gaulle déclare : « L'Algérie algérienne existera un jour », il fait approuver ce « saut » vers l'indépendance algérienne par voie de référendum.
Il obtient un « oui franc et massif » : 75,26 % des voix.
Mais une Organisation armée secrète (OAS) s'est créée, qui va multiplier les attentats, les assassinats.
Pis : un « putsch des généraux » s'empare du pouvoir à Alger (21 avril 1961). Il vise à renverser le régime.
Cette rébellion, fait unique dans l'histoire des républiques, souligne la profondeur de la crise, le traumatisme qui secoue l'âme de la France.
La nation mesure qu'elle vit un tournant de son histoire, la fin, dans la souffrance, d'une époque impériale – quel sort pour les Français d'Algérie, ce territoire si profondément inséré dans la République, celui dont tous les gouvernements ont assuré qu'il était la France, unie « de Dunkerque à Tamanrasset » ?
De Gaulle condamne le « pouvoir insurrectionnel établi en Algérie par un pronunciamiento militaire ». Il stigmatise ce « quarteron de généraux » en retraite (Salan, Challe, Jouhaud, Zeller) qu'inspirent des « officiers fanatiques ».
Cette tentative, en rupture avec toutes les traditions nationales, va échouer, le pouvoir légitime de De Gaulle recevant l'appui de l'ensemble des soldats du contingent et d'une majorité d'officiers.
Dès lors, en dépit des attentats perpétrés par l'OAS, des manifestations de la population algéroise (la troupe tire sur les pieds-noirs, rue de l'Isly et dans certains quartiers d'Alger, faisant plus de cinquante morts), un accord de cessez-le-feu est conclu à Évian le 18 mars 1962.
Il est approuvé par près de 90 % des Français consultés par référendum le 19 avril.
Fin de la guerre commencée il y a plus de sept années, le 1er novembre 1954.
Mais, pour des centaines de milliers de personnes, ce cessez-le-feu, cette reconnaissance de l'unité du peuple algérien, de sa souveraineté sur le Sahara – dont de Gaulle avait espéré conserver la maîtrise –, est la dernière et la plus douloureuse station d'un calvaire.
Européens d'Oran enlevés, assassinés.
Musulmans tués par des commandos de l'OAS qui veulent créer le chaos.
Dizaines de milliers de « supplétifs » de l'armée française – les harkis – abandonnés, donc livrés aux tueurs, aux tortionnaires.
Horreur partout.
Désespoir des pieds-noirs qui n'ont le choix qu'« entre la valise et le cercueil ».
Seule une minorité de quelques milliers d'Européens restera en Algérie, malgré les menaces et les assassinats perpétrés par les tueurs du FLN en réponse à ceux de l'OAS.
L'été 1962 est ainsi une période sinistre dont les Français de métropole n'ont pas une conscience aiguë.
C'est l'un des traits de l'histoire nationale que de vouloir « oublier » la crise et les drames que l'on vient de vivre.
On est heureux du retour des soldats du contingent, même si près de 30 000 sont morts ou ont disparu.
Qui se soucie des 100 000 harkis assassinés ou des centaines de milliers de victimes algériennes (500 000 ?) ?
On veut aussi oublier les dizaines d'Algériens tués à Paris le 17 octobre 1961 alors qu'ils manifestaient pacifiquement.
On oublie les 8 morts du métro Charonne qui protestaient contre l'OAS.
On veut refouler cette période tragique.
Un nouveau Premier ministre, Georges Pompidou, a été nommé dès le 14 avril 1962 en remplacement de Michel Debré.
Une autre séquence politique commence. On veut pouvoir entrer dans le monde de la consommation – télévision, réfrigérateur, machine à laver, voiture – qui rythme le nouveau mode de vie. Les « colonies » appartiennent au passé. La guerre d'Algérie est perçue comme une incongruité, un archaïsme à oublier. On détourne la tête pour ne pas voir les « rapatriés ». Quant aux soldats rentrés d'Algérie, ils se taisent et étouffent leurs souvenirs, leurs remords, rêvant à leur tour d'acheter une voiture, Dauphine ou Deux-Chevaux.
Dans ce contexte, l'attentat perpétré contre de Gaulle au Petit-Clamart, le 22 août 1962, par le colonel Bastien-Thiry – arrêté en septembre, condamné à mort, exécuté après le rejet de sa grâce – révolte, tout comme avaient scandalisé les attentats de l'OAS commis à Paris contre certaines personnalités – et qui avaient blessé de leurs voisins : ainsi une enfant aveuglée lors de l'attentat contre Malraux.
De Gaulle, sorti indemne de la fusillade du Petit-Clamart qui crible de balles sa voiture, va tirer parti de l'événement.
Il décide de soumettre à référendum une révision de la Constitution. Le président de la République sera désormais élu au suffrage universel direct. Toute la classe politique – hormis les gaullistes – s'élève contre ce projet censé conforter le « pouvoir personnel » et qu'on identifie à une procédure plébiscitaire.
Pour de Gaulle, c'est la clé de voûte des institutions républicaines : « L'accord direct entre le peuple et celui qui a la charge de le conduire est devenu, dans les temps modernes, essentiel à la République. »
La presse se déchaîne, à la suite des hommes politiques, faisant campagne contre de Gaulle. Le président du Sénat, Gaston Monnerville, parle de forfaiture. Une motion de censure est votée à l'Assemblée.
Mais 61,75 % des votants répondent oui lors du référendum du 28 octobre 1962. Et, aux élections législatives du 25 novembre, le parti gaulliste frôle la majorité absolue. De Gaulle a remporté une double victoire sur les partis.
La Ve République prend ainsi sa forme définitive.
De Gaulle, en stratège, s'est appuyé sur la tragédie algérienne pour retrouver le pouvoir et lui donner une Constitution conforme à ses vues.
Ayant tranché le nœud gordien algérien, il peut enfin déployer ses projets pour la France.
La nation le suivra-t-elle alors qu'elle aspire à la consommation ?
« Nous vivons, dit de Gaulle, évoquant cette année 1962, un précipité d'histoire. »
De fait, la France est devenue autre.
68.
De 1963 à 1968, la France se déploie.
C'est comme si la sève nationale, détournée ou contenue et accumulée depuis plus d'une décennie, jaillissait, maintenant que le verrou « algérien » a sauté, et irriguait le corps entier du pays.
Et de Gaulle, dans tous les domaines, pousse la nation en avant puisque, pour lui, « la France ne peut être la France sans la grandeur ».
Rien, dans la Constitution de la Ve République, ne peut, après 1962, l'entraver. Il bénéficie d'un domaine réservé, la politique étrangère, et n'est pas responsable devant le Parlement, où il dispose d'ailleurs d'une majorité disciplinée.
Les alliés de l'UNR (le parti gaulliste) que sont les héritiers des familles modérée et démocrate-chrétienne – le « centre » et, à partir de 1966-1967, les Républicains indépendants de Valéry Giscard d'Estaing – ne deviendront des partenaires critiques (« Oui... mais ») qu'au moment où le soutien populaire au Général s'effritera.
Car de Gaulle, qui dispose de la liberté d'agir d'un monarque, est un républicain intransigeant qui, s'il conteste le jeu des partis politiques et exige des députés qu'ils approuvent sa politique, n'avance que s'il est assuré de l'approbation populaire.
On l'a vu à chaque étape du règlement de la tragédie algérienne.
On le vérifie après 1963 : non seulement il accepte et suscite le verdict électoral, mais il multiplie les rencontres avec le peuple.
Le Verbe et le Corps du monarque républicain deviennent ainsi des éléments importants du fonctionnement politique.
Les conférences de presse – télévisées, radiodiffusées –, les voyages nombreux dans tous les départements, ce Corps et ce Verbe présents, les contacts lors des « bains de foule », participent de cette recherche d'une communication directe avec le peuple, presque d'une communion.
L'élection présidentielle au suffrage universel direct est une sorte de sacre démocratique et laïque du président.
La première a lieu les 5 et 19 décembre 1965.
Décisive, elle l'est d'abord par le nouveau paysage politique qu'elle met en place.
Aux côtés du candidat du centre, Jean Lecanuet, la gauche présente François Mitterrand, qui a obtenu le soutien des communistes.
Venu de la droite, celui-ci – contrairement à une partie de la gauche, et notamment Pierre Mendès France – a compris que l'élection présidentielle conduisait à la bipolarisation. Il a donc eu le courage politique de commettre la transgression majeure : s'allier aux communistes.
Grâce à la présence de Lecanuet – 15,57 % des voix – qui draine les voix du centre hostile à de Gaulle, considéré comme un nationaliste antieuropéen, Mitterrand réussit, avec 32 % des voix, à mettre de Gaulle en ballottage.
La signification de ce premier tour est claire : les partis politiques et, derrière eux, un nombre important de Français ne jugent plus nécessaire, puisque la crise algérienne est dénouée, la présence au pouvoir de De Gaulle.
Les politiciens ont hâte de retrouver une pratique constitutionnelle qui leur permette de se livrer à leurs jeux, censés exprimer la démocratie parlementaire.
Et le « peuple », plutôt que d'entendre évoquer la grandeur de la France, souhaiterait que sa vie quotidienne soit améliorée par une hausse des salaires.
Une longue grève des mineurs – mars 1963 – a montré la profondeur des insatisfactions ouvrières.
C'est que la France change vite, et cette mutation crée des inquiétudes, des déracinements.
Des villes nouvelles sortent de terre. Les premiers hypermarchés ouvrent. Un collège nouveau est inauguré chaque jour. Télévision, radio (Europe n° 1), nouvelles émissions, nouvelles mœurs, nouveaux « news magazines », modifient les manières de penser des couches populaires, mais aussi des nouveaux salariés du « tertiaire », employés et cadres urbanisés.
Ceux qui sont nés pendant la guerre ou lors du baby-boom des années 1946-1950 n'ont pas pour repères la Résistance ou la collaboration, de Gaulle ou Pétain. Quand on les interroge, ils répondent : « Hitler ? Connais pas. »
Les plus jeunes – les adolescents d'une quinzaine d'années en 1963 – sont encore plus « décalés » par rapport à ce que représentent de Gaulle et le gaullisme, ou même la classe politique issue le plus souvent de la Résistance et de la guerre.
Mitterrand était à Vichy, puis dans la Résistance, Giscard d'Estaing a fait la campagne d'Allemagne en 1945, Chaban-Delmas a participé à la libération de Paris comme jeune général délégué de De Gaulle, Messmer a été un héroïque officier de la France libre.
Les jeunes gens qui écoutent l'émission « Salut les copains » sur Europe n° 1, acclament Johnny Hallyday et se retrouvent à plus de cent cinquante mille, place de la Nation, le 22 juin 1963, sont le visage d'une nouvelle France qui se sent séparée de la France officielle.
La guerre d'Algérie qui vient à peine de s'achever lui est aussi étrangère que la Seconde Guerre mondiale. Elle ne cherche pas à les connaître.
Si peu de films ou de livres évoquent la guerre d'Algérie, c'est parce que ce nouveau public s'intéresse davantage à la mode « yé-yé » qu'à l'histoire récente.
Quant aux cadres un peu plus âgés, soucieux de carrière et de gestion, ils lisent L'Expansion – qui vient d'être lancé par Jean-Louis Servan-Schreiber, frère de Jean-Jacques, créateur de L'Express.
Qui, dans ces nouvelles générations, peut vibrer aux discours de Malraux – inamovible ministre des Affaires culturelles –, qui, en 1964 lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon – comme s'il avait l'intuition du fossé culturel séparant la génération de « Salut les copains » des valeurs patriotiques d'un Jean Moulin et de la différence d'expérience vécue entre les contemporains de Johnny Hallyday et ceux de la Gestapo – déclare : « Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé : ce jour-là, elle était le visage de la France ! »
Cette fracture entre les générations, l'élection présidentielle de 1965 la reflète aussi.
De Gaulle a soixante-quinze ans, Mitterrand et Lecanuet insistent sur leur jeunesse (relative) et sur la relève nécessaire. Ils veulent rejeter de Gaulle dans le passé, et Mitterrand cherche à en faire le candidat de la droite. Lui-même sait qu'il doit incarner la gauche et que, dans cette élection, dès lors qu'il met de Gaulle en ballottage, il devient – quelles que soient les péripéties à venir – le futur candidat à la présidence des gauches unies.
Même si, lors de ce second tour de 1965, Mitterrand rassemble tous les antigaullistes, de l'extrême droite collaborationniste aux partisans de l'OAS et de l'Algérie française, en sus, naturellement, des socialistes et des communistes...
De Gaulle dénonce dans cette candidature le retour des partis et des politiciens. C'est, pour lui, « un scrutin historique qui marquera le succès ou le renoncement de la France vis-à-vis d'elle-même »...
Il précise que le candidat à la présidence de la République doit se situer au-dessus des partis : « Je suis pour la France, dit-il. La France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français. Ce n'est pas la gauche, la France ! Ce n'est pas la droite, la France ! » Et il ajoute : « Prétendre représenter la France au nom d'une fraction, c'est une erreur nationale impardonnable. »
De Gaulle est élu le 9 décembre 1965 avec 54,5 % des voix.
Pourcentage élevé, mais ce ballottage – lourde déception pour l'homme du 18 juin – indique que les clivages politiques traditionnels ont repris de leur vigueur.
L'âme de la France n'oublie ses divisions qu'au fond de l'abîme.
Elle sacre alors un personnage exceptionnel, mais s'en éloigne dès qu'elle reprend pied.
Cette élection de 1965 donne en principe sept années à de Gaulle pour ancrer la France à la place qui correspond à sa « grandeur ».
Mais ce projet par lui-même suscite des réserves et des sarcasmes.
Et il est vrai qu'il y a un style gaullien dont on se plaît à caricaturer l'emphase. On met en scène un de Gaulle en nouveau Louis XIV entouré de sa cour. On en critique les réalisations, du paquebot France à l'avion supersonique Concorde.
On sent que derrière ces réticences s'exprime une autre vision de la France, puissance devenue moyenne, qui doit se fondre dans une Europe politique, renoncer à une diplomatie autonome, être un bon soldat de l'OTAN, ne pas chercher à bâtir une force nucléaire indépendante – la « bombinette », comme l'appellent les humoristes.
Mais ils critiquent, du même point de vue, la volonté de Malraux de réussir dans le domaine de la culture ce que Jules Ferry a réussi pour l'instruction. Et, malgré les sarcasmes, des maisons de la culture surgissent dans les régions, deviennent des centres de création, mais aussi des lieux de contestation politique.
Avec le recul, on mesure que c'est dans cette décennie gaullienne que la France de la fin du xxe siècle s'est dessinée : villes nouvelles, effort dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, création d'universités (Nanterre, par exemple), d'instituts universitaires de technologie.
C'est le temps où la France glane des prix Nobel (en médecine : Lwoff, Jacob, Monod ; en physique : Alfred Kastler), et même des médailles olympiques (jeux Olympiques d'hiver à Grenoble en 1968).
Certes, ces résultats sont issus des semailles effectuées pendant le IVe République. Ces transformations participent des Trente Glorieuses qui, sur le plan économique et social, bouleversent en profondeur la nation. Mais, grâce aux impulsions données par l'État, le mouvement est maintenu, accéléré, soutenu.
Le Plan est une « ardente obligation » ; la DATAR veille à l'aménagement du territoire.
Il y a un esprit, un espoir, un effort gaulliens. Ils affirment que la France a la capacité de demeurer l'une des grandes nations.
D'ailleurs, ne devient-elle pas la quatrième puissance économique ?
Elle peut, dans le domaine scientifique, développer une recherche de pointe qui lui permet, en aéronautique ou dans le secteur nucléaire, de maintenir des industries compétitives. L'industrie nucléaire est capitale pour assurer une défense – donc une diplomatie – indépendante, et garantir l'autonomie énergétique au moyen des centrales nucléaires.
Quarante années plus tard, malgré le renoncement de fait aux ambitions gaulliennes pratiqué par les successeurs du Général, les directions choisies par de Gaulle sont encore visibles, même si elles commencent à s'effacer, en ce début du xxie siècle, et si l'on s'interroge pour savoir s'il convient de les prolonger.
La persistance – la résistance – des choix gaulliens, malgré leur remise en cause, est encore plus nette en politique extérieure.
La cohérence du projet gaullien en ce domaine s'appuie d'abord sur une lecture de l'âme de la France.
« Notre pays, dit de Gaulle, tel qu'il est parmi les autres tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. »
Ce qui se traduit en politique extérieure par l'affirmation de l'indépendance et de la souveraineté.
Cela ne signifie pas le refus des alliances et de la solidarité à l'égard des nations amies. Ainsi, en 1962, de Gaulle a manifesté aux États-Unis de Kennedy, engagés dans une confrontation dangereuse avec l'URSS à propos de missiles installés à Cuba, un soutien sans équivoque.
Il a de même affirmé, par le traité de l'Élysée signé en 1963, sa volonté de bâtir avec l'Allemagne une relation privilégiée et déterminante pour l'avenir de l'Europe.
Il n'envisage pas l'Europe seulement dans le cadre de la Communauté européenne. Il veut une « Europe européenne » « de l'Atlantique à l'Oural », c'est-à-dire qu'il se place au-dessus du « rideau de fer » idéologique, politique et militaire qui sépare une Europe démocratique sous protection et domination américaines d'une Europe colonisée par les Soviétiques.
De Gaulle veut que la France soit à l'initiative du dégel. Pour cela, elle doit ne pas dépendre des États-Unis, et s'il refuse l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE, c'est qu'il estime que Londres est soumis à Washington et son agent en Europe.
Il faut donc que la France brise tout ce qui crée une sujétion à l'égard des États-Unis.
En 1964, premier État occidental à oser le faire, de Gaulle reconnaît la Chine communiste.
La même année, il effectue une tournée en Amérique latine, invitant les nations de ce continent à s'émanciper de la tutelle américaine – « Marchamos la mano en la mano », dit-il à Mexico.
En 1966, il renforce la coopération avec Moscou. Mais c'est « la France de toujours qui rencontre la Russie de toujours ». Il visitera la Pologne, et plus tard la Roumanie.
Nation souveraine, la France estime que les idéologies glissent sur les histoires nationales et que celles-ci ne peuvent être effacées.
La nation est plus forte que l'idéologie.
Mais l'acte décisif, qui change la place de la France sur l'échiquier international – et pour longtemps –, est accompli le 7 mars 1966 quand de Gaulle quitte le commandement intégré de l'OTAN, exige le départ des troupes de l'OTAN qui séjournent en France et le démantèlement de leurs bases.
La France vient d'affirmer avec force sa souveraineté. Elle dispose de l'arme atomique. Elle construit des sous-marins nucléaires lance-engins ; elle est donc indépendante. Elle retrouve, selon de Gaulle, le fil de la grande histoire.
Preuve de son autonomie diplomatique au-dessus des blocs : il se rend à Phnom Penh, et, dans un grand discours, invite les États-Unis à mettre fin à leur intervention militaire au Viêt Nam.
Ces prises de position scandalisent : les uns hurlent de colère, les autres ricanent, affirment que la France n'a qu'une diplomatie de la parole et du simulacre.
Les centristes (Jean Lecanuet) et les indépendants critiquent cette politique extérieure qui fait naviguer la France entre les deux icebergs de la guerre froide. Ces formations politiques s'apprêtent à assortir leur soutien à de Gaulle de profondes réserves. Ce sera, en 1967, le « Oui... mais » de Giscard d'Estaing, qui ainsi prend déjà date pour l'après-de Gaulle.
La gauche et l'extrême gauche, où l'antiaméricanisme est répandu et où l'on crée des comités Viêt Nam, n'appuient pas pour autant de Gaulle, à la fois pour des raisons politiciennes – il est « la droite » – et parce que l'idée de nation souveraine leur est étrangère.
En outre, en se rassemblant et en élaborant un programme – Mendès France et Michel Rocard en discutent lors de divers colloques, notamment à Grenoble en 1966 –, la gauche devient attirante, « moderne ».
La base électorale du gaullisme se réduit d'autant. Les élections législatives de 1967 confirment à la fois le succès de la gauche et l'érosion du parti gaulliste, de plus en plus dépendant de ses alliés du centre et de la droite traditionnelle, qui sont, eux, de plus en plus réticents.
Les propos que tient de Gaulle à Montréal, le 24 juillet 1967, saluant d'un « Vive le Québec libre ! » la foule qui l'acclame, scandalisent un peu plus. De Gaulle perdrait-il la raison ?
Ceux du 27 novembre 1967, lors d'une conférence de presse consacrée au Moyen-Orient, et qui qualifient le peuple juif de « peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur », le mettant en garde contre les actions de guerre et de conquête qui l'entraîneraient dans une confrontation sans fin avec les États voisins, suscitent indignation, condamnation, incompréhension.
Certains évoquent le vieil antisémitisme maurrassien. Mais l'excès même de ces accusations inexactes portées contre de Gaulle montre que celui-ci ne fait plus l'unanimité, pis : qu'il n'est même plus respecté, qu'il exaspère, que de larges secteurs du pays, en cette fin d'année 1967, ne le comprennent plus. Et que, pour d'autres, il appartient à un monde révolu.
Il aura soixante-dix-huit ans en cette année 1968 qui commence.
À Caen, de jeunes ouvriers en grève affrontent violemment les forces de l'ordre le 26 janvier.
À Paris, des étudiants, membres du Comité Viêt Nam national, brisent les vitres de l'American Express ; certains sont arrêtés. Et le 22 mars, à Nanterre, la salle du conseil de l'université est occupée.
Un étudiant franco-allemand, Cohn-Bendit, crée le Mouvement du 22 mars. La « nouvelle France », celle des jeunes qui ont autour de vingt ans, apparaît sur le terrain politique et social ; elle annonce une nouvelle séquence historique. Cette génération s'interroge sur le sens d'une société dont elle ne partage pas les valeurs officielles.
L'un de ces nouveaux jeunes acteurs de la vie intellectuelle et sociale, Raoul Vaneigem, qui se définit comme situationniste, écrit en ce mois de mars 1968 : « Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre celle de mourir d'ennui. »
Le flux inéluctable des générations entraîne et modifie l'âme de la France.
69.
Mai 1968-juin 1969 : c'est l'année paradoxale de la France.
En mai 1968, le pays est en « révolution ». Le gouvernement semble impuissant. Pierre Mendès France et François Mitterrand se disent prêts à prendre un pouvoir qui paraît à la dérive.
Un mois plus tard, le 30 juin, la France élit dans le calme l'Assemblée nationale la plus à droite depuis 1945. Rejetés en mai, les gaullistes y détiennent la majorité absolue pour la première fois depuis le début de la Ve République.
Mais, le 28 avril 1969, au référendum proposé par de Gaulle, le non l'emporte avec 53,18 % des voix. Conformément aux engagements qu'il a pris, de Gaulle « cesse d'exercer ses fonctions ».
Un mois et demi plus tard, le 15 juin 1969, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, Georges Pompidou, est élu président de la République avec 57,8 % des suffrages exprimés !
Cette année jalonnée de surprises et de paradoxes est un condensé d'histoire nationale, une mise à nu et une mise à jour de l'âme de la France.
Le spectacle commence dans la nuit du 10 au 11 mai 1968, quand le Quartier latin, à Paris, se couvre de barricades pour protester contre l'arrestation d'étudiants, l'occupation et la fermeture de la Sorbonne par la police qui les en a délogés.
C'est comme si les étudiants, dépavant les rues, rejouaient les journées révolutionnaires, retrouvant les gestes des insurgés du xixe siècle, ceux de 1830 ou de 1832, de 1848 ou de 1871, mais aussi ceux des combats de la Libération, en août 1944.
C'est un théâtre de rue : pavés, arbres sciés, voitures incendiées, charges des CRS accueillies aux cris de « CRS, SS », effet de la mémoire détournée qui devient mensongère.
Dans ces affrontements, en brandissant le drapeau rouge, on joue aussi des épisodes de la lutte des classes mondiale : on invoque Marx, Lénine, Trotsky, Mao, Che Guevara, le Viêt-cong, et on dénonce l'impérialisme américain.
En cette première quinzaine de mai 1968, Paris marie la tradition nationale et l'idéologie gauchiste qui se réclame du marxisme, du trotskisme, du castrisme et du maoïsme.
En fait, comme en de nombreux autres pays (États-Unis, Allemagne, Italie, Japon, par exemple), la jeunesse issue du baby-boom d'après guerre entre en scène.
En France – particularité de l'âme de la nation –, elle interprète un simulacre de révolution.
La genèse en a été la protestation de quelques étudiants organisés dans des mouvements minoritaires, celui du 22 mars ou ceux relevant de la mouvance trotskiste.
Ils sont le détonateur qui embrase la jeunesse, les « copains » qui, depuis les années 60, investissent peu à peu l'espace social et culturel. Cette génération entre dans le théâtre politique français, où le décor, les textes, la mémoire et les postures sont révolutionnaires.
Surpris – le Premier ministre, Pompidou, et le président de la République sont en voyage officiel à l'étranger –, le pouvoir politique s'interroge.
Il contrôle remarquablement la répression : grâce au préfet de police Grimaud, la nuit des barricades sera certes violente, avec de nombreux blessés, mais restera un simulacre de révolution.
Exception française : la « révolution » étudiante déclenche une crise sociale et politique.
La France est bien ce pays d'exception, centralisé, où la symbolique historique joue un rôle majeur et où ce qui se passe sur la scène parisienne prend la profondeur de champ d'un événement historique.
Longtemps contenues, les revendications ouvrières explosent face à un régime affaibli. Les grèves éclatent, mobilisent bientôt plus de dix millions de grévistes – un sommet historique.
Au gouvernement, certains craignent une « subversion communiste », puisque la CGT est liée au Parti communiste.
Et ce n'est plus seulement Paris qui est concerné. Toute la nation est paralysée.
Les villes de province sont parcourues par des cortèges à l'ampleur exceptionnelle.
Les amphithéâtres de toutes les universités, les théâtres – à Paris, celui de l'Odéon –, les écoles – celle des Beaux-Arts –, les rues, les places, deviennent des lieux de débat. Des assemblées tumultueuses écoutent des anonymes, des militants, des écrivains célèbres (Sartre, Aragon). On applaudit, on conteste.
C'est la « prise de parole », le rejet des institutions. Les communistes sont débordés par les gauchistes, les maoïstes, les trotskistes.
Et l'on crie : « Adieu, de Gaulle, Adieu ! » ou encore : « Dix ans, ça suffit ! »
Ainsi, à la fin du mois de mai, la « révolution » étudiante est devenue radicalement politique.
C'est comme un condensé d'histoire. Les multiples réunions font penser par leur nombre, les participations massives, la diversité des problèmes soulevés par une foule d'intervenants, aux assemblées préparatoires aux états généraux élaborant leurs cahiers de doléances. Déjà on semble à la veille d'un 14 juillet 1789.
Dans les cortèges, certains souhaitent qu'on prenne une Bastille qui ferait tomber le pouvoir du vieux monarque. On lance : « De Gaulle au musée ! »
Tout se joue dans les quatre derniers jours de mai.
D'abord, Pompidou réunit les syndicats. Il aboutit le 27 mai aux accords de Grenelle avec la CGT. Il retire ainsi du mordant au mouvement social et stoppe sa propagation.
En outre, l'indication politique est précieuse : les communistes ne veulent pas – lucidité ou calcul lié à la politique extérieure de De Gaulle ? – d'un affrontement, aux marges de la légalité, avec le pouvoir.
Dès lors, l'acte de candidature de François Mitterrand et de Pierre Mendès France – alliés et concurrents –, se déclarant le 27 mai prêts à gouverner alors que le pouvoir n'est pas vacant, apparaît comme le choix de pousser le pays dans l'« aventure ».
Celui-ci ne le désire pas.
Il suffit d'un appel radiodiffusé du Général, le 30 mai, pour renverser la situation.
De Gaulle s'est rendu la veille auprès du général Massu, commandant les forces françaises en Allemagne, stratagème créant l'angoisse et l'attente, habile dramatisation bien plus que démarche d'un président ébranlé cherchant l'appui de l'armée. À la radio, il annonce la dissolution de l'Assemblée et des élections législatives.
La volonté du pays de mettre fin à la « révolution » s'exprime aussitôt : manifestation d'un million de personnes sur les Champs-Élysées, le 30 mai ; aux élections des 23 et 30 juin, triomphe des gaullistes de l'UDR (gain de 93 sièges) des indépendants (gain de 10 sièges), et échec communiste (perte de 39 sièges) et des gauches de la FGDS (perte de 64 sièges).
Derrière le simulacre de révolution à quoi s'était complue l'âme de la France se manifeste l'aspiration à la paix civile et au respect des procédures constitutionnelles.
L'âme de la France apparaît ainsi ouverte au débat, mais seule une minorité infime désire réellement la révolution. Son discours et ses postures ne suscitent pas de prime abord le rejet : on les entend, on les regarde, on les approuve, on les suit même comme s'il s'agissait de revivre – de rejouer – des scènes de l'histoire nationale auxquelles on est affectivement – et même idéologiquement – attaché. Tout ce simulacre fait partie de l'âme de la France. Mais on ne veut pas se laisser entraîner à brûler le théâtre parce que, sur la scène, quelques acteurs, qu'on peut applaudir, dressent des barricades et déclament des tirades incendiaires.
D'ailleurs, ces acteurs eux-mêmes – trotskistes, maoïstes, gauchistes de toutes observances – se refusent à mettre le feu à la France.
Les plus engagés d'entre eux – maoïstes regroupés dans la Gauche prolétarienne – n'auront jamais versé – à l'exception de quelques rares individualités – dans la « lutte armée », comme cela se produira en Allemagne et surtout en Italie.
Comme si, dans la culture politique nationale, cette séquence de l'« action directe » de petits groupes prêts à l'attentat et à l'assassinat ne trouvait pas d'écho favorable, mais une condamnation ferme.
Comme si l'action politique « de masse », accompagnée de controverses idéologiques ouvertes plutôt que d'une culture de secte, l'emportait toujours.
Comme si les « militants révolutionnaires » avaient la conviction que le « peuple français », celui de 1789, de 1830, de 1848, de 1871, de 1944, pouvait les écouter, les comprendre et les suivre. Comme si, finalement, l'action armée, groupusculaire, terroriste, était la marque de nations qui n'avaient pas connu « la » Révolution, mais dont les peuples, au contraire, s'étaient laissé enrégimenter par la « réaction », le fascisme, le nazisme... et le stalinisme.
Le refus du gauchisme de passer à la lutte armée est ainsi le résultat moins d'une impossibilité « technique » (petit nombre de militants décidés à agir) que du poids d'une histoire nationale dans laquelle la société – le peuple – a joué le rôle déterminant à toutes les époques, de la monarchie à la république.
Et, en effet, c'est par la société et en son sein que les « révolutionnaires » de Mai 68 l'emportent.
Ils s'y insèrent, y conquièrent des postes d'influence dans ces nouveaux pouvoirs que sont les médias.
Ils constituent une « génération » solidaire qui transforme le simulacre de révolution en vraie mythologie révolutionnaire.
Ils exaltent les épisodes estudiantins – les barricades à résonance historique – et effacent des mémoires la plus puissante grève ouvrière qu'ait connue la France.
Une reconstruction idéologique de Mai 68 est ainsi réalisée par les acteurs eux-mêmes, avec l'assentiment de tous les pouvoirs.
Cette révolution de Mai est aussi une déconstruction de l'ordre républicain et de ses valeurs, points d'appui des mouvements sociaux. La République, c'était l'exception française, manière de s'opposer à la « normalisation économique ».
La révolution de Mai, au contraire, est en phase avec la nouvelle culture qui envahit le monde à partir des années 60. Elle est permissive sur le plan des mœurs (culture gay et lesbienne, avortement, usage du cannabis, etc.), féministe et antiraciste.
Elle refuse les hiérarchies, les structures jugées autoritaires. Elle valorise et exalte l'individu, l'enfant. Elle provoque un changement des méthodes d'enseignement.
Cette révolution culturelle, portée par la diffusion des médias audiovisuels, condamne l'idée de nation. Elle la soupçonne de perpétuer une vision archaïque, autoritaire, hostile à la jouissance, à la consommation libertaire adaptée à l'économie de marché.
L'héroïsme national, l'idée de grandeur, l'idée même de France – et de son rôle exceptionnel dans l'histoire –, sont refoulés.
L'âme de la France se trouve ainsi déformée, amputée.
Dans ce climat, de Gaulle et les valeurs qu'il représente sont condamnés.
« Adieu de Gaulle, adieu », « De Gaulle au musée » : ces slogans des manifestants rendent compte en négatif des aspirations des nouvelles générations.
Le nouveau Premier ministre (Maurice Couve de Murville a remplacé Georges Pompidou, qui a efficacement fait face aux événements de Mai, mais qui apparaît comme un candidat possible à la présidence de la République) incarne plus caricaturalement que de Gaulle les valeurs de cette histoire française que la révolution de Mai a dévalorisées.
De Gaulle est parfaitement conscient du changement intervenu, du « désir général de participer... Tout le monde en veut plus et tout le monde veut s'en mêler. » Mais le référendum qu'il propose le 28 avril 1969, visant à modifier le rôle et la composition du Sénat et à changer l'organisation des collectivités territoriales, ne peut répondre à l'attente qui traverse la société.
En somme, de Gaulle est devenu le vivant symbole du passé.
Sa place est en effet, au musée, dans l'histoire révolue.
Et l'on voit déjà se profiler derrière lui un homme d'État moderne : Georges Pompidou. L'ancien Premier ministre, s'est contenté, pendant la guerre, d'enseigner. Il a « vécu », a été banquier chez Rothschild. Il aime l'art contemporain, est photographié avec un pull noué sur les épaules. Des rumeurs tentent de le compromettre avec le monde de la nuit et de la débauche. Il s'agit d'une tentative visant à l'abattre. Mais peut-être qu'au contraire cette calomnie a plaidé en sa faveur.
Ce n'est plus un héros quasi mythologique que la France désire. Elle veut un homme non pas quelconque, mais plus proche.
Le non l'emporte au référendum du 28 avril 1969.
« Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi », communique de Gaulle à 0 h 10, le 29 avril.
Georges Pompidou est élu président de la République le 15 juin 1969 avec 57,8 % des suffrages exprimés, contre 42,25 % à Alain Poher, modéré, président du Sénat.
Au premier tour, les candidats de la gauche socialiste (Defferre, Rocard) obtiennent respectivement 5,1 et 3,61 % des voix).
Mitterrand, prudent et lucide, n'a pas été candidat.
Le communiste Duclos a rassemblé 21,5 % des voix.
Le trotskiste Krivine, 1,05 %.
Tel est le visage électoral de la France un an après la « révolution » de Mai.
La gauche n'est pas présente au second tour du scrutin, alors qu'en 1965 Mitterrand avait mis de Gaulle en ballottage.
Pourtant, malgré la victoire de Georges Pompidou, la République gaullienne est morte.
De Gaulle n'y survivra pas longtemps.
Il meurt le 9 novembre 1970.
Refusant tous les hommages officiels, il avait souhaité être enterré sans apparat à Colombey-les-Deux-Églises.
Il avait écrit, dédicaçant un tome de ses Mémoires à l'ambassadeur de France en Irlande, quelques semaines après son départ du pouvoir, une pensée de Nietzsche :
Rien ne vaut rien
Il ne se passe rien
Et cependant tout arrive
Et c'est indifférent.
5
LA FRANCE INCERTAINE
1969-2007
70.
En 1969, comme si souvent au cours de son histoire, la France entre dans le temps des incertitudes.
Elle avait choisi durant une décennie de s'en remettre au « héros » qui, une première fois, l'avait arrachée aux traîtres, aux médiocres et aux petits arrangements d'une « étrange défaite ».
Respectant le contrat implicite que le pays avait passé avec lui, de Gaulle avait mis fin à la tragédie algérienne.
La France pouvait donc – le moment, l'occasion, les modalités, seraient affaire de circonstances – renvoyer le héros au « musée » de ses souvenirs.
De Gaulle parti, la France est incertaine.
Les successeurs – Georges Pompidou (1969-1974), Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981), François Mitterrand (1981-1995), Jacques Chirac (1995-2007) – ne sont, chacun avec son rapport singulier à la France, au monde, à la vie, que des hommes politiques.
Ils ne gravissent plus les pentes de l'Olympe, mais les modestes sommets d'une gloire politicienne, même si l'avant-dernier, qu'animait une jalousie rancie à l'égard de De Gaulle, rencontré pour la première fois en 1943, a tenté – on a l'Olympe qu'on peut – de construire sa mythologie en conviant ses courtisans et les caméras à l'ascension, devenue rituelle, de la roche de Solutré, son site préhistorique.
Mais, derrière la succession apaisée des présidents de la République, dont aucune crise de régime ne vient interrompre un mandat que seule la maladie peut écourter (mort de Pompidou en 1974), les enjeux sont majeurs pour la nation.
Le projet du « héros » était clair, simple mais exigeant : indépendance, souveraineté, fidélité à l'âme de la France, et donc grandeur.
L'exception française devait être maintenue à la fois dans l'organisation économique, sociale et politique – un État fort animant et canalisant la vie économique, instituant la « participation » – et dans les relations internationales – la France n'est d'aucun bloc, elle reconnaît les nations comme des entités souveraines, libres de vivre à l'intérieur de leurs frontières comme elles l'entendent. Ni droit ni devoir d'ingérence.
La révolution culturelle de Mai – réplique de la domination mondiale des images de la société américaine, elle-même modelée par son histoire, son mode d'organisation économique – a contesté le projet gaullien.
Mais le « nouveau modèle culturel » a-t-il réellement pénétré, et jusqu'à quelles profondeurs, la société française ? A-t-il vaincu, balayé tous les aspects du projet gaullien ?
Entre le nouveau et l'ancien, quelle combinaison, quel équilibre peut-on réaliser ? Et comment les présidents successifs – et les forces politiques qui les soutiennent – vont-ils se situer par rapport à cette question majeure ?
Vont-ils s'appuyer sur les aspirations nouvelles, les reconnaître, et, à partir d'elles, « modifier l'âme de la France », ou tenter au contraire de les contenir, de les refouler, ou encore, pragmatiquement, en fonction de leurs intérêts électoraux, tenter de concilier l'ancien et le nouveau ?
Il s'agit en somme de savoir qui va assumer, et comment, l'héritage de la « révolution » de Mai 68. Quelle part on en retiendra, ce qu'on refusera, et vers quelles formations politiques se porteront les acteurs de Mai.
À l'évidence, ils ont inquiété les électeurs de juin 1968, qui ont élu une majorité absolue de députés gaullistes, et ceux de juin 1969, qui ont choisi Georges Pompidou et écarté la gauche et l'extrême gauche.
Pompidou, qui par ailleurs bénéficie d'une conjoncture économique favorable, dispose d'une large assise électorale exprimant la réaction du pays devant le risque « révolutionnaire » et son attachement conservateur au modèle ancien.
Cependant, la société est travaillée par l'« esprit de Mai ».
Au fil des années, tout au long de la présidence de Georges Pompidou (1969-1974), il se manifeste souvent. Les gauchistes sont présents.
La tentation de créer un « parti armé » est réelle, même si – nous l'avons noté – elle ne se réalisera pas. La mort d'un militant – Pierre Overney, en 1972 – et ses obsèques sont symboliquement la dernière grande manifestation gauchiste à traverser les quartiers de l'Est parisien, traditionnellement « révolutionnaires ».
Il y a l'émergence du Mouvement de libération des femmes (MLF) ; la déclaration, en 1971, de 343 femmes reconnaissant avoir eu recours à l'avortement.
Tel ou tel fait divers (le suicide d'un professeur, Gabrielle Russier, qui a pour amant un élève mineur de dix-huit ans, et Pompidou saura, citant Paul Éluard, trouver les mots de la compassion vis-à-vis de « la malheureuse qui resta sur le pavé... »), illustre les tensions, les conflits entre les nouvelles aspirations et la loi.
C'est un travail de déconstruction qui se poursuit.
Il modifie le regard qu'on porte sur deux périodes clés de l'histoire nationale, fondatrices de l'héroïsme national et de sa mythologie.
D'abord, la Révolution française, qu'un historien comme François Furet commence à repenser à la lumière de ce qu'on a appris du régime soviétique. Ce n'est plus de la liberté qu'on crédite la Révolution, mais du totalitarisme. Robespierre est l'ancêtre de Lénine et de Staline, et ceux-ci sont les créateurs de l'archipel du goulag (les trois volumes de Soljenitsyne sont publiés en russe à Paris en décembre 1973, en français en 1974-1975).
L'autre révision porte sur la France de Vichy (titre d'un livre de l'historien américain Robert Paxton). Sur la geste gaulliste qui affirme que Vichy « est nul et non avenu » et que la nation a le visage de la Résistance et de la France libre – sorte de tapisserie où ne figurent que des héros – vient se superposer une France ambiguë, celle que révèle aussi le film de Max Ophüls, Le Chagrin et la pitié.
Au mythe héroïque et patriotique déconstruit succède le mythe d'une lâcheté nationale, d'un attentisme généralisé, voire d'un double jeu – où se reconnaissent un Georges Pompidou, un François Mitterrand – aux antipodes des choix radicaux et clairs pris par certains (de Gaulle, Messmer) dès juin 1940.
Ces révisions de l'histoire nationale participent de l'esprit de Mai.
En choisissant comme Premier ministre Jacques Chaban-Delmas – général gaulliste –, Pompidou, en juin 1969, cherche l'équilibre entre l'ancien et le nouveau, puisque Chaban, lorsqu'il présente son programme à l'Assemblée, déclare : « Il dépend de nous de bâtir patiemment et progressivement une nouvelle société. »
Ce projet de « nouvelle société » a été élaboré par Simon Nora – proche de Mendès France – et Jacques Delors, syndicaliste chrétien.
La « nouvelle société » devient l'idée force et la formule emblématique recouvrant toutes les initiatives du gouvernement Chaban-Delmas.
Par ses attitudes, l'homme veut d'ailleurs incarner un « nouveau » type de personnalité politique. Il est « moderne », svelte, sportif, séducteur, souriant.
Cette apparence peut être à soi seule un manifeste politique.
Il y a d'ailleurs une ressemblance d'allure entre Chaban, Valéry Giscard d'Estaing – ministre de l'Économie et des Finances – et Jean-Jacques Servan-Schreiber, directeur de l'Express, désormais président du Parti radical, auteur du programme radical Ciel et Terre. À travers eux s'affirme un parallélisme des volontés réformatrices.
Les mots réforme, réformateur, peuplent les discours politiques. Ils justifient les mesures prises par le gouvernement.
Les plus commentées concernent la justice, la radio et la télévision publiques (ORTF), qui se voient garantir l'indépendance. L'effet est réel à la télévision où, pour la première fois, certains magazines – « Cinq colonnes à la une » – reflètent la réalité avec ses conflits et ses tensions.
Mais, pour Pompidou comme pour sa majorité, ce style Chaban, ces mesures, sont autant de concessions à la « gauche », qui fragilisent la majorité.
La situation économique se dégrade sous l'effet des mesures monétaires prises par les États-Unis de Richard Nixon (fin de la convertibilité entre le dollar et l'or, chute du dollar, hausse des cours du pétrole : en 1973, le prix du baril est multiplié par quatre). Les conflits sociaux s'aggravent. La gauche progresse, et aux élections de 1973, en pourcentage de votants, elle dépasse même la majorité (42,99 % pour cette dernière, 43,23 % pour la gauche).
Pompidou avait anticipé ce recul, tentant, par le renvoi de Chaban et son remplacement par Pierre Messmer, en juillet 1972, de rassembler sa majorité sur les « valeurs traditionnelles » du modèle ancien.
Ce redressement paraît d'autant plus nécessaire que François Mitterrand – en 1971, au congrès d'Épinay – a pris la tête d'un nouveau Parti socialiste. Celui-ci a signé en 1972 avec le PCF et le Mouvement des radicaux de gauche (MRG) un Programme commun de gouvernement. La gauche a donc resurgi rapidement des décombres de 1969. Et il apparaît, au vu des résultats électoraux de 1973, qu'elle fait jeu égal avec la droite.
C'est ainsi qu'à la mort de Pompidou – 2 avril 1974 –, face à la candidature de Valéry Giscard d'Estaing, représentant des modérés libéraux, les gaullistes se divisent. Chaban-Delmas est candidat, mais une partie des gaullistes, derrière Jacques Chirac, apportent leur soutien à Giscard.
Celui-ci l'emporte sur François Mitterrand, candidat unique de la gauche (49,2 % des voix contre 50,8 %, soit une différence de 425 599 voix).
Le faible écart qui sépare les deux candidats est signe de l'incertitude française.
La gauche est portée par le désir d'alternance, les premières conséquences sociales du choc pétrolier de 1973, le recours à une histoire mythifiée : le Front populaire, l'unité d'action.
Maints acteurs de Mai ont adhéré au PS après le congrès d'Épinay, comme de nombreux militants du syndicalisme chrétien. De nouvelles générations peuplent ainsi la gauche et lui donnent un nouveau dynamisme, renforcé par le fait que le PCF perd de son hégémonie culturelle et politique. Il se dégrade en même temps que l'image de l'URSS.
L'« esprit de Mai » reverdit le vieil arbre socialiste, et, dès le lendemain de la défaite du 19 mai 1974 face à Giscard, chacun, à gauche, estime que la victoire était – sera bientôt – à portée de main.
Pourtant, Giscard d'Estaing est le président le plus décidé à « moderniser » la société française.
Jeune (quarante-huit ans en 1974), il déclare au lendemain de son élection : « De ce jour date une ère nouvelle de la politique française. » Il a choisi Jacques Chirac comme Premier ministre, mais c'est pour neutraliser le parti gaulliste. Son gouvernement comporte des réformateurs (Jean-Jacques Servan-Schreiber, Françoise Giroud), des personnalités indépendantes (Simone Veil).
Mais, surtout, cet homme d'expérience (ministre de l'Économie et des Finances de 1959 à 1966, puis de 1969 à 1974) qui a contribué à la chute de De Gaulle en appelant à voter non au référendum de 1969 a un véritable projet pour la France.
Et il est l'antithèse du projet gaullien.
Il s'agit d'abord de réaliser que la France n'est qu'une puissance moyenne (1 à 2 % de la population mondiale, insiste-t-il). Elle doit abandonner ses rêves de grandeur, se contenter d'être l'ingénieur de la construction européenne, qui est son grand dessein et sa chance.
Giscard est, pour l'Europe, le maître d'œuvre de réformes décisives (élection au suffrage universel du Parlement européen, création du Système monétaire européen, renforcement des liens avec l'Allemagne).
Il est à l'initiative des rencontres des Grands, le G5, pour discuter des affaires du monde.
Il croit à la possibilité de la détente internationale comme à la fin de la « guerre civile froide » que se livrent les forces politiques françaises. Il est partisan de la « décrispation », d'une « démocratie française apaisée », de la possibilité de gouverner au centre, en accord avec le groupe central – les classes moyennes –, et, il l'annonce dès 1980, il acceptera une « cohabitation » avec une majorité législative hostile, et la laissera gouverner.
C'est une négation de l'esprit des institutions tel que de Gaulle l'avait mis en œuvre : à chaque élection, il remettait son mandat en question.
En fait, Giscard exprime la « tradition orléaniste » française, qui accepte une partie de l'héritage révolutionnaire et veut oublier que « l'histoire est tragique », ou à tout le moins qu'elle n'est pas seulement le produit et le reflet de la Raison.
Giscard met ce projet en scène.
Le président est un homme accessible. Il remonte à pied les Champs-Élysées. Il s'invite à dîner chez des Français. Il visite les prisons.
C'est un souverain, mais proche, ouvert. Il joue de l'accordéon et au football.
La « communication » commence à balayer comme un grand vent les traditions compassées de la vie politique.
Il s'agit de changer les mœurs, de prendre en compte l'esprit de Mai.
Majorité et droit de vote à dix-huit ans, loi sur l'interruption volontaire de grossesse, création d'un secrétariat d'État à la Condition féminine et réforme de l'ORTF sont la traduction institutionnelle des revendications sociétales apparues en 1968. De même, la multiplication des débats où le président rencontre des lycéens ou des économistes veut montrer que le pouvoir est favorable à la « prise de parole », au dialogue avec les citoyens.
Cependant, ce projet récupérateur, moderne, souvent anticipateur, ne va pas permettre la réélection de Giscard en mai 1981.
D'abord parce que la crise de 1973 fait sentir ses effets : le chômage devient une réalité.
Ensuite, les « gaullistes » s'opposent aux « giscardiens » à partir de 1976, de la démission de Chirac du poste de Premier ministre, puis de son élection – contre un giscardien – à la mairie de Paris. Ils signifient qu'ils sont dans l'« opposition ».
Cette défection est révélatrice.
Les gaullistes – leurs électeurs – sont heurtés par la « déconstruction » active, proclamée, exaltée, du « système français ».
Le patriotisme français – ravivé par de Gaulle – s'irrite de cette volonté giscardienne de gommer les spécificités françaises, de nier l'exception et la grandeur nationales.
On est choqué qu'il ait choisi de s'exprimer en anglais lors de sa première conférence de presse.
L'histoire nationale résiste, l'âme de la France se cabre. Quant à la rigueur du nouveau Premier ministre, Raymond Barre, elle heurte. Ni l'opinion ni les forces politiques ne sont prêtes à entendre le professeur Barre, « meilleur économiste de France », énoncer des vérités déplaisantes sur la réalité sociale et économique du pays. D'une certaine manière, la « modernisation » giscardienne devance l'évolution du pays.
François Mitterrand, au contraire, veille à rassembler à la fois les « modernisateurs » – ainsi, en matière d'information, il est partisan des « radios libres », ou bien il prend explicitement position contre la peine de mort – et les « conservateurs » de la gauche.
Ces derniers, d'ailleurs, souhaitent l'alternance politique à n'importe quel prix.
Mitterrand sait leur parler non de « groupe central », ou de la fin de « la guerre civile froide franco-française ». Il évoque le Front populaire (lui-même porte un grand chapeau à la Blum !), la lutte des classes, le sort d'Allende – le président chilien renversé et mort après un coup d'État militaire soutenu par les États-Unis le 11 septembre 1973.
Les communistes, qui ont rompu avec lui sur le Programme commun en 1977 – ce qui a permis la victoire des giscardiens aux législatives de 1978 –, sont contraints de se rallier à lui au second tour.
Tous les Français – y compris les gaullistes – qu'inquiète la « modernisation » de la France, laquelle n'est à leurs yeux qu'une américanisation, se retrouvent dans l'idée d'une « force tranquille » qui protège, sur les affiches de Mitterrand, un village traditionnel blotti autour de son église.
Image « pétainiste » qui renvoie à la terre, aux traditions, repoussant Giscard dans une modernité sans racines dont on ne veut pas. Transformant le « modernisateur » qu'il est en une sorte d'aristocrate rentré de Coblence, compromis dans une affaire des diamants comme il y eut une affaire du collier de la reine ! La calomnie est, de tradition nationale, une arme politique.
Mitterrand est élu le 10 mai 1981 avec 51,75 % des voix contre 48,24 % à Giscard (15 708 262 voix contre 14 642 306).
En juin 1981, les législatives font écho à ce succès présidentiel : le PS et ses alliés obtiennent la majorité des sièges à l'Assemblée.
C'est moins un fort déplacement de voix que les abstentions des électeurs de droite qui sont à l'origine de ce succès.
L'alternance politique est complète.
Mais, pour vaincre, il a fallu ne pas choisir entre « modernes » et « archaïques », donner des gages aux uns et aux autres tout en privilégiant la phraséologie marxisante pour séduire les plus militants des électeurs.
Cette ambiguïté ne peut qu'être source de déceptions.
Mais il est sûr que la victoire n'a été possible que par le ralliement à la gauche des « révolutionnaires » de mai 1968.
En mai 1981, venus de la Bastille, ils arpentèrent les rues du Quartier latin – du théâtre d'une révolution vraie à celui d'une révolution simulacre – en scandant : « Treize ans déjà, coucou nous revoilà ! »
71.
À compter de 1981 et durant les vingt dernières années du xxe siècle, la France est déchirée entre illusions et réalité, entre promesses et nécessités.
Certes, souvent l'âme de la France s'est réfugiée dans les songes et les mythes glorificateurs ou consolateurs. Ils avaient aussi la vertu de pousser le peuple à accepter, à conquérir l'avenir.
Rien de tel depuis l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. C'est comme si la vie politique française – gauche et droite confondues – n'avait plus pour objet que de cacher la vérité aux électeurs, de les gruger afin de les convaincre de voter pour tel ou tel candidat.
Si bien que l'écart n'a jamais été aussi grand entre programmes et réalisations, entre discours et actes.
Et jamais la déception n'a été aussi profonde dans l'âme de chaque Français ; le pays entier bascule dans l'amertume, la colère, le mépris à l'égard de la « classe politique » qui gouverne.
Les abstentionnistes sont de plus en plus nombreux et les partis extrémistes – de droite comme de gauche –, protestataires exclus de la représentation parlementaire et de l'exécutif, recueillent les « déçus » des partis de gouvernement, Parti socialiste et RPR – ce parti qui se prétend gaulliste mais qui n'est qu'au service de « son » candidat, Jacques Chirac.
Le PS comme le RPR ont promis des réformes radicales : les uns faisant miroiter au pays la justice sociale, l'égalité ; les autres, la croissance, l'efficacité, donc la richesse et le profit.
Le programme socialiste de 1981 vise même à « changer la vie » !
Jack Lang, ministre de la Culture inamovible, caractérise l'alternance comme le passage « de la nuit à la lumière ». Il inaugure la première fête de la Musique le 21 juin 1981 – jour du deuxième tour des élections législatives qui vont donner la majorité absolue au PS associé aux radicaux de gauche (MRG), débarrassant ainsi Mitterrand de l'hypothèque et du chantage communistes.
Mais l'avenir ne sera pas une fête.
En 1982, dévorée par l'inflation, la France compte pour la première fois de son histoire plus de deux millions de chômeurs.
Quant à Jacques Chirac, élu à la présidence de la République en 1995 au terme des deux septennats de François Mitterrand, il dénonce dans sa campagne contre Édouard Balladur, issu du RPR, Premier ministre de 1993 à 1995, la « fracture sociale ». Et s'engage à la réduire.
Quelques semaines après sa victoire, plus personne ne croit plus au joueur de flûte qui a guidé les électeurs jusqu'aux urnes.
La déception, la méfiance et, ce qui est peut-être pire, l'indifférence méprisante à l'égard des politiques, qui pénètrent l'opinion, expliquent l'instabilité qui s'installe dans les sommets de l'État.
Il peut paraître paradoxal de parler d'instabilité quand François Mitterrand est président de la République pendant quatorze ans et Jacques Chirac, douze ans (un septennat, un quinquennat, 1995-2002-2007). Mais ces durées ne sont que la manifestation la plus éclatante du mensonge et de la duperie qui se sont nichés au cœur de la République.
Ce trucage, destiné à masquer la déconstruction des institutions de la Ve République, se nomme « cohabitation ». Il ne s'agit pas d'un pouvoir rassemblant autour d'un programme résultant d'un compromis politique, du type « grande coalition » entre démocratie chrétienne et sociaux-démocrates allemands, mais d'une neutralisation – stérilisation et paralysie – du président et du Premier ministre issus de partis opposés et préparant la revanche de leurs camps.
La « cohabitation » est pire que l'instabilité qui naissait de la rotation accélérée du manège ministériel sous les IIIe et IVe Républiques. Car, ici, l'ambiguïté, l'hypocrisie, la « guerre couverte », sont le quotidien de l'exécutif bicéphale dominé par la préparation de l'échéance électorale suivante.
Ce système – annoncé par Giscard d'Estaing – présente certes l'avantage de montrer qu'entre les grandes familles politiques, dans un pays démocratique, les guerres de religion et l'affrontement d'idéologies totalitaires contraires ont cédé la place à des divergences raisonnées à propos des politiques à mettre en œuvre au sein d'une société, d'une économie, d'un monde que plus personne ne veut radicalement changer.
C'est bien la fin de la « guerre civile franco-française », le choix de gouverner en s'appuyant sur un groupe central, souhaités par Giscard, qui se mettent lentement en place.
Mais, de manière parallèle, le mitterrandisme puis le chiraquisme ne sont que des giscardismes masqués, l'un sous les discours de gauche, l'autre, sous les propos volontaristes d'un néogaullisme improbable.
Déçu par les majorités qu'il élit, le peuple, d'une échéance électorale à l'autre, contredit son vote précédent, et aucune majorité gouvernementale ne se succède à elle-même depuis 1981.
En 1986, la droite l'emporte aux législatives et Chirac devient le Premier ministre de François Mitterrand.
Ce dernier, désavoué par la défaite de son camp aux législatives, a « giscardisé » les institutions en ne démissionnant pas, mais en menant, de 1986 à 1988, une guerre souterraine contre Chirac, battu en 1988 par un président malade de soixante-douze ans.
Mitterrand dissout alors l'Assemblée. Une majorité socialiste est élue, et Rocard est investi chef du gouvernement.
En 1993, effondrement socialiste, gouvernement d'Édouard Balladur et présidence de Mitterrand jusqu'en 1995.
Élection de Chirac, qui ne dissoudra l'Assemblée – de droite – qu'en 1997, et début d'une nouvelle cohabitation, puisqu'une Assemblée à majorité socialiste est élue...
Cette rivalité au sommet trouve sa justification dans le recours à des discours qui, au nom du « socialisme » ou du « libéralisme », anathématisent l'autre.
Mais ils ne convainquent plus qu'une frange toujours plus réduite de la population. Les couches populaires sont de moins en moins sensibles à ces invocations idéologisées qui n'empêchent pas la dégradation de leur situation (chômeurs, exclus, bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, habitants de « quartiers défavorisés »). Ils ressentent cette « guerre verbale » comme un théâtre qui ne parvient plus à masquer une convergence, des arrangements qu'on ne saurait avouer puisqu'il faut, pour des raisons électorales et de partage du pouvoir, continuer de s'opposer comme à Guignol.
Les changements radicaux intervenus dans la situation mondiale rendent encore plus factices les affrontements entre une gauche qui continue de parler parfois marxiste – à tout le moins « socialiste » – et une droite qui, comme la gauche de gouvernement, applaudit à la construction européenne et aux traités qui l'élèvent : Acte unique, Maastricht, monnaie unique, etc.
On verra sur les mêmes tribunes, en 1992, ministres « socialistes » et chiraquiens ou giscardiens favorables à la ratification du traité de Maastricht, cependant que d'autres socialistes (Chevènement) et d'autres « gaullistes » (Séguin) s'y opposeront, les uns et les autres rejoignant pour l'élection présidentielle de 1995 des cases différentes : Séguin, celle de Chirac, Chevènement, celle de Jospin, les giscardiens et d'autres RPR, celle de Balladur.
En fait, la question européenne est révélatrice de la position des élites politiques – et intellectuelles – à l'égard des questions internationales.
Car Mitterrand ne rejette pas seulement l'esprit et la pratique gaulliens des institutions, il abandonne aussi les fondements de la politique extérieure de De Gaulle.
Comme Giscard, il estime que la France ne peut jouer un rôle qu'au sein de l'Europe : « La France est notre patrie, mais l'Europe est notre avenir », répète-t-il. Il faut donc reprendre sa place dans l'OTAN, suivre les États-Unis dans la guerre du Golfe (1990).
La chute du mur de Berlin – 1989 – et la réunification de l'Allemagne, puis la disparition de l'Union soviétique, confortent la diplomatie mitterrandienne dans l'idée que seule l'Union européenne offre à la France un champ d'action.
Restent les interventions dans le pré carré africain, les discours sur les droits de l'homme qui tentent de redonner à la France une audience mondiale non plus au plan politique, mais par les propos moralisateurs, comme si compassion et assistance étaient la menue monnaie de la vocation universaliste de la France.
Ces prises de position manifestent le ralliement du pouvoir socialiste puis du pouvoir chiraquien à l'idéologie du « droit et du devoir d'ingérence », puis du Tribunal pénal international, qui s'appuie sur la conviction que le temps de la souveraineté des nations est révolu.
Les formes nationales étant obsolètes, il convient de privilégier les communautés, les individus, et de rogner les pouvoirs de l'État.
En ce sens, les gouvernements socialistes sont aussi en rupture avec une « certaine idée de la France ».
Ils retrouvent la veine du pacifisme socialiste de l'entre-deux-guerres. C'est au nom de ce pacifisme qu'on juge la Communauté européenne. Elle est censée avoir instauré la paix entre les nations belliqueuses du Vieux Continent. Cette idéologie « postnationale » ne permet pas de comprendre qu'il existe une « âme de la France » et que le peuple – dans ses couches les plus humbles – ressent douloureusement qu'on ne s'y réfère plus. Pis : qu'on la nie.
Et rares sont les politiques – à droite comme à gauche – qui prennent conscience du caractère « national » de la révolution démocratique qui secoue et libère l'Europe centrale après la chute du mur de Berlin et la fin de l'URSS.
Cette force du désir d'identité nationale est ignorée. Évoquer la France, a fortiori la patrie ou la nation, est jugé, par la plupart des socialistes, comme l'expression d'un archaïsme réactionnaire.
Durant les deux septennats de François Mitterrand, ce qui a été mis en avant, ce sont les problèmes économiques, sociaux, voire sociétaux.
Certes, réduire la durée du temps de travail à trente-neuf heures, fixer l'âge de la retraite à soixante ans, instituer une cinquième semaine de congés payés, c'est satisfaire les couches salariées.
Mais l'état de grâce, comme au temps du Front populaire, ne dure que quelques mois. Et les mesures prises en 1981, qui rappellent celles décidées en 1936, les « avancées sociales ou les nationalisations », n'empêchent pas le nombre de chômeurs d'augmenter, les déficits, de se creuser.
C'est qu'il y a une liaison intime entre l'insertion au sein de la Communauté européenne, les choix libéraux qui sont faits à Bruxelles et la politique qu'un gouvernement peut suivre. Et, au bout de quelques mois, dès 1982-1983, s'annoncent la « pause » dans les réformes, la « rigueur ».
Ne pas s'engager dans cette voie, choisir une « autre politique », exigerait de prendre ses distances avec l'Europe. Ce serait une rupture révolutionnaire, et Mitterrand, malgré les conseils de quelques-uns de ses proches, ne la veut pas.
Au vrai, la nomination dès 1981 de Jacques Delors – naguère l'un des concepteurs de la « nouvelle société » de Chaban – au poste de ministre de l'Économie et des Finances montre bien que, malgré quelques pas de côté, Mitterrand ne tenait pas à s'éloigner de la piste du bal.
Mais alors tout discours « socialiste » devient mensonger, puisque la politique économique et budgétaire, et donc la politique sociale engendrée par les choix économiques et financiers, est encadrée par Bruxelles.
Mitterrand peut bien, dans des envolées lyriques, dénoncer « l'argent qui grossit en dormant », son Premier ministre Bérégovoy ouvre la France à la libre circulation des capitaux, met en œuvre une législation favorable à l'expansion de la Bourse, maintient une politique monétaire du franc fort qui provoque la hausse du chômage.
En abandonnant la souveraineté nationale, Mitterrand et les socialistes, aux discours près, acceptent une politique de libéralisation qui est en contradiction avec les mesures économiques et sociales qu'ils ont prises en 1981-1982 ou qu'ils promettent encore. Ce qu'ils développent, face à l'impossibilité de prendre des mesures « socialistes » dans le cadre européen dont ils exaltent par ailleurs la nécessité et la pertinence, c'est une politique sociale d'assistance dont le RMI (Michel Rocard), les « emplois aidés », les allocations de toutes sortes, sont l'expression.
Mais la politique sociale creuse le déficit budgétaire, il faudrait relancer la croissance, donc baisser les impôts pour attirer les investissements et favoriser la consommation, ce qui accroîtrait d'autant les déficits – toutes choses en contradiction avec le traité de Maastricht. Le piège européen est en place, qui condamne toute politique non libérale.
Dès lors, le chômage, résultat de ces contradictions, s'accroît. Mitterrand s'avoue incapable de le réduire (« Nous avons tout essayé »).
Par ailleurs, le nombre des immigrés augmente, résultat de la politique de regroupement familial, d'ouverture des frontières, et de l'attrait qu'exercent la France et l'Europe sur les populations misérables du Sud et de l'Est.
Mais les Français ont le sentiment que l'identité de la nation change au moment même où ils perçoivent que le pays a perdu sa souveraineté politique.
Les élites françaises – celles de gauche au premier chef – persistent à ne pas comprendre cette angoisse et cette souffrance, à propos de la perte de la nation, qu'éprouvent les catégories les plus humbles.
Les réponses « mitterrandiennes » sont sociétales, le plus souvent tactiques et politiciennes.
On suscite la création de mouvements antiracistes, manière de dériver vers une bataille idéologique à faible incidence économique, donc compatible avec les directives européennes, les protestations populaires.
L'émergence, à partir de 1983, d'une formation d'extrême droite, le Front national de Jean-Marie Le Pen, qui se présente comme un mouvement nationaliste et qui atteindra en 1995 plus de 15 % des voix, favorise la stratégie mitterrandienne.
On agite l'épouvantail du Front national pour compromettre la droite si elle songeait à s'allier avec lui, et pour rassembler autour de la gauche les jeunes générations.
On recrée une tension idéologique qui déplace les affrontements sociaux sur le terrain de la menace fasciste, du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie.
En fait, on abandonne le thème de la souveraineté nationale à cette extrême droite, ce qui, imagine-t-on, va conforter l'européisme.
On oublie que la « nation », la défense de l'identité française, sont des éléments fondamentaux de l'âme de la France.
Or des millions de Français, surtout parmi les couches populaires, ont le sentiment qu'ils ne sont plus pris en compte.
Les défilés populaires du 1er mai sont des rituels qui paraissent désuets, tandis que la Gay Pride occupe les écrans de télévision.
L'âme de la France semble à beaucoup s'évanouir.
On ne se reconnaît plus dans les orientations politiques. Où est la gauche ? Où est la droite ? Qu'est devenue la France ?
La corruption éclabousse tous les milieux politiques.
Le 1er mai 1993 – jour symbolique –, l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy se suicide.
C'est comme si une gauche, celle qui avait conquis le pouvoir et gouverné avec François Mitterrand, venait de mourir. L'Assemblée nationale est à droite, Édouard Balladur est Premier ministre d'un président de la République rongé par la maladie.
En 1995, Jacques Chirac va être élu avec 52,64 % des voix contre 47,36 % à Lionel Jospin, candidat du Parti socialiste.
Ces chiffres ne donnent pas la mesure de la profondeur des changements qui ont affecté l'âme de la France au cours des deux septennats de François Mitterrand.
Le temps de la « force tranquille », du village immuable de 1981 recueilli autour de son clocher, paraît d'un autre siècle.
En 1995, il est question de mosquées et non d'églises.
Le débat qui avait secoué le pays en 1984 sur la place de l'enseignement privé – catholique – et qui, le 24 juin de cette année-là, avait mobilisé plus d'un million de manifestants défendant la « liberté de l'enseignement » contre l'idée d'un grand service public unifié prôné par les socialistes, a été tranché ; la querelle – qui peut rejouer en telle ou telle circonstance – n'occupe plus le devant de la scène.
Mais la question de la laïcité reste centrale. Et elle s'est posée à la fin du second septennat de Mitterrand à propos de l'autorisation ou de l'interdiction donnée aux jeunes musulmanes de porter en classe un foulard islamique.
Tout comme demeure ouverte la question du rôle de l'État central. Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur de Mitterrand, avait, dès 1981, engagé le pays dans la voie de la décentralisation. Elle s'est élargie pas à pas.
Fallait-il aller jusqu'à l'autonomie, négocier avec les nationalistes corses qui n'hésitent pas à utiliser la violence ?
Ces questions – laïcité, pouvoirs de l'État central –, comme les politiques économiques et budgétaires, se posent dans le cadre de l'Union européenne. Du coup, certains s'interrogent : pourquoi un étage national, dès lors qu'il y a le rez-de-chaussée régional et la terrasse européenne ? La nation n'est-elle pas devenue caduque, inutile ?
Durant les deux septennats mitterrandiens, la place, la puissance, la signification de la nation, qui avaient été les obsessions de De Gaulle, paraissent absentes des préoccupations socialistes.
L'âme de la France, c'est dans les paysages de ses terroirs qu'elle gît désormais. On la rencontre au sommet de la roche de Solutré ou sur le mont Beuvray, site de la ville gauloise de Bibracte où Mitterrand avait songé à se faire inhumer, achetant même à cette fin un carré de cette terre, de cette histoire.
Mais l'indépendance, la souveraineté de la nation, que sont-elles devenues ?
Mitterrand enrichit Paris de monuments. Il croit donc à la pérennité de la capitale de la France.
Mais est-elle pour lui un centre d'impulsion politique au rayonnement mondial, ou seulement un lieu de promenades touristiques et gastronomiques dont ce gourmet de la vie sous toutes ses formes était particulièrement friand ?
L'âme de la France ne doit-elle plus être que cela : une mémoire qu'on visite comme un musée ?
Au fond, durant deux septennats, François Mitterrand a fait à son peuple la « pédagogie du renoncement tranquille ».
Et le peuple, de manière instinctive, en s'abstenant aux élections, en changeant de représentants, en votant pour les « irréguliers », a protesté, s'est débattu comme un homme qui refuse les somnifères et ne veut pas renoncer à son âme.
Et qui s'indigne qu'au moment où toutes les nations renaissent on veuille que l'une des plus anciennes et des plus glorieuses s'assoupisse.
72.
De 1995 à 2007, d'un siècle à l'autre, la question de la France est posée.
Comme aux moments les plus cruciaux de son histoire – guerre de Cent Ans ou guerres de Religion, « étrange défaite » de 1940 –, c'est de la survie de son âme qu'il s'agit.
C'est dire que le bilan de la double présidence de Jacques Chirac – 1995-2002-2007 – ou du quinquennat au poste de Premier ministre de Lionel Jospin (1997-2002), dans le cadre de la plus longue période de cohabitation de la Ve République, ne saurait se limiter à évaluer les qualités et les faiblesses des deux chefs de l'exécutif, ou à mesurer l'ampleur des problèmes qu'ils ont été conduits à affronter dans un environnement international qui change totalement de visage et pèse sur la France.
En 1995, on imaginait encore, malgré la guerre du Golfe contre l'Irak, un avenir de paix mondiale patronnée par l'hyperpuissance américaine.
En fait, la guerre sous toutes ses formes a rapidement obscurci l'horizon. Bombardement et destruction de villes européennes (Dubrovnik, Sarajevo, puis Belgrade écrasée sous les attaques aériennes de l'OTAN en 1999). Et la France s'est engagée dans ce conflit des Balkans contre ses alliés traditionnels, les Serbes au nom du « droit d'ingérence ».
Elle est aussi concernée, comme toutes les puissances occidentales, par l'attaque réussie contre les États-Unis (World Trade Center, 11 septembre 2001).
« Nous sommes tous américains », affirme le directeur du Monde – et la France s'engage dans la guerre contre l'Afghanistan (2002).
Mais elle conteste l'intervention des États-Unis et de leurs alliés en Irak en 2003.
La posture de Chirac, le discours de son ministre des Affaires étrangères, Villepin, au Conseil de sécurité de l'ONU, semblent réactiver une politique extérieure « gaullienne », la France apparaissant comme le leader des pays qui tentent de conserver un espace de dialogue entre les deux civilisations, musulmane et chrétienne.
Ce n'est néanmoins, dans la politique étrangère française, qu'une séquence, certes majeure, mais contredite par d'autres attitudes. Comme si Chirac, plus opportuniste que déterminé, hésitait à élaborer une voie française.
Il est vrai que son choix a suscité dans les élites françaises des critiques nombreuses. On a dénoncé son « antiaméricanisme ».
Par ailleurs, la radicalisation de la situation mondiale se poursuit : attentats de Madrid et de Londres (2004-2005) ; reprise des violences en Afghanistan ; guerre civile en Irak ; guerre entre Israël et le Hezbollah aux dépens du Liban en 2006 ; ambitions nucléaires de l'Iran ; pourrissement de la question palestinienne.
La France hésite, condamne l'idée d'un choc des civilisations entre l'islamisme et l'Occident.
Chirac craint que cet affrontement ne provoque des tensions – elles existent déjà, mais restent marginales – entre des Français d'origines et de confessions différentes.
La France semble donc incertaine, la situation internationale mettant à l'épreuve sa capacité à résister aux forces extérieures.
L'inquiétude se fait jour de voir renaître des « partis de l'étranger », l'appartenance à telle ou telle communauté apparaissant, pour des raisons religieuses, plus essentielle que la spécificité française.
Ainsi se trouve posée la question de la « communautarisation » de la société nationale.
Or, de 1995 à 1997, de nombreux indices ont montré qu'elle était en cours.
On a vu le Premier ministre Lionel Jospin conclure avec les nationalistes corses des accords de Matignon – un « relevé de conclusions » – sans que ses interlocuteurs aient renoncé à légitimer le recours à la violence et à revendiquer l'indépendance.
En acceptant d'ouvrir des discussions avec eux – pas seulement pour des raisons électorales : la présidentielle de 2002 est proche –, Jospin reconnaît de fait la pertinence de la stratégie nationaliste et la thèse d'une Corse colonisée et exploitée par la France.
Or – toutes les élections le montrent – les nationalistes ne représentent qu'une minorité violente, s'autoproclamant représentative du « peuple corse », tout comme les gauchistes affirmaient naguère qu'ils étaient l'expression de la classe ouvrière.
Cette reconnaissance par le Premier ministre, avec l'assentiment tacite du président de la République, et par toutes les « élites » politiques de ce pays – exception faite de quelques « irréguliers » comme Jean-Pierre Chevènement – est lourde de sens.
Le 6 février 1998, en effet, le préfet de Corse, Claude Érignac, a été tué d'une balle dans la nuque à Ajaccio par des nationalistes.
Toutes les autorités républicaines et la population corse ont condamné ce crime hautement symbolique. Le préfet représente l'État centralisé – napoléonien, mais héritier de la monarchie. L'abattre, c'est, par la lâcheté du crime et par sa signification, atteindre l'État, la France, marquer que l'on veut les « déconstruire ».
Accepter que les porte-parole de ces criminels non repentis négocient à Matignon, c'est capituler, admettre, à terme, la fin de la République une et indivisible.
Ceux qui dirigent l'État entre 1995 et 2007 – qu'ils appartiennent au parti chiraquien ou à la « gauche plurielle » – ont jugé que l'espoir de paix civile valait l'abandon des principes républicains.
D'autres signes jalonnant la marche vers une société française communautarisée se multiplient entre 1995 et 2007.
La création du Conseil français du culte musulman, les nombreuses critiques émises au moment de la loi interdisant le port du voile islamique dans certaines conditions, la création d'associations se définissant par leurs origines (Conseil représentatif des associations noires, Indigènes de la République, etc.) sont, quelles que soient les intentions de leurs initiateurs, la preuve de l'émiettement désiré de l'identité française.
Et déjà surgissent – avivées par la situation internationale – des rivalités entre ces communautés.
C'est bien l'« âme de la France » qui se retrouve ainsi contestée dans l'un de ses aspects essentiels : « l'égalité entre les individus liés personnellement à la nation, sans le “filtre” et la médiation d'une représentation communautaire, éthique ou religieuse ».
Le même processus de « déconstruction nationale » est à l'œuvre dans la plupart des secteurs de la vie politique, économique, sociale et intellectuelle.
Dans le domaine institutionnel, Chirac et Jospin ont, de concert, réduit le mandat présidentiel à cinq ans.
Ils poursuivent ainsi le travail de sape de la Constitution gaullienne entrepris par Mitterrand.
Chirac, comme Mitterrand, choisit la cohabitation comme moyen de survie politique.
Il est en effet confronté, dès les lendemains de sa victoire de 1995, à l'impossibilité de tenir ses promesses électorales.
Les contraintes budgétaires d'origine européenne sont renforcées par les obligations liées au passage à la monnaie unique, l'euro, prévu pour 2002.
Premier ministre, Alain Juppé – né en 1945, pur produit de l'élitisme républicain (ENS-ENA) – applique donc une politique de rigueur qui soulève contre lui, en décembre 1995, une vague de grèves à la SNCF, soutenues par une partie des élites intellectuelles représentée par le sociologue Pierre Bourdieu.
Ce dernier aspect est significatif de la permanence et de la réactivation en France d'un courant critique radical. La mort de Sartre en 1980 n'a pas fait disparaître la posture de l'intellectuel critique. Même si les figures emblématiques sont moins nombreuses – Bourdieu en est alors une –, la multiplication du nombre des enseignants et des étudiants aux conditions de vie difficiles crée une sorte de « parti intellectuel prolétarisé ».
Sans se référer obligatoirement à une idéologie définie, les jeunes professeurs, les étudiants diplômés à la recherche d'un emploi, retrouvent, dans telle ou telle circonstance, un discours radical.
Certains d'entre eux, durant cette période 1995-2007, vont rejoindre les rangs des formations d'extrême gauche qui contestent le Parti socialiste en tant que parti de gouvernement. Ces nouvelles générations, plus instinctives et spontanées que théoriciennes, sans culture historique, philosophique ou révolutionnaire précise, prolongent néanmoins une tradition nationale contestatrice.
Dès lors, en France, la « gauche » gouvernementale, séduite par la « troisième voie » telle que peuvent l'exprimer un Clinton, un Tony Blair, un Schröder (à la conférence des sociaux-démocrates européens réunie à Florence en 1999, Jospin, Premier ministre, est présent aux côtés de Bill Clinton), est électoralement menacée et idéologiquement bloquée par cette extrême gauche.
Quand la social-démocratie explicite et théorise sa ligne politique – Lionel Jospin, né en 1937, de culture trotskiste, s'y essaie –, elle ne peut que dire qu'elle est favorable à l'économie de marché, et hostile à une « société de marché ».
Mais elle est serrée par la mâchoire européenne. Elle ne peut prendre que des mesures sociales, étatiques – réduction de la semaine de travail à trente-cinq heures, création d'emplois aidés, recrutement de fonctionnaires –, qui remettent en cause l'efficacité économique libérale.
Elle est tentée de dépasser ces contradictions en portant le combat contre la droite sur le terrain sociétal : mesures en faveur des immigrés, des homosexuels (PACS, bientôt mariage, droit à l'adoption). Mais elle s'avance prudemment sur le terrain de la flexibilité du travail, compte tenu de cette extrême gauche active qui exerce une sorte de chantage idéologique sur elle.
Ces hésitations du Parti socialiste, ce paysage politique qui se radicalise à l'extrême gauche – et, sur l'autre versant, à l'extrême droite : 15 % de voix pour le Front national à l'élection présidentielle de 1995 –, fragilisent la démocratie représentative.
En décembre 1995, les grévistes font reculer Chirac, qui, pour sortir le gouvernement Juppé de l'impasse, provoque la dissolution de l'Assemblée en 1997.
La gauche l'emporte, et une cohabitation de cinq années commence, avec comme seul objectif, pour Chirac, d'user Jospin afin de le battre à l'élection présidentielle de 2002.
Et Jospin, lui, n'a pour but politique que d'être élu président.
Entre leurs mains politiciennes, les institutions de la Ve République sont devenues une machine à empêcher tout projet à long terme !
Surprise révélatrice de la profondeur de la crise nationale et de la crise de la gauche : pour la première fois depuis 1969, le représentant du Parti socialiste, concurrencé par d'autres candidats se réclamant de la gauche, ne sera pas présent au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Jospin, écarté par les électeurs, Le Pen est opposé à Chirac, devenu le candidat « républicain », « antifasciste », « antiraciste », etc.
Débat truqué qui empêche la vraie confrontation entre Chirac et Jospin !
Mais situation exemplaire : les électeurs ne croient plus à la différence entre la gauche et la droite de gouvernement, liées en effet par le carcan européen.
Dès lors, c'est la rue qui décide.
En 2006, une loi votée par le Parlement – sur le contrat première embauche (CPE) – suscite des manifestations importantes. Jacques Chirac la promulgue puis la retire aussitôt, désavouant et protégeant tout à la fois son Premier ministre.
Cette pirouette juridique et politicienne confirme la déconstruction des institutions et le mensonge mêlé de ridicule où sombre la vie politique.
C'est bien la France et son âme qui sont en question.
C'est que, dans tous les secteurs de la société, la crise nationale grossit depuis plusieurs décennies.
En fait, dès les années 30 du xxe siècle, les élites ont commencé à douter de la capacité de la France à surmonter les problèmes qui se posaient à elle.
Les hommes politiques ne réussissaient pas à donner à leur action un sens qui transcende les circonstances, oriente la nation vers un avenir.
Dans ces conditions, la défaite de 1940, cet affrontement cataclysmique, n'avait rien d'« étrange ».
L'impuissance de la IVe République, après la brève euphorie de la victoire, était inscrite dans l'instabilité gouvernementale et dans la médiocrité des hommes politiques, incapables de faire face aux problèmes posés par la fin de l'empire colonial.
Le gaullisme est une parenthèse constructive mais limitée à quelques années – 1962-1967 –, une fois l'affaire algérienne réglée.
Mais, de Gaulle renvoyé, les problèmes demeurent et se compliquent.
Cette France incertaine qui cherche dans la construction européenne un substitut à sa volonté défaillante débouche sur les années 1995-2007, où la crise nationale ne peut plus être masquée.
Il ne s'agit pas de déclin. Les réussites existent. La France reste l'une des grandes puissances du monde. Des tentatives pour arrêter la déconstruction se manifestent çà et là (ainsi la loi sur le voile islamique et quelques postures en politique étrangère). Mais alors que le peuple continue d'espérer que les élites gouvernementales et intellectuelles lui proposeront une perspective d'avenir pour la nation, on lui présente des réponses fractionnées, destinées à chaque catégorie de Français.
Or une somme de communautés, cela ne fait pas une nation, et un entassement de solutions circonstancielles ne fait pas un projet pour la France.
Le vote qui place le Front national au second tour de l'élection présidentielle du 21 avril 2002 traduit ce déficit de sens.
Et le rejet, le 29 mai 2005, du traité constitutionnel européen signifie que la majorité du peuple – contre les élites – ne croit pas qu'un abandon supplémentaire de souveraineté nationale permettra de combler ce déficit de sens qui est cause de la crise nationale. D'autant moins que, de la persistance d'un chômage élevé aux émeutes dans les banlieues (2005), l'insécurité sociale s'accroît, redoublant les problèmes liés à l'identité nationale.
Car durant ces douze années de la présidence Chirac, ce n'est plus seulement le sens de l'avenir de la France qui est en question, mais aussi son histoire.
Ceux qui ne croient plus en l'avenir de la France ou qui refusent de s'y inscrire déconstruisent son histoire, n'en retiennent que les lâchetés, la face sombre.
Par son discours du 16 juillet 1995, Chirac a reconnu la France – non des individus, non l'État de Vichy – coupable et responsable de la persécution antisémite, contredisant ainsi toute la stratégie mémorielle du général de Gaulle. Selon lui, la France – et pas seulement les Papon, les Bousquet, les Touvier – doit faire repentance et être punie.
L'on a vu ainsi s'ouvrir en 2006 un procès intenté à la SNCF, accusée d'avoir accepté de faire rouler les trains de déportés. Et un tribunal condamner l'entreprise nationale, oubliant les contraintes imposées par l'occupant, le rôle héroïque des cheminots dans la Résistance, cette « bataille du rail » exaltée au lendemain de la Libération !
France coupable, comme si la France libre et la France résistante n'avaient pas existé, donnant sens à la nation.
Mais coupable aussi, et devant se repentir pour la colonisation, pour l'esclavage, la France de Louis XIV et de Napoléon, de Jules Ferry et de De Gaulle.
Si bien que, sous la présidence de Chirac, en 2005, la France participe à la célébration de la victoire anglaise de Trafalgar mais n'ose pas commémorer solennellement Austerlitz !
L'anachronisme, destructeur de la complexité contradictoire de l'histoire nationale, est ainsi à l'œuvre, dessinant le portrait d'une Marianne criminelle au détriment de la vérité historique.
Dans cette vision « post-héroïque » de la France, l'État et la communauté nationale sont des oppresseurs à combattre, à châtier, à détruire. Il faut, dit-on, « dénationaliser la France ».
Restent des communautés, chacune avec sa mémoire, s'opposant les unes aux autres, faisant éclater la mémoire collective, la mémoire nationale, ce mythe réputé mensonger.
Et, de 1995 à 2007, l'Assemblée nationale a fixé par la loi cette nouvelle histoire officielle, anachronique, repentante, imposant aux historiens ces nouvelles vérités qu'on ne peut discuter sous peine de procès intentés par les représentants des diverses communautés.
Comment, à partir de cette mémoire émiettée, de cette histoire révisée, reconstruire un sens partagé par toute la nation ?
Comment bâtir avec les citoyens nouveaux qui vivent sur le sol hexagonal un projet pour la France qui rassemblera tous les Français, quelles que soient leurs origines, et faire vivre ainsi l'âme de la France ?
C'est la question qui se pose à la nation à la veille de l'élection présidentielle de 2007, sans doute la plus importante consultation électorale depuis plus d'un demi-siècle.
Avec elle s'ouvre une nouvelle séquence de l'histoire nationale. Elle sera tourmentée. L'élu(e) devra trancher et donc mécontenter et non plus seulement parler, ou séduire et sourire. Les mirages se dissiperont. Après le temps des illusions peut venir celui du ressentiment et de la colère. Certains Français douteront de l'avenir de la nation.
Qu'ils se souviennent alors que, au temps les plus sombres de notre histoire millénaire, dans une France des cavernes le poète René Char, combattant de la Résistance, écrivait :
J'ai confectionné avec des déchets de montagnes
des hommes qui embaumeront quelque temps
les glaciers.
Dans ces lignes mystérieuses, bat l'âme de la France.
Décembre 2006.
CHRONOLOGIE V
Vingt dates clés (1920-2007)
1923 : La France occupe la Ruhr
1933 : Après l'accession de Hitler au pouvoir (30 janvier), l'Allemagne quitte la Société des Nations
1936 : Hitler réoccupe la Rhénanie (7 mars) – Front populaire (mai-juin). Guerre d'Espagne (juillet)
1938 : Accords de Munich
14 juin 1940 : Les Allemands entrent dans Paris, ville ouverte
18 juin 1940 : Appel du général de Gaulle à la résistance
10 juillet 1940 : Pleins pouvoirs à Pétain, fin de la IIIe Répu-blique
1943 : Jean Moulin préside à la création du Conseil national de la Résistance (CNR)
1944 (24 août) : « Paris libéré par lui-même »
Janvier 1946 : De Gaulle démissionne (20 janvier)
1954 : Défaite de Diên Biên Phu (7 mai), attentats en Algérie mar-quant le début de l'insurrection (1er novembre)
Janvier 1956 : Victoire du Front républicain (Mendès France, Guy Mollet)
Mai-juin 1958 : Retour au pouvoir du général de Gaulle
18 mars 1962 : Fin de la guerre d'Algérie
10 mai 1981 : François Mitterrand élu président de la Répu-blique. Il le restera jusqu'en 1995 (réélu en 1988)
1995-2007 : Présidences de Jacques Chirac (réélu en 2002)
21 avril 2002 : Le Pen au second tour de l'élection présiden-tielle
29 mai 2005 : Les Français rejettent le traité constitutionnel européen
2007 : Élections présidentielle et législatives
DU MÊME AUTEUR
ROMANS
Le Cortège des vainqueurs, Robert Laffont, 1972.
Un pas vers la mer, Robert Laffont, 1973.
L'Oiseau des origines, Robert Laffont, 1974.
Que sont les siècles pour la mer, Robert Laffont, 1977.
Une affaire intime, Robert Laffont, 1979.
France, Grasset, 1980 (et Le Livre de Poche).
Un crime très ordinaire, Grasset, 1982 (et Le Livre de Poche).
La Demeure des puissants, Grasset, 1983 (et Le Livre de Poche).
Le Beau Rivage, Grasset, 1985 (et Le Livre de Poche).
Belle Époque, Grasset, 1986 (et Le Livre de Poche).
La Route Napoléon, Robert Laffont, 1987 (et Le Livre de Poche).
Une affaire publique, Robert Laffont, 1989 (et Le Livre de Poche).
Le Regard des femmes, Robert Laffont, 1991 (et Le Livre de Poche).
Un homme de pouvoir, Fayard, 2002 (et Le Livre de Poche).
Les Fanatiques, Fayard, 2006.
SUITES ROMANESQUES
La Baie des Anges :
I. La Baie des Anges, Robert Laffont, 1975 (et Pocket).
II. Le Palais des Fêtes, Robert Laffont, 1976 (et Pocket).
III. La Promenade des Anglais, Robert Laffont, 1976 (et Pocket).
(Parue en 1 volume dans la coll. « Bouquins », Robert Laffont, 1998.)
Les hommes naissent tous le même jour :
I. Aurore, Robert Laffont, 1978.
II. Crépuscule, Robert Laffont, 1979.
La Machinerie humaine :
• La Fontaine des Innocents, Fayard, 1992 (et Le Livre de Poche).
• L'Amour au temps des solitudes, Fayard, 1992 (et Le Livre de Poche).
• Les Rois sans visage, Fayard, 1994 (et Le Livre de Poche).
• Le Condottiere, Fayard, 1994 (et Le Livre de Poche).
• Le Fils de Klara H., Fayard, 1995 (et Le Livre de Poche).
• L'Ambitieuse, Fayard, 1995 (et Le Livre de Poche).
• La Part de Dieu, Fayard, 1996 (et Le Livre de Poche).
• Le Faiseur d'or, Fayard, 1996 (et Le Livre de Poche).
• La Femme derrière le miroir, Fayard, 1997 (et Le Livre de Poche).
• Le Jardin des Oliviers, Fayard, 1999 (et Le Livre de Poche).
Bleu, blanc, rouge :
I. Marielle, Éditions XO, 2000 (et Pocket).
II. Mathilde, Éditions XO, 2000 (et Pocket).
III. Sarah, Éditions XO, 2000 (et Pocket).
Les Patriotes :
I. L'Ombre et la Nuit, Fayard, 2000 (et Le Livre de Poche).
II. La flamme ne s'éteindra pas, Fayard, 2001 (et Le Livre de Poche).
III. Le Prix du sang, Fayard, 2001 (et Le Livre de Poche).
IV. Dans l'honneur et par la victoire, Fayard, 2001 (et Le Livre de Poche).
Les Chrétiens :
I. Le Manteau du soldat, Fayard, 2002 (et Le Livre de Poche).
II. Le Baptême du roi, Fayard, 2002 (et Le Livre de Poche).
III. La Croisade du moine, Fayard, 2002 (et Le Livre de Poche).
Morts pour la France :
I. Le Chaudron des sorcières, Fayard, 2003.
II. Le Feu de l'enfer, Fayard, 2003.
III. La Marche noire, Fayard, 2003.
L'Empire :
I. L'Envoûtement, Fayard, 2004.
II. La Possession, Fayard, 2004.
III. Le Désamour, Fayard, 2004.
La Croix de l'Occident :
I. Par ce signe tu vaincras, Fayard, 2005.
II. Paris vaut bien une messe, Fayard, 2005.
Les Romains :
I. Spartacus. La Révolte des esclaves, Fayard, 2005.
II. Néron. Le Règne de l'Antéchrist, Fayard, 2006.
III. Titus. Le Martyre des Juifs, Fayard, 2006.
IV. Marc Aurèle. Le Martyre des Chrétiens, Fayard, 2006.
V. Constantin le Grand. L'Empire du Christ, Fayard, 2006.
POLITIQUE-FICTION
La Grande Peur de 1989, Robert Laffont, 1966.
Guerre des gangs à Golf-City, Robert Laffont, 1991.
HISTOIRE, ESSAIS
L'Italie de Mussolini, Librairie académique Perrin, 1964, 1982 (et Marabout).
L'Affaire d'Éthiopie, Le Centurion, 1967.
Gauchisme, réformisme et révolution, Robert Laffont, 1968.
Histoire de l'Espagne franquiste, Robert Laffont, 1969.
Cinquième Colonne, 1939-1940, Plon, 1970 et 1980, Complexe, 1984.
Tombeau pour la Commune, Robert Laffont, 1971.
La Nuit des Longs Couteaux, Robert Laffont, 1971 et 2001.
La Mafia, mythe et réalités, Seghers, 1972.
L'Affiche, miroir de l'Histoire, Robert Laffont, 1973 et 1989.
Le Pouvoir à vif, Robert Laffont, 1978.
Le xxe Siècle, Librairie académique Perrin, 1979.
La Troisième Alliance, Fayard, 1984.
Les idées décident de tout, Galilée, 1984.
Lettre ouverte à Robespierre sur les nouveaux Muscadins, Albin Michel, 1986.
Que passe la Justice du Roi, Robert Laffont, 1987.
Manifeste pour une fin de siècle obscure, Odile Jacob, 1989.
La gauche est morte, vive la gauche, Odile Jacob, 1990.
L'Europe contre l'Europe, Le Rocher, 1992.
L'Amour de la France expliqué à mon fils, Le Seuil, 1999.
Histoire du monde de la Révolution française à nos jours en 212 épisodes, Fayard, 2001 (et Le Livre de Poche, mise à jour 2005 sous le titre Les Clés de l'histoire contemporaine).
Fier d'être français, Fayard, 2006.
BIOGRAPHIES
Maximilien Robespierre, histoire d'une solitude, Librairie académique Perrin, 1968 (et Pocket).
Garibaldi, la force d'un destin, Fayard, 1982.
Le Grand Jaurès, Robert Laffont, 1984 et 1994 (et Pocket).
Jules Vallès, Robert Laffont, 1988.
Une femme rebelle. Vie et mort de Rosa Luxemburg, Fayard, 2000.
Jè. Histoire modeste et héroïque d'un homme qui croyait aux lendemains qui chantent, Stock, 1994, et Mille et Une Nuits, 2004.
Napoléon :
I. Le Chant du départ, Robert Laffont, 1997 (et Pocket).
II. Le Soleil d'Austerlitz, Robert Laffont, 1997 (et Pocket).
III. L'Empereur des rois, Robert Laffont, 1997 (et Pocket).
IV. L'Immortel de Sainte-Hélène, Robert Laffont, 1997 (et Pocket).
De Gaulle :
I. L'Appel du destin, Robert Laffont, 1998 (et Pocket).
II. La Solitude du combattant, Robert Laffont, 1998 (et Pocket).
III. Le Premier des Français, Robert Laffont, 1998 (et Pocket).
IV. La Statue du Commandeur, Robert Laffont, 1998 (et Pocket).
Victor Hugo :
I. Je suis une force qui va !, Éditions XO, 2001 (et Pocket).
II. Je serai celui-là !, Éditions XO, 2001 (et Pocket).
César Imperator, Éditions XO, 2003 (et Pocket).
CONTE
La Bague magique, Casterman, 1981.
EN COLLABORATION
Au nom de tous les miens, de Martin Gray, Robert Laffont, 1971 (et Pocket).
Vous pouvez consulter le site Internet de Max Gallo surwww.maxgallo.com