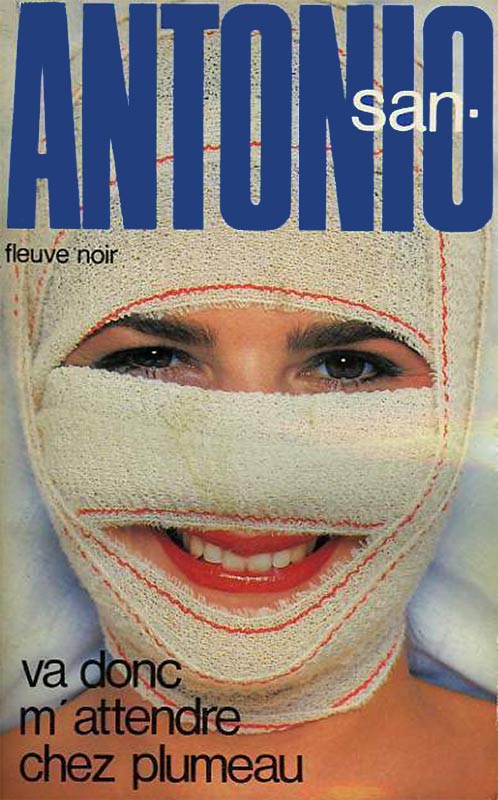
San-Antonio
Va donc m'attendre chez Plumeau
A Robert DEBŒUF
Avec mon affection berjallienne
INTRODUCTION
Tiens, je suis d’humeur.
Je vais t’en pondre un bourré de péripéties.
Un qui cavale, cavalcade, cabriole.
Un qui pète et qui claque. Pif ! Pouf ! Paf ! Ça oui : paf, avec moi, tu peux pas y échapper.
Saignant ! Qu’est-ce qu’on risque, puisque c’est pour rire.
Le titre, j’hésite.
J’aimerais « Coolie de tomates », mais cinquante pour cent des mecs ignorent ce qu’est un coolie, et l’autre cinquante pour cent ce qu’est du coulis ; alors mon jeu de mots je me le carre dans le hangar à thermomètre.
C’est dur de faire le con avec des cons. Si tu joues trop au con, ils te prennent pour un con, et si tu déploies du vrai esprit, ils le trouvent con. C’est con.
Non, dans celui-ci, je vais acharner sur l’historiette. Bien rebondissante à souhait.
Et je te tue, et tu me tutoies, et on danse en tutu. Turlututu chapeau pointu.
Tu vois le genre ? Académique, quoi.
Bon, alors, enfile ta veste, Ernest.
Moi j’enfilerai ta dame.
LE COUP DES GOGUES
Une Daimler double-six (12 cylindres) de couleur marron glacé. Fastoche à reconnaître à cause des cannelures de sa calandre.
Et qui roule, roule, roule imperturbablement derrière moi. Il arrive qu’elle me dépasse, dans les lignes droites, mais très vite elle attend que je la saute.
Ce dont je.
Et elle continue de guigner mon pot d’échappement : une merveille du genre. Même Chazot peut pas prétendre.
Bref, cette Daimler marron glacé me suit, il faut appeler les verbes par leur nom, dirait Béru.
Depuis Zurich. Et bientôt ce sera Berne, la capitale fédérale, un peu austère, mais si belle.
Je me dis textuellement et familièrement ceci : « Mon vieux Toto, avant de débarquer en ville, tu dois en avoir le cœur net ! »
Mon cerveau ayant transmis cet ordre à ma pédale de frein, j’écrase icelle vigoureusement, pile au moment où je parviens à la hauteur d’une station-service, et j’oblique foutrement sur la rampe d’accès y conduisant.
Dans mon rétro, j’ai le temps de constater que le gonzier de la Daimler, surpris, se range sur le bas-côté et entreprend la périlleuse manœuvre consistant à reculer sur une autoroute afin de gagner lui aussi la voie menant à la station.
Peu de monde aux pompes. Un zig en combinaison jaune et rouge flambant neuve me demande en allemand ce que je souhaite.
— Le plein ! j’annonce dans la langue de ce cher Goethe (que je n’ai pas relu depuis bien longtemps, j’espère qu’il ne m’en voudra pas. Et j’ajoute :) Qu’où sont les toilettes ?
Le pompistador m’indique. La chose se situe dans un local annexe, derrière la station. Nobody. Trois pissotières offrent leurs conques aux vessies de passage, deux chiottards, leurs portes béantes. Je m’engouffre par la première. Le local est éclairé à la lumière électrique. J’attends, l’oreille tendue.
Un bruit d’arrivant ne tarde pas. Et que perçois-je alors ? Celui, plus menu, mais autrement inquiétant, d’un pistolet que l’on arme. Moi, l’Antonio d’élite, je ne barguigne jamais dans ces cas-là. Hop ! le dos au mur, les pieds contre la paroi d’en face.
Evidemment, c’est pas dans la cathédrale de Chartres que tu peux réussir cette fantaisie. Prenant appui des pinceaux, je fais glisser mon dos, en élévation, contre la paroi de faïence, qu’heureusement nous sommes en Suisse, car ce serait en France ou au Zaïre, mon beau costar clair serait plein de merde.
Puis je remonte mes pieds. Et ainsi de suite, très vite, de manière à me trouver surélevé horizontalement d’un mètre cinquante de la cuvette à changement de vitesses, freins à disques, chasse incorporée, refroidissement par air pulsé, faf à train monogrammé, musique d’ambiance. Le bas de la porte s’arrête à dix centimètre du sol, ce qui me permet de voir, grâce à la lumière rasante du local, l’ombre de deux pieds parallèles, face à la porte.
J’entends distinctement : « Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! » Quatre trous perforent la lourde à hauteur d’homme assis. Le mur, au-dessus de la cuvette, est défaïencé de première.
Nouveau bruit de pas qui s’éloignent sans se presser. Je compte jusqu’à trois et me remets en position verticale. Ensuite je délourde fissa et ramasse les quatre douilles gisant au sol.
Le mec de la Daimler est un grand blond, coiffé d’une casquette sport à petits carreaux. Il porte un blouson de cuir bordeaux, un pantalon blanc ; il a le pif chaussé de Ray-Ban sombres.
Il va récupérer sa guinde stoppée à l’écart. Je pique un sprint silencieux et le rejoins au moment où il actionne son démarreur. La frime qu’il pousse en me voyant vaut le sprint ! Un pur moment d’égarement, d’incrédulité.
— Un instant ! lui dis-je. J’ai une particularité : quand on me tue, je rends toujours les douilles. Pour les balles, il faut attendre que ma digestion soit faite !
Et je jette les quatre douilles dans sa tire.
L’Effaré décarre en trombe. Il n’a pas vu le bitougnot aimanté que j’ai plaqué contre la portière de sa voiture.
Je radine jusqu’au pompiste. Il achève mon plein. Je le cigle calmement. Un vieux kroum barbichu ressort des gogues en glapissant comme quoi c’est scandaleux de percer des trous dans les portes des toilettes ! Les voyeurs ne se contrôlent plus, décidément.
Je démarre pleins gaz. Une Daimler roule vite, mais une Maserati, c’est pas dégueulasse non plus. En quelques kilbus j’ai recollé à mon agresseur. Alors je prends un petit boîtier dans le vide-poches, pas plus grand qu’un paquet de Gitanes. J’oriente l’objet convenablement, en le tenant hors de ma voiture par la vitre baissée. J’ai choisi une belle ligne droite avec personne venant dans l’autre sens, ni personne à proximité de la Daimler, mais par contre, du monde derrière moi, qui pourra témoigner.
Allez, zou ! Je presse le contacteur.
Là-bas, à deux cents mètres, il se fait une gerbe intéressante. Ma bombette, c’est pas du berlingot de laitier. La moitié du véhicule est arrachée. La Daimler titube, fonce sur la glissière de sécurité qui la renvoie à droite. Elle escalade un talus abrupt terminé par un fort grillage, ce dernier fait trampoline et la retourne à l’envoyeur. La bagnole en folie n’en finit pas de tourniquer comme un reptile tranché.
Je m’arrête à bonne distance et cours, armé de mon extincteur, à toutes fins utiles. C’est utile puisque des flammes jaillissent déjà du moteur. Je pulvérise ma drogue à tout-va : les flammes s’éteignent. D’autres tomobilistes viennent à la rescousse avec, eux aussi, des extincteurs.
Les portières sont bloquées. Mon tueur blond est plutôt mal en point, la moitié du corps prise dans des ferrailles disloquées. Il me regarde salement, ce teigneux, avec un pied dans le tableau de bord et l’autre dans la tombe.
— Tu vois, lui dis-je, avec tes mauvaises manières, tu te fais des ennemis, c’est fatal.
Il perd connaissance. Moi, en douce, je lui secoue son portefeuille, plus un petit sac de plastique fermé par un cordonnet ; tout cela sous prétexte de lui porter aide et assistance ; les témoins m’hurlent de m’écarter, que peut-être le réservoir d’essence va exploser.
Bon, bon, je m’écarte, gueulez pas si fort !
Mais le réservoir n’explose pas.
Lorsque les policiers bernois s’annoncent, nous leur expliquons ce qui s’est passé. Ils trouvent sur le mort un pistolet muni d’un silencieux, plus un petit revolver à mufle de bulldog.
— La voiture devait être piégée, détectent-ils ; l’affaire est sûrement très grave.
Ils peuvent pas savoir comme !
LE COUP DE CE QUE TU VAS VOIR
En plein cœur de Berne, dans la rue aux fontaines peintes dont je n’ai pas retenu le nom car il était pressé et germanique, j’avise trois hippies pie pourris ! en train de bivouaquer sous les arcades. Il y a deux filles et un garçon. Le garçon est plus sale que les filles, peut-être parce que étant plus blond ça se remarque davantage. Barbe de Christ, en fils d’or, moustache gauloise souillée de nicotine et autres produits déshonorants. Le trio est en jeans, avec guitares, sacs tyroliens et mines extatiques.
Je vois alors sortir de l’immeuble devant lequel ils déposent leurs chansons un vieux bougre en corps de chemise, d’apparence chenue, mais qui reste athlétique pourtant, grâce à ses escalades hebdomadaires de la Jungfrau et aussi de sa femme à la poitrine tout autant culminante.
Il se met à apostropher les hip hippies hourra dans ce dialecte bernois qui ressemble tant, pour nous autres étrangers, à une extinction de voix dans une crypte.
Son courroux est tel que le solide vieillard se met à administrer bel et bien des coups de pied au trio.
Les trois gentils cradingues, sans doute plus camés que léons, subissent l’orage inattendu et protestent mollement, bien qu’en hollandais. La passivité attise la cruauté.
Le vieux se déchaîne foncièrement et bieurle ceci-cela en suisse-deutsch, comme quoi ces gars sont la plaie de la Société, qu’ils maculent par leur présence tout un quartier, comme il suffit parfois de deux lignes abominables dans un journal pour déshonorer celui-ci, comme le hareng gâté déshonore la mer. Il continue de piétiner les filles, de faire sonner le flanc des guitares, de savater la barbe christienne du grand Batave pourri.
Moi, tu me connais ?
Bayard ! On ne se refait pas, surtout lorsqu’on est réussi.
Je me jette sur le nerf gumène, le retire du brasier de sa colère, comme l’a si bellement écrit Mme Yoursblack dans Le maître de Forges-les-Eaux, le tiens bon au collet (monté) et lui vocifère :
— Espèce de baderne, schnock, ganache ! Vous assouvissez vos bas instincts sur des êtres sans défense, et vous…
— Le colonel Müller veut vous contacter d’urgence, me chuchote-t-il, en se débattant. Allez souper au Grossbitrhof !
Il a balancé ça en bon français, mais vite, puis continue de protester hautement dans son jargon amygdalien.
— Mein Herr ! Qu’est-ce qu’il vous arrive-t-il ! Est-ce que vous prenez-t-il moi pour un méchante mésieur, mésieur ? Nein, nein, ces vilaines gens malpropres, no bon pour la rue ! Vagabondes, comprénez-vous-t-il, sales vagabondes !
Je relâche le bonhomme qui se carapate dans l’immeuble.
Songeur, je musarde par la ville et je profite d’un flic pour lui demander le chemin du Grossbitrhof. L’excellent homme veut bien me l’indiquer, la chose lui est d’autant plus aisée que l’établissement se trouve à très exactement cinquante-six mètres douze du lieu de ma requête.
Boîte un peu grave, un peu figée. La carte est proposée par un cuisinier de bois, dont le regard ressemble à deux trous du cul mal torchés. Elle promet de la bouffe sacramentelle qui flanquerait la fièvre quarte à Henri-Christian Gaumiau.
Je suis accueilli par un larbin en smoking noir dont la coupe remonte à l’époque où le canton de Berne ne faisait pas encore partie de la Confédération.
— Vous êtes seul, monsieur ?
— Oui, dis-je, mais avec moi c’est toujours provisoire.
Alors, bon, il m’installe à une table. L’une des rares qui restent disponibles car la taule est pleine de bons bourgeois venus clapper de l’émincé de veau ou bien « la chasse » comme on dit en Suisse, avec de la confiture d’airelles et des spetzlis (je te garantis pas l’orthographe, mais qu’en aurais-tu à foutre ?).
Ce restaurant bernois est tranquille comme la conscience d’un chanoine en retraite. J’ai beau mater les alentours, je ne renouche aucune personne seule susceptible de me « contacter ». Le pingouin m’allonge le menu relié plein cuir. Je l’ouvre et trouve, fiché dans un angle du parchemin, par-dessus la liste des « hors-d’œuvre riches », un bristol sur lequel on a tracé quelques lignes. Il y est écrit ceci :
Soyez à onze heures à la boîte de nuit le Ran-Tan-Plan. Pendant les attractions, rendez-vous aux toilettes.
On a griffonné à la hâte, et d’une autre encre, l’avertissement suivant :
Prenez garde au couple d’Asiatiques qui se trouve dans la salle.
J’escamote le bristol prestement, voire artistiquement, prends connaissance des mets proposés, opte pour une mousse de truite et un canard aux pêches ; commande une bouteille de Dôle du Mont et entreprends de me sustenter tout en surveillant d’un regard atone le couple asiate indiqué sur la notice. Deux êtres petits, qui font songer à un serre-livres chinois. Lui est en complet bleu sombre, chemise blanche, cravate, calvitie frontale, lunettes cerclées d’or, lourdes paupières semblables aux stores des boutiques de luxe de l’avenue Montaigne (1533–1592). Elle, la face exagérément circulaire, la chevelure gonflante en forme d’as de trèfle, les pommettes rondes comme celles des poupées russes, les yeux pareils à deux fêlures de vitre, portant une robe imprimée dans les jaune et ocre.
Ils jaffent en se parlant très peu, seulement intéressés par la bouffe qu’ils chipatouillent menu.
Je ne m’attarde pas sur eux.
J’ai enregistré que je devais m’en méfier, c’est inscrit sur les tablettes de mon ordinateur. Si je les retrouve sur ma route, je ne manquerai pas d’écarquiller les yeux.
Tout en clappant une cuistance évasive, sérieuse, et morose, je récapitule l’affaire. Me voici embarqué dans une étrange béchamel, d’autant plus inquiétante que je n’en connais pas les tenants et en redoute les aboutissants.
Il y a trois jours, je suis appelé en « haut lieu ». Pas chez le Vieux, encore plus haut. Le Dabe ne participe même pas à la réunion. Outre deux éminentes autorités, comme on charabiase volontiers dans les rapports où l’on ne dit rien en se donnant l’air de cacher l’essentiel, j’y trouve un Anglais beau comme une asperge qui n’aurait pas verdi et Demussond, un très ancien collègue à moi. On s’est connus à nos débuts. Nous avons sympathisé et on a même fait quelques virouzes pas tristes. Et puis, la vie, tu sais ? Bifurcation ! Lui s’est orienté sur les Renseignements généraux, de là, d’après certains on-dit, il serait carrément entré au Contre-espionnage. Mais enfin, ce sont ses oignes et c’est pas ça qui paiera ton tiers provisionnel, pas vrai, Bébert ?
Je te reviens à la big réunion.
L’une des Huiles bouillantes me demande :
— Seriez-vous d’accord pour exécuter une mission tout à fait particulière, commissaire ?
Je réponds que des missions particulières, j’en accomplis autant qu’un moniteur d’auto-école donne de leçons de conduite au cours de sa carrière. Une de plus, quand bien même elle serait particulièrement particulière, n’est pas faite pour effaroucher un beau Santantonio bandant, dans toute la force de l’âge.
Le sieur de l’Huile sourit, parfait, qu’en ce cas je veuillasse bien me placer sous les ordres du général Blackcat ici présent. On cause un peu de ceci, cela, la pluie, le Bottin, comment va Lady Di, comment va le père François, et la livre, elle est toujours sterlinge ? Au bout de dix broquilles on s’éponge dans la pièce voisine, le général Asparagus Blackcat, Demussond et moi.
Manière d’en viendre aux choses sérieuses, comprends-tu ? C’est mon ex-pote qui mord dans le gras du lard, bille en boule :
— Un truc fou, San-Antonio !
— Y a bon Banania, pourléché-je ; vas-y, j’écarquille.
— L’affaire débute par un nommé Stone-Kiroul, diplomate indien en poste à Moscou.
Il regarde le général Blackcat, lequel, d’après le peu de nos relations, a des difficultés avec le dialecte de Molière. L’officier en civil (jamais un officier ne fait davantage militaire que lorsqu’il est en civil) se tient droit contre le dossier de sa chaise, épousant à ce point la forme d’icelle qu’il a lui-même l’air d’un siège. On dirait que tout ce qui s’échange comme paroles dans une autre langue que la sienne ne l’intéresse pas.
Demussond poursuit :
— Un beau jour, Stone-Kiroul prend contact avec l’un de ses homologues britanniques et lui annonce qu’il vient de mettre le nez dans une histoire terrific dans laquelle l’Angleterre est concernée. Il n’en dit pas davantage, mais disparaît le soir même, bien qu’un rendez-vous à l’échelon suprême eût été pris pour le lendemain. On retrouve le corps de Stone-Kiroul dans sa voiture incendiée. Officiellement, elle a percuté un camion militaire. Fin du premier épisode.
— Je crois bien que je vais rester pour écouter le second, soupiré-je.
Demussond sourit. Le général paraît absolument momifié et je me demande presque s’il n’a pas été confié à mon pote par le conservateur du British Museum, des fois que ce serait Ramsès XX déguisé pour mieux passer les douanes.
— La semaine dernière, continue mon terlocuchose, un incident curieux, mais qui n’est pas le premier du genre, s’est produit à l’aéroport de Zurich : on a trouvé un homme dans le train d’atterrissage d’un avion de l’Aeroflot, en provenance de Moscou. L’individu était presque congelé par le froid. On l’a transporté à l’hosto dans un état de coma profond. Qu’il vive encore tenait du miracle.
— Effectivement, j’ai lu un entrefilet à ce propos dans mon bulletin paroissial, conviens-je. Un gars qui avait « choisi sa liberté » ?
— Le gars en question n’est autre que Stone-Kiroul, mon bon. Son cadavre carbonisé appartenait, si je puis dire, à quelqu’un d’autre. Lui avait été embastillé.
— Et il a joué la belle ?
— Mystère. Toujours est-il qu’on a trouvé sur lui le document dont voici la photocopie. Cela a été écrit avec le propre sang du gars ; Stone-Kiroul a utilisé une grosse écharde de bois comme plume et un méchant papier hygiénique en guise de vélin supérieur. Les Services britanniques ont repassé les caractères à la mine de plomb pour les rendre plus lisibles.
Je lis ces lignes, rédigées en anglais :
Si mort, adresser I.S. London. Prévenir P. J. France San Antonio. V 818 Stocky Pied.
Je lis, relis, rerelis, apprends par cœur ce texte un peu plus bref, j’en conviens, que les stances du Cid ; le rends à Demussond avec une grimace d’incompréhension.
— Non capito, dis-je. Tu as une photo de ce Stone-Kiroul ?
Demussond qui n’attendait que cela extrait de son attaché-case un portrait de format 13 × 18 représentant un homme de race effectivement indienne, beau mais quasiment mort, ce qui ôte du charme aux individus les mieux tournés. L’homme a les yeux mi-clos, bien qu’on ait essayé de lui remonter les paupières pour faire plus gai.
D’un coup d’œil je balaie mes propres doutes.
— Je n’ai jamais rencontré ce gus, Milou (je l’appelais Milou à l’époque de nos frasques).
Il n’insiste pas, sachant parfaitement qu’en pareille circonstance je n’avancerais jamais une chose dont je ne sois rigoureusement sûr.
— Alors, comment expliques-tu ce message, Antoine ? murmure-t-il.
— Je ne l’explique pas. Cet homme m’est totalement inconnu, point à la ligne. Je suis même ahuri qu’il soit au courant de mon existence. Maintenant approfondissons un peu tout ça.
— Bonne idée, laisse tomber le général, en anglais pour nous convier à user de ce patois.
— Vous y croyez, vous autres, à l’évasion de Stone-Kiroul ? leur demandé-je. Vous avez déjà entendu parler des mecs qui se sont arrachés des culs-de-basse-fosse en U.R.S.S. ? Et en admettant la chose, vous trouvez logique que ce diplomate risque une telle équipée au lieu de se rendre tout bonnement à l’ambassade anglaise ou américaine ? Comme s’il était possible à un fugitif de vadrouiller sur les pistes de l’aéroport de Moscou et de se faufiler dans le logement d’un train d’atterrissage ! Cousu de fil blanc, mes amis. Ceci est un piège. Ce sont les Popofs qui vous ont expédié le gus.
— Après s’être esquinté le tempérament à faire croire qu’il était mort accidentellement ? objecte le général.
— Pourquoi pas ? Leurs desseins sont infinis… Dans quelle situation se trouvait-il lorsqu’on l’a déniché ?
— Il était attaché après un kraposck[1] bloqueur, me renseigne Demussond.
— Attaché avec quoi ?
— Une sangle usée qu’il aurait pu trouver dans les salles où est entreposé le fret.
— D’après les employés de piste qui l’ont découvert, il aurait pu se fixer lui-même au kraposck ?
— Ils ne se sont pas posé la question et ont tranché les liens.
— Ce sont les autorités suisses qui ont transmis le message ?
— En effet. Conformément au souhait du diplomate, elles sont entrées en contact avec l’I.S. La chose n’a pas transpiré car les Helvètes sont discrets, c’est notoire ; la presse n’a même pas publié l’identité du fugitif, laquelle a cependant été connue moins de deux heures après qu’on l’eut trouvé dans sa niche.
— Il a des chances de survivre ?
— Il est mort, fait le général.
— Sans avoir repris conscience ?
— Est-ce qu’un bloc de glace reprend conscience une fois qu’on l’a fait fondre ?
Je soupire.
— Donc, pour l’I.S. je constitue une espèce de recours, n’est-ce pas ? J’ai une signification puisque le gars m’a adressé ces mots.
— Nous sommes en droit de l’espérer.
— Je sais parfaitement, général, que pour un organisme comme l’I.S., les dénégations d’un pékin, fût-il un honorable commissaire français, ne sont pas davantage prises en considération qu’un pet de moineau, pourtant, quand bien même vous auriez la possibilité de m’infliger le supplice de la question, je ne pourrais rien vous apprendre. Il y a cinq minutes encore, je n’avais jamais entendu parler de Stone-Kiroul. Vous ne me croyez pas ?
L’ex-momie (mais encore général et définitivement anglais) croise ses longues jambes maigres, puis ses longues mains maigres sur son genou gauche, plus maigre encore que tout le reste.
— Ecoutez, commissaire. Stone-Kiroul porte à la main gauche une entaille qu’il s’est faite avec un éclat de bois. Ce même éclat de bois lui a servi de stylo pour écrire, avec l’encre sortant de la blessure, un texte qui vous est adressé. Il est difficile d’admettre que vous vous ignoriez, lui et vous.
— Et s’il s’agissait d’une machination ?
— Cela changerait quoi ? Vous avez fatalement quelque chose en commun ?
Demussond, embarrassé de servir d’intermédiaire, se racle la gargoulette. Il sent bien que ça se crispe entre le vieux Rosbif et moi et que nous risquons de nous crêper le chignon si un été on se trouve en vacances ensemble au Club Méditerranée.
— San Antonio, P. J. France, récite mon ancien compagnon de beuverie ; on ne voit guère qui d’autre que toi pourrait être concerné.
Un beau silence franc et massif succède. On entendrait voler le portefeuille d’un usurier écossais.
Doucement, le général Blackcat reprend :
— V 818. Stocky Pied, cela ne vous dit rien ?
— Pas davantage que votre diplomate indien. Vous êtes bien sûr qu’il s’agit de son propre sang ?
— Notre laboratoire est formel : les deux sont du groupe AB négatif ; mieux, on a identifié l’écriture de Stone-Kiroul.
— Bon, fais-je, on ne va pas attendre Noël pour bouffer du pudding, général, il faut tenter quelque chose.
— Ce serait bien, admet ce manche à balai de fakir.
— Tu as une suggestion à formuler ? demande Demussond.
— Ce que tu causes bien en vieillissant, ricané-je ; nous voilà loin des bitures d’autrefois ! Certaines nuits, on avait tellement picolé qu’on ne se reconnaissait plus.
Cette évocation, devant Blackcat, le foudroie. Il pâlit, sourcille, puis hausse les épaules avec humeur.
Manière de dissiper sa rancœur, je me tourne vers le général.
— Il m’a été précisé que vous avez une mission particulière à me confier, je pense que toute suggestion de ma part serait prématurée avant que vous ne m’ayez fait part de cette mission.
La vieille asperge britannouille apprécie mon tempérament décidé.
— Pendant que Stone-Kiroul se trouvait en réanimation, quelqu’un de l’extérieur a tenté de l’approcher ; fort heureusement, nos amis suisses font toujours bien les choses et la fausse infirmière qui essayait de gagner son chevet en a été pour ses frais. On l’a stoppée dans le couloir, elle a prétendu je ne sais quoi à propos d’une histoire d’amour qu’elle vivait avec un interne et on l’a relâchée car elle n’avait commis somme toute aucun délit.
— Cette tentative prouve que votre Indien intéresse du monde.
— Comme, hélas ! il a rendu l’âme, il va nous falloir un autre point d’intérêt pour appâter le « monde » en question, explique le général.
— Moi, en l’occurrence ?
— Bon gré mal gré, tu es impliqué dans l’histoire, souligne avec aigreur mon ex-ami, car l’amitié, comme la jeunesse, ne dure qu’un moment, sauf rares exceptions.
Demussond me pardonne difficilement mon allusion à nos cuites d’antan. Les hommes, franchi une certaine durée, se prennent pour quelqu’un et veulent être reconnus de gravité publique.
— Si je comprends bien, continué-je, je me rends au chevet de votre Indien dont le décès n’est pas connu, j’y passe un bon moment et je repars tranquillos en attendant que des gens malintentionnés m’abordent pour me demander ce qu’on s’est dit, lui et moi ?
— Admirable ! répond le général. Vous comprenez vite et bien, commissaire.
— Et j’agis de même, général.
* * *
J’ai clappé tout en évoquant, liché les deux tiers de ma boutanche de Dôle.
Je me dis que le général Blackcat a rudement bien fait de me remettre tout un tas de gadgets défensifs et offensifs. Curieux mec, indeed ! Il a des doutes à mon sujet, mais, me chargeant de mission, il se comporte néanmoins comme s’il était sûr de moi. Cela dit, je me gaffe bien qu’il me fait surveiller comme M. Rockefeller fait surveiller les cours de la Bourse. L’incident du gros vieux avec les hippies en est la preuve. Jamais, au cours de ma garcerie de carrière je n’ai dû avoir autant de monde aux baskets.
Tiens ! le couple de Jaunes demande la note. Peut-être va-t-il m’attendre dans un coin d’ombre ?
Je choisis des fruits rafraîchis comme dessert. La corbeille devait fatiguer et on l’a reconvertie dans un compotier. Un peu de « crème à baquet » et une giclée de kirsch réparent de la moisissure l’irréparable outrage.
Je me sens étrangement seul dans Berne, ce soir, malgré la profusion d’anges gardiens.
Les Orientaux, extrêmement orientaux, s’évacuent sans m’accorder un regard, et comment le pourraient-ils d’ailleurs ? Ils n’ont pas d’yeux. En guise de regards, quatre coups de rasoir dans le portrait. Ça trouble. Moi, quand je les vois, les Japs par exemple, je me dis qu’ils doivent fabriquer leurs bagnoles et leurs appareils photo à tâtons, comme les aveugles jouent de l’orgue.
J’attends un peu et demande un cigare. On m’apporte un grand humidor d’acajou bourré de Davidoff toutes catégories.
Je m’offre un petit Château d’Yquem, à cause du nom surtout qui m’éblouit les papilles.
Quelques bouées, et puis je réclame l’addition.
Les rues de la capitale fédérale sont presque désertes. Un tramway passe en louvoyant, quelques gonziers en renfrognance sont visibles à travers les vitres embuées, dans une lumière de salle d’attente. Personnages, d’ailleurs, qui ne me serviront jamais à rien. Juste des silhouettes, comme ça, pour traverser ma vie, un soir, dans un bruit de ferraille. Je les salue du cœur, et un chant suissaga me revient : « Qu’il vive ! Qu’il vive ! Qu’il vive et soit heureux, ce sont là nos vœux ! » O.K. : qu’ils vivent, ces Bernois fantomatiques, aussi fugaces que l’étincelle accrochée au bout du trolley ; qu’ils vivent et soient heureux sur les bords de leur fosse aux ours, ce sont là mes vineux.
Dix plombes. Trop tôt pour le rancard du Ran-Tan-Plan. Que faire ? Mon hôtel ? Une heure à tuer. La tuer comment ? A coups de revolver ?
Je pense au type qui m’a défouraillé contre dans les cagoinsses du relais autoroutier. Un dénommé Friedrich von Schplaff, né à Hambourg, selon ses papiers. Mais peut-on se fier aux pièces d’identité prises sur un tueur en exercice ? Dans la pochette de plastique engourdie avec son portefeuille, j’ai trouvé un paquet de cigarettes entamé, et un étui de carton contenant deux seringues pleines prêtes à servir lorsqu’on en a déchiré l’étui aseptisé. Il faudra faire analyser le produit et les cigarettes par la suite.
Bon, alors, ces soixante minutes, qu’est-ce que j’en fais ?
LE COUP DE BAMBOU
Dieu pourvoit toujours aux perplexités de l’homme indécis. Il faut dire que, tout Lui étant possible, Il en use. Mets-toi à Son illustre place !
Ça se goupille de la façon suivante : je bute contre une saillie de trottoir. Que fais-je alors, en un fulgurant réflexe ? J’écrie « Merde ! ». Pour moi tout seul. Mais, tout comme les pauvres poilus tombés à Verdun, mon juron n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Un type qui nonchalait sous les arcades, à regarder la vitrine éclairée d’un montrier, se retourne et m’exclame :
— Français ?
— De père en fils jusqu’à Clovis, lui réponds-je ; on n’a pas pu remonter plus haut, la mairie a été détruite par les Alamans.
Il m’approche en constatant :
— Oh, oh ! Et cultivé, on dirait. Rien de plus rarissime chez les Français.
Moi, ça me mi-figue le raisin, des réflexions de ce genre en sol étranger.
— Vous êtes quoi ? bougonné-je.
— Auvergnat par ma mère et lorrain par son mari qui a bien pu être mon père, après tout.
Le type est intéressant. Tu croirais un hérisson aux cheveux blancs. Un gros nez-museau constellé de menus cratères ressemble à la face exposée de la Lune. Il a des sourcils en guidon de course, le teint sombre et plein de rides venues lui taillader la gueule avant l’âge. Pas très grand, mais trapu ; la caisse d’horloge, tu vois ? Un imper à épaulettes officières renforce l’aspect géométrique du mec. Son regard me paraît très clair dans la lumière urbaine de ce centrum bernois. Une expression sceptique et rigolarde lui compose une curieuse lippe en gouttière déglinguée. D’emblée, tu le situerais dans les « caustiques sympas ».
Il me dit, tout de go :
— Deux Français dans Berne, à dix heures du soir ; ça s’arrose, non ?
« Bien, me dis-je en aparté, ce quidam fait probablement partie des gens qui s’intéressent à moi présentement, abondons dans son sens. Il me filochait et s’est décidé à me contacter dans un but qui ne doit pas être louable, mais chaque homme déterminé mérite sa récompense, je me dois de lui accorder satisfaction.
Et mon visage s’éclaire d’un sourire en tranche de pastèque qui aurait craché ses méchants pépins noirs ; car Dieu merci, je n’ai pas de chicots.
— Et pourquoi pas, mon cher compatriote ? lui réponds-je avec un maximum d’urbanité, voire d’urbanisme.
— Auparavant, me déclare cet homme de bien, je vous demanderai la permission de pisser dans l’une de ces magnifiques fontaines qui font l’orgueil de cette rue. Le bruit de l’eau courante a toujours sollicité ma vessie, comme l’odeur du renard énerve les chiens courants de la vieille Angleterre.
Joignant la bite à la parole, il dégaine sa camarade d’entrejambe et fait participer son propre jet aux fastes aquatiques de la rue. Je remercie le ciel bernois de ce qu’aucun gendarme ne se pointe, tout en me disant que si cet homme est un quelconque agent secret chargé de me circonscrire (ou de me circoncire pour peu qu’il soit de religion juive ou musulmane), il a de drôles de manières.
Tout en compissant avec force, l’homme déclare sans se retourner :
— Je m’appelle Rameau, Jean Rameau.
— J’ai bien connu son neveu, ricané-je.
Le gars pouffe.
— On me l’a déjà faite, vous n’êtes pas le premier gars qui connaisse le théâtre français.
Il range Coquette dans ses appartements privés après l’avoir dûment essorée, se rince les doigts dans l’eau où il vient d’adjoindre, les essuie à la doublure de son imper et me rejoint.
— Mon nom à moi est San-Antonio, dis-je.
L’homme s’arrête et me détaille.
— N’êtes-vous pas ce flic dont il est question épisodiquement ?
— Je le suis.
— Vous aimez à faire parler de vous, apprécie Rameau.
— Non, rectifié-je ; il arrive que les autres se complaisent à parler de moi, ce qui n’est pas du tout pareil.
Ainsi devisant, nous passons le seuil de mon hôtel et nous nous dirigeons vers le bar.
— Je suis descendu ici, me déclare Jean Rameau.
— Comme c’est curieux : moi aussi.
— C’est confortable et central, poursuit mon compagnon sans paraître relever mon ironie.
Le bar est joyeux comme le Journal Télévisé. Il y a un pianiste qui s’évertue, derrière un pot de fleurs ; un vieux barman panard qui a du mal à se déplacer derrière son rade, deux entraîneuses solitaires (et solidaires) à l’assaut d’un gros industriel descendu d’un canton primitif et un couple d’Arabes à l’air malheureux.
Rameau se désimperméabilise, roule le survêtement pour s’en confectionner un polochon et le jette sur la banquette.
— On se fait une roteuse ? me demande-t-il.
— Pour moi, ce sera plutôt une vodka, je ne bois le champagne qu’en apéritif.
Je détaille mon vis-à-vis à la lumière électrique. Il est franchement laid. Son gros pif en forme de groin ne pardonne pas. Et son teint grisâtre n’arrange rien. Ses cheveux blancs lui emboîtent le haut de la tronche comme le ferait une perruque trop juste sur laquelle on aurait forcé. Son regard va et vient sans jamais s’arrêter. Il a les yeux de ces petits fennecs fous d’inquiétude qui ont l’air traqués de toute part ; mais chez Rameau il s’agit d’un tic, car en fait, c’est un individu plein de sang-froid.
— Vous êtes dans les affaires ? je lui demande.
— Dans un sens, oui : je suis expert.
— Je peux vous demander en quoi ?
— Hydrocarbures. Quand on soupçonne du pétrole quelque part : voyez Rameau ! Sans pavoiser, je compte probablement parmi les cinq premiers renifleurs d’or noir.
Il tapote son nez.
— Il est mahousse, mais il rend service.
— Et vous venez renifler les gisements helvétiques ?
— Pas les gisements : les sociétés qui les exploitent, et que j’exploite comme je peux. Cela dit, elles ne rechignent jamais avec ceux qui peuvent accroître leur prospérité.
Nous passons commande. Rameau s’offre une demie de Pommery, moi ma vodka avec beaucoup de poivre et une larmiche de churasco.
Mon pote rigole de ma boisson.
— Les explosifs, chez nous, on s’en sert pour éteindre les puits en flammes ; vous faites une radio de l’estomac de temps en temps, j’espère ?
Il est franchement sympa, un peu braque. Maman le qualifierait de « vieil original ».
— Et vous, la Suisse, boulot-boulot ?
— Secret professionnel, excusez.
— Ben voyons, encore que « les secrets d’aujourd’hui fassent généralement la Une de demain ».
Il rit.
Comme on lui sert son champagne, il murmure après avoir bu la première gorgée :
— Allez, aggravons notre cas !
— Pourquoi, vous avez des ennuis hépatiques ?
— Non, des scrupules. Je suis terrifié par la quantité de denrées diverses que j’ai consommées en cinquante-six ans. L’autre jour, j’ai fait un petit bilan approximatif. Ça vous intéresse ?
Il sort un carnet de sa poche, chausse des lunettes minuscules et lit :
— Dix-huit tonnes de pain, trois tonnes de viande, sept tonnes de pâtes, trois tonnes de riz, neuf de légumes, huit cents kilos de chocolat, douze mille litres de vin, cinq mille de bière, vingt mille d’eau minérale, cinq mille bouteilles de champagne, cent quarante mille cigarettes, mille cinq cents suppositoires, en chiffre plus ou moins ronds. Et pour ne citer que des matières de première nécessité. Vous vous rendez compte, l’ami ? Et tout cela pour faire quoi ? Pour faire qui ? Moi ! Regardez le bonhomme : un mètre soixante-neuf, soixante-dix-huit kilos, une gueule à chier. J’ai honte. Que va devenir le résultat de cette formidable consommation ? Vous donnez votre langue au chat ? Un squelette, mon vieux ; de la poudre d’os !
« Ces tonnes de pain, de bidoche, de fruits, ces hectolitres de boissons vont se résumer en une pincée de poudre grise ! Je refuse. Cette montagne de produits dont je n’ai encore une fois évoqué que les principaux, passant outre les vêtements, le papier hygiénique, les glaces à la vanille dont je raffole, la pâte dentifrice, le cirage, l’essence, l’eau de Cologne, l’onguent gris de ma jeunesse, le cuir, le cuivre, l’acier, le bois, la laine, le coton, dont j’ai pris ma part avec avidité. L’or ! Tenez : l’or… Le cher or si cher. Tout ! Et ce tout monumental, écrasant, va restituer un vilain zéro à l’arrivée. Un souvenir vite estompé. J’aurai mangé des vaches, des moutons, des hectares de blé, bu des hectares de vigne, usé des hectares de forêt pour écrire des sottises ou me torcher le cul et cela en perte pure, l’ami, en perte pure.
« Je suis un gouffre. Une bouche de nuit. Je prends et ne rends rien. Et pourtant je voudrais utiliser la matière née de toute cette matière assimilée. Chaque fois que je défèque, j’ai la tentation de créer une SA.R.L. pour exploiter mon excrément, le lancer dans la ronde des engrais azotés. Certes, j’ai légué mes yeux à la banque des yeux, mes reins à celle du rein, mes testicules à qui les voudra, mon foie à la ville de Lyon, la plus accablée au monde par la cirrhose. Je donne volontiers mon sang et mon sperme, mais cela n’est que broutilles. »
Il se tait, amer, boit pour, en effet, aggraver son cas, joue avec ses petites lunettes tellement fragiles sans monture, que de regarder au travers doit les endommager.
— Vous avez des enfants, monsieur Rameau ?
— Deux, ce qui ne fait que multiplier mon problème…
— Mais sacrebleu, en compensation de cette consommation, vous avez produit, lui dis-je. Vous vous êtes rendu utile ! C’est la seule monnaie qu’un homme ait à sa disposition pour régler sa pension, ici-bas : se rendre utile, créer, agir, aider, aimer. Hein, dites : l’amour, monsieur Rameau ? Ça justifie tous les tonnages de barbaque ou de pinard. Un regard d’amitié, une main tendue, un poème, une porte qu’on ouvre valent beaucoup plus que des cargos chargés à couler de denrées périssables.
Mon terlocuteur hoche la tête.
— Oh ! alors, si vous prenez le problème par la philosophie de bistrot, c’est comme si vous l’attrapiez par la quéquette : vous le faites bander et puis c’est tout.
Pour se consoler, il finit de licher sa bouteille. Un peu pincecorné, le pétrolman. Un dada, tout le monde en monte un pour courir après ses rêves.
A court de converse, car on a retiré l’échelle des arguments et pas encore changé les draps du sujet, ainsi que l’écrit si admirablement Ours Noir dans « Passe-moi ton bicorne, je te passerai mon gode », à court de converse, donc, nous nous taisons, ce qui est la plus belle chose que puissent décider deux hommes pour éviter de déconner.
Ma montre se pointe dans les chiffres prévus par le colonel Müller. Il va être temps que je me rende au Ran-Tan-Plan. Aussi hélé-je le loufiat cacochyme pour carmer le sinistre.
— Que non pas, laissez ! s’égosille Rameau, je vous ai invité. D’ailleurs nous n’allons pas nous quitter déjà !
— C’est que j’ai un rendez-vous, objecté-je, auquel il serait malséant d’arriver en retard.
— Une dadame ?
— Exquise.
— Pas suissesse à coup sûr.
— Et pourquoi ?
— Les dames suisses ne baisent que l’après-midi, le soir elles préparent des gâteaux pour leurs enfants, ou leurs jolies fesses pour leur époux. En aucun cas elles ne se dévergondent, c’est ce qui, avec le secret bancaire, assure la solidité de ce grand petit pays.
Je me lève.
— J’espère avoir l’occasion de vous offrir ma tournée très prochainement, monsieur Rameau. En attendant, faites taire vos scrupules, mangez et buvez, c’est le Seigneur Lui-même qui nous l’a ordonné.
Rameau soupire.
— Vous faites partie des contaminés, mon vieux. La société de consommation vous a eu.
Il se rapetisse sur sa banquette et se met à m’oublier.
LE COUP FOURRÉ
Le Ran-Tan-Plan est une taule moderne, dans un immeuble neuf de la tête aux pieds entièrement sculpté dans du fibrociment ou autres denrées de ce genre que les architectes modernes s’entêtent à prétendre matière noble parce qu’ils n’ont pas autre chose à se foutre sous le compas. Buildinge d’une douzaine d’étages, ni mieux ni pire que les autres et qui fait qu’Helsinki ressemble à Los Angeles comme Tokyo à Abidjan ou à la Défense. Les buildinges étant, avec le Cola-Cola, le dénominateur commun à tous les pays.
Pour accéder au Ran-Tan-Plan, il convient de traverser l’immeuble, puis de descendre par un ascenseur dans d’étranges profondeurs d’où le vacarme ne s’échappe pas. On arrive alors à un vaste palier. Un employé en spencer vert et pantalon noir s’empresse de vous le faire traverser et de vous introduire dans le bunker par une large porte garnie de velours bleu roi et cloutée d’étoiles de cuivre.
Une nana en cucul-jupe noire et collants à grille prend le relais. Blonde, grande, avec un sourire assez peu intellectuel mais des nichons impecs et peu farouches, elle te fait accomplir la cérémonie du vestiaire dans un tambour velouté de bleu également ; déjà tu perçois le fracas de la musique disco. Lorsque la blonde te propulse dans l’antre, c’est soudain comme si tu déboulais dans la chambre des machines du Couine Elisabeth. Dieu de Dieu, ce boucan ! Et cette pénombre, cousine germaine de l’obscurité ! Les serveuses deviennent ouvreuses de cinoche, sauf qu’elles n’ont pas de lampes électriques car la topographie est balisée par des raies phosphorescentes tracées sur le plancher.
La donzelle qui vient de me butiner pourrait ressembler à feu Mme Golda Meir que j’y verrais que tchi. Elle me traîne jusqu’à une banquette voluptueuse. Je m’y assois comme dans un baquet empli de mousse à raser. Devant moi, une table basse pourvue d’une loupiote verte à la lumière ultra-confidentielle.
— Champagne ou whisky ? questionne la piloteuse de pigeons.
— Vodka au poivre.
Elle dit que bon d’accord, sans se formaliser et m’abandonne. Dans cette casba, impossible de s’écouter penser. Tout ce que tu peux faire pour toi, c’est de plaquer bien fort tes mains contre tes coquillages en attendant que ça se tasse (à café).
L’endroit est bondé. Sur la piste, ça gambille sec. Des tas de couples se dégustent les muqueuses à pleine bouche. On perçoit des rires à travers la viorne fissureuse de tympans. Je rêve de passer un week-end dans la salle des rotatives de France-Soir, histoire de me reposer un peu les trompes.
Aussi, lorsque soudain tout se tait, c’est comme quand on te passe la langue sur le filet dans une alcôve faite pour. Tout ton être se trouve en grande délivrance. T’es tellement joyce que t’as envie d’applaudir.
Tandis que le bruit disparaît, la lumière revient. Tu clignes des vasistas en défrimant autour de toi. La salle est plus grande que ce que la ténèbre te laissait supposer. Et plus bondée que ce que tu pressentais. Je profite de ce que mes deux mains sont redevenues disponibles pour m’entifler la vodka copieusement servie.
Les danseurs ont regagné leurs places. Alors une scène mobile sort du mur du fond et s’avance sur la piste. Sans bruit. Quand elle a achevé son parcours, un gonzier en smoking blanc se pointe. Il annonce, en allemand, en français et en anglais que la direction du Ran-Tan-Plan est heureuse de présenter à sa clientèle chérie un programme d’une haute qualité, puisqu’il va comprendre la participation de vedettes aussi illustres que Miss Lili, la strip-teaseuse de bonne aventure ; Carlo Karl, le fameux chanteur de charme allemand ; les Ringardo’s, ces antipodistes sud-américains dont la renommée a franchi l’Atlantique à bord d’un Boeing 747 ; et de Tupu Duku, l’illusionniste chinois qui est parvenu à dérider la reine Fabiola avec un fer à repasser magique. Applaudissements polis, prudents, voire condescendants.
« Eh bien, me dis-je en privé, cela va être à toi de jouer, l’Antonio. » Car, si tu ne l’as pas oublié, on m’a signifié de devoir me rendre aux lavabos pendant les attractions.
J’attends donc que les loupiotes repartent à dame et qu’une connasse fanfreluchée se pointe, avec un boa et des tas de poils partout, attifée d’un attifet, le cul en trémulation comme un cœur frappé d’arythmie. Il s’agit de la fameuse Miss Lili annoncée précédemment et qui va perpétrer le dangereux exercice qui consiste à se dévêtir en public, merci bien, je lui laisse la place ! Que moi, déjà, je coince deux fois sur trois la fermeture Eclair de ma braguette ! Aller au décarpillage sur un air langoureux, semer ses effets et ses effets comme au vent les pétales de marguerite, tu mords la tâche ?
Filer le tricotin aux gusmen blasés qu’en ont vu d’autres et des mieux, bien plus lascives, franchement, je t’en fais cadeau !
Sitôt l’obscurité revenue, je me dirige vers les toilettes dont l’entrée se trouve entre le vestiaire et la salle. Cela commence par un bref couloir, lequel débouche sur un autre plus large. A droite sont les chiches : gentlemen et ladies, à gauche les téléphones, au nombre de deux, accrochés sous deux dômes insonorisés. Je remarque que l’un des appareils est décroché et qu’il pend au bout de son fil tel un petit pantin.
« C’est pour ma pomme ! » songé-je. Et de cueillir le combiné afin de le porter à mon oreille, mais la tonalité m’apprend que la précédente communication a été coupée et qu’il ne reste personne en ligne. Par acquit de conscience, je lance trois ou quatre « Allô ? ». Mais le morceau de plastique est plus muet qu’un poisson rouge fossilisé.
De guerre lasse, je replace l’appareil sur sa fourche, et puis j’attends.
Je ne te l’ai point appris encore, mais le général Blackcat m’a déclaré qu’une fois à pied d’œuvre, en Suisse, il se pourrait que je sois contacté par le colonel Müller, ce qui t’explique la docilité avec laquelle j’ai répondu aux sollicitations du vieux bonhomme, puis de la note écrite dans le menu du restaurant. M’est avis que le colonel Müller se manifestera dans les instants qui vont suivre.
Je décide de poireauter un bout tandis que dans la salle, Miss Lili est en train d’opérer un lâcher de soutien-gorge. L’assistance, qui enjambe des nichons tout l’été, reste aussi froide que l’intérieur d’un congélateur. Devenue trop exhibitionniste, la femme a perdu de son mystère, et ce n’est plus qu’au gros de l’hiver, écrasée de fourrures, qu’elle éveille encore quelque salacité chez les mâles blasés.
J’attends depuis quelques minutes déjà quand mon fameux sens olfactif se met à prendre le vent. Je renifle avec application, certain qu’une odeur de poudre flotte dans l’air confiné. Me voici prêt à te parier un billet pour l’Opéra contre une nuit d’amour avec Alice Sapritch que des coups de pétard ont été tirés ici très récemment.
Je me dirige vers la partie gogues et remarque que l’odeur se fait plus intense. J’ouvre la porte marquée ladies, j’avise deux boxes ouverts et vides. C’est ensuite dans la partie masculine que je m’annonce. L’un des deux chiottards est occupé. J’actionne le loquet, mais c’est fermé de l’intérieur.
— Il y a quelqu’un ? demandé-je.
Silence.
C’est alors que j’avise deux trous très proprement faits dans le panneau de bois à hauteur de poitrine. Les balles tirées sont d’un faible calibre, mais elles sont en barillum peaufiné et les dégâts qu’elles infligent à l’organisme qui les héberge ne pardonnent pas.
Décidément, mes ennemis sont fidèles à leur méthode d’équarrissage en chiottes !
J’hésite un peu, et puis je me dis qu’une balle de plus ou de moins, de toute façon faudra changer la lourde. Alors je dégaine mon pote Tu-Tues et je plombe la serrure. Moi, c’est des gros noyaux que je crache. Tu passerais le poing par le trou qui vient d’être pratiqué. La porte décapsulée ne rechigne pas trop, pourtant elle ne peut s’ouvrir entièrement à cause de la personne inanimée (mais qui n’a peut-être plus d’âme, contrairement aux objets) affaissée sur le carrelage. J’arrive tout de même à insinuer ma tronche par l’écartement.
Jean Rameau, M. Anti-consommation, baigne dans son sang. Il a eu l’épaule gauche pratiquement arrachée par une balle au barillum peaufiné. Tandis que le second projectile lui a carbonisé le pif, ce qui n’est pas un gros dommage en soi.
Je parviens à le refouler de côté, ce qui me permet d’ouvrir complètement la lourde et, partant, de le rejoindre. Ma main avertie (elle en vaut deux, de même que Jean-Christophe Averty vaut deux réalisateurs normaux) part explorer sa poitrine. Le guignol bat correctement.
Bon, alors qu’est-ce que je fais, moi ? Je donne l’alarme et me farcis la police bernoise, ou bien je cours écrire des cartes postales dans un endroit salubre ?
J’opte pour la seconde solution.
LE COUP DE CŒUR
Malgré ces avatars qui ne sont pas, conviens-en ou va te faire inculquer chez les Grecs, piqués des moustiques, je passe une excellente nuit, longue et réparatrice. Dix plombes de ronflette sans escale, ce qui m’est rarissime, à moi, dormeur d’un seul œil. Nonobstant les dangers et autres chausse-trapes ou chaudes pisses qui me guignent, je pionce fermement, bien décidé à me fabriquer un moral d’airain.
Et, ô merveille ! je l’ai bel et fort en m’éveillant. Une lumière concevable[2] filtre à travers les rideaux toujours mal joints, tu l’auras remarqué.
Je requiers pour le breakfast et c’est une jeune femme de chambre qui me livre à domicile. Personne agréable et qui serait même irrésistible pour peu qu’elle consente à se séparer des vingt-cinq kilogrammes excédentaires encombrant son individu.
— C’est merveilleux d’être caféaulaité par une ravissante fille, lui dis-je. Parlez-vous français, au moins ?
— Oh ! oui, je suis de Porrentruy.
Moi, te dire comme je me sens bien luné, je me mets à chanter à pleine voix, sur un air connu :
« De porc en truie, la voilà la jolie truie e e e… »
La môme s’esclaffe en jurassien.
— Quel est votre prénom, ma douceur ?
— Martine.
— Adorable ! Eh bien, Martine, je vous propose un jeu. Regardez mon drap, il recouvre trois protubérances très marquées ; si vous posez la main sur elle qui n’est pas causée par mes genoux, vous avez gagné.
— J’ai gagné quoi ? demande la friponne.
— La chose qui protubère.
Elle m’explique à regret qu’elle doit encore livrer des plateaux à l’étage et que le directeur de l’hôtel est très strict question service.
Je me rabats donc sur mon caoua lequel renifle presque aussi bon que celui de ma Félicie.
Tout en massacrant un croissant, des pensées mafflues m’affluent. Je décroche le téléphone la bouche pleine et, toujours la bouche pleine, ce qui n’est pas la marque d’une parfaite éducation, je compose un numéro à Paris.
— Milou ? dis-je, reconnaissant l’organe de Demussond.
— Ah ! c’est toi, l’Artiste. Alors ?
Je lui résume ce que tu sais déjà et que je t’épargnerai vu que nous sommes là, toi et moi, pour aller de l’avant et non pour jouer le Boléro de Ravel.
— Il faut que j’en sache davantage sur Jean Rameau, conclus-je. Ensuite de quoi, il serait bon que je puisse le visiter à l’hôpital, car le tueur l’a raté et je pense que ses jours ne sont pas en danger, selon la formule consacrée. Les bourdilles bernois doivent le tenir à l’écart et le surveiller, j’aimerais pouvoir l’approcher sans avoir à leur raconter ma vie depuis les Gaulois ; O.K. ?
— Je m’en occupe.
— J’aimerais savoir également si c’est vraiment votre colonel Müller qui souhaitait me contacter hier et ce qu’il avait à me dire.
— C’est tout ?
— Mon tueur-tué coltinait des fafs au nom de Friedrich von Schplaff, il serait sûrement opportun de vérifier s’il s’agit ou pas d’une identité bidon. Il avait en sa possession une enveloppe de plastique contenant des cigarettes et des seringues pas catholiques, j’en fais quoi ?
— Un paquet que tu confieras à la réception à l’intention de M. Müller, justement.
Je lui laisse le numéro de l’hôtel, celui de ma chambre, et j’attaque un pain au lait bien croustillant.
Je n’ai pas achevé de lui faire sa fête qu’on toque à ma lourde.
— Entrez ! conseillé-je, tout en dégageant mon flingue de sous mon oreiller pour le placer en position de défouraillage express.
Une fort jolie dame pénètre dans ma piaule. Bon chic, bon genre. La quarante-cinquaine sonnée mais vaillamment supportée, l’élégance seizième, le maintien digne.
Elle a un mouvement de recul en me découvrant au plumard.
— Pardonnez-moi, dit-elle, j’aurais dû m’annoncer par téléphone, mais votre ligne était occupée.
— Je vous en prie, m’hâté-je, donnez-vous la peine et veuillez me pardonner de rester couché, mais j’ai l’habitude de dormir en simple veste de pyjama.
Elle hésite, luttant avec des principes que madame sa maman lui a probablement serinés pendant vingt piges.
Mon accueil urbain la décide. Elle relourde, s’approche jusqu’à deux mètres quatre-vingt-dix.
— Asseyez-vous, madame. Je déplore de ne pouvoir moi-même vous avancer un siège, mais ce serait au détriment d’une pudeur que je devine fortement ancrée en vous.
Elle sourit menu, se dépose sur un bout de fauteuil qui se voudrait Louis XV, ce con, comme si ça pouvait l’avancer à quelque chose.
— Je suis Anny Etoilet, je travaille à Berne à la Burnkreuse Petroleum Company. J’avais rendez-vous, tôt ce matin, avec Jean Rameau. Il ne s’est pas présenté. J’ai essayé de l’appeler, mais ça ne répond pas dans sa chambre. Inquiète, je suis venue aux nouvelles. La direction a bien voulu visiter sa chambre : son lit n’est pas défait.
Elle a une voix agréable, ferme et chaleureuse. C’est le genre de mémé qui doit te faire ronfler la toupie fantasque, espère ! Comme toujours, je ne puis m’empêcher, en l’écoutant et regardant, d’imaginer la façon dont je me comporterais si, de bonne aventure, elle acceptait mon lit au lieu de mon fauteuil merdico-louis-chose.
Elle continue, de son ton uni, précis :
— Des employés questionnés prétendent qu’ils l’ont vu hier au soir au bar, avec vous. Si je me permets de venir vous importuner, c’est parce que nos affaires en cours sont très importantes et que je suis inquiète de les lui voir négliger. Jean Rameau est un homme très à cheval sur le travail. Son absence, pour ne pas dire sa disparition, m’alarme.
Tout cela bien balancé, net, sans bavures. Je signe le récépissé d’un acquiescement pénétré.
Mon siège est fait, ma décision prise, mon paquetage bien carné. Je lui narre notre rencontre d’hier à Rameau et à moi, sans omettre son autoréquisitoire à propos de la société de consommation, ce qui la fait sourire. J’achève sur ma prise de congé et m’abstiens de lui raconter les péripéties du Ran-Tan-Plan. Après tout, la nouvelle va être connue incessamment et il serait mal venu que je me mouillasse pour la renseigner.
Elle s’apprête à me prendre congé quand le turlu retentit.
Déjà, c’est le camarade Demussond.
— Ton Rameau d’olivier est un bonhomme très honorablement connu, ayant pignon sur rue, ladite rue se trouvant être les Champs-Elysées où il possède ses bureaux. Réputation irréprochable, il est très demandé dans le monde de l’or noir.
J’écoute sans cesser de contempler ma visiteuse. Belle à croquer, décidément. Je me la ferais façon Jockey-Club, tout en rond de bite et en usant du subjonctif pour prendre mon pied. Dame surchoix. Quand elle monte en mayonnaise, ça ne doit pas être de la mayonnaise sous tube.
— Par ailleurs, j’ai fait le nécessaire pour ta visite au bonhomme. Il se trouve à l’hôpital cantonal, service du professeur Achpentzeinmayer.
— C’est pas un nom, c’est un éternuement, objecté-je.
— Il s’en est tout de même servi pour faire carrière dans le bistouri électronique. Maintenant, concernant le colonel Müller, c’est le black-out le plus complet et je suis infoutu de te dire ce qu’il comptait te communiquer.
— En somme, je fais du tourisme en attendant ?
— Si tu veux. Il paraît que les Bernoises sont plutôt jolies ?
Je place ma main sur l’émetteur et je demande à Mme Anny Etoilet :
— Etes-vous bernoise ?
— Non, lausannoise, me répond-elle.
Je délivre le combiné de ma patoune obstruante et déclare à mon pote :
— Erreur, mon ami, ce ne sont pas les Bernoises qui sont jolies, mais les Lausannoises. Salut !
Et je raccroche.
La dame est devenue rouge de confusion. Ce n’est certes pas le premier madrigal qu’elle encaisse, mais on ne lui en avait encore jamais balancé de cette manière indirecte. Pas mal fignolé, n’est-il pas ? comme disent nos chers Britanniques.
Elle se redresse.
— Je vous prie de m’excuser encore pour cette intrusion…
— Que pouvais-je souhaiter de plus merveilleux à mon réveil, chère Anny ? J’espère que vous serez d’accord pour que nous déjeunions de concert et de conserve, sinon de conserves ? Nous confronterons les renseignements que nous aurons butinés au sujet de cette mystérieuse disparition.
Mais elle secoue la tête, un peu raidasse tout à coup.
— Je vous remercie, c’est absolument impossible, bonsoir !
Elle marche résolument vers la sortie.
— Hé ! Attendez !
Elle se retourne.
Alors, mézigue, culotté (ce qui est une, pure image car seul est couvert mon hémisphère nord) de sauter du pieu pour aller vers elle, le métronome battant la mesure à quatre temps dans toute sa gloire de l’aube triomphante.
— Anny, quand on vient voir un homme jusqu’à son lit, on ne le quitte pas comme le super-P.-D.G. des pétroles Machinchouette à la fin du conseil d’administration.
Elle a eu un haut-le-corps qui me perd en conjonctures. Est-ce mon impudence ? Est-ce mon ardeur ? La vigueur de mon compagnon de polissonneries ; son calibre respectable ?
Je mets à profit ce léger blocage pour m’approcher en plein.
— Anny, je susurre, il ne faut pas aller contre la volonté de Dieu, jamais. Il a horreur de ça. Or c’est Lui qui vous a conduite jusqu’aux rives de ma couche solitaire. Vous êtes venue ici de votre plein gré, vous n’en sortirez qu’avec le consentement d’un homme dont, en une seconde, vous avez bouleversé les sens. Et je prouve ce que j’avance, et j’avance ce que je prouve ; ce ne sont pas des paroles en l’air, constatez-le ou tâtez-le.
Cette femme, tu penses : quarante-cinq balais admirablement préservés, mais qui sont là, au complet, une bite pareille, elle la laisse pas passer. Trêve de marivaudage, venons-en aux actes sous seins privés (et qui ne le seront plus d’ici douze secondes !).
Je la prends dans mes bras, la soulève comme une rose de Panthéon, la dépose sur mon lit comme sur la tombe de Jean Jaurès.
— C’est fou ! parvient-elle à articuler, ce qui constitue un agrément tacite.
La suite l’est davantage ! Elle déjà pomponnée, attifée, parée pour la journée. Et moi, hirsute mâle en chibrance féroce, sentant la ménagerie matinale, pris encore dans les rets de la dorme, mais en rut au point que naguère la soubrette de Porrentruy aurait fait l’affaire en deux coups mes grosses !
Etreinte sauvage. Furie du charnel explosant au détour de l’instant, sans préméditation. On ne savait rien l’un de l’autre quelques minutes au paravent. Et voilà qu’on accomplit ensemble l’acte le plus intime de tous : la baise.
Elle ne parle plus, elle geint de bonheur surpris. Il y a encore le plateau du petit déjeuner au pied du lit. Perrette et le pot au lait ! Quelle belle troussée ! Noble ! Intense ! Eperdue ! Tu serais là, t’aurais irrésistiblement besoin d’applaudir. Je crois bien qu’on va représenter la France et l’Helvétie aux championnats du monde de la brosse, tous les deux médaille d’or dans les figures libres, et re-d’or dans les 69 départ arrêté. Plus des médailles d’argent dans un peu tout le reste.
Mais quoi ? La vie est ce qu’elle est et il faut faire avec, aller d’un instant l’autre pour perpétuer sa durée, en essayant que chaque minute apporte une quelconque satisfaction.
Le quart d’heure qui s’écoule s’inscrit dans la colonne du crédit. On a tort de jeter le bois à demi consumé des allumettes car il constitue le souvenir de l’allumette, son témoignage d’ex-flamme. De même, on ne doit pas oublier les moments forts de l’existence car ils aident à supporter les mauvais.
Mais pour l’instant, je m’applique à exister au maximum et à faire participer la dame à cette transe sublime. Mutuel cadeau. L’offrande absolue. « Tiens ! » n’est-il pas le cri du corps ? Prendre, c’est donner. S’assouvir, c’est offrir. Je t’en passe, pouvant très bien débloquer de la sorte jusqu’à ce que cet humble polar t’en choie des mains comme une assiette trop chaude.
Mais comme les choses les meilleures ont une fin, ressemblant en cela aux choses les moins bonnes, nous aboutissons sur le gazon de la réalité et tout se termine par du savon, comme toujours chez les gens rigoureusement civilisés.
Anny Etoilet se refait une santé, une espèce de virginité, puis une beauté. Donc, se place en position de proche récidive.
— Vous êtes un homme terriblement déterminé, note cette femme aimable.
— J’essaie seulement de conjurer la mornité de l’existence, soupiré-je. Merci d’avoir répondu spontanément à ce désir franc et massif, douce Anny.
Là-dessus je lui roule la pelle mélancolique des fins d’étreintes et nous nous prenons congé sans nous fixer de rendez-vous.
Gueuse est la vie, l’ami !
LE COUP DE BUIS
Rameau est sorti de sa nuit, si tu veux bien me permettre au passage cette calembredaine qui témoigne de ma culture-poudre-aux-yeux.
Pansé, tuyauté, ravaudé, il repose en un lit d’une blancheur qui ne se trouve presque jamais au-dessous de trois mille mètres d’altitude. Il est figé, un peu sonné par les médecines qu’on lui a injectées. Cependant, son regard me prouve qu’il est parfaitement conscient et m’a reconnu.
— Salut, Français, dis-je en m’asseyant ; vous avez eu des bricoles pas très catholiques ?
Un masque de sparadrap emplâtre sa frite mutilée depuis ses paupières inférieures, jusqu’à sa lèvre supérieure. Je ne sais pas s’ils sont parvenus à lui rebricoler un tarbouif convenable, les gaziers du professeur Atchoum, de toute manière, le second ne saurait être plus disgracieux que le premier.
Jean Rameau profère des mots peu audibles, car n’ayant plus de nez, il parle du nez, ce qui est inévitable.
— Pardon de vous faire répéter, vieux, mais il faut essayer d’articuler, le prié-je.
— C’est bien fait pour ma gueule, dit alors le blessé.
— Pourquoi ?
— Quand on joue au con on l’a dans le cul, affirme mon ami d’une heure avec philosophie.
— Vous pouvez me raconter ce qui s’est passé ?
Il acquiesce.
— Je n’ai pas donné de détails aux flics d’ici, pensant bien que vous viendriez aux nouvelles.
— Bravo. Alors ?
— Hier soir, je vous ai suivi.
— Quelle idée !
— Je ne croyais pas à votre histoire de fille ; vous n’aviez pas du tout l’expression d’un type qui monte aux miches, vous paraissiez plutôt tendu. N’ayant rien à foutre, j’ai pensé qu’il serait peut-être intéressant de voir ce qu’un poulet de chez nous fabrique dans une capitale étrangère…
— C’est pas très joli, sermonné-je.
— J’en avais un coup dans les naseaux, plaide mon curieux bonhomme.
Et maintenant, il n’a plus de naseaux du tout. Il appartient désormais au club de ceux qui auraient mieux fait de rester devant leur Martini au lieu d’aller fourrer leur nez ailleurs que dans leur mouchoir.
— Continuez !
— Je vous ai donc filé jusqu’à cette boîte de nuit et me suis installé à une table éloignée de la vôtre.
— Vous vous croyiez devenu un personnage de Le Carré ?
Il a une moue amère.
— Bien puni !
— Et que s’est-il passé ?
— Comme je venais de commander du champagne, une fille de la boîte s’est amenée en brandissant un écriteau fluorescent sur lequel était écrit : « M.S. Antonio, téléphone ». Vous dire ce qui m’a pris, je n’en suis pas capable. Un élan irréfléchi. J’ai fait signe à la môme. Elle a cru que j’étais le S. Antonio demandé et a rebroussé chemin.
— Et vous êtes allé au téléphone ?
— Exact.
— Pour répondre à ma place ?
— J’étais curieux de savoir ce qu’on allait vous dire.
Je pose ma main sur la sienne.
— Cher Rameau, murmuré-je, vous savez que si vous n’étiez pas disloqué et plein de drains sur un lit, je vous ferais bouffer vos dents ?
— J ai un râtelier, soupire ce vieux garnement.
— Poursuivez !
— Un téléphone était décroché. Je m’en suis approché, j’ai dit : « Ici commissaire San-Antonio, j’écoute ! » Mais il n’y avait personne en ligne. A cet instant, quelqu’un a appuyé quelque chose de dur dans mon dos et m’a ordonné de lâcher l’appareil et d’aller m’enfermer dans les toilettes.
— Vous avez vu le quelqu’un ?
— C’était une femme, ravissante, avec un accent étranger. Très brune, la peau mate, sans doute asiatique. Elle portait une veste de chinchilla sur une robe noire. Elle avait les cheveux coupés court, une frange lui arrivant au ras des sourcils. Elle était affublée de lunettes teintées à grosse monture noire. Elle paraissait terriblement déterminée. Elle tenait une arme à la main, genre pistolet, mais cela ne ressemblait pas tout à fait à un pistolet ; plutôt à un gant de métal dont l’index aurait été pointé sur moi. Je lui ai obéi sans faire le fiérot, j’avais la certitude qu’elle allait tirer sur moi tant il se dégageait d’elle une expression implacable. Elle m’a guidé jusqu’aux chiottes pour hommes. « Entrez et fermez le loquet ! » a-t-elle enjoint. J’ai obtempéré sans comprendre. Je me remettais à espérer. C’est à l’instant où je fermais le verrou qu’il m’a semblé que je volais en éclats. Ma gueule, mon buste ont comme explosé et j’ai perdu connaissance.
Un silence, il murmure :
— Dites, l’ami, avec ma connerie, je ne vous aurais pas sauvé la vie par hasard ?
— Peut-être bien, conviens-je ; mais peut-être pas, car je dispose de certains gadgets qui permettent de faire face de dos à ce genre de problème, si j’ose m’exprimer ainsi.
— Vous m’en voulez ?
— Peut-on en vouloir à un homme qui morfle deux bastos hors série en vos lieu et place ? Cela dit, votre version du mec beurré qui décide de jouer « Tintin contre Sherlock Holmes » ne me satisfait qu’à moitié.
— Vous imaginez quoi ? soupire Rameau.
— Des chiées de choses. On a prévenu votre famille ?
— Je suis divorcé. Mon ex a épousé un fabricant de je ne sais pas quoi qui habite Bogota. Quant à mes garçons, l’un est dans une université américaine et l’autre joue de la guitare en compagnie de quinze autres connards dans un merveilleux appartement de dix mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés.
— Votre bureau des Champs-Elysées ?
— Oh ! dites, vos services de renseignements fonctionnent vite.
— Je ne m’en plains pas. Alors ?
— Alors quoi ? Où voulez-vous en venir ?
— A ceci : vous semble-t-il possible de passer pour moi pendant quarante-huit heures ? Après tout, c’est vous qui avez pris l’initiative.
— Je veux bien, mais je suis ici pour affaires, j’ai des rendez-vous et je…
— Je ferai prévenir Mme Etoilet, nous trouverons un prétexte pour expliquer votre départ précipité.
Il me file un regard admiratif.
— Et vous connaissez le nom de la petite Anny, par-dessus le marché. Fortiche, l’ami ! Très fortiche.
Je m’abstiens de lui préciser que je connais également de l’intéressée autre chose que son nom.
Son œil se fait malicieux malgré ses souffrances.
— Un conseil d’ami, l’ami : allez donc la prévenir vous-même ; c’est la meilleure baiseuse de toute la Suisse romande.
COUP DE BOURDON
Bon, et alors, il en est où, l’Antonio, petit futé ? Dans quel vilain entonnoir tourbillonne-t-il, pour atteindre quel goulot fétide ?
Me voici à Berne après avoir échappé à deux tentatives d’assassinat. J’ai su faire dévier la première et le sort m’a trouvé in extremis un remplaçant volontaire pour la deuxième.
Ensuite ?
Tout ce bigntz, au lieu de s’éclaircir, s’opacifie. Je suis l’œuf d’opaque ; le glandu de l’histoire. Une affaire à mourir debout dans des gogues suisses, lesquels sont plus propres que la cuisine de bien des restaurants français.
Je capitule les péripétances précédentes.
Un diplomate indien a découvert un secret soviétique, il promet à un collègue anglais de le lui révéler, mais se fait arrêter aussitôt.
Fait unique — et trop unique pour être crédible —, il s’évade de sa geôle, parvient à gagner l’aéroport et à se loger dans le train d’atterrissage d’un zinc en partance pour la Suisse.
L’invraisemblance augmente. Un monsieur faisant dans la diplomatie internationale ne peut ignorer qu’à l’altitude où vole un grand jet, la température n’est pas supportable. Avant de commettre cette folie, il a écrit un mystérieux message avec son sang ; message dans lequel il est question de moi. Abasourdissement du fameux commissaire San-Tonio, lequel n’a jamais entendu parler de ce Stone-Kiroul.
Le « fugitif-entre-guillemets » est retrouvé mort ; son message est dépêché à 1’I.S. britannouille. Les Services de Sa Majesté, épaulés par les Services français, me convoquent. Personne ne pige la signification du message. Alors on décide que je vais me rendre au chevet de Stone-Kiroul dont on a tu la mort, histoire de voir ce qui se passera. Je. Illico, je suis filé par un tueur à gages qui, à la première occase, m’abat. Mais l’Antonio, génial, se tire les pattounes de la béchamel et c’est lui qui déguise l’agresseur en hamburger.
A peine débarqué à Berne, un gonzier me contacte pour me dire que le colonel Müller des Services suisses veut me rencontrer. Je vais dans un restaurant où un rancard m’est donné, en même temps qu’un avertissement : me méfier d’un couple d’Asiatiques. Je prends note.
Sortant du Grossbitrhof je rencontre inopinément ( ?) un vieux dingo du nom de Rameau, nous buvons un pot, échangeons quelques propos d’après-boire et je le quitte pour me rendre au rendez-vous de Müller. Ce con de Rameau me filoche, répond à l’appel qui m’est adressé et se fait tirer dessus par une belle gonzesse apparemment made in Asie.
Devant trois décis de fendant, je tente de faire un peu de ménage dans tout cela.
Je gamberge pêle-mêle, car on réfléchit toujours dans le désordre ; c’est seulement ensuite, pour rapporter ses conclusions, qu’on classe ses pensées dans un ordre soi-disant chronologique.
Selon moi :
A : Ce sont les Popofs qui ont placé Stone-Kiroul dans le train d’atterrissage après l’avoir obligé à écrire ce message.
Dans quel but ? Et pourquoi y suis-je mentionné ? Là, je donne ma langue aux chattes ; l’avenir nous éclairera sans doute, sinon mon éditeur dénoncera notre contrat et je n’aurai plus que la ressource de publier des poèmes à compte d’auteur.
B : Des agents, dits secrets, qui ne sont ni russes, ni anglais, ni français, ont appris « l’évasion » de Stone-Kiroul et, le croyant encore vivant, ils tentent de l’approcher. Ils n’y parviennent pas. Par contre, quand ils me voient ressortir de sa chambre, ils décident de me liquider. Pourquoi ? Parce qu’ils pensent que l’Indien a pu me confier un secret d’Etat. Alors, on doit immédiatement me réduire au silence.
Version plausible.
Ils me ratent et j’atteins Berne sans autre encombre.
C : Le grand vieux qui me parle de Müller était-il réellement mandaté par celui-ci ?
Probablement.
D : La note figurant au menu du Grossbitrhof émanait-elle aussi de Müller ? Je le pense. Nota : pourquoi le grand vieux ne m’a-t-il pas directement fixé le rendez-vous du Ran-Tan-Plan ? Il fallait donc auparavant que je passe par ce restaurant ? Pour me désigner à quelqu’un ou pour me désigner quelqu’un, en l’occurrence le couple de Jaunes ? A voir…
E : L’attentat perpétré au Ran-Tan-Plan n’est certes pas le fait du colonel Müller ; selon moi, « on » a eu vent du rendez-vous aux toilettes prévu pendant les attractions, et « on » m’a fait demander avant celles-ci afin de me liquider. C’est Rameau qui a écopé.
Conclusion : la tueuse ne me connaît pas, sinon elle n’aurait pas tiré sur ce vieux melon.
F : Et maintenant ?
Alors là, mon pote… Alors là…
En accord avec les amis suisses, on va annoncer à la presse que c’est le commissaire San-Antonio qui a été agressé hier dans la boîte de nuit. Les autres seront-ils dupes ? N’ai-je pas déjà d’autres anges gardiens au fion ? On verra bien. Il n’empêche que j’aimerais bien rencontrer le colonel Müller. Pourquoi Demussond m’a-t-il déclaré que c’était trop compliqué pour l’instant ?
Je sors mon élégant Caran d’Ache laqué et me mets à griffonner sur un bout de papelard le message rédigé avec le sang de Stone-Kiroul. Je l’ai appris par cœur, mais j’ai besoin de le voir écrit : Prévenir P. J. France San Antonio. V 818 Stocky Pied.
Il n’y a pas de tiret à San Antonio, mais tout le monde l’oublie et je le lis souvent mon blase, amputé de ce petit signe, en caractères importants dans les baveux, ce qui me rend triste.
Pourquoi adresser aux Services britanniques un message qui m’est destiné ? N’eût-il pas été plus logique de me le faire parvenir directement ?
Je me verse une rincelette de fendant dans ce minuscule verre dont usent les Suisses pour déguster leurs vins blancs. Le liquide d’or pâle mousse légèrement, je dirais plutôt qu’il frise, en dessinant un motif de bulles lilliputiennes en forme d’étoile.
Certains lisent dans le marc de café. Me mettrais-je à lire dans le fendant valaisan ?
Brusquement, une certitude me saute dessus comme une puce dans une culotte de vieillarde. Depuis le début, je la traînais confusément dans les communs de mon esprit ; et la voici, superbe, à poil, rayonnante, bien en chair, qui s’ébroue au soleil de la réalité : Cette affaire ne me concerne pas. Je n’ai rien à voir dans ce micmac russo-britannique. Il y a maldonne ! Une confusion m’a fait embrigader de force dans ce big circus ; mais à l’origine le gentil commissaire San-Antonio (avec tiret, je vous conjure) n’a rien à branler avec Stone-Kiroul.
Reste à piger pourquoi il fallait « prévenir P. J. France San Antonio ».
S’agit-il d’un message codé ? D’une rencontre de mots ? Et voilà qu’à présent une tripotée de vilains ne rêvent que de me faire passer l’arme à gauche.
J’achève mes trois décis. Il fait beau. La dame Etoilet faisait admirablement l’amour. Berne a quelque chose de rassurant, comme un coffre-fort suisse. Les habitants vaquent d’une allure mesurée : Dieu est avec eux !
Pourquoi est-ce « le black-out complet » sur le colonel Müller, pour reprendre la phrase exacte de mon ami Demussond ? Comment se fait-il que mes drivers parisiens ne puissent entrer en contact avec leur correspondant helvétique ? Tu ne trouves pas ça bizarre, toi, joufflu ?
Je quitte ma table pour me rendre au téléphone du troquet. Maman m’a toujours enseigné que les solutions les plus simples étaient les bonnes.
J’empoigne l’annuaire des téléphones de Berne et me mets à folâtrer du regard dans une colonne de « Müller ». J’ignore le prénom du mien, mais sa profession est assez particulière pour que je puisse espérer. Et, fectivement, je pique droit sur un Conrad P. Müller, officier, domicilié Tumlagratt Strasse 8. Je note son bigophone et me mets à turluter aussitôt, mais cela sonne bizarrement. A croire que sa ligne est en dérangement. C’est un peu comme la sonnerie occupée, mais lointaine et plaintive.
« Bon, me dis-je, puisque tu n’as rien à foutre en dehors d’Anny Etoilet et que c’est déjà fait, tu vas rendre une visite au colonel, des fois qu’il serait at home (de Savoie). »
Tumlagratt Strasse est une rue des quartiers résidentiels, en dehors de la ville. Tu passes devant la fosse aux ours, emblème du canton, tu suis les voies du tramway sur ta gauche et tu te pointes enfin dans un coinceteau peinard, bien arborisé, où d’opulentes propriétés crépies dans les tons vert pâle se succèdent sans bruit derrière murs et grilles. Comme mon bahut ralentit, j’avise quelques voitures noires groupées dans la rue du colonel. Pour tout te dire, ne rien te cacher et être franc avec toi en toute sincérité, lesdites bagnoles stationnent devant le 8. Quelques gendarmes gris palabrent en bordure de la grille. Je m’approche d’eux et les aborde civilement puisque je ne porte pas d’uniforme. J’ai droit à une rapide tournée de saluts militaires, secs mais courtois.
— Pardonnez-moi, messieurs, leur dis-je en bon allemand, savez-vous si le colonel Müller se trouve chez lui ?
Le plus gradé du lot jette un regard semi-circulaire sur ses compagnons, puis me demande d’un ton raide comme la justice de Berne :
— Pourquoi voulez-vous savoir cela ?
— Parce que j’aimerais le rencontrer.
— A quel sujet ?
— Ma foi, monsieur, c’est à lui que je souhaiterais expliquer l’objet de ma visite.
Le gradé dit quelque chose en suisse-allemand à l’un de ses hommes, lequel se dirige vers la maison. Les gendarmes cessent de parler ; comme tous les policiers de la planète, ils possèdent l’art subtil de marquer de l’hostilité sans proférer une broque. Un moment s’écoule de la sorte. On entend un ramage d’oiseaux en provenance d’une immense volière édifiée au fond du parc. Ici, tout est sérénité : les hommes, les ours, les oiseaux et le ciel qui les recouvre.
Le messager revient, flanqué d’un bonhomme corpulent et chauve, aussi sympa à regarder que du coulis de tomate sur une robe de mariée. Une cicatrice violette sinue de sa pommette gauche à son menton. Son regard n’a jamais dû se poser sur une fleur, un bébé, une jeune fille ou un San-Antonio, sinon il ne serait pas pétri d’une telle fumiardise définitive.
Il me revolvérise d’une œillée brutale.
— C’est vous qui voulez voir le colonel Müller ?
— Oui, monsieur. Cette requête constituerait-elle un délit ?
— Qui êtes-vous ?
Manière de planifier la situasse, je lui produis ma brémouze.
— Commissaire San-Antonio, de Paris. Je devais contacter le colonel.
Mon turlututucuteur fait relâche, mais sans se départir de son air malsain.
— Suivez-moi.
Nous marchons à la couette lélette en direction du perron. Il entre dans la vaste maison sage, aux boiseries fourbies jusqu’à l’os. D’autres personnages appartenant à la fonction publique se tiennent dans le hall, compassés. L’un d’eux téléphone à une table logée sous un escalier monumental, les autres chuchotent. Tu croirais une scène de conspiration écrite par Ionesco.
Mon chauve, qui ne sourit pas, attend que la ligne soit libérée, après quoi il se jette sur le téléfon comme une bite de sadique sur un tas de poils et compose un numéro d’un index pesant. Sa jactance est lente. Il est question de moi, je reconnais mon blaze. Il attend un long moment et je ne vois que son large dos, immobile. Ensuite il parle encore, mais brièvement, raccroche et se retourne.
— En effet, dit-il, le Service du colonel Müller est au courant de votre séjour.
Puis il ajoute :
— Malheureusement, vous ne pourrez pas rencontrer le colonel : il est mort cette nuit.
COUP DE JARNAC
Le colonel Müller avait son P.C. dans un bâtiment vert pomme, non loin du palais fédéral, au dernier étage desservi par un escalier en pierre avec rampe de fer ouvragé. Des fonctionnaires silencieux y circulent, dans des vêtements couleur de muraille, arborant des frimes assorties. On devine qu’ici tout est sérieux, méthodique. Si farfelu, s’abstenir.
Je me présente à un bureau pourvu d’une double porte sur laquelle on a collectionné des plaques d’émail conseillant dans les principales langues usuelles d’entrer sans frapper.
Je suis ce précieux avertissement, ce qui me permet de découvrir un gros type en uniforme dont les beaux yeux rouges et le teint couperosé admettent qu’il n’a jamais plus œuvré pour la prospérité de l’illustre Maison Nestlé depuis que sa maman l’a sevré.
— Je voudrais parler à Mlle Chtockmurtcher, lui dis-je en germain courant, non sans lire le nom sur le papier où l’on me l’a écrit.
— De la part ?
— Commissaire San-Antonio, de Paris.
Sa bouille s’épanouit.
— Ça c’est un monde ! s’exclame l’huissier, en français. Figurez-vous que j’ai été en voyage de noces à Paris !
Je le remercie vigoureusement de l’honneur que son épouse et lui-même firent à la France en venant perpétrer leur premier coït à l’ombre de Notre-Dame.
— On était dans un petit hôtel près de la gare de Lyon, continue le brave homme ; c’était pas cher mais y avait des punaises.
— On en fait l’élevage dans ce quartier, admets-je. Vous m’auriez demandé, je vous aurais conseillé la Goutte-d’Or, là-bas, ce sont les cafards.
— Ce sera pour la prochaine fois, rétorque mon accueilleur en décrochant son téléphone.
Il m’annonce. Puis se lève :
— C’est en ordre, venez avec moi !
On dédale dans des couloirs. Les personnes que nous rencontrons arborent des mines de circonstance ; on sent que le Service est en deuil.
Après quelques méandres, le voyagedenoceur parisien sonne à une porte matelassée. Un déclic s’opère et la porte s’entrouvre. Je pénètre alors dans un bureau qui détonne avec le reste des bâtiments car il est très moderne : murs blancs, larges baies, meubles design. Il y a même un énorme bouquet artistement composé sur une table basse.
Une dame vêtue d’un tailleur gris d’une cinquantaine d’années (elle, elle paraît un peu plus), quitte le bureau où elle travaillait pour venir à moi. Regard bleu clair, direct, et qui te mate la France au fond des yeux en deux coups d’écuyère à Pau ; cette personne donne une forte impression d’énergie et de sagacité. Je note qu’elle a l’expression douloureuse des femmes qu’un deuil frappe durement mais qui ont à cœur de faire bonne figure. Je m’incline, elle me tend la main.
— Je suppose, dis-je, que la brutale disparition du colonel doit vous affecter beaucoup ?
— C’était un homme tout à fait exceptionnel, répond Mlle … (attends que je ressorte mon papier) Chtockmurtcher.
Mais, voulant me signifier qu’elle n’entend pas qu’on dérape dans l’oraison funèbre de salon, elle demande :
— Que puis-je pour vous, monsieur le commissaire ?
— Vous êtes, enfin vous étiez, la plus proche collaboratrice du colonel, m’a-t-on assuré ?
— Je pense qu’on peut dire cela de toutes les secrétaires qui ont passé vingt-cinq ans avec leur patron.
— Probablement, admets-je avec une voix au sirop d’orgeat dans laquelle tu as laissé tomber un peu d’extrait d’angustura. Le colonel Müller a été abattu hier au soir, alors qu’il quittait son domicile, aux environs de vingt-deux heures trente. Un tueur le guettait au volant d’une Mercedes sombre stationnée face à sa maison et l’a descendu d’une seule balle dans la tête, tirée par un fusil à lunette infrarouge. Boulot de grand professionnel.
Mlle … (merde, je retrouve plus mon papelard), enfin, la secrétaire de Müller, a une crispation de tout son être. Peut-être a-t-elle été pour le colonel une secrétaire très particulièrement particulière, non ? Cela arrive. Le boulot rapproche les êtres mieux que les cocktails. On moque toujours les pédégés et leur secrétaire qui jambenlairent, mais il est normal que le fignedé concrétise les relations de travail. Il en est la noblesse. La preuve, je sais des chefs d’entreprise qui passent à la moulinette à crinière des gerces beaucoup moins choucardes que leurs légitimes : logique, mon pote, bégueule pas : boulot-dodo, c’est lié. Inévitable. Point à la ligne et pine au cul, c’est ça la vie (en anglais the life).
— Vous êtes au courant, bien entendu, de l’affaire Stone-Kiroul, ce diplomate indien découvert dans le train d’atterrissage d’un avion en provenance de Moscou ?
Ma motocultrice (ou interlocutrice, si tu es un pureur de la langue) me déclare :
— Je ne suis pas habilitée à parler du Service à des étrangers, fussent-ils commissaires, commissaire.
Poum ! c’est dit ! Bien carrément, sans bavures ni réplique. Je me retiens d’exploser, ayant, comme le dit Jacques Chazot de l’Académie française, beaucoup de métrite.
— Mademoiselle…
Je retrouve mon papier et épelle son nom : Chtockmurtcher. (C’est moins duraille qu’on ne croit quand on fait appel à des pense-bêtes mnémoniques. Ainsi je me dis : Chtock, comme les éditions, et murtcher, comme l’auteur des Scènes de la vie de bohème.)
— Mademoiselle Chtockmurtcher, votre regretté patron m’avait demandé de me trouver à onze heures dans une boîte de nuit appelée le Ran-Tan-Plan. Il a été liquidé une demi-heure avant ce rendez-vous, alors qu’il s’en allait de chez lui ; m’est-il possible de supposer que des gens qui n’hésitent pas à frapper fort ont voulu coûte que coûte s’opposer à cette rencontre ? Parallèlement, ils ont, dans le cabaret en question, tiré sur un homme qui se faisait passer pour moi. Je conclus donc, moi, simple flic français, que les vilaines personnes qui se sont opposées à cette entrevue craignaient qu’il en résulte une chose terriblement préjudiciable pour leurs affaires ? Logique, pas logique ?
Elle s’est radoucie et me délivre un acquiescement.
— Très bien, l’en remercié-je. Deux points sont à éclairer si nous voulons venger la mort du colonel Müller, vous êtes à même de le faire, du moins en ce qui concerne le premier.
« Est-ce bien Müller qui m’a posé ce rendez-vous au Ran-Tan-Plan ? Dites-le-moi franchement. Si le chef de la police qui mène l’enquête sur son assassinat m’a adressé à vous, c’est bien parce qu’il admet que vous me fournissiez quelques renseignements essentiels, non ?
Mlle Editions Stock-Henry Murger marque un nouveau signe affirmatif.
— Donc, c’est bien le colonel qui a organisé cette rencontre ?
— Je suis en mesure de l’affirmer.
— Savez-vous sur quoi devait porter notre entretien ?
— Sur le tueur de l’autoroute, celui qui est mort de l’explosion d’une bombe.
A son ton, je pige qu’elle en sait long comme la ligne du Transsibérien à propos du décès évoqué.
— Et que voulait m’en dire Müller ?
— Vous m’en demandez trop.
— Ses Services me faisaient filer ?
— Je l’ignore.
Oh ! la menteuse ! Son regard est un aveu. Mais elle est une collaboratrice modèle et ne mouftera pas. Prudence, prudence. Ne pas prendre la moche du couche, mais essayer de glaner un maxi. Une grappe de raisin ne se bouffe pas comme une pomme en mordant dedans, mais grain après grain.
— Müller était décidé de venir personnellement au Ran-Tan-Plan ?
— Je crois.
Donc, si elle dit qu’elle croit, c’est que c’est oui en bonnet difforme (Béru dixit).
— Pourquoi le Ran-Tan-Plan ?
— Il devait avoir ses raisons.
— Raisons que vous ignorez ?
— Le propre d’un officier occupant le poste du colonel Müller, c’est de parler le moins possible, y compris à ses proches.
— Le tueur de l’autoroute était connu de vos Services ?
— Je l’ignore.
A cet instant, une jeune fille ravissante, blonde comme les exquis lingots de la Schweizerische Nationalbank, passe la tête par l’échancrure de la porte, non sans avoir pressé le timbre avertisseur.
— Fräulein Chtockmurtcher, vous avez un instant ?
Pourquoi ai-je l’impression que, tout en demandant, elle adresse un clin d’œil à mon interlectrocutée ? Probablement parce qu’elle lui en fait bel et bien un, non ?
— Je vous prie de m’excuser, murmure la collaboratrice précieuse et discrète de feu le colonel Müller.
Elle s’évacue. Moi, curieux comme un spéculum, au lieu de rester sage sur ma chaise, je ne peux ni empêcher de girafer sur le burlingue de la demoiselle Machintcher. Pourquoi-ce ? Biscotte, lorsque je suis entré, elle a refermé promptement un dossier étalé devant elle, en le retournant pour qu’on ne puisse lire le titre.
Me connaissant comme je connais le slip de ta femme, tu penses bien que je n’ai rien de plus rapide que de choper le dossier pour mater son en-tête. Il s’agit d’une chemise en bristol gris, sur laquelle est écrit, en caractères d’imprimerie collés au browlinghousth, et en allemand adhésif, le texte suivant, que je te traduis car, analphabètes tels que nous le sommes, on se ferait chier la bique toi et moi :
Ultra-confidentiel
Beau début. Dans mon job, on a l’impression que tout ce qui est réputé top-secret vous concerne davantage qu’une lettre de votre maîtresse favorite.
En plus mignard, et rédigé au crayon d’une écriture penchée vachement rétro :
Curriculum de Peter Jeansen France
Déjà la porte se rouvre et je laisse quimper la chemise ; mais Mlle Chose a eu le temps de voir mon geste. Glaciale, elle s’avance.
— Je n’ai plus rien à vous dire, monsieur le commissaire ; ravie de vous avoir connu.
Je me dresse, un peu embêté sur les bords, car il est toujours vexant de se faire jeter comme un vieux tampax en fin de carrière.
Je m’incline cérémonieusement.
Sors.
Sursaute.
Dans le couloir, qu’avisé-je, bien raide et blanc sur une banquette de cuir noir ?
Le général Blackcat soi-même, les jambes croisées, ce qui constitue une espèce de chevalet à scier le bois. Il a un bras sur l’accoudoir de la banquette (qui est donc un banc), son autre main est posée sur son genou comme un gant perdu sur la pointe d’un piquet.
— Hello, commissaire ! me jette-t-il guillerettement, ce qui équivaut aux débordements d’un ordonnateur des pompes funèbres en cours d’exercice.
Je ne lui réponds pas « Elle chauffe », ainsi qu’il était d’usage à la communale quand on criait « Hello », mais m’approche de lui du pas enthousiaste d’un hérétique se rendant à une convocation de la Sainte Inquisition.
— Vous z’ici, général ?
Il ne bouge pas ses pattounes pour la poignée de main rencontrale ; faut dire que les Rosbifs le shake-hand n’est pas leur sport favori, ils lui préfèrent le shaker, ces poivrots mondains.
— Ravi de vous voir, me dit-il, je m’apprêtais à passer à votre hôtel pour vous remercier de votre prestation, tout cela a été très édifiant, mon cher. Beau travail.
Est-ce qu’il se fout de ma gueule, ce vieux squelette ?
J’attends la suite.
Il me la fournit :
— Nous allons pouvoir vous rendre à vos occupations habituelles, commissaire, cette phase de l’affaire est terminée et nous n’avons plus besoin de vous.
Son regard est impénétrable, sa voix coule comme la barbe d’un patriarche. Il ne se départ pas de ses manières urbaines.
Le voilà qui développe le mètre pliant qui lui tient lieu de carcasse.
— Il ne faut pas que je fasse attendre cette chère miss Chtockmurtcher, soupire-t-il. Adieu, donc, cher commissaire. Demussond s’occupera de vos notes de frais, bien entendu, et vous seriez aimable de lui restituer le petit matériel qui fut mis à votre disposition.
J’ai droit à une grimace qui, si tu la regardais dans un miroir déformant, pourrait passer pour un sourire.
Il disparaît sans autre forme de procès.
La rogne m’embrase. Je déponne la lourde de la révérende mère Secrétaire sans prendre la peine de frapper au prélavable.
— Dites donc, général, égosillé-je, si vous congédiez de cette manière les confrères étrangers qui risquent leur peau pour vous, je comprends que vos cheminots et vos mineurs se foutent en grève dans votre île de merde !
COUP DE MAÎTRE
Une ambiance étrange règne sur la Grande Maison. Torpeur de clinique huppée où l’on vient mourir sans encombre ni encombrer ses proches.
On chuchote, les regards se dérobent, les cheminements se font d’un pas feutré. C’est un poil morbide, je trouve.
Lorsque je m’annonce, trois jours après les événements narrés ci-devant (je me suis payé une virouze réparatrice sur les rives du Léman en compagnie de la gente Anny Etoilet, décidément partenaire sublime, dont la chair, les actes et surtout les actes de chair sont un peu plus ensorceleurs chaque jour) mon premier soin est de réclamer audience auprès du dirlo.
Le brigadier Merdedieu, fraîchement promu chef de la garde privée de l’empereur, me dit qu’il va voir si ma requête peut être agréée dans un laps de temps très court. Cinq minutes plus tard, il me confirme un rancard pour dans cinq minutes siouplaît, m’sieur l’commissaire, et soiliez gentil d’être à l’heure, j’vous prille, car le nouveau directeur est très inextricable rapport à l’heure qu’est l’heure, vu que tout de suite n’est pas t’t’à l’heure et inversement.
La seule chose qui me reste dans la citrouille de sa belle tirade est le mot « nouveau ». Il a dit « le nouveau directeur ». Donc, il y a eu chambardement pendant mon absence ?
Voilà ce que c’est que de ne pas lire les baveux franchouillards quand on séjourne à l’étranger !
Cinq broquilles après cette sidérante annonce, je me présente dans l’antichambre. Là encore, autre surprise : l’huissier lui aussi a changé. Le nouveau est un jeune type glabre, avec un nez en forme de bec, des cheveux comme une aile de corbeau, et un regard aussi tendre qu’une poire en albâtre.
— Je suis le commissaire San-Antonio, lui déclaré-je en lui tendant la main.
— Je sais, me répond-il sans la prendre.
Il décroche le godemichet mérovingien qui sert de tubophone interne.
— Monsieur le directeur, le commissaire San-Antonio est à votre disposition, annonce cette infamure vivante.
Il écoute, se courbe.
— Tout de suite, monsieur le directeur.
Il raccroche et m’introduit.
Mon cœur se serre comme un pied qui vient d’emménager dans une godasse trop petite de trois pointures.
Le nouveau directeur ! O Seigneur ! Où est-il, notre cher Achille au crâne poli, à l’œil si bleu, aux manières délicates ? Viré, shooté, proscrit ? Fin d’une carrière longue et noble, assortie de mondanités, ponctuées d’engueulées farouches où le moindre accord de participe était respecté, le vocabulaire aussi raffiné que dans du Monteilhet, les péroraisons toujours explosives. Dans quel hôtel particulier silencieux, vers quelle gentilhommière enlierrée, sur quel bateau transformé en concert flottant s’est-il réfugié, le Vieux chéri qui aimait tant à se plier au Pouvoir, comme tous ceux qui raffolent de commander ?
Et le nouveau, hein, le nouveau ? Un Saint-Just, probablement, venu de l’enseignement secondaire, voire seulement primaire, pour refondre une police qui cependant servait de modèle à celle de la Haute-Volta, du Liechtenstein, de la Tanzanie et de la Sierra Leone, pour ne citer que les principaux pays qu’elle épatait, notre valeureuse police française.
Je l’imagine, le nouveau, oh ! que oui : froid comme colin sans maillard, le mutisme menaçant, syndiqué jusqu’au rectum, vêtu de triste et en confection, entièrement nourri de surgelé, serrant la main à dix centimètres de soi, pas davantage.
Et alors, bon, meurtri par la nostalgie, l’appréhension, le reste, plus tout ce à quoi je ne pense pas encore mais bouge pas ça viendra, j’entre dans le saint des saints.
Contrairement à ce que me soufflait une mesquine logique bâtie en éléments préfabriqués, le nouveau dirlo n’est pas un grand maigre habillé de gris, pas un pâlichon mal nourri, pas un doctrinaire sur le qui-vive, pas un réciteur de récitations, pas un mystique laïque, pas un Marx Brother, pas un illuminé-qui-s’use-que-lorsque-l’on-s’en-sert, pas un diurétique hématurique, pas un rouage, non. Bien au contraire, il s’agit d’un bon vivant corpulent et sanguin, aimant visiblement la chair et la chère (bonne ou mauvaise).
Il est avant tout du cul et pour le cul. Sagement démesuré. Les convenances ne sont point sa monture favorite. Il y a des gaz en lui et il ne s’embarrasse pas de préjugés pour les exprimer.
Donc je m’arrête, interdit (de séjour) devant le gros monsieur portant un superbe complet de flanelle sombre à fines rayures smaltesques. Le cheveu rare est admirablement gominé. Les joues rasées à mort luisent comme un cul de singe. L’œil benoît jubile. Un sourire désamorcé retrousse un tantisoit la lèvre supérieure. Chemise blanche, cravate bleu marine.
— Qu’est-ce que ça veut dire, Gros ? exhalé-je dans un souffle d’agonie.
Bérurier, car, initié comme je te sais à l’œuvre santoniaise, tu as deviné depuis au moins dix secondes qu’il s’agit de l’Enorme.
Bérurier, donc, me considère d’un air plutôt satisfait. Il me désigne le siège qui lui fait face et dit d’un ton sobre :
— Si vous voudrez bien vous asseoir, commissaire, et m’app’ler m’sieur l’directeur, j’vous en saurai un plein pot d’gré.
J’obtempère.
— A quand remonte cette prodigieuse promotion, monsieur le directeur ?
— Avant-t’hier.
— Et cela s’est fait comment ?
— Mon prédécurseur a été invoqué sec, pourri ! au chômedu ! M’sieur l’miniss l’a remplacé par un homme compéteur, doué d’une espérience solide et qu’ses sympathies pour la gauche fassent aucun doute.
— Je ne vous savais pas engagé politiquement, monsieur le directeur.
— Tout ce que vous savez pas et d’aut’ sachent, y a un monde, objecte l’éminent personnage depuis son trône.
Baissant la voix, comme s’il craignait d’entendre lui-même ce qu’il va dire, le directeur murmure :
— Confidencieus’ment, l’mérite en revient à ma nièce.
— Vous me faites dépérir de curiosité mal contenue, monsieur le directeur.
— Ma nièce et quasiment fille, Marie-Marie, est pleine d’idoles au logis. D’puis lulure elle appartient aux jeunesses socialisses ; v’m’suvez, commissaire ?
— Fort bien, tout adolescent doit avoir des élans à gauche, sinon sa puberté risque d’être gravement perturbée.
— J’vous l’fais pas dire. ’maginez-vous qu’ c’te petite diablesse m’a inscrit aussi, un soir qu’j’étais blindé. J’lu ai signé le bulletin adhésif en croiliant qu’c’tait son carnet scolaire. D’puis lors, c’t’elle qui casque les cotisances. Et v’là qu’ça a apporté ses fruits.
— Les fruits de la passion, fais-je. Mazette, quelle corbeille !
— Tout d’sute, pris au débotté, j’ai cru qu’avait maldonne, poursuit le directeur. J’m’ai d’mandé si l’exist’rait pas un aut’ Bérurier. Mais non, j’m’ai rendu à l’évidage : c’tait bien d’moi qui s’agissait. V’v’rendez compte, commissaire, c’qu’en moins d’deux j’ai fallu faire ? Ach’ter un costar neuf, une limouille blanche, une cravtouze mylord. Et puis imprimer d’nouvelles cartes d’visite dont je vous en donne une volontiers à titre d’curiosité. Sans parler d’maâme Bérurier qu’a besoin de toilettes neuves pour paraît’ dans l’monde. On a dû r’tirer de l’Ecureuil pour faire face. C’est pas tous les jours qu’on est promouvu directeur d’la police.
— Je suis persuadé que vous ferez merveille à ce poste, monsieur le directeur. Il est déjà arrivé dans l’Histoire qu’on prenne le plus con pour occuper le plus haut poste, en pensant que ce serait une mesure transitoire et qu’on ait eu des surprises, la fonction créant l’homme.
Le directeur hoche la tête.
— J’vous remercille pour vot’ confiance, commissaire. Il est pas impossib’ qu’j’songeasse à vous pour occuper d’hautes fonctions dans un av’nir proche. Slave dit, vous vouliez m’causer ?
— C’est toute une histoire, monsieur le directeur.
— Eh ben, racontez-la-le-moi, mon cher ami, si j’ai deux oreilles c’est pas s’lement pour r’tenir les branches d’mes lunettes d’soleil.
M’efforçant de passer outre ma timidité, je fais au nouveau patron une relation très minutieuse des événements dont tu as eu la primeur, ce qui est tout à fait logique étant donné que tu paies le bouquin. Je conclus par l’éviction désinvolte décidée par le général Blackcat.
M. le directeur prend fait et cause pour moi. Il donne violemment du poing sur le burlingue d’acajou et exclame :
— V’v’lez que j’vais vous dire, commissaire ? Ces Rosbifs d’mes deux sont des enculés, et vu mes hautes péjoratives j’pèse mes mots. Y vous sucent et ensute vous arguent sans un mot d’remerciement. J’comprends que mon pauv’ prédécurseur s’soye fait j’ter à force d’fout’ ses flics d’élitre dans des béchamelles à la con. Alors y a eu carnage en Suisse, vous avez réchappé la mort à deux reprises, et conclusion : va taire voir, gamin ! Non, mais y nous prennent pour qui est-ce, ces veaux ! M’étonne pas qu’y soyent encore en royauté ! C’est tout c’ qu’y méritent : une reine à frime d’chaisière qu’le premier plombier-zingueur en chômage va regarder pioncer dans sa chambre quand il sait pas où finir après une nuit de libellation et qu’les bistrots sont fermés. Ecoutez-moi, commissaire, parlez-moi pas, j’devine ; vous connaissant tel que j’vous pratique, vot’ idée c’est d’poursuive l’enquête au compte d’la Maison Pébroque, ou j’me goure ?
— Travailler sous vos ordres est une volupté rare, monsieur le directeur. En effet, je souhaiterais poursuivre, surtout après ce que j’ai découvert.
— Et qu’avez-vous découvert duquel vous m’eussiez pas causé ?
— Je vous ai relaté le fait, mais vous n’y avez pas pris garde car, voyant désormais les choses de trop haut, il ne vous est point loisible de capter les détails.
— L’essentiel est qu’mon personnel à chevron voye et m’mette au parfum, riposte l’Eminent personnage.
— J’en suis convaincu, monsieur le directeur. Je vous ai donc dit qu’un dossier se trouvait sur le bureau de la secrétaire du colonel Müller. Il concernait un dénommé Peter Jeansen France.
— Fectiv’ment.
— Ce qui abrégé donne P. J. France. Voilà qui commence à éclairer le mystérieux message écrit avec le sang de Stone-Kiroul. Tout le monde a cru qu’il s’agissait de la P. J. française. Le texte est « Prévenir P.-J. France San Antonio ». D’où ce bel ensemble pour me demander des comptes et m’embarquer sur la galère. En réalité il n’est pas du tout question de moi. Je viens de me livrer avec Mathias à des recherches poussées. Nous avons découvert l’existence d’un dénommé Peter Jeansen France, à San Antonio, Texas. San Antonio sans tiret.
— Ah ! ça, c’est chié ! s’écrie le nouveau Big Boss. Qu’est-ce vous z’attendez pour foncer là-bas ?
COUP D’ENVOI
C’est un très bel avion de la Té-double-vé-A (en anglais : Ti doble you É) Boeing rutilant, pomponné, avec du bourbon ambré et des hôtesses platinées comme on n’en trouve plus que sur les lignes américaines.
On survole des nuages roses sur fond bleu, très choucards, car la T.W.A. est une excellente compagnie qui ne te traîne pas les miches dans n’importe quels cieux.
Je suis assis au côté d’un vieux Texan à cheveux blancs qui ne s’est pas départi de son chapeau de paille noir et qui réussit le tour de force de mâcher du chewing-gum, boire du whisky, parler à l’hôtesse et roter son barbe-cul de midi en même temps.
Moi, tout dodelineur, rêvasseur, tragique de solitude, je mémore mon affaire, et aussi l’extraordinaire évolution sociale qui a permis à mon subordonné de devenir mon chef. Nous vivons l’ère des contes de fées. Les bons contes faisant les bons amis, je sens se développer dans mon âme et sa périphérie les racines de la fraternité. Ayant toujours été ouvert à celle-ci, j’accueille son flux impétueux comme le pastis dans son verre accueille l’eau claire qui va le troubler.
Bérurier directeur de la police française ? Soit, d’accord. Elle est dans de bonnes mains, un peu calleuses, certes, gercées, couturées, trop onglées et plus ou moins bien lavées, mais je sais que le bon sens suppléera la carence du savoir-vivre.
D’ailleurs, le savoir-vivre, tel qu’on le pratique dans nos contrées suréquipées, est la source de toutes les hypocrisies, donc il sert d’humus au mensonge, cette plaie de l’humanité. Et quoi de plus contraignant que d’avoir à paraître ce qu’on n’est pas ou peu, devant des gens qui, eux aussi, s’appliquent à donner d’eux-mêmes une idée non conforme à la vérité ? Conclusion, le savoir-vivre est haïssable, au même titre que le polygone irrégulier. Je n’en démordrai pas, ou alors il faudrait qu’on y mette le prix.
Cela étant bon à dire et dit, ô mon lecteur affectionné, j’en reviens à ma mission.
Je me fais l’effet d’un pirate, n’étant aucunement mandaté pour la poursuivre. Mais le franc-tirage, ça me connaît, il est devenu mon style.
Je gamberge d’abondance.
Au début, le coup de P. J. France a induit nos Anglais en erreur.
Et puis la situation a évolué, par moi et aussi en dehors de moi. Les services de renseignements suisses ont compris, eux, que P. J. France ne me concernait pas. Mieux : ils détenaient le curriculum vitré (comme dit mon nouveau directeur) de M. France. A partir du moment où ils en ont informé le général Blackcat, celui-ci m’a laissé quimper comme un résidu de nourritures. Il est probable que, dès lors, je devenais encombrant. De rouage je passais poids mort. Or, la position de poids mort est la plus inconfortable de tout l’appareillage social. San-Antonio (avec tiret) devenait une sorte d’emballage perdu qu’il convenait de perdre au plus vite.
A présent, gentil lecteur sous-développé (puisque me lisant), laisse-moi t’expliquer comment l’idée m’est venue de chercher le Peter Jeansen France à San Antonio. Facile.
Confirmé dans l’impression de maldonne qui me poignait, je me suis dit « Il n’existe que deux espèces de San-Antonio au monde : moi et les villes ou bourgades ainsi nommées, c’est-à-dire le San-Antonio avec tiret, et les autres qui ne peuvent s’offrir ce luxe typographique, les cons. Cherchons donc si, dans l’un des San Antonio sans tiret épars dans l’univers, en Italie, en Espagne, dans la Sud Amérique et aux U.S.A. se trouvait un dénommé France. »
Mathias s’attelle à la tâche à grand et petit renforts d’annuaires internationaux. Et deux heures plus tard, mon rouquin magique se pointe avec la solution du rébus. Il existe bel et bien à San Antonio, Texas, un Peter Jeansen France. Gagné !
La profession de ce quidam ?
Je te le donne en mille ?
C’est trop ?
Alors en dix ?
Tu ne trouves toujours pas ?
Très bien, donne ta langue, chérie, à moins que tu n’aies mangé du Munster[3].
Eh bien, figure-toi (ou figure-moi, si tu préfères) que ce mystérieux mister France dirige une entreprise de pompes funèbres. Faut l’inventer, non ? Oui, cet homme dont le nom se trouve impliqué dans une sombre affaire d’espionnage entre l’Est et l’Ouest et qui possède sa biographie dans les dossiers du S.R. bernois, cet homme travaille tout bonnement dans la viande froide. Tu lui donnes un mort, il en fait un paquet.
Le gentil Mathias, ça va de soi, ou plutôt de lui, se livre à une enquête sur le gazier en question. Il s’adresse aux R.G., au G.I.G.N., au C.E., à la C.G.T., à l’U.D.R., au B.I.T., à la S.N.C.F., à la R.A.T.P., au C.O.C.A.C.O.L.A., au Q.I., au Z.O.B., au P.A.F., ailleurs. Il fouille dans les archives, les dossiers, les tiroirs, il regarde dans le tréfonds des placards, il vide les malles des greniers, il passe sa main sur les armoires, il vide les caves, explore les corbeilles à papiers sans rien obtenir. La réalité française est là, simple et tranquille : pour toutes nos instances policières, gendarmeuses, politiques, médicales, socioprofessionnelles, pédérastiques, religieuses, académiques, criminelles, problématiques, culturelles, occultes, maritimes, aériennes, antédiluviennes, ferrugineuses, vélocipédiques, militaires, maraîchères et phonétiques, pour tout, tous et toutes, dis-je, le dénommé Peter Jeansen France n’est qu’un nom sur l’annuaire de San Antonio. On ne possède aucun renseignement à son sujet. Ma crémière n’en a jamais entendu parler, non plus que M. Leprince-Ringuet, auquel je me plais à rendre hommage ici, et pas davantage que M. Roger Peyrefitte qui écrit mieux que moi, mais des trucs plus dégueulasses et que j’aime bien car on est deux au moins à pisser au cul des Jean-foutre ; nul journal ne mentionna jamais ces trois noms chargés de qualifier un même individu. Bref, la France, bien soudée et unanime comme dans les jours sombres de son Histoire, la France ignore mister France.
Et c’est pas plus mal comme ça.
Le vieux Texan d’à mon côté continue ses virtuosités maxillaires.
Il produit un bruit pénible de déglutition permanente. Quelle horreur, ces bipèdes qui se foutent des choses non comestibles dans la gueule et qui, plus tard, les recrachent pour les coller sous la table !
Je ferme les yeux. Mais l’œil étant dans la tombe et regardant Caïn, l’affaire continue de me fixer dans la pénombre relative de mes paupières closes. Je m’acharne à décrypter le texte du message trouvé sur Stone-Kiroul. Je surtresse, sautaille, sursaute, tressaille avec un synchronisme qui écœurerait un ordinateur (de pompes funèbres).
— Hello, please ! interpellé-je l’une des hôtesses, la plus mieux platinée du lot, avec en suce un sourire à t’arracher le copeau (ses chailles de devant ressemblent aux touches d’un appareil à sténotyper).
Elle attend mon bon plaisir, prête à ôter sa culotte si mes desiderata allaient dans ce sens.
— Avez-vous un horaire de tous les vols en direction ou en provenance de San Antonio, ravissante demoiselle ?
Elle paraît déçue comme si on lui annonçait qu’on va lui bouffer le frifri avec des baguettes.
La v’là partie dans son gourbi à frichti, farfouillant dans un placard du bas, ce qui tend admirablement une jupe qu’on aimerait fendre d’un coup de rasoir subtil. Elle se rabat ensuite sur la commode et finit par dégauchir un gros book grouillant de chiffres, de lettres abréviatives, de noms enchanteurs.
En me le tendant, elle déchapeaute le vieux Texan, ce qui fait bougonner celui-ci et laisse apparaître une calvitie fortement eczémateuse.
Voici ton Antonio joli (le vrai, à tiret) parti dans des compulsages méthodiques. Une sorte de jubilation mal contenue chauffe mes cellules grises, j’ai la certitude prémonitée que je vais découvrir ce que j’attends, ce que je sais. Car la vérité me pénètre par pulsions violentes et un instinct poulardier m’indique ce que je dois apprendre.
Si tu n’as pas cette espèce de don, il est inutile de pratiquer mon dur métier et mieux vaut te faire épilateur chez la femme à barbe.
Je mets dix minutes à trouver ce que je cherche ; mais le trouve, et un hymne de grasse (c’est Manouche qui me l’a appris) s’échappe de mon cœur, comme un vent du fauteuil directorial de M. Alexandre-Benoît Bérurier.
« Il » est là, bien là, avec ses trois chiffres avenants : 818. Ah ! chers 8, signes de l’infini. Et toi, 1, sans qui rien ne serait puisque tout commence par toi, si svelte. Vol 818 ! Voilà donc déchiffré un autre bout du message écrit à l’encre de veine. Vol 818, soit San Francisco-San Antonio. J’avance. Ne reste plus que deux mots à déchiffrer : Stocky et Pied. Mais je trouverai.
Sur cette certitude, l’avion se pose impeccablement sur une piste jonchée de criquets énormes.
COUP D’ŒIL
Funeral House
C’est écrit en puissants caractères dorés dans du marbre blanc. Une porte immense, laquée de couleur lie-de-vin, à doubles vantaux, pourrait livrer passage à des funérailles nationales italiennes. Commence alors une succession de halls d’exposition very interessinges, offrant à l’amateur indécis tout ce que l’art funéraire a pu produire depuis les pharaons jusqu’au style new look américain, en passant par les plus folles créations napolitaines. Il y a des halls de cercueils, d’autres de tombeaux. C’est présenté par un étalagiste qui doit se faire la main au Salon de l’Auto. Des podiums drapés de velours, des tentures, des décors peints, des tourniquets, mettent en valeur les ères les plus époustouflantes. Capitonnées, cela va de soi ; en bois rares, inutile de le mentionner, avec des poignées de métal précieux et des marqueteries qui auraient foutu la diarrhée verte à Charles X, ce grand con, je te le consigne pour mémoire ; en marbre sculpté, en bronze, en papier mâché ; mais faut voir les formes ! Certains cercueils, tu croirais des bagnoles de formule 1 ; d’autres sont gothiques, d’autres byzantins ; il y a le cercueil époque Néron, le cercueil Rudolph Valentino, avec plume dans le cul, le cercueil indien, comportant quatre éléphants aux angles et des poignées en ivoire. Cercueils d’ébène, d’acier, de verre ; cercueils à coupole, à roulettes, à ailerons ; cercueils en forme de chars romains, de sous-marins, de pianos droits, de cigare (allumé : le bout est éclairé au néon et c’est l’occupant qui fait les cendres). Cercueils blancs, rouges, arc-en-ciel. Cercueil, en forme de dalle dont le couvercle est un gisant (motif à choisir, t’as l’Indien à plumes, le guerrier noir, le cosmonaute en combinaison, le lancier du Bengale, le toréador, Ophélie, Caligula, Nixon, Moïse, Amin Dada, le doge de Venise, l’archevêque de Canterbury, Gaston Defferre, Ramsès II, George Washington, Charlie Chaplin (à roulettes), Napoléon Pommier, Frank Sinatra, Mme Récamier, Agrippine (de cheval), le Spirit of Saint Louis, mon cul, le tien, le nôtre, Lenôtre, Louis XIV, Marilyn Monroe, Juan Carlos II, Fenimore Cooper, Maurice Schumann, un autre, Reagan en cow-boy, le docteur Mabuse, Léon Tolstoï, Léon Trotte-ski, Léon Zitrone, Canuet, deux autres, Buster Keaton, Dioclétien, Casanova, Anne de Boleyn, Agamemnon, l’Agha Khân III, l’Agha même nom IV, Coluche, et deux mille autres).
Une musique allègre retentit sur cet immense bazar funéraire ; air de jazz guilleret qui va bien avec le style « Mourez, nous ferons le reste » de cet établissement comme il est regrettable que nous n’en possédions pas chez nous car l’Europe, quoi qu’elle prétende, est une contrée sous-développée.
De fort jolies hôtesses, accortes comme disait mon grand-père, en uniforme rose praline, sont là pour vous renseigner, vous distribuer les prospectus, voire vous guider jusqu’aux bureaux de location-vente pour y passer commande.
Ma pomme échafaude en parcourant ces salles d’exposition. Il s’agit, maintenant que me voici à pied d’œuvre, de ne pas renverser la saucière sur mon complet blanc. Prudence est mère de la P. J., a dit La Fontaine.
Après que j’aie visité les trois mille mètres carrés d’exposition, caressé les sarcophages, admiré l’architecture des plus beaux tombeaux, rêvé des moelleux capitons à l’intérieur desquels il doit faire bon dormir, il me paraît opportun de commencer à chercher une fente où enfoncer mon coin.
Ayant reparcouru l’ensemble, je m’intéresse au mouvement de cette étrange boutique. Des couples y viennent choisir leur future sépulture, comme d’autres vont à l’aéroport de Bruxelles, le dimanche, pour jeter du pain aux avions. C’est un but de promenade utile. Ils supputent, admirent, demandent des prix et emportent des catalogues. D’autres personnes moins chalandes sont là afin de requérir les services immédiats de la maison à la suite d’un deuil tout frais.
Je surveille, entre z’autres, les pérégrinations de deux messieurs noirs, de condition aisée, cela se remarque à leur vestimenture et à leur maintien, qui font l’emplette pour leur vieille maman défunte d’un mirifique cercueil rouge, avec hard top en plexiglas fumé, poignées incorporées. Deux grands fils aimants, je pressens, soucieux de gâter une dernière fois la mère vénérée. Je leur virgule un sourire de compassion fraternelle qui ne parvient pas à destination car ils se méprennent sur sa signification profonde. Ainsi, souventes fois, nos élans de l’âme glissent-ils sur les peaux de banane de l’incompréhension, ce qui est déplorable, mais qu’y puis-je ? Je remets donc mes excellents sentiments dans ma culotte et poursuis ma vadrouille dans le palais des ultimes mirages.
Je ne tarde pas à remarquer que chaque jeune femme préposée, lorsqu’une commande s’amorce, va en référer à une dame blonde, en robe de ville sobre mais élégante. Ladite est coiffée tiré, avec une raie médiane, une sorte de chignon sur la nuque, maintenu par une grosse barrette d’écaille. La fille est grande, mince, distinguée pour une Ricaine, avec un regard sombre, intelligent ; elle a très peu de poitrine, c’est dommage, mais on peut s’en acheter une ailleurs. Elle se tient en principe dans un grand box vitré, meublé somptueusement, mais qu’elle abandonne à tout bout de champ pour répondre aux sollicitations de ses hôtesses. Bref, il est clair que la jolie personne assume la direction de la partie présentoir. Elle s’acquitte de sa tâche avec classe, affable et réservée ainsi qu’il sied dans un négoce de ce genre qui t’amène des pratiques chez qui la mort vient de frapper.
Je jette sur elle mon dévolu, attendant que ses activités connaissent une accalmie pour l’aborder des plus civilement.
— Pardonnez-moi, miss, fais-je en lui présentant ma carte de grand reporter (j’en possède douze pour mes déplacements à l’étranger, affirmant que je suis journaliste, médecin, réalisateur TV, artiste peintre, ingénieur dans l’électronique, etc., selon les besoins des causes).
Elle regarde, mais c’est écrit en français que je suis correspondant permanent aux U.S.A. du Courrier de l’Ardèche, et dans l’ignorance de cette langue où elle se trouve, me rend la brème en ne retenant d’elle que le mot « Presse » et sa barre tricolore en diagonale.
— Je réalise un grand reportage sur « la mort aux Etats-Unis », expliqué-je. Vos habitudes diffèrent beaucoup des nôtres et il y a là matière à intéresser le public de mon journal ; envisageriez-vous de m’accorder une interview ? Bien entendu il n’est pas question de vous importuner pendant vos heures de travail, mais c’est volontiers que je vous inviterais à dîner si la chose vous paraît réalisable.
Elle sourit.
Et puis me défrime car, sous toutes les latitudes, toutes les longitudes, tous les parallèles, tous les pôles, tous les équateurs, avant de répondre à une proposition de ce genre, l’intéressée examine celui qui l’articule.
Je m’efforce donc (et sans grand mal, ma modestie dût-elle en pâtir) de ressembler à un homme bien tourné, au visage agréable, au regard pétillant d’esprit, possédant un sexe de belle facture et sachant où le placer ainsi que la façon de l’actionner lorsque c’est chose faite.
L’examen, pour bref qu’il soit, est concluant car la jeune belle femme dit :
— Ce serait une bonne idée.
J’évite de me pourlécher de façon trop ostentatoire.
— J’habite l’hôtel Commodore, sur la San Antonio River, voulez-vous me rejoindre au bar, ce soir à neuf heures ? Nous prendrons quelques drinks et ensuite je compte sur vous pour m’indiquer le meilleur restaurant de la ville.
— Celui du Commodore jouit d’une excellente réputation.
— Merveilleux, dis-je en songeant que, de la sorte, nous ne serons pas éloignés de ma chambre.
Elle déclare, très spontanée, comme toutes les Ricaines :
— Mon nom est Maggy.
— Ce soir, je le saurai par cœur, promets-je.
Je chique les cérémonieux et m’incline comme si j’étais le roi d’Espagne en visite chez la duchesse d’Albe ; les bonnes manières impressionnent toujours les gens qui n’en ont pas. Même si elles sont contraires aux principes de la personne.
Cette prise de congé ravit la belle Maggy. Elle me regarde disparaître à travers son bric-à-brac d’emballages à osselets comme une génisse s’attarde sur le fourgon de queue d’un petit train d’intérêt départemental.
Je me promets pour très bientôt des instants exceptionnels.
En sortant, je musarde par la ville. Il y fait chaud et l’air est empuanti de gaz d’échappement. Un homme-tronc vend des journaux aux titres tapageurs au bord du trottoir.
Le sol est jonché de papiers sales et d’insectes qui éclatent sous vos pas. Une petite Noirpiote vêtue d’une jupe bleu ardent et d’un tee-shirt sur lequel est écrit « Mon cul s’appelle Reagan » actionne un appareil distributeur de Coca. Je lui souris, elle me tire la langue. Jolie langue d’un mauve de samoyède. Un cireur de pompes, qui a surpris mon manège, murmure en me fixant en plein dans les carreaux comme, autrefois, le président Giscard fixait la France : I kill you (je te tue).
Décidément, les sourires ne sont pas appréciés au Texas.
J’atteins un carrefour marqué par une tour au sommet de laquelle galope le texte d’un journal lumineux. Nouvelles locales. Des accidents de bagnole…
Il est five o’clock. Tu crois que la belle Maggy va se laisser embarquer dans ma combine ? Et dans mon plumard, dis ?
Le hasard nonchalant, mais qui veille, me conduit jusque devant les vastes burlingues de la T.W.A.
J’y pénètre. C’est grand comme le siège principal d’une banque suisse avec plein de guichets. L’air conditionné sévit si fort que tu te sens illico au bord de la pleurésie. Au bout de dix secondes tu y es accoutumé et tu baignes dans le bien-être de la vie moderne.
J’opte pour un guichet marqué « Renseignements », derrière lequel M.H.J. Malckommer, un rouquin au nez pointu, essuie ses lunettes de myope (si j’en crois l’épaisseur de ses vitres, c’est le dernier stade avant la canne blanche).
Je l’aborde avec civilité, ce qui l’incite à rechausser ses besicles pour que je cesse d’être un ectoplasme.
— Hello ! lui fais-je gaillardement, à présent qu’il est en mesure d’apprécier mon charme fait d’énergie et de sympathie, le tout enveloppé dans de la peau de mec surchoix.
Il opine, prudemment.
— Que puis-je pour vous ?
Je n’hésite pas, lui déballe ma carte professionnelle, la vraie, d’entrée de jeu.
— J’appartiens à la police française et me livre à une enquête dans le cadre d’Interpol.
Il opine. A cet instant son turlu mélodise, il décroche et se met à parler avec une nommée Daisy de leur Van tout neuf, si exquisement décoré, si pratique qu’ils se demandent pourquoi ils habitent un appartement au troisième étage de Roubignol’s street, au-dessus d’un garage de merde plein de bruits et de fureur.
J’attends la fin de leurs états d’âme en feuilletant un dépliant où ça cause d’Acapulco, comme quoi on y est mieux que dans un goulag, tout ça.
M.H.J. Malckommer (c’est écrit en lettres dorées sur fond noir à son guichet), raccroche, l’air béat.
— Nouveau marié, hé ? lui glissé-je, je parie qu’elle est jolie à croquer et je l’imagine, avec ses lunettes, son nez retroussé, ses taches de rousseur, ses cheveux frisottés et sa jolie robe verte.
Il me coule une œillade surprise, quoique surmyopée, et prend le parti de sourire.
— Depuis huit mois, consent-il à révéler, en réponse à ma question, et c’est vrai qu’elle est fantastique.
Il me fait un peu penser à Mathias, H.J., avec sa chevelure incandescente et son air définitivement soumis à sa moitié — à part — entière.
— Vous disiez donc, inspecteur ?
Je le laisse me dégrader sans vergogne (et sans rancune de ma part), n’étant pas de ces hommes accrochés aux barreaux de l’échelle sociale.
— Vous devez conserver la liste des passagers usant de votre fabuleuse compagnie ?
— Certainement.
— J’aimerais vérifier si un certain Stocky Pied a pris votre vol 818 San Francisco-San Antonio un jour d’il y a quelque temps ; comment faire ?
Mon ami Malckommer prend un petit air de circonstance.
— Vous parlez du vol 818 qui a eu… des ennuis ?
Tilt ! Voilà, j’ai fait « Tilt ! ». Des ennuis ! Un vol. Quels ennuis ?
Et tout haut j’articule ce que mon cerveau vaseline dans le silence :
— Quels ennuis ?
Du coup, Malckommer me semble en perte de vitesse. Il a son réacteur gauche qui foire.
— Mais… enfin je croyais…
— Vous croyez bien, cher nouveau marié. Il est probable qu’il s’agisse du vol en question. Que lui est-il arrivé ?
Mon hydrocuteur n’est pas encore sorti d’embarras. Comme on déteste parler d’une voix monocorde dans la maison d’un pendu, le gars d’une compagnie de transport préfère évoquer les cours de la Bourse plutôt que les ennuis de ses appareils.
— Je pensais que vous aviez lu la chose dans les journaux : le mois dernier, à l’atterrissage, le Boeing du 818 a télescopé un petit avion de tourisme dont le pilote avait commis une fausse manœuvre…
— Beaucoup de dégâts ?
— Sept morts, onze blessés, à cause du début d’incendie, et pourtant le pilote a été formidable et les pompiers de l’aéroport se sont trouvés sur les lieux en quatre minutes…
— Je pourrais avoir la liste des passagers qui se trouvaient à bord ?
Malckommer roule son pif entre le pouce et l’index comme s’il escomptait l’affûter davantage.
— Il faudrait que vous formuliez une demande à la direction ; je n’ai pas qualité pour…
La paperasse, comme toujours, comme partout… N’importe le continent ; la divine paperasse, flot gris et blanc, flot lent et perfide qui nous charrie vers l’infini du découragement. Paperasses pour naître et mourir, pour exister, pour aimer. Formulaires, formulaires. A remplir ! En plusieurs exemplaires. Toujours, toujours : plusieurs exemplaires, un pour l’Administration, un pour les archives, un pour jeter, un pour perdre, un en cas que tu te ferais voler celui qui est à perdre. Paperasses honteuses, bouffeuses d’arbres. Papier perdu, que pas seulement on s’en torche ni en enveloppe les œufs.
Je souris tendrement au gentil Malckommer, qui sera si parfaitement heureux avec sa Daisy toute neuve. Ils auront trois enfants et quatre amants, je prévois : M. Nostradamus, l’Antonio. Le destin des autres qui frappe à ma porte. Je les retapisse en coup férant ! Leur avenir ; c’est jamais l’autoroute du Soleil. Mais celle de la merdaille, grisaille, ringaille. Foireuse, rectiligne jusqu’aux abîmes. Déjà finie au départ. En éternel projet, avortement garanti. Qui n’a pas son joli cancer ? Demandez nos infarctus de saison ! Ah ! la belle vérole, méâmes z’et messieurs ! Votre fils est coiffeur pour dames ? Le mien aussi est pédé ; et alors ? Si ça ne rapporte rien, ça bouche toujours un trou, non ?
Donc, je souris à Malckommer. Franchement et massivement. Tant largement qu’il peut apercevoir mon tabouret en or, au fond et à droite, près de ma dent de sagesse.
— Voyons, H.J., lui fais-je, pourquoi me contraindre à une telle démarche puisque je peux trouver dans le journal relatant l’accident la liste des engagés et le numéro des dossards ?
— C’est possible, admet le rouquin au nez pointu et à la Daisy suractivée, mais je dois pour ma part me conformer au règlement.
— O.K., fils, vous auriez dû vous faire douanier avec une rigidité pareille, j’espère qu’elle s’étend jusqu’à votre slip pour le plus grand bonheur de Daisy.
Il devient blanc sans bouillir, kif tu le fourbirais avec Ariel.
Aussi sec, il cesse de s’intéresser à moi et se plonge dans des écrivailleries sans grande importance, tu veux parier ? pour le devenir de sa compagnie aviatique.
Je tournique sur un seul talon. Le hasard me place face à la sortie.
Je sors donc, ne contrariant jamais les décisions a priori inexplicables du sort.
— Hep ! taxi.
Un bahut énorme, jaune, avec damiers blancs et noirs sur le toit. Joli en plein. Le driver, un gros Noir tout en jean, bouffe du pop-corn.
Je m’accoude à sa portière ouverte.
— Quel est le plus grand journal du patelin, mon ami ?
Il rote discrètement à travers son pop qui, de ce fait, se taille de sa bouche.
— San Antonio Tribune, exhale mon interpellé.
— Vous pouvez m’y conduire ?
— Espèce d’enculé de sa mère, vous ne savez pas lire ? répond l’aimable chauffeur en me désignant une gigantesque enseigne au néon, juste en face de nous.
Moi, tête froide sous l’insulte. On vit une époque, si tu réagis quand on te traite d’enculé, t’as plus qu’à te barricader chez toi après avoir débranché le téléphone. Au lieu de lui tendre l’autre joue, je lui présente un billet d’un dollar ponctué d’un remerciement chaleureux.
S’amadouant, il me dit :
— Vous seriez pas tombé sur un mec intègre, il vous aurait baladé pour dix dollars avant de vous ramener ici.
Pour le récompenser de sa probité, je lui débloque un nouveau petit vert.
Car j’adore débloquer.
COUP DE CŒUR
Dieu qu’elle est belle !
Tu te souviens de la pauvre chère Grace Kelly avant qu’elle change de métier ?
Elle !
La même classe, le même visage lumineux, le même regard empli d’idéal mais qui te filait le tricotin sournois.
Elle s’est saboulée en noir, avec une grosse broche sur le bustier. Maquillage d’une somptueuse délicatesse. Son sac doré, sa ceinture dorée sont aussi impressionnants que sa bonne renommée.
Elle s’avance vers moi, comme mon Aquarama Spécial Riva fend la mer. Tu dirais la plus gracieuse des embarcations sur le flot d’azur (la moquette est bleue).
Je me précipite à sa rencontre, lui souhaite la bienvenance, m’égosille de sa beauté, de son élégance, toutes choses qu’apprécie une femme. Nos compagnes, comme on dit, ne sont plus guère gâtées question délicatesse. La galanterie, n’en parlons plus. Tu peux aller chercher un escabeau (le plus beau possible) pour retirer le mot du dictionnaire. Il est devenu superflu, sans signification. L’homme est entré en goujaterie, comme en religion, à cause sans doute de la femme qui aspire aux droits masculins et réclame l’égalité avec le julot en toutes choses, pauvre connasse linotte, si c’est pas malheureux avec un cul pareil, à faire bander tous les singes du zoo.
Elle s’installe, surprise par ma prévenance qui va jusqu’à lui pousser délicatement son fauteuil bridge sous les miches en le tenant par le dossier, siouplaît !
Et la manière que j’hèle le loufiat. Et que je propose à la belle superbe des boissons vaporeuses et artistiquement alcoolisées, en homme qui en possède toute la liste variée et qui est capable de te la réciter comme du Verlaine de la bonne année. Maggy opte pour un rose (dont la feuille sera pour plus tard, espérons-le ; tu peux toujours prier à cette intention en attendant, ça m’avancera).
Quant à moi, c’est le bloody-mary cher au Vieux, le pauvre cher homme résilié, renvoyé coucouche-panier d’un trait de plume.
Nous éclusons un godet, puis deux, et après le troisième nous passons à table où je compose un menu d’inspiration française avec les conneries mises à ma disposition. Une bouteille de bordeaux chauffée au bain-marie et qui coûte un saladier, complète l’illuse.
Nous mangeons tout en parlant. Maggy me raconte les dessous de sa curieuse profession ; cette emphase de la mort, ce culte de la sépulture surchoix, et je t’embaume, je te bichonne, pomponne, linceulise dans la soie. Et je te commande un caveau éclairé au néon, avec des anges qui se grattent le trou du luth, plein marbre, des fleurs tellement artificielles qu’on jurerait des vraies, des cercueils en first, cérémonie Barnum, orchestre, majorettes sans majoration, very très beaucoup bioutifoules ; un vrai bonheur de se laisser ensevelir dans de telles conditions ; pour un rien, on se suiciderait afin de connaître au plus vite les fastes de l’enterrement-zim-boum-boum.
Mes questions sont pertinentes. Je prends des notes, manière de faire vrai. Après quoi, j’en arrive à la haute direction : qui dirige une telle boîte ?
Maggy s’empreint de solennité pour me répondre que c’est mister P. J. France, un tout grand businessman de la région. Il gère d’autres affaires très éclectiques, P. J. Compagnie de transports routiers, distillerie de bourbon, fabrique de meubles, elle en passe et des moins bonnes. Moi, je fais mine de m’énerver comme une puce dans le slip d’Ursula Andress.
— Mais il faut absolument que j’interviewe ce monsieur !
Alors, Maggy fait la moue (et bientôt l’amour, j’espère de plus en plus fortement).
— Ça ne va guère être possible, vous savez.
— Pourquoi ? réponds-je avec mon sens du dialogue extrêmement proverbial.
— Mister France est plus difficile à approcher que Dieu le Père. Il vit retiré à Santa Prostata dans un ranch de luxe, gardé comme un prince arabe. Il a une piste d’atterrissage pour son jet privé et ne reçoit que les gens qu’il doit rencontrer pour ses affaires, des P.-D.G. de son envergure. Chez lui, tout se fait par télex. Il dispose d’une armada de collaboratrices car il n’est entouré que de filles. Ses gardes du corps sont aussi des femmes.
— Voilà qui s’appelle prendre la vie du bon côté.
Maggy a un léger sourire.
— Détrompez-vous : P. J. n’apprécie le beau sexe que dans le travail.
— Voulez-vous dire que ses mœurs sont celles d’Oscar Wilde ?
— Je ne connais pas le monsieur dont vous parlez, me répond Maggy (car aux U.S.A., même quand on est une jeune femme élégante, on reste peu ouvert à la culture européenne), mais je pense, poursuit-elle, que la personne en question n’avait de vraiment masculin que son prénom. Pour P. J. France, c’est un peu pareil.
— Me trouvez-vous apte à séduire un homosexuel, Maggy ?
Elle pouffe.
— Un homo et aussi une femme !
— Ne serait-il pas possible de laisser entendre à mister France que le journaliste qui désire le rencontrer ressemble davantage à Gary Cooper qu’à Mme Golda Meir ?
— Vous ne vous mouchez pas du coude, me répond-elle en américain, ce qui est beaucoup plus propre.
Je la veloute de mon regard enjôleur.
— Allons, Maggy, faites quelque chose pour moi et essayez de contacter ce curieux boss que je brûle d’approcher. Soyez un amour : allez téléphoner à France.
— Je le ferai demain.
— De grâce, appelez-le maintenant, les instants sont chargés d’électricité, quand on veut les reporter à plus tard, une déperdition s’opère. Je sens que dans la foulée, vous aurez gain de cause !
J’avance mes deux mains en conque vers sa jolie figure.
— Tenez, je vous charge d’ondes bénéfiques, ainsi lestée, rien ne peut vous résister.
Elle rit, mais continue d’hésiter.
— Je crains que P. J. ne m’envoie sur les roses, soupire la merveilleuse.
— Si c’est le cas, j’ôterai les épines une à une.
Alors bon, elle file au turlu. Y séjourne un bon moment et en revient plus radieuse que le printemps en fleurs dans la vallée de Chevreuse.
— Gagné ? lui lancé-je.
— Au-delà de toute espérance, Tony, vos passes magnétiques sont terriblement efficaces, car France vous invite à déjeuner demain.
— Oh ! Maggy, je vous aime ! exclamé-je. Connaissez-vous le coup de la chevrette corse ?
— Non ; de quoi s’agit-il ?
— Et celui du tambourinaire en folie ?
— Non plus.
— La position de Mme Angèle chez le duc d’Aumale ?
Elle sourit de plus en plus large.
— Pas davantage.
— La bécane du pasteur Morton ? La flûte du sous-préfet ? La calebasse mongole ? La tige convertible ? Le pied dans le gazon ? La langue fouineuse ? Rien de tout cela ?
— Mais non !
— Seigneur ! Que de temps à rattraper ; nous allons mettre les bouchées doubles, ma chérie.
Elle a un sourire flou, incertain, léger comme duvet en brise.
A cet instant, un grand zig avec une frite de catcheur bien recousue s’approche de notre table, découvrant trente-deux ratiches à la parade, et qui semblent inamovibles. Le gars porte un costar léger, bleu très pâle, une chemise bleu roi déboutonnée jusqu’au nombril, et qui laisse admirer une sorte de totem (un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout) d’or qui brimbale sur sa poitrine toisonnante.
— Hello ! il nous fait.
Maggy me dit :
— Oh ! Tony, permettez-moi de vous présenter Bob, mon mari ; je lui avais demandé de venir me chercher à la fin du repas.
Je coule un regard sur l’armoire dressée devant moi.
— Vous avez bien fait, approuvé-je. Asseyez-vous, Bob, et prenez une entrecôte avec du sucre en poudre comme dessert.
Ça recroqueville dans ma poitrine ; le phénomène se généralise, dévale jusqu’à mes testicules qu’il investit.
Les regrets de la viande et du cœur vous font souvent cet effet-là.
COUP DUR
Ma Cadillac Seville paille et crème (sorbet pamplemousse-vanille), de louage, fait crisser les graviers.
Un chemin bordé de palétuviers roses m’a conduit jusqu’en ce lieu privilégié où le luxe se montre hardi et le modernisme insolent.
Je me dis que si mister P. J. France avait bâti ce petit palais dans la région parisienne, et qu’il lui arrive de débaucher son personnel, ça donnerait un fameux feu de joie ! On vit des temps où il est plus difficile de conserver que d’acquérir. Vivement le grand nivellement, qu’on se retrouve enfin dans une caverne, à souffler sur un brandon pour avoir du feu. Allumer un Davidoff no 1 à la flamme d’un Dunhill d’or, ça commence à bien faire, non ? Pas dommage qu’on ait enfin compris que la grande, la toute suprême aspiration de l’homme, c’est d’être ratissé, cul nu dans des orties. Finito, la Bourse, les demeures m’as-tu-vuses, les Ferrari, les yachts, la haute couture, le foie gras, la tête dans les trois étoiles. Ne doit plus rester que le sol, la mer, le ciel. Bouffer de l’écorce, devenir arboricoles (et non aborigènes comme tant s’imaginent), le pied…
Tiens, à propos de pied…
Mais non : je t’expliquerai plus loin.
Comme je stoppe devant une grille d’inspiration ibérique, en fer forgé magnifiquement ouvragé, quelqu’un jaillit. Pas dégueulasse. Une fille d’au moins un mètre quatre-vingts, vêtue d’une combinaison de cuir noir sur laquelle sont cousues deux mains en cuir blanc. La main droite est plaquée sur le sein droit de la guerrière, tandis que la gauche est appliquée sur son pubis, le médius n’est qu’amorcé et cesse au départ du pli merveilleux que tu sais, laissant accroire, par la magie du trompe-l’œil, qu’il s’est fourvoyé en un point chaud dont je ne vivrai jamais suffisamment pour en célébrer pleinement les mérites, ainsi que l’écrivait une grande romancière qui raffolait du gigot à l’ail.
La fille est coiffée très court. Elle est blonde, avec un visage géométrique et des yeux d’acier. Elle porte un pistolet à sa ceinture, et je gage qu’il s’agit d’un lance-gaz. Elle a au cou un walkie qui grésille en permanence comme le beurre de tes œufs au plat matinaux.
— Hello ! lancé-je, à demi défenestré. Je suis le journaliste français que mister France attend pour le lunch (car ici, c’est la loi du lunch qui est en vigueur).
Sans marquer le moindre intérêt pour ma personne, la fille jacte dans son zinzin. Les directives qu’elle reçoit sont en ma faveur car il lui suffit d’appuyer sur un contacteur fixé à sa ceinture pour que la grille s’enfonce dans le sol.
— Remontez l’allée jusqu’au parking, vous garerez votre voiture et quelqu’un viendra vous chercher, m’enjoint-elle.
Un vrai robot, cette nière.
J’ai beau essayer de l’amadouer en lui votant mon sourire humide 16 bis, amélioré l’an dernier, ponctué de mon œillade langoureuse C 19, elle reste d’acier. Déjà la grille remonte derrière moi. Alors je suis mon petit bonhomme d’allée carrossable.
La propriété est immense. Avec des vallonnements, des dunes gazonneuses, des boqueteaux de pins parasols, des plans d’eau, des statues grecques, des mobiles de Calder, une reproduction de la tour Eiffel grandeur nature, le Parthénon, des roseraies et bien d’autres merveilles.
Le chemin s’élève mine de rien dans cet univers forcené. Quand tu parviens au faîte, tu découvres une stupéfiante demeure hispano gréco-romano-coloniale. Tous les matériaux y sont rassemblés : le verre, l’acier, le bois, le marbre, l’ardoise. C’est le camp du Drap d’Or rêvé par un gus qui fait une indigestion d’escargots à la parisienne ou de crème Chantilly. Il y a là des terrasses, des patios, des péristyles, des perrons, des pergolas, des dômes, des clochetons, des baies, des fenêtres à meneaux, des beffrois, des poternes, des balcons, des corrals, des coraux, des barbecues, des tennis, des piscines, des pistes de ski artificielles, des serres, des cerfs, des desserts.
Sur l’immensité flotte une musique d’ambiance, très suave, un peu funèbre, qui serait mieux appropriée à la funeral house. Un mât haut de vingt-cinq mètres deux pouces supporte un gigantesque drapeau jaune frappé des trois lettres P. J. F.
Le parking où j’aboutis a la forme d’une formidable coquille de verre fumé. Il y a là de la place pour une centaine de voitures. Une douzaine de Rolls, autant de Cadillac, six Ferrari, huit Porsche, cinq Land Rover et une 2 chevaux Citroën y sont déjà rangées, toutes marquées aux initiales du milliardaire.
Une nouvelle gonzesse qui est la réplique rigoureuse de celle de la grille ; à croire que celle-ci a pris un raccourci pour m’accueillir. Elle me montre un box. J’y enfourre ma tire.
Lorsque je sors, elle a une inclinaison de tête.
— Si vous voulez me suivre.
Je l’emboîte. Nos pas nous conduisent à un arc de contrôle tout pareil à ceux qui figurent dans les salles d’embarquement des aéroports.
— Franchissez le radar, s’il vous plaît, enjoint ma guidesse.
J’obtempère. L’appareil module un tuuuuuuuut désagréable.
— Vous avez quelque chose de métallique sur vous, dit-elle.
Je lui tends un petit stylo-bille réclame ennobli d’une agrafe.
— On parie que c’est ce petit machin ?
Sans piper (hélas !) elle prend l’objet. Je repasse le tunnel. L’appareil me donne quitus. L’exquise mégère me rend mon stylo et nous débouchons dans un jardin de rêve dont les pelouses se composent uniquement de trèfles à quatre feuilles et les massifs d’orchidées doubles. De l’eau teintée de bleu glougloute dans une vasque d’albâtre flanquée d’une statue admirable que ça représente un berger grec en train de sodomiser un angelot.
On attaque alors un labyrinthe authentique, composé de haies épineuses de deux mètres. Le camarade Dédale n’aurait jamais fait mieux, et son fiston pouvait toujours se coller des plumes au fion pour l’en arracher ! Mon guide s’y déplace sans hésiter.
Après un ahurissant cheminement qui me donne l’impression de danser le tango : trois pas en avant, deux en arrière, nous débouchons sur une vaste terrasse de quinze cents mètres carrés, au centre de laquelle est dressée une tente à rayures jaunes et blanches, de soie brochée, voire reliée.
Une tente ? Non : un vélum. Les tantes sont dessous. Deux.
Mais que je te les raconte, non pas par le menu, car elles sont énormes, mais dans les grandes lignes, comme disait un marchand d’articles de pêche.
Figure-toi deux gusmen de cent vingt kilogrammes heure chacun. L’un avoisine les cinquante berges, l’autre n’a pas franchi la trentaine. Ils sont en maillots de bain extrêmement brefs qui ne cachent que le principal, c’est-à-dire la panoplie grand veneur. Soit, peu de chose au demeurant. Roses et velus, portant l’un comme l’autre une barbe abondante, taillée en rond, les deux individus mentionnés dans le paragraphe en cours impressionnent par leur bestialité gaillarde.
Le plus âgé a de grands yeux bleus, candides, d’épais sourcils blonds, des seins de bouchère, un ventre de poussah, des lèvres boudinées, une fossette boudeuse, les cheveux pleins de bouclettes, et des bijoux partout : au cou, aux oreilles, aux doigts, poignets, chevilles, que probable, si tu voudrais bien te donner la peine de parier, il doit avoir une orerie quelconque aux burnes.
Son compagnon, aussi gras, aussi rose, aussi barbu, mais barbé de brun, pourrait après tout être son fils s’ils ne faisaient à ce point pédoques tous les deux, dans leur graisse, leurs poils, leurs ors.
Ils bouffent avec application et jubilation interne.
Du foie gras arrosé de Château d’Yquem 1967, merde, faut pouvoir s’offrir tout ça. Nous autres, en pleine reconversion sociale, du foie gras et de l’Yquem, à moins qu’ils soient remboursés par la Sécu (f.d.) c’est pas demain la veille.
Ils clappent de la manière ci-dessous :
Chopent un toast croustillant fait à la seconde par une amazone blonde, déposent dessus une tranche de foie gras venu par jet spécial de chez Girardet (Helvétie), puis une tranche de truffe, et l’une comme l’autre sont aussi épaisses que le toast. Ils mordent dans ce bonheur à pleines chailles. Qu’à peine la bouchée engloutie, ils éclusent un godet de Sauternes glacé ; rouvrent la main et recommencent. Bravo pour la prestation.
Ma guide se plante à quelques mètres de la table en argent massif sur laquelle ce couple surprenant fait la dînette. Immobile, garde-à-vous, fixe ! elle attend le bon vouloir.
Le quinqua engloutit une bonne demi-douzaine de toasts avant de se préoccuper de l’arrivante. De guère lasse, je m’assieds en tailleur sur le sol marmoréen.
Quand la grosse gonfle a fini son foie gras, elle rote avec brio et demande, sans seulement tourner la tête vers nous :
— Quoi, Barbara ?
— Le journaliste français, mister France.
— Oh ! yeah !
Le mec daigne alors me visionner. Il a la bouille de Carlos, en blond, en pas très sympa.
Me voyant assis par terre, il sursaute.
— Il est malade, ce type ?
D’une détente j’exécute un rétablissement qui me remet à la verticale.
— J’ignorais si l’attente serait encore longue, mister France, et je tenais à conserver tout mon potentiel énergétique pour le moment où vous vous intéresseriez à moi.
Le barbu éclate de rire. Sa main courtaude, ruisselante de gemmes, se pose sur la cuisse d’haltérophile poids lourd de son petit ami.
— Il est marrant, ce Frenchman, dit-il.
Son giton reste crispé. Souvent, les petits amis des souverains se croient obligés de faire la gueule pour se composer une autorité qu’ils n’ont pas. J’ai déjà remarqué : les courtisans des vedettes, les minets des pédales fameuses ou des grossiums, tous arborent une mine compassée (qu’ont passé dessus) afin de marquer de l’hostilité. Instinct de préservation. Ils ont peur de ce qui rapplique de l’extérieur, voire également de ce qui, à l’intérieur de la place, risque de mettre la leur en cause. Faut calmer le jeu, désamorcer l’enthousiasme, neutraliser la sympathie. Ils vigilent sur leur territoire, prêts à le défendre bec et ongles. J’en ai connu, des noms à pas citer sur livre, because procès. Les ai regardés avec rassurance, pas qu’ils redoutent de moi qui ne veux rien, ne serai jamais suceur — cireur à la cour, moi qui paie pour qu’on ne me paie pas. Les devants ! Seulâbre ! Liberté ! Tu piges ? Merci.
France a lâché le cuissot de son pote et, de ses deux mains d’empereur romain, masse doucement son propre ventre.
— On finit le petit déjeuner et on passe à table, me dit-il. Vous buvez quoi ? J’ai un bourbon qui pourrait rivaliser avec vos meilleurs armagnacs.
— En ce cas, il ne faut pas le boire, mister France, mais le garder pour le musée de la pharmacie.
Ma réplique accroît sa jubilation.
— Il est inouï, non ? insiste-t-il en posant cette fois sa main sur le maillot de son chérubin où il ne se passe rien qui mérite d’être signalé à l’attention des populations.
Le barbu brun prend un air de constipé chronique et renfrogne de plus rechef.
— En ce cas, dit France, que voulez-vous boire ?
Je désigne la bouteille ambrée qui a les fesses dans la glace.
— Un demi-verre de ce nectar me ferait éjaculer de plaisir, mister France.
— Facile !
Il claque des doigts à l’intention de son esclave en cuir noir (et mains blanches lascives) pour lui intimer d’apporter une nouvelle bouteille et un verre.
— J’admire votre art de vivre, déclaré-je sans jambage. Fichtre ! foie gras et Château d’Yquem au petit déjeuner, dans un cadre pareil et avec un joli garçon comme mademoiselle, fais-je en désignant l’éphèbe barbu.
France part d’un nouveau rire. Son minet (angora) gronde comme un doberman quand tu t’approches trop près de sa gamelle.
— Puisque vous êtes français, déclare soudain le grand boss des pompes funèbres et d’une chiée d’autres entreprises, vous allez pouvoir me rendre un service.
— Avec plaisir, mister France.
— Avant le repas, j’aimerais que vous me décoriez de la Légion d’honneur.
Sa requête me déconcerte, mais passagèrement, car j’en ai entendu d’autres au cours de ma prestigieuse existence.
— Ce serait volontiers, hélas ! je n’en ai pas sous la main.
— Ne vous tracassez pas : un ami m’en a offert une de toute beauté, en or enrichi de brillants, qui appartint à je ne sais plus lequel de vos hommes illustres, Louis XIV peut-être… Cet ami se trouvant être américain n’a pu me décorer. Vous tombez à point nommé.
— Eh bien, ma foi, résigné-je, si vous estimez que je puis faire l’affaire…
— Evidemment.
Il jette à la vestale :
— Eva, ma Légion d’honneur, dans ma chambre…
La fille va pour s’éloigner, mais moi :
— Un moment, please !
Et à France :
— Il conviendrait que vous passiez un veston, mister France, car je n’oserais accrocher cette décoration à votre slip de bain, de peur de vous blesser à un endroit délicat.
— Juste ! admet le monarque. Amenez une veste de smoking pendant que vous y êtes, Eva. Dans les blancs, ça crachera davantage. Quoiqu’un rose serait mieux en harmonie. Faites venir mes musiciens et mes chargés de presse.
Il est tout gamin, P. J., trémousseur, content. Il caresse à tout bout de champ le sexe de son jeune camarade, éclate en rires brefs mais stridents.
Alors bon, que je gaze un peu.
On livre la bouteille d’Yquem 67, sublime, à goût de fleurs de tilleul et de miel sauvage, un vin que tu manges plus que tu ne le bois, car tu le mâches. Et quand tu l’as avalé, c’est pas terminé : la fête continue en profondeur, et l’âme te chante.
Et puis un orchestre se pointe : trente-deux musiciens en uniformes jaunes portant le monogramme du P.-D.G. au revers.
Et l’Eva ramène deux vestes de smok : l’une rose suave, l’autre blanc virginal.
Et encore voilà six photographes, un cameraman, un preneur de son, un chef opérateur.
P. J. France se lève en soupirant. Une fois qu’il est à la verticale, tu t’aperçois qu’il est tout petit et beaucoup plus gros qu’assis. Son bide a quelque chose de phénoménal. La fortune que représente une brioche pareille, c’est pas chiffrable ! Ces tonnes de caviar, foie gras, truffes, homard, mon neveu ! Ça impressionne. Y aurait de quoi alimenter le Biafra, l’Inde, les favellas de Rio ! Mais c’eût été moins spectaculaire, moins complet comme réussite.
— On y va ? demande France.
— Je suis à votre disposition.
Il hésite entre les deux vestes, place sa Légion d’honneur (une pièce rare qui a dû coûter un saladier chez un antiquaire spécialisé dans le bijou) alternativement sur l’un puis l’autre vêtement, finit par opter pour la veste blanche qu’il enfile aussi prestement que son jules.
— Où dois-je me placer ? demande-t-il.
Je désigne la pièce d’eau.
— Cette toile de fond me paraît idéale, mister France.
— O.K., allons-y ; vous savez que je suis ému, french boy ?
— Je le conçois, mister France.
Il va se mettre au garde-à-lui. Et tu ne peux pas te figurer le combien c’est dingue, un instant pareil. Cet obèse barbu, loqué d’une veste de smok et d’un slip de bain, nu-pieds devant un triton de marbre qui crache de l’eau bleue, tandis que trente-deux musicos sont disposés à l’arrière-plan et que des flashes crépitent, qu’une caméra mouline.
France jette un ordre. La musique attaque l’hymne américain. Des pigeons blancs s’envolent à tire-d’ailes. Miss Eva, figée dans son vêtement de cuir, ressemble à une Martienne de bande dessinée. Le giton est seul à table, vautré, réprobateur.
France lui aboie un :
— Stand-up ! pour garde-chioume du bagne, époque Stevenson.
En rechignant, le gros barbu flasque soulève son fond de commerce, lequel coïncide avec son fond de culotte.
Le ciel est toujours bleu au-dessus de la résidence P. J. France, des hélicoptères bien équipés y veillent.
On a arrangé les échos de manière à ce que la sonorité soit tip top. La nature, faut pas croire, mais ça se remodèle, mon pote. Si t’as la fraîche, des gusmen astucieux font le reste. A Denain on te crée des couchers de soleil sur le Pacifique, des plages d’or, des atolls ondulés, des jardins exotiques, on peut t’y amener la Méditerranée si tu veux. Il suffit de pouvoir douiller les magiciens, ils sont mâtins, les bougres, comme dit le bon Pauwels.
Quand l’hymne ricain est fini, je comprends que c’est à mégnace-gommeux de jouer.
J’empare la médaille.
M’approche du magnat maniaque.
S’agit de trémoler un peu, pour créer l’ambiance. Que juste, il me vient un pouème que je te bénéficie dans la foulée :
Déroulède ?
Des roux l’aident
A dérouler
Des roues laides.
Aragon n’a jamais fait mieux, je m’excuse. Çui-là, faut que je l’adresse à quelqu’un en hommage. Tiens, à M. maître Rheims, pour le remercier de m’avoir offert un Grand Prix de l’Académie française du dix-huitième siècle en parfait état, juste une trace de monture et quelques taches de moisissure.
Ma petite médaille aux doigts, je m’avance jusqu’à l’hurluberlu pour déclamer, d’une voix de store (Béru dixit) :
— P. J. France, en vertu des pouvoirs qui ne me sont pas conférés, en mon nom et sans celui du président de la République Française, je vous fais Grand Officier de la Légion d’horreur.
Mffui mfuifff, deux bises dans la barbouze. L’orchestre, pas bêcheur, attaque la Marseillaise. Minute de toute beauté. Tiens, prends-la, elle est à toi.
Mister France a les larmes aux yeux. Si beau, avec sa barbe, sa veste à revers de soie, sa Légion d’honneur, son slip de bain, ses beaux pattounets pédicurés.
On doit être frais, tous, immobiles sous le ciel texan dans lequel monte la chanson de Rouget de Lisle.
Croquignolets.
La cérémonie prend fin, musicos et photographes s’esbignent.
P. J. tombe la veste décorée et va piquer une tronche dans la piscaille en compagnie de son camarade de franche connexion. Oh ! les jolis dauphins ! Comme ils s’ébattent bien, se frôlant, plongeant, jaillissant, geysérant à qui mieux mieux ; barbes irisées, ventres comme des bouées d’amarrage, rires déployés.
Deux larbines venues silencieusement les attendent, pareilles à des chauves-souris, en tenant de grandes serviettes de bain noires déployées. Avec leurs combinaisons noires idem, il ne leur reste plus que de se suspendre la tête en bas pour parfaire l’illuse.
Les deux gros messieurs se laissent sécher, bichonner. Puis changent de slip avant de passer à table.
Celle-ci a été amenée au bord de l’eau vert émeraude. Toute dressée. Et faut voir comme !
— Vous ne prenez pas un petit bain avant le lunch ? s’inquiète mon hôte.
— Non, merci, j’ai déjà batifolé dans la piscine de mon hôtel avant de venir, mister France.
— Deux bains valent mieux qu’un, assure Barbamorpions.
Et comme il déclare, son gros vilain julot de merde se rue sur ma pomme et d’un coup d’épaule forcené me propulse à la baille.
Je me retrouve dans la tisane comme un glandu, avec mon costar d’alpaga et mes mignons croquenots de chez Jourdan, le bottier qui me botte. Un brin furax, espère. L’envie me démange d’assaisonner la grosse gonfle à barbe, de lui savater la frime d’importance avec, en conclusion, un shoot terrifiant dans ses petites sœurs des pauvres.
Grabotteux, spongieux, ruisseleux, je m’arrache aux tentacules de la piscine. L’escadrin de bronze doré est dur à gravir, ainsi trempé.
Bien entendu, ces deux sagouins sont pliés en deux. Je découvre enfin le rire du giton qui ressemble à un piège à loup dans un tas de broussailles.
Alors moi, tu sais quoi ?
On ne se refait pas, que veux-tu… J’ai beau être invité… Avoir une mission au four…
Je chope la table chargée de verreries, porcelaine de Sèvres-Babylone, cristaux, argenterie, caviar, vodka, toasts. Et vlaouff ! D’une détente, la file au jus.
Ça tourne à la branquignolade, ma visite. Au Laurel et Hardy belle époque.
Le gars France cesse de rigoler, son julot aussi. Ils regardent flotter les assiettes creuses, un instant avant de couler, et la nappe se gonfler, et le caviar se délayer (une boîte de cinq kilogrammes !).
— Au revoir, m’sieurs-dames !
J’adresse au couple un salut détrempé de la main. Et puis fais demi-tour.
Leurs regards me charançonnent le dos.
Malgré la chaleur, je claque des dents, because ma détrempe. Un gonzier fringué, lorsqu’il sort de l’eau, il trembille, normal.
Je quitte l’immense terrasse en me disant que ces deux zozos, merci beaucoup, ça finit par faire trop pour un seul homme.
Et je m’engage dans une allée bordée de plantes vives, très hautes. Elle oblique à droite. Je prends à droite. Ensuite, elle débouche sur une autre allée père-pend-dix-culs-l’air.
J’hésite, chope à gauche, mon agitation, ma rage m’empêchent de me concentrer.
Ce n’est qu’un bout d’un petit moment que je réalise la vérité : je suis paumé dans le labyrinthe.
Ça se sardaigne, non[4] ?
COUP d’AILE
Un labyrinthe, à notre époque, je vous demande un pneu ! Grotesque. Le Petit Poucet (il a beaucoup grandi) sans cailloux à semer avec un « x » au pluriel.
Je sais qu’il est inutile de paniquer, car tu ne fais que rendre la situation plus inextricable. Or, j’ai besoin d’extriquer dans les meilleurs délais. Déjà, je regrette mon coup d’humeur. Me fallait entrer dans la farce bien totalement et subir sans jouer les D’Artagnan. J’aurais fait cette visite juste pour décorer un fou et gâter un costar coupé impec.
Et puis me voilà perdu dans des méandres sans fin, prisonnier de haies d’épineux, teigneuses et infranchissables.
Je m’arrête donc pour me repérer au ciel ; mais le ciel est d’un bleu incommensurable et joue à te donner des notions d’infini. Seul le soleil me permet de situer approximativement les quatre points cardinaux (lesquels ne sont pas toujours pourpres comme le laisserait entendre leur qualificatif).
J’écoute, guettant un bruit de pas. Mais le sol est revêtu de faux gazon, comme on en pose autour de certaines piscines intérieures.
« Baste, me dis-je en aparté, malgré leur dinguerie, ces gens finiront bien par s’inquiéter de mon sort. Quand ils s’apercevront que ma bagnole est toujours là, ils enverront une caravane de secours. »
Malgré ce point de vue optimiste, une heure s’écoule sans modifier ma solitude ni la vanité de mes errances. Alors, merde ! je me mets à héler, bien que cette solution me paraisse peu digne de mon personnage. Il n’y a que les enfants perdus et les soldats qui meurent, pour crier « Maman ! » Voilà pourtant ton Antonio qui égosille des « Hello ! Ohé ! On peut m’envoyer un guide ? » qui n’ajoutent rien à son standinge.
Mais j’ai beau m’effilocher les cordes vocales, personne ne se pointe.
Je m’assois en tailleur au milieu de l’allée faussement engazonnée. Il s’agit de conserver la tête froide, Tonio chéri. Facile à dire, le mahomet à la verticale me cicogne le bulbe méchamment. Mes fringues sont déjà presque sèches. Manière de faire quelque chose, je sors le contenu de mes vagues : papiers détrempés dans le porte-cartes de croco à coins d’or, dollars mous comme des dinars, stylobille à agrafe de ferraille, je te le répète, lunettes de soleil, mon sésame (dérisoire dans cette prison sans portes), pochette d’allumettes que l’eau a rendues pâteuses, petite loupe pliante qui m’est souvent utile pour examiner des indices…
La loupe ! Ah ! la good idea ! Bravo, Santantonio !
Je me redresse et musarde le long de la haie, à la recherche d’une plante desséchée. Tiens, voici une branche de conifère morte, dont le brun foncé m’enchante.
T’as tout pigé : branche morte, loupe, soleil ardent ? Mes compliments. Faut dire que tu as ton certif ; on a beau critiquer, mais l’instruction stimule les fonctions cérébrales.
Or, donc, me voici avec ma loupe brandie au-dessus de la branchette, en priant le soleil pour qu’elle devienne brandon (depuis la virgule, je me suis payé un superbe alexandrin que je dédie à Jean Dutourd, de l’Académie française, en lui rappelant respectueusement qu’il m’a promis de voter pour Georges Marchais lors de la prochaine élection à son club).
Je m’efforce de conserver mon bras immobile, scrutant l’extrémité du rameau sec. Au bout d’assez peu, dois-je conviendre, une légère fumée auréole la branchette. Et puis une imperceptible incandescence se produit. Ce que constatant (ou tonton) je me mets à souffler dessus gentiment, pour oxygéner ce foyer lilliputien. Et, tu m’as devancé : la flamme naît. L’Antoine a gagné la guerre du feu ! Je souffle, souffle, inépuisablement, comme un vieillard transi sur un grog trop chaud (je t’écrirai le prochain Sana en alexandrins, c’est promis ; « depuis le temps que ça couve », comme disait de Murville à l’époque où il était Premier sinistre).
Un délicieux crépitement. La flamme toute petite prend de l’assurance, gagne le tronc de la plante, le lèche longuement. Mais ledit est vert et ça hésite. Souffle, souffle, Antonio ! La chaleur fit fondre les ailes d’Icare, dans ton cas, elle va t’en donner. Effectivement, ça se met à cramer en souplesse. Puis à crépiter. Et bientôt c’est le tout beau foyer, blanc et massif, ardent, qui, impétueux, s’élance le long de la haie, l’investit, la rend vive et transparente, la bouffe, la suit, la suie, tout bien ! Jamais feu d’artifice ne me parut plus somptueux. Ah ! que c’est beau, la pyrotechnie !
Je calte le plus loin possible du brasier. Ce qui constitue la perfidie d’un labyrinthe, c’est qu’on ne peut s’y orienter. A partir du moment où tu as un point de repère, les choses s’arrangent. Le feu croit, enfle, grimpe. Des flammèches s’en détachent, qui voltigent dans l’air à la ronde, comme l’amour, le boutant de-ci, de-là.
Pour lors, ça commence à s’agiter ferme dans le secteur. On crie, on intervient. Des gusses déboulent, armés d’extincteurs. Ne me reste qu’à foncer à contre-courant. Je parviens enfin au parking.
Ma chignole est laguche. Ouf ! Manœuvre rapide, et ploum ! dans la grande allée.
Mais, parvenu devant le portail, celui-ci est fermé. Je donne du klaxon pour alerter la préposée. En vain.
N’obtenant pas de réponse, je descends et m’approche de la grille, histoire de repérer la commande permettant de l’ouvrir. Mais j’ai beau fouinasser, je ne trouve rien. Retour à ma guinde. Klaxonnage furieux : tagada — gada — tsoin — tsoin. Nobody ! Ce qui se passe alors est ahurissant. Apprête-toi à ahurir, mon loulou. A ahurir bien fort, de partout, tête aux pieds, sous les bras, les roustons, la plante des pinceaux.
Brusquement, ma Cadillac est happée par une formidable mâchoire sortie du sol. Je te détaille, pas que tu clamses idiot en plein, ta dose originelle te suffit. Tu connais ces pinces à sucre munies de quatre griffes que tu actionnes en appuyant sur un bitougnot à ressort ? Là, magine-toi que la pince est à la renverse. Ma Seville, c’est le sugar, la pince s’ouvre et se plaque contre mon véhicule, immobilisant les portières.
Comme je n’ai pas coupé le moteur, je mets le levier en marche arrière et j’appuie sur la pleurotte. Mon siège[5] !
C’est tout juste si la chignole se met à vibrer. Les roues patinent. La séance magique ne fait que débuter, pars pas, tu raterais le plus beau.
Voilà-t-il pas que ma voiture s’enfonce dans le sol, puis dans le sous-sol. Assez rapidement. J’opère une plongée dans l’inconnu dont parlait Baudelaire. Tout s’obscurcit. Une forte secousse, un grincement, ma tire se met à avancer, tractée par un rail à crémaillère.
Le cheminement dans un étroit tunnel est interminable. Faut dire que ça va mollo. Tu me jouerais la Marche funèbre de Chopin, j’aurais l’impression de filer le train à un corbillard.
« Bon, me dis-je, on verra bien. »
Me sens disponible par tous mes sens, pores de peau.
L’aventure, que peux-tu souhaiter de mieux ? Et appréhender quoi ? Qu’elle finisse mal ? De toute manière, tu finiras mal, non ? Alors ?
Je me laisse crémailler en prenant une posture relaxe, assis en travers de la banquette, les pieds sur le tableau de bord.
Le voyage s’achève dans une sorte d’abri antiatomique voûté, assez dans l’esprit d’une station de métro modèle réduit. C’est carrelé, éclairé par des rampes de néon, et il y a des trottoirs de part et d’autre. Je note qu’au-delà de l’abri, le tunnel reprend et se perd dans les ténèbres.
« Fort bien, et maintenant ? » me demandé-je.
Maintenant, c’est kif précédemment : personne n’intervient. Je reste prisonnier de ma chignole dont les lourdes sont toujours bloquées par les implacables mâchoires. Pour quitter l’auto, je devrais briser le pare-brise ; seulement je ne dispose d’aucun instrument contondant, hormis mes poings et mes tatanes. Pas suffisant pour avoir raison d’une glace sécurit de Cadillac.
Je m’exhorte à la patience. On ne m’a pas amené laguche pour du beurre ; quelqu’un finira bien par se montrer.
Lové sur la copieuse banquette, je prends le parti de roupiller.
COUP DUR
Qu’à cela ne tienne. Casse la tienne, Etienne.
De guerre lasse…
Une bouillie de mots laborieusement assemblés m’attend à mon réveil. Piètre déjeuner. Et les deux apôtres, là-haut, qui se gavent de choses surchoix. Je les plains. Une galette de sarrasin (aurait dit Albertine) ferait mon affaire. Un jour, je me convertirai à la frugalité. Ivresse de la nourriture réduite à l’essentiel. Là, oui, la véritable gastronomie. Riz à l’eau, laitages, pain. Et du sel ! Une pomme de terre pour dessert. Volupté des papilles en pleine disposance. Guérir sa faim par les mets les plus naturels : céréales, tubercules. Et Sel !
Je m’arrache aux sales filaments de la dorme. Me sens tout mal foutu d’avoir porté des fringues mouillées qui ont séché sur mes endosses. J’étouffe un peu dans cette bagnole. Impossible de m’échapper par les vitres baissées car les mâchoires géantes qui bloquent les portes sont aussi larges qu’elles.
J’ôte l’une de mes godasses pour tenter de pulvériser le pare-brise, ensuite la lunette arrière, mais seule la charge d’un marcassin en viendrait à bout, or, je ne dispose que d’un mocassin.
Le lieu est à hurler, tant tellement il me déprime avec son carrelage pour pissotière publique, ses froids néons, son tunnel à chaque extrémité piquant vers deux mystères. Je n’aperçois aucune porte dans les parois de cette curieuse station.
Ma montre m’indique dix-sept heures quinze. Pourquoi me laisse-t-on mijoter dans cet univers blafard et silencieux ? Dans l’intention de me réduire en mettant mes nerfs à l’épreuve de la solitude complète ? Ou bien attend-on que je crève, à l’écart ? Meurtre parfait, somme toute. On me laisse périr de dénutrition, et puis on drive ma charrette dans un coin désert où l’on me retrouvera, mort derrière mon volant. Et l’on pensera à un suicide peu banal. Une mort de fakir ou de gréviste de faim.
Un bâillement me déverrouille le clappoir. J’essaie de brancher la radio, mais je n’obtiens qu’un menu crachotement.
« Eh bien ! m’interpellé, mon cher Santantonio, il est grand temps de te prouver quelque chose ; à toi de savoir quoi et comment ! » Belle phrase dont la tournure quelque peu nonchalante plaira, j’espère, à la mignonne lectrice blonde qui a changé de slip pas plus tard que ce matin.
Dans la vie, je vais te dire, c’est très simple : « Si tu ne vas pas à Lagardère, c’est Lagardère qui va-t’à toi. »
Je considère l’habitacle de la Cad comme le ferait un douanier auquel on aurait chuchoté qu’il recèle dix kilos de neige. L’homme est un roseau pensant. Donc je suis.
J’escalade ma banquette avant, retire le siège arrière et entreprends d’arracher le dossier. Oh ! bien sûr, il résiste, mais dis, je n’ai pas été élevé au lait Guigoz, je n’ai pas bu des bonbonnes d’huile de foie de morue, bouffé un tonnage de denrées comparable à celui qu’a englouti le pauvre Jean Rameau, pour me retrouver avec des biceps pareils à du chewing-gum craché. De bas en haut de son individu, c’est du dur, l’Antoine.
Vrran ! ahhhhrrrrchlccc, ça y est, le dossier cède. Il m’est donc possible de communiquer avec le coffre. Je me coule jusqu’à la serrure mais le verrouillage, pardon ! pire que celui d’un porte-monnaie de maquignon. Heureusement qu’à l’intérieur de la roue de secours, se trouve la boîte à outils. Dès lors, pour quitter ma prison, je n’ai que l’embarras gastrique du choix des armes : soit je craque la serrure, soit je pète le pare-brise avec le treuil utilisable dans les changements de roue. La mère rit de mon treuil. Un gros tournevis va faire l’affaire. A quoi bon mutiler exagérément cette belle tomobile ?
Cric-crac, une pesée de bas en haut et je viens à bout du bitougnot. La porte du coffre s’ouvre toute seule. San-Antonio est libéré. Tous les compliments de la petite lectrice, Tonio. Elle mouille d’enthousiasme.
Pour commencer, un peu de footinge sur le trottoir du quai. Ensuite, sauf votre respect, je fais pleurer le gosse. Bon, et maintenant, que décidé-je ?
Ayant palpé la totalité des parois, je suis convaincu qu’il n’existe pas d’autres issues que le tunnel. Il s’agit d’un conduit de trois mètres de diamètre, équipé de cette foutue crémaillère. Un peu galerie de mine. Des wagonnets devaient y circuler jadis ou naguère.
Rebroussé-je chemin, ou poursuis-je au-delà de la station ? Tu devines ma décision ? Sana, toujours en avant ! Rebrousser chemin implique une soumission au sort ; c’est s’avouer vaincu.
J’allume les phares de la Cadillac pour qu’ils éclairent ma marche au départ et descends dans la tranchée.
J’avance lentement, avec pour seule arme le fort tournevis, passé dans ma ceinture telle une dague.
Trente mètres après la station, le tunnel oblique à droite et la lumière déjà estompée cesse. Me voici dans le schwartz le plus total. Je ne perçois que le bruit de mes pas sur le sol cimenté, celui également de ma respiration. Afin de combattre le malaise qui m’empare, à déambuler ainsi dans les abysses, je compte mes pas à haute voix ; les convertissant en mètres linéaire.
A deux cent cinquante je marque une pause pour souffler.
Dis, il est encore long, ce boulevard des ténèbres ? Tu parles d’une soupe de nuit !
Je repars pour deux cent cinquante nouveaux mètres. Et toujours l’obscurité. Je bute à tout instant contre le rail ou le trottoir de ciment. Ce tunnel sent le sépulcre. Je me demande bien où il conduit. Et pas seulement cela, Ernest. Me demande également à quoi rimait cette halte à la station de métro Sanporte. Pourquoi stopper mon véhicule dans la lumière des néons et m’y laisser mijoter ? Aurait-on fini par me tirer de là ?
Nouvel arrêt. Je regrette de ne pas être nyctalope pour de bon ; je crois posséder ce don, parfois, parce que ma vue, très au-dessus de la moyenne, me permet de me repérer dans les fortes pénombres, mais quand l’obscurité est totale, je suis aligné sur le même pot de goudron que les copains.
Marche, marche, Antonio ! Tu vas vers la lumière, il convient de t’en persuader.
Mille mètres…
Si jeûne m’abuse, cela équivaut bien à un kilomètre ?
Il s’arrête où, ce terrier, faudrait me dire. S’il y avait au moins une loupiote bleue, par-ci, par-là, mais tu peux toujours t’éplucher la prostate, fiston ! Du black, du schwartz, du négro et encore du noir. C’est le boulevard Richard-Lenoir ! Aussi chiant qu’un mari méfiant. Ce qu’ils peuvent m’agacer, ces cons, avec leur manie de guigner leur rombière, à sourciller, sitôt que tu leur adresses la parole, à laisser tomber leur serviette inopinémoi pour s’assurer que tu leur fais pas un brin de panard sous la table ! Ils sont cons de comporter ainsi, ça ne change rien à la finalité des choses, et en plus tu les hais au lieu de les prendre en grande tendresse comme avec les vrais cocus professionnels, francs et massifs qu’on trompe par pure sympathie.
La seule lumière dont je dispose, c’est le cadran lumineux de ma tocante. Si je te disais : au milieu d’une obscurité si parfaite, quand je tiens mon bras devant moi, il me semble qu’une aube point.
Bientôt six plombes du soir.
J’avance encore.
Et tout à coup : ploaff ! Je prends une surface verticale et dure dans les naseaux. J’en suis tout étourdi. Mes mains investigatrices détectent une paroi rugueuse. Le tunnel s’achève par un mur de béton. N’ai-je donc tant marché que pour cette infamie ? Oh ! je hais ces culs-de-sac qui nous ont fait tant de mal ! Me suis farci un kilomètre quatre cent soixante-six mètres pour la peau. Horreur ! Malédiction ! Trois fois hélas !
Fou furieux, écœuré jusqu’en ma plus humble cellule, je me mets à palper toute la surface contre laquelle mon destin vient buter. Et au moment où je désespère, que rencontrent mes doigts fureteurs ? Tu donnes ta langue ? Non, je préfère celle de ta sœur : un échelon. Scellé. Je me baisse : il y en a un à hauteur de mes genoux. M’y juche, palpe plus haut, d’autres succèdent. J’ai beau lever les yeux, onc rai lumineux ne filtre. Tant pis, il faut grimper ; l’homme doit s’élever par tous les moyens, ça lui permet de tomber de plus haut en fin de parcours.
Huit échelons. Et ce que je redoute se produit : ma tête heurte une surface plane. J’arc-boute pour pousser du chef, mais zob !
Alors ma dextre part en reconnaissance, bien lui en prend : elle empoigne très vite une espèce de grosse manette de fer en demi-cercle. Je cigogne vigoureusement ladite, elle décrit un quart de tour.
Je pousse, ça se soulève : une trappe. Cette fois, un peu de lumière — je dirais de lueur pour me conformer à la réalité — filtre. Je me retrouve à plat ventre sur une surface limoneuse qui sent l’algue en décomposition.
Je tente de me mettre debout, mais c’est pas possible vu que je suis dans une sorte de faille naturelle qu’un cours d’eau a dû creuser dans la roche. Figure-toi une belon formidable entrebâillée. Telle une perle (de grande culture, merci), je gis au fond de la coquille.
Rampant sur le visqueux, je gagne l’extérieur. La lumière se fait de plus en plus vive. Après moult (au moins) efforts, me voici au bord de la faille.
Ouf ! Le jour ! Le soleil ! L’horizon. Et quel ! La roche domine un cours d’eau, torrent impétueux qui cabriole dans une étendue de caillasses et de rochers. Je paresse un long moment dans la chaleur, lézard charmé par la caresse du soleil et l’hymne de l’eau sauvage, a écrit je me rappelle plus quelle rombière des lettres en souffrance…
Libre ! Sauvé ! Vive le San ! Vive l’Antonio ! Vive le trait d’union ! Je descensionne jusqu’au cours d’eau ; de la flotte glacée sur ma frite de hibou, une bénédiction !
Ne me reste plus qu’à marcher ensuite vers la civilisation.
COUP DE POMPE
Au moment où le portier de mon hôtel me tend la clé de ma turne, je file un regard à la pendule accrochée derrière lui et je suis surpris de lui voir indiquer quatre heures douze de l’après-midi, alors que ma tocante à moi marque six heures cinquante, ce qui est son droit absolu.
— Votre horloge marche juste, ou si elle fait de la chaise longue ? questionné-je.
L’officier de serrure ouvre son œil personnel grand comme une pièce de cinq francs suisses, tandis que l’autre, en baccarat véritable (il était croupier à La Vegas avant de venir ici, après la perte de son lampion gauche), reste de marbre, ou plus exactement de verre.
— Elle ne s’est jamais déréglée d’une seule minute en quatre ans, riposte-t-il âprement, en homme toujours prêt à voler au secours de l’opprimé, quand bien même il s’agit d’une pendule.
Pour corroborer, il m’avance son poignet sous le regard. Sa montre de portier américain, en or sous-titré, exprime comme elle peut quatre heures douze, non, hop ! treize, mais le temps passe si vite !
D’instinct, je porte la mienne à l’oreille. Son zonzon électrique me rassure. Elle marche. Pourquoi, en ce cas, avance-t-elle de plus de deux plombes ? Cela dit, je suis aux prises avec des préoccupations plus importantes. Je mets mon oignon à l’heure et grimpe me doucher et me changer.
En robe de chambre dans une vaste pièce anonyme, qui prétend faire accroire à des marchands de bestiaux en voyage qu’elle représente l’aboutissement du luxe, je commande un sandwich-club et une bouteille de bordeaux.
Bien blotti dans son fauteuil de cuir, les jambes sur les accoudoirs, le délicieux San-Antonio examine les derniers incidents de parcours, comme le taureau rumine entre deux coïts.
France ! Un milliardaire loufoque dont le nom apparaît dans la ténébreuse affaire Stone-Kiroul… Nabab dingue ! Pédé, boulimique, mégalo. Ne pouvant supporter ses facéties, je me barre de chez lui vigoureusement. Me paume dans son foutu labyrinthe. En sors par la ruse. Mais ne peux quitter son domaine car, au dernier moment, comme dans un dessin animé de science-fiction, ma voiture est happée par une mâchoire géante et entraînée dans un tunnel mystérieux.
Tu sais que si ce n’était pas moi qui avais écrit cela, je n’y croirais pas ? Je te le déclare carrément. Et pourtant, telle est bien la strychnine vérité, comme dit volontiers mon nouveau patron ; je t’en donne sa parole d’honneur, plus la parole d’honneur à M. Begin, celle de M. Canuet, la tienne, et la parole d’honneur du vicomte de Bragelonne par-dessus le marché, alors tu vois !
Pris dans les profondeurs du sol, je parviens à m’en arracher, ô miracle ! Je regagne mon hôtel et gamberge, ce qui m’amène à la conclusion intestinale que tout est à recommencer. Ma visite chez France a compté pour du butter, comme disait la mère Fly quand elle était calmée. On remet le compteur à zéro et on repart pour un tour.
Si t’es pas d’accord, tu peux te faire rembourser le chapitre précédent.
Enfin, j’aurais pu y laisser ma peau dans ce tunnel de merde. Sana, mort sur un champ de bétail, ça ferait du cri dans les chaumières où sèchent de jolies petites culottes friponnes, moi je te dis. Ce concert des veuvettes, mon neveu ! « C’est’y-t-il possible, un garçon comme ça, avec une bite pareille, des manières si tellement exquises, des initiatives coupe-pattes, une infatigabilité que Casanova l’aurait su, il se filait dans le Grand Canal avec une pierre de vingt livres au cou en guise de jabot ! »
Un loufiat plus galonné que le général Bokassa le jour de son sacre (sacré Bokassa !), m’apporte l’en-cas (de besoin) réclamé quelques paragraphes plus avant. Tout en guignant le mahousse sandwich, et par pure association d’idées, j’entreprends d’appeler mon nouveau directeur, manière de lui rapporter les aléas de ma mission.
— Ah ! bonjour, mon cher, il fait, en accompagnant de ronds de langue. J’sus navré de pas pouvoir vous esgourder lulure, mais y a le chef des gogues à m’sieur l’miniss d’l’Intérieur dans mon burlingue. C’est pourquoi faut que vous allez êt’ bref, surtout au prix d’la communicance. Ce sidi j’vous écoute…
— Monsieur le directeur, bêlé-je, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants.
Et bon, je résume avec cette concision à laquelle personne, même quelqu’un de circoncis, ne saurait atteindre.
L’Eminent personnage écoute en réprimant des rots familiers, car ses nouvelles fonctions ne l’autorisent plus à les exprimer avec l’enthousiasme de naguère. L’homme est cerné par sa réussite. Plus il s’élève sur la pyramide sociale, moins il a de liberté de mouvements. L’incongruité, par exemple, est un mode d’expression réservé à la base, de même que le chandail troué à col roulé, le jean à braguette pisseuse, le non-rasage et le casse-croûte aux harengs.
Il ne faut pas plus d’une minute dix pour l’informer. Lorsque je me tais, il parle :
— Dites, mon cher, vot’ croque-mort, ça m’a l’air d’un drôle d’pistolet, non ? Notez, y a un truc positiviste dans c’que vous m’avez raconté.
— En vérité, monsieur le directeur ?
— L’accident d’avion. V’s’avez découvert l’restant du message, en somme.
— Presque. V 818, c’est le numéro du vol qui a connu cette catastrophe, et Stocky est une des victimes, j’ai lu son nom sur la liste publiée par le journal du cru. Ne reste à éclaircir que le mot « Pied ».
M. le directeur grommeluche des suppositions, puis s’adresse au personnage assis en face de lui : « Veuillez-moi z’en pas, m’sieur l’chef des Cagoinsses, dit-il, j’sus t’en converse avec le Mexique. En effet, San-Antonio est en mission à San Antonio, ça paie, non ? »
Il pouffe ; mais l’autre ne doit pas partager, car il exécute une volte.
— Bien, v’là mes consignations, mon cher. Du moment qu’ c’est carbonisé du côté Borniole, faut s’rabat’ sur le cimetière, vous mordez où je veux en viendre ?
— Pas exactement, monsieur le directeur.
— Les deux derniers mots du message c’est Stock pied. Stocky, c’t’un homme, p’t’être que « pied » c’est le sien, non ?
— Pourquoi pas, monsieur le directeur ?
— J’vas faire chercher des recherches su’ ce gonzier, v’s’avez des détails à propos d’son sujet ?
— Sur la liste funèbre, il y avait simplement « W.H. Stocky, de Boston. »
— Ça s’écrit comme ça s’prononce : b, o, x, o, n ?
— Oui, mais avec « st » au lieu du « x ».
— Donnez-moi vos cornets, j’vous ferai préviendre dès qu’on aura du neuf.
— Mes cornets ? Vous voulez dire mes coordonnées, monsieur le directeur.
— Vous m’avez parfaitement compris, l’ami, jouez pas au plus con av’c moi, v’l’auriez dans l’ogne. S’cusez-moi si je perds mon contrôleur, m’sieur l’chef des chiottes, mais si on tolère les familièrités d’ses suborneurs, en deux coups les gros y vous appellent Dugland.
Je n’ai que le temps de lui indiquer le nom de mon hôtel et il raccroche sans un mot d’au revoir.
Ah ! le pouvoir, quelle triste chose !
J’achève de clapper mon sandwich et regarde l’heure. Ma montre marque six heures. Je cherche confirmation sur la pendulette de la fausse cheminée en faux marbre, avec faux feu, et l’obtiens, sans bavures : on dirait que ma tocante est revenue à de bons sentiments.
On sonne.
Je presse le bouton d’ouverture. Une femme de chambre paraît, dans un croquignolet uniforme bleu échancré de partout, mais y a pas de quoi triquer vu que la donzelle est une Jap ou assimilée, avec une face large comme un plat d’offrande et des cannes plus arquées que les parenthèses dont j’émaille ce livre admirablement con.
Elle me montre une pile de linge de toilette.
— C’est le change, annonce-t-elle.
— Yes, yes, lui dis-je.
Elle passe dans ma salle de bains. Je me choisis une tenue passe-partout : pantalon de toile blanche, blouson en daim léger dans les tons tilleul, chemise blanche.
Quand la f. de c. sort de la s. de b., je lui désigne le costar qui me servit de maillot de bain et lui demande de le confier au pressinge dare-dare.
— Pour demain ? me demande-t-elle.
— Gi go, ma poule.
Elle a droit à un talbin rupinos, sur lequel le père Washington fait une gueule sinistre, comme quoi il aurait préféré être réservé aux billets de cent dollars, ce con. Un verdâtre d’un pion, tu penses ; c’était vraiment le prendre pour un minus !
La soubrette qui n’est pas toute jaunette, griffe l’artiche, se fend d’un sourire et s’éclipse d’autant plus aisément qu’elle ressemble à la lune.
Je me loque en sifflotant.
Allons, la vie continue, donc elle est belle. Aujourd’hui est semblable à hier, mais demain sera un autre jour, je te le promets, Antoine.
C’est en me calamistrant qu’elle me vient, cette bizarre sensation d’enculage dont je ne t’ai pas encore parlé, mais je vais.
Etrange sentiment que quelque chose se coince là où je ne me gaffe pas. Comme quand tu roules à fond la caisse au volant de ta chignole et que la portière n’est pas fermée de ton côté.
Ça vient de quoi, d’où ? On possède un ordinateur quelque part, entre cœur et cerveau, qui enregistre l’imperceptible.
En limant à l’aide de mon canif multilames un ongle qui accroche (ce qui n’est pas gentil pour les dames) j’émets soudain une exclamation de lion sur la queue duquel un éléphant myope vient de poser le pied.
Tout me surgit, grand écran.
Ce couple d’Asiatiques dans le restaurant de Berne… Tu te le rappelles ? Le message me conseillait de m’en gaffer. Eh bien, la femme de chambre qui sort d’ici… Tu m’as compris, tu m’as ? Sur l’instant, je ne l’ai pas retapissée. Faut dire que pour les Blanchâtres que nous sommes, les Jaunes et les Noirs se ressemblent comme un paquet de Bonux à un autre. Elle était loquée soubrette et affairée, cette personne, et moi submergé par les soucis, ça créait une fracture dans mon souvenir. Heureusement, mon malin petit subconscient, toujours sur la brèche, veillait.
« Gaffe ! Gaffe bien à tes os, mon joli Sana ! » m’enjoins-je. Cette visite ne me dit rien qui vaille. Qu’est venue bricoler l’Extrême-Orientale dans ma carrée ? Elle apportait du linge de toilette. Elle est entrée quelques secondes seulement dans ma salle de bains, c’est trop peu pour installer une chaîne Ifi (génie) mais suffisant pour cloquer une bombe à retardement sous le lavabo.
Je me précipite. Le linge propre se trouve en place sur les tringles chromées. En flic expérimenté, j’explore l’endroit avec un maximum de promptitude. Lavabo, gogue, chasse d’eau, bidet, armoire à pharmacie, rouleau de faf à train, porte-savon, boîte à ordures, radiateur de chauffage, plafonnier, aérateur (tu croirais un poème de Prévert).
Rien.
Je déplie chaque linge. Toujours rien.
Ai-je eu la berlue ? Peut-être me gouré-je, après tout ? Je le répète, rien ne ressemble davantage à un Japonais qu’un autre Japonais, sinon une vieille bassinoire de cuivre. La gnère du restau, je l’ai renouchée en vitesse. Elle était en tailleur et je n’ai pas dû la regarder plus de cinq secondes.
Par acquit de conscience, je presse le bouton blanc sur lequel une silhouette de soubrette est gravée. De même que l’affût du canon met un certain temps pour refroidir, la préposée met un certain temps pour se pointer. C’est la fille qui vient de me rendre visite. Mes doutes se dissipent. S’il s’agissait de l’Asiatique de Berne, et qu’elle m’eût bricolé un galoup vicieux, tu penses qu’elle aurait mis les adjas vite fait. Et puis, et surtout, elle n’appartiendrait pas au personnel de l’hôtel.
Je bredouille trois broques à propos du costar que je lui ai confié, comme quoi on doit bien veiller au pli, que c’est ma maniaquerie, tout ça. Elle promet de chapitrer la lingère.
Pendant que je lui parle, je la capte à bloc. Un vrai documentaire. Dans cent douze ans je serai encore capable de te raconter ses oreilles, la largeur de son tarbouif, le craquelé de ses paupières batraciennes, le velouté de sa peau, son bronzage (couleur bronze garantie). Plus je défrime cette fille, plus je me dis qu’il ne doit pas s’agir de la dame en question.
Quand elle se retire, je me sens à peu près rassuré, mais néanmoins, mon indéfinissable malaise persiste.
Rien n’est plus propice que l’action lorsqu’on veut lutter contre l’angoisse. Alors je me rabats sur le téléphone. Funeral House. Service des renseignements.
— Ici Joseph Dupont, de Nemours, France. Je suis le beau-frère d’une personne dont vous avez assuré l’inhumation récemment et je voudrais profiter de mon voyage au Texas pour aller me recueillir sur sa tombe.
— Parfaitement.
— Pour cela il faut que vous me disiez où elle est enterrée.
— Le nom de ce client ? demande la voix mélodieusement impersonnelle de la préposée.
— Il s’agit de M.W.H. Stocky, de Boston.
— Un instant, je vous prie.
Je devine que ma terlocutrice répercute ma requête au service compétent. Il y a des zizillements dans l’appareil. Et puis une voix d’homme me dit :
— C’est vous qui voulez visiter la sépulture de mister W.H. Stocky ?
— C’est moi.
— Mister Stocky repose au cimetière de Fort Makabee, allée 45, bloc 6.
— Merci beaucoup.
— Service.
Je raccroche. Qu’à peine, le ronfleur retentit déjà.
— On vous appelle de la France, me jette une standardiste blasée.
Même les communications en provenance de la planète Mars la laissent froide.
Je reconnais la voix de Mathias à travers l’éther.
— Hello, Rouquin, ça va, la vie ?
— Nous avons un nouveau bébé, commissaire ! répond triomphalement le Radieux. C’est une fille : Anne-Gertrude.
— Bravo ! Quel est le numéro de son matricule ?
— Dix-sept.
— A dix-huit, la Sécurité t’offre une castration gratuite.
Ça le fait marrer ; il encaisse sa progéniture avec bonne humeur, le Rouillé. Les Allocs lui versent chaque mois des sommes faramineuses pour récompenser sa bibite de lapin.
— Je vous téléphone rapport au dénommé William Hugh Stocky, de Boston, mort dans l’accident d’avion de San Antonio.
— O.K., alors ?
— Stocky est un ancien collaborateur du Président Johnson. Officier de marine pendant la guerre, grièvement blessé dans les Philippines. Il a été marié à une Suédoise, laquelle est morte de leucémie dix ans après cette union sans lui avoir donné d’enfants. Au cours de la période qu’il a passée à la Maison-Blanche, il s’était spécialisé dans la diplomatie occulte, c’est-à-dire qu’il voyageait beaucoup, gravitant dans les ambassades, les coulisses des gouvernements. C’était un homme très écouté, jouissant d’un crédit certain auprès des principaux protagonistes de la politique internationale.
Jolie tournure, qui dénote son lecteur du Monde, car Mathias a beau baiser comme un lapin et semer à tout ventre, il est érudit, et c’est pas à lui que tu ferais gurgiter la presse-branlette.
— Encore des choses ? questionne l’avide que je suis.
— C’est tout pour l’instant.
— Tu es au courant de l’affaire Stone-Kiroul ?
— Dans les grandes lignes, M. le directeur me l’a résumée.
— Il t’a fourni le texte du message ?
— Oui, pourquoi ?
— Comment se fait-il que les services secrets britanniques n’aient pas su immédiatement qui était Stocky ?
— Ils n’ont pas pu l’ignorer, assure l’Incendié, il ne m’a pas fallu quarante minutes pour trouver le curriculum du personnage.
En moi, commence à poindre une aurore. Mais c’est enfoui tout au fonde ma caboche.
« Voyons, Sana, me prends-je à partie, l’I.S. ne pouvait ignorer le nom de Stocky et t’affirmait cependant n’en rien connaître. Le chef des services de renseignements suisses, lui, savait qui était P. J. France, et le général Blackcat entretenait de bons rapports avec lui, ce qui permet de supposer qu’il le savait également ; or, il a feint de croire que P. J. France San Antonio s’appliquait à toi. Conclusion, on t’a pris pour le roi des cons, mon chéri. Tu as été une marionnette mignonne entre les doigts desséchés de ce vieux squelette d’outre-Manche. »
— Vous êtes toujours en ligne, commissaire ? s’inquiète le Rouquemoute.
— Pardonne mon silence : je suis.
— Vous êtes quoi ?
— Je pense, donc je suis. Dis voir, mignonnet, toi qui sais tout et inventes le reste, tu connais Demussond ?
— Un ancien des R.G. ?
— Un ancien, un actuel ou un futur, c’est un de ces malins qui ont toujours trente-six fers au feu de trente-six forges. Tu vas t’arranger pour le rencontrer. Tu lui diras de ma part que San-Antonio, tiret, est à San Antonio, sans tiret, qu’il a tout pigé et qu’il ira lui pisser au cul dès son retour ; compris ?
— Ne pourrais-je chercher une équivalence à la dernière partie de la phrase, commissaire ?
— Le propre des meilleures locutions c’est d’être irremplaçables, mon vieux Flamboyant. Fais ce que je te dis et dis ce que je te dis, quand on a planté dix-sept mougingues à une mégère comme Mme Mathias, c’est qu’on a des couilles, non ?
Là-dessus, je sectionne la communication.
Clic ! Et il m’arrive presque aussitôt un drôle de turbin. J’ai un blanc. Entends par là que toute image disparaît de ma rétine, toute pensée de mon cervelet. Je paume l’usage de l’ouïe, du goût, du toucher et, cela va de soi, de l’odorat. Me voilà contraint de me laisser glisser au sol pour m’y allonger.
« Seigneur, je… »
Et tout devient rien.
COUP DE SANG
Bon, quand je réadhère à la normale, il est plus tard que tu ne crois. A preuve : il fait noye. Ma chambre est éclairée par la réverbération d’une enseigne lumineuse vantant les mérites des cigarettes Chmurtz qui sont si douces à la santé avec leur filtre en mégalovinyle emplâtré.
Je me sens léger, remis, dispos comme après une nuit réparatrice. Un peu meurtri des endosses toutefois, malgré l’épaisseur de la moquette, mais j’ai si souvent pieuté sur la dure que je me dénoue les muscles par quelques mouvements gymniques appropriés.
L’heure ?
Minuit moins des.
La faim me tenaille encore plus fortement qu’avant de clapper mon sandwich-club. Je décide d’aller faire la soupette dans quelque restaurant de nuit.
Comme je sors, je suis surpris de trouver l’écriteau Do not disturb accroché à la poignée de ma porte. Ce n’est pas moi qui l’ai fixé. D’ailleurs, je n’ai pas dormi de « mon » propre sommeil. On m’a soporifiqué, crois-tu ? La dame jaune ? Pour venir fouiller ma chambre ? Elle avait toute possibilité de le faire en mon absence. D’ailleurs je n’éprouve aucune de ces séquelles inévitables consécutives à un soporifique quelconque, telles que : nausées, mal de tête, bouche sèche, etc. La forme, te dis-je.
Je m’adresse au concierge pour m’enquérir d’un endroit où clapper, le restaurant de l’hôtel étant fermé.
— Ah ! bon, s’exclame l’homme en m’apercevant, je suis bien aise de vous voir, mister Antonio, depuis trente heures que vous êtes enfermé, nous commencions à nous inquiéter, d’autant qu’il y a eu plusieurs appels téléphoniques pour vous ce soir et que vous ne répondiez pas, je venais justement d’en référer à la direction.
Trente heures ! Merde, pas surprenant que j’aie les crocs.
— Je me suis offert une petite cure de sommeil, réponds-je d’un ton léger. Mes correspondants n’ont pas laissé de messages ?
— Aucun.
Il a droit à la photo de Washington le Boudeur, lui aussi, en échange de laquelle il me fait savoir qu’à quatre pas d’ici le Rodrigue est un night-club où l’on trouve les meilleurs steaks de tout le Texas.
L’endroit n’est pas pire que ceux qu’on rencontre sur tous les continents. On y trouve le même décor plus ou moins art déco, les mêmes lumières orangées, les mêmes pétasses, la même musique vociférante. « Désormais, comme le disait Béru, du temps qu’il était à mes ordres non moi aux siens, désormais, c’est chez toi que t’es le mieux ailleurs. »
Je dégauchis une place sur un tabouret rembourré, au bar en « S » servant de râtelier aux bipèdes venus s’étourdir en se poivrant le nez et s’entre-frottant le lard.
Une majorette habillée seulement d’un boléro et de son cul assure le service dans ma zone de clappe.
Je lui commande le fameux « Steak maison » et un bourbon, histoire de conformer mes mœurs à celles du pays. Service éclair. Le temps pour un bègue de compter jusqu’à dix et l’on dépose devant moi une assiette large comme la roue avant des premiers vélocipèdes, lestée d’un quartier de barbaque suffisant pour assurer pendant un mois la survie de quinze spéléologues perdus dans l’utérus de Mme Bambino.
Je songe, avant de grignoter ce qui convient à mon appétit, que tant que l’on servira de pareilles poncifs à un seul homme, il n’y aura rien de changé dans le royaume de Danemark.
Alors me voilà parti sur mon récif de bidoche, condor s’attaquant à un buffle décédé, quand j’avise, de l’autre côté de mon auge, la môme Maggy avec son baise-ballman d’époux. Eux aussi se font un steak format société de surconsommation, mais ils ont eu la sagesse d’en commander un pour deux.
Ils devisent la bouche pleine (ce qui ne doit pas affecter la diction du grand glandu), en se tenant de profil, un coude sur le rade, à l’américaine.
Moi, pour attirer leur attention, tu sais quoi ? Je lance ce que mon distingué Béru appelle : un coup de sifflet de trident.
C’est si suraigu que, nonobstant la musique en rut, toute la populace de la mangeoire regarde dans ma direction, y compris le couple. Maggy paraît surprise. Elle tarde à me sourire, mais ça vient. Son grand bestiau me crie un « Hello ! » qui fêlerait le bourdon de la cathédrale. Par gestes, vu le brou-de-haha, on s’indique qu’on prendra un pot ensemble après la collation. Je m’octroie huit cents grammes de viandasse, règle la note en conseillant à la majorette de préparer des assiettes anglaises avec les trois kilogrammes restants, car j’ai bouffé très proprement. Elle hausse les épaules et bascule mon reliquat par le trappon d’un dévaloir qui conduit le tout aux ordures, comme quoi un taureau a pris la peine de grimper sur une vache, la vache de faire un veau, le veau de grandir, tout cela pour échouer en fin de compte dans la benne des éboueurs. Ulcérant ! Atteinte à la nature !
Nous voici enfin réunis, Maggy, son super-nœud et moi. Entassés sur un bout de banquette, avec une source sonore au ras de nos manettes, ce qui ne facilite pas chouchouille les élans de l’âme. On écluse des trucs alcoolisés. Le bœuf se raconte, comme toujours, les cons : il raffole de sa propre histoire, la trouve belle, élogieuse, bien trempée ; il dirige une fabrique d’engrais. Le fumier, c’est son pain quotidien, cézigue. Ils ont une ravissante maison sur les bords de la San Antonio River. Et est-ce que ça me dirait d’aller biberonner un godet chez eux, en sortant du Rodrigue ? Non, merci bien, j’ai pas de bagnole pour l’instant. Alors une autre fois ? D’accord.
Maggy est blottie dans les bras du marchand d’engrais. C’est du neuf, eux deux. Il doit monter au paf comme il cavale sur le terrain de baseball : sans fioritures, mais en force. Au début, les gerces adorent. C’est ensuite que les élans libertins leur viennent, plus tard, passé la trente-cinquantaine, quand leurs paupières commencent à faire le papier de chocolat défroissé.
Profitant de ce que le disc-jockey nous soulage d’un machin moins paroxystique, elle me dit :
— A propos, comment s’est passé votre déjeuner chez mister France ?
— Au poil, on s’est baignés dans sa piscine.
— C’est un homme… intéressant, non ?
— Très. Sa femme aussi est pittoresque, avec sa belle barbe noire.
Elle sourit.
— France est réellement fou, ou bien il fait semblant ? demandé-je.
Maggy répète :
— C est un homme intéressant.
Le big boss, tu parles, elle va pas bêcher, prendre le risque de lui faire un mauvais papier, qu’on ne sait jamais qui colporte quoi ; quand tu penses à quel point les hommes sont dégueulasses, et de jour en jour davantage. Plus ils deviennent nombreux, plus ils deviennent féroces…
Tout à coup, le bœuf se met à faire le sémaphore en folie avec ses grands bras. Il veut attirer l’attention de quelqu’un dans la foule. Le quelqu’un finit par capter ses signaux et y répond par un geste joyeux.
Le quelqu’un s’approche de notre table.
Le quelqu’un est une dame.
Fort jolie et qui baise divinement : Anny Etoilet.
Un homme mourant d’âge m’a dit un jour :
« Tu sauras qu’une femme est laide lorsqu’elle n’est vraiment pas belle. »
Le paraphrasant, je déclare ceci : « Tu sauras qu’une femme est belle lorsqu’elle n’est vraiment pas laide. » Tout est grâce et harmonie chez Anny. Ses formes, ses yeux, sa bouche, la couleur de ses cheveux, celle de ses dessous, le son de sa voix, son odeur et les ondes qui partent de sa personne pour arabesquer autour de ton cœur. Elle est si parfaite qu’on ne se lasse pas de la contempler, comme on contemple une source, un feu de cheminée, la neige tombant sur un boqueteau de sapins.
Tout autre que moi — toi, par exemple — serait soudé de voir ma ravissante Vaudoise débouler à San Antonio et marquerait sa surprise par des mouvements désordonnés et de ces paroles désyntaxées dont seules les sonorités sont éloquentes. Tout autre qu’elle — toi, par exemple — serait ahuri de me trouver à San Antonio en compagnie de gens de connaissance et l’exprimerait par quelques-unes de ces simagrées dont les gens ont le secret lorsqu’ils essaient de traduire une émotion.
Eh bien, laisse-moi te dire que nous sommes parfaits de self-control, elle et moi.
On se dit « Bonjour », chaleureusement. Je baisotte le dos de sa menotte, elle me vote un sourire humide, une œillade nostalgique en forme de sa jolie chatte.
— Vous vous connaissez ! s’écrie le bœuf qui veut devenir aussi intelligent que la grenouille.
— La Suisse est le plus beau point de rencontre de l’Univers, éludé-je.
Et c’est à mon tour de m’exclamer :
— Vous vous connaissez ?
— Depuis cinq ans, répond le bœuf, Anny nous loue son chalet du Montana chaque hiver ; et quand elle vient traiter ses affaires de pétrole à Houston, elle ne manque pas de faire une escapade jusqu’à San Antonio.
Bravo, parfait, tout est bien qui continue bien. Le serveur apporte de nouvelles boissons bleutées et corsées.
— Comment va notre ami Rameau ? demandé-je.
Anny me saisit l’avant-bras, juste à l’endroit où j’ai fixé un stylet à pointe bique, pour on-ne-sait-jamais-les-nuits-sont-fraîches-même-au-Texas. Ce contact étranger ne la fait pas frémir. Et elle retire sa main sans cesser de sourire[6].
— Ne savez-vous donc pas ce qui lui est arrivé ? demande Anny.
— Disez-le-moi !
— Il s’en enfui de l’hôpital et on n’a pas retrouvé sa trace.
— Ne l’aurait-on plutôt enlevé ?
— D’après certains témoignages, il semblerait qu’il est bel et bien parti volontairement, en pyjama. Il a emprunté un vélomoteur dans la cour de l’établissement.
Je branle le chef et m’abandonne un moment à la musique lancinante. Des gens, attifés faut voir comme, gambillent sur la piste, très fiers de se donner en pitoyable spectacle ; car c’est cela qui les hante surtout, les hommes, après le pognon : être admirés, s’inscrire dans les rétines des autres.
Anny pose sa main ornée d’un joli morceau de carbone cristallisé sur mon genou. Prometteuse. Je sais qu’elle tiendra. Je sais aussi qu’il se passe des drôles de choses, car enfin, il est exclu que notre rencontre à tous les quatre soit fortuite. L’Antonio est coincé entre les mâchoires d’un moule à gaufres, et il va devoir s’arc-bouter vilain s’il ne veut pas être aplati. C’est merveilleux, le hasard, mais il ne faut pas en abuser.
La soirée est plutôt languissante, malgré le tohu-bohu. Le bœuf s’en aperçoit et, péremptoire, déclare qu’on ne va pas se plumer plus longtemps dans cette taule de charlots, qu’allez, ouste ! il nous convie dans sa gentilhommière.
Et pourquoi not ?
Bon, alors on se trisse, tu vois. Chacun tient son petit lot par la taille. Bob promet de me ramener en ville après la nouba. Il a une grande chignole blanche décapotable, un peu vioque et inconforme aux principes raisonnables régissant désormais le monde automobilingue. On s’installe. Je passe à l’arrière, naturliche, avec la belle Anny que je me mets à goûter à pleines lèvres.
Le bœuf branche la radio autant fort qu’il peut, à t’en faire craquer les étagères à mégots, le poste, et jusqu’à son tableau de bord.
Et puis on s’éloigne de la ville. Comme je reste flic jusque dans les délicats moments, je questionne au bout d’un instant :
— Il y a combien de rétroviseurs sur votre tas de ferraille, Bobby ?
— Trois : le central et un autre à chaque portière avant.
— Il vous en faudrait combien pour que vous puissiez vous apercevoir qu’on nous suit ?
Il se met à mater dans le miroir fixé au pare-brise.
— La Porsche blanche ?
— Elle nous file le train depuis le Rodrigue. Si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, il faut faire placer un système de vidéo sur votre charrette, mon petit père.
— Une Porsche, ça ne peut pas être des flics, dit-il.
— Sûrement pas, d’ailleurs pourquoi des flics vous suivraient-ils ? Vous n’avez commis aucune infraction.
— Je vais essayer de les semer, assure le bœuf en clouant l’accélérateur au plancher.
Sa tire bondit, et les boudins se mettent à gueuler au petit pois sur l’asphalte.
Je ricane.
— Vous savez, Bob, pour semer une Porsche, il faut une autre Porsche et la faire surgonfler. Avec votre baquet, vous ne sèmeriez même pas le triporteur d’un unijambiste.
— Vous avez raison, admet le bouvillon ; alors on va s’y prendre autrement ; ces gars-là, c’est sûrement des partouzards en quête d’une fine soirée. Ils ont vu partir deux couples, et ils se sont dit que c’était pour une partie de jambes en l’air. Bougez pas…
Il ralentit. La Porsche idem, derrière.
Bob emprunte un chemin à droite. Au Texas, j’ai remarqué, dès que tu largues une nationale, c’est pour tomber sur des routes en terre plus ou moins ravinées où tu disparais dans un nuage de poussière jaune.
On se met à cahin-caher, mollo. Nos phares arrachent de l’ombre une étendue plate et sans arbres.
La Porsche a emprunté la voie cahoteuse à son tour.
— Vous allez voir ! jubile Bob.
Il franchit un millier de mètres et stoppe au beau milieu du chemin.
— Il va bien falloir qu’ils annoncent la couleur, déclare mon ami.
On est là, immobiles, retournés sur nos banquettes, à suivre les agissements de nos suiveurs.
La Porsche a ralenti, mais elle continue d’avancer.
— Si ces malins nous proposent la botte, vous êtes d’accord pour qu’on leur fasse une tête au carré, Tony ? rigole mon pote.
Les deux filles protestent, comme quoi la chicorne est toujours idiote, sans compter que les loustics filocheurs sont peut-être armés, non ?
Quand la Porsche est à dix mètres de notre diligence, elle stoppe et garde ses loupiotes allumées pleins phares braquées sur nous.
On attend un peu, mais les occupants ne se décident pas à sortir.
— Ça commence à bien faire ! gronde Taureau Fougueux en sortant de sa tire.
Et il marche à grandes enjambées vers la seconde voiture.
Je l’entends s’exclamer :
— Non, mais dites, à quoi vous jouez ?
En guise de réponse, une rafale brève déchire la nuit. Bob pousse un cri qui ne va pas jusqu’au bout de son propos et s’écroule. Maggy se fout à hurler.
— Couchez-vous ! enjoins-je aux deux filles.
D’un bond de léopard j’escalade le dossier qui me sépare du volant, enclenche la marche arrière et appuie tout ce que ça peut.
Vois-tu, l’abbé, ce qui différencie souvent la réussite de l’échec, c’est la promptitude. Lorsque tu agis d’une façon fulgurante, tu gagnes. Je te prends l’occurrence : si j’avais mis une minute pour exécuter ces différents gestes déguisés en manœuvres, les mecs auraient eu le temps, eux, de reculer. Mais je n’ai utilisé que six secondes. Faut dire que deux éléments jouaient en ma faveur : Bob n’avait pas coupé le moteur et le chauffeur de la Porsche disposait d’une boîte mécanique, non d’une boîte automatique.
Ça fait vraâââfffflllll braoum ! A peu de chose près, mais plus fort. Tout s’éteint derrière nous car les loupiotes des meurtriers ont volé en éclats. Purée de Porsche ! Dans ma fureur je continue de reculer à fond la caisse, en mettant pleins gaz. Ces vieilles tires ricaines sont les championnes du stock-car. De vrais petits bulldozers ! J’entends des tôles se froisser, des longerons se tordre, et également des cris. Mais bibi, pas de quartiers, fussent-ils de noblesse !
J’appuie ! J’appuie ! Que dis-je : j’appuille ! On continue de reculer. La pompe à Bobby remue du cul, ronfle, s’enrogne, soubresaute ; impitoyable, elle s’acharne avec furia, comme un taureau sur un canasson de picador. Mais la Porsche n’est pas caparaçonnée, elle. Dedieu ! ce nuage de poussière !
Je respire un grand chouia avant de me déplanquer. Faut que t’ailles aux nouvelles, petit homme ; que tu constates les dégâts, voire les décès.
Juste à la décarrade, v’là la Porsche qui s’embrase pour le beau final. D’un coup d’un seul, vlouf !
— Un extincteur ! bramé-je à Maggy ! Vite !
Mais elle n’a pas d’extincteur. Elle est tellement chavirée, la gosse, qu’elle se rappelle même plus ce que c’est.
Dans le brasier, j’ai le temps d’apercevoir, illuminé de l’intérieur, mon couple d’Asiatiques. Ils ont été emboutis jusqu’au fond de leur calèche, lardés des mille poignards de leur carrosserie disloquée. Pas d’erreur, ce sont bien les deux Jaunes de Berne. Et la gonzesse, oui, oui, Santonio, t’avais vu juste : la femme de chambre de l’hôtel. Ils sont sans réaction au milieu des flammes.
Quid de Bob-le-bœuf ?
Je bombe vers lui. Il gît à vingt mètres devant (car j’ai reculé), nez au sol dans un champ pelé. Je l’examine comme je peux, bien que je sache que c’est sans espoir : il en a pris une bonne douzaine dans l’horloge. Dis donc, ils faisaient pas le détail, les constipés.
Bien entendu, Maggy se jette sur l’époux tant aimé.
Scène déchirante ! Anny, sous la lune, plus blanche qu’une pierrotte, claque des dents comme une machine à coudre.
— Oh ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! gémit-elle, est-ce possible ?
La chose est arrivée si vite, et si sottement, on peut douter de la réalité, en effet.
COUP DE TRAFALGAR
Pas joyces du tout, les policiers texans. La manière malmeneuse qu’ils comportent avec une pauvre jeune femme enveuvée à la fleur de l’âge, ça fait honte. A aboyer, rudoyer, soucieux de bien tout savoir : et comment ceci, et pourquoi cela. Avait-il des ennemis, le cher bœuf ? Se livrait-il à un trafic illicite ? Baisait-il inconsidérément ? Il avait des choses à voir avec l’Asie ? Le Viêt-nam, par exemple ? La Mandchourie ? Le Japon ? Formose ? La veuve de Mao ?
Ensuite c’est ma fête à moi aussi. Pourquoi t’est-ce j’ai emplâtré de si furieuse manière les deux Jaunes ? Des Coréens, selon leurs fafs. Faut que je vais me tenir à la disposition des autorités. Légitime défense, leurs culs, aux cow-boys du patelin. San-Antonio-tiret, ils s’en torchent l’oigne, les archers de San Antonio-tout-nu.
Je te passe, qu’à quoi bon t’entartrer la caberle avec nos démêlés ? Ça fastide vite d’expliquer les choses administrateuses. Raconter ses malheurs ne fait du bien qu’au bénéficiaire, les autres se disent : « Cause toujours et crève, salaud ! » Voilà la mentalité. Chacun pour soi et Dieu pour Lui.
C’est seulement au petit morninge qu’on nous laisse regagner. Je propose aux deux filles de venir pioncer à mon hôtel, pas qu’on se sépare après avoir vécu de telles péripéties. Elles acceptent. Je prends deux piaules supplémentaires. Maggy est prostrée. Anny l’aide à se zoner, la borde, la chougnarde ce qu’il faut. Elle lui dégauchit même un somnifère helvétique de first quality, pas qu’elle rate sa décarrade dans le sirop de dorme ; ensuite, la jolie Vaudoise vient me rejoindre dans ma chambre pour faire le point. Je suis déjà dans mon pyjama de soie blanche et j’ai enfilé (en attendant mieux) ma robe de chambre de soie sauvage bleu nuit.
Anny Etoilet se laisse glisser dans le meilleur fauteuil, les bras ballants. Elle moule en douce ses mignons souliers.
— De l’alcool ou de l’eau ? je lui questionne.
Elle soupire :
— Si je peux me permettre, je préférerais de l’amour. Je suis à bout de nerfs et de fatigue et cela me plonge dans un état de surexcitation inextinguible.
Bon, je vais tout de même tenter de l’extinguer. D’autant que moi aussi, des nuits pareilles me branchent sur la haute tension.
Alors, soit, je viens m’agenouiller à ses pieds. Pour commencer, je me contente de poser ma joue sur ses genoux, que des confrères médiocres déclareraient « gainés de nylon ». Matière synthétique, le nylon. Dépravante. T’as des vers à soie qui se font chier le cocon à fabriquer une matière noble et on se rabat sur la chimie pour « gainer » les cuisses de nos ravissantes, bordel ! Moi, les hommes, ça commence à bien faire, sérieusement ! Au revoir et merci, bonne continuation !
Tiens, l’autre jour, je bouffais un fruit dans notre jardin ; cueilli à la branche, j’adore. Cadeau du ciel. Directo du producteur au consommateur. L’épicier vient livrer des caisses de je ne sais quoi. Il m’annonce qu’il fait beau. J’admets. Il me dit qu’il adore la nature. Je m’associe. Il m’avoue qu’il ne peut plus voir les gens.
« — Moi non plus, lui avoué-je, alors c’est pas la peine de rester à déconner comme nous le faisons.
Il a ri jaune, il est parti. Et quand il n’a plus été là, que je suis demeuré en tête-à-tête avec ma petite cruauté, j’ai eu envie de crier « Pouce ». De clamer que « Mais si, je les aime bien, les gens ». Ou plutôt que j’aime bien les hommes, mais que les gens me cassent les couilles. Les hommes, tant qu’ils ne deviennent pas « des gens », ça va. En y mettant du sien, on reste des leurs.
Et je coule ma main le long du collant. Cul-de-sac ! Tu sais ma marotte ? La haine spontanée, je la connais par le collant féminin. Tu pars du genou, tu fais la bébête qui monte qui monte ; et puis tu décris un virage en épingle à cheveux (ou en fer à cheval quand la gonzesse n’est pas potelée à point) et tu redescends.
Dedieu ! Je chope Anny par les brancards et la tire en avant, jusqu’à ce qu’elle soit dans la posture d’une mitrailleuse. Elle n’a pratiquement plus que le dos sur le fauteuil. Et tu sais pas, son collant ? Avec les dents je le lui arrache ! Elle gueule parce que ça lui déplume le cœur d’artichaut, mais ma voracité la dédolore, en fin de compte. Je pars pour le bel exploit sans ambiguïté, grand service à la carte.
Il fait jour, plein soleil. Ah ! Phébus, ne rougis pas, et glorifie de tes rayons ce qui se perpètre.
It’s a long way to the bed ! Il nous faut vingt minutes pour gagner mon plumard, bien que deux pauvres mètres nous en séparent. Chemin de croix adorable ; chemin de cris, chemin de plaintes. Ainsi va la charrue dans la terre beauceronne… Et puis, la couche enfin, où notre amour s’allonge…
Jouez au bois, résonnez, bals musettes !
De feux en artifices et d’artifices en fesses.
Joie sans (et avec) mélange.
Et puis le dénouement. Le calme qui revient, la mer qui s’apaise. L’affreux jojo qui refait le modeste. Passant, ici repose un héros fier et doux, dont les nobles vertus égalaient le courage (épitaphe de Don Quijotte).
Epuisée, Anny se blottit contre moi et s’endort.
— Non, mon âme, fais-je en caressant tendrement sa joue avant de dormir, tu vas tout me dire.
Il est des mots qui réveillent l’endormant plus sûrement qu’un seau d’eau froide.
Anny rouvre ses jolis yeux cernés.
— Te dire quoi, mon amour ? balbutie-t-elle.
— Un doigt de vérité additionné de beaucoup de détails, chérie.
— Quelle vérité ?
Je caresse ses adorables hanches, bien fermes, veloutées, conçues pour des mains d’artiste, comme les anches (sans h) d’un saxophone.
— Tu connais la vieille, très vieille histoire du monsieur qui rentre inopinément de voyage ? Il trouve, en plein après-midi, sa femme nue dans leur lit, s’étonne. « J’étais souffrante », dit la dame. Le monsieur aperçoit alors des chaussettes rouges sur le tapis alors qu’il n’en a jamais possédé. « C’est celles de mon frère », répond la dame. Le monsieur avise un mégot de cigare dans un cendrier, or il ne fume pas. « C’est celui du tapissier qui est venu poser les rideaux », rassure l’épouse. Continuant ses investigations, le monsieur ouvre l’armoire et se trouve nez à nez avec un type à poil. « Qu’est-ce que vous fichez là ! » tonne le mari. Alors le gars murmure : « Ecoutez, si vous avez cru les explications que madame vient de vous donner, moi j’attends le métro. » Anny, ma chère âme, si tu penses que je trouve normales ta présence à San Antonio et tes relations avec Bob et Maggy, si tu crois que j’ai trouvé normale ta venue dans ma chambre de Berne, le lendemain de l’agression, si tu crois cela, ma chérie, je te donne ma parole qu’en ce moment j’attends le métro.
Elle sourit, noue ses mains sous sa nuque et se met à contempler le plafond, comme souvent les dames qu’on vient de baiser.
— A quoi bon finasser, en effet, dit-elle.
— Je te le demande humblement.
— Maman est anglaise.
— Il n’y a pas de sots métiers, la rassuré-je.
— Ç’a été quelqu’un de très actif pendant la guerre ; elle appartenait à l’I.S.
— Et tu as repris le flambeau ?
— Exactement.
— Marrant, il est des enfants qui reprennent le cabinet médical ou la charcuterie paternelle, toi tu as repris le fond d’espionnage de maman, c’est joli et quasi moral ; je la raconterai, plus tard, à mes enfants, après « Le Petit Chaperon Rouge ».
— Cela dit, j’appartiens vraiment à la Burnkreuse Petroleum Company.
— L’ami Rameau, il fait dans quoi, lui ? C.I.A., Guépéou, I.S., ou quoi d’autre ?
Elle secoue sa joie tête.
— Il fait dans le pétrole, uniquement. Votre rencontre a été tout à fait fortuite.
— A voir.
— Pourquoi te cacherais-je quelque chose, puisqu’on se dit tout.
— Tu collabores avec le général Blackcat ?
— Affirmatif.
— C’est lui qui t’a chargée de me… couvrir ?
— Affirmatif ; bien que ce soit le contraire qui se soit produit, ajoute la mutine en m’empoignant sans vergogne le tergiverseur d’ambivalence (Espagne) dans l’espoir avoué de s’en faire un tabouret.
— C’est toi qui m’as fait prévenir que je devais me rendre au Grossbitrhof, puis au Ran-Tan-Plan ?
— C’est moi.
— Et qui m’as averti que je devais me méfier du couple de Jaunes ?
— Toujours exact.
— Tu m’expliques tout de suite, ou bien je trouverai les réponses dans le prochain numéro du San Antonio Tribune ?
— Tu sais bien que dans mes occupations, on n’explique rien, disons que notre succursale suisse avait à l’œil une équipe de Nord-Coréens dont on savait qu’ils s’intéressaient à l’affaire Stone-Kiroul…
— C’était bien le colonel Müller qui devait me contacter au Ran-Tan-Plan ?
— Oui.
— Et Rameau a réellement joué au con, ou bien travaille-t-il pour une autre maison et a-t-il voulu me squeezer ?
— Il est génial dans son boulot, mais assez stupide dans la vie. C’est un scout qui a mal vieilli ; avec des problèmes métaphysiques, des fantasmes et une jugeote de serin. Il s’est flanqué sous les roues de ton enquête comme un aveugle sous celles d’une auto.
— Admettons. Je crois que l’I.S. s’est montré singulièrement cavalier avec moi. Depuis le début, les gars ont décrypté le message, mais ils ont feint de se fourvoyer en me faisant porter le balla afin d’avoir les coudées franches ici.
— C’est possible ; je connais mal l’affaire, je ne suis qu’un rouage.
A propos de rouage, elle est drôlement en train de remonter le mien ; elle va faire péter le ressort si elle continue à s’activer de la sorte ! Mince de vigoureuse ! Le champignon, médème, faut pas lui en promettre ! Avec sa pomme, tu peux pas te faire remplacer par une banane Chiquita. Et la voilà qui moule la converse pour me tutuyer l’invertébré ! A bout portant !
Je sors les aérofreins et le parachute de secours. D’un ton pâlot, je demande :
— Bob et Maggy, raconte !
— Mouaggy hé hune fouille wa naous ! consent-elle à expliquer laborieusement.
Merde, une femme de cette classe ! sa maman qui lui a mis le pied à l’étrier ne lui a donc jamais dit que c’était pas poli de causer la bouche pleine !
— Maggy est une fille à vous ? traduis-je de la pipe.
— Mwoui.
— Elle surveille l’équipe de France, si je puis me permettre un tel calembour au moment ou tu satisfais à la fois mes sens et ma curiosité ?
— Mrn-waoui. Hmmmm !
Comme l’a dit le grand Pierre Dac : « Il ne faut jamais faire le jour même ce que tu peux faire faire par un autre le lendemain. » Au lieu de pousser l’interrogatoire, je me laisse embarquer pour un deuxième tour de circuit.
En plein radada, si ce n’est pas honteux !
Au moment précis où j’exécute à Anny le coup du postier vaudois ! Une cuisse au-dessus de tout soupçon ! Au plus fort de la partie, alors que je mène quatre jeux à deux dans le troisième sexe après avoir remporté les deux premiers !
Elle est là, la pauvrette, emperlée de la plus radieuse, de la plus émouvante des sueurs, quand ma porte s’ouvre sans fracas, mais avec décision. Trois mectons sont laguches : le garçon d’étage qui vient de jouer son petit solo de passe-partout, un grand pustuleux à moustache de rat asthénique, captivé par la manière dont se pratique le coït franco-helvétique ; plus deux balaises taillés dans un bloc de fonte, et que tu croirais, l’un et l’autre, la caricature de John Wayne réalisée par mes trois chers mousquetaires Mulatier, Morchoisne, Ricord, les empereurs du dessin déformant.
Les balaises s’avancent du pas appuyé de deux mecs voulant neutraliser un début d’incendie à la moquette. Ils s’approchent de mon pageot plein d’amour et de poils. L’un d’eux sort une plaque de sa poche.
— Agent fédéral Robson, il dit, juste avec le nez, sans se servir de sa bouche, dont il a besoin pour mâcher son chewing-gum.
Le préposé scrofuleux s’approche en catiminette, admirer la manière impec qu’elle se faisait chibrer, Anny. Lui, il n’a vu ça, jusqu’à présent, que dans des dessins animés pornos ; mais il trouve la réalité autrement plus attrayante.
Le copain à l’agent fédéral Robson va cueillir les fringues de ma partenaire sur le fauteuil où elles pêle-mêlaient dans un désordre suggestif ; il les jette sur le lit.
— Je ne sais pas où vous en êtes de la corrida, fait-il, mais si vous vous appelez bien Anny Etoilet, grouillez-vous de prendre votre pied et suivez-nous.
Au lieu d’une plaque, lui, c’est un document qu’il produit. Le district machinchouette le mande d’arrêter ma petite citoyenne Bourremiche dans les meilleurs délais.
— Voyons, voyons, interviens-je, vous allez nous expliquer un peu de quoi il retourne, non ?
— Non, répond le balaise. Sortez de cette dame, qu’elle puisse remettre sa culotte, et occupez-vous de vos propres oignons.
— Vous pourriez au moins vous retourner ! lance Anny, furieuse.
— Si on se retournait quand on vient arrêter quelqu’un, il y a longtemps qu’on nous aurait sacqués, annonce Robson.
Il change sa gum de côté, pas causer une surchauffe à ses gencives, et coule un pouce dans sa ceinture, pile comme dans les cow-boyculteries que les cons se précipitent dessus, même si t’as le président qui cause sur une autre chaîne, ce qui, pourtant, est bien plus marrant.
Ma chère partenaire se loque avec un maximum de célérité et de discrétion.
— Un malentendu, j’espère ? lui lancé-je.
Elle ne me répond pas. Soudain j’ai l’impression qu’elle m’a oublié et que je ne compte plus pour elle. Ingratitude féminine. Oh ! les cruelles auxquelles un bidet suffit à apporter l’oubli.
La petite troupe s’en va.
Poliment j’escorte.
Et qu’aspers-je dans le couloir ? Maggy, en larmes entre deux autres balaises qui doivent sortir de la même manufacture de fédés que « les nôtres ».
Emballage en série ! Est-ce consécutif à l’assassinat de Bob ? En ce cas pourquoi ne m’arrête-t-on pas également ?
Plus j’avance dans ce tas de sable, moins je pige. Comme quoi j’aurais dû acheter un bureau de tabac au lieu de faire flic. On perd sa vie à galoper. Les seuls réels vivants de la planète, ce sont les paysans. Ils croissent et meurent où ils sont nés, y a pas de déperdition ; chaque seconde conduit à la suivante en empruntant le même chemin. Ils regardent pisser la fontaine, brunir les feuilles, couler le ciel et ils vivent pleinement le présent, sans attendre le moment d’aller ailleurs. La faim et le sommeil sont leurs seuls maîtres bienveillants. Ils n’ont peur que pour les récoltes et ne se laissent intimider que par la foudre qui pourrait tomber sur leur paille.
Partir, c’est mourir un peu. Moi, je ne fais que partir, donc que mourir beaucoup ; et quand la vraie mort viendra, je lui dirai : « J’ai déjà donné, mais prends le reste. » Mourir à tempérament, mon vieux, c’est tristounet, je te le dis. Ce qui ne pardonne pas, c’est les intérêts.
Ma cambre, soudain, devient bien grande. La solitude surdimensionne.
Que faire ?
Dormir ? Non, merci, il n’en est pas question, malgré ma fatigue délabrante. Je sifflote Long alone. Très jolie mélodie, compagne de l’âme. Je devrais plutôt fredonner Il est cocu, le chef de gare, parce que enfin, le général Blackcat m’a franchement pris pour un trou, comme dit le gynécologue de Jacques Chazot. Inscrivez « pas drôle » au tableau d’affichage et offrez-moi une soupe !
J’étais la chevrette innocente lancée dans les pattounes de la horde de loups ! Et tout le monde me guignait, tout le monde voulait neutraliser l’Antonio d’une manière ou d’une autre : par balles ou volupté. Comment suis-je encore sur mes cannes ? Si je ne bénéficiais pas d’une protection occulte, tu pourrais sortir ton mouchoir et faire dire des messes à ma mémoire.
Mais qu’est-ce qui fait courir l’Antonio, dis, ma belle ? La carotte ? Elle est chouette, non ? Tiens, tu peux te la caser où tu veux.
Je m’abandonne entre les bras d’un fauteuil et attire le bigophone à moi. Quelle heure est-il à Paris ? Je visionne ma Rolex, fais un prompt calcul mental et conclus qu’il doit être environ 16 heures à la pendule de notre salon. C’est l’heure où Félicie commence à préparer les tartines de Toinet qui va rentrer de l’école. Il adore le pain de campagne beurré demi-sel et s’en engloutit trois ou quatre à son goûter.
J’entends la sonnerie de notre téléphone, la reconnais. Et le souffle de M’man, avant sa voix…
— Allô !
Je la laisse prononcer deux ou trois « Allô », par plaisir. Et je ne saurais t’expliquer ce qui motive cette allégresse ; si, attends : peut-être de savoir qu’elle est là, qu’elle vit ? Le bonheur, c’est une impulsion brève et intense.
— Ça va, la vie, ma chérie ?
— Oh ! Antoine. Où es-tu ?
— A San Antonio.
— San Antonio, Texas ?
— Textuel !
— Que fais-tu, là-bas ?
— Je passe pour un con, sauf le respect que je te dois.
— Ça m’étonnerait, c’est pas ton genre.
— Tu te rappelles le jour où l’on a retrouvé une petite auto Dinky Toy de Toinet dans ta purée mousseline ?
Elle réagit encore comme le fameux soir évoqué (on avait du monde à table et ma pauvre Félicie a failli mourir de honte).
— Ne me parle pas de ça, je…
— Eh bien, tu vois, M’man, je me sens aussi incongru à San Antonio que l’était la petite Triumph rouge dans ta purée.
— En ce cas, rentre.
— Ce serait m’avouer vaincu.
— On ne peut pas toujours gagner, mon grand. Savoir accepter sa défaite est parfois une forme de victoire.
Un temps ; elle me sent inconvaincu.
— Tu préparais les tartines d’Antoine ? je demande.
— Il les a mangées depuis longtemps, il est déjà six heures moins dix.
— C’est curieux, ma montre déconne depuis deux jours.
— Les montres tombent malades comme les gens, remarque ma brave femme de mère.
Pourquoi me mets-je à évoquer la fausse femme de chambre jaune morte depuis ? Parce que j’étais assis dans ce fauteuil à l’instant où elle est entrée, portant le linge de toilette ?
Qu’est-ce qui a motivé sa venue ? Elle ne voulait pas perquisitionner puisque je me trouvais dans la pièce. Elle n’a rien déposé de fâcheux : bombe ou micro, puisque j’ai fouillé minutieusement après son départ sans rien découvrir. Néanmoins, peu de temps après sa venue, j’ai perdu conscience. Elle aurait largué un gaz avant de se retirer ? Un gaz retard, incolore et inodore ? Ça existe, ça ? Ou je l’invente ?
— Mon grand ! appelle Félicie.
— Oui, M’man, je suis toujours là ; pardonne-moi, je pensais à quelque chose.
— Tu comptes rentrer bientôt ?
— Demain, m’entends-je lui répondre.
— Evidemment tu ne peux pas me dire l’heure…
— Non, je n’ai même pas encore de billet de retour.
Le mieux c’est que tu prépares une daube. Froide, avec de la moutarde, c’est le pied !
Le pied !…
Je pense à Stocky, mort dans un accident d’avion, inhumé par les soins de l’entreprise P. J. France. Stocky, Pied, fin du message.
— A très vite, M’man. Embrasse Toinet et ne le laisse pas regarder la télé jusqu’à plus d’heure, sinon, demain, il ne sera même pas foutu de réciter sa table de multiplication par dix.
Bises, rebises. Déclic.
On frappe à ma porte. C’est le rat crevant de naguère, celui qui escortait les fédés et prenait ces jetons de présence mirifiques qui ont tant jeté l’émoi dans son slip.
Il tient un petit plateau d’argent plaqué cuivre de sa main blanchement gantée.
— Qu’est-ce que c’est ? m’informe-je.
— Les clés de votre voiture qu’on a ramenée, monsieur. Le voiturier l’a mise à la place 17 de notre parking.
Je me saisis du maigre trousseau. Subventionne le groom d’un dollar, pour ses œuvres, selon mon habitude.
— Merci, monsieur. Et je voulais vous dire bravo, pour tout à l’heure, c’était franchement réussi.
COUP DE GRÂCE
La chignole est là, à la place 17 annoncée prélavablement, comme dit Bérurier le Grand.
Je la défrime d’un regard suspicieux. Piégée ? M’étonnerait : le voiturier ne l’a-t-il pas remisée sans encombre ? D’ailleurs, il se la radine, avec sa casquette plate, sa chemise bleue portant sur la poche poitrine l’écusson de l’hôtel.
— Oui a ramené cette bagnole, fiston ? lui demandé-je en me fendant d’une nouvelle image (quand tu vis dans les palaces, tu prends mal au poignet à force d’effeuiller des liasses de talbins).
— Le négro d’un garage, m’sieur.
Il dit m’sieur en français dans le texte, à cause de mon accent qui le renseigne sur ma nationalité.
— Il n’a rien dit ?
— Non. Il aurait dû ?
La meilleure façon d’éluder une question, c’est de se grouiller d’en poser une autre.
— Vous connaissez le cimetière de Fort Makabee, fiston ?
— Sûr, ma pauvre grand-mère y a été enterrée l’année passée.
— Toutes mes condoléances, vieux ; et ça se trouve où ?
Il m’explique qu’on sort de la ville à l’est, et puis qu’on se dirige vers la nationale 90, mais qu’il faut surtout pas la prendre et s’enquiller dans un chemin sur la droite, tout bien, des trucs topographiques laborieux dont tu as oublié le début quand on a achevé de te fournir les explications. Je remercie, m’installe au volant de ma tire et décarre.
Il est bien honnête, P. J. France, somme toute. Me faire restituer cette chignole part d’un bon sentiment. Ce qui ne m’empêche pas de me garer sur le premier parkinge rencontré pour l’explorer en menus détails. Tout est O.K. On a même réparé la serrure du coffre que j’avais forcée et lustré la carrosserie, sans doute pour gommer la trace laissée par les mâchoires de la grue kidnappeuse.
Juste un truc : la montre du tableau de bord indique huit plombes, alors qu’il est midi cinquante. Pourtant, il me souvient qu’elle marchait parfaitement ; j’avais même été surpris de constater que ma tocante personnelle et cette pendule se trouvaient à l’unisson.
Ce serait ta pomme, tu ne prendrais pas garde à la chose. Mais un poulet pur fruit, lui, ça le fait tiquer. Je me dis qu’il n’y a aucune raison pour que deux montres en ordre de marche se foutent à déconner simultanément. Ou plutôt, si : il y a une raison. Et je dois la découvrir.
J’en suis là de ma décision, lorsqu’un nouveau vertigo me biche au débotté ; poum ! Heureusement que je suis à l’arrêt, sinon ç’allait être la catastrophe. Tu m’imagines, lancé plein tube sur une strasse et me vapant en une seconde, sans avoir le temps de décoller mon panard du champignon ? Prenez vos serpillières, les gars, pour venir éponger les vilaines taches !
Je m’affale sur la banquette et c’est là que je me retrouve beaucoup plus tard. La joue sur le velours synthétique. Il fait sombre. De la lumière électrique ruisselle sur mon pare-brise. Je perçois des ronflements de moteur. Je me sens bien, comme on l’est après un bon sommeil.
M’étant redressé, je redécouvre le parking. Mais il fait noye et des lampadaires dispensateurs d’une lumière cruellement blanche l’illuminent.
Boîte à musique ? Comme disent les Anglais pour demander l’heure. Ma breloque marque neuf heures.
Du soir, certes. Mais de quel soir ? Ai-je dormi huit ou trente-deux plombes ?
Mon ticket de parking va me l’apprendre. Ayant respiré largement l’air tiède de la nuit, je me dirige vers la sortie. Le préposé enquille mon carton dans son ordinateur qui se met à réclamer huit heures trente de redevance.
Bon, alors ça signifie quoi donc, ce bigntz, mon Tantonio si malin ? Hein, réponds quand je te cause ! Tu vas me dire ? Ben, dis, l’artiste ; mais dis vite, j’ai le bulbe qui fatigue, moi, à force d’à force.
Je palpe ma mornifle et démarre. Le péage du parking forme comme une voûte lumineuse. Et c’est de la lumière que jaillit la lumière. Dans une somptueuse fulgurance de mon génie[7] je comprends maintenant à quoi rime ce séjour prolongé dans le tunnel de mister France.
La station sans porte, mais brillamment éclairée, tu t’en souviens ou tu te la rappelles, non ? En fait, je suis prêt à te parier ce que j’ai vécu contre ce qui te reste à vivre, mon jeune ami, que ces tubes fluorescents ont des propriétés très particulières ; disons neutralisantes, pour le moins. Un séjour très prolongé dans cette bizarre lumière, et tu défuntes de ta belle mort, ou bien tu perds la mémoire définitivement. Ce truc est si puissant qu’il dérègle tes montres.
Et maintenant, la voiture qui a été, disons, fortement irradiée, m’a flanqué un retinton de digue-digue.
Dis, j’espère que c’est terminé, l’effet nazebroque ! Que je vais pouvoir y aller franco.
En route pour Fort Makabee !
Nous autres, Latins, les morts, on redoute qu’ils se taillent, alors on les claquemure. Tout de suite après les coffres bancaires, les orphelinats et les pénitenciers, t’as les cimetières dans l’ordre de la bouclarde.
Chez ces cons d’Anglo-Saxons, foin de hauts murs et de portails verrouillés à patron-minette, comme dit encore M. le directeur Alexandre-Benoît Bérurier, lequel, quand il est en verve, ne manque pas de déclarer : « Un bon conseil, mon gars : Choisy le Roy, Bourg-la-Reine et Jouy-en-Josas », ce qui est vraiment très très drôle, et pourquoi on irait chercher le midi à quatorze heures pour faire de l’esprit quand des saillies et autres boutades du premier degré (au-dessous de zéro) font pouffer ?
Le cimetière de Fort Makabee se niche dans un vallon verdoyant, complanté de cyprès et autres espèces relevant davantage de l’art funéraire que de l’arboriculture : buis, saule chialeur, etc. De simples dalles recouvrent les caveaux. Tout y est géométrique comme une ville ricaine neuve. C’est compartimenté en allées et en travées, avec des feux tricolores dans les carrefours les plus importants. Des squares y sont aménagés, pourvus de bancs et de lampadaires, il existe des aires de pique-nique, avec tables de pierre, blocs sanitaires, cabines téléphoniques, manèges pour les enfants, postes à essence, marchands de sandwiches, piscines.
C’est la mort de bonne compagnie.
J’abandonne ma tire soporifiante pour me repérer. Allée 45, m’a dit le préposé. Un plan en couleur, éclairé par une rampe de néon, est à la disposition du visiteur. Il ne me faut pas cinq minutes pour aboutir à la tombe de feu Stocky. Sobre pierre blanche où l’on a gravé l’essentiel de son curriculum vitré, à savoir son nom, l’année de sa naissance, celle de sa mort. Et que voudrais-tu ajouter, mon pauvre ami ? Il n’y a jamais rien de plus à dire sur un homme qui a cessé. Signaler qu’il fut est déjà une bien grande distinction, car point n’est besoin de renseigner qui reste sur qui est parti vu qu’ils sont désormais totalement étrangers l’un à l’autre.
Or, donc, mister Stocky gît là, sous cette dalle de ciment poli. Et il m’appartient de violer sa sépulture, histoire de m’assurer si elle abrite ou non un secret capable de déclencher tout le bordel qui précède.
Il va me falloir desceller la dalle et la soulever. Et moi, bonne pomme antoniaise, de me pointer mains aux poches, avec un canif à deux lames ; tu juges ?
« Heureusement, me dis-je, que tu disposes de la trousse d’outils de la Cadillac. Elle aura été à la peine, donc à l’honneur, dans cette aventure texane. »
Je m’en vais donc rassembler un max de matériel.
Dûment lesté, je reviens au labeur, dépose mon veston sur la tombe de Mary Krackett (1920–1981), et déballe ma panoplie sur celle de Steve Bheurgh (1913–1982).
Primo : torche électrique. J’inspecte le boulot à accomplir. Et alors je constate que le ciment scellant la dalle est tout frais. Je te parie le gros machin que je t’ai fait voir l’autre jour, ma chérie, contre le petit truc que tu m’as permis de caresser, que cette tombe a été ouverte depuis moins de quarante-huit heures.
La déception me défrise les poils sous les bras. Eh quoi ! Grillé, l’Antoine ? Coiffé au poteau rose ? Dieu, se peut-ce ?
Accablé, je dépose mes fesses sur la page de garde de Samuel (1908–1979).
A quoi bon entreprendre cette macabre besogne ? D’autres sont venus, ont cherché, trouvé, refermé. Et moi, pauvre de moi, je n’ai droit qu’aux restes, si je puis dire. Mon enquête tombe en cendres (celles du pauvre Mr. Stocky, que Dieu ait son âme et l’emmitoufle bien, le doux Seigneur).
Il ne me reste plus qu’à recoltiner mes outils jusqu’à la tuture et à m’emporter dans des contrées plus propices à mon épanouissement.
Seulement, telle la flamme qui veille dans le chœur de l’église, y assurant la permanence de l’Esprit Saint, une petite lueur d’espoir, pas plus hardie que la lumière d’un ver luisant dans la cathédrale de Dakar, subsiste au creux de ma déconfiture. En moi germe la question suivante : « Que ferait le président Mitterrand s’il était à ta place ? Et James Bond zéro zéro sept (ses six aînés sont dans le commerce de gros, eux aussi), et Tintin ? Hein ? » Force m’est de répondre qu’ils ne s’avoueraient pas vaincus, eux ; oh ! mais que non ! Tu les connais ?
« Bien, soupiré-je, y étant, je vais y rester. »
Me munis alors d’un fort tournevis et d’un marteau. Evidemment, ça irait plus vite avec un ouvre-tombes automatique ; le ciment a beau être frais, il faut tout de même le dépiauter sur tout le pourtour. Fortreusement, l’endroit est désert ; mieux : isolé. Je n’entends que la très lointaine rumeur de l’autoroute et aussi le jappement d’un coyote tenaillé par une bergerie.
J’interromps parfois ma besogne pour tendre l’oreille et filer un coup de périscope, mais mon qui-vive est vain ; alors je me remets au turbin.
Et enfin, après une bonne heure d’escrimance, j’ai détouré la pierre. A l’aide d’un démonte-pneu, je pratique un trou dans le sol, à dix centimètres de la dalle, je stabilise le fond du trou à l’aide d’un caillou plat (tu viendras pas te plaindre que j’esquive les explications) et pose le socle du cric sur le caillou, qu’ensuite j’incline l’outil pour que sa tête se loge sous le rebord de la pierre tombale, et puis me mets à le cigogner, façon pompiste du début de siècle. La dalle remue, s’écarte progressivement. Belle astuce ! Tu me surprendras toujours, Santantonio ! Tu es le king ! Le king des kongs ! Le roi des kings, voire à la limite, le roi des kongs, des Vikings et du Viêt-cong.
Donc, la dalle s’écarte suffisamment pour que je puisse la saisir et, en marc-boutant bien, la déplacer complètement, par saccades héroïques : Jean Valjean soulevant la charrette à l’essieu brisé pour sauver la vie d’un pauvre roulier, au nez et à la fausse barbe de l’impitoyable Javert, lequel devant l’exploit se dit : « Il n’est qu’un homme pour accomplir cet exploit : c’est l’ancien forçat du bagne de Toulon ! » Car il a passé sa carrière à traquer le malheureux Jean Valjean pourtant rédempté de bas en haut, le Javert. Faut dire que le délit initial à Valjean était de taille : il avait barboté un pain dans une boulangerie un jour de disette.
Moi, tu sais mon hugolâtrerie, mais merde, valait mieux qu’il écrivasse des pouèmes, Totor, plutôt que des Santonio, des A.D.G., des Gérard de Villiers, des Boileau-Narcejac. Comment qu’il se serait planté la gueule, Barbapoux, s’il avait pondu dans la chicorne voluptueuse, le coup de théâtre et tutti frutti (ou tutti chianti, si t’as soif).
Voleur de pain aux abois pendant des lustres ; identifié because il soulève un tombereau, y a pas de quoi se faire élire pair de France, ni paire de couilles, du point de vue phosphoraison. T’envoies ça à l’Eclaireur de la Pointe du Raz, le rédacteur en chef te le retourne en même temps qu’une baffe, non sans s’être torché en trois exemplaires avec ton bioutifoule papier pelure (d’oignon).
Mais enfin, quoi : autre étang, autre nurse, ça l’a pas empêché de best-sellerer, le vieux Vic, ni d’avoir sa poire sur les talbins de cinquante pions, comme moi bientôt. Tout ça, je t’en ai déjà causé, par ailleurs, et par-derrière, mais quand un truc me tracasse, j’hésite pas à le mettre en vitrine. Toujours bien se vider de ses préoccupations. Une vessie peut cacher une lanterne.
Etant délicat à outrance de nature, j’abstiens de te signaler la féroce odeur qui me saute au nez, aussi promptement que ta dame me saute au paf quand tu descends chercher la glace du dessert avant le repas. C’est à peine soutenable pour un type possédant un sens olfacpif (j’écris bien olfacpif) tellement surdéveloppé qu’il parvient à trouver des truffes dans les cervelas truffés de Jacques Borel.
Je m’applique à respirer avec la bouche, réservant mon nez à des parfums ultérieurs.
Le cercueil est en place, un gros machin d’acajou qui ressemble à une Lamborghini sans roues. C’est ici qu’il va falloir se recueillir et ne plus se lâcher, mon Tonio joli. Sale moment et qui ne servira peut-être à rien, mais nous autres, hommes d’action, avons également des obligations.
Je saute dans la fosse, heureusement cimentée. Il existe un intervalle d’une quarantaine de centimètres entre la bière et les parois. Suffisant ! Le faisçal de ma loupiote étudie le couvercle et je constate d’emblée qu’il a été dévissé et simplement reposé sur le coffrage par des gens pressés.
Courage, mon drôle. T’en as vu d’autres.
Hop ! Je biche le couvercle et le soulève. Lourdingue ! On lui a rien refusé pour son confort posthume, m’sieur Stocky. Tu peux affronter l’éternité dans un bolide commak. Il voyage cool, l’ancien conseiller de la Maison Withe.
Pour être extrêmement franc avec toi, ma poule, le spectacle n’est pas baisant le moindre. Même un film de Robbe-Grillet est plus hilarant. Oh ! dis donc, ce qu’il a morflé dans les gencives, ce gus ! D’abord il en manque. L’un de ses bras s’est fait la malle. Et puis tout le burlingue est éclaté. Et le bas de frite est également porté disparu. Sa physionomie commence deux centimètres au-dessous du tarin.
A l’entreprise P. J. France, ils ont essayé de rebecter un peu l’ensemble avec des sparadraps spéciaux, des fards, des mastics, mais dans un sens, ça aggrave presque le cas du mort, lui donne un côté Frankenstein loupé. Tu vas dire que j’en remets, fillette, que je complais dans le sinistros, que je deviens morbide (toi, si mordbite), juste je rends compte de la vérité vraie. Tu voudrais quoi-ce ? Que j’entonne l’hymne au Printemps ? Que je cause pervenche, piafs mutins, aube claire ? T’oublies que je suis en train de bricoler dans un sépulcre, ma jolie.
Nonobstant l’horreur insoutenable (tu le ferais, toi, en pleine nuit ?), je procède à l’examen dont pour lequel j’ai venu, comme dirait m’sieur l’nouveau directeur.
La lumière blanche de ma torche descend le long du cadavre mutilé. Jusqu’aux godasses. L’une d’elles se trouve simplement là pour mémoire. Y a rien dedans, car il manque un pattounet à Stocky, officier de marine blessé aux Philippines (et à la jambe).
J’ai le courage d’ôter la chaussette flasque du bas. Un moignon depuis lurette cicatrisé m’apparaît. Il est clair que Stocky portait une prothèse, il reste une sangle au-dessus de son mollet.
C’est ce pied bidon qu’on est venu prélever dans cette tombe, avant que je m’y pointe.
Fin du message : « Stocky Pied ».
Ce pied, j’ai la pénible sensation que le mort s’en sert encore pour me botter le cul.
COUP DU CIEL (ou de génie)
Franchement, je veux pas donner dans le shakespearien, encore que je raffole du grand Willy, mais un qui chasserait le ver luisant et m’apercevrait, assis sur le bord de la tombe ouverte, le front sur le poing, le coude sur le genou, me prendrait sec pour Hamlet (dont le toubib n’existe pas).
Je fais donc le point sur mon poing, à la pâle clarté qui tombe des étoiles (merde, v’là que je bascule dans Corneille), le cœur plus lourd que cette dalle déplacée. N’est-il pas grand temps de forcer l’obscurité sépulcrale de cette histoire pour, enfin, trouver un peu de clarté vivifiante ? Non, mais réponds quand je t’interpelle, Acharbon !
Schématiser. Résumer l’affaire. Et puis se reculer pour juger de l’effet. Ne pas avoir peur de ressasser. La râbache a du bon, parfois. Il faut se débarrasser du texte pour pouvoir le bien jouer ; donc, l’apprendre par cœur. Apprenons par cœur les données du problème.
Un diplomate indien, en poste à Moscou, a découvert quelque chose de terriblement important et prend langue avec un diplomate anglais. Aussitôt il est arrêté par les Services soviétiques.
Après une brève période de détention, on le retrouve à Zurich, dans le train d’atterrissage d’un jet, il est agonisant et ne survivra pas. Il porte sur lui un message écrit avec son sang et adressé à l’I.S. britannique : Prévenir P. J. France ; San Antonio V 818 Stocky Pied.
Les Rosbifs ne peuvent ignorer de quoi il s’agit, c’est-à-dire de la mort dans l’accident du vol 818 d’un nommé Stocky, ex-collaborateur d’un président américain, porteur d’un pied articulé à la suite d’une grave blessure de guerre.
Pourtant ces bons amis jouent à me faire croire que je suis concerné et me lancent sur le sentier de la guerre, sachant bien que le San Antonio du message se rapporte à la ville texane et non à moi.
Manœuvre de diversion ? Pour jouer au plus marle avec l’adversaire ?
En somme, il existe six éléments majeurs derrière ce rideau de brume : Stone-Kiroul, les Russes, les Britiches, les Nord-Coréens, P. J. France et Stocky dont les restes gisent à l’intérieur d’un superbe cercueil carrossé par Bertone.
De toute évidence, les Russes se sont servis de Stone-Kiroul pour amorcer un coup fumant, le message a été conçu par eux, mais dans quelles perspectives ? Les Anglais ont feint d’être appâtés, mais pour berner qui ? P. J. France appartient à quel bord ? Que cherchent les Nord-Coréens dans l’aventure ? Pourquoi a-t-on assassiné le colonel Müller ? Que recelait la prothèse pattounarde de Stocky ? Et qui s’en est emparé ? Pourquoi les fédés ont-ils arrêté Maggy et Anny ?
Le mec qui répondrait à ces différentes questions aurait droit à mon respect, à une boîte de préservatifs et à la liste exhaustive des radars disposés sur le territoire français.
On s’habitue aux pires désagréments. L’odeur affreuse montant de la fosse ne me chavire plus. Elle est motif de réflexions sereines, au contraire, quant à notre devenir. Pourquoi dit-on « ils » en parlant des morts, alors que nous sommes en puissance ces « ils » ? La nation des anéantis n’existe pas ailleurs qu’en nous-mêmes ; c’est une espèce de diaspora irréfutable. Nous appartenons à la race Mort, impossible de s’insurger ; on ne peut refuser d’être blanc ou noir.
Dans le fond, le dénominateur commun à tous ces éléments, n’est-ce pas P. J. France ? C’est lui qu’on retrouve partout : sur le message d’abord, ensuite Stocky a été enseveli par ses soins, il a dans l’une de ses entreprises un couple travaillant pour des services secrets (Bob et Maggy), la belle Anny Etoilet vient draguer dans son secteur ; les Nord-Coréens également, et San-Antonio avec tiret idem. Alors ?
Stocky Pied.
Quel lien existait-il entre les deux morts ? Stone-Kiroul et Stocky, en dehors du « S » de leur initiale patronymique ?
Coup de pied à suivre !
Bon, je ne vais pas passer mes vacances au bord de cette fosse pestilentielle. Il s’agit de remettre le couvercle sur la boîte à dominos.
Oh ! hisse ! Je recommence à m’escrimer ; sûr que demain j’aurai un tour de reins. J’agis en grande détresse. Mon désarroi augmente au fur et à mesure que la lourde pierre rampe sur l’ouverture. Il me semble que le mort m’appelle, qu’il a quelque chose à me confier. Des ténèbres abominables monte un cri muet : « Attends, pars pas, insiste, j’ai un secret à te confier. Lorsque tu auras obstrué ce trou, il sera trop tard, trop tard pour toujours ! »
Idiot, non ?
Pas tant, l’ami ; pas tant ! L’intuition est la voix de la vraie raison, celle qui est enfouie au creux de nous, emmitouflée dans le subconscient, et qui se manifeste dans les moments d’exception pour nous chuchoter des certitudes.
Alors, soit. J’interromps ma besogne, et qui plus est, je refoule la dalle pour mieux dégager la dernière demeure de Stocky. Officier héroïque, mister Stocky : bataille des Philippines, blessé, devient conseiller à Washington. Il conseillait quoi, au Président ?
Je braque ma loupiote sur la tête horrible du défunt, saccagée et mal rafistolée avec des matériaux de misère. Car rien ne remplace la viande humaine, elle n’est pas copiable.
« Eh bien, mister Stocky, allez-y, je vous écoute. Je suis venu de Paris pour obtenir vos confidences. »
J’ai le calme courage de regarder cette tête sinistrée, tentant de lui restituer par un effort d’imagination, son apparence d’avant l’accident.
Je crois le capter à peu près, un peu comme on recherche sur les traits d’une vieillarde endommagée sa frimousse de jeune fille.
Le gros handicap, c’est que j’ignore tout de lui, ou presque. Il a fini par surgir à ma connaissance au cours de mes errements. Ancien officier blessé pendant la guerre dans les Philippines, se convertit ensuite dans les affaires diplomatiques occultes et devient même important à un certain moment de sa carrière ; mort dans un accident d’avion. Cet accident le visait-il ? Hypothèse à ne pas écarter, le nombre de gens qui sont morts pour s’être simplement trouvés dans la même charrette qu’un type à liquider !…
Son pied articulé recelait quelque chose de capital : des documents, pour user du mot magique qui couvre tout et ouvre les lourdes à l’aventure. Documents ! Qui lui a piqué son panard bidon ? France ou les Coréens ? J’inclinerais plutôt à penser que ce sont les Jaunes. Stocky, ou plutôt son cadavre, s’est trouvé à la disposition de P. J. France. Ce dernier a eu tout le temps de prélever le nougat articulé du défunt. Pas besoin de rouvrir sa tombe ! Donc, si les Coréens se sont livrés avant moi à cette macabre opération, ils ont dû être bités puisque P. J. France était passé par là.
« Bien vrai, M. Stocky, vous ne voulez rien me dire ? »
Le coyote continue de japper dans les confins. Il a les crocs, l’ami. Le mouton l’empêche de roupiller. Mais le mouton dort, repu, car lui est plein d’herbe. Les hommes le nourrissent et le mettent à l’abri du coyote pour pouvoir le bouffer eux-mêmes. Pauvre coyote aux abois (ou plutôt au jappage) sous la lune texane.
Pauvre Sanantonio qui joue Hamlet (au lard) au bord d’un trou de mort. Et qui veut piger, mais qui ne pige pas. Qui est bloqué, merdiquement. Pourtant, il a de belles méninges, Antoine, non ? Pourquoi sont-elles boueuses, cette nuit ? Elles grippent piteusement. La gamberge s’enclenche mal. Et pourtant je possède toutes les données fondamentales, dirait un politicard. Ils aiment bien ces deux mots chez les marchands de promesses : données fondamentales. Le bon populo gobe bien, ça l’impressionne, kif les enzymes suractivés ; comme quoi fallait continuer de dire la messe en latin ! Quand je les vois en grande déconnance, tous, les bras m’en choient. Un Giscard élu à une poignée de voix et qui s’empresse d’abaisser le droit de vote à dix-huit ans pour être bien certain de ne pas être réélu, le clergé en rémoulade qui dit la messe en français, pour convaincre les fidèles que c’était seulement l’idée qu’ils s’en faisaient ! Y a un grand souffle suicidaire de par le monde, moi je dis. On était déjà des équilibristes, et voilà qu’on refuse le balancier ! On veut y aller, quoi. Où ça ? On l’ignore. Mais y aller en vitesse. Le grand tourment universel, c’est le besoin de plonger. On est devenus des défenestrés ; les plus lourds passent devant les plus légers. En les doublant ils leur lancent, gentiment : « Alors, ça tombe ? » Et les autres répondent, guillerets : « Ça tombe, vous voyez. » « Bon écrasement ! » « Vous de même ! » C’est con des parachutistes sans parachute.
Oui, les données fondamentales, pour t’en revenir, je les ai à dispose.
Stone-Kiroul annonce aux Britannouilles qu’il va leur écrémer un truc formide. Il se fait arrêter presque immédiatement. Je sais, je t’ai déjà mouliné tout ça ; on boléroderavelle en couronne, mais faut ! Il s’évade prétendument, se love prétendument dans le train d’atterrissage d’un Tupolev, en meurt, mais laisse un message rédigé avec une écharde de bois en guise de plume et son sang en guise d’encre. Je retrouve ma blague du monsieur nu dans le placard. Si tu crois vraiment qu’il a échappé au Guépéou, qu’il a pu gagner l’aéroport de Moscou et se nicher dans un zinc, moi j’attends le métro ! Donc… Donc… Oh ! merde ! Ça y est, bouge pas, je pige…
Oui, le voile se déchire, comme disait Isadora Duncan dans sa belle torpédo[8].
Un élément fondamental, issu des données fondamentales.
Les Russes ont eux-mêmes organisé l’évasion, le départ, la rédaction du message. Espéraient-ils abuser l’Intelligence Service ? Impossible. Alors ? Eh bien, alors, tout cela signifie que Russes et Anglais étaient de connivence. Il s’agit d’une énorme machination réalisée en commun. Pour abuser qui ? Les Asiatiques ? Probable. Fatal ! Et on m’a parachuté dans l’affaire pour donner de la substance à la chose, faire accroire aux Jaunes que l’I.S. prenait la chose à cœur et mordait à l’hameçon.
En somme, tout s’est passé comme si, au fil des choses, on avait voulu amener les Coréens à venir chercher le pied articulé de Stocky dans sa tombe.
Tant pis pour les meurtres, qu’importe qu’on trucide San-Antonio et que le chef du Renseignement suisse laisse sa peau dans l’aventure (il possédait un dossier P. J. France, ne l’oublie pas.) Sans doute, le bon général Blackcat s’est-il servi du colonel Müller comme il s’est servi de moi, afin d’étoffer un dossier qui n’existait pas. Et, pour une raison « X » (les meilleures), les choses ont tourné plus mal pour Müller que pour moi. Le grain de sable. L’accident imprévu. Il ne s’est pas trouvé un connard de Jean Rameau pour déguster le potage à sa place, Müller.
Le chat et la souris. C’est la bande des Asiatiques qui a été manipulée par les Ruscofs et les Rosbifs. Elle s’est intercalée entre deux antagonistes supposés pour tenter, à tout prix, de tirer les marrons du feu. Et c’est ce qu’on voulait qu’elle fît ! Les marrons, c’est, en l’occurrence, une prothèse. Donc, à l’heure où je gamberge assis sur cette tombe, Russes et Britanniques ont gagné le canard. Ils sont parvenus à leurs fins. P. J. France appartient à quelle équipe ? La blanche et rouge ou la jaune ? A moins qu’il ne soit le gardien de but d’une troisième ?
J’expectate donc sur ces derniers points, me demandant si je dois plier mes cannes à pêche et rentrer chez moi, ainsi que je l’ai promis à maman, ou bien si je persévère encore dans la bulle de savon et la cimetière party by night.
Une dernière fois j’essaie d’interviewer le défunt.
Sa tête mal ravaudée, histoire d’escamoter ses plus cruelles abîmures, est énigmatique. Je note qu’il porte les cheveux en brosse coupés assez court. Il est brun très foncé, mais ses favoris sont presque blancs de même que la barbe qui a dû pousser depuis sa mort. Dame, un héros de la dernière, ça traîne du carat. Le temps galope, emporte tout. Encore vergif d’avoir des tifs à plus de soixante-cinq balais. Il se teignait, le valeureux militaire en retraite, pour tenter d’enrayer l’irréparable outrage. Ça me rappelle quand, mouflet, je freinais mon vélo dépenaillé en frottant le pied contre la roue avant dans les descentes. Que de bûches dont ma viande ne se souvient plus mais qui ont éraflé à jamais ma mémoire !
Pour quelle raison Russes et Britiches ont-ils tout mis en œuvre, diaboliquement, pour que les Jaunes (couleur du souci) viennent récupérer ce pied mécanique dans une tombe ? Stocky a-t-il servi de bouc émissaire ? Essayons de piger le développement de la manœuvre, vu des plus hauts sommets.
Tout s’est déroulé comme une ténébreuse affaire opposant les Soviétiques et les sujets (de mécontentement) de Sa Grassouillette Majesté Mme Deux. Il convenait en effet de donner l’impression à l’équipe canari d’une bataille de l’ombre entre les services secrets de ces deux nations. Va-t’en même savoir si le tireur de l’autoroute ne jouait pas dans l’équipe anglaise ? Toujours est-il que la monumentale feinte a parfaitement réussi et que tout s’est déporté sur le cadavre de Stocky.
Et me voici tout égrotant au bord de sa tombe, à contempler sa triste dépouille dans le faisceau d’une lampe électrique. Dis, je ne vais pas attendre le chant du coq ?
« Navré de vous avoir importuné, mister Stocky. Je vous dis adieu et je remets votre couvercle ; bonne éternité ! »
Stocky ne répond rien. D’abord il n’a plus de bouche, plus de menton.
Pourtant, il a quelque chose à m’apprendre ! Je le sens, je le sais !
A nouveau, je saute dans le sépulcre. Le mort en partance pour la décomposition ne m’incommode même plus. Je défais ses fringues comme j’agirais dans un cauchemar, sans répugnance, au ralenti, avec des gestes aériens. Une rage m’empare. La vérité ! La vérité toute nue ! Le cadavre tout nu. Bon, il y avait ce pied artificiel, mais ça, c’était la poudre aux yeux bridés, le piège à cons. Le secret est ailleurs.
M’aidant d’un couteau effilé, je sectionne les hardes qui me résistent. Et bientôt je découvre un abominable pot aux roses, si tu me permets d’appeler cela des roses !
Le pauvre Stocky a été charcuté de partout, puis hâtivement rafistolé avec des plaques de sparadrap. On l’a plus qu’autopsié : émietté. Il est vidé, fouillé jusqu’au plus profond de sa chair. On a même pratiqué des incisions dans les cuisses, le bras restant, les fesses, le dos. Cet ignoble tailladage en fait une sorte de loque de chair qui se répand lorsqu’on a achevé d’ôter les bandes adhésives. Travail minutieux ! C’est la première fois de ma prestigieuse carrière que je vois un corps ainsi inventorié, fouillé comme un appartement.
Alors là, mon pote Sana, dis-toi bien qu’on n’a pas perpétré une telle besogne dans cette tombe, à la sauvette. Il a fallu un labo. Et comment qu’il a été passé aux rayons « X », Mr. Pied-de-Fer, et puis incisé, examiné dans toutes ses profondeurs. Ça, c’est l’œuvre de la Maison P. J. France. Le dépeceur a-t-il déniché ce qu’il cherchait ? C’est probable, ou alors ce qu’il voulait dénicher ne se trouvait pas dans la carcasse de Stocky.
A demi dingue, je me jette hors de la tombe. Bon, qu’elle demeure ouverte, ce sera ma manière de venger ce pauvre mort. Demain, on donnera l’alarme, la police se pointera, on constatera les mutilations infligées au cadavre et la funeral house de Mr. France aura maille à partir avec les poulardins d’ici.
Salut, Stocky, m’est avis que tu auras eu un destin pas piqué des charançons.
Je cavale jusqu’à ma Cad’. Je suis effrayé par la puanteur accrochée à mes fringues. J’ai hâte de balancer mes effets dans un vide-ordures et de plonger pendant une plombe dans l’eau saturée d’O Bao d’un bain brûlant. Dire qu’un jour, cette odeur sera la mienne. La tienne. Là nôtre. T’es content ?
COUP POUR COUP
A l’horizon, le ciel, bien qu’il fasse nuit est d’une blancheur émasculée (comme dit Bérurier Il). Une certaine fraîcheur me fait frissonner, mais n’est-ce point la conséquence de mon séjour au sépulcre ? La Vénus-de-mille-os, dis, ça suffit !
Je rallie ma Cadillac et m’y engouffre avec tant de précipitation que je suis déjà assis lorsque je m’avise qu’elle est pleine de monde. Se trouvent à l’intérieur trois personnes de sexe officiellement masculin, mais le doute plane puisqu’il s’agit de P. J. France, flanqué de son petit camarade et d’un gorille sang-mêlé avec une nette dominante indienne. Mr. France occupe le siège passager et une paire de jumelles pend sur sa bonbonne, son giton bouffe un chocolat fourré pour se faire les lèvres, quant au gorille, il berce dans le pli de son bras gauche un chouette pistolet tout neuf, de grande marque, ça tu peux y compter.
— Alors, ces recherches, mister commissaire ? demande France.
— Désagréables et inutiles, réponds-je.
Le gros barbu se bouche le nez.
— Vous traînez une odeur épouvantable ! s’exclame-t-il.
— C’est que je ne rentre pas de la roseraie de Bagatelle, mister France.
Je lui montre ses jumelles.
— A infrarouge, je suppose ?
— Naturellement, la nuit…
— Je suis bien aise de vous revoir, vous ne pouvez savoir combien je pensais à vous au cours de ces dernières heures.
— Et vous y pensiez comment, mister commissaire ?
— J’y pensais en forme de crosse épiscopale ; votre nom, dans mon esprit, se dresse au milieu d’un champ de points d’interrogation.
Il rit. Je note que le revers de sa veste de velours noir s’orne du ruban de la Légion d’honneur (tout l’honneur est pour moi qui ne l’aurai jamais). France caresse la dentelle froufroutante de son jabot Grand Siècle.
— Le jour où je me suis rendu chez vous, vous connaissiez ma fonction ?
— Je l’ai su pendant que vous étiez au bord de la piscine, en arrivant. Votre image est partie par bélino à un certain endroit ou l’on connaît à peu près tout le monde.
Il rit à nouveau.
— Vous êtes un coriace ; c’est la première fois que quelqu’un s’évade de mon souterrain magique.
— Parce que vous n’y avez accueilli que des podagres sans doute, ce fut un jeu d’enfant. A propos, vous savez que le traitement par rayons m’a sérieusement perturbé ? Il faut combien de temps pour qu’un gars défunte pour de bon ?
— C’est variable selon sa résistance physique. Vingt-quatre heures constituent la bonne moyenne. Comment avez-vous su, pour ces foutus rayons ?
— En faisant fonctionner ma cervelle. Nous disposons tous d’un ordinateur personnel, il suffit d’y fourrer des données et il vous restitue des conclusions.
— Bravo !
— Je vous en prie.
— Que cherchiez-vous dans cette tombe ?
— La vérité sur une affaire dans laquelle on m’a embarqué de force.
— L’avez-vous trouvée ?
Je regarde France. Il ne sourit plus, son œil est devenu très dur, incisif. Il a perdu son attitude de gros désœuvré farfelu ; l’espace d’un instant, on découvre l’homme d’action déterminé et impitoyable.
A la lumière dont il me questionne, à cause de cette âpreté dans sa voix, je me dis que s’il me pose une telle question, c’est que lui non plus n’a pas déniché ce qu’il espérait. Et cette brusque certitude me comble d’aise.
— Non, dis-je en le prenant bien aux yeux ; non, mister France, je n’ai pas trouvé. J’ai pigé pas mal de choses au bord de ce caveau, mais la clé de la dernière porte est restée dans la poche du linceul.
— Vous avez compris quoi, mister commissaire ?
— Un instant, fais-je. Avant de bavarder, j’aimerais savoir quelles sont vos intentions. Si, à l’issue de l’entretien, votre délicat porte-coton doit me vider dans la tête le contenu de son chargeur, je préfère me recueillir ; priorité à Dieu, vous ne me convaincrez pas du contraire !
— Pourquoi vous tuerait-on, mister commissaire ?
— Pour me faire oublier ce que j’ai appris, par exemple ; voire plus simplement parce que ma tête déplaît ; le nombre de gens qui sont morts pour un grain de beauté mal placé ou un léger strabisme… Quand un homme braque un pistolet sur un autre, il suffit d’un battement de cils inopportun pour lui faire presser la détente.
— Soyez sans inquiétude, me répond P. J. France, je n’entreprendrai rien de fâcheux contre vous.
— Pourtant, vous avez cherché à me faire le coup du tunnel ?
— Oui, mais vous vous en êtes sorti et je suppose que dans l’intervalle, vous avez communiqué avec vos copains de Paris ou d’ailleurs. Je me suis arrangé pour qu’on arrête Maggy et la Suissesse, mais on vous a laissé en pleine liberté. Notre intérêt, désormais, est que vous gardiez un bon souvenir, mister commissaire.
Il prononce commissaire en français. C’est attendrissant ce gros bébé barbu qui vient manier notre patois moliéresque et montaigneux. On dirait un veau qui vient d’avaler de traviole.
— Alors, donnez-moi une nouvelle preuve de votre bienveillance, et remisez la pétoire de votre sbire dans la boîte à gants : on ne tourne pas un remake des Incorruptibles !
En souriant, France tend la main en arrière :
— Le feu ! enjoint-il.
Le gorille le lui remet avec autant de complaisance qu’un ours en met à restituer un pot de miel. Le gros pédoque ouvre la boîte à gants et y fourre la pétoire.
— Heureux ? me dit-il.
— S’il n’en existe pas d’autres spécimens en vadrouille dans vos poches, disons que je me sens soulagé.
— O.K., alors allons bavarder dans un endroit plus convenable.
— Hé ! minute, mister France, je trouve cette voiture tout à fait apte à nous servir de salle de conférences.
— Filons en tout cas dans un lieu plus réjouissant, riposte P. J. France.
Puis, à l’Indien :
— Va dire aux autres de remettre cette foutue pierre tombale en place, je veux du travail impec.
Docile, le gorille cuivré descend de ma tire et se dirige à grandes enjambées vers une haie, derrière laquelle, je m’en aperçois seulement, stationne l’une des Rolls du barbu.
— Vous pouvez démarrer, me dit ce dernier.
— Où allons-nous ?
Il a un geste de prélat.
— Peu importe, puisque vous refusez mon hospitalité. A vous de décider.
Je mets le jus et décarre. De fréquents regards dans le rétroviseur m’informent que nous ne sommes pas suivis. Est-il décidé à jouer franc jeu ? Je suis dans l’équivoque (que d’autres nomment aussi l’expectative, mais c’est un peu plus cher et je ne voudrais pas te pousser à la consommation). Que ces gens m’aient surveillé, cela va de soi, compte tenu de tout ce qui précède. Qu’ils veuillent s’assurer que j’ai fait chou noir en explorant le cadavre, c’est la moindre des choses ; mais qu’ils engagent un dialogue, voilà qui me paraît plus aléatoire, car celui-ci s’opérerait à sens unique. En effet, ils savent à peu près tout de moi et moi j’ignore à peu près tout d’eux ; il n’y a donc aucune raison pour qu’ils me fassent des confidences, à moi, flic français parachuté dans leurs manigances. Mais ces deux grosses pédales oseraient-elles s’attaquer toutes seules à superman Tonio, alors qu’il est au volant de la bagnole ? Lui laisseraient-elles l’initiative de la direction à prendre ?
Je surveille le gros petit ami de P. J. France, redoutant de ce vilain soufflé quelque arnaque vicieuse. Il est tranquille pour l’instant.
J’arrive à l’extrémité de la petite route poussiéreuse qui rejoint la nationale et décide de piquer sur San Antonio. J’ai déjà mis mes clignotants, lorsque j’avise un barrage de police. Ils sont une demi-douzaine de poulardins, avec des motos et une chignole pourvue d’un feu giratoire qui éclaire tout l’horizon jusqu’au Nouveau-Mexique. Une chaîne hérissée de piquants acérés est tendue en travers de la chaussée.
Docile, je freine. Un chef en manches de chemise bleue, coiffé d’une casquette plate, s’approche. Il est blond, à frime carrée, avec un regard qui te filerait des coliques néphrétiques.
— Papiers !
Je porte la main à ma poche et pâlis. A la suite de ma baignade chez France, j’ai mis mes fafs à sécher dans le sous-main de l’écritoire de ma chambre et ils s’y trouvent encore.
— Je les ai oubliés à mon hôtel, réponds-je.
P. J. France se penche afin de se montrer au flic.
— Vous me reconnaissez, sergent ?
— Oh ! parfaitement, monsieur France, dit le flic.
— Je me porte garant de cet homme, c’est un ami.
— Je prends bonne note, monsieur France. Malgré tout, il est indispensable que je fasse le nécessaire et qu’il vienne jusqu’au poste volant, c’est à quinze cents mètres…
— Je vous trouve plutôt intraitable, sergent, déclare France avec humeur.
— Depuis l’élection du nouveau gouverneur, nous avons des ordres, répond l’autre, sans joie.
Et à moi :
— Deux de mes hommes vont vous escorter au poste, vous roulez derrière eux, compris ?
— O.K., soupiré-je, fataliste.
Pas tellement fâché dans le fond que France ait été vu en ma compagnie, ce soir. Peut-être que cet incident m’épargnera des désagréments plus cruels, par la suite, va-t’en savoir. Je crois dur comme Defferre aux bons agencements du hasard.
Le grand blond va jacter avec deux de ses guerriers, ceux-ci enfourchent leurs trottinettes et, poum ! on y va.
Au bout de cinq cent cinquante-six mètres virgule vingt, on oblique à droite dans une voie montante. Les motards m’ont pris en sandwich. Celui qui passe devant a éclairé une espèce de phare de recul dont la clarté m’éblouit, m’obligeant à conduire à trente à l’heure, les yeux plissés comme ceux d’une chouette qui voudrait faire de la télé.
— Quelle idée de sortir sans papiers ! grommelle P. J. France, maussade.
— Si vous ne m’aviez pas propulsé dans votre damnée piscaille l’autre jour, je les aurais sur moi, mais malgré mon séjour dans vos néons spéciaux, ils étaient encore humides lorsque je suis parvenu à mon hôtel.
Le barbu se tasse contre sa portière en souriant.
Alors, bon, que je te revienne à la situasse. Nous roulons quelques minutes encore. Le flic avant m’adresse un signe pour m’intimer de ralentir, lui-même stoppe. Je limite et l’imite.
Le phare de recul continue de me court-circuiter les vasistas. France descend de l’auto ainsi que son julot. Je m’apprête à en faire autant, mais le flic qui me filait se pointe dans l’encadrement.
— Ne bouge pas, petit drôle ! me lance-t-il d’un ton qui remplacerait ton congélateur s’il tombait en rideau.
Le canon de sa mitraillette de cérémonie pointe sur moi.
— Ben quoi ? je demande.
— Ta gueule !
Le sublime Sana pige illico qu’il l’a dans le prosper, enquillé d’une trentaine de centimètres au moins ! La grande feinte bioutifoule. Comment qu’on t’a possédé, bonne pomme de petit Françouze égaré dans la jungle texane. Ça, oui, c’est du beau boulot de professionnel.
Le rire de P. J. France se veut démoniaque. Il a baissé sa vitrine de son côté avant de descendre. Je reçois un seau d’eau dans le portrait de famille.
Horreur ! Il ne s’agit pas de flotte, mais d’essence.
Et alors je comprends que M. l’Antonio de ses belles deux va cramer comme des lettres d’amour après rupture. Une allumette et…
Je déguste un coup de goumi féroce sur le temporal, chaleureusement administré par le faux poulet à la mitraillette. M’estourbir, mettre la tuture en route en la braquant contre un arbre ou quelque précipice, puis, au dernier instant, l’allumette fatale. Mort accidentelle d’un touriste européen. De profundis !
Si j’ai le temps de penser ça, c’est que le coup porté n’a pas eu raison de ma raison, mon tagoniste agissant par l’encadrement d’une portière. Mais je dois faire comme si, absolument. Alors j’exhale un râle escamoté et m’abats sur la banquette.
Comme prévu, la lourde s’ouvre. Un « flic » s’avance, met le contact, puis enclenche le drive. Ensuite il sort de l’auto, referme la portière et use d’une longue branche pour appuyer sur l’accélérateur depuis l’extérieur. La Cadillac se met à avancer par saccades, parcourant deux ou trois mètres à chaque fois. Arbre ou précipice ? De toute manière cela va être pour bientôt, pour tout de suite. Le signal sera l’allumette qui m’embrassera et alors il sera trop tard.
J’attends la seconde pesée de la branche. Dès qu’elle se sera produite, il y aura une seconde de battement pour que le gonzier revienne se placer au niveau de la Cadillac. J’actionne la boîte à gants. Pourvu que sa serrure ne récalcitre pas. Mais non, c’est du pratique et ça fonctionne au quart de poil. Le petit panneau de faux bois s’abat. Ma main glaoupe à l’intérieur et chauffe le feu de la concorde qui y fut déposé par Mr. France en personne, le sympathique barbu des concerts san-antoniens. Mon pouce expert vérifie dans la foulée que le cran de sûreté n’est pas mis.
Mon tourmenteur enquille à nouveau sa branche. Feu au-dessus de l’épaule ! Il bascule recta, ploum ! Pierre lâchée ! Ses potes doivent croire dans l’immédiat qu’il a été déséquilibré par le tressaut de la voiture. Je biche la poignée de la porte, et, voyez caisse ! Un roulé-boulé, façon Azor.
Heureusement qu’il fait schwartz. Chose réjouissante, mes trois autres tagonistes sont en pleine luce, éclairés comme à l’avant-scène d’un théâtre par le phare de recul du premier motard.
— Les mains en l’air, tous les trois ! barris-je, ayant appris l’éléphant usuel lors d’un séjour dans l’Inde millénaire.
Au lieu d’obtempérer, le premier faux flic dégaine son feu. Fatale réaction. Je le plombe sobrement d’une seule bastos dans le cou. La jugulaire sectionnée, il s’écroule. Ce que voyant, P. J. France prend le funeste parti de courir.
— Stop ! j’ lu sommationne.
Mon cul. Tu peux toujours crier stop à un habitant de Saint-Pierre de la Martinique quand le volcan déconne.
Pour l’arrêter, je lui praline les cannes. Il s’en chope deux belles : une dans la cuisse gauche, l’autre dans le genou droit, et ça, crois-moi, c’est très très douloureux. Le voilà à plate bedaine dans la poussière, qui vagit sinistrement.
— Hello, mister Prenduron, lancé-je en m’avançant vers la petite femme à barbe de France ; seriez-vous le seul type raisonnable de ce quatuor ?
Car lui, il tient ses pattounes levées comme un saint-bernard qui fait le beau. N’ayant pas de sucre à lui refiler pour le récompenser, je me mets à lui flatter la croupe par-derrière. C’est pas la chose du vice, mais celle de la sécurité : il n’a pas d’arme.
— Voilà une belle soirée qui finit mal, lui dis-je ; la vie est pleine de « hélas », d’« aléas » et d’« alinéas ».
Tout en jactant, je continue de le braquer, et tout en le braquant, je considère les lieux. Nous nous trouvons sur une espèce d’entablement pelé qui surplombe une faille rocheuse. Le bruit d’un torrent me parvient, de très bas. Donc, ces garnements allaient bel et bien me virguler dans le vide.
L’ivresse de ma victoire éclair m’oxygène les soufflets. Putain, j’ai eu chaud aux plumes ! Mais quel retournement ! On ne me changera jamais, te dis-je. Je fais de nouveau face au mignon barbu.
— Va t’asseoir dans ma bagnole, fiston !
Il hésite.
Pour l’inciter à la soumission pleine et entière, je lui vote un coup de latte dans les mignonnes. Il râle de douleur et se plie en deux.
— Non, non, debout ! enjoins-je en le redressant d’un coup de genou sous le menton.
Cette fois, il obéit.
Au passage, je note que les deux motards sont positivement morts. Par acquit de ce que tu sais, je n’en rafle pas moins leur arsenal avec célérité.
Bon, maintenant, le jeune gros barbu est dans la chignole. On entend geindre son riche protecteur, non loin. Et puis les plaintes cessent parce qu’il s’est évanoui de souffrance.
— On est plus que nous deux, tu vois, chéri ? je fais à mon copain angora. Toi, assis dans cette bagnole ruisselante d’essence. Je gratte une allumette et tu t’illumines comme un gâteau d’anniversaire. Moi, dehors, bourré d’armes et de santé. Il me suffit de tirer une praline dans la banquette de la Cad’ pour que ça crame. Gras comme tu es, avec la paille d’emballage que tu trimbales au menton, tu es la proie rêvée pour les flammes. T’as jamais vu de zigs carbonisés à leur volant ? Moi, si. Ils deviennent grands comme des poupées.
Le chérubin grelotte de trouille abominable.
— Franchement, tu ne m’es pas sympa, je lui dis, mais ce n’est pas une raison pour abattre un mec, sinon la planète serait dépeuplée. Tu veux bien répondre loyalement à mes questions ?
Il acquiesce vivement.
— Attends ; par répondre, je sous-entends dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, nous sommes d’accord ?
— D’accord.
— O.K., je commence. Question facile, à dix dollars : pour le compte de qui travaille P. J. France ?
— Ça dépend.
— Ça dépend de quoi ?
— De qui le paie. Il fait partie d’un consortium important qui a des ramifications dans le monde entier.
— Consortium du Crime ?
— Comme vous y allez !
— Ne chipotons pas sur le vocabulaire, mon gros joufflu. Et d’ailleurs, là n’est pas la question. Tu es au courant de l’affaire Stone-Kiroul ? Ça, c’est une question à cent dollars.
— Un peu.
— Un peu beaucoup, j’espère… pour toi.
— Faut voir.
— Raconte !
— Raconter quoi ?
— Ce que tu sais ?
Le jeune barbu a une réaction du type béruréen, figure-toi que l’émotion lui a tracassé la ventraille et qu’il lâche un pet d’affolement pareil à une étoffe qu’on partage en deux.
— Ça, c’est une déclaration d’amour pour le père France, ricané-je. Je préfère que tu me répondes en américain. Alors, Stone-Kiroul ?
— Que voulez-vous savoir ?
— Rigoureusement tout, ma vieille contrebasse, tout, depuis son départ en avion jusqu’à la tombe de Stocky.
Le dodu à poils longs grattouille sa barbe floconneuse et contractuelle.
— Je ne sais que ce que je sais, fait-il modestement.
— Je l’aurais parié, réponds-je. Récite-le bien comme il faut et tu auras peut-être la moyenne. Toute note au-dessous de dix entraînerait la mise à feu de ton système pileux et de son support.
— Je crois savoir que le père de Stone-Kiroul était très ami avec Stocky, je ne me rappelle plus lequel avait sauvé la vie de l’autre, mais enfin des liens très forts les unissaient.
— Bon début, t’as le sens de la narration, fiston, continue sur ce ton et on fera relier ta thèse en peau de couilles.
L’enflé renifle. Il reprend confiance en son destin. Peut-être mijote-t-il une parade ? Ces grosses gonfles mollasses sont parfois capables de fâcheux sursauts. Il s’agit de le garder à l’œil.
— Stocky et Stone-Kiroul fils continuaient d’entretenir de bons rapports. Je vous raconte ce que j’ai cru comprendre à travers des conversations que P. J. a eues avec… différentes personnes.
— Ça me va parfaitement. Alors ?
— Récemment, ils se sont rencontrés à Helsinki, au cours d’un congrès sur les droits de je ne sais qui…
— De l’homme, probablement ; les hommes n’ont que le droit de faire des réunions pour affirmer leurs droits.
Je suis là, à le tartiner, lui faisant enfler le bulbe, au pauvre biquet, au lieu de le laisser poursuivre, moi qui pourtant ai une folle envie de savoir. Mais taquiner une envie rend son assouvissement plus jouissif.
— Au cours de ce voyage, Stocky a révélé à Stone-Kiroul que sa vie état en danger et qu’il était surveillé par une équipe de Jaunes.
— Avait-il l’explication de cette surveillance ?
— A l’époque où il sévissait à la Maison-Blanche, il s’occupait de l’Extrême-Orient.
— Il n’a rien dit de plus ?
Bébémou hausse ses épaules de déménageur gonflé au gaz de Lacq (mot capital au scrabble lorsque les noms propres sont acceptés).
— On ne connaît pas grand-chose de cette conversation, dit-il, juste ce que Stone-Kiroul en a dit aux Anglais d’abord, aux Russes ensuite.
— Mais encore, mon gros ?
— D’après ce que j’ai cru comprendre, cela concernerait un plan d’invasion générale de l’U.R.S.S. par la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Pakistan et je ne sais encore qui. Cette formidable opération est prévue à une date donnée et, en cas de réussite, devrait être poussée jusqu’en Europe.
— Les prédictions de Nostradamus, soupiré-je.
— Je ne connais pas ce journaliste, avoue humblement Barbabite, lequel possède plus de graisse que de culture.
Un instant de silence passe sur nous, comme une langue agile sur une tête de nœud ; bienfaisant, car il nous permet de mettre un peu d’ordre dans notre esprit et d’établir une juste connexion entre nos pensées et nos émotions, amen.
— Voyons, Pafensucre, réattaqué-je, Stocky possédait-il ce plan ou était-il simplement au courant de son existence ?
— Il a dit qu’il avait tout et que son infirmité lui servait de coffre-fort.
— Bien sûr, les Russes ont fait parler proprement Stone-Kiroul ?
— Vous pensez ! Il en a tellement dit qu’il a même dû en inventer. Seulement, pour les détails, il faudra vous adresser à eux, demander à P. J., moi, après tout, ces histoires-là…
— Oui, c’est pas ton oignon. Avec ce que tu as appris, quel que soit le peu d’intérêt que tu as marqué pour la chose, tu résumerais l’affaire de quelle manière ?
Il réfléchit. Son gros bide gargouille désespérément ; il n’a pas l’habitude des équipées nocturnes et l’heure de ses tartines de caviar est passée depuis lulure.
— Mon avis…, murmure-t-il. Mon avis…
Puis, inquiet :
— Il faudrait peut-être voir où en est P. J., non, vous l’avez salement touché.
— Te bile pas, Bill. Si tu deviens veuve, je parie que tu palperas un beau morceau du gâteau, mon petit doigt me dit que tu as su manipuler le gros lard pas seulement du bas et qu’il s’est occupé de ton avenir.
Il a un vilain sourire effronté qui en dit long comme le désespoir du patronat français sur ses « espérances » comme on disait dans les lieux jadis bourgeoisissants.
— Alors, ton résumé, ça vient ?
— Ecoutez, avec ce que je sais, en réfléchissant bien, je vois les choses comme ça : Stocky ramassait un pognon terrible en faisant chanter les Jaunes, ou un truc dans ce genre. Je suis certain qu’il tirait profit de son secret.
— Tu souilles sa mémoire, ma Grosse Zézette au miel !
— Ce qu’il en a à foutre maintenant ! ricane l’Obéseur, et de poursuivre : Russes et Britanniques ont eu partie liée dans ce coup-là.
Un bon point pour lui : ses conclusions rejoignent les miennes.
Il continue de sa voix un peu trop fluette pour son gabarit :
— Bien sûr que les Popofs et les Anglais se sont mis après Stocky pour lui arracher son secret.
— L’ont-ils obtenu ?
— Ça, ni France ni moi ne le savons.
— Après ?
— Qu’ils l’aient obtenu ou pas, ils ont décidé de monter tout un mimodrame pour feinter les Chinois.
— Dans quel but ?
— Les amener à croire, après moult péripéties, qu’ils avaient mis la main sur le fameux document.
— Dans quel but ? répété-je, la même question restant valable.
Le gros faisandé me défrime avec un brin d’insolence.
— Vous êtes flic ou quoi ? Dans quel but ! Mais pour les amener à annuler leur dispositif. Seulement, il a fallu organiser un tas de péripéties pour que la chose ait l’air vraie ; ils sont malins, les bougres, alors le cinéma qui leur a été monté devait impliquer mille rebondissements.
— Pour les amener à la tombe de Machin ?
— Evidemment. C’était l’acte final auquel ils sont arrivés après bien des incidences et fausses manœuvres.
— Le pied mécanique ?
— Juste. Il était vide. Mieux, ils ont pu constater que le corps, en tant que tel, avait été fouillé comme une malle. Donc, que tout espoir était perdu pour eux.
— En somme, l’accident de l’avion visait Stocky ?
— Affirmatif.
— Et il fallait qu’il se produise à l’aéroport de San Antonio pour que vous ayez le cadavre à disposition ? France est connu des troupes secrètes qui grenouillent de par notre miséreuse petite planète rabougrie. Les Jaunes ont pigé en voyant le cadavre dans cet état que l’équipe de Mr. France avait fait le nécessaire, au profit des Russo-Britanniques ?
— Je crois que ça cadre pile.
— Ultime point d’interrogation, les Russo-Britannouilles, comme tu dis, ont-ils mis, oui ou merde, la main sur le fameux plan ?
— Là, je vous répète que je l’ignore ; ce sont des trucs qu’on ne raconte pas dans les soirées mondaines.
Fatal laisser-aller de l’homme en méditance. Tout à « l’affaire », je me suis mentalement relâché, du point de vue prudence. J’ai laissé mon qui-vive au vestiaire. Et tu ne sais pas ?
Non, je te jure, assieds-toi, pose ta grolle qui fait tellement chier ton cor au pied et écoute.
Juste que j’erre dans le jardin touffu de mes pensées, voilà qu’une silhouette massive se dresse dans l’encadrement de la portière qui me fait face. Au moment où je l’avise, reconnaissant le visage décomposé de P. J. France, je note le canon de pistolet dirigé sur moi.
Et le temps, te dis-je, de comprendre, ça tonne à nouveau dans le petit Verdun texan. Quatre bastos lâchées dans les règles. Des belles, un peu pataudes, capables de traverser un blindage de char ou l’intelligence d’un contractuel. Plaoum ! Plaoum ! Plaoum ! Plaoum !
Je tombe à la renverse sous le coup de boutoir. Un choc de cinq cents kilogrammes à l’épaule, même un éléphant dresse l’oreille quand il morfle une bastos de cette envergure. Au sol, je me sens tout le côté gauche paralysé, étourdi.
Suis-je touché à mort ? Ces choses-là, il faut un instant pour en être informé. Tout de suite, l’impact te met K.-O., la gravité, ça se décide peu après. En tout cas je conserve, magnifiquement préservée, ma notion de la vie. Ainsi, je sais que la bagnole crame, que le barbu dodu hurle et s’enfuit en flammes sans avoir l’idée de se rouler par terre. Je sais que P. J. France, l’héroïque, ne va pas en rester là et qu’il va se traîner jusqu’à moi pour me filer le coup de grâce. S’il m’a à demi raté c’est parce que son minet placé entre nous le gênait. Donc, il me faut prendre les devants. Alors je me place dans une posture judicieuse et j’attends. La frime déshumanisée par la douleur du gros follingue ne tarde pas à apparaître de l’autre côté du brasier.
Ebloui et brûlé par les flammes proches, il ne peut me voir. Tu parles d’une cible !
Tentante. Mais l’Antonio, tu peux marcher derrière son écu : c’est toute la chevalerie françoise (ça, yes, mon pote !).
— Lâchez votre gun, France, ou je vous flashe ! hurlé-je.
Il repte un peu plus.
— Stoppez ! Placez vos mains nues en avant et ne bronchez plus ! lui intimé-je.
Tu parles d’un acharné. Au lieu d’obtempérer, il se remet à praliner en direction de ma voix, beaucoup trop à gauche, car j’ai eu la bonne idée de me rapprocher du second motard défunt.
Alors, quoi, merde, tant pis. Le vieux forban déguste sa potion d’infini. Deux prunes dans les favoris. Son petit ami achève de brûler comme du suif, au bord de la falaise.
Putain d’elle, quelle noye !
Je me remets debout en gémissant. Mon épaule gauche a dérouillé. J’ai la clavicule naze et il me manque deux cents grammes de bidoche dans la région en question.
Tu crois que je vais pouvoir piloter une moto dans cet état ?
Oui, puisque je suis San-Antonio !
COUP DU CIEL
— Non, non, ne t’agite pas, mon grand ! supplie M’man.
Elle caresse le dos de ma main valide.
— Tu fais de la température, m’explique-t-elle. Tu as trop attendu pour te faire soigner. Prendre l’avion avec une telle blessure, sans seulement la désinfecter, c’est de la folie !
— Je t’avais promis de rentrer ! lui dis-je.
— Le professeur Berjalien est tout à fait rassuré, tu pourras récupérer l’usage de ton bras.
— Je m’en servirai pour te serrer contre moi, ma chérie.
Elle continue, baissant le ton :
— J’aurais voulu qu’on te donne une chambre pour toi tout seul, mais « ils » sont complets. Je n’ai pu obtenir qu’une chambre à deux lits. Le monsieur d’à côté m’a l’air très gentil, un peu bavard, mais sympathique.
— C’est très bien comme ça, M’man.
Et là-dessus la porte s’ouvre. Tu devines sur qui ?
Oui : M. le directeur Alexandre-Benoît, superbe dans un pardingue en poil de chameau comme jamais je n’eusse cru qu’il en portasserait un jour.
Il s’avance, rasé de frais, la trogne luisante, sentant bon l’eau de Cologne. Un soûl neuf, quoi !
— Salut, mon cher, il me fait. En apprenant dont vous étiez rentré, et malgré les multiplicités d’occupations que je suis en saillie, j’ai tenu à viendre personnellement moi-même en personne vous serrer la main. J’ai ligoté l’rapport dont vous avez t’nu à écrire dans l’avion qui vous rentrait ; bien qu’ vot’ écriture branlasse au manche, j’tiens à vous féliciter. Qu’vous avez pu y voir clair dans ce tas de merde, sauf le respecte que j’doye à Maâme vot’ mère ci-gît présente, chapeau ! Faut s’incliner. J’vous cach’rai pas, le nez en moins, qu’a un truc qui m’chiffonne : c’est l’coup du plan. Croilliez-en ma solide espérience, j’sus convaincu qu’piersonne n’l’a trouvé. C’Stocky, y l’était marle. S’lon moi, s’il s’a confié à l’Hindou, c’est pas pour ses beaux yeux ni par amitié pour son dabe, mais parce que les Jaunes d’vaient s’ fatiguer d’ le nourrir grappefruit pour des os[9]. Il a voulu charogner en prenant contac av’c les Rouges. S’lement, de jaune et rouge, y a qu’ le drapeau espingo qu’il s’harmonisance, v’s’êtes bien d’accord ? Retour d’ manivelle. Slave dit, mon bon ami, si les jules de tous ces services secrets de mes fesses, sauf le respec que j’vous doye toujours, maâme Félicie, sont marron, v’s’auriez-t-il une idée d’ l’endroit qu’ce Stocky remisait l’document ?
Quand une longue phrase s’achève par un point d’interrogation, en général, ton interlocuteur se tait.
Ça ne rate pas. Je saute donc sur l’ouverture.
— Monsieur le directeur, articulé-je, quand j’ai eu rédigé, dans l’avion qui me ramenait, le rapport dont vous avez bien voulu prendre connaissance, avec votre bienveillance coutumière à laquelle je me plais à rendre hommage…
Des larmes perlent aux cils du Gros.
— Lorsque j’ai eu achevé ce rapport, donc, je me suis pratiquement évanoui. Et, dans ce semicoma, j’ai rêvé, ou continué de réfléchir, au choix… Et savez-vous ce que j’ai cru comprendre ?
— Disez, disez, mon cher, j’sus t’ici pour tout entendre.
— J’ai pensé que Stocky n’était pas homme à se séparer d’une chose aussi redoutable. Il devait pouvoir en disposer à tout moment, où qu’il se trouve.
— Vous écrivez dans vot’ rapport qu’ son cadav’ a été découpé en rondelles, vidé, mise en charpine. V’n’allez pas prétend’ qu’un gus comme lui s’baladait avec l’documentaire dans son portefeuille ? Son panard mécanique, ça oui, c’tait la bonne planque.
Je fais signe au Mastar d’approcher son oreille, biscotte mon voisin de chambre, que je n’ai pas encore aperçu, et qui écoute les informes de merde sur son transistor, de l’autre côté du paravent (chinois ?) qui nous sépare.
— Dans quelque temps, Gros, lorsque tout se sera tassé, envoie une équipe clandestine au cimetière de Fort Makabee ; qu’on rouvre une fois de plus la tombe de Stocky, et qu’on lui rase les tifs au double zéro. Si quelque chose est tatoué sur son crâne mis à nu, qu’on le photographie !
M. le directeur ne pense pas à se formaliser de mon tutoiement, lui-même l’utilise pour chuchoter.
— Tu crois que ?
— C’est le seul endroit de sa personne qui n’a pas été exploré. Et j’ai remarqué qu’il avait les cheveux en brosse et qu’il se les teignait, tu piges ?
Le Mammouth se redresse, appuie deux doigts conjureurs sur mon front brûlant.
— Sognez-vous bien, mon cher, sognez-vous bien, contenu de vos capacités, on f’ra probab’ment d’vous un chef d’la Criminelle.
— Non, merci, monsieur le directeur, j’aime trop le grand air et pas assez la poussière des intrigues pour accepter une telle promotion.
L’Enorme se retire, pincé.
Mon voisin de chambrée tousse. Son sommier grince, imite la gamme. Il décide à mi-voix d’aller pisser. Se lève en ahanant et sort de derrière son paravent.
Qui vois-je surgir ? Je te le dis ? Oui, puisque c’est la fin. Rameau ! Jean Rameau !
Sa surprise s’aligne sur la mienne. On se considère un bout, puis, en même temps, on déclare :
— Ça alors !
Après quoi, on ajoute :
— Mais caisse vous faites z’ici ?
Je le laisse répondre le first.
— A l’hôpital de Lausanne, j’étais comme un coq en plâtre, service soigné, hygiène totale, seulement il y a eu une nouvelle infirmière un beau matin, une Jaune. J’ai pris les chocottes et me suis sauvé. Le milieu hospitalier français ne vaut peut-être pas l’helvétique au niveau du service après-vente, mais ici je me sens davantage en sécurité, et puis je bénéficie précisément de la sécurité. Ce qui me frappe, c’est la charge que je représente pour cet organisme. Rendez-vous compte.
Déjà, il lève un doigt pour entreprendre une longue énumération de ce que son existence dévore à la pauvre Société efflanquée où nous nous débattons. Mais il se ravise.
— Et puis non, on fera l’inventaire après, d’abord, il faut que j’aille uriner. Ce n’est pas de gaieté de cœur, croyez-moi : vous vous rendez compte, tous ces décilitres de sous-produits perdus ! Au prix où est l’engrais !