|
|
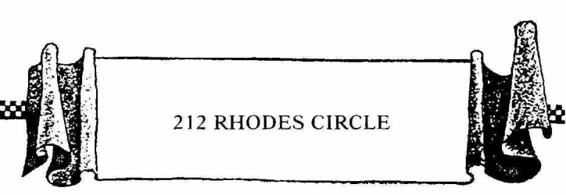
BIRMINGHAM,
ALABAMA
5 janvier 1986
Réfugiée dans la petite pièce où elle faisait ses travaux de couture, Evelyn Couch entama un deuxième carton de glace aux pépites de chocolat de chez Baskin-Robbins en contemplant d’un œil éteint sa table sur laquelle s’empilaient les motifs de broderie qu’elle n'avait pas touchés depuis le jour où elle les avait achetés dans un accès de bonnes intentions. Ed suivait un match de football à la télé et elle ne s’en plaignait pas, car depuis quelque temps, à chaque fois qu’il la voyait consommer une sucrerie, il lui demandait, faussement étonné : « Ça fait partie de ton régime amaigrissant ? »
Elle avait menti au vendeur de chez Baskin-Robbins, prétendant qu’elle donnait une fête pour ses petits-enfants. Elle n’avait même pas de petits-enfants.
A quarante-huit ans, Evelyn avait le sentiment de s’être perdue quelque part en route.
Tout avait changé si vite. Pendant qu’elle élevait les deux enfants requis — «un garçon pour lui, une fille pour moi» —, le monde était devenu un lieu qui lui était totalement étranger.
Elle ne comprenait plus les histoires drôles. Elle les trouvait cruelles, et elle était choquée par leur grossièreté. A son âge, elle n’avait encore jamais osé aller au-delà d’un «zut» ou d’un «flûte» pour se défouler. A la télé, elle ne regardait plus que des vieux films et des rediffusions du Lucy Show. Pendant la guerre du Viêt-Nam, elle avait cru ce que lui avait dit Ed, que c’était une guerre juste et nécessaire, et que tous ceux qui disaient le contraire étaient des communistes. Et puis, bien plus tard, quand elle comprit enfin que cette guerre n’avait peut-être pas été aussi juste que ça, Jane Fonda avait depuis longtemps abandonné les grandes idées pour l’aérobic, et plus personne ne se souciait de ce que pouvait penser Evelyn du Viêt-Nam. Elle éprouvait à l’égard de l’ex-pasionaria du pacifisme un ressentiment certain et souhaitait que disparaissent enfin du petit écran le tricotis inlassable de ses guibolles tout en galbe et fitness et ses contorsions de poupée Barbie.
Ce n’était pourtant pas faute d’avoir essayé de donner un sens à sa vie. Elle s’était efforcée d’éveiller la sensibilité de son fils, mais Ed lui avait fichu la frousse en lui disant qu’elle ne réussirait qu’à en faire une mauviette, voire une «tantouse». Son fils lui avait ainsi échappé au point que, même à présent, il lui était presque étranger.
Idem avec sa fille, Janice. A quinze ans, la gamine en savait plus en matière de sexe qu’Evelyn n’en saurait jamais.
Du temps où elle faisait ses études, les choses lui avaient paru si simples. Il y avait les filles sages et les dévergondées, et chacun savait qui était qui. On était soit de l’un, soit de l’autre groupe. Evelyn avait fait partie du premier, et elle n’avait jamais connu le nom d’une seule fille ou d’un seul garçon appartenant au second. Ses copines ne portaient pas de minijupes au ras des fesses, et ses copains n’avaient pas de jeans moulants comme des capotes anglaises. Dans son entourage, les jupes descendaient jusqu’aux mollets, quand ce n’était pas plus bas, et la largeur des falzars garantissait le quasi-secret aux érections garçonnières. Quand on se réunissait entre copines, on fumait une Kent, une seule. Aux bals, on se permettait une seule bière, et tout pelotage était interdit en dessous du cou.
Plus tard, le jour où elle accompagna chez le gynécologue sa fille qui voulait se faire poser un diaphragme, ce fut elle qui rougit. Pour en faire autant, elle avait attendu la veille de ses noces.
Et quel choc! Personne ne lui avait dit que le sexe serait aussi douloureux. Elle n’aimait toujours pas ça. Chaque fois qu’elle se laissait aller, l’image de la mauvaise fille jaillissait dans sa tête comme un diable de sa boîte.
Oui, elle avait été une jeune fille sage, s’était toujours tenue comme une dame, n'avait jamais élevé la voix, avait toujours respecté tout le monde et toutes choses. Elle avait vaguement espéré que tôt ou tard elle en recevrait quelque récompense. Mais nenni, elle n’en avait pas encore vu la queue d’une. Quand sa fille lui avait demandé si elle avait déjà « baisé » avec un autre homme que son cher époux et qu’elle avait répondu que «non, bien sûr que non», elle s’était entendu répondre: «Oh, M’man, comment peut-on être aussi gourde ! Tu ne sais donc pas si P’pa est un "bon coup” ou pas. C’est terrible. »
C’était vrai : elle ne le savait pas.
Elle avait tout de même fini par comprendre que ça ne comptait guère qu’on soit une bonne ou une mauvaise fille. Les filles qui, au lycée, étaient allées «jusqu’au bout» n’avaient pas sombré dans la déchéance, elles n’arpentaient pas le macadam en jupes fendues, ainsi qu’Evelyn l’avait pensé. Elles étaient comme les autres : mariées et heureuses ou malheureuses en ménage. Ainsi avaient été vains tous ces efforts pour rester une jeune fille pure, et bien mal fondée cette peur d’être touchée, cette peur qu’un geste, une parole n’allume la passion d’un garçon, cette peur surtout de se faire engrosser. Aujourd’hui, les stars de cinéma avaient des enfants à la pelle hors du mariage et elles les prénommaient Rayon de Lune ou Plume de Soleil !
Et quel profit avait-elle tiré de la sobriété? Elle avait toujours entendu dire qu’il n’y avait rien de pire qu’une femme ivre, et elle n’avait jamais fait que tremper les lèvres dans un verre de whisky coupé d’eau. Aujourd’hui, les femmes les plus célèbres faisaient régulièrement une cure de désintoxication dans les centres de Betty Ford, se faisaient tirer le portrait en entrant et en sortant, et célébraient la fin de leur séjour par de grandes fêtes copieusement arrosées. Evelyn se demandait souvent si Betty Ford acceptait les femmes uniquement désireuses de perdre quinze kilos de «surcharge pondérale».
Sa fille lui avait fait tirer une bouffée d’un joint de marijuana, mais dès que ses gants de ménage sur le comptoir de sa cuisine s’étaient mis à ramper dans sa direction, elle s’était jetée sur le tube de Valium et s’était bien gardée de renouveler l’expérience. Exit la drogue.
Quand, près de dix ans plus tôt, Ed avait eu une liaison avec l’une de ses collègues à la compagnie d’assurances, Evelyn avait, dans le but de sauver son ménage, adhéré à un groupe appelé « La Femme Parfaite». Elle n’était pas sûre de beaucoup aimer Ed, mais elle tenait suffisamment à lui pour ne pas avoir envie de le perdre. Et puis, que ferait-elle seule? Elle avait vécu avec lui aussi longtemps qu’avec ses propres parents. Le credo de La Femme Parfaite affirmait que celle-ci ne trouverait le bonheur avec son homme qu’à la seule condition de consacrer sa vie entière à rendre ce dernier heureux.
La meneuse du groupe leur avait affirmé que toutes ces femmes riches ou ces battantes qui menaient de brillantes carrières et paraissaient tellement épanouies et heureuses étaient en réalité fort seules et misérables et enviaient secrètement les humbles épouses et autres femmes au foyer.
Evelyn avait du mal à concevoir qu’une Barbara Walters puisse tout abandonner pour un Ed Couch, mais elle n’en essaya pas moins de se conformer au petit livre de La Femme Parfaite. Et puis l’apôtre saint Paul lui-même n’avait-il pas dit que la grandeur de l’épouse tenait dans l’humilité qu’elle mettait à servir son compagnon ?
Aussi fut-ce toute gonflée de l’espoir d’être sur le bon chemin qu’elle entreprit de gravir les Dix Etapes du Bonheur Parfait. A la première étape, elle accueillit Ed à la porte d’entrée... nue sous un châle indien. De toute la personne d’Ed, seuls ses cheveux se dressèrent. Il se hâta d’entrer et claqua la porte derrière lui. « Nom de Dieu, Evelyn, où as-tu la tête ? Ça aurait pu être le facteur ! »
Elle n’eut pas plus de succès avec la Deuxième Etape, qui consistait à se rendre au bureau d’Ed, affublée comme une prostituée.
L’expérience s’arrêta là, car la meneuse du groupe, Nadine Fingerhutt, dut divorcer et chercher un emploi, et personne n’eut l’audace de la remplacer. Et puis, au bout de quelque temps, Ed rompit avec cette femme, et le calme revint dans le ménage des Couch.
Après quoi, cependant, toujours en quête d’un sens à sa vie, Evelyn tâta du C.C.F., le Centre Communautaire Féminin. Elle aimait bien les idées qu’on y développait mais elle aurait aimé que ses compagnes de lutte utilisent un peu de rouge à lèvres et s’épilent les jambes. Elle était la seule à être fardée et à ne pas avoir le mollet poilu comme un primate. Elle aurait bien aimé rester au C.C.F. mais, quand il fut question que la semaine suivante elles apportent un miroir afin d’étudier leurs vagins, elle abandonna illico.
Ed déclara à cette occasion que ces femmes n’étaient qu'une bande de frustrées et de laiderons, de vrais repoussoirs. Ainsi demeura Evelyn, ennuyée par les réunions Tupperware, et trop peureuse pour plonger les yeux dans son vagin.
Le soir où Ed et elle se rendirent à la trentième réunion annuelle des anciens élèves du lycée, elle avait espéré trouver quelqu’un à qui parler de tout ça. Mais les autres femmes s’avérèrent tout aussi confuses et perplexes qu’elle-même; elles s’accrochaient aux bras de leurs époux et à leurs verres comme si leur existence même avait dépendu de ces deux appuis. Leur génération semblait parquée dans un enclos, incapable de se décider à sauter la barrière.
Après cette réunion, il lui arriva de rester des heures devant des photos de sa jeunesse. Ou bien, prenant la voiture, elle allait voir et revoir tous les endroits qu’elle avait pu fréquenter.
Ed ne lui était d’aucune aide. Dernièrement, il s’était mis à ressembler de plus en plus à son père, se conformant à l’idée qu’il se faisait du maître de maison idéal. Avec les années, il devenait cependant renfermé, et le samedi il s’en allait seul se balader pendant des heures au C.A.H., le Centre d’Amélioration de l’Habitat, sans savoir ce qu’il y cherchait. Il chassait, péchait, regardait le foot à la télé comme le faisaient les autres hommes, mais Evelyn le soupçonnait maintenant de jouer lui aussi un rôle.
Elle contempla le carton de glace vide et se demanda où était passée la jeune fille qui souriait sur les photos.